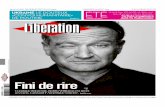DEFINITON DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Transcript of DEFINITON DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
DEFINITON DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Expression de JEAN PICTET, le CICR définit le DIH comme l’ensembledes règles internationales d’origine conventionnelle ou coutumière,qui sont spécialement destinés à régler les problèmes humanitairesdécoulant directement des conflits armés internationaux ou non, etrestreignent pour des raisons pour des raisons humanitaires, ledroit des parties aux conflits d’utiliser les méthodes et moyens deguerre de leur choix ou protègent les personnes et les biensaffectés ou pouvant être affectés par le conflits.(Éric David ; principe de Droit des Conflits Armés)Le droit desconflits armés est un droit simple, un peu de bon sens et un minimumde générosité permettent à n’importe qui d’en découvrir pas soi-mêmeles règles de base sans être juriste patenté ou avertit. D’ailleursen simplifiant à l’extrême, ces règles peuvent se résumer en 4préceptes :
Ne pas attaquer les non combattants Ne pas attaquer les combattants n’importe comment Traiter humainement les personnes en son pouvoir Protéger les victimes
LA CLAUSE MARTENS
La clause de Martens est une disposition des traités de droithumanitaire qui revêt une importance potentielle considérable maisqui donne lieu à des interprétations très différentes. Inscrite àl'origine dans le préambule de la Convention (IV) de La Haye de1899 et de 1907, elle a été insérée par la suite dans le corps duProtocole additionnel I en son article 2 de 1977 et dans lepréambule alinéa 5 du Protocole additionnel II. Cette clausestipule que si un cas donné n'est pas prévu par les traitésexistants, les combattants « restent sous la sauvegarde et sousl'empire » du droit coutumier, des principes de l'humanité et desexigences de la conscience publique.
On a longuement débattu de la question de savoir si les «principes de l'humanité » et les « exigences de la consciencepublique » étaient des critères distincts et juridiquementcontraignants pour évaluer objectivement en droit une arme ou uncomportement, ou s'il s'agissait plutôt de principes moraux. Ilest très important que la Cour ait affirmé la pertinence de laclause de Martens, « qui continue indubitablement d'exister etd'être applicable », et qu'elle ait déclaré qu'elle « s'estrévélée être un moyen efficace pour faire face à l'évolution
1 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
rapide des techniques militaires ». C'est sur cette base que laCour a considéré que les principes fondamentaux du droithumanitaire continuaient à s'appliquer à toutes les armesnouvelles, y compris les armes nucléaires, soulignant en outrequ'aucun État ne contestait ce point de vue.
Le juge Shahabuddeen est allé plus loin dans l'analyse. Ilconsidère que la clause de Martens ne se limite pas à affirmer ledroit coutumier — ce qui serait superflu –, mais qu'elle autorisebel et bien à considérer les principes de l'humanité et lesexigences de la conscience publique comme des principes du droitinternational devant être définis à la lumière de l'évolution.
Le juge cite à l'appui le jugement rendu en 1948 dansl'affaire Krupp par le tribunal militaire des États-Unis, siégeantà Nuremberg, qui affirme que la clause de Martens« est bien plusqu'une pieuse déclaration. C'est une clause générale, qui érigeles usages établis entre les nations civilisées, les lois del'humanité et les exigences de la conscience publique en uncritère juridique à appliquer dans l'hypothèse où les dispositionsspécifiques de la Convention (...) ne couvriraient pas certainscas (...) ».
DISTINCTION CIVILS COMBATTANTS DANS LES CONFLITS ARMESINTERNATIONAUX
Nils Mezler : Aux fins du principe de distinction dans lesconflits armés internationaux, toutes les personnes qui ne sont nimembres des forces armées d’une partie au conflit ni desparticipants à une levée de masse sont des personnes civiles, etelles ont donc droit à la protection contre les attaques directes,sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant ladurée de cette participation.
DISTINCTION CIVILS COMBATTANTS DANS LES CONFLITS ARMES NONINTERNATIONAUX
Nils Mezler : Aux fins du principe de distinction dans les conflitsarmés non internationaux, toutes les personnes qui ne sont nimembres des forces armées d’un Etat ou de groupes armées organisésd’une partie au conflit sont des personnes civiles, et elles ontdonc droit à la protection contre les attaques directes, sauf s’ilelles participent directement aux hostilités et pendant la durée decette participation. Dans les conflits armés non internationaux, lesgroupes armés organisés d’une partie non étatique au conflit et ne
2 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
se composent que des personnes ayant pour fonction continue departiciper directement aux hostilités.
PRECAUTIONS ET PRESOMPTION DANS LES SITUATIONS DE DOUTE
Toutes les précautions pratiques possibles doivent être prises aumoment de déterminer si une personne est une personne civile, et encas, si cette personne civile participe directement aux hostilités.En cas de doute, la personne doit être protégée contre les attaquesdirectes.
Combattant : le privilège de combattant à savoir le droit departiciper directement aux hostilités en bénéficiant de l’immunitécontre les poursuites judiciaires en vertu de la législationnationale pour des actes de guerre licite, n’est conféré qu’auxparticipants à une levée de masse.
DEFINITION DE CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX
Au regard de l’art 2 aux 4 conventions de Genève du 12 Aout1949, celles-ci s’applique en cas de guerre déclaré ou tousautres conflits surgissant entre deux ou plusieurs autresparties contractantes.
Il ressort de cette disposition que tous différents surgissantentre deux Etats et provoquant l’intervention des forces armésest un conflit armés international comme le précise lecommentaire de Jean Pictet et D. Chindler dans l’article « thedifférents types of arms conflits to the general conviction » .
Une telle disposition a trouvé échos dans la jurisprudence duTPIY en l’occurrence dans l’affaire Dusko Tadic rendu le 02octobre 1995, elle énonce : « il existe conflits armésinternational chaque fois qu’il y a recours à la force entreEtats ».
la CPI dans l’affaire J.P Bemba du 15 juin 2009 précise qu’ilya conflits armés international lorsque les hostilités ouvertesentre les Etats avec leurs armées respectives.
Donc le droit applicable n’est rien d’autre que le Droitinternational Humanitaire ces CAI.Les conventions de la Haye, les quatre conventions de Genève leprotocole additionnel 1, et le DIH coutumier.
3 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
DEFINITION DE CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX
1. Aux termes de l’article 1 paragraphe 1 du protocole II de 1977relatif à la protection de civils dans les conflits armés noninternationaux « un conflit international non international estun conflit armé qui se déroule sur le territoire d’une HautePartie Contractante entre ses forces armées et des forcesarmées dissidentes ou de groupes armés organisés qui sous lecommandement responsable, exercent sur une partie de sonterritoire tel qu’il leur permettre de mener des opérationsmilitaires continues et concertées et d’appliquer les lois etcoutumes de la Guerre ».
2. Le statut de la CPI tel qu’amendé le 29 novembre 2010 énonce enson article 8 paragraphe 2.f conflit armé non internationalest un conflit qui opposent de manière prolongée sur leterritoire d'un État les autorités du gouvernement de cet Étatet des groupes armés organisés ou des groupes armés organisésentre eux.
3. Cette définition a trouvé échos dans une foisonnante dejurisprudences. Dans l’affaire le procureur contre Dusko TADICdu 02 octobre 1995, le TPIY énonce de façon claire unedéfinition largement acceptée. « il y a conflit armé noninternational lorsqu’il y a recours à la force armé entre Etatset des groupes armés organisés. Encore plus, dans les affairesFatmirLimaj et RamushHaradinaj et consorts respectivement du30 novembre 2005 et de 3 avril 2008 au paragraphe 84 énonce lamême définition
4. La doctrine quant à elle n’est pas resté en marge. Yves Sandoz,Swinaski, Zimmerman dans leur commentaire de l’article 1 duprotocole 2 affirme qu’il existe conflit armé internationalchaque qu’il y a opposition sur le territoire d’un Etat entreles groupes armés gouvernementales et les groupes armésorganisés.
DEFINITION DE CONFLITS ARMES INTERNATIONALISES
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), AffaireTadic, Arrêt du 15 juillet 1999, par. 84 : ≪ Il est indéniablequ’un conflit arme est de caractère international s’il oppose deux
4 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
ou plusieurs Etats. De plus, un conflit arme interne qui éclatesur le territoire d’un Etat peut devenir international (ou, selonles circonstances, présenter parallèlement un caractèreinternational) si i) les troupes d’un autre Etat interviennentdans le conflit ou encore, si ii) certains participants au conflitarmé interne agissent au nom de cet autre Etat. ≫
DEFINITION DE GROUPES ARMES ORGANISES
1. De la définition du conflit armé non international, l’article1 du protocole II en son paragraphe 1 définit deux critèrespour caractériser et définir un groupe armés organisés : uncritère organique et un critère d’intensité. Ces deuxcritères ont été réaffirmée par la jurisprudence du TPIY dansl’affaire procureur c/ Limaj, et il précise que« pour que leDIH puissent trouver application, deux critères déterminantesdoivent être dégagé : l’intensité du conflit et le niveaud’organisation du groupe armé.
Qu’entend-on par Intensité de Conflit ?
2. Le TPIY dans l’affaire Ramush établit de manièresymptomatique plusieurs indicateurs quantitatifs dont lecalibre et les armes utilisées ; le nombre de victimes ; lenombre de déplacé ; l’ampleur de la destruction ;l’engagement du conseil de sécuritéetc.
Quid du critère d’organisation ?
3. L’article 1.1 du protocole II précise que le groupe armé doitêtre organisé. Ainsi 4 critères doivent être cumulativementremplies et respectées :
Soumis à un commandement responsable A des règles disciplinaires en permettant de respecter
les lois et coutumes de la guerre Exercer un contrôle sur une partie du conflit Avoir la capacité de conduire et de mener des actions
militaires concertées et continues
4. Il ne suffit pourtant pas de prouver qu’un conflit violent aatteint un certain d’intensité pour que le DIH s’applique. Ilfaut démontrer en outre l’organisation criminelle ou la base
5 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
constitue un groupe armé organisé. Selon le TPIY procureur c/RamushHaradinaj et consorts, cette entité se caractérisepar :
L’existence d’une structure de commandement, derègles de disciplines et d’instance disciplinaire ausein du groupe ; d’un quartier général ;
le fait que le groupe contrôle un territoiredélimité ;
la capacité qu’à le groupe de se procurer des armeset autres équipement militaires ; de recruter et dedonner une instruction militaire ; la capacité deplanifier ; de coordonner et de mener des opérationsmilitaires, notamment d’effectuer des mouvement detroupes et d’assurer un soutien logistique ; lacapacité de définir une stratégie militaire uniqueet d’user de tactiques militaires ; et la capacitéde s’exprimer d’une seule voie et de conclure desaccords comme des accords de cessez-le feu ou depaix ».
5. J.Pictet, Zimmerman et Swinaski, dans leur commentaire auxprotocoles ont mentionné ces critères mais a précisé qu’iln’est pas besoin que le groupe armé présente desressemblances structurelles avec les forces armées pourvu quel’organisation soit suffisante.
LE PRINCIPE DE DISTINCTION EN DIH
Entre civils et combattants
Règle 1. – Les parties au conflit doivent en tout temps faire ladistinction entre civils et combattants. Les attaques ne peuventêtre dirigées que contre des combattants. Les attaques ne doiventpas être dirigées contre des civils.
1. Le principe de la distinction entre civils et combattants a étéformulé pour la première fois dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg dans préambule, qui dispose que «le seul but légitime
6 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
que les États doivent se proposer durant la guerre estl’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi».
2. Le Règlement de La Haye ne spécifie pas littéralement qu’unedistinction doit être établie entre civils et combattants, mais sonarticle 25, qui interdit «d’attaquer ou de bombarder, par quelquemoyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtimentsqui ne sont pas défendus».
3. Le principe de la distinction est maintenant codifié dans lesarticles 48, 51, paragraphe 2 et 52, paragraphe 2 du Protocoleadditionnel I.
4. L’interdiction des attaques visant les civils figure aussi dans leProtocole II, le Protocole II article 3 paragraphe 7 tel que modifiéet le Protocole III article 2 paragraphe 1 à la Convention sur lesarmes classiques article 3 paragraphe 2, ainsi que dans laConventiond’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnelpréambule 3.
5. En outre, aux termes du Statut de la Cour pénale internationale, «lefait de lancer des attaques délibérées contre la population civileen général ou contre des civils qui ne prennent pas directement partaux hostilités» constitue un crime de guerre lorsqu’un tel acte estcommis dans un conflit armé international.
6. Dans l’affaire procureur c/ Omar Kassem et autres, en 1969, leTribunal militaire israélien siégeant à Ramallah a reconnu que leprincipe selon lequel les civils ne devaient pas faire l’objetd’attaques directes était l’une des règles fondamentales du droitinternational humanitaire.
7. Dans son avis consultatif relatif à l’affaire des Armes nucléaires,la CIJ a déclaré que le principe de la distinction était l’un des«principes cardinaux» du droit international humanitaire et l’un des«principes intransgressibles du droit international coutumier».
8. L’article 13, paragraphe 2 du Protocole additionnel II interdit quela population civile en tant que telle, ainsi que les personnesciviles, ne soient l’objet d’attaques.
7 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
9. La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1965, asolennellement déclaré que tout gouvernement et toute autre autoritéayant la responsabilité de mener des combats lors de conflits armésdevraient respecter l’interdiction des attaques contre la populationcivile résolution. XXVIII
10. La jurisprudence de la Cour internationale de justice, dansl’affaire des Armes nucléaires, du Tribunal pénal international pourl’ex-Yougoslavie, en particulier dans les affaires Tadić, MartićetKupreškić, et de la Commission interaméricaine des droits de l’hommedans l’affaire relative aux faits survenus à La Tablada en Argentineapporte des preuves supplémentaires du fait que l’obligationd’opérer une distinction entre les personnes civiles et lescombattants est une règle coutumière, dans les conflits armésinternationaux et non internationaux.
La distinction entre les biens de caractère civil et les objectifsmilitaires
Règle 7. – Les parties au conflit doivent en tout temps faire ladistinction entre les biens de caractère civil et les objectifsmilitaires. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre desobjectifs militaires. Les attaques ne doivent pas être dirigéescontre des biens de caractère civil.
1. Cette règle est formulée dans les articles 48 et 52, paragraphe 2 duProtocole additionnel I dans les conflits armés internationaux.
2. Le Statut de la Cour pénale internationale, «le fait de lancer desattaques délibérées contre des biens civils, c’est-à-dire des biensqui ne sont pas des objectifs militaires» constitue un crime deguerre dans les conflits armés internationaux article 8, paragraphe2.
3. Dans son avis consultatif, la Cour dans l’affaire des armesnucléaires a déclaré que le principe de la distinction était l’undes «principes cardinaux » du droit international humanitaire, etl’un des «principes intransgressibles du droit internationalcoutumier».
4. La jurisprudence de la Cour internationale de justice affairesnucléaires et du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslaviedans les affaires , affaires Le Procureur c. Zoran Kupreškićet
8 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
consorts, jugement, et Le Procureur c. Dario Kordić et Mario Cerkez,décision relative à la requête conjointe de la défense et jugementfournit des éléments de preuve supplémentaires de la naturecoutumière de l’interdiction des attaques contre les biens decaractère civil dans les conflits armés, tant internationaux que noninternationaux.
5. « Les attaques sans discrimination sont interdites » Protocoleadditionnel 1 article 51.
LE PRINCIPE PROPORTIONNALITÉ DANS L’ATTAQUE
Règle 14. – Il est interdit de lancer des attaques dont on peutattendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humainesdans la population civile, des blessures aux personnes civiles, desdommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de cespertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantagemilitaire concret et direct attendu.
1. Le principe de la proportionnalité dans l’attaque est formulé àl’article 51, paragraphe 5 b) du Protocole additionnel I, et répétéà l’article 57.
2. En outre, aux termes du Statut de la Cour pénale internationale, «lefait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causeraincidemment des pertes en vies humaines ou des blessures parmi lapopulation civile, des dommages aux biens de caractère civil (…) quiseraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble del’avantage militaire concret et direct attendu» constitue un crimede guerre dans les conflits armés internationaux.
3. Dans son avis consultatif sur l’affaire les armes nucléaires reconnuque «le respect de l’environnement est l’un des éléments quipermettent de juger si une action est conforme aux principes denécessité et de proportionnalité».
4. De nombreux États se sont dotés d’une législation aux termes delaquelle toute violation du principe de la proportionnalité dansl’attaque, dans un conflit armé de quelque type que ce soit,constitue une infraction. Dans l’affaire de la Junte militaire en1985, la Cour d’appel nationale d’Argentine a jugé que le principede la proportionnalité dans l’attaque faisait partie du droitinternational coutumier.
9 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
5. TPIY, affaires Le Procureur c. Milan Martic, examen de l’acted’accusation et Le Procureur c. Zoran Kupreškić et consorts,jugement Commission interaméricaine des droits de l’homme, Thirdreport on humanrights in Colombia ont fait de cette règle deproportionnalité une rège importante que toute bonne conduite deshostilités exigent l’observation de cette règle de proportionnalité.L’inobservation de cette règle du jus cogens constitue uneinfraction grave.
LE PRINCIPE DE PRECAUTION DANS LES ATTAQUES
Règle 15. – Les opérations militaires doivent être conduites enveillant constamment à épargner la population civile, les personnesciviles et les biens de caractère civil. Toutes les précautionspratiquement possibles doivent être prises en vue d’éviter et, entout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans lapopulation civile, les blessures aux personnes civiles et lesdommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causésincidemment.
Principe de précaution : ensemble des règles à respecter en prévision demaux possibles, de dangers vraisemblables.
L’obligation de veiller constamment à éviter ou à réduire au minimumles pertes en vies humaines dans la population civile, ou à prendredes précautions à cet égard, est inscrite dans un nombreconsidérable d’instruments pertinents.
1. l’article 13, paragraphe 1 exige que «la population civile et lespersonnes civiles jouissent d’une protection générale contre lesdangers résultant d’opérations militaires», et il serait difficilede satisfaire à cette exigence sans prendre des précautions lors desattaques. Protocole II article 13.1.
2. En outre, dans une résolution adoptée en 1970 énonçant les principesfondamentaux touchant la protection des populations civiles enpériode de conflit armé, l’Assemblée générale a exigé que «dans laconduite des opérations militaires, tous efforts [soient] faits pourépargner aux populations civiles les ravages de la guerre, et toutesprécautions nécessaires [soient] prises pour éviter d’infliger desblessures, pertes ou dommages aux populations civiles».
10 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
3. Dans l’affaire Kupreškić, le Tribunal a jugé que l’exigence deprendre des précautions dans l’attaque faisait partie du droitinternational coutumier, car elle précisait et étoffait des normes.
4. générales antérieures. Le Tribunal s’est aussi fondé sur le fait quecette règle n’a été contestée par aucun État.
LES ARMES
Les interdictions relatives à des armes, moyens et méthodes spécifiques sont contenues dans un certain nombre de traités dont :
La convention d’interdiction des armes biologiques de 1972La convention sur l’interdiction d’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles de 1972La convention des NU de 19800 sur les armes classiques de 1980 dont le :Le protocole 1 sur les armes à éclats non localisableLe protocole 2 sur les mines et pièges et autres dispositifs (explosives conçus pour tirer ou blesser, de déclencher soit à la main, soit à distance).Le protocole 3 sur les armes incendiairesProtocole 4 sur les armes à laser aveuglantes conçu pour causer la cécitépermanenteLe protocole 5 sur les restes explosifsConvention de l’Ottawa sur l’interdiction des mines anti personnelles de 1997Deux critères permettent de considérer que les mines antipersonnel sont des armes frappant sans discrimination : premièrement, elles ne peuvent viser réellement des objectifs militaires, puisqu'elles sont placées à l'avance dans l'hypothèse que des combattants pourraient passer par là ; deuxièmement, elles ont souvent des effets imprévus, tout spécialement lorsqu'elles quittent leur emplacement original en raison des conditions météorologiques.Convention sur les armes chimiques de 1980
Règle 70. – Il est interdit d’employer des moyens ou des méthodes deguerre de nature à causer des maux superflus.
1. Protocole 1 article 35.2« il est interdit d’employer des armes, desprojectiles des matières ainsi que des méthodes de guerre de natureà créer des maux superflus ».
Il est heureux que la CIJ dans l’affaire des armes nucléaires ait qualifié de « principe cardinal » la règle coutumière protégeant les
11 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
combattants contre certaines armes, car nombreux sont ceux, dans la communauté internationale, qui ne l'ont acceptée que pour la forme au cours des dernières décennies, préférant se concentrer sur la protection des civils. L'auteur de ces lignes ne connaît que trop les efforts qui ont été nécessaires pour aboutir à l'interdiction récente des armes à laser aveuglantes et il faut espérer que tant ce nouveau traité que l'avis de la Cour vont fermement réaffirmer l'existence et l'importance de cette règle.Quant à l'interprétation de la règle, l'avis consultatif de la Cour affirme :« (...) il est donc interdit d'utiliser des armes leur causant de tels maux ou aggravant inutilement leurs souffrances (...), c'est-à-dire des souffrances supérieures aux maux inévitables que suppose la réalisation d'objectifs militaires légitimes.».
Règle 71. – Il est interdit d’employer des armes qui sont de natureà frapper sans discrimination.
Non seulement la Cour, dans son ensemble, considère que cette règle relève de la coutume, mais encore le juge Bedjaoui estime qu'elle fait partie du jus cogens, et le juge Guillaume déclare qu'elle représente un principe absolu. L'avis consultatif présente la règle dans les termes suivants : « Les États ne doivent jamais prendre pour cible des civils, ni en conséquence utiliser des armes qui sont dans l'incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires. ». Cette interdiction a été réaffirmée dans le Statut de la Cour pénale internationale dans son avis consultatif dans l’affaire des armes nucléaires
1. Dans l’affaire Martić en 1996, le Tribunal pénal international pourl’ex-Yougoslavie a lui aussi fait référence à ce critère.
2. Le Protocole additionnel I dans son article 51 paragraphe 4 interditd’employer des armes qui sont «propres à frapper indistinctement desobjectifs militaires et des personnes civiles ou des biens decaractère civil». Cette interdiction a été réaffirmée dans le Statutde la Cour pénale internationale en son article 8 paragraphe 2.
LE STATUT DE PRISONNIER DE GUERRE
Protocole additionnel 1 aux conventions de Genève de 1949 en sonarticle 69
12 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
1. Un prisonnier de guerre est un membre des forces armés ou un membrede groupes ou corps de personnes reconnues d’être partie à unconflit armés qui tombe au pouvoir d’une partie adverse. (Article 4convention III). La conséquence principale d’un tel statut, outre lefait de bénéficier d’un traitement qui est règlementé de façondétaillé par la convention III, est que la personne ne peut êtrejugée pour le simple fait d’avoir pris part aux hostilités ou pouravoir des actes qui en situation normale, seraient considérés commecrime de guerre (meurtres, destruction de propriétés etc.
2. Le droit de Genève instaure différents régimes suivants qui estdonné aux personnes arrêtés et détenues : le régime de prisonnier deguerre, régie par la troisième convention de Genève, et le régime dela personne civile est régi par la quatrième convention de Genève.En cas de doute sur l’appartenance à l’une ou l’autre catégoried’une personne ayant commis un acte de belligérance, celle-ci doitbénéficier de la protection de la troisième convention de Genève, enattendant que son statut ait déterminé par un tribunal compétent(article 5 paragraphe 2 de la Convention III). Toute autre personneprotégée est réputée civile.
3. Principe de limitation qui exigent chaque que des personnes sontdans les conditions d’être mises hors combat, il ne faut en aucunemanière sur ces personnes. Même le principe de nécessité etd‘humanité.
DESTRUCTION DES BIENS CULTURELS
Règle 7 : les parties en tout teps doivent faire la distinction entre biens de caractère civil et les objectifs militaires
Articles 52 du protocole 1« les biens à caractère civil nedoivent faire l’objet ni d’attaques ni de représailles ».
Article 53 du protocole II « il est interdit de commettre toutacte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, lesœuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent lepatrimoine culturel ou spirituel des peuples ;d'utiliser cesbiens à l'appui de l'effort militaire ; de faire de ces biensl'objet de représailles ».
protocole 2 en son article 16 « il est interdit de commettretout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques,
13 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent lepatrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliserà l’appui de l’effort militaire.
Statut de la CPI e son article 8.2 al b) ii)
PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Règle 38 : Chaque partie au conflit doit respecter les biensculturels :
Des précautions particulières doivent être prises au coursdes opérations militaires afin d’éviter toute dégradation auxbâtiments consacrés à la religion, à l’art, à la science, àl’enseignement ou à l’action caritative, ainsi qu’auxmonuments historiques, à condition qu’ils ne constituent pasdes objectifs militaires.
Les biens qui présentent une grande importance pour lepatrimoine culturel des peuples ne doivent pas être l’objetd’attaques, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse.
Article 4 et 19 de la convention pour la protection des biensculturels en cas de conflits armé dispose « les hautesparties contractantes s’engagent à respecter les biensculturels situés tant sur leur propres territoires que surcelui des autres Hautes Parties contractantes ens’interdisant l’utilisation de ces biens, celles de leursdispositifs de protection et celle de leurs abords immédiatsà des fins qui pourraient exposer ces biens à une destructionou à une détérioration en cas de conflits armés, et ens’abstenant de tout acte d’hostilité à leur égard
Statut de la CPI en son article 8.2 al b).e) concernant lesattaques délibérées contre les biens culturels.
L’application de la Convention de La Haye à titre de droitinternational coutumier à des conflits armés noninternationaux a été reconnue par le Tribunal pénalinternational pour l’ex-Yougoslavie en 1995 dans l’affaireTadić.
Article 52 et 16 respectivement des protocoles I et II.
14 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
Après la seconde guerre mondiale, le tribunal permanent deMetz, dans l’affaire Ligenfelder et le tribunal militaire desUSA à Nuremberg ont condamné pour saisie et destructions desbiens culturels
Il ne faut comprendre cette règle avec l’interdit desattaques contre les biens culturels contenus dans l’article53.a et l’article 16 du protocole II, qui ne prévoit en casde dérogation en cas de nécessité militaire impérative(article 6.1 al a) du protocole 2 de la convention de la Hayedes biens culturels.
JM HENCKEARTS ET HOWSWALD-BECK indique clairement dansl’ouvrages intitulé « DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRECOUTUMIER » précisément à la page 174 paragraphe 1 que sousla conférence diplomatique qui a conduit à l’adoption desprotocoles additionnels aux conventions de Genève, les Etatsont indiqué que malgré l’absence de de toute notion dedérogation dans le texte, des biens culturels pourraient êtrenéanmoins l’objet d’attaques ou ils seraient utilisés à desfins militaires.
PROTECTION DE L’ENFANT
Règle 136 : Les enfants ne doivent pas être recrutés dans les forces armées ou les groupes armés organisés
Règle 137 : les enfants ne doivent pas être autorisés à participer aux hostilités
Les protocoles additionnels I en son article 77 par 2 et II enson article 4 paragraphe2 interdisent de recruter des enfants.
Selon le Statut de la Cour pénale internationale en son article8.2 al e), «le fait de procéder à la conscription ou àl’enrôlement d’enfants» dans des forces ou des groupes armésconstitue un crime de guerre dans les conflits armésinternationaux et non internationaux. Ce crime de guerre estaussi inscrit dans le Statut du Tribunal spécial pour la SierraLeone en son article 4
M. Lubanga a été déclaré coupable, en qualité de co-auteur, des
15 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
crimes de guerre consistant en : L’enrôlement et laconscription d’enfants de moins de 15 ans dans la Forcepatriotique pour la libération du Congo (FPLC), et les faireparticiper activement à des hostilités, dans le cadre d’unconflit armé ne présentant pas un caractère international du1er septembre 2002 au 13 août 2003 (sanctionnés par l’article8-2-e-vii du Statut de Rome).
STATUT DE REFUGIES
Conformément à la convention de 1951 en son article 1.A.2, relativeau statut de réfugié, un refugié est une personne qui :
1. Craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sareligion, sa nationalité, ses opinions politiques, son appartenanceà un groupe ;
2. Se trouve hors de son pays d’origine et ;
3. Ne peut ou se veut se réclamer de la protection de ce pays ou yretrouver parce qu’elle craint d’être persécutée.
La convention de l’OUA, régissant les aspects propres aux problèmesdes réfugiés en Afrique, un traité régional adopté en 1969 élargi ladéfinition de la convention de 1951 pouvait inclure uneconsidération plus objectivement fondée à savoir : « toute personnequi du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’unedomination étrangère ou d’évènement troublants gravement l’ordrepublic dans une partie ou la totalité de son pays d’origine ou depays dont elle a la nationalité et est obligé de quitter sarésidence ».
Cela signifie que les personnes qui fuient les troubles civils, laviolence généralisée et la guerre ont le droit de demander le statutde réfugiés dans les Etats qui sont parties à cette conventionqu’elles craignent ou non avec raison d’être persécutées.
Les réfugiés et les demandeurs d'asile ne doivent pas être pénalisésou exposés à un traitement défavorable du simple fait que leurprésence dans le pays est jugée illégale; on ne doit pas appliquer àleurs déplacements d'autres restrictions que celles qui sont
16 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
nécessaires dans l'intérêt de la santé publique et de l'ordrepublic.
Les réfugiés et les demandeurs d'asile doivent jouir de tous lesdroits civils fondamentaux internationalement reconnus, enparticulier de ceux qui sont énoncés dans la Déclaration universelledes droits de l'homme.
Les réfugiés et les demandeurs d'asile doivent recevoir toutel'assistance nécessaire et l'on doit leur fournir tous les produitsde première nécessité : vivres, abris et services d'hygiène et desanté de base; à cet égard, la communauté internationale doit seconformer aux principes de la solidarité internationale et dupartage des charges.
Les réfugiés et les demandeurs d'asile doivent être traités commedes personnes dont le sort tragique appelle une compréhension et unebienveillance particulières. Ils ne doivent pas être assujettis àdes traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Les réfugiés et les demandeurs d'asile ne doivent pas être l'objetde mesures discriminatoires fondées sur la race, la religion,l'opinion politique, la nationalité, le pays d'origine oul'incapacité physiqueArticle 3 de la CR.
Les réfugiés et les demandeurs d'asile doivent être considérés commedes personnes au regard de la loi et avoir librement accès auxtribunaux et autres autorités administratives compétentesArticle 16.
Le lieu de séjour des réfugiés et des demandeurs d'asile doit êtredéterminé en fonction de leur sécurité et de leur bien-être ainsique des exigences de sécurité de l'État d'accueil. Les personnes enquête d'asile doivent, dans la mesure du possible, être installées àune distance raisonnable de la frontière de leur pays d'origine.Elles ne doivent pas s'engager dans des activités subversives contreleur pays d'origine ou contre quelque autre État.
L'unité de la famille doit être respectée.
Toute l'assistance possible doit être fournie en vue de rechercherles proches parents des intéressés.
17 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
Des dispositions appropriées doivent être prises pour la protectiondes mineurs et des enfants non accompagnés.
L'envoi et la réception de courrier doivent être autorisés.
L'assistance matérielle provenant d'amis ou de membres de la familledoit être autorisée.
Des dispositions appropriées doivent être prises, dans toute lamesure du possible, en vue de l'enregistrement des naissances, desdécès et des mariages.
Les réfugiés doivent se voir accorder toutes les facilités vouluespour parvenir à une solution durable satisfaisante.
Les réfugiés doivent être autorisés à transférer dans le pays quileur offre une solution durable les avoirs qu'ils ont fait entrersur le territoire.
Toutes les mesures doivent être prises en vue de faciliter lerapatriement librement consenti.
ENTREPRISES MILITAIRES ET DE SECURITES PRIVEES
Le statut des membres du personnel des EMSP est déterminé par le droit international humanitaire notamment dans le « Document de Montreuilsur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les Etas en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées opérant pendant les conflits Armés du 17 septembre 2008 et adopté par 17 Etats membres et plus d’une 40 Etats sont partis »,au cas par cas, en particulier selon la nature et les circonstances des fonctions dans lesquelles ils sont impliqués.
À moins qu’ils ne soient incorporés dans les forces armées d’un État ou qu’ils exercent des fonctions de combat pour un groupe armé organisé appartenant à une partie au conflit, les membres du personnel des EMSP sont des civils.EMSP dans les conflits armés internationaux, aussi longtemps qu’ils ne sont pas incorporés dans les forces armés, les EMSP ne perdent pas leur qualité de civile du simple fait qu’ils accompagnent les forces armés ou assurent des fonctions militaires. Lorsque ces personnes participent directement aux hostilités sans y être expressément autorisées ou tacitement autorisées par l’Etat partie au conflit, elles restent civileset perdent leur protection contre les attaques directes.
18 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
En conséquence : ils ne peuvent pas être pris pour cible ; ils ne peuvent pas faire l’objet d’attaques, sauf s’ils participent
directement aux hostilités et pendant la durée de cetteparticipation.
Si toutefois des membres du personnel des EMSP mènent des activitésqui reviennent à participer directement aux hostilités :
ils perdent cette protection contre les attaques pendant la durée decette participation ;
s’ils sont capturés, ils peuvent être traduits en justice pour leursimple participation aux hostilités, indépendamment du fait qu’ilsaient commis ou non des violations du droit internationalhumanitaire.Garder une base militaire pour la protéger des attaques ennemies,recueillir des renseignements militaires tactiques et actionner dessystèmes d’armement dans des opérations de combat est des activitésauxquelles le personnel des EMSP peut être associé et quiconstituent une participation directe aux hostilités.S’ils opèrent dans des situations de conflit armé, les membres dupersonnel des EMSP ont l’obligation de respecter le droitinternational humanitaire ; ils peuvent être tenus pour pénalementresponsables de toute violation qu’ils commettraient, et ce, qu’ilssoient au service d’un État, d’une organisation internationale oud’une entreprise.
Ils participent directement aux hostilités lorsqu’ils ont unefonction de combat continue.
Le professeur Schmitt affirme que si les sous-traitants de sécuritéssont autorisés par un Etat à participer directement aux hostilitésen son nom cessent d’être un civils et deviennent membres des forcesarmées de cet Etats au regard du DIH.
Exemple :
1. chauffeur d’un camion. transportant des minutions
L’acheminement, à bord d’un camion conduit par un civil, deminutions jusqu’à une position de tire active sur la ligne de frontdevrait presque certainement être considérés comme faisant partie
19 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
intégrante des opérations de combats en cours et, par conséquent,comme une participation directe aux hostilités.Un raisonnement similaire a été récemment adopté par lesjurisprudences nationales.
Un premier cas concerne la conduite d’un véhicule transportant deuxmissiles sol-air, proximité temporelle et spatiale d’opérations decombat en cours. Commission militaire, USA c/ Salim Ahmed Hamdam 19décembre 2007.
La conduite d’un véhicule transportant des munitions jusqu’au lieuoù elles seront utilisées aux fin aux fin des hostilités. Israël,Haute Cour de Justice, PCATI c/Israël
Par contre, le fait de transporter des munitions entre l’usine et leport où elles seront embarquées pour rejoindre un entrepôt dans unezone de conflit est trop éloigné de l’utilisation de ces munitionsdans les opérations militaires spécifiques pour être considéré commeétant la cause directe des effets nuisible qui en résulte. Bien quele camion transportant de munitions demeure un objectif militairelégitime, le fait de conduire ce camion ne constituerait pas uneparticipation directe aux hostilités et ne priverait pas lechauffeur civil de l’immunité contre les attaques.
LA PRISE D’OTAGES
Définition : La convention internationale sur la prise d’otages, demême que la statut de la CPI défissent la prise d’otages comme lefait de s’emparer d’une personne (otage) ou de la détenir,accompagné de menaces, de la terreur, de la blesser ou de continuerà la distraire afin de contraindre une tierce personne à accomplirun acte quelconque ou s’en abstenir en tant que condition de lalibération de l’otage.L’interdiction de la prise d’otages est perceptible à la lecture dela règle 36.A la lumière de La convention 4 de Genève en son article34, l’article 3 commun aux 4 conventions de Genève de 1949, àl’article 75.2 et l’article 4.2 respectivement des protocoles I etII. En outre le statut des différentes juridictions internationalesnotamment l’article 8.2 du statut de la CPI, l’article 2.1 du statutdu TPIY, l’article 4.1 du statut du TPIR et de l’article 3.1 duTPISS de répression de crimes ont d’ailleurs inclus cetteinterdiction ont énoncé de façon claire et sans ambages que la prised’otages est interdite.
20 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
Selon ces statuts, la prise d’otages constitue un crime de guerredans les conflits tant interne et international.Dans les affaires Kardzic et Mladic en 1995, les chefs d’accusationd’infraction grave retenus contre eux concernant la prise d’otagesdes membres de maintien de la paix des N.U. Dans son examen d’actesd’accusation le tribunal a confirmé.Dans l’affaire Blaskic en 2000, dans l’affaire Dario Kordic et MarioCerkez en 2001, le TIPY a reconnu que l’accusé s’est rendu coupabledes violations des lois et coutumes de la guerre en exerçant laprise des otages.De toutes ces jurisprudences, le TPIY a jugé les accusés coupablesde l’infraction grave de prise d’otage.
ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA PARTICIPATION DIRECTE AUX HOSTILITES
Pour constituer une participation directe aux hostilités, un actespécifique doit remplir les critères cumulatifs suivants :
l’acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou àla capacité militaire d’une partie à un conflits armé, ou alorsl’acte doit être de nature à causer des pertes en vies humaines, desblessures et des destructions à des personnes ou à des biensprotégés contre les attaque directe (seuil de nuisance), et
il doit exister une relation directe de causalité entre l’acte etles effets nuisibles susceptibles de résulter de cet acte ou d’uneopération militaire coordonnée dont cet acte fait partie intégrante(la causation directe), et
l’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement deseffets nuisibles atteignant le seuil requis, à l’avantage d’unepartie au conflit et au détriment d’une autre (lien debelligérance).
Résumé: les actes constituants une participation directe auxhostilités doivent remplir trois conditions cumulatives ;premièrement, un certain seuil de nuisance doit être susceptible derésulter de l’acte ; deuxièmement, il doit exister un rapport decausalité directe entre l’acte et les effets nuisibles attendus ;et, troisièmement, il doit exister un lien de belligérance entrel’acte et les hostilités conduite entre les parties à un conflitarmé.
21 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
RESPONSABILITE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE NON MILITAIRE
Selon Jamie Allan Williamson, Conseiller Juridique Régional du CICRdans son article sur la responsabilité du commandement et lapratique pénale définit les autres supérieurs hiérarchiques commeles personnes exerçant les fonctions de ministres, de directeursd’usines, maires…Leur responsabilité est visible :
Article 28.2 du statut de la CPI qui dispose que : « En ce quiconcerne les relations entre supérieur hiérarchique etsubordonnés non décrites au paragraphe a), le supérieurhiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de lacompétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous sonautorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il ou elle n'a pasexercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les casoù :1. Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés
commettaient ou allaient commettre ces crimes ou adélibérément négligé de tenir compte d'informations quil'indiquaient clairement ;
2. Ces crimes étaient liés à des activités relevant de saresponsabilité et de son contrôle effectifs ; et
3. Le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesuresnécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pouren empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer auxautorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites. »
Article 86.2 du Protocole additionnel I aux conventions de Genève : « Le fait qu'une infraction aux Conventions ou auprésent Protocole a été commise par un subordonné n'exonère passes supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire,selon le cas, s'ils savaient ou possédaient des informations leurpermettant de conclure, dans les circonstances du moment, que cesubordonné commettait ou allait commettre une telle infraction,
22 | P a g e
Concours Régional de Plaidoirie sur le DroitHumanitaire à TUNIS
et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures pratiquement possiblesen leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction.
Règles coutumières 153 de l’étude du CICR des professeurs JMH et LD-BECKS
Les autres supérieurs hiérarchiques sont pénalement responsablesdes crimes de guerre commis par leurs subordonnés s’ils savaient,ou avaient des raisons de savoir, que ces subordonnéss’apprêtaient à commettre ou commettaient ces crimes et s’ilsn’ont pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables quiétaient en leur pouvoir pour en empêcher l’exécution ou, si cescrimes avaient déjà été commis, pour punir les responsables.
Jurisprudences
Les commandants militaires ont vu leur responsabilité pénaleengagé par les crimes commis par leurs subordonnés lors deplusieurs procès suivants la seconde guerre mondiale. AffaireRAUER par 656 rendu par le tribunal militaire à Wuppertal auRoyaume Uni ; UAS c/ affaire Wilhem Von Leeb et autres (affairesdu haut commandement) par 657 ;USA c/ Wilhem List ( Procès desotages) par rendu 658 par le tribunal militaire américainsiégeant à Nuremberg. Affaire du Général Yamashita rendu la Courla Suprême des USA par 659 ; affaire du Tribunal militaire deTokyo (affaires des grands criminels de guerre et TOYODA par 693-701
TPIY : Cette règle a été confirmée dans plusieurs affaires jugéespar la TPIY en autres : milan Martic par 705 ; Karadzic et mladicpar 706 ; delalic et consorts par 707 ; alessovkic par 708 ;Blaskic par 709 ; kunurac et consotrs par 711 ; cerkez et kordicpar 712, Radislavkrstic par 713 ; Miroslav Kvocka et consorts714.
CPI : Cette règle a été confirmée par cette auguste cour dans une précédente affaire THOMAS LUBUNGA. La cour a jugé que les crimes ont étécommis délibérément et en toute connaissance de cause dans la mesure
23 | P a g e





























![“Legal grounds for the return of the Parthenon Marbles” [2002] 2 Revue Hellénique de droit International 513](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334715776a7ca221d08b192/legal-grounds-for-the-return-of-the-parthenon-marbles-2002-2-revue-hellenique.jpg)