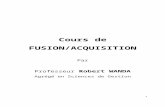Droit des Societes Allain (Cours - seance 7).pdf
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Droit des Societes Allain (Cours - seance 7).pdf
UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE Faculté de Droit
DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS LICENCE 3
Cours de Monsieur Tanguy ALLAIN Année universitaire 2016-2017
COURS MAGISTRAL
Leçon n°5(séance 7) La société à responsabilité limitée
Toujours dans la catégorie des sociétés à risque limité, et à côté des sociétés par actions, il existe une autre forme sociale qu’il convient de présenter : la société à responsabilité limitée (SARL). Si l’on évoque cette forme sociale dans un titre II consacré aux « sociétés hybrides », c’est que la SARL, qui est une société commerciale par la forme soumise à l’IS mais n’est pas une société par actions, va emprunter son régime à la fois aux sociétés de personnes (sociétés fermées) - et se caractériser alors par la présence d’un intuitus personae relativement important - et aux sociétés 1
de capitaux (sociétés ouvertes) . 2
La SARL a été introduite en France par une loi du 7 mars 1925, sur le modèle allemand de la GmbH , forme de société dotée d’un très fort intuitus personae (incessibilité de principe des parts 3
sociales ; gérant quasiment irrévocable). A compter de la loi de 1966, la SARL a toutefois commencé à subir quelques modifications législatives pour la rendre plus souple et mieux adaptée aux besoins économiques. Depuis lors, et surtout à partir des années 80, le législateur n’a cessé de moderniser la SARL pour touches successives. Aujourd’hui, cette forme sociale est de loin celle la plus prisée des français, notamment parce qu’elle est facile à créer, qu’elle offre une limitation de la responsabilité aux associés, et que les apports sont rémunérés par des parts sociales, dont le régime juridique garantit une protection contre l’arrivée de tiers non sollicités. De très nombreuses TPE, PME, ou sociétés familiales sont aujourd’hui constituées sous forme de SARL. Néanmoins, la SARL reste, à côté de la SAS, une forme de société assez lourde à gérer. De plus, il ne s’agit pas d’une société permettant de rassembler facilement des fonds en grande quantité : elle n’émet pas d’actions et ne peut pas faire des offres au public . En outre, depuis 1985 , Ia 4 5
SARL peut être unipersonnelle. Si l’on parle à cette occasion d’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), c’est toutefois de la même forme sociale dont il s’agit. Elle est alors un véhicule juridique très intéressant pour qui veut exercer une activité en solo de façon sécurisée,
Peu d’associés, parts sociales non négociables, mécanisme légal d’agrément en cas cession des parts 1
sociales… Elle est dotée d’un certain formalisme ; il existe de nombreuses obligations structurelles ; des sanctions 2
pénales sont applicables ; le législateur laisse peu de place à la liberté contractuelle.Gesellschaft mit beschränkter Haftung.3
Il est seulement admis qu’elle puisse émettre des obligations, mais à condition de remplir certaines 4
conditions, notamment de taille et de se soumettre à un contrôle légal (C. com., art. L. 223-11). Loi n°85-697 du 11 juillet 1985, relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à 5
l’exploitation agricole à responsabilité limitée, JORF, 12 juill. 1985, p. 7862.�1
ou de façon plus technique, pour structurer des filiales détenues à 100% par une société mère dans un groupe de sociétés.
Les dispositions applicables à la SARL sont prévues aux articles L. 223-1 à L. 223-43 du Code de commerce.
Comme pour toutes les autres formes sociales, on peut présenter la SARL en s’intéressant d’une part à sa constitution (Section I), d’autre part à son fonctionnement (Section II) et enfin, aux hypothèses de mutation dont elle peut faire l’objet (Section III). On renverra au droit commun s’agissant des règles générales applicables à tous les actes de sociétés (contrat de société, statut de la période de formation, etc.) . 6
Section I. La constitution de la SARL
Classiquement, pour constituer une SARL, il convient de réunir des conditions de fond (A) et des conditions de forme (B).
A. Les conditions de fond
Les conditions de fond pour constituer une SARL sont au nombre de trois. Nous évoquerons l’objet social (1), les associés (2) et le capital social (3).
1. L’objet social
C’est ici le droit commun des sociétés qui doit s’appliquer : les sociétés sont en principe libres de déterminer leur objet social, sous réserve des limitations prévues par le Code civil . Il est à noter 7
cependant que certaines activités ne peuvent pas être exercées sous la forme de SARL : par exemple, les sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne , les bureaux de tabacs . 8 9
2. Les associés
La SARL est instituée par « une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports » . Cette forme sociale se singularise donc par la possibilité d’être 10
constituée par une associé unique (EURL). Dans ce cas, les textes évoquent l’« associé unique ». La SARL et l’EURL sont une même forme sociale et l’on passe de l’une à l’autre des dénominations sans formalité particulière , si ce n’est une modification des statuts si leurs 11
rédacteurs n’ont pas tenu compte de cette éventualité .12
A ceci près que les causes de nullité de la société sont plus restrictives : la nullité de la société ne peut 6
résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne oui les associés fondateurs (C. com., art. L. 235-1). C. civ., art. 1833 : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des 7
associés ». C. com., art. L. 223-1 al. 5.8
Le Code général des impôts (art. 568) impose une structure impliquant la responsabilité du débitant de 9
tabac : SNC ou entreprise individuelle. C. com., art. L. 223-1 al. 1.10
Ainsi, par exemple, en cas de réunion en une seule main de toutes les parts d’une SARL, la société 11
n’encourt pas dissolution, par dérogation à l’article 1844-5 du Code civil. C. com. art. L. 223-4. En pratique, il est toujours conseillé de fournir des statuts de SARL tenant compte de l’éventualité de 12
n’avoir plus qu’un seul associé. Et inversement, lorsque la SARL est créée au départ avec un associé unique, il est conseillé d’adapter les statuts pour le cas où à l’avenir il devait y avoir de nouveaux associés.
�2
Si la SARL peut compter en outre plusieurs personnes, c’est toutefois dans la limite de 100 associés . En cas de dépassement de ce nombre en cours de vie sociale , la société doit être 13 14
dissoute au terme d’un délai d’un an, à moins que pendant ce délai, le nombre d’associé soit devenu égal ou inférieur à 100, ou bien que la société ait fait l’objet d’une transformation. Cette limite marque le caractère fermé de cette forme sociale.
En tous les cas, les associés ne sont pas commerçants. Cette qualité est donc ouverte largement, même aux incapables à condition d’être représentés. Toute personne physique ou morale peut 15
être associé d’une SARL et d’une EURL. A l’extrême, on peut même envisager qu’une EURL soit associée unique d’une autre EURL.
Ainsi qu’il a sûrement été précisé dans le cours de droit général des sociétés, le conjoint de l’associé qui a souscrit ou acquis des parts sociales à l’aide biens ou de fonds communs, peut revendiquer la qualité d’associé . 16
3. Le capital social
Il n’est pas nécessaire, pour constituer une SARL, de rassembler un capital minimum légal . Le 17
législateur laisse aux créateurs de la société, le soin de le fixer dans les statuts . Ils devront 18
toutefois être vigilants car la jurisprudence sanctionne les fondateurs qui ne dotent pas leur société de capitaux en adéquation avec l’activité , ou engagent des dépenses excessives par rapport aux 19
capacité de leur société . Ce capital peut être constitué par les voies connues : apports en 20 21
numéraire, nature et en industrie.
S’agissant en premier lieu des apports en numéraire, précisons que les parts sociales qui les représentent peuvent être libérées, partiellement, d’au moins 1/5ème de leur montant et à condition de libérer le surplus en une ou plusieurs fois dans un délai de 5 ans (à compter de l’immatriculation de la société au RCS), sur décision du gérant . L’objectif est de faciliter la 22
constitution de la société avec des sommes de départs potentiellement très faibles. En tout état de cause, cette libération doit être intégrale si la société veut procéder à l’émission de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire. Les fonds provenant de la libération des parts sociales fond l’objet d’un dépôt auprès d’un « dépositaire des fonds » (Caisse des dépôts et consignations, notaire ou banque) dans les 8 jours de leur réception. Ils pourront être retirés par le gérant après 23
l’immatriculation de la société au RCS . Si la société n’était pas constituée dans le délai de 6 mois 24
à compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n’était pas immatriculée dans le ce même délai, les
C. com., art. L. 223-3. 13
Si ce nombre est dépassé dès la constitution, il y a fort à parier que le dossier d’immatriculation sera 14
rejeté par le greffe. Même un mineur, à condition d’être âgé de 16 ans révolus peut être autorisé, par sa ou ses 15
administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d’administration nécessaires à la création et à la gestion d’une société unipersonnelle. les actes de dispositions restent toutefois effectués par son ou ses administrateurs légaux. C. civ., art. 388-1-2.
C. civ., art. 1832-2.16
Pour faire face à l’éventualité d’un capital peu protecteur de leurs intérêts, il est fréquent que les 17
créanciers réclament auprès des gérants l’obtention de garanties personnelles : cautionnement, aval, garantie à première demande…
C. com., art. L. 223-2.18
V. par ex. Cass. com., 23 nov. 1999, BRDA 2000, n°5, p. 4.19
Cass. com., 19 mars 1996, Rev. sociétés 1996, p. 840, note T. Bruguier.20
Sur l’apport de biens communs, on renvoie ici au droit général des sociétés et à l’article 1832-2 du Code 21
civil. C. com., art. L. 223-7. 22
C. com., art. L. 223-8 et R. 223-3.23
C. com., art. L. 223-4.24
�3
apporteurs peuvent à titre individuel, demander en justice l’autorisation de retirer le montant de 25
leurs apports. Un mandataire représentant tous les apporteurs peut demander directement (sans 26
faire une demande justice), au dépositaire le retrait des fonds . Si les apporteurs veulent 27
finalement constituer la société, ils devront procéder à nouveau au dépôt des fonds.
S’agissant en deuxième lieu des apports en nature, ajoutons qu’une procédure d’évaluation est 28
prévue à l’image de ce que l’on a pu observer dans les SA. Ainsi, les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Cette évaluation est réalisée par les associés, sur la base d’un rapport (qui sera annexé aux statuts) établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports. Celui-ci est désigné soit à l’unanimité des futurs associés, soit, à défaut d’accord, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent. Il est particulièrement notable que les associés peuvent toutefois décider à l’unanimité (ou sur décision de l’associé unique) de ne pas désigner de commissaire aux apports, si la valeur d’aucun apport en nature n’excède 30 000€ , et la valeur totale de tous les apports non soumis à évaluation n’excède pas la moitié du 29
capital. En outre l’associé unique qui apporte une activité professionnelle qu’il exerçait en nom propre (ou sous forme d’EIRL), peut se dispenser de l’évaluation du commissaire aux apports. Dans ces cas, et également dans l’hypothèse où les associés retiendraient une valeur différente de celle proposée par le commissaire aux apports , les associés (mêmes nouveaux) sont alors 30
responsables solidairement pendant 5 ans de la valeur qu’ils ont attribué aux apports. Sans compter les sanctions pénales applicables en cas de majoration frauduleuse des apports en nature . 31
Enfin en dernier lieu, notons que les apports en industrie sont autorisés , il appartient aux statuts 32
d’en déterminer les modalités . Cette liberté statutaire n’est toutefois pas exclusive des règles de 33
droit commun prévues par le Code civil : les apports en industrie ne concourent pas la formation 34
du capital social ; ils donnent lieu à l’attribution de parts sociales non cessibles, ouvrant droit au 35
partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes, et selon la répartition mentionnée par les statuts ; l’associé apporteur en industrie doit rendre compte à la société de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport ; enfin, la part de l’apporteur en industrie dans les bénéfices et sa contribution aux pertes étant égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, sauf clause contraire, il est conseillé en pratique de définir précisément dans les statuts les apports en question et leurs modalités d’exécution. Les titulaires de parts sociales résultant de tels apports ont par ailleurs droit à l’attribution de parts sociales en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves.Le capital social est divisé en parts sociales égales et souscrites en totalité . Ces parts ont 36 37
toutes la même valeur nominale , mais peuvent, selon les auteurs, conférer des droits différents à 38
Cette autorisation est donnée par le président du tribunal du commerce du lieu du siège social, statuant 25
sur requête. C. com., art. R. 223-5 1°. Une autorisation écrite de tous les apporteurs est nécessaire. C. com., art. R. 223-5 2°.26
C. com., art. L. 223-8 al. 2.27
C. com., art. L. 223-9.28
C. com., art. D. 223-6-1.29
Que ce soit une surévaluation (ce qui permettrait de rendre illusoire le gage des créanciers) ou une 30
sous-évaluation (dans un objectif de fraudes vis-à-vis du fisc par exemple). Sont encourus : 5 ans de prison et 375 000€ d’amende. C. com., art. L. 241-3 1°.31
Il a longtemps été considéré que, dans une société à risque limité, le gage général des créanciers étant 32
limité aux actifs sociaux, il fallait interdire les apports ne concourant pas au capital social. C. com., art. L. 223-7, al. 2.33
C. civ., art. 1843-2, 1843-3, 1844-1.34
Il est donc indispensable de procéder à au moins un apport en numéraire ou un apport en nature, pour 35
répondre à l’exigence de constitution d’un capital social, aussi faible soit-il. C. com., art. L. 223-2.36
C. com., art. L. 223-7.37
Elle est fixée dans les statuts. Cette valeur est à distinguer de la valeur vénale des parts sociales, qui 38
dépend quant à elle de la valeur de l'actif net de la société et de ses perspectives.�4
leurs porteurs (à l’exclusion de la suppression du droit de vote ). Leur répartition entre les 39
associés est mentionnée dans les statuts et est en principe proportionnelle aux apports . Les 40 41
parts sociales ne sont pas négociables . La violation de cette règle, dont la visée est d’interdire 42
toute spéculation et à protéger une forme d’intuitus personae, est sanctionnée pénalement . Les 43
règles de transmission des parts sociales sont ainsi très encadrées et font l’objet d’un formalisme particulier.
B. Les conditions de forme
Les conditions de forme sont en fait très similaires à celles que connaissent les SA : - rédaction des statuts (contenant des mentions obligatoires communes à toutes sociétés ou 44
propres à la SARL, telles que : la forme sociale, la durée de la société, le montant du capital social, la dénomination, le siège social, l’objet social, l’évaluation des apports en nature, la répartition des parts sociales entre les associés). Ils sont signés par tous les associés, en autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités. Un exemplaire établi sur papier libre est remis à chacun ; 45
- des formalités de publicité : extrait dans un journal d’annonces légales, enregistrement à la recette des impôts, dépôt du dossier au centre de formalités des entreprise (CFE) pour immatriculation au RCS, publicité au BODACC… ;
Il est à noter que le législateur facilite la création des EURL dans lesquelles l’associé unique 46
assume également la gérance, en prévoyant des « statuts-types » . C'est statuts-types 47
s’appliquent de façon supplétive à tous ceux des créateurs qui n’ont pas rédigé de statuts. Bien entendu, ils sont libres de s’en écarter en produisant eux mêmes des statuts dans leur demande d’immatriculation de la société. Des formalités allégées de publicités sont en outre prévues (notamment dispense de BODACC) .48
Les premiers gérants et associés sont civilement et pénalement responsables des irrégularités commises lors de la constitution de la SARL .49
Les règles relatives à la reprise des actes passés pendant la période de conception relèvent du droit commun.
Section II. Le fonctionnement de la SARLUne SARL comme toute les autres sociétés fonctionne essentiellement à travers les organes dont elle est dotée. C’est à grâce à la gérance (A) et les associés (B) que la SARL fonctionne. On ajoutera à cela quelques mots sur les règles de contrôle de ce fonctionnement (C).
A. La gérance de la SARL
C. civ., art. 1844.39
C. com., art. L. 223-7 al. 3. Les statuts doivent donc être modifiées à chaque cession de parts sociales.40
C. civ., art. 1843-2.41
C. com., art. L. 223-12 ; C. civ., art. 1841.42
C. com., art. L. 241-2 (6 mois de prison et 9000 € d’amande).43
C. com. art. L. 210-2. 44
C. com., art. R. 223-1.45
C. com., art. L. 223-1 al. 2. 46
Annexe 2-1 du Livre II du Code de commerce. Ces modèles de statuts doivent en outre remis 47
gratuitement au fondateur de la société par le centre de formalité des entreprises. C. com., art. D. 223-2. C. com., art. L. 223-1 al. 3. 48
C. com., art. L. 223-10. 49
�5
La conduite des affaires, dans une SARL est menée par un gérant. Son statut (1), ses pouvoirs et obligations (2) et ainsi que sa responsabilité (3), son étroitement organisés par la loi et assez largement claquées sur le directeur général de SA.
1. Statut du gérant
Envisageons ici quatre éléments du statut du gérant : sa nomination, la cession de ses fonctions, sa rémunération, et enfin son statut fiscal et social.
- La nomination du gérant
Seules les personnes physiques , associées ou non, sans considération d’âge, disposant de la 50
capacité civile, éventuellement étrangères , peuvent être nommées gérantes de SARL, et à 51
condition de ne faire l’objet d’aucune interdiction de gérer une entreprise, d’une déchéance ou une incompatibilité (par ex. : fonctionnaire, avocat, commissaire aux comptes) . Il n’est pas 52
commerçant. Il peut être nommé plusieurs gérants (sans limitation de nombre), on parle alors de « co-gérants », qui exercent leurs pouvoirs concurremment (ce qui peut rendre les choses assez complexes en pratique, notamment en cas de désaccord). Ce sont les associés qui nomment le ou les gérants, dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité des parts sociales (ou une 53
majorité plus élevée). Ils sont nommés pour la durée de la société sauf stipulation contraire. La nomination fait l’objet d’une publication légale et est par conséquent opposable aux tiers . Le 54 55
législateur ne prévoit aucune limite pour le cumul des gérances. L’associé unique d’EURL peut exercer les fonctions de gérant, comme il peut désigner un tiers.
Le gérant ainsi nommé peut conserver un contrat de travail qu’il avait conclu antérieurement avec la société, à condition d’exercer une activité salariée effective et distincte de la gérance . Le 56
gérant peut aussi conclure un contrat de travail après sa nomination, à condition que l’emploi occupé soit effectif et distinct des fonctions sociales , et de faire l’objet de la procédure applicable 57
pour le contrôle des conventions réglementées . Toutefois, cette possibilité de cumul n’est 58
autorisée qu’à la condition que le gérant soit placé dans une relation de subordination vis-à-vis de la société . C’est-à-dire qu’il doit, soit ne pas être associé, soit être associé minoritaire. Ainsi, le 59
gérant s’il est associé unique , associé égalitaire ou associé majoritaire , ne peut pas conclure 60 61 62
de contrat de travail avec la société, sous peine de nullité. En tout état de cause, et quelle que soit sa participation au capital (même minoritaire voire non associé ), si la relation de subordination 63
n’est pas établie, le contrat de travail ne peut pas être conclu (et s’il a déjà été conclu, il doit alors être suspendu ). Les intérêts pour un gérant de conclure un contrat de travail avec la société sont 64
multiples : possibilité de réclamer des sommes et intérêts en cas de licenciement abusif ; possibilité d’obtenir une garantie de paiement des salaires en cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) de la société ; indemnités de chômage.
C. com., art. L. 223-18 al 1.50
Sous condition de détention d’un titre de séjour si la résidence est établie en France51
Les statuts sont libre de fixer toute autre condition : âge, appartenance à un groupe familial, niveau 52
d’études, etc. C. com., art. L. 223-18 al. 2. L’associé majoritaire qui souhaite devenir gérant est assuré de l’être.53
Journal d’annonces légales, RCS, BODACC.54
C. com., art. L. 210-9.55
CA Versailles, 17ème ch. 9 nov. 2000, Bull. Joly sociétés 2001, §45.56
Cass. soc., 2 févr. 1994, Bull. Joly sociétés 1994, p. 383, § 113.57
C. com., art. L. 223-19.58
Pour une illustration v. Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 11-12161, Bull. joly sociétés 2012 §425, p. 777, note 59
G. Dedessus-Le-Moustier. CA Poitiers, 8 sept. 2009, RTD Com., 2009, p. 562, obs Cl. Champaud et D. Danet.60
Cass. soc., 4 mars 1981, Rev. sociétés 1981, p. 761, note P. Le Cannu.61
Cass. soc. 7 févr. 1979, D. 1979, IR, p. 367, obs. F. Derrida ; Rev. sociétés 1981, p. 578, note J. Hémard.62
CA Paris, 18 mars 1993, Bull. Joly sociétés 1993, p. 685, §190, note P. Le Cannu. 63
Cass. com., 9 juin 1999, RJDA, 1999, n° 1080.64
�6
- La cessation des fonctions de gérant
Classiquement, le gérant de SARL peut voir ses fonctions cesser pour des causes multiples : échéance du terme de la société ou du mandat , démission, décès , faillite, interdiction 65 66
déchéance, atteinte de la limite d’âge statutaire, transformation de la société… Ils peuvent en outre faire l’objet d’une révocation prononcée par les associés à la majorité des parts sociales 67
dans les conditions d’une AGO (les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ). Si le gérant 68
majoritaire est protégé contre le risque de révocation, le gérant minoritaire, lui, est à la merci des associés. Il semble que le gérant puisse être révoqué même si la question n’est pas prévue à l’ordre du jour, à l’occasion d’un incident de séance , le tout étant aujourd’hui nuancé par les 69
évolutions de la jurisprudence en cas de révocation n’offrant pas au gérant révoqué la possibilité de préparer ou présenter sa défense.
Cette révocation reste valable si elle décidée sans juste motif , mais elle peut alors donner lieu au 70
versement de dommages-intérêts au profit du gérant évincé (il n’est donc pas révocable ad 71
nutum). Une indemnisation peut être prévue de façon conventionnelle, à condition de ne pas prévoir un montant qui dissuaderait les associés de prononcer la révocation . En outre, et en 72
application des règles du droit civil, si la révocation est entourée de circonstances vexatoires, brutales ou qu’elle est réalisée dans des conditions intempestives, le gérant est en droit de réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi .73
Enfin, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé , notamment pour défendre l’intérêt social , sans aller jusqu’à exiger la démonstration 74 75
d’une faute intentionnelle . 76
Il appartient aux associés de supprimer des statuts le nom du ou des gérants dont la cessation des fonctions a été décidée, réunis en AG et à la majorité ordinaire . 77
Le gérant ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement : Cass. com. 17 déc. 2000, Bull. Joly sociétés, 65
2003, p. 307, note P. Le Cannu. En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé peut convoquer 66
l’assemblée générale en vue de procéder à son remplacement (C. com., art. L. 223-27 al. 6). C. com., art. L. 223-35. 67
Sans aller jusqu’à exiger l’unanimité : CA Paris 10 oct. 2006, Rev. sociétés 2007, p. 185, obs. I. Urbain-68
Parléani. Cass. com., 28 févr. 1977, D. 1977, IR 312, obs. J.-C. Bousquet ; Rev. sociétés 1978, p. 245, note J.-P. 69
Gastaud ; Cass. com., 4 mai 1993, Rev. sociétés, 1993, p. 800, note P. Didier. Il s’agira principalement de s’appuyer sur le comportement du gérant et de lui reprocher des fautes 70
(violation de la loi ou des statuts, fautes de gestion, négligences, dénigrement de la société, concurrence déloyale, comptabilité irrégulière, etc.) ou plus largement une inaptitude aux fonctions. En outre, la révocation peut être justifiée si elle est décidée dans l’intérêt objectif de la société (révocation d’un co-gérant pour réduire les coûts de fonctionnement ; mésentente : Cass. com., 4 mai 1999, n° 96-19503, Bull. IV, n° 94; Bull . Joly sociétés 1999, §215, note P. Le Cannu ; voire perte de confiance : CA Reims, 10 nov. 1975, Rev. sociétés 1976, p. 307, note J. Guyénot…). En revanche, le seul changement de majorité n’est pas un motif légitime (Cass. com., 29 mai 1972, Rev. sociétés 1973, p. 487, note J. Hémard ; CA Versailles, 12ème ch. 19 janv. 2016, n°14/00470, Bull. Joly sociétés juin 2016, p. 37, note T. Favario) ; ne le sont pas non plus les mauvais résultats de la société lorsqu’ils sont des à la conjoncture économique (CA Paris, 26 juin 2012, RG n°11/18760, RJDA 6/12, n° 529.
C. com., art. L. 223-25 al. 1.71
Cass. com., 6 nov. 2012, n°11-20582, Bull. civ., IV, n°202 ; Dr. sociétés, 2012, comm. n° 26, note D. 72
Gallois-Cochet ; Cass. com., 17 déc. 2000, Bull. Joly sociétés 2003, note. P. Le Cannu. Cass. com., 1er févr. 1994, Bull. Joly sociétés, 1994, p. 413, §123, note R. Baillod. 73
C. com., art. L. 223-25 al. 2.74
CA Paris, 6 mars 2003, RJDA, 12/2003, n°1191.75
Cass. civ. 3ème, n°13-14374, BRDA, 7/2014, n° 4.76
C. com., art L. 223-18 al. 2.77
�7
- La rémunération du gérant
Aucune disposition légale ne vient traiter la question de la rémunération des gérants de SARL. Par conséquent la liberté est de mise : il appartient aux statuts de préciser quel organe est compétent pour fixer la rémunération . Le plus fréquemment, les statuts confèrent donc ce pouvoir aux 78
associés réunis en assemblée générale. On a pu s’interroger sur le point de savoir si, à défaut d’indication des statuts, le gérant pouvait s’attribuer lui-même sa rémunération. La Cour de cassation a toutefois exigé que la rémunération résulte soit d’une clause statutaire, soit d’une décision des associés . Ainsi, la rémunération et ses modalités peuvent donc être prévus dans les 79
statuts , mais aussi d’exercice en exercice (voire pour plusieurs exercices) à l’occasion de chaque 80
assemblée générale annuelle. Le gérant s’il est associé, peut voter à l’assemblée générale fixant sa rémunération . On comprend aisément que le gérant associé majoritaire peut facilement 81
composer sa rémunération, tandis que le gérant non associé, ou associé seulement minoritaire peut être exposé à la fixation d’une rémunération qui ne le satisfait pas ou qui n’évolue pas comme il le souhaiterait. Le juge, pour sa part, n’a pas de pouvoir pour se substituer aux organes sociaux afin de fixer de la rémunération du gérant . Il peut seulement demander aux associés de prendre 82
une décision en ce sens , voire sanctionner un abus de majorité ou de minorité, ou engager la 83
responsabilité du gérant pour faute de gestion, en cas de rémunération excessive.
- Le statut fiscal et social du gérant
Le gérant de SARL, qu’il soit majoritaire ou non, est imposable au même titre que les salariés, sur ses revenus personnels au titres des BIC. Ils bénéficient des mêmes déductions et abattement 84
que les salariés. Concernant le régime social : les gérants majoritaires sont traités comme des travailleurs indépendants et sont donc affiliés au RSI. Les gérants minoritaires sont traités quant à eux comme des salariés, affilés au régime général de la sécurité sociale, à condition d’être rémunérés pour leurs fonctions de gérant. Aucun ne bénéficie de l’assurance chômage, sauf à cumuler de façon licite un contrat de travail.
2. Pouvoirs du gérant
D’une façon générale, il appartient au gérant de la SARL d’animer la société. Il dispose à ce titre de pouvoirs pour convoquer les assemblées, nommer le commissaire aux apports ou le commissaires aux comptes, gérer l’entreprise, proposer aux associés les orientations stratégiques (politique, économique, fiscale, sociale) à mettre en oeuvre. Il doit en outre informer les associés , que ce soit en tenant et en communiquant la comptabilité ou à travers notamment le rapport de gestion . Il est à noter que, si le gérant est associé unique, il n’est pas tenu de publier son rapport 85
de gestion au RCS. Il est simplement exigé de le tenir à disposition au siège social de toute
On évitera de fixer la rémunération directement dans les statuts : sa modification exigerait 78
nécessairement une modification des statuts, ce qui pourrait être difficile à obtenir à défaut d’accord de la part des associés.
Cass. com., 25 sept. 2012, n°11-22754, Bull. civ. IV, n° 171, D. 2012, p. 2302, obs. A Lienhard.79
CA Versailles, 31 oct. 2002, Bull. Joly sociétés, 2003, p. 184, §42 note A. Constantin.80
Il est admis que la décision fixant la rémunération n’est pas une convention entre le dirigeant et la 81
société, ce qui l’exclut du champ d’application de la procédure des conventions réglementées. Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13205, JCP E, 2010, 1993, n°3, obs. Fl. Deboissy et G. Wicker.
Cass. com. 31 mars 2009, Dr. sociétés 2009, comm. n° 116, note D. Gallois-Cochet.82
Cass. com., 14 nov. 2006, n° 03-20836, Bull. civ., IV, n° 225, Dr. sociétés, mars 2007, è52, note J. Monnet.83
CGI, art. 62.84
C. com., art. L. 223-26.85
�8
personne qui en ferait la demande . En outre, le rapport de gestion n’est pas exigé pour les EURL 86
dont l’associé unique est gérant ne dépassant certains seuils .87 88
Il doit enfin exécuter de nombreuses taches et démarches administratives : formalités de publicité, obligations déclaratives, fiscales ou sociales, modification des statuts, réalisation des modifications du capital social, passer les contrats, embaucher, licencier, initier les procès, etc.
Le Code de commerce distingue les pouvoirs du gérant à l’égard des associés, et ceux à l’égard des tiers.
A l’égard des associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts . Ce faisant, une 89
grande liberté est donnée pour interdire aux gérants de prendre certains actes, de leur imposer des limitations, de soumettre préalablement leurs décisions à des autorisations ou des avis, d’exiger d’eux une obligation d’information, le tout pouvant profiter aux associés voire à un organe statutaire spécialement désigné. Dans le silence des statuts, il convient toutefois de se reporter à l’article L. 221-4 du Code de commerce, applicable au gérant de SNC. Ce texte précise que dans les rapports entre associés et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société.
A l’égard des tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société . Ce pouvoir légal s’exerce dans le cadre désormais connu : 90
pouvoirs attribués par la loi aux associés ; objet social ; limitations statutaires ; respect de 91 92
l’intérêt social.
S’il y a plusieurs gérants, chacun détient séparément les pouvoirs prévus par la loi. Chacun, par exemple, est capable de représenter la société, et est dépositaire de la signature sociale . En 93
pratique, il est fréquent que les statuts répartissent les missions et les pouvoirs appartenant à chacun, ou exigent parfois que les co-gérants agissent ensemble. Ces clauses restent néanmoins inopposables aux tiers, et leur violation n’est donc sanctionnée que par une action en responsabilité contre celui des co-gérants qui ne les a pas respectées . Toutefois, chacun des co-94
gérants peut s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue. Cette opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est toutefois sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance . 95
En dernier lieu, il convient d’ajouter que dans l’exercice de ses fonctions, le gérant est tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité envers la société. Cela lui interdit notamment d’exercer d’autres fonctions de gérant dans une société concurrente .96
3. Responsabilité du gérant
C. com., art. L. 232-22.86
C. com., art. L. 232-1 IV.87
Deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros au bilan ; 8 millions d’euros de chiffre d’affaires ; 50 88
salariés. C. com., art. D. 123-200. C. com., art. L. 223-18 al. 4. 89
C. com., art. L. 223-18 al. 5.90
La société reste engagée même pour les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins 91
de prouver que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitatives des pouvoirs sont inopposables aux tiers, que ceux-ci soient de 92
mauvaise foi ou non. C. com., art. L. 223-18 al. 7.93
Cass. com., 3 déc. 2000, BRDA, 3/ 2003, p. 5. 94
C. com., art. L. 223-18 al. 7.95
Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15049, Bull. 2011, IV, n°188.96
�9
Concernant la responsabilité civile, l’ensemble des règles de droit commun applicables aux dirigeants sont applicables aux gérants de SARL, à travers notamment les actions sociales et les actions individuelles . A ceci près que, si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le 97
tribunal déterminer la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Les co-gérants ne sont pas en principe solidairement responsables, sauf à avoir agir comme coauteurs ou complices.
Au titre de la responsabilité pénale, celle-ci peut relever naturellement du droit commun , mais 98
aussi de délits particuliers : émission de valeurs mobilières ; attribution frauduleuse à un apport 99
en nature d’une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; répartition de dividendes fictifs ; 100
présentation de comptes infidèles ; abus des biens ou du crédit de la société, etc.
On ajoutera une responsabilité fiscale : les gérants de SARL sont tenus des impôts de la société si celle-ci n’est pas en mesure de la payer en raison de manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation répétée des obligations fiscales incombant au gérant . 101
B. Les associés de la SARL
S’il appartient au gérant de gérer quotidiennement la SARL, ce pouvoir s’exerce sous le contrôles des associés, qui interviennent quant à eux, plus périodiquement. Pour bien saisir la place des associés dans la SARL, il faut envisager tout d’abord leurs droit individuels (1), puis les différentes façons dont ils peuvent agir de façon collective (2).
1. Les droits individuels des associés
Classiquement, les associés de SARL peuvent, à titre individuel et tant que détenteurs de parts sociales, exercer trois séries de droits : des droits politiques, des droits financiers et des droits patrimoniaux.
- Les droits politiques
On pourrait parler plus largement de droits d’intervention dans la vie sociale. En premier lieu, il est naturel d’évoquer le droit de vote. Sur ce point, on retrouve les règles de droit commun : tout associé a droit de participer aux décisions collectives , sans que les statuts 102
puissent y déroger. Le droit de vote est exercé proportionnellement au nombre de parts sociales dont disposent les associés . 103
En second lieu, il faut préciser que les associés disposent d’un droit à l’information sociale : il existe un droit d’accès permanent à l’ensemble des documents sociaux à toute époque et pour 104
les trois derniers exercices, avec la possibilité d’assistance d’un expert . A l’occasion des 105
assemblées générales et sous peine de nullité, les associés disposent d’une information périodique : sont communiqués, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis 106
par les gérants, ainsi que les textes des résolutions proposées, et le cas échéant le rapport du
C. com., art. L. 223-22. 97
vol, escroquerie, faux en écriture, chèque sans provision, etc. 98
6 mois de prison et 9000 € d’amende (C. com., art. L. 241-2).99
5 ans de prison et 375 000€ d’amende (C. com., art. L. 241-3 et s.)100
Livre de procédures fiscales (LPF), art. L. 266.101
C. civ., art. 1844. 102
C. com., art. L. 223-28.103
Bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumises aux assemblées, procès-verbaux 104
de ces assemblées. C. com., art. L. 223-26 et R. 223-15.105
C. com., art. L. 223-26 al. 2, et R. 223-18.106
�10
commissaire aux comptes, 15 jours au moins avant la date de l’assemblée. Ils peuvent également poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée . Dans tous les cas, l’associé peut demander au président du tribunal de commerce 107
statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte le gérant de lui communiquer ces informations, soit de désigner un mandataire charger d’y procéder . 108
En troisième lieu, les associés peuvent deux fois par exercice des questions écrites au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes . En outre, un ou plusieurs associés représentant 109 110
au moins 1/10ème du capital social, peuvent individuellement ou en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice (président du tribunal de commerce) la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opération de gestion , 111
dans les limites fixées par le juge. La demande doit reposer toutefois sur un motif sérieux , c’est-112
à-dire qu’il existe des opérations suspectes vi-à-vis de l’intérêt social réalisées par les gérants. Le rapport de l’expert fait ensuite l’objet d’une large diffusion . 113
- Les droits financiers
Les associés ont naturellement droit aux bénéfices, réserves et boni de liquidation 114
proportionnellement à leur part dans le capital social . Les statuts peuvent déroger assez 115
librement à cette règle de répartition, dans la limite des stipulations léonines . Sont également 116
prohibés les aménagements tendant à créer des clauses d’intérêt fixe ou intercalaire , ou le 117
versement d’un dividende fictif. On rappellera également les limites liées à l’abus de majorité, notamment dans des hypothèses de mise en réserve systématique des bénéfices, au détriment des minoritaires.
En contrepartie, les associés sont tenus de contribuer aux pertes, à proposition de leur part dans le capital social. Leur apport peut donc éventuellement être perdu, en tout ou partie, à l’occasion de la dissolution de la société, ou d’une réduction de capital motivée par des pertes.
- Les droits patrimoniaux
Les associés peuvent exercer des droits patrimoniaux sur leurs parts sociales. Si l’on met de côté certaines opérations comme le remembrement de propriété, le nantissement, on peut se concentrer la cession et la transmission de parts sociales.
La cession de parts sociales de SARL relève pour l’essentiel du droit commun des contrats et de 118
la vente . Des dispositions spécifiques sont toutefois prévues. 119
C. com., art. L. 223-26 al. 3.107
C. com., art. L. 238-1.108
C. com., art. L. 223-36.109
C. com., art. L. 223-37. Le ministère public ou le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes 110
fins. Ce qui exclut les décisions prises en assemblée générale. Cass. com., 30 mai 1989, Bull. Joly sociétés, 111
1989, p. 715, note P. Le Cannu. Cass. com., 21 oct. 1997, JCP E, 1998, 36, note Y. Guyon.112
Il est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes 113
ainsi qu’au gérant. Il est également annexé à celui du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et sera publié de la même façon.
C. com., art. L. 232-1.114
C. civ., art. 1844-1. 115
C. civ., art. 1844-1 al. 2.116
C. com., art. L. 232-15.117
C. civ., art. 1101 et s.118
C. civ., art. 1582 et s.119
�11
S’agissant de la forme de la vente, celle-ci doit nécessairement être constatée par écrit , à titre 120
de preuve , et être portée officiellement à la connaissance de la société, dans les formes prévues 121
à l’article 1690 du Code civil (signification ou intervention à l’acte authentique), à charge de nullité . Pour éviter ce formalisme couteux et lourd, les textes permettent le remplacement de la 122
signification par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. L’accomplissement de ces formalités et la publication des statuts modifiés au RCS (éventuellement par voie électronique) rend la cession opposable aux tiers.
S’agissant de la procédure applicable à la cession, il faut se rappeler que la SARL a un caractère intuitu personae très marqué. Par conséquent, la cession de parts sociales à un tiers peut constituer un danger. C’est la raison pour laquelle le Code de commerce prévoit une procédure d’agrément d’ordre public : les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers 123 124 125
qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant la moitié des parts sociales , à 126
moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Pour obtenir cet agrément, l’associé cédant doit notifier à la société à chacun des associés le projet de cession , à peine de nullité de l’opération . Dans les 8 jours à compter de cette 127 128
notification, le gérant doit convoquer l’assemblée des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession, ou si les statuts le permettent, il consulte les associés par écrit sur le projet . La 129
décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les associés peuvent donc soit approuver le cessionnaire, soit s’opposer à son arrivée au capital. Si la société n’a toutefois pas fait connaître sa décision dans le délai de 3 mois à compter de la notification, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de donner son agrément à la cession, plusieurs solutions de sortie sont possibles : soit l’associé renonce à la cession de ses parts ; soit les autres associés acquièrent ou ou font acquérir les parts, dans le délai de 3 mois à compter du refus ; soit la société réduit 130 131
son capital du montant de la valeur nominale des parts de l’associé après lui avoir racheté ses parts . La société peut demander en justice dans ce dernier cas et sur justification, un délai de 132
paiement de 2 ans.
Enfin, si à l’expiration du délai imparti à compter du refus de l’agrément, aucune solution n’est intervenue, l’associé recouvre la liberté de céder ses parts sociales, au cessionnaire initialement envisagé . 133
C. com., art. L. 223-17, renvoyant à l’article L. 221-14.120
L’écrit n’a pas de vertu solennelle. La cession de parts sociales est parfaite dès l’accord des volontés.121
Cass. com., 21 janv. 2014, n°12-29221, Rev. sociétés 2014, p. 437, note A. Reygrobellet.122
C. com., art. L. 223-14. 123
L’impossibilité de déroger aux dispositions légales invitent parfois certains cédants à frauder : Cass. 124
com., 21 janv. 1997, Bull. Joly sociétés 1997, p. 465, §187, note P. Le Cannu. La notion de cession est entendue très largement : volontaire, forcée, échange, donation, etc. 125
L’associé cédant n’étant pas exclu du vote, il est assuré d’obtenir l’agrément s’il est majoritaire. 126
Par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. com., art. R. 127
223-11 al.1) Cass. com., 21 janv. 2014, n°12-29221, PB, Bull. Joly sociétés, 2014, p. 250, note B. Saintourens.128
C. com., art. R. 223-12.129
Le gérant peut demander en justice la prolongation de ce délai, jusqu’à 6 mois.130
A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code 131
civil. Cette solution n’est toutefois ouverte qu’aux associés détenant leurs parts depuis au moins 2 ans (sauf 132
s’ils les ont acquis par voie de succession, liquidation de communauté de biens entre époux, donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant). C. com., art. L. 223-14 al. 6.
Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-15887, PB, Dr. sociétés, 2012, n° 8, obs. D. Gallois Cochet.133
�12
Lorsque la cession est envisagée au profit d’un associé , elle est en principe libre. Pour 134
préserver l’équilibre des pouvoirs, les statuts peuvent toutefois stipuler une clause d’agrément. Dans ce cas, il faudra alors respecter la procédure légale précédemment décrite, mais avec tout de même la possibilité de réduire la majorité ou d’abréger les délais.
Lorsque les parts sociales sont également librement transmissibles (succession, liquidation de commenté de biens entre époux) ou cessibles (entre conjoints et entre ascendants et descendants) au sein d’une même famille . Il est toutefois loisible aux statuts de contrôler 135
l’arrivée de nouveaux associés par cette voie en prévoyant l’application d’une procédure d’agrément dans les conditions de l’article L. 223-14 . 136
En outre, en cas de décès de l’un des associés, les statuts peuvent prévoir que la société continuera soit avec son héritier, soit avec les seuls associés survivants. Lorsque l’héritier n’est pas agréé ou que la société continue avec les seuls survivants, il est prévu de vers la valeur des droits sociaux à l’héritier. Dans le cas contraire, l’ouverture de la succession emporte attribution immédiate des parts sociales au profit de l’héritier.
2. La collectivité des associés
A titre principal, les associés sont amenés à prendre les décisions, réunis en assemblée. Toutefois, il est possible de prévoir des alternatives à ce mode de décision. Nous préciserons en dernier lieu les pouvoirs de l’associé unique.
- Les assemblées d’associés137
Les assemblées sont convoquées en principe par le gérant , et peuvent l’être sur demande d’un 138
ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales. En outre tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
La convocation doit être faite au moins 15 jours avant l’assemblée générale, par lettre recommandée , et contenir l’ordre du jour ainsi que les documents destinés à informer à les 139
actionnaires . La violation des règles de convocation entraîne la nullité facultative de 140
l’assemblée . 141
Il doit se tenir au moins une assemblée générale par exercice, au moins pour soumettre à l’approbation des associés, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels , dans les 6 142
mois de la clôture de l’exercice . A défaut pour le gérant d’avoir réuni l’assemblée générale 143
annuelle dans ce délai, toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal de commerce statuant en référé pour enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette
C. com., art. L. 223-16 al. 1. 134
C. com., art. L. 223-13 al. 1. 135
Les délais prévus pour statuer sur l’agrément ne doivent pas être plus longs que ceux prévus à l’article 136
L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte. C. com., art. L. 223-27.137
Et subsidiairement par le commissaire aux comptes. 138
C. com., art. R. 223-20.139
Ce sont ceux prévus à l’article L. 223-26 du Code de commerce. 140
C. com., art. L. 223-27 dern. al. En l’occurence, l’action en nullité n’est pas recevable quand tous les 141
associés étaient présents ou représentés. Cass. com., 10 nov. 2016, n° 14-16022, Bull. Joly Sociétés, 2016, p. 149, note M. Buchberger.
C. com., art. L. 223-26 al. 1. 142
Le gérant peut toutefois demander en justice une prolongation du délai.143
�13
assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder . Le gérant qui ne convoque pas 144
l’assemblée générale annuelle encourt par ailleurs des sanctions pénales .145
Les décisions sont prises dans le cadre de délibérations à l’issue d’un vote exprimé par les associés. Les associés ne peuvent en principe se faire représenter que par leur conjoint ou un 146
autre associé , mais les statuts peuvent prévoir la représentation par d’autres personnes . 147 148
Chaque mandat est spécial, et par conséquent limité à une seule assemblée . En outre, si les 149
statuts le prévoient, les associés peuvent participer aux assemblées par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, permettant leur identification. Ces procédés ne sont toutefois permis que pour les assemblées ne modifiant pas les statuts ni pour celles statuant sur l’approbation des comptes . Les statuts peuvent également prévoir un droit d’opposition à 150
l’utilisation de ces moyens, au profit d’un nombre déterminé d’associés et pour une délibération déterminée.
La majorité requise pour adopter les résolutions dépend de la nature des décisions.
En premier lieu, s’agissant des décisions modifiant les statuts, les assemblées générales de SARL ne délibèrent valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation, 1/4 des parts sociales et sur deuxième convocation, 1/5ème. A défaut de réunir ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois maximum à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans tous les cas, l’assemblée prend ses décisions à la majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts sont libres de prévoir des quorum et une majorité plus élevés (mais pas plus faibles). 151
Il faut savoir que ces règles ne sont en principe applicables qu’aux SARL constituées après le 2 août 2005 . Pour les SARL constituées avant cette date, les textes précisent que les décisions 152
sont prises en principe, sans condition de quorum, à une majorité des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales , sans pouvoir prévoir une majorité plus élevée. Naturellement, 153
les sociétés constituées avant 2005 sont libres d’opter pour le nouveau régime.
Il existe quelques variantes : le déplacement de siège social peut être décidé par un ou plusieurs associés représentants seulement plus de la moitié des parts sociales, de même que l’augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves. L’unanimité est même parfois requise pour certaines décisions importantes : changement de nationalité , augmentation 154
des engagements des associés , transformation en SNC ou SAS .155 156
En second lieu, s’agissant des décisions de modifiant pas les statuts, les décisions sont prises à la la moitié des parts sociales . La jurisprudence autorise les statuts à prévoir une majorité plus 157
C. com., art. L. 223-26 al.1.144
9000€ d’amende. C. com., art. L. 241-5. Une consultation seulement tardive des associés semble 145
échapper à l’application des dispositions pénales. Sauf si la société ne comprend que les deux époux.146
Sauf si la société ne comprend que deux associés.147
C. com., art. L. 223-28.148
C. com., art. R. 223-21. Le mandat peut toutefois être donné pour deux assemblées si elles se tiennent 149
le même jour ou dans un délai de 7 jours. De plus, le mandat donné pour une assemblée vaut pour toutes les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
C. com., art. L. 223-27 al. 3.150
Sans aller jusqu’à exiger l’unanimité.151
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, JORF, n° 0179, du 3 aout 152
2005, p. 12639. La règle est assez stricte : la décision ne peut pas être prise tant que cette majorité n’est pas atteinte. 153
C. com., art. 223-30 al.1. 154
C. civ., art. 1836 ; C. com., art. L. 223-30 al. 5.155
C. com., art. L. 223-43.156
C. com., art. L. 223-29.157
�14
élevée . Si cette majorité n’a pas pu être obtenue (opposition des minoritaires par exemple), il est 158
possible d’organiser une seconde consultation des associés, qui pourront cette fois-ci prendre leur décision à la majorité des votes émis . Les statuts peuvent toutefois écarter cette règle.159
Un procès verbal signé par le gérant et le président de séance vient constater l’identité des associés présents ou représentés, et retracer le déroulement de la réunion .160
- Les consultations Les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés . Ce faisant, le gérant peut ainsi adresser à chaque associé 161
les décisions qui sont envisagées par lettre recommandée . Chaque associé dispose alors d’un 162
délai minimum de 15 jours (les statuts peuvent prévoir un délai plus long) pour émettre leur vote par écrit. Les règles de majorité sont les mêmes que lorsque les décisions sont prises en assemblée. Le gérant dresse un procès-verbal après avoir reçu les réponses.
Cette possibilité n’est pas autorisée pour les décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale annuelle.
- Le consentement exprimé à l’acte
En dernier lieu, l’article L. 223-27 du Code de commerce autorise les statuts à prévoir que les décisions soient prises à l’occasion du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. C’est une mesure de simplification particulièrement utile dans les petites SARL.
- Les décisions de l’associé unique
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés ainsi qu’ils ont été 163
décrits précédemment. Il va donc prendre non seulement toutes les décisions ordinaires, mais également toutes les décisions emportant des modifications des statuts, ou de révocation du gérant non associé . Ces décisions, qu’il prend seul, et dans les modalités qu’il souhaite, sont 164
consignées un registre , sous peine de nullité (qui peut être demandée par tout intéressé).165
L’associé unique, lorsqu’il n’exerce pas la gérance, a vocation à approuver les comptes sociaux dans les 6 mois à compter de la clôture de l’exercice . Toutefois, si l’associé unique exerce la 166
gérance, il n’a pas besoin de les approuver formellement : il lui suffit de les déposer au RCS avec l’inventaire et les comptes annuels. Il est à noter toutefois que la décision d’affecter le résultat est une décision distincte de l’approbation des comptes. Elle devra donc faire l’objet des mêmes démarches que pour toute autre décision de l’associé unique.
C. Le contrôle de la SARL
On retrouve dans la SARL de nombreux dispositifs permettant de contrôler la gestion. Ceux-ci peuvent être d’ordre légal : c’est notamment le cas du comité d’entreprise lorsque la société a plus de 50 salariés, mais aussi du commissaire aux comptes (a) et de la procédure des conventions réglementées (b). Nous nous concentrerons sur ces deux derniers aspects. L’ensemble de ces
Cass. com. 2 déc. 1997, D. aff., 1998, p. 33, obs. A. L.158
Même arrêt que la note précédente. 159
C. com., art. R. 223-24.160
C. com, art. L. 223-27 al. 1. 161
C. com., art. R. 223-22.162
C. com., art. L. 223-1.163
Cass. com., 9 mars 2010, n°09-11631, PB, D. 2110, p. 764.164
C. com., art. L. 223-31 al. 4.165
C. com., art. L. 223-31 al. 2. 166
�15
règles ne sont toutefois pas exclusives de dispositifs qui pourraient être prévus dans les statuts, à l’image par exemple d’un conseil de surveillance, ou d’un censeur.
a. Le commissaire aux comptes
Les SARL ne sont principe pas tenues de désigner un commissaire aux comptes. Les associés peuvent naturellement le décider de façon volontaire , par décision ou consultation écrite ayant 167
réuni plus de la moitié des parts sociales . 168
Mais, pour les SARL, les plus importantes (c’est-à-dire celles qui dépassent à la clôture d’un exercice social, deux des critères suivants : 1 550 000 d’€ au total de bilan, 3 100 000 d’€ de chiffre d’affaires hors taxes, ou 50 salariés) la désignation d’un commissaire aux comptes 169
devient obligatoire.En outre, même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins 1/10ème du capital.
b. Les conventions réglementées
Les associés comme les gérants ne peuvent pas passer librement n’importe quelle convention avec la société. On retrouve ici un système relativement proche de celui applicable dans les SA.
Ainsi, sont interdits , à peine de nullité d’ordre public : les emprunts, découverts, cautions, 170 171
avals. Cette interdiction s’applique aux gérants et aux associés, autre que de personnes morales , ainsi qu’aux représentants légaux des personnes morales associées. Elle s’applique 172
également aux conjoint, ascendants et descendants de ces mêmes personnes.
Sont en revanche soumises à une procédure de contrôle, sauf si elles portent sur des opérations courantes et qu’elles sont conclues à des conditions normales , les conventions intervenues 173
directement ou par personnes interposées, entre la société et l’un des gérants ou des associés . 174
Il en va de même pour les conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable ou un dirigeant est également associé ou gérant de la SARL.
Dans ce cas, il appartient au gérant ou, le cas échéant, au commissaires aux comptes , de 175
présenter à assemblée générale, un rapport spécial sur les conventions ainsi intervenues. Il 176
n’existe donc pas d’’autorisation préalable . Il appartient ensuite à l’assemblée générale 177
d’approuver ou de désapprouver les conventions, aux conditions ordinaires de majorité, sans que la personne intéressée, si elle est associée, ne puisse prendre part au vote, et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
C. com., art. L. 223-35.167
Il est renvoyé à l’article L. 223-29 du Code de commerce. 168
L’article R. 223-27 du Code de commerce renvoie à l’article R. 221-5 du même code, applicable aux 169
SNC. C. com., art. L. 223-21.170
Cass. com. 25 avr. 2006, Bull. Joly sociétés, p. 1024, §209, note J.-Cl. Hallouin.171
Il s’agit ici de faciliter les opérations intragroupe.172
C. com., art. L. 223-20.173
C. com., art. L. 223-19.174
Dans ce cas, les conventions doivent lui être adressées par le gérant dans le mois de leur conclusion. 175
C. com., art. R. 223-16. Si les associés sont consultés par écrit, ce rapport est joint aux documents communiqués.176
Une exception est toutefois prévue : lorsqu’il n’existe pas de commissaire aux comptes et que les 177
conventions sont conclues par un gérant non associé, il faut alors les soumettre à l’approbation préalable de l’assemblée (C. com., art. L. 223-19 al. 2).
�16
Les conventions désapprouvées par l’assemblée (voire plus simplement, non soumises à l’approbation des associés) produisent néanmoins leurs effets, mais à charge pour la personne intéressée, de supporter individuellement ou solidairement, les conséquences du contrat préjudiciables à la société . 178
Les conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice, font l’objet d’une information auprès du commissaire aux comptes, dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice . 179
Dans le cadre d’une EURL, seul l’associé unique est en mesure d’approuver les conventions qu’il aurait conclu avec la société, dans des formes très simples : il doit seulement en faire mention au registre des décisions . 180
Section III. Les mutations de la SARL Comme toute société, la SARL est amenée à évoluer pour s’adapter à son activité ou à son environnement, notamment en modifiant son capital (A) ou en se transformant (B). Elle est aussi amenée à disparaître par voie de dissolution (C).
A. La modification du capital
Sans véritable spécificité par rapport aux sociétés par actions, la SARL peut être amenée à augmenter (1) son capital ou à la réduire (2).
1. L’augmentation de capital
La modification du capital ayant pour effet de modifier les statuts, il appartient aux associés réunis en assemblée générale extraordinaire de la décider. Une exception est toutefois prévue : si l’augmentation de capital est réalisée par voie d’incorporation de bénéfices ou de réserves, elle peut être prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales . On ajoutera 181
que l’arrivée de nouveaux associés impliquera le respect de la procédure d’agrément.
L’augmentation de capital par voie d’apports en numéraire ne peut être réalisée qu’à la condition 182
que tous les apports précédents aient été entièrement libérés , à peine de nullité. Quant aux 183
parts résultant de l’augmentation de capital, elles doivent être intégralement souscrites, mais peuvent être libérées partiellement à hauteur d’1/4 de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai de 5 ans à compter du jour où l’augmentation de capital est devenue définitive . Le retrait des fonds s’effectue dans les mêmes 184
circonstances que lors de la constitution de la société, de même que leur récupération, dans l’hypothèse où l’opération ne serait finalement pas réalisée . 185
La loi ne prévoit aucun droit préférentiel de souscription ni de règles relatives à la prime d’émission. Sans stipulations spécialement dédiées à ces questions, ou décision des associés à l’occasion de l’augmentation de capital , il n’en existe donc pas. 186
V. par ex., Cass. com. 28 juill. 1988, Rev. sociétés, 1988, p. 545. 178
C. com., art. R. 223-16 al. 2. 179
C. com., art. L. 223-19 al. 3.180
C. com., art. L. 223-30 dern. al. 181
C. com., art. L. 223-32.182
C. com., art. L. 223-7 al. 1. 183
C. com., art. L. 223-32 al.1. 184
Cf. C. com., art. L. 223-8.185
V. par ex. Cass. com., 18 avr. 2000, Bull. Joly sociétés 2000, p. 920, note J.-J. Daigre.186
�17
Lorsque l’augmentation de capital est réalisée par voie d’apports en nature , les règles sont les 187
mêmes que lorsque ce type d’apport a lieu lors de la constitution de la société : désignation d’un 188
commissaire aux apports à l’unanimité des associés, ou à défaut par décision de justice, à la demande d’un associé ou du gérant ; évaluation des apports par ce commissaire désigné ; responsabilité solidaire des gérants et des personnes ayant souscrit à l’augmentation de capital , pendant 5 ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports, si aucun commissaire aux apports n’ a été désigné, ou si une valeur différente de celle établie par le commissaire aux apports a été retenue.
2. La réduction de capital
Pour les raisons déjà exposées, la SARL peut être amenée à réduire son capital. Cette décision, prise par les associés en assemblée générale statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts , peut être justifiée pour faire face à des pertes ou au contraire pour 189
procéder une distribution de liquidités aux associés , sans pouvoir porter atteinte à l’égalité des 190
associés.
Cette décision peut être prise également dans l’hypothèse où la société a perdu la moitié de son capital , lorsque les associés ont décidé de poursuivre l’activité et de ne pas prononcer la 191
dissolution.
B. La transformation de la SARL
La SARL peut en outre se transformer pour adopter une autre forme sociale. Les textes posent toutefois certaines exigences, dont la violation entraîne la nullité de l’opération : 192
En premier lieu, la transformation en SNC, SCS ou SCA, qui sont des formes de sociétés exposant les associés à un risque plus grand, ne peut perte prise qu’avec l’accord unanime de tous les associés . La décision doit être précédée d’un rapport d’un commissaire aux comptes sur la 193
situation de la société.
En deuxième lieu, la transformation en SA peut être décidée à une majorité moins exigeante : la 194
majorité requise pour la modification des statuts est suffisante. Elle peut même être décidée par les associés représentant la seule majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros . Un rapport du commissaire aux comptes sur la situation 195
de la société est également exigé. En outre, lorsque la SARL n’a pas de commissaire aux comptes, il convient de désigner un ou plusieurs commissaire à la transformation, chargé 196
d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers . Dans ce 197
cas, il peut prendre en charge par ailleurs le rapport sur la situation de la société.
C. com., art. L. 223-33.187
Il est renvoyé à l’article L. 223-9.188
C. com., art. L. 223-34. 189
Un droit d’opposition des créanciers est également prévu. C. com., art. L. 223-34 al. 3. 190
Pour le détail de la procédure : C. com., art. L. 223-42. C’est en tous points similaire à ce qui a déjà 191
exposé dans le cadre de la SA. A l’exclusion des dispositions relatives au commissaire à la transformation (C. com., art. L. 224-3), qui 192
n’évoquent de l’hypothèse de la nullité à défaut d’approbation expresse de la transformation par les associés.
C. com., art. L. 223-43 al. 1. 193
C. com., art. L. 223-43 al. 2. 194
Il faut y voir ici une mesure d’incitation des « grosses » SARL en SA. 195
A l’unanimité des associés ou à défaut, par décision de justice. 196
C. com., art. L. 224-3.197
�18
En dernier lieu, la transformation en SAS, exige à son tour l’unanimité des associés . Un rapport 198
du commissaire aux compte sur la situation de la société est également exigé. A défaut de commissaire aux comptes, il est également exigé de désigner un commissaire à la transformation.
C. La dissolution de la SARL
Outre les hypothèses de dissolutions applicable en vertu du droit commun à toutes les sociétés , 199
les SARL peuvent encourir la dissolution en cas de dépassement du nombre de 100 associés, à défaut de régularisation au terme d’un an, ou de transformation en une autre forme sociale . 200
En revanche, ni le décès, ni l’incapacité, ni la faillite personnelle d’un associé ne provoquent cette dissolution, sauf stipulations statutaires le prévoyant (ce qui vient tempérer la force de l’intuitus 201
personae dans la SARL) pas plus que la réunion des parts en une seule main , qui se traduit 202
simplement par le passage à l’EURL.
Dans une EURL, les effets de la dissolution doivent être distingués selon que l’associé unique est une personne physique ou une personne morale. S’il s’agit d’une personne morale, la dissolution emporte transmission universelle du patrimoine à l’associé unique sans que cela donne lieu à liquidation (l’associée unique recueille alors la totalité de l’actif et du passif de l’EURL dissoute). 203
S’il s’agit d’une personne physique, la dissolution de l’EURL emporte sa liquidation (l’actif et le 204
passif doivent être répartis).
C. com., art. L. 227-3.198
C. civ., art. 1844-7.199
C. com., art. L. 223-3.200
C. com., art. L. 223-41.201
C. com., art. L. 223-4.202
C. civ., art. 1844-5 al. 3. Pour une illustration : Cass. soc., 12 janv. 2016, n° 14-21533, Bull. Jolys 203
sociétés, mai 2016, p. 281, note R. Raffray. C. civ., art. 1844-5 al. 4.204
�19