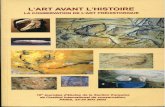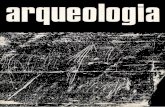Contribution à la reconnaissance de traits culturels pertinents dans les arts rupestres sahariens....
Transcript of Contribution à la reconnaissance de traits culturels pertinents dans les arts rupestres sahariens....
83
Contribution à la reconnaissance de traits culturels pertinents dans les arts rupestres sahariens. Étude de cas : la station d’Ozan
Éhéré (Tassili-n-Ajjer, Algérie) Contribution in acknowledgment of relevant cultural features
in Saharan rock arts. Case Study: the rock art station of Ozan Éhéré(Tassili-n-Ajjer, Algeria)
Amel Mostefaï
UMR 5608 (TRACES),Université de Toulouse le Mirail II5, allées A. Machado, 31058 Toulouse CedexCourriel : [email protected]
Résumé : Au Sahara central, on a souvent confondu culture et identité raciale, mode de vie supposé, technique ou style des œuvres, tandis qu’on y a indûment distingué « europoïdes, négroïdes, pouloïdes », et de manière hâtive chasseurs, pasteurs, graveurs et peintres. J’évoquerai les solutions partielles aux problèmes que pose ce contexte difficile, par l’étude du cas d’Ozan Éhéré, dont le répertoire iconographique éclaire d’un jour nouveau les relations entre certains groupes.
Mots-clefs : Cultures préhistoriques, attributions anthropologiques, peintures, gravures, Tassili-n-Ajjer.
Abstract: In central Sahara, culture has often been mixed up with racial identity, supposed way of life, technique or style of works, whereas “europoïdes, négroïdes, pouloïdes” have been wrongly distinguished, and hastily named hunters, pastoral people, engravers and painters. I will mention partial solutions to the issues of this difficult context, through the case of Ozan Éhéré, which iconography provides us new information about the relations between some of these groups.
Keywords: Prehistoric cultures, anthropological attributions, pictographs, petroglyphs, Tassili-n-Ajjer.
Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, tome LXIV, 2009, p. 83 à 93Préhistoire, Art et Sociétés
84
Aborder la question de la définition des espaces culturels préhistoriques par le biais de l’art rupestre, c’est enrichir notre réflexion de documents particulièrement prolixes, mais aussi multiplier les difficultés. J’évoquerai le cas emblématique de la recherche saharienne aux prises avec une documentation rupestre à la profusion et à la variété inouïes. Outre des difficultés de terrain nombreu-ses, l’état des connaissances sur la question révèle ici les impasses et les errements auxquels une telle recherche peut s’exposer. Au Sahara, on a semble-t-il toujours peu ou prou confondu « culture » et « identité raciale » ou « ethnique ». La littérature spécialisée est émaillée de références à des populations « europoïdes », « pouloïdes », « négroïdes »..., attributions difficilement recevables. On s’y est également appliqué à reconnaître des groupes selon leur mode de vie supposé, esquissant un tableau respectueux de l’évolution des modes de subsistance au cours de la Préhistoire : aux groupes de chasseurs unis dans une même gangue culturelle succèdent des pasteurs appartenant résolument à un horizon nouveau, avant que la désertification ne condamne les habitants du Sahara à un mode de vie plus chiche. Or il semble aujourd’hui difficile d’affirmer qu’il existe dans l’art rupestre saharien une période archaïque qui soit le fait de chasseurs exclusifs et que la domestication n’y ait fait son apparition que dans une période seconde. De même, rien ne justifie l’établissement d’une histoire culturelle hachée, au cours de laquelle les groupes s’engrènent sans qu’aucun lien ne se puisse jamais établir entre eux, sinon un rapport temporel de succession.
La notion d’« espace culturel » y reste donc largement à explorer. Outre les problèmes de sa définition qui marquent d’incertitude et de subjectivité toute tentative de reconstitution de l’espace-temps investi par une culture préhistorique, la mise en évidence d’un espace culturel se complique du fait que l’archéologue saharien ne peut souvent invoquer que le seul document rupestre, soit l’objet le plus complexe et le plus insaisissable qui soit : l’art.
Après un rapide détour historiographique, je traiterai des tentatives de dépassement de ces problèmes, à travers les conclusions de quelques travaux récents (Le Quellec, 2004 ; Gauthier, 2006). Dans une perspective structurale, j’aborderai la question des rapports entre anthropomorphes « Bovidiens » et « Têtes Rondes » de la station d’Ozan Éhéré. La présence diffuse mais remarquable de gravures au sein de cet ensemble pictural nous fournira également l’occasion d’aborder la question des rapports entre ces deux modes d’expression artistique qui, jusqu’il y a peu, constituaient des traits culturels divergents.
1. Les cultures et espaces culturels du Sahara central d’après la littérature
Depuis la découverte, en 1850, des gravures, puis dans les années 1930, des peintures sahariennes, la documentation rupestre saharienne1 n’a cessé de s’enrichir dans des proportions qui n’ont d’égal que sa difficulté d’étude archéologique.
1.1. Construction des espaces culturels sur une base documentaire fragile
Il est inutile d’insister sur les difficultés propres à un terrain aussi singulier que le désert du Sahara, sinon pour répéter que si ce milieu est particulièrement bénéfique à la conservation des peintures2, il l’est bien moins pour les vestiges osseux et autres matériaux organiques. La déflation et l’extrême sécheresse y sont responsables de la rareté des accumulations sédimentaires. Les possibilités de fouilles y sont réduites et, dans la plupart des cas, le matériel archéologique affleure, mélangé. En conséquence, l’art mobilier y est délicat à étudier3. Autant de singularités qui obligent à penser des méthodes d’étude propres à ce contexte. Pour les abris peints du plateau des Ajjers, aucune fouille à la base des parois n’a permis d’établir d’indubitables relations entre couches archéologiques et documentation rupestre4. La datation de ces arts est encore incertaine et controversée, comme l’atteste la coexistence de deux options chronologiques que quelques dix millénaires séparent (fig. 1).
La région pose, en outre, aux rares équipes qui ont pu y travailler, des problèmes d’étude du fait de son immensité, de sa profusion en vestiges archéologiques et du manque chronique de moyens. Il en résulte un profond déséquilibre entre ses potentialités archéologiques et un état de la recherche saharienne d’autant plus insatisfaisant que, durant des décennies, des pratiques et des méthodes inadéquates, peu rigoureuses, parfois franchement néfastes5, y ont été appliquées. C’est notamment la
1 Les premières, en Libye, par l’explorateur allemand Heinrich Barth, les secondes (signalées dès 1910 par le capitaine Cortier), sur le plateau des Ajjers, par le lieutenant Charles Brenans.2 Pourvu qu’elles soient abritées par un auvent des intenses éolisation et exposition solaire (abris en taffoni).3 « Rondes-bosses », gravures animalières sur œuf d’autruche, statuettes en terre cuite...4 Dans l’état actuel de nos connaissances, seules les datations relatives de Uan Muhuggiag et de Uan Telocat (Mori, 1970), dans l’Akâkûs proche, fournissent des éléments de datation radiométriques.5 « Humidification » des parois (pour reprendre l’euphémisme utilisé par Lhote), crayonnage-détourage au crayon ou au charbon de bois des contours, apposition de « vernis protecteurs » expérimentaux aux conséquences désastreuses.
Amel Mostefaï
85
fiabilité des relevés (relevés des gravures à main levée ou relevés artistiques des œuvres peintes (Lajoux, 1977)), le manque d’exhaustivité des enregistrements documentaires (Le Quellec, 1993) et la datation subjective des ensembles (Muzzolini, 1983) qui font l’objet de reproches justifiés. La plus élémentaire prudence nous enjoint à douter des « faits » qui paraissaient établis dans ces conditions, notamment des faits culturels. Il convient de garder à l’esprit qu’il en a résulté un isolement artificiel des rupestres relevés de leur contexte.
1.2. Construction des espaces culturels sahariens sur une base méthodologique fragile
S’y ajoute un isolement supplémentaire en groupes de figurations clairement différenciés et imperméables les uns aux autres, sur la base de considérations irrecevables.Aux yeux de nos prédécesseurs, la première des distinc-tions culturelles fondamentales était d’ordre ethnique, ou plus justement racial. On ne peut que souscrire à la critique que Muzzolini en a faite (1986), soulignant l’absence de corrélation entre « style » des œuvres et « identité ethnique » et l’inadmissible glissement sémantique qui en résulte. Pourtant, sa révision de l’attribution raciale des « Têtes Rondes » à des « europoïdes » procède bien de la méthode anthropométrique. Loin de faire davantage la lumière sur le type anthropologique des figures, sa « démonstration par le document rupestre » souligne au contraire le caractère contestable des « preuves6 » récoltées . Plus grave que les jugements de valeur souvent portés sur ces anatomies7 et que la subjectivité évidente de bien des attributions8, est la pauvreté sémantique du concept de « culture » dans la démarche scientifique saharienne, qui croit encore généralement trouver dans des distinctions raciales les raisons d’être culturelles profondes et les modalités d’expression d’un groupe préhistorique. C’est à la lumière de telles croyances qu’il faut comprendre l’accueil enthousiaste (Lhote, 1972) fait
à la théorie interprétative d’Amadou Hampaté Bâ (1966) sur les fresques « bovidiennes » du Tassili à la lueur des cosmologie et ritologie peules subactuelles9, ainsi que sa longévité dans la littérature jusqu’à aujourd’hui. En dépit des mises en garde des ethnologues et anthropologues, l’attitude classique en recherche saharienne relève encore très largement de la persistance de l’idéologie raciste du XIXe et de la première moitié du XXe siècle10. Je ne m’appesantirai pas sur les considérations d’ordre économique, sinon pour rappeler les critiques formulées à l’encontre de la paradigmatique division culturelle entre « Peuples de Chasseurs », et « peuples de pasteurs ». Lorsqu’il y a 25 ans, Muzzolini récusait l’existence d’une « période bubaline », supposée archaïque et être exclusivement le fait de chasseurs, se contentant d’y voir un « style » ou une « école particulière de gravures d’âge bovidien », il se basait sur une critique serrée des chronotypologies traditionnelles (Lhote, Mori) mais aussi sur des documents généralement écartés. Les travaux d’inventaire des gravures du Messak (Van Albada, 1994 ; Le Quellec, 1998) ont apporté, depuis, une nouvelle confirmation archéologique magistrale à sa thèse. Une base documentaire indiscutable, riche de plus de 60 scènes figurant des troupeaux, de scènes de traite, de multiples figurations de traits incontestablement domestiques (pendeloques, cornages.), traités dans le singulier style « bubalin » du Messak, y atteste d’une pratique consommée de l’élevage par ce groupe de créateurs.
Une autre division culturelle importante paraissait établie en matière de technique mise en oeuvre. Du fait d’aires de répartition différenciées entre artefacts gravés et artefacts peints (Ill. 1), nos prédécesseurs avaient déclaré non fortuite, mais culturelle, une telle distribution dichotomique. Pourtant dès les années 1950, on signalait la présence de figures mixtes sur les sites peints tassiliens (Tschudi, 1956 ; Lhote, 1957). Les dernières décennies ont permis d’enrichir considérablement le répertoire pétroglyphique de zones à priori dévolues aux seules peintures (Ferhat, Striedter, Tauveron, 2000)11.
6 Se fondant sur un critère que lui-même juge « fort contestable », le degré de prognathisme, et sur « les figurations non ambiguës, de quelques visages et de quelques anatomies » – que l’auteur sait rares dans une école qui « cultive surtout l’expression conventionnelle » –, Muzzolini n’en décrète pas moins qu’ « aucune hésitation n’est possible » quant à cette attribution (1986, p. 171).7 Ainsi est-on invité à apprécier les subtilités suivantes : « allure europoïde », anatomies plus « graciles », « lèvres peu lippues » et « silhouettes plus élancées »...8 Muzzolini avouait que les traits « négroïdes » « ne se concentrent jamais tous sur une composition donnée, encore moins sur un individu isolé, il nous suffit (l’appréciation subjective est ici inévitable) qu’ils apparaissent en nombre suffisant » (1986, p. 181). L’auteur, du reste, n’hésite pas à attribuer à une volonté toute caricaturale ou symbolique – sinon relevant du plus pur hasard technique – les cas de figurations de ces traits sur des figures considérées comme « non négroïdes ».
9 Dont une part importante remonte pourtant au XIIIe siècle, ainsi que Le Quellec l’a montré, 2004, p. 18.10 Ainsi, Muzzolini estime-t-il possible et fructueuse l’utilisation de la notation des traits physiques (« voire la notion de ‟groupes raciaux” (idem, p. 180) comme critères discriminants d’un point de vue culturel).11 Avec la découverte, dans la Tadrart algérienne, de plusieurs centaines de figurations d’un type particulier dit « Kel Essuf », gravées à même des parois souvent ornées de peintures.
Contribution à la reconnaissance de traits culturels pertinents dans les arts rupestres sahariens : la station d’Ozan Éhéré
86
L’idée d’une histoire universelle linéaire, faite de progrès et de dépassements, sous-tend toutes les tentatives de classifications sahariennes (particulièrement celles basées sur le style12, avant les travaux de Muzzolini). Remarquons pour finir que nous la trouvons également formulée en matière de pratiques religieuses et de relation au « sacré ». Ainsi, l’histoire de l’art rupestre saharien y relèverait-t-elle d’une « laïcisation progressive » (Muzzolini,1992, p. 42) et d’une hiérarchisation toujours plus complexe des sociétés. Ce paradigme y était du reste renforcé par la nature supposée documentaire des arts rupestres sahariens (exception faite pour les « Têtes Rondes »). Nonobstant le fait que des critiques solides l’ont mis à bas13, les études basées sur ce préjugé
tenace ignorent délibérément bien des faits comme l’existence probable de sociétés dites « aniconiques », l’impact majeur du processus taphonomique et des aléas de la recherche sur l’étendue de nos connaissances, la dimension symbolique des œuvres. Il apparaît donc que l’on a affirmé, sur les images rupestres sahariennes et leurs auteurs, bien des choses que la prudence scientifique n’autorise pas à relayer.
1.3. Tentatives de dépassement
La mise en relation délicate entre les images rupestres et d’autres vestiges archéologiques a été tentée entre autres chercheurs par les Gauthier, dans le cadre d’une archéologie comparée des monuments funéraires et de l’art rupestre. Les conclusions de leurs travaux ont mis en lumière les relations qui pouvaient s’établir notamment entre gravures dites de l’« école du Messak » et monuments en corbeille, et entre peintures dites de l’« école d’Iheren-Tahilahi » et monuments en trous de serrure (Gauthier, 2004, 2006). Pour provisoires que soient ces résultats, ils soulignent la possibilité et les potentialités d’une telle approche.
Une mise en relation structurale des groupes à l’échelle régionale a été tentée par Le Quellec à propos des thérianthropes cynocéphales du Messak, du Tassili-n-Ajjer et de l’Akâkûs. Les résultats de son analyse montrent
Figure 1 : Carte de la région. A gauche, les chronologies longue (F. Mori), moyenne (H. Lhote) et courte (A. Muzzolini) de l’art rupestre saharien.Figure 1: Map of North Africa and Sahara. Long-term, middle and short-term chronologies of Saharan rock art.
12 Sur lesquelles nous ne croyons pas nécessaire de revenir, sinon pour rappeler que de telles constructions sont empreintes de préjugés et de présupposés multiples. L’appréciation subjective des styles souvent mal ou tout simplement non définis et une conception pour le moins surannée d’une histoire de l’art au rythme ternaire (impliquant souvent une emphatisation du temps supposé s’être écoulé entre deux styles, Lhote, 1958) les condamnent.13 Qui ont su souligner la naïveté d’une telle approche. Avec la découverte de l’art paléolithique, notamment, « l’idée de progrès [dans les arts] meurt un après-midi d’été 1879, près de Santander, en Espagne (...) » (citation de Claude Roy empruntée à Lorblanchet, 1999, p. 9).
Amel Mostefaï
87
que ce motif important s’y distribue de telle manière et avec de telles caractéristiques que la confrontation des zones suggère une lecture en miroir quasi-parfaite, compatible avec l’existence de deux aires culturelles s’ignorant si peu qu’elles l’ont construit en complète opposition l’une à l’autre (Le Quellec, 2004, p. 29).
2. Contribution à la caractérisation de traits culturels pertinents. Étude d’Ozan Éhéré
La station d’Ozan Éhéré ouvre des perspectives d’étude intéressantes du fait de sa richesse, de son hétérogénéité iconographique et de sa profusion en matériel rupestre. Je présenterai ici les résultats préliminaires de mes recherches sur certains aspects, envisagés dans une perspective structurale, tels la comparaison entre anthropomorphes de divers styles, ou la présence et la place des témoignages gravés dans cet ensemble essentiellement pictural.
2.1. Présentation de la station et méthodologie
Découverte en 1960 par le photographe Jean-Dominique Lajoux, Ozan Éhéré14 est une riche station de peintures de la région de l’Edjerit, sur le plateau des Ajjers, située à une trentaine de kilomètres de la ville de Djanet, à quelques 1 700 mètres d’altitude, et à deux heures de marche de la célèbre station de Jabbaren. Elle est elle-même bien connue pour ses peintures de style dit « bovidien » et notamment de « Séfar-Ozanéaré » (Lajoux, 1977). Du fait de sa découverte tardive, en dehors du cadre des « missions Lhote », et de son caractère excentré par rapport aux circuits touristiques traditionnels, la station est peu visitée. Elle m’a paru présenter les conditions d’étude les plus satisfaisantes dans une zone où de nombreux témoignages avaient subi des dommages certains. À l’instar des autres sites de la région, elle n’avait pas fait l’objet d’une tentative d’enregistrement exhaustif de son matériel pictural. Son étude m’a permis d’en entrevoir la richesse, de compléter le répertoire connu de nombreuses figurations de style « Têtes Rondes », de représentations de style d’« Iheren-Tahilahi », ou de témoignages gravés, ainsi que d’y distinguer l’existence d’au moins trois sites. En outre, elle m’a permis de mesurer la difficulté de distinguer les groupes racialement définis de « Séfar-Ozanéaré » et d’« Abaniora » (Muzzolini, 1986).
Du fait de la séparation des images rupestres en groupes stylistiques irréductibles et en vertu de considérations diverses15, on s’était interdit de confronter
les ensembles. De fait, je pense qu’a été négligée une des possibilités de compréhension de ces arts, que les documents eux-mêmes – et l’exemple d’Ozan Éhéré n’est pas à cet égard original – suggèrent d’établir.
2.2. Les anthropomorphes d’Ozan Éhéré
Les anthropomorphes représentent à Ozan Éhéré une composante dominante, tant d’un point de vue numérique (plus de 300 figures, soit 49% de l’ensemble) que du point de vue thématique, si bien qu’il n’est pas insensé de parler ici d’un véritable « règne des personnages ».
En matière de localisation, des différences substantielles distinguent les « Têtes Rondes » des autres figures dites « bovidiennes » de cette station16. Á Ozan Éhéré I, les premières occupent préférentiellement un espace compris dans l’aire sud-ouest du site, mais les parois ornées de ces figurations comptent également des anthropomorphes « bovidiens » nombreux, souvent immédiatement juxtaposés, sinon superposés à elles. Il en résulte que si le premier des grands types a nécessité une mise en place précise, de telles figurations n’y vont pas sans le second. À Ozan Éhéré II, à l’inverse, les deux grands types semblent se partager cette fois l’espace de manière quasi-parfaite : chacun d’eux occupe préférentiellement un des deux couloirs juxtaposés17. Dans l’état actuel de nos connaissances, les mélanges y sont extrêmement rares et les cas de superpositions de groupes absents. Cette ségrégation forte, au regard de l’organisation du site I, permet d’envisager l’existence d’un lien qui ne serait pas de simple proximité entre ces deux grandes catégories stylistiques. Sans qu’il soit possible de déterminer la place chronologique et culturelle de chaque groupe, il est au moins permis de douter que ces ensembles se soient ignorés18.
Mais le rapprochement qui peut se faire entre « Têtes Rondes » et « bovidiens » n’est pas seulement d’ordre spatial. Si la mise en évidence de figuration des organes sensoriels et sexuels n’est pas aisée sur des figures généralement altérées, de rares cas où ces détails sont manifestes invitent à s’interroger. Les éléments
14 Toponyme généralement transcrit sous la forme « Ozanéaré » dans la littérature. Nous lui avons préféré une forme plus proche de sa signification en tamahâq : « partage des chèvres ».15 Notamment critiques vis-à-vis de la méthode structuraliste (Muzzolini, 1995).
16 On pourrait invoquer ici l’effet du processus taphonomique altérant préférentiellement des œuvres plus anciennes, mais il faut noter (sans que cela soit un contre-argument contraignant) que les « Têtes Rondes » d’Ozan Éhéré nous ont paru relativement mieux conservées que les figures « bovidiennes ».17 Mais il nous faut préciser tout de suite que l’exploration de ce second site débute et que son inventaire rupestre est à peine entamé. L’avenir pourrait nous amener à rectifier ces constats.18 Ou – si l’on s’en tient aux typochronologies classiques – que les « bovidiens » aient ignoré les « Têtes Rondes ».
Contribution à la reconnaissance de traits culturels pertinents dans les arts rupestres sahariens : la station d’Ozan Éhéré
88
consignés dans ce cadre, bien que provisoires, appellent en effet quelques remarques. La comparaison des figures relève pour l’heure une forte divergence dans le traitement de ces dimensions entre groupe d’« Iheren-Tahilahi » et reste des figurations (Ill. 2).
L’originalité de ce groupe à Ozan Éhéré paraît d’autant mieux marquée que les figurations d’Iheren-Tahilahi y occupent une position marginale (en nombre, les zoomorphes y sont dominants), mais leur présence paraît nécessaire sur les parois ornées de « bovidiens », qui en comptent quasiment toutes au moins un spécimen. À l’inverse, le reste des figurations – « Têtes Rondes » comme « bovidiennes » – paraît répondre à des impératifs proches en matière de représentation humaine. La représentation des organes sensoriels y est généralement réduite à l’expression d’un seul sens (sauf cas exceptionnel d’un anthropomorphe féminin (Ill. 2. figure 1). Il s’agit souvent de l’ouïe chez les « Têtes Rondes » (avec les figurations d’oreilles pour le moins inhumaines, oreilles de lagomorphe, oreilles de type dit « Mickey »), sinon d’yeux (laissés en réserve) ou de la marque du nez chez les « Bovidiens » en aplat. Cette réduction, il est vrai, pourrait n’être que conjoncturelle. La réalisation de ces détails dans un pigment ou dans une matière particulière et fragile pourrait facilement expliquer leur disparition, et en outre des figurations « Têtes Rondes » semblent attester le port de masques. Mais il resterait tout de même à se questionner quant à une extraordinaire convergence dans les moyens employés, sinon quant à un résultat final comparable et qui ne serait pas anodin. D’autant qu’à cette rareté des figurations sensorielles peut être adjointe celle de la figuration des organes sexuels. Cette dimension a manifestement été omise sur la quasi-totalité des figures peintes d’Ozan Éhéré. Là encore, le parallèle entre « Têtes Rondes » et « bovidiens » en aplat nous paraît remarquable. D’autant que, pour l’un comme pour l’autre, dans la quasi-totalité des cas incontestables, ce sont des figurations féminines qui sont à l’honneur19. La rareté des figurations explicites de ce point de vue dans des arts qui n’ont souvent pas fait l’impasse sur cette dimension importante – comme l’attestent des scènes de coït – pose question. La profusion relative des figurations féminines au sein d’un ensemble globalement « neutre » de ce point de vue souligne à notre sens le caractère symbolique de toutes ces œuvres. Elle n’appelle pas forcément une interprétation masculine du reste des figurations de l’ensemble. En effet, s’ils se révèlent extrêmement rares, les cas de figuration explicite du phallus existent (fig. 2 : 4, 10).
Ce déséquilibre « féminin / masculin », ces raretés et ces absences remarquables posent question. Il s’ensuit que l’idée d’une permanence culturelle dans l’art rupestre de la région n’est pas en soi à rejeter par principe, cependant qu’une telle permanence ne signifierait pas pour autant que les systèmes de pensée soient exactement les mêmes. Dans l’ordre d’une interprétation structurale de ces constats préliminaires, on peut suggérer le fait que ces omissions concourent toutes à une plus grande « neutralité » des figures, à une moins grande « individualisation » des anthropomorphes. Tous éléments invitant à en faire une lecture symbolique, même – et peut-être surtout – pour les figurations « bovidiennes » jugées d’ordinaire comme les plus banales de ce point de vue. Les rares figures féminines appellent d’ailleurs, à Ozan Éhéré, une lecture d’ensemble qui souligne l’importance du thème « maternel ». Ainsi, le sujet de la « mère et de son enfant » y est-il traité à plusieurs reprises, dans différents styles (fig. 2 : 2, 9, 8), et à cet égard, il me paraît important de souligner également que les rares représentations humaines phalliques (ou possiblement phalliques) d’Ozan Éhéré occupent généralement une position haute habituellement dévolue à la figuration d’un grand bovin (dont il ne subsiste parfois que l’encornure).
2.3. Présence subtile mais remarquable de gravures en contexte pictural à Ozan Éhéré
Au Sahara, de manière plus frappante encore qu’ailleurs, la maxime selon laquelle « on ne trouve que ce que l’on cherche » peut être perçue dans toute son acuité. Ce qui frappe de prime abord en ce qui concerne les gravures de la station, c’est leur présence subtile, diffuse, peu visible au départ. Mais une fois celle-ci constatée, elle s’enrichit considérablement au fil des observations. Il en résulte une « profusion relative » de témoignages graphiques gravés. Ainsi peut-on décompter20 pour la station une dizaine d’unités ou d’ensembles gravés. Bien entendu, comparée à la profusion de vestiges peints21, la proportion de gravures est dérisoire, puisqu’elle ne représente pas même 1% de l’iconographie de la station. Mais cette présence est remarquable, d’autant que la visite d’autres stations sur le chemin d’Ozan Éhéré nous a permis de la relever avec constance22. Un second constat peut être fait qui concerne l’hétérogénéité stylistique (« naturalisme », « schématisme »), technique (gravures profondes, incisions fines, polissage, piquetage) et thématique (faune sauvage, domestique, signes,
19 À Ozan Éhéré, pour les « Têtes Rondes » comme pour les « bovidiens » en aplat, 90% des œuvres incontestablement sexuées sont féminines.
20 Il va sans dire qu’il s’agit d’une estimation basse.21 610 témoignages, 230 vestiges graphiques sont à décompter pour l’heure à Ozan Éhéré.22 À Foufoua, Ghiyayé et Alagh-n-Dament, les riches ensembles picturaux comprennent eux aussi des gravures aussi rares mais toujours présentes.
Amel Mostefaï
89
anthropomorphes) de ces gravures, qui en outre occupent des positions variées (sol rocheux, dalle gravée, sur paroi). Cette variabilité extraordinaire au sein de chacune de ces stations constitue une seconde constante remarquable. Gravures et peintures y investissent le même espace dévolu à l’expression graphique. Notons pour l’heure que, sans qu’il soit vraiment possible de savoir quel type d’œuvre vient avant l’autre, il est au moins possible de souligner que celles-ci s’y distribuent sans s’ignorer25 : ainsi de la localisation singulière de fines gravures aux deux extrémités d’un abri dévolu aux figurations peintes et de la présence de deux motifs indéterminables de type mixte (Abri I, Ozan Éhéré I).
La répartition singulière des gravures sur le site I nous a suggéré la possibilité d’une utilisation particulière de ces témoignages dans le cadre de la circonscription d’un espace original (elle souligne un abri particulièrement riche en figurations anthropomorphes et figurations de la faune sauvage). Mais on ne saurait réduire la complexité de ces ensembles à cette seule hypothèse.
Enfin, il faut noter que la localisation des gravures à Ozan Éhéré I relève d’une situation inverse de celle des « Têtes Rondes » du site. Les témoignages de chacun de ces groupes paraissent s’y distribuer en s’excluant : avec des « Têtes Rondes » au sud-ouest du site et des gravures et ensembles finement incisés localisés dans un triangle situé au nord-est. L’absence pour l’heure de témoignages gravés à Ozan Éhéré II, associée à une ségrégation forte des « Têtes Rondes » sur ce second site, soulignerait à nouveau la singularité de ce dernier et pourrait impliquer l’existence d’un jeu de relations propre à ces ensembles techniquement différenciés.
Figure 2 : Appréhension des dimensions sensorielle et sexuelle des anthropomorphes d’Ozan Éhéré : analyse comparative. Les « bovidiens » représentent environ 81% des figures anthropomorphes d’Ozan Ehéré ; les « Têtes Rondes » 18%. Les figures présentant des traces perceptibles de figuration des organes sensoriels ou sexuels sont ultra-minoritaires et ne représentent actuellement pas plus de 5% des figures.Figure 2: Sensitive and sexual dimensions of anthropoids of Ozan Ehéré: comparative analysis.“bovidian” figures account for 81% of the anthropomorphic figures from Ozan Ehéré, and “Têtes rondes” about 18%. Figures with perceptible figuration of sensorial or sexual organs are very scarce (actually no more than 5%).
25 Plusieurs cas probants attestent, en outre, d’une prise en compte du répertoire peint (ainsi à Foufoua – où une antilope gravée est approchée par un serpent peint – et à Ghiyayé – où à l’instar de certaines peintures, les gravures consistent en inscriptions alphabétiques).
Contribution à la reconnaissance de traits culturels pertinents dans les arts rupestres sahariens : la station d’Ozan Éhéré
90
Si Ozan Éhéré II ne compte pour l’instant aucune gravure, quatre figures peintes appellent néanmoins l’attention et permettent d’envisager sérieusement l’existence d’un tel lien entre ensembles peints et gravés à l’échelle régionale. Il s’agit de peintures rappelant (dans des variantes singulières) les « Kel Essuf » gravés de la Tadrart algérienne (fig. 3).
J’aimerais conclure avec un dernier rapprochement possible entre groupes, établi par la présence subtile de « creux », « ronds » et autres « motifs circulaires » peints ou gravés. Exécutés à proximité immédiate de peintures et de gravures, ces ensembles paraissent enserrer, en un arc de cercle, le ou les sujets qu’ils accompagnent (fig. 4). L’hypothèse d’une circonscription singulière de l’espace par le biais de ces éléments ne me semble pas hardie et mériterait des recherches complémentaires. Constatons seulement que ces motifs établissent un lien entre des figurations stylistiquement et techniquement très différentes.
Il est impossible de tirer des conclusions définitives de ces cas singuliers dont l’analyse ne fait que débuter. Aussi limitées et provisoires que soient les conclusions présentes de nos travaux – qui réclament des vérifications sur le terrain – nous espérons qu’elles auront au moins eu le mérite d’attirer l’attention sur des aspects habituellement négligés. Malgré de nombreuses inconnues, il est fort possible que certaines des caractéristiques des témoignages graphiques d’Ozan Éhéré plaident pour un jeu de relations ténues entre groupes habituellement envisagés isolément. Elles nous engagent sur des pistes de réflexion qu’il faudrait à l’avenir baliser.
Chaque année apporte son lot de découvertes importantes qui amènent à réviser parfois considérablement les aires culturelles définies à l’échelle de la région tassilienne. En parallèle de la nécessaire distinction en groupes et zones rupestres, nous croyons impératif de procéder à des comparaisons poussées entre ces ensembles, surtout lorsque ceux-ci occupent un espace
Figure 3 : Gravures en contexte pictural d’Ozan Éhéré I. Association peinture / gravure à Foufoua.Figure 3: Engravings in the pictural context of Ozan Ehéré I. Association painting / engraving in Foufoua.
Amel Mostefaï
91
restreint à l’échelle d’une station, sinon d’un site, ce qui, pour la région tassilienne, est généralement le cas. Le fait que ces documents puissent ne pas se partager les lieux selon les règles du hasard implique la nécessité de soumettre à leur feu la viabilité de nos découpages culturels. La mise en évidence d’un jeu de relations explicites est à priori à exclure, celles de relations clairement intelligibles davantage encore. L’art de la région ne s’y relève qu’à l’état relictuel, nos dossiers documentaires sont condamnés à n’être jamais exhaustifs et nous ne disposerons jamais des clés de lecture qui nous auraient permis d’en approcher le sens. Mêmes modestes, les résultats obtenus par confrontations de matériel rupestre n’en constituent pas moins autant d’étapes vers une meilleure compréhension de ces arts.
Remerciements
J’adresse mes remerciements à l’Office du Parc National du Tassili pour m’avoir permis de réaliser ce travail préliminaire sur Ozan Éhéré.
BIBLIOGRAPHIE
AUMASSIP G., 1993. Chronologies de l’art rupestre saharien et nord africain. Jacques Gandini, Calvisson.
DIETERLEN G., 1966. Les fresques d’époque bovidienne du Tassili n’Ajjer et les traditions des Peuls : hypothèses d’interprétation. Journal de la Société des Africanistes, t. XXXVI : 141-157.
FERHAT N. ; STRIEDTER K. H. ; TAUVERON M., 1996. Une limite ante quem pour l’art bubalin du Sahara central. C.R. Académie des Sciences de Paris, 324/1 : 75-77.
FERHAT N. ; STRIEDTER K. H. ; TAUVERONM., 2000. Les Kel Essuf : un nouveau faciès de l’art rupestre du Sahara central. C.R. Académie des Sciences de Paris, 330/8 : 577-580.
GAUTHIER Y. ; GAUTHIER C., 2004. Un exemple de relation monuments-art rupestre : monuments en corbeilles et grands cercles de pierres du Messak (Libye). Cahiers de l’Association des Amis de l’Art Rupestre Saharien, 9 : 45-62.
Figure 4 : Peintures de type « Kel Essuf » d’Ozan Éhéré II. Subtile et récurrente présence de « creux », « ronds » et autres « motifs circulaires » peints ou gravés.Figure 4: Paintings of « Kel Essuf » type in Ozan Ehéré II. Subtle and recurrent presence of “hollows”, “rings” and others “circular patterns” painted or engraved.
Contribution à la reconnaissance de traits culturels pertinents dans les arts rupestres sahariens : la station d’Ozan Éhéré
92
GAUTHIER Y. ; GAUTHIER C., 2006. Monuments en trou de serrure et art rupestre. Cahiers de l’Association des Amis de l’Art Rupestre Saharien, 10 : 79-110.
HACHI S., 1998. Une approche anthropologique de l’art figuratif préhistorique d’Afrique du Nord. Analyse d’une fresque de Tin Hanakaten (Tassili n’Ajjer). Études et documents Berbères, 15-16 : 164-184.
HACHID M., 1998. Le Tassili des Ajjers : aux sources de l’Afrique, 50 siècles avant les pyramides. Edif 2000, Paris, Alger.
LAJOUX J.-D., 1977. Tassili n’Ajjer. Art rupestre du Sahara préhistorique. Société nouvelle des Éditions du Chêne, Paris.
LAJOUX J.-D., 2006. Art rupestre et aventures. Cahiers de l’Association des Amis de l’Art Rupestre Saharien, 10 : 127-148.
LE QUELLEC J.-L., 1993. Symbolisme et art rupestre au Sahara. L’Harmattan, Paris.
LE QUELLEC J.-L., 1997. Commentaire à la note de Nadjib Ferhat, Karl Heinz Striedter et Michel Tauveron, « Une limite ante quem pour l’art bubalin du Sahara central ». C.R. Académie des Sciences de Paris, T. 324, sér. II a : 75-77.
LE QUELLEC J.-L., 1998. Art rupestre et préhistoire au Sahara. Le Messak Libyen. Payot, Paris.
LE QUELLEC J.-L., 2004. Arts rupestres et mythologies en Afrique. Flammarion, Paris.
LE QUELLEC J.-L., 2007. « Chasseurs » et « pasteurs » au Sahara : les « chasseurs archaïques » fezzanais chassés du paradigme. Page web, http://jean-loic.lequellec.club.fr/page46/page94/page94.html, consultée le 1/02/07.
LHOTE H., 1957. Chronique des missions : compte-rendu provisoire de la mission Lhote au Tassili n’Ajjer, février-septembre 1956. Travaux de l’Institut de Recherches Sahariennes, XV/2 : 179-182.
LHOTE H., 1958-2006. À la découverte des fresques du Tassili. Paris, Arthaud.
LHOTE H., 1968. Données récentes sur les gravures et les peintures rupestres du Sahara. Simposio de arte rupestre, Barcelona, 1966 : 273-290.
LHOTE H., 1972. Déchiffrement d’une fresque d’époque bovidienne du Tassili n’Ajjer. Santander Symposium, Actas del Symposium Internacional de Arte Prehistórico, Santander, 1972 : 503-510.
LHOTE H., 1984. Chronologie de l’art rupestre nord-africain et saharien. L’Anthropologie, 88 : 649-654.
LHOTE H., 1989. Quelques mises au point à propos de gravures et des peintures rupestres d’Afrique du Nord et du Sahara. Ars Praehistorica, t. VII/VIII : 239-253.
LORBLANCHET M., 1999. La naissance de l’art. Genèse de l’art préhistorique. Paris, Éditions Errance.
MORI F., 1965. Tadrart Acacus. Arte rupestre e culture del Sahara preistorico. Enaudi, Turin.
MORI F., 1970. Proposition d’une chronologie absolue de l’art rupestre du Sahara d’après les fouilles du Tadrart Acacus (Sahara libyen). Valcamonica Symposium, Actes du symposium International d’art préhistorique, Capo di Ponte, Ed. del Centro : 345-355.
MUZZOLINI A., 1983. L’art rupestre du Sahara central : classification et chronologie. Le boeuf dans la préhistoire africaine, Thèse de doctorat, Université de Provence, Aix-Marseille.
MUZZOLINI A., 1986. L’art rupestre préhistorique des massifs centraux sahariens. BAR, Oxford.
Amel Mostefaï
93
MUZZOLINI A., 1992. Le profane et le sacré dans l’art rupestre saharien. Bulletin de la Société Française d’Égyptologie, 124 : 24-70.
MUZZOLINI A., 1995. Les images rupestres du Sahara. Chez l’auteur, Toulouse.
STRIEDTER K. H. ; TAUVERON M., 2002-2003. The most ancient rock art engravings in the central Sahara? Afrique : Archéologie et Arts, 2 : 31-38.
TSCHUDI Y., 1956. Les peintures rupestres du Tassili-n-Ajjer. À la Braconnière, Neuchâtel.
VAN ALBADA A. ; VAN ALBADA, A.-M., 1994. Art rupestre du Sahara : les pasteurs-chasseurs du Messak Libyen. Faton.
Contribution à la reconnaissance de traits culturels pertinents dans les arts rupestres sahariens : la station d’Ozan Éhéré