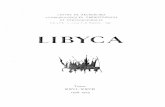Géologie et géotechnique de quelques formations superficielles du Nord-Ouest Constantinois, Algérie
Mémoire de sociolinguistique chez les étudiants de psychologie (Algérie)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Mémoire de sociolinguistique chez les étudiants de psychologie (Algérie)
1
République Algérienne Démocratique et Populaire
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Département de Français
Mémoire de Magister
- École doctorale -
Spécialité : français
Option : sciences du langage
Présenté par :
Mlle HARBI Sonia
Thème :
« Les représentations sociolinguistiques des langues (arabe, français)
chez les étudiants en psychologie de l’université de Tizi-Ouzou »
Devant le jury composé de :
Mme SAFIA RAHAL ASLAH ; Présidente, Professeur, Université d’Alger.
M. ZABOOT TAHAR ; Examinateur, Professeur, Université UMMTO.
M. .IMMOUNE Youcef, M.C; université d’Alger; rapporteur
Soutenu le 22/11/2011
2
Remerciements
Je remercie tous ceux qui ont participé à la réalisation
de ce travail de prés ou de loin
- Toute ma gratitude va vers mon directeur de
recherche, le docteur IMMOUNE Youcef pour ses
orientations, ses conseils, ses remarques judicieuses et sa
disponibilité
- Je remercie les membres du jury d’avoir accepté
d’examiner ce travail
3
Dédicace
Je dédie ce modeste travail
- A la mémoire de mes grands parents
- A ma mère que j’aime et mon père que j’adore
- A mon unique frère NABIL
- A mes chères soeurs SAMIRA, HANANE et
KATIA
- A Celui qui a été à mes cotés durant la réalisation
de ce travail, mon bien aimé HACENE
- A tous mes amis et collègues
4
Table des matières
Introduction………………………………………………………………………………09
I- Partie théorique
Chapitre 1 : situation sociolinguistique de l’Algérie.......................................................16
1-1- la langue berbère...........................................................................................................17
1-2- le statut du berbère en Algérie......................................................................................18
1-3- la langue arabe..............................................................................................................19
1-4- l’arabe classique...........................................................................................................19
1-5- l’arabe dialectal.............................................................................................................21
1-6- la langue française........................................................................................................22
1-7- le statut du français en Algérie.....................................................................................22
1-8- la politique de l’arabisation..........................................................................................25
Chapitre 2 : définition de quelques concepts sociolinguistiques....................................30
2-1- le bilinguisme................................................................................................................30
2-2- la politique linguistique................................................................................................31
2-3- le marché linguistique...................................................................................................32
2-4- le comportement sociolangagier...................................................................................33
2-5- sécurité et insécurité linguistiques................................................................................34
2-6- attitudes et représentations............................................................................................35
2-6-1- les attitudes................................................................................................................36
2-6-2- les stéréotypes............................................................................................................38
2-6-3- les représentations.....................................................................................................38
II- Partie pratique
1- Considérations méthodologiques..................................................................................44
5
1- l’enquête...........................................................................................................................44
1-1- l’enquête en science sociale..........................................................................................45
1-2- l’enquête en science du langage...................................................................................45
1-3- notre enquête................................................................................................................46
2- l’échantillon.....................................................................................................................46
2-1- l’échantillon représentatif............................................................................................46
2-2- l’échantillon aléatoire...................................................................................................47
2-3- l’échantillon stratifié....................................................................................................47
2-4- unités et grappes..........................................................................................................47
2-5- l’échantillon non aléatoire ...........................................................................................48
2-6- l’échantillon par quotas ...............................................................................................48
2-7- notre échantillon...........................................................................................................49
3- le questionnaire................................................................................................................49
3-1- le questionnaire structuré..............................................................................................50
3-2- le questionnaire non structuré.......................................................................................50
4- l’entretien.........................................................................................................................50
4-1- l’entretien directif.........................................................................................................50
4-2- l’entretien non directif..................................................................................................51
4-3- l’entretien semi-directif................................................................................................51
5- les différents types de questions.......................................................................................51
5-1- selon le contenu............................................................................................................51
5-1-1- les questions de fait...................................................................................................52
5-1-2- les questions d’opinion..............................................................................................52
5-2- selon la forme...............................................................................................................52
5-2-1- les questions ouvertes................................................................................................52
6
5-2-2- les questions fermées.................................................................................................53
5-2-3- les questions semi-fermées........................................................................................53
Notre entretien.....................................................................................................................54
2- analyse des données.......................................................................................................57
2-1- éléments de contextualisation de l’enquête et de l’analyse.....................................57
2-1-1- présentation des informateurs...................................................................................57
2-1-2- présentation des variables..........................................................................................63
2-1-2-1- la langue maternelle...............................................................................................63
2-1-2-2- l’appartenance sexuelle..........................................................................................64
2-1-2-3- la spécialité d’étude...............................................................................................64
2-2- éléments descriptifs de la présence des langues en psychologie : diversité et
sectorisation........................................................................................................................66
2-2-1- en classe : prédominance de l’arabe..........................................................................66
2-2-2- rédaction : prédominance de l’arabe.........................................................................69
2-2-3- en dehors de la classe : prédominance du français...................................................70
2-2-4- vers la diversité des langues.....................................................................................73
2-2-5- vers le français comme langue de l’enseignement...................................................74
2-3- mise en mots des préférences linguistiques et argumentation...............................76
2-3-1- pour la langue française............................................................................................77
2-3-1-1- travail.....................................................................................................................77
2-3-1-2- qualité de l’enseignement.......................................................................................79
2-3-1-3- documentation........................................................................................................81
2-3-2- pour la langue arabe..................................................................................................82
2-3-2-1- travail.....................................................................................................................82
2-3-2-2- documentation........................................................................................................83
7
2-3-3- la position nuancée....................................................................................................84
2-3-3-1- travail.....................................................................................................................84
2-3-3-2- études.....................................................................................................................86
2-4- les langues et la documentation.................................................................................86
2-4-1- les ouvrages en français............................................................................................86
2-4-1-1- disponibilité............................................................................................................87
2-4-1-2- utilisation...............................................................................................................87
2-4-1-3- intérêt.....................................................................................................................87
2-4-2- les ouvrages en arabe.................................................................................................90
2-4-2-1- disponibilité............................................................................................................90
2-4-2-2- utilisation................................................................................................................90
2-4-2-3- intérêt.....................................................................................................................91
2-5- analyse des variables...................................................................................................94
2-5-1- la variable sexe..........................................................................................................94
2-5-1-1- études.....................................................................................................................94
2-5-1-2- travail.....................................................................................................................96
2-5-2- la variable langue maternelle....................................................................................98
2-5-2-1- études.....................................................................................................................98
2-5-2-2- travail...................................................................................................................100
2-5-3- la variable spécialité d’étude...................................................................................102
2-5-3-1- études...................................................................................................................102
2-5-3-2- travail...................................................................................................................105
Conclusion générale....................................................................................................109
9
Introduction
La richesse de la situation linguistique de l’Algérie fait d’elle une véritable source
d’interrogations et de recherches. En effet, le marché linguistique algérien a subi et
continue de subir des changements importants qui sont le résultat de la coexistence de
plusieurs langues et plusieurs variétés de langues, l’arabe dialectal et le berbère d’une part,
l’arabe classique et la langue française d’autre part.
La situation sociolinguistique de l’Algérie laisse apparaître que le berbère et l’arabe
dialectal (langues maternelles, majoritairement utilisées dans la vie quotidienne) sont
minorés par le discours politique officiel de l’Etat. En revanche, l’arabe standard bénéficie
d’une place prestigieuse dans les institutions étatiques.
Depuis l’indépendance l’Etat algérien a promulgué des lois sur l’arabisation. Des
lois dont l’objectif est de donner à l’arabe classique une légitimité et un statut de langue
nationale et officielle dans divers domaines d’utilisation, notamment l’enseignement
supérieur qui est l’épine dorsale du développement du pays.
L’université forme fonctionnaires, enseignants, cadres et chercheurs pour tous les
secteurs d’activité. Par sa vocation humaine et sociale, elle reflète l’évolution des valeurs
et les aspirations du pays. Elle représente un atout majeur d’expérience, d’expertise et de
recherche. Acteur de premier plan dans le développement socio-économique du pays, elle
se fonde sur un important capital de compétence dans le domaine de l’enseignement, de la
formation et de la recherche.
L’université algérienne telle que toutes les institutions de l’Etat est ciblée par la
politique de l’arabisation qui vise à supplanter la langue française implantée en Algérie par
les Français et la remplacer dans la mesure du possible par la langue arabe considérée
comme la seule langue officielle et nationale.
10
Mais l’arabisation de l’université n’a pas été totale. Certaines branches de
l’enseignement supérieur (médecine, biologie sciences vétérinaires, pharmacie,
architecture, informatique…) et les secteurs clé de l’économie national (industrie,
hydrocarbure, technologie, banque…) continuent à utiliser la langue française. En
revanche, les filières des sciences humaines et sociales (sciences politique, histoire,
philosophie, psychologie…) ont adopté l’arabe comme langue d’enseignement.
La psychologie est l’une de ces filières touchées par l’arabisation puisque les cours et
les TD s’effectuent en langue arabe depuis la première année jusqu'à la fin du cursus. De
ce fait, la langue française perd son statut de langue d’enseignement et son volume horaire
se voit réduit à une heure et demie par semaine, pendant les trois premières années. Ces
séances de français sont conçues principalement pour apprendre la terminologie de la
psychologie en français.
C’est dans ce contexte que nous avons centré notre recherche dans le but de dégager
les représentations des étudiants en psychologie à l’égard des deux langues (arabe,
français) susceptibles d’être utilisées dans leur cursus universitaire, la première pour la
rédaction et la deuxième pour d’éventuelles autres utilisations
Nous avons cherché à travers le discours épilinguistique tenu par les étudiants à faire
ressortir un rapport si rapport il y a entre les statuts des langues en présence et les
représentations des locuteurs à leurs égards, ces dernières sont-elles influencées par le
statut de chaque langue ? Autrement dit, y a-t-il un rapport entre le statut politique et
pédagogique des deux langues (arabe et français) et les représentations des locuteurs à leur
égard ?
11
En guise de réponse préalable à ces questions ; nous soutenons que le statut politique
et pédagogique d’une langue exerce une influence sur les représentations
sociolinguistiques et que ces dernières déterminent les attitudes et les comportements socio
langagiers des locuteurs.
Tout en sachant que les variables âge, sexe, lieu de résidence, langue maternelle d’un
locuteur peuvent déterminer l’influence des représentations sur les attitudes linguistiques et
sur les comportements socio langagiers, nous nous limitons dans notre travail à la variable
sexe et langue maternelle que nous estimons plus pertinentes. Nous allons introduire une
autre variable qui s’avère intéressante dans le cas de notre échantillon, c’est la spécialité
suivie par l’informateur, sachant que dans le département de psychologie, il existe quatre
spécialités qui sont : la psychologie clinique, la psychologie scolaire, la psychologie du
travail et organisation des groupes et enfin l’orthophonie.
En vue de vérifier nos hypothèses ; nous avons effectué une enquête auprès des
étudiants du département de psychologie à l’université de Tizi-Ouzou. Nous avons choisi
l’université car c’est un lieu d’interaction culturelle où se présentent plusieurs langues
différentes. Quant à notre choix pour le département de psychologie, c’est pour le fait qu’il
soit un lieu de coexistence des deux langues en question l’arabe classique et le français.
Opportunité du thème
Les représentations sociolinguistiques, les attitudes et les comportements
sociolangagiers relèvent d’une grande importance et sont essentiels à toute planification
linguistique. Ils apportent aussi des données importantes pour les chercheurs en didactique.
12
Méthodologie
A fin de recueillir le discours epilinguistique nous permettant d’étudier les
représentations sociolinguistiques de nos enquêtés, nous avons mené auprès de ces derniers
une enquête par entretien semi-directif. La population ciblée au cours de cette enquête est
constituée de 14 étudiants du département de psychologie.
L’enquête s’est déroulée au département de psychologie, à l’université de Tizi-Ouzou
auprès des étudiants de troisième et de quatrième années. Nous avons réparti les enquêtés
en prenant en considération les variables suivantes : le sexe, la langue maternelle et la
spécialité. Nous pensons que ces variables jouent un rôle dans les jugements de valeur que
portent les locuteurs envers les deux langues (arabe / français). Pour nous faciliter la tâche,
nous avons divisé notre échantillon de la manière suivante :
- Deux (02) étudiants de langue maternelle arabe.
- Trois (03) étudiantes de langue maternelle arabe.
- Cinq (05) étudiants de langue maternelle kabyle.
- Quatre (04) étudiantes de langue maternelle kabyle.
Approche du travail
Dans le but de dégager les représentations sociolinguistiques des étudiants du
département de psychologie et leurs attitudes envers les langues (arabe / français), nous
nous appuyons sur l’analyse des enregistrements obtenus par le biais d’entretiens semi-
directifs auprès de quatorze étudiants de ce département.
Pour mener à bien notre recherche, nous avons opté pour l’analyse du contenu qui
repose sur la sélection des thèmes engagés dans l’entretien, elle sert à dégager les
différents points de vue, et croyances des informateurs
13
Plan du travail
La présente étude se subdivise en deux parties.
Une partie théorique : comportera deux chapitres
Le premier s’intéressera à la présentation de la situation sociolinguistique de
l’Algérie (les langues en présence).
Le deuxième comportera la définition de quelques concepts clés qui ont une relation
avec notre thème (représentations, attitudes, bilinguisme sécurité/insécurité linguistiques,
imaginaire linguistique…).
Une partie pratique qui se structure en deux chapitres
Le premier traitera des considérations méthodologiques tenant à la constitution du
corpus, de l’échantillon, du questionnaire et de l’entretien
Le deuxième et dernier se focalisera sur l’analyse et l’interprétation des résultats
obtenus par voie des entretiens semi-directifs et la vérification des hypothèses
d’explications émises.
15
CChhaappiittrree II
SSiittuuaattiioonn
ssoocciioolliinngguuiissttiiqquuee
ddee ll’’AAllggéérriiee
16
Introduction
L’Algérie est peuplée depuis l'antiquité par les berbères. Cette aire géographique a
été du fait de son emplacement stratégique le témoin de nombreuses invasions :
phénicienne, romaine, byzantine, vandale, arabe, turque, espagnole et française.
De toutes ces conquêtes, celle des Arabes est la plus longue et la plus profonde. Le
Berbère, langue utilisée par les nord-africains a cédé sa place petit à petit à la langue arabe,
celle de l’Islam et du livre sacré" le Coran", depuis l'arrivée d'Okba Ibn Nafaa et ses
compagnons pour propager l'Islam au VII siècle. L’impact de la colonisation française est
aussi visible dans la société algérienne, elle a duré 130 et a laissé des traces se traduisant
par la pratique de la langue française. L’Algérie a accédé à l’indépendance en 1962 après
une guerre qui a duré septe ans et demi.
1- La situation sociolinguistique en Algérie
La situation linguistique en Algérie est très complexe. Elle se caractérise par la
présence de plusieurs langues comme a constaté S. ABDELHAMID : « le problème qui se
pose en Algérie ne se réduit pas à une situation de bilinguisme, mais peut être envisagé
comme un phénomène de plurilinguisme »1. En effet, cette complexité du paysage
linguistique en Algérie est due à son histoire et sa géographie.
Les différentes invasions et conquêtes que l’Algérie a embrassées ont engendré la
coexistence de plusieurs codes linguistiques à coté du berbère, langue de la communauté
autochtone. Cela justifie l’existence de deux groupes importants, les berbérophones et les
arabophones qui se sont mêlés à travers l’histoire, sans pour autant négliger la langue
française qui est pratiquée par les deux groupes en question. Ce qui nous mène à dire que
1 S. ABDELHAMID, Pour une approche sociolinguistique de l’apprentissage de la prononciation du
français langue étrangère chez les étudiants du département de français université de Batna, thèse de
doctorat, université de Batna, 2002, p 35.
17
le pays se caractérise par une situation de plurilinguisme sociale : arabe standard / français
/ arabe dialectal /les différentes variétés du berbère.
Nous allons dans cette partie, présenter les différentes langues en présence ainsi que
leurs statuts respectifs.
1-1- La langue berbère
L'appellation "berbère" fut en premier lieu utilisée par les romains pour designer les
habitants de l'Afrique du Nord dont ils ne comprenaient pas la langue. Le terme "barbaros"
qualifie toute personne étrangère, celle qui ne sait pas parler et par extension, le "sauvage",
"le non civilisé", "la brute". Le terme a subi des modifications phoniques à travers le temps
pour arriver en fin à berbère, appellation qui désigne les habitants et le parler de l'Afrique
du Nord. Par le fait de son acception péjorative, les berbères préfèrent utiliser l'appellation
tirée de leur propre langue "Imazighene", pluriel "d'Amazighe" qui signifie homme libre.
Concernant le nombre des berbérophones, il est difficile d’avancer des chiffres
exactes vue l’absence des recensements linguistiques systématiques, les chiffres qui ont pu
être proposés sont contestés de tout part ; néanmoins S. CHAKER nous renseigne sur ce
fait en avançant que : « Sur l'ensemble de la population algérienne, les pourcentages de
l'ordre de 25% à 30% de berbérophones, retenus pendant la période coloniale, sont rejetés
comme nettement surévalués. En revanche, les 17.8% de berbérophones que donne le
recensement algérien de 1966, sont en dessous de la réalité. En tout état de cause on peut
admettre que l’ensemble des berbérophones doit représenter un pourcentage minimum de
20% de la population algérienne »1
Le berbère se présente sous forme de plusieurs dialectes qui sont :
1 S. CHAKER, Manuel de linguistique berbère I, éd. Bouchène, Alger, 1991, p 08
18
- Le kabyle : pratiqué dan le nord du pays, principalement dans les wilayas de
Tizi-Ouzou, Bejaïa et Bouira.
- Le chaoui : parlé par les chaouis qui occupent les Aurès, massif montagneux de
l’Algérie méridionale.
- Le m’zab : employé par les mozabites qui vivent dans le nord du Sahara
algérien dont la principale ville c’est Ghardaïa.
- Le targui : pratiqué par les touaregs qui vivent dans le Sahara, communauté
que l’on appelle aussi « les hommes bleus ».
1-2- Le statut du berbère en Algérie
Après l’indépendance, la langue berbère, comme l’arabe dialectal, a subi l’impacte de
la politique de l’arabisation qui tend à promouvoir et généraliser l’utilisation de la langue
arabe classique, dans le but d’une unification nationale. Le berbère bien qu’il soit présent
dans les pratiques journalières des locuteurs berbérophones et vivace dans leurs
communications quotidiennes ne bénéficie pas d’un statut privilégié, comme le confirme
T.ZABOOT : « le berbère n’a jamais bénéficiée ni de mesure administratives ou
politiques, ni de conditions matérielles pouvant favoriser son développement »1, ce qui a
poussé les berbérophones à revendiquer un statut officiel pour leur langue.
Les berbérophones, mécontents de la condition de leur langue, demandent que le
berbère soit reconnu comme la langue propre des régions berbérophones comme la
Kabylie. Ils demandent également que la langue berbère soit reconnue comme langue
nationale et officielle de l’Algérie, ce qui impliquerait le droit pour tout citoyen d’utiliser
la langue berbère dans toutes les circonstances de la vie publique
1 T. ZABOOT, Un code switching algérien : le parler de Tizi-Ouzou, thèse de doctorat, université de la
Sorbonne, 1989, p.50
19
Depuis 1989, une série d’actions de masses spectaculaires a confirmé l’affirmation
identitaire des berbères d’Algérie : plusieurs grèves générales en Kabylie, des
manifestations d’une grande ampleur à Tizi-Ouzou, Bejaia et Alger en 1991, le boycott
scolaire général de septembre 1994, d’autres manifestations sanglantes en 1994 et les
événements du printemps noir en 2001. Toutes ces revendications adoptées par les
berbérophones ont abouti à la création d’un haut commissariat à l’amazighité en 1995, à
l’intégration de la langue berbère dans plusieurs écoles du pays et à la reconnaissance du
berbère comme langue nationale en 2002.
1-3- La langue arabe
Il existe en Algérie deux variétés de l’arabe. Une variété haute, prestigieuse, réservée
pour l’usage officiel dite l’arabe standard et une variété basse minorée par les politiques
linguistiques mais pratiquée par la majorité des Algérien dite l’arabe dialectal.
1-4- L’arabe classique
La langue arabe classique jouit d’un certain prestige du fait qu’elle est la langue de
l’Islam, la langue du Coran« C’est cette variété choisie par ALLAH pour s’adresser à ses
fidèles »1. C’est la langue de l’instruction, de l’enseignement religieux, c’est la référence et
l’outil symbolique de l’identité arabo-musulmane
Considéré comme un pays arabo-musulman, l’Algérie a pour langue officielle
l’arabe. Il est essentiellement utilisé dans l’enseignement, dans les administrations et dans
toutes les institutions de l’Etat, en plus de sa fonction religieuse
C’est la variété des lettrés, elle sert de véhicule au savoir de façon générale, utilisée
comme langue de culture et dans des situations de communications formelles.
Essentiellement écrite, elle est aussi pratiquée à l’oral, il s’agit plus exactement de l’écrit
1 K.TALEB IBRAHIMI, Les Algériens et leur (s) langue (s), El Hikma, Alger, 1995, p05
20
oralisé. Cette variété principalement apprise à l’école, n’est en fait pratiquée par aucune
des communautés linguistiques qui composent la société algérienne, pour les besoins de la
communication quotidienne ou dans les conversations usuelles de la vie de tous les jours.
A ce propos G. GRANDGUILLAUME affirme que : « (…) sans référence culturelle
propre, cette langue est aussi sans communauté. Elle n’est la langue parlée de personne
dans la réalité de la vie quotidienne (...) derrière cette langue "nationale", il n’y a pas de
« communauté nationale » dont elle serait la langue tout court, dont elle serait bien sur la
langue maternelle »1. Cette langue donc n’est utilisée par les Algériens que dans des
situations formelles (école, administration, tribunal…) et elle n’a aucune existence dans la
sphère informelle (conversations entre amis, en famille, dans la rue…)
Par ailleurs, « cette langue étant perçue et considérée comme composante essentielle
de l’identité du peuple algérien est en quelque sorte le ciment de l’unité nationale »2 , aussi
« son espace d’utilisation s’élargit sans cesse et s’ouvre sur de multiples domaines, tels
l’informatique, l’enseignement des matières scientifiques, univers autrefois réservé
exclusivement à la langue française »3. Après l’indépendance l’Etat algérien a adopté
l’arabe standar comme la seule langue officielle dans le but d’unifier tout le peuple
algérien autour de cette langue qui est comme nous l’avons déjà signalé le véhicule de la
religion musulmane
1 G. GRANDGUILLAUME, Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Maisonneuve et Larose,
Paris, 1983, p.11 2 T. ZABOOT, Un code switching algérien : le parler de Tizi-Ouzou, thèse de doctorat, université de la
Sorbonne, 1989, p 80 3 T. ZABOOT, Un code switching algérien : le parler de Tizi-Ouzou, thèse de doctorat, université de la
Sorbonne, 1989, p 75
21
1-5- L’arabe dialectal
« L’arabe dialectal est la langue maternelle de 72 % da la population algérienne »1.
Il est le véritable instrument de communication pour la majorité des locuteurs Algériens,
c’est la langue du quotidien, et de leur première socialisation
Sans tradition scripturale, cette langue vit et évolue au sein de la population qui en
fait usage d’où l’appellation arabe populaire. Elle est utilisée dans les lieux publiques : la
rue, les cafés, les stades… Elle est employée dans des situations de communications
informelles, intimes : en famille, entre amis etc. De ce fait, elle remplie une fonction
essentielle même si elle est exclue de toutes les institutions gouvernementales
(administration, école, etc.) et ne jouit d’aucun statut officiellement reconnu. Dans ce
contexte R. CHIBANE affirme que : «malgré l’importance numérique de ses locuteurs, et
son utilisation dans les différentes formes d’expression culturelle (le théâtre et la
chanson), l’arabe dialectal n’a subi aucun processus de codification ni de normalisation
»2. Cette langue est donc ni codifiée, ni standardisée, c’est une langue essentiellement orale
mais parfois utilisées par certains auteurs dans leurs productions artistiques et littéraires
surtout la chanson, la poésie et le théâtre comme les monologues de Mohammed Fellag.
1-6- La langue française
C’est après la conquête de 1830 que l’usage de la langue française fut ressenti en
Algérie. Lorsque les Français arrivèrent, c’était les zaouïas et les medersas qui
dispensaient un enseignement religieux totalement en langue arabe. Ces dernières ont été
1 J. LECLERC. Algérie dans « l’aménagement linguistique dans le mande, Québec, TLFQ, université Loval,
24 février 2007. « http:// www. Ulaval.ce/ax/AFRIQUE/ Algérie-1demo. Htm ».26/01/2008. 2 R. CHIBANE, Etude des attitudes et de la motivations des lycéens de la ville de Tizi-Ouzou à l’égard de la
langue française : cas les élèves du lycée Lala Fatma N’soumer, mémoire de magistère, université de Tizi-
Ouzou P.20. 2009.
22
transformées par la suite en écoles pour enseigner la langue française, dans le but de
former un nombre important d’indigènes pour occuper l’administration coloniale.
« La langue française a été introduite par la colonisation. Si elle fut la langue
des colons, des Algériens acculturés, de la minorité scolarisée, elle s’imposa surtout
comme langue officielle, langue de l’administration et de la gestion du pays, dans la
perspective d’une Algérie française. »1 Pendant les cent trente deux ans qu’a duré la
colonisation, la langue française a été la seule langue qui jouit d’un statut officiel et
reconnue par l’Etat colonial pour la mise en place de toutes ses institutions
1-7- Le statut du français en Algérie
Le paysage linguistique en 1962 est largement dominé par le français. C’est la langue
utilisée dans l’administration, omniprésente dans l’environnement, et diffusée dans un
système d’enseignement en voie d’expansion.
Après l’indépendance, les choses ont pris une autre tournure « la langue française a
connu un changement d’ordre statutaire et de ce fait, elle a quelque peu perdu du terrain
dans certains des secteurs où elle était employée seule, à l’exclusion des autres langues
présentes dans le pays, y compris la langue arabe, dans sa variété codifiée »2. C’est dans
les institutions de l’Etat en général, que le champ de l’utilisation du français est
sensiblement réduit (l’enseignement, les formations professionnelles, les palais de justice,
les administrations, etc.).
Néanmoins, la langue française occupe encore une place prépondérante dans la
société algérienne, et ce, à tous les niveaux, économique, social et éducatif. Le français
garde toujours son prestige dans la réalité algérienne, et en particulier dans le milieu
1 G. GRANDGUILLAUME, Langues et représentations identitaires en Algérie,
[http://grandguillaume.free.fr/ar_ar/langrep.html] (page consulté le 22-05-2009) 2 - T. ZABOOT, Un code switching algérien : le parler de Tizi-Ouzou, thèse de doctorat, université de la
Sorbonne, 1989, p.91
23
intellectuel. Bon nombre de locuteurs algériens utilisent le français dans différents
domaines et plus précisément dans leur vie quotidienne, qu’il s’agisse de l’étudiant, du
commerçant, de l’homme d’affaire ou de l’homme politique. Et pourtant, l’Algérie, est le
seul pays du Maghreb qui n’appartient pas à la francophonie. Ce refus vis-à-vis de la
francophonie soulève souvent des interrogations et repose continuellement la question de
la place et de la prégnance de la culture française dans la société, la représentation du joug
étranger et ce que la langue française charrie comme culture.
En effet le français est un outil de travail important pour les Algériens que ce soit sur
leurs lieux de travail, à l’école ou même encore dans la rue. La langue française bénéficie
d’une place à la fois symbolique et linguistique. Pour certain elle est la langue qu’on peut
s’approprier hors sa référence à la France " un butin de guerre" selon l’expression de
Y.KATEB. Pour d’autres, elle fut et demeure une langue d’ouverture à la modernité, de
relations au monde.
La langue française n’est pas uniquement un héritage de cent trente-deux ans de
colonisation, elle est toujours présente dans la société algérienne grâce à ce qu’on appelle
« l’éclatement des frontières ». La parabole qui permet de capter TF1, France 2, TV5,… et
Internet qui rend les échanges avec les francophones possibles et intensifs réduisent la
distance entre les deux pays. C’est pour cette raison qu’il est important de se rendre compte
de la place qu’occupe la langue française dans la société algérienne, de considérer cette
langue comme un acquis à conserver permettant l’ouverture sur le monde extérieur et de
voir en la francophonie une autre manière de vivre l’universel.
Elle est présente linguistiquement d’une façon directe, dans les multiples usages
qu’en sont fait, dans l’enseignement, l’administration, les médias, la famille, mais aussi
d’une façon indirecte, dans les parlers arabes et berbères. Ces derniers empruntent au
24
français de nombreux termes qu’ils arabisent ou berbérisent au point que les locuteurs qui
ignorent le français n’ont pas nécessairement conscience de l’origine de ces termes.
Dans le secteur éducatif, la langue arabe a pris en charge les enseignements des
matières scientifiques dans le primaire, le moyen et le secondaire. Mais cette arabisation
n’a pas été poursuivie dans le supérieur étant donné que le français reste la langue des
enseignements scientifiques et techniques notamment la médecine et les filières
techniques. Le malaise que ressentent les nouveaux bacheliers à cause de ce hiatus naît du
fait qu’ils ont étudié la langue française comme langue étrangère pendant neuf ans avec un
volume horaire réduit. Dans ce contexte, il importe d’envisager un élargissement du
français dans le cadre éducatif en se basant sur sa place dans la réalité actuelle.
Cette langue tient aussi une position importante dans les masse medias comme en
témoigne la radio (Alger chaîne trois) et la télévision (canal Algérie) qui sont diffusées en
français, elle tien aussi une place capitale dans la presse écrite où l’on compte de nombreux
quotidiens algériens rédigés exclusivement en français, tel El Watan, El Moudjahid,
Liberté, Le Soir...,
Dans le domaine de l’édition et de la diffusion du livre, la langue française continue
de bénéficier d’une place non négligeable. Même si depuis quelques années, d’énormes
efforts sont consentis pour la promotion du livre en langue arabe, la langue française
trouve un essor considérable dans les écrits littéraires. A ce sujet, T.BEN JELLOUN
explique que : «même si le français était au début la langue du colonisateur. A l’heure
actuelle, il est perçu autrement, puisque poètes et romanciers l’utilisent pour exprimer leur
enracinement et leurs aspirations »1.Il en ressort donc que la langue française est
omniprésente dans la réalité algérienne. Elle demeure une langue de transmission du
1 T.BEN JELOUN, «La langue de feu pour la littérature maghrébine », in Geo n° 138, Paris, Août 1990, pp
89-90.
25
savoir, une langue de communication et surtout un médiateur culturelle. Elle jouit d’une
place non dérisoire dans la vie de l’Algérien et continue à colorer ses discours.
1-8- La politique d’arabisation :
En 1962, tout le pays fonctionnait en français : enseignement, administration,
environnement, secteurs économiques… La langue arabe classique n’est connue que par
une minorité qui l’a apprise dans des écoles coraniques, elle avait perdu sa place de langue
écrite da la société du fait de la colonisation « le gouvernement algérien voulait réaliser la
face culturelle de l’indépendance en mettant à la place de la langue française la langue
arabe, non pas la langue parlée, mais la langue arabe standard issue de l’arabe
coranique, ce fut l’objet de la politique d’arabisation ».1
La politique d’arabisation a présenté deux volets, l’un explicite et l’autre implicite.
Le premier consistait à remplacer la langue française par la langue arabe dans tous ses
usages en Algérie, et le second visait à faire tenir à l’arabe classique la place des langues
parlées multiples, arabes et surtout berbère. Ces deux dimensions expriment l’essentiel des
tensions suscitées autour de l’arabisation.
Cette politique est mise en pratique dés le lendemain de l’indépendance jusqu’à nos
jours, la colonne vertébrale en est la politique suivie dans l’enseignement, mais elle
concerne tout aussi bien l’administration et l’environnement. Voici retracées ci-dessous les
grandes dates de la promotion de cette politique puisées principalement des travaux de K-
T-IBRAHIMI2
1963 : l’enseignement de l’arabe dans toutes les écoles primaires, en raison
de 10 heures d’arabe sur 30 heures en français.
1 G. GRANGUILLAUME, La francophonie en Algérie, école des grandes études en sciences sociales, paris,
09-04-2008 http://sinistri.canalblog.com/archives/2008/04/09/8718521.html, pages consultées le 15-03-2009
2 K.T.IBRAHIMI, Les Algériens et leur (s) langue(s), Elhikma, Alger, 1995.
26
1964 : - l’arabisation totale de la 1ere année primaire, pour cela les autorités
firent venir 1000 instituteurs égyptiens.
- A l’université d’Alger un institut islamique est crée et l’ancienne
licence en arabe transformée en licence monolingue sur le modèle oriental.
1967 : - l’arabisation de la 2eme année primaire.
- Implantation d’une section arabe à la faculté de droit.
1968 : - création d’une licence d’histoire en arabe.
- Une ordonnance rend obligatoire pour les fonctionnaires la
connaissance de la langue nationale.
- Arabisation de la fonction publique.
1970 : arabisation complète de l’enseignement primaire et secondaire.
1971 : perspective pour l’arabisation du supérieur.
1973 : la création d’une commission nationale d’arabisation chargée de
promouvoir et d’appliquer la politique de l’arabisation.
1975 : première conférence sur l’arabisation.
1976 : - l’arabisation de l’état civil, des noms de rues, des plaques
d’immatriculation et de l’affichage.
- Le vendredi est déclaré jour de repos hebdomadaire, à la place du
dimanche.
1979 : la grève des étudiants arabisants pour réclamer l’arabisation de la
fonction publique.
27
1980 : plan national d’arabisation de l’administration, du secteur économique
et de la recherche scientifique.
1981 : - installation d’un haut conseil de la langue nationale chargé du suivi
et du contrôle de l’arabisation.
- Mise en place de l’enseignement du calcul en arabe.
1989 : Arabisation totale du primaire et du secondaire, le français n’est plus
langue d’apprentissage pour aucune matière autre que le français lui-même.
1990 : loi sur la généralisation de la langue arabe, rendant obligatoire l’usage
de cette langue dans tous les documents écrits.
1991 : le ministre de l’enseignement supérieur annonce l’arabisation de
l’université.
1996 : réanimation de la loi sur la généralisation de la langue arabe suspendue
en 1992. La nouvelle Constitution de 1996 confirme l’arabe comme seule langue nationale
et officielle, mais reconnaît l’amazighité (l’identité berbère) comme l’une des trois
composantes fondamentales de l’identité nationale, à côté de l’arabité et de l’islamité.
Toutes ces décisions prises en faveur de la langue arabe classique ont été contestées
de toute part notamment de la part des berbérophones qui voient dans cette politique une
exclusion totale de leur propre langue. Depuis le champ de l’utilisation de la langue arabe
n’a pas régressé, néanmoins le berbère et le français ont bénéficié de quelques avantages :
1990 : l’ouverture d’un département de langue et culture Amazighe à
l’universté de Tizi-Ouzou
1991 : l’ouverture d’un autre département à Bejaia
1995 : la création symbolique d’un haut commissariat à l’amazighité (HCA)
28
1998 : revendication des berbérophones de la reconnaissance du berbère. Le 7
juillet, le président Zeroual rejette la reconnaissance du berbère
2002 : face aux revendications des berbérophones, le berbère accède au statut
de langue nationale par un amendement de la Constitution.
2006 : l’introduction de la langue française dés la troisième année primaire
Conclusion :
Dans l’Algérie de l’an 2000, la question des langues se pose d’une façon très
différente de ce qu’elle fut en 1962, et même les années suivantes. L’évolution de l’opinion
publique, traduite par des intellectuels Algériens, les rapports des langues sur le terrain, la
nécessité d’aborder des problèmes dans une approche réaliste, sont autant des facteurs qui
oeuvrent en faveur de nouvelles perspectives.
Aujourd’hui la population continue d’utiliser le français, la langue de l’ex-puissance
coloniale au grand dam des partisans de l’arabisation. Dans l’état actuel des choses, la
politique d’arabisation implique nécessairement le refus de la réalité et du plurilinguisme
algérien. Au lieu d’avoir libérer le peuple algérien et d’avoir valoriser les langues
algériennes, l’arabisation a fini par signifier une nouvelle colonisation, une exclusion des
langues pratiquées réellement dans la vie quotidienne de tout Algérien à savoir : le
français, l’arabe dialectal et les différentes variétés du berbère.
La coexistence français-arabe doit donc être encouragée d’abord à l’école mais aussi
dans l’environnement socio-économique, non seulement pour bénéficier des apports des
deux langues mais aussi pour créer dans les deux idiomes. Pour cela, les politiques
linguistiques et éducatives doivent être menées de manière concertée et procéder par
l’accumulation des richesses des codes et non par l’ostracisme de l’une ou de l’autre. Le
29
multilinguisme en Algérie n’est pas une malédiction dans un monde multiculturel, au
contraire, la cohabitation entre le français et l’arabe est plus que souhaitable.
30
CChhaappiittrree IIII
DDééffiinniittiioonn ddee
qquueellqquueess ccoonncceeppttss
ssoocciioolliinngguuiissttiiqquueess
31
2- Définition de quelques concepts sociolinguistiques
2-1- Le bilinguisme
Le bilinguisme est une situation sociolinguistique caractérisant les sujets pratiquants
deux langues ou plus (multi ou plurilinguisme). C’est un concept linguistique qui signifie
l’utilisation variable des langues ou des variétés linguistiques diverses par un individu ou,
par un groupe à des degrés divers
Le bilinguisme est défini, dans un sens restrictif, par rapport au mode
d’apprentissage des langues. Dans ce cas, est considéré bilingue l’individu qui possède
naturellement deux langues maternelles (par opposition au polyglotte qui apprend une ou
plusieurs langues grâce à l’enseignement scolaire).
Dans un sens moins restrictif, on peut qualifier de bilingue tout sujet parlant qui
pratique deus langues différentes dans ses communications orales ou écrites. Le
bilinguisme est défini généralement comme l’usage de deux ou plusieurs langues par un
individu.
Cependant, il ne faut pas confondre entre le bilinguisme et la bilingualité. Or le
bilinguisme « est un phénomène global qui implique simultanément et un état de
bilingualité de l’individu et un bilinguisme de la situation de communication au niveau
collectif. Lorsqu’il y a communication bilingue sans bilinguisme des individus, il y a quand
même contact des langues ... le terme bilinguisme inclut celui de bilingualité qui réfère à
l’état de l’individu mais s’applique également à un état d’une communauté dans laquelle
deux langues sont en contact avec pour conséquence que deux codes peuvent être utilisés
32
dans une même interaction qu’un nombre d’individus sont bilingue (bilinguismes
sociétal) »1
Le bilinguisme peut donc concerner :
Un individu qui pour des raisons personnelles, est conduit à utiliser plus
d’une langue dans ses relations sociales.
Un groupe d’individus (famille, communauté, peuple) qui pour des raisons
sociales, politiques ou historiques, sont amenés à communiquer avec l’extérieur et à utiliser
une langue différente de celle parlée à l’intérieur du groupe.
Une zone géographique (région, pays) où se côtoient des communautés
linguistiques différentes.
2-2- La politique linguistique
Chez les chercheurs anglo-saxons l’expression "langage planning" signifie en
français "politique linguistique".
Selon J.L.CALVET, une politique linguistique « est l’ensembles des choix conscients
effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie »2. En ce sens n’importe quel
groupe peut élaborer une politique linguistique.
Pour M-L MOREAU, le mot politique désigne « la phase d’une opération
d’aménagement linguistique la plus abstraite consistant en la formulation d’objectifs,
postérieurement à l’évolution d’une situation faisant apparaître des aspects perfectibles,
1 HARMES. J.F, BLANC. M, Bilingualité et Bilinguisme, Pierre Mardaga, éditeur, 2 galeries des princes,
1000 Bruxelles. 1983 p31 2 J-L CALVET. Sociolinguistique, PUF. Collection Que sais-je ? Paris. 1993, P 111-112
33
soit dans le corpus d’une langue (l’inadaptation de la structure par rapport à des besoins),
soit dans le statut des langues »1.
Chez BOYER « l’expression politique linguistique est souvent employée en relation
avec celle de planification linguistique : tantôt elles sont considérées comme des variantes
d’une même désignation, tantôt elles permettent de distinguer deux niveaux de l’action du
politique sur la/les langue(s) en usage dans une société donnée. La planification
linguistique est alors un passage à l’acte juridique, la concrétisation sur le plan des
institutions (étatiques, régionales, voire internationales) de considération de choix de
perspectives qui sont ceux d’une politique linguistique »2. Il s’agit donc d’un ensemble de
principes, de lois, de règlements, d’institutions et de pratiques, adopté à travers le temps,
qui guide et appuie l’action gouvernementale.
Dans notre pays, la politique linguistique mise en place par l’État, c’est bien la
politique de l’arabisation qui tend à promouvoir et à généraliser l’utilisation de la langue
arabe , dans toutes les institutions étatiques, dans le but d’une unification nationale et d’un
rattachement culturel au monde arabo-musulman. C’est une politique qui valorise la langue
de l’Islam qui est totalement absente des pratiques langagières des locuteurs algériens et
qui dévalorisent les langues utilisées quotidiennement dans la vie de tous les jours, à savoir
l’arabe dialectal, le berbère et le français.
2-3- Le marché linguistique
Le terme marché linguistique est utilisé pour la première fois par P.BOURDIEU. Il le
définit comme « l’ensemble des conditions politiques et sociales d’échanges des
producteurs consommateurs »3. C’est-à-dire que toute pratique est symbolisée et a un
1 M-L MOREAU. Sociolinguistique, les concepts de base, MARDAGA, Bruxelles, 1997, p 229
2 BOYER. H, Sociolinguistique : territoires et objet, Delachaux, Lausanne 1996, P 23
3 P. BOURDIEU. Question de sociologie, Minuit. Paris 1984.p 121
34
caractère social. L’effet du marché linguistique est repérable dans toutes les situations de
communications. « Il y a marché linguistique, toutes les fois que quelqu'un produit un
discours à l’intention de récepteurs capables de l’évaluer, de l’apprécier, de lui donner un
prix. »1.
Toute manifestation langagière ne reçoit sa valeur qu’en rapport à un marché
linguistique, défini par les mécanismes de formation des prix linguistiques. « Le discours
n’est pas seulement un message destiné à être déchiffré, c’est aussi un produit que nous
livrons à l’appréciation des autres, et dont la valeur se définira dans sa relation avec
d’autres produits plus rares ou plus connus. »2
Dans un pays plurilingue comme l’Algérie, la relation entre les langues qui y existent
constitue un enjeu politique « la langue officielle a partie liée avec l’Etat. Et cela tant dans
sa genèse que dans ses usages »3. A partir de ce point de vue, nous pouvons constater que
les mécanismes de formation des prix linguistiques sont intimement liés aux mécanismes
de domination politique. L’Etat Algérien impose l’arabe classique comme langue officielle
et seule légitime, cette langue tient donc un rapport de force contre les autres langues
existantes. Cette unification linguistique implique l’unification du marché linguistique
algérien dans lequel les usages linguistiques et leurs valeurs se trouvent mesurés à la
langue dominante à savoir l’arabe classique.
2-4- Le comportement socio langagier
Communément, la notion de comportement désigne une certaine façon d’agir (de
parler) et adopter ou accepter une certaine conduite. Elle est intégrée dans les sciences
humaines, particulièrement en psychologie et en psychologie sociale, comme synonyme de
1 P. BOURDIEU, 1984, p.121
2 P. BOURDIEU. Ce que parler veut dire, l’économie des échanges linguistique, FAYARD. Paris 1982. Le
texte de couverture du livre. 3 P. BOURDIEU, 1982, p 27
35
"behavior" pour exprimer la manière objective d’être et d’agir, des animaux et des
hommes.
Le comportement langagier est une notion centrale pour toute science qui s’applique
aux relations entre les êtres humains. « En sociolinguistique, le comportement langagier
outre qu’il est le produit des personnes qui sont influencés par les autres, est aussi l’un des
moyens par lequel on peut exercer de l’influence ».1 De ce fait, le comportement
linguistique désigne la façon dont les locuteurs valorisent leur langue ou, au contraire, la
façon dont ils la modifient pour se conformer au modèle prestigieux.
2-5- Attitudes et représentations
Les études portant sur les représentations sont considérées récentes, un nouveau
chantier, un nouveau domaine d’investigation. La linguistique a en effet ajouté, voici
quelques années, à l’étude des pratiques et des formes celle d’un domaine jusque-la
négligé : ce que les locuteurs disent, pensent, des langues qu’ils parlent et de celles que
parlent les autres.
A la question "pourquoi étudier les représentations sociales ? Serge MOSCOVICI,
qui a ravivé le concept des représentations sociales dans le domaine de la psychologie
sociales répond que c’est « pour explorer le coté subjectif de ce qui se passe dans la réalité
objective ».2
Les études portant sur les perceptions des langues et leurs usages ont été
principalement problématisées, à partir des années 1960, à travers la notion d’attitude et
ceci dans plusieurs directions. Elles explorent les images des langues pour expliquer les
1 COMITI. J.M, "Théories sociolinguistiques et étude des comportements langagiers dans une communauté
de langue minorée" p24-31, in Actes du symposium linguistique franco-algérien de Corti 9- 10 août1993.
Edités par George MORACCHINI, Studii Corsi, Editions Bastia, Août, 1994, p.10 2 S MOSCOVICI cité par H.BOYER in. Sociolinguistique : territoires et objets, DELACHAUX. Lausane,
1996. p15
36
comportements langagiers, en s’intéressant aux valeurs subjectives accordées aux langues
et à leurs variétés, et aux évaluations sociales qu’elles suscitent chez les locuteurs.
Les deux notions, celle de représentation et celle d’attitude, toutes deux empruntées à
la psychologie sociales sont parfois utilisées l’une à la place de l’autre. La plupart des
auteurs préfèrent néanmoins les distinguer.
2-5-1- Les attitudes
Le concept d’attitude vient du latin "aptitudo" dans le sens de «manière de se tenir le
corps »1, avec le temps, ce terme a subi différentes interprétations selon le domaine
d’utilisation. Il est défini dans le dictionnaire de sociologie comme « une disposition
mentale, d’ordre individuel ou collectif, explicative du comportement social »2. La notion
d’attitude se révélera comme stimulation et réponse sur lequel de nombreuses disciplines
scientifiques se sont penchées, notamment la psychologie sociale, la psychologie et la
sociologie, car c’est un concept indispensable dans l’explication du comportement social.
Dans son acception la plus large, le terme d’attitude linguistique est employé
parallèlement et sans véritable nuance de sens à "norme subjective", "jugements",
"opinion", pour désigner tout phénomène à caractère épilinguistique. On note que le terme
"épilinguistique" qualifie « les jugements de valeurs que les locuteurs portent sur la langue
utilisée et sur les autres langues »3
Les attitudes s’expriment plus au moins ouvertement à travers divers symptômes ou
indicateurs (paroles, actes, choix ou leur absence), elles exercent une fonction à la fois
cognitive, énergétique, et régulatrice sur les conduites qu’elles sous-tendent. Appliquées au
domaine de la linguistique, « les attitudes renvoient à des prises de positions individuelles
1BOUMEDIENE. F, Etude des représentations, attitudes linguistiques et comportements langagiers des
locuteurs Tizi- Ouzéens à l’égard des langues arabe, kabyle et française, thèse de magistère, université de
Tizi-Ouzou, 2002, P.18 2 AKOUN. A et ANSART. P, Dictionnaire de sociologie, Le Robert /Seuil, Paris, 1999, p.42
3DUBOIS. J et al, Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage, Larousse, Paris, 1994, p184.
37
ou collectives, par rapport à l’objet"langue", et à la variation qui la (les) caractérise »1.Le
caractère social de la langue suscite des comportements, des attitudes, des sentiments
différents de la part de ses utilisateurs.
Pour J.L.CALVET «les attitudes linguistiques renvoient à un ensemble de sentiments
que les locuteurs éprouvent pour les langues ou une variété d’une langue. Ces locuteurs
jugent, évaluent leurs productions linguistiques et celles des autres en leur attribuant des
dénominations. Ces dernières révèlent que les locuteurs, en se rendant compte des
différences phonologiques, lexicales et morphosyntaxiques, attribuent des valeurs
appréciatives ou dépréciatives à leur égard».2 Les attitudes langagières sont recueillies à
travers les réactions des sujets à l’égard des locuteurs s’exprimant dans deux ou plusieurs
variétés linguistiques, en concurrence ou en contact sur un territoire, sur des échelles
relatives à l’attrait physique, la compétence, la personnalité, le statut social, etc.
« L’attitude est généralement définie comme une disposition à réagir de manière
favorable à une classe d’objet, une (pré) disposition psychique latente acquise, à réagir
d’une certaine manière à un objet »3. Les informations dont dispose un individu sur un
objet particulier constituent ainsi son stock de croyances sur l’objet. Ces croyances peuvent
être motivées par des informations objectives, comme elles peuvent s’appuyer sur des
préjugés ou des stéréotypes.
2-5-2- Les stéréotypes
On considère généralement que le stéréotype constitue une forme spécifique de
verbalisation d’attitudes, caractérisés par l’accord des membres d’un même groupe autour
de certains traits, qui sont adoptés comme valides et discriminants pour décrire un autre
1 COMITI. J.M, Les corses face à leur langue, de la naissance de l’idiome à la reconnaissance de la langue.
Squadradiv Finusellu Diacciu.1992. 2 J.L.CALVET, la sociolinguistique, PUF, collection Que Sais Je ? Paris, 1993, p 46.
3 KOLD 1981, cité par LUDI. G & PY. B, Etre bilingue, Peter Lang, Berne, 1986, p.97.
38
dans sa différence. Le stéréotype affiche ainsi les perceptions identitaires et la cohésion des
groupes.
Le stéréotype apparaît donc comme un élément de la structure des représentations, or
les stéréotypes sont des « représentations généralisantes forgées à priori, sans fondement
empirique ou rationnel, amenant à juger les individus en fonction de leur appartenance
catégorielle, et résistantes à l’apport d’informations, ils vont servir de fondement aux
processus de stigmatisation sociale, en d’autres termes de jugements de valeur ».1
Les stéréotypes identifient des images stables et décontextualisées, schématiques et
raccourcies, qui fonctionnent dans la mémoire commune et auxquelles adhérent certains
groupes. Le degré d’adhésion et de validité que leur portent certains groupes de locuteurs
ou d’individus peuvent être liés à des conduites, à des comportements linguistiques et à des
comportements d’apprentissage.
2-5-3- Les représentations
Le terme "représentation" est conceptualisé par plusieurs disciplines des sciences
humaines (sciences du langage, sociologie, psychologie, anthropologie, épistémologie,
philosophie,…).
Généralement, on entend par ce terme « le fait d’évoquer à l’esprit un objet, ce
dernier est représenté sous forme de symboles, de signes, d’images, de croyances, de
valeurs, etc ».2
1 S.M. FLAY, la compétence interculturelle dans le domaine de l’intervention éducative et sociale, in cahier
de l’actif. ACTIF. Paris, 1997. p57.
2 Encyclopédie philosophique universelle, "Des notions philosophiques ", Dictionnaire n° 02, éd, PUF, 1990,
France., p.2239-2241.
39
En sciences sociales, représentation signifie « le processus d’une activité mentale,
par laquelle un individu ou un groupe d’individus reconstitue le réel auquel il est
confronté et lui attribue une signification spécifique ».1
BRONCKART définit les représentations sociales « comme modalités de pensées
pratiques, orientées vers la communication, la compréhension et la maîtrise de
l’environnement, modalités qui relèvent à la fois des processus cognitifs généraux et des
processus fonctionnels socialement marqués. ».2
La notion de représentation est apparue pour la première fois au début du XX siècle
comme concept sociologique. Elle sera reprise au sein des sciences du langage par de
nombreux sociolinguistes notamment MOSCOVICI3, sous diverses appellations (idéologie
linguistique, représentation sociolinguistique, imaginaire linguistique…), pour désigner
l’ensemble d’images que les locuteurs associent aux langues qu’ils connaissent.
Les représentations linguistiques enregistrent des mythes, des valeurs et des
stéréotypes. A partir de cet imaginaire linguistique, les locuteurs se forgent l’idée qu’il
existe des langues plus valorisantes que d’autres et décident par conséquent de rejeter telle
forme linguistique et de favoriser telle autre forme.
En d’autres termes, les représentations sont le discours que les locuteurs d’une
communauté linguistique donnée, tiennent sur les langues. Ce discours n’est pas objectif
car les locuteurs ne tiennent pas de rapports neutres avec la/les langue(s) qu’ils pratiquent
ou qui les entoure (ent). Si une langue est perçue comme une langue de savoir et de la
réussite, elle est systématiquement valorisée et ses locuteurs le sont aussi. A l’inverse, si
une langue est dévalorisée, ses locuteurs se retrouvent immergés dans l’infériorité.
1 J.C.ABRIC.1999 cité par D.JODELET, in. Les représentations sociales, PUF, Paris. 1989, p206
2 BRONCKART cité par LUDI, G et PY, B in Etre bilingue, Peter Lang, Berne, 1986, P. 203
3 S. MOSCOVICI, Social représentations Cambridge, Cambridge Université Presse. 1984
40
Selon J L CALVET les représentations c’est « la façon dont les locuteurs pensent les
pratiques, comment ils se situent par rapport aux autres locuteurs, et aux autres pratiques,
comment ils situent leurs langues par rapport aux autres langues ».1
Le même auteur souligne que ces représentations déterminent :
Des jugements sur les langues et la façon de les parler, jugement qui
souvent se répandent sous forme de stéréotypes.
Des attitudes face aux langues, aux accents, c'est-à-dire en face aux
locuteurs que les stéréotypes discriminent.
Des conduites linguistiques tendant à mettre la langue du locuteur en accord
avec ses jugements et ses attitudes.
Analyser une représentation sociale, c’est tenter de comprendre et d’expliquer la
nature des liens sociaux qui unissent les individus, des pratiques sociales qu’ils
développent, de même que les relations intra et intergroupes.
MOSCOVICI2 insiste sur deux processus à l’œuvre dans la formation et le
fonctionnement des représentations.
Celui d’objectivation d’abord, qui rend compte de la manière dont un individu
sélectionne certaines informations plus expressives pour lui et les transforme en images
signifiantes, moins riches en information mais plus productives pour la compréhension.
Celui d’ancrage ensuite, qui permet d’adapter pour l’incorporer l’élément moins familier
au sein des catégories familières et fonctionnelles que le sujet possède déjà. Autrement dit,
1 J.L.CALVET, Pour une écologie des langues du monde, PLON, France 1999, p.158.
2 MOSCOVICI. S, Social représentations Cambridge, 1984, cité par J.L.CALVET, Pour une écologie des
langues du monde, PLON, France 1999
41
il s’agit de rendre intelligible ce qui est nouveau ou étranger et de permettre une meilleure
communication en offrant des outils communs d’analyse des événements.
Les recherches autour des représentations se rejoignent sur deux constats :
D’une part on peut relever des traces (notamment discursives) d’un état de
la représentation, de même qu’on peut relever des traces de son évolution en contexte. Les
représentations son malléables, elles se modifient (on peut donc aussi les modifier).
D’autre part, les représentations entretiennent des liens forts avec le
processus d’apprentissage des langues, et pour la mise en œuvre d’actions didactiques
appropriées.
Les représentations sont constitutives de la construction identitaire, du rapport entre
soi et les autres et de la construction des connaissances. Les représentations ne sont ni
justes, ni fausses, ni définitives, dans le sens où elles permettent aux individus et au groupe
de s’auto catégoriser et de déterminer les traits qu’ils jugent pertinents pour construire leur
identité par rapport à d’autres.
Elles sont ainsi à considérer comme une donnée intrinsèque de l’apprentissage qu’il
convient d’intégrer dans les politiques linguistiques et les démarches éducatives. Ces
démarches doivent pouvoir réconcilier des tensions à priori contradictoires entre un besoin
d’auto centration et de rattachement au connu, et l’indispensable ouverture que nécessite
l’apprentissage des langues.
2-5- Sécurité/insécurité linguistiques
Reconnaissant les usages linguistiques socialement valorisés, les locuteurs
choisissent de les pratiquer et manifestent par là un désir de s’identifier à une classe
sociale, qui à leurs yeux, parle la forme prestigieuse. Ce choix est déterminé par
l’ensemble des formes linguistiques employées fréquemment par un grand nombre de
42
locuteurs appartenant à une communauté linguistique. Autrement dit, il est déterminé par la
norme. Considérant cette norme comme la manière la plus valorisante de pratiquer une
langue, les locuteurs modifient leurs pratiques linguistiques pour se rapprocher du modèle
prestigieux quand ils se sentent en insécurité linguistique. Par contre, s’ils considèrent que
leur langue est la forme la plus correcte ils se sentent en sécurité linguistique.
Louis Jean CALVET définit le couple sécurité/insécurité linguistique comme suit
« on parle de sécurité linguistique lorsque, pour des raisons sociales variées, les locuteurs
ne se sentent pas mis en question dans leur façon de parler, lorsqu’ils considèrent leur
norme comme la norme. A l’inverse, il y a insécurité linguistique lorsque les locuteurs
considèrent leur façon de parler comme peu valorisante et ont en tête un autre modèle,
plus prestigieux, mais qu’ils ne pratiquent pas. »1
Ainsi « quand un locuteur se trouve dans une communauté linguistique où est pratiquée
une langue qu’il ne maîtrise pas, le sentiment d’insécurité linguistique se traduit chez lui
par un effort conscient de correction afin de se rapprocher de l’usage jugé prestigieux.
Dans ce cas, les locuteurs rejettent leur façon de parler pour dissimuler leur identité
sociale, se voient ridiculisés par le groupe qui détient la forme légitime »2
Le désir de se rapprocher de la forme prestigieuse conduit souvent les locuteurs à
commettre des erreurs. Ce genre de comportement est dit hypercorrection. Quant à
l’hypocorrection, elle est utilisée comme une stratégie de communication se manifestant
chez un individu qui maîtrise une langue, mais transgresse certaines des règles qui la
régissent sur le plan phonologiques, lexicale ou syntaxique, dans les situations où il est
appelé à utiliser une langue plus au moins relâchée
1 J-L CALVET, La sociolinguistique, PUF, collection que sais je ? Paris, 1993, p.50
2 P- BOURDIEU. Ce que parler veut dire, l’économie des échanges linguistiques, FAYARD. Paris 1982.
P.104
45
I- l’enquête
Toute recherche, toute analyse de situation se fait à l’aide d’une ou de plusieurs
méthodes. Il s’agit pour nous d’une méthode bien précise qui est « l’enquête ». Il est
difficile de définir l’enquête en général car celle-ci ne se limite pas à un seul type et sa
pratique exige le recours à différentes techniques (entretien, questionnaire, analyse de
contenu, analyse statistique…). C’est une interrogation sur une situation sociale dans le but
de généralisation.
R.GHIGLIONE considère que l’enquête consiste à « interroger un certain nombre
d’individus en vue d’une généralisation ».1 GHIGLIONE insiste sur trois données qui sont
« interroger », « individus » et « généralisation », qui renvoient respectivement à l’outil
utilisé, au concept de l’échantillon et à l’idée de représentativité de l’échantillon retenu.
F DE SINGLY défini l’enquête « comme un instrument de connaissance du social
(…) elle contribue à la connaissance de l’objet de la recherche, à la mise en œuvre de sa
description rigoureuse et objective, à l’élaboration des schémas explicatifs »2. Elle
consiste à soumettre des hypothèses, à recueillir des informations et des réponses et à
susciter un ensemble de discours.
Nous voyons donc qu’une enquête nécessite une conception totale et définitive avant
sa réalisation pratique. Etant un moyen de recherche, l’enquête prend un aspect technique
propre aux sciences humaines. Elle consiste à faire une quête d’informations écrites (les
questionnaires, les traces documentaires…) ou orales (les entretiens, les interviews…).
1 R.GHIGLIONE et B.MATALON. Les enquêtes sociologiques, Théorie et Pratique, Armand Colin, Col
«U», Paris, 1978, p 06. 2 F DE SINGLY. L'enquête et ses méthodes : le questionnaire, Editions Nathan. Coll. 128, Paris, 1992, P 28
46
L’enquête passe par trois étapes : l’observation, l’analyse et l’explication, ce qui lui
donne une certaine rigueur pour qu’elle soit un outil considérable pour toute recherche en
sciences sociales.
Quelles que soient les raisons ayant poussé un chercheur à réaliser une enquête, la
première démarche scientifique consiste à préciser l’objectif, c’est à dire à déterminer le
but de l’enquête, en se demandant : « Quelle information dois-je obtenir ? Quelle est la
question que je pose, à laquelle je cherche une réponse ? »1. C’est l’étape essentielle de
l’enquête, celle dont les démarches ultérieures dépendront.
1-1- L’enquête en sciences sociales
L’enquête est considérée comme étant une technique rigoureuse et objective. Son
élément essentiel est la question. L’enquête est, donc, le moyen par lequel le chercheur en
sciences sociales récolte les opinions, les attitudes, note les opinions des individus, de
groupe d’individus. En effet, ce que les sciences sociales recherchent est orienté vers ce
que l’individu pense, croit veut faire croire, etc. L’individu est, donc, interrogé ou observé
dans son milieu social.
1-2- L’enquête en sciences du langage :
Etant une branche des sciences du langage, la sociolinguistique, science de terrain, à
pour objet de décrire le rapport entre la société et l’évolution de la langue et ses fonctions.
« La sociolinguistique étudie ces rapports en collectant les données à analyser au près
d’un échantillon représentatif de la communauté linguistique, en utilisant les instruments
qui assurent l’objectivité et la fiabilité de la recherche » 2.L’enquête en sociolinguistique
1 M. GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales. 3ème éd. Paris, Dalloz, 1976, p.573.
2 L.J.CALVET et P.DUMOND. Enquête sociolinguistique, l’Harmattan, Paris, 1999, p.15.
47
est la recherche de la distribution, de la répartition des variables, c’est à dire, les facteurs
qui influencent les enquêtés : l’âge, le sexe, le niveau socioprofessionnel, socioculturel….).
1-3- Notre enquête
Pour la réalisation de ce présent mémoire, nous avons choisi l’enquête comme
méthode de travail. Notre enquête, a eu lieu à l’université de Tizi-Ouzou, département de
psychologie. Dans le but de dégager les représentations linguistiques que manifestent les
étudiants de ce département à l’égard des langues arabe et française, nous avons effectués
quatorze (14) entretiens semi-directifs à travers lesquels, nous allons essayer de voir ce que
ces étudiants pensent de ces deux langues en question et quelles sont les variables qui
peuvent les influencer.
2- L’échantillon
Une fois l’objet défini, la problématique posée, les hypothèses énoncées, le choix de
l’enquête comme méthode de travail fait, il faut s’intéresser à la population qui va être
interrogée, qui interroger ? De cette question découle la nécessité de constituer un
échantillon sur lequel portera le travail, et pour cela nous distinguons plusieurs méthodes
d’échantillonnage dont :
2-1- L’échantillon représentatif
Il est difficile d’étudier d’une manière exhaustive une population, c’est à dire d’en
interroger tous les membres, c’est pour cela qu’il faut se limiter à un nombre de personnes
représentatif. Selon R.GHIGLIONE et B. MATALON « un échantillon est en principe
représentatif si les unités qui le constituent ont été choisies tel que tous les membres de la
population ont la même probabilité de faire partie de l’échantillon. Si ce n’est pas le cas,
48
on dira que l’échantillon est biaisé puisque certains individus avaient plus de chance que
d’autres d’être choisis ».1
2-2- L’échantillon aléatoire (l’idéal statistique)
Les échantillons dits aléatoires ou statistiques s’obtiennent par un tirage au sort selon
les lois du hasard respectant la condition de la définition de l’échantillon représentatif :
faire en sorte que chaque membre de la population ait la même probabilité de faire partie
de l’échantillon.
Exemple : un tirage à la loterie est un bon exemple d’échantillonnage aléatoire.
Lorsqu’on, a un échantillon de 49 numéros, chacun de ces derniers à une chance égale
d’être sélectionné et chaque combinaison de six numéros à la même chance d’être
gagnante.
2-3- L’échantillon stratifié
Dans certains cas, l’échantillon peut être constitué d’un petit nombre de personnes
appartenant à certaines catégories mais très importantes pour le problème étudié. Donc, on
est confronté à un problème de construction des échantillons, et pour cela, on fait recours à
la stratification qui consiste à diviser la population en groupes homogènes (appelés strates),
qui sont mutuellement exclusifs, puis sélectionner à partir de chaque strate des échantillons
indépendants.
L’échantillonnage stratifié nous assure d’obtenir une taille d’échantillon suffisante
pour des sous-groupes de la population à laquelle nous nous intéressons
1 R.GHIGLIONE et B. MATALON les enquêtes sociologiques, Théorie et Pratique Armand Colin, Col «U»,
Paris, 1978 p.29
49
2-4- Unité et grappes
Généralement l’enquête sociologique porte sur des individus mais dans certains cas,
elle peut s’intéresser à d’autres unités telles que les entreprises, les ménages, les
associations. Selon R.GHIGLIONE et B, MATALON « on appelle une grappe un
ensemble d’unités tirés simultanément, un ménage constitue une grappe d’individus, un
département une grappe de communes, une entreprise une grappe d’établissement ou de
salariés, un immeuble une grappe de logement…. Considérant que les membres d’une
même grappe présentent entre eux des similitudes du point de vue de leurs opinions, on
procède alors à un tirage au sein de la grappe ».1
2-5- L’échantillon non aléatoire
La différence entre l’échantillon aléatoire et l’échantillon non aléatoire tient à une
hypothèse de base au sujet de la nature de la population à étudier. Dans le cas de
l’échantillonnage aléatoire, chaque unité a la chance d’être sélectionnée. Dans celui de
l’échantillonnage non aléatoire, on suppose que la distribution des caractéristiques à
l’intérieure de la population est égale.
L’échantillonnage par quotas est l’une des formes les plus courantes de
l’échantillonnage non aléatoire.
2-6-les échantillons par quotas
Selon F.SINGLY : « l’échantillon sera un modèle réduit de la population selon les
critères pris en considération »2. En général, les quotas sont définis en fonction de
quelques caractéristiques simples, comme l’age, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle.
1R.GHIGLIONE et B, MATALON, les enquêtes sociologiques, Théorie et Pratique Armand Colin, Col «U»,
Paris, 1978, p34 2 F.De, SINGLY, L'enquête et ses méthodes : le questionnaire, Editions Nathan. Coll. 128, Paris, 1992 p. 43
50
C’est une méthode qui est utilisée dan les instituts de sondage. Son but est de reproduire
dans l’échantillon la structure de la population mère.
Autrement dit, pour que l’échantillon soit jugé comme représentatif de la population,
il faut que ces deux structures présentent une ressemblance forte pour les dimensions
considérées. Par exemple : si la population à étudier comporte autant de femmes que
d’hommes, on fera en sorte que ce soit de même dans l’échantillon. Si la population en
questions comporte 20 % d’enseignants on s’efforcera d’avoir 20% d’enseignants dans
l’échantillon interrogé.
2-7- Notre échantillon
Parmi les échantillons définis au préalable celui qui correspond le plus à notre
enquête est l’échantillon aléatoire (l’idéale statistique), nous avons donc utilisé ce type
d’échantillonnage pour mener à bien notre travail. Notre échantillon est constitué de 14
étudiants du département de psychologie à l’université de Tizi-Ouzou qui ont accepté de
répondre à nos questions. Le tri de la population que nous avons interrogée est soumis aux
lois du hasard, le seul critère de sélection pris en considération est le fait que l’interrogé
soit un étudiant en psychologie en troisième ou en quatrième année à l’université de Tizi-
Ouzou. La totalité des étudiants de ce département avaient leur chance de figurer parmi la
population interrogée. L’exclusion des étudiants de la première et de la deuxième année de
notre échantillon est dû au fait que ces étudiants en question sont en tronc commun, et ce
n’est qu’a leur troisième année qu’ils vont être réparti selon les différentes spécialités, alors
que dans notre travail, nous avons besoin de cette variable que nous pensons déterminantes
des représentations des langues chez ces locuteurs.
51
3- Le questionnaire
Le questionnaire est un intermédiaire entre l’enquêteur et l’enquêté. Il est le moyen
essentiel par lequel les buts de l’enquête doivent être atteints. D’une part il sert à motiver,
aider, inciter l’enquêté à parler, d’autre part il permet d’obtenir des informations sur
l’enquêteur. Il représente un outil adéquat pour interroger la totalité de la population à
étudier.
Selon R. GHIGLIONE et B. MATALON « un questionnaire est un instrument
rigoureusement standardisé, à la fois dans le texte des questions et dans leur ordre.
Toujours pour assurer la comparabilité des réponses de tous les sujets, il est absolument
indispensable que chaque question soit posée à chaque sujet de la même façon, sans
adaptation ni explication complémentaires laissées à l’initiative de l’enquêteur »1.
Le questionnaire peut être structuré ou non structuré :
3-1- Le questionnaire structuré
Il est composé de questions fermées, semi fermées ou ouvertes. L’enquêté n’a qu’à
répondre par « oui » ou « non », ou de choisir une réponse parmi une liste proposée par
l’enquêteur.
3-2- Le questionnaire non structuré
Il comprend uniquement des questions ouvertes. L’enquêté est libre de répondre
comme il veut, selon sa guise.
1 R. GHIGLIONE et B. MATALON, les enquêtes sociologiques, Théorie et Pratique Armand Colin, Col
«U», Paris, 1978, P 98
52
4- L’entretien
L’entretien est un échange verbal provoqué/demandé par l’enquêteur en vue
d’obtenir des informations à propos d’un sujet auprès d’un enquêté. Il fournit de la matière
brute : la parole, le discours oral.
Il existe trois types d’entretiens : directif, semi-directif et non directif.
4-1- Entretien directif
Consiste à adresser aux interviewés les mêmes questions (ouvertes ou fermés),
formulées selon une même forme linguistique et un même ordre « par sa batterie de
questions toutes prêtes, l’enquêteur directif guide l’entretien de bout en bout »1. Son atout
est l’objectivité des réponses grâce à la standardisation du processus de récolte de la
parole. Son inconvénient est l’orientation dés le départ de l’enquêté vers une des réponses
attendues par l’enquêteur.
4-2- Entretien non directif
Propose de réduire les interventions de l’enquêteur à leur plus simple expression,
laissant à l’enquêté la liberté de traduire ses émotions, de faire part de ses observations et
expériences, de décrire et d’analyser à sa guise. « La conception de l’enquêteur blanc,
transparent, qui n’est là que pour recueillir la parole mais qui ne participe pas à sa
production recouvre une naïveté, au mieux un fantasme »2 Ce type d’entretien à donc ses
faiblesses car il laisse l’interviewé livré à son sort et risque de l’éloigner du sujet de la
recherche.
4-3- L’entretien semi-directif :
Il est également nommé interactif ou centré, ici l’enquêté peut répondre librement sur
le thème proposé par l’enquêteur qui n’intervient que pour relancer ou recentrer l’entretien.
1 BRES dans CALVET J-L..., DUMONT P, Enquête sociolinguistique, l’Harmattan, Paris, 1999, P 65
2 BRES in CALVET J-L..., DUMONT, 1999, P 65
53
Le contenu des questions de base et leurs objectifs y seront formulés de façon identique,
mais elles sont d’une autre nature, car invitant l’interviewé à une expression libre, une
interaction. L’enquêteur réagit aux propos de l’informateur, construit la forme de ses
questions, décide quelquefois de leur ordre comme dans toutes conversations.
5- Les différents types de questions
Les questions posées lors d’un entretien ou d’un questionnaire peuvent être
distinguées selon leurs contenus et selon leurs formes
5-1- Selon le contenu
Selon le contenu on peut considérer deux types de questions : les questions de fait et
les questions d’opinion.
5-1-1- Les questions de fait
Elles dépendent des phénomènes observables ou vérifiables. Ce sont, par exemple,
les questions qui caractérisent l’âge, le sexe de l’enquêté, etc., celle comme, quelle langues
pratiquez-vous ? Quel métier exercez-vous ?
5-1-2- les questions d’opinion
Questions dites aussi "subjectives" ou "psychologiques", elles portent sur des
opinions, des attitudes, des représentations, des motivations, des préférences etc. Voici un
exemple : que pensez- vous de l’enseignement du français en Algérie ?
En outre, dans la réalité, la frontière entre questions de fait et questions d’opinion est
assez floue, étant donné qu’une question de fait pour l’un peut être une question d’opinion
pour l’autre.
5-2- selon la forme
Les questions peuvent aussi être distinguées selon leur forme :
54
5-2-1- les questions ouvertes
Ce sont des questions qui ne comprennent pas de pré-réponses auxquelles le sujet
doit répondre , ici l’interrogé répond comme il le désire, s’exprime librement en faisant les
commentaires qu’il juge bons, en donnant des détails et en formulant ses opinions et ses
jugement, etc.
Exemple : Que pensez-vous de l’arabisation de votre filière.
5-2-2- Les questions fermées
Ce sont des questions ou l’on présente au sujet, après lui avoir posé la question, une
liste pré-établie de réponses possibles, parmi lesquelles on lui demande de cochez ou
d’encercler la bonne réponse.
Exemple : parlez-vous français ?
Oui Non
L’avantage des questions fermées est qu’elles permettent de recueillir des réponses
précises et surtout un traitement simple. Mais ce genre de questions à l’inconvénient
d’imposer à l’enquêté de répondre par oui ou non, alors que, peut être celui-ci voudrait
davantage justifier son opinion.
5-2-3- Les questions semi fermées
Elles sont des questions à plusieurs choix, c’est un ensemble de réponses suggérées à
l’enquêté qui choisit celle(s) qui qualifie (ent) son point de vue.
La rédaction des questions est un moment important. De façon générale, les
questions doivent être brèves, simples, claires, non répétées, avec un vocabulaire à sens
unique, sans équivoques et non connoté (éviter les sujets délicats comme : l’inceste, le
salaire, le sexe…).
55
Elle exige le respect des règles suivantes :
- Ne pas impliquer personnellement le sujet.
- Eviter des références à des personnalités (chanteurs, hommes politiques…)
- Eviter d’induire un jugement moral.
- Toujours prévoir un sans avis.
- Eviter les questions trop techniques.
Tous les sujets doivent pouvoir répondre à toutes les questions.
Notre entretien
Nous avons choisi de mener nos différents entretiens d’une façon semi-directive. Au
début de l’entretien nous avons exposé notre thème de mémoire et expliqué la raison de
notre choix méthodologique. A la suite de quoi, nous avons informé nos différents
interlocuteurs des informations que nous voulions recueillir. Ces différents entretiens sont
consultables en annexe.
Les quatorze entretiens que nous avons effectués se sont déroulés dans une période
de quinze jours, dans des salles du département de psychologie que nous avons choisi
calmes pour mettre les interviewés à l’aise et nous permettre de recueillir le plus
d’informations possibles. Le matériel que nous avons utilisé est un micro-ordinateur
portable équipé d’un enregistreur, il a été visible pendant le déroulement de ces opérations.
Nous l’avons disposé d’une manière permettant d’enregistrer toutes les discussions et ne
pas rater un seul mot de ce que les étudiants ont dit
Les questions posées aux enquêtés durant ces entretiens tournent autours de cinq axes
principaux :
- les langues pratiquées au sein de l’université (avec les enseignants : dans la
classes, avec les amis : en dehors de la classe)
56
- l’utilité de la langue arabe et de la langue française pour poursuivre des études
en psychologie
- l’intérêt des étudiants en psychologie pour la langue arabe et pour la langue
française
- la documentation en arabe et en français
- les langues susceptibles d’être utilisées dans le travail d’un psychologue
De ces questions principales ont découlées des questions secondaires selon les
réponses des interlocuteurs et l’orientation de nos entretiens, toutefois, nous avons essayé
dans la mesure du possible de poser les mêmes questions à l’ensemble de la population
interrogée.
Nous avons distribué aux informateurs des fiches de renseignement dans lesquelles,
nous leur avons demandé de reporter leur appartenance sexuelle, leur langue maternelle,
leur année et spécialité d’étude. Ces informations nous ont été utiles pour l’étude des
différentes variables.
Après avoir récupéré les fiches de renseignement et enregistré les entretiens, nous
avons transcrit ces derniers graphiquement selon les caractères de l’alphabet français
même pour les segments en kabyle ou en arabe. À fin de faciliter la lecture de ce présent
travail, nous avons pris le soin de mettre ce qui a été dit en arabe ou en kabyle entre
parenthèses et en italique gras.
58
1-éléments de contextualisation de l’enquête et de l’analyse
1-1- Présentation des informateurs
Pour faciliter la lecture de ce mémoire, nous avons jugé utile de présenter nos
informateurs. Tout au long de notre analyse, nous désignons par la lettre « A » les
informateurs qui ont comme langue maternelle l’arabe et par la lettre « K » ceux qui ont le
kabyle comme langue maternelle. Pour ce qui est du sexe, la lettre « F » indique le sexe
féminin et la lettre « M » le sexe masculin. La langue maternelle et le sexe seront précédés
par « IN » qui veut dire informateurs. De ce fait nous avons obtenu 4 catégories
d’informateurs qui sont INFA, INFK, INMA, INMK
A l’aide d’une fiche de renseignement que nous leur avons soumis lors des entretiens,
nous avons pu les répertorier comme suit :
INFA1
- Sexe féminin.
- Langue maternelle arabe.
- Troisième (3ème
) année psychologie, orthophonie.
- Langue de la consultation des ouvrages : le français.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, comprendre, parler, écrire
INFA2
- Sexe féminin.
- Langue maternelle arabe.
- Quatrième (4ème
) année psychologie, psychologie clinique.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe et le français.
59
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, écrire, parler, comprendre.
INFA3
- Sexe féminin.
- Langue maternelle arabe.
- Troisième (3ème
) année psychologie, orthophonie.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe et le français.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, écrire, parler, comprendre.
INFK1
- Sexe féminin.
- Langue maternelle kabyle.
- Troisième (3ème
) année psychologie, psychologie scolaire.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe et le français.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, comprendre, parler.
INFK2
- Sexe féminin.
- Langue maternelle kabyle.
- Troisième (3ème
) année psychologie, psychologie scolaire.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe.
60
- Compétences linguistique :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, comprendre, parler, écrire.
INFK3
- Sexe féminin.
- Langue maternelle kabyle.
- Quatrième (4ème
) année psychologie, psychologie scolaire.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, comprendre, parler, écrire.
INFK4
- Sexe féminin.
- langue maternelle kabyle.
- Quatrième (4ème
) année psychologie, psychologie scolaire.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : comprendre.
INMA1
- Sexe masculin.
- Langue maternelle arabe.
- Troisième (3ème
) année psychologie, psychologie clinique.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe.
61
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, écrire, parler.
INMA2
- Sexe masculin.
- Langue maternelle arabe.
- Quatrième (4ème
) année psychologie, psychologie de travail et organisation des
groupes.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe et le français.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire ; écrire, parler, comprendre.
INMK1
- Sexe masculin.
- Langue maternelle kabyle.
- Troisième (3ème
) année psychologie, orthophonie.
- Langues de la consultation des ouvrages : l’arabe et le français.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, comprendre, parler, écrire.
INMK2
- Sexe masculin.
- Langue maternelle kabyle.
- Quatrième (4ème
) année psychologie, psychologie clinique.
62
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe et le français.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, comprendre, parler, écrire.
INMK3
- Sexe masculin.
- Langue maternelle kabyle.
- Quatrième (4ème
) année psychologie, psychologie de travail et organisation des
groupes.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire ; écrire.
INMK4
- Sexe masculin.
- Langue maternelle kabyle.
- Troisième (3ème
) année psychologie, psychologie de travail et organisation des
groupes.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe
- Compétences linguistiques :
l’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, écrire, parler, comprendre
INMK5
- Sexe masculin.
63
- Langue maternelle kabyle.
- Troisième (3ème
) année psychologie, psychologie de travail organisation des
groupes.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, écrire, parler, comprendre.
64
1-2- Présentation des variables sociales
A priori, nous présentons les trois critères (langue maternelle, sexe, année d’étude)
qui peuvent être en corrélation avec les représentations de la population soumise à
l’enquête.
1-2-1- La langue maternelle
La langue maternelle. Arabe Kabyle
Nombre 05 09
Pourcentage 35.71% 64.28%
Représentation graphique :
0
10
20
30
40
50
60
70
arabe kabyle
pourcentage
Le nombre d’enquêtés de langue maternelle kabyle est légèrement supérieur à
celui des enquêtés de langue maternelle arabe, à raison de 64.28% pour les kabylophones
et 35.71% pour les arabophones.
65
1-2-2- L’appartenance sexuelle des enquêtés
Sexe Féminin Masculin
Nombre 07 07
Pourcentage 50% 50%
Représentation graphique :
0
10
20
30
40
50
féminin masculin
pourcentage
Le nombre de filles est égal à celui des garçons, pourcentage identique de 50% pour
chaque sexe.
1-2-3- Spécialité d’étude
Spécialité Scolaire Travail et organisation Clinique orthophonie
Nombre 04 04 03 03
Pourcentage 28.57% 28.57% 21.42% 21.42%
66
Représentation graphique :
0
5
10
15
20
25
30
scolaire travail clinique orthophonie
nombre
Au cours de la troisième année, les étudiants en psychologie sont orientés selon
leurs moyennes et leurs choix vers quatre spécialités qui sont : « psychologie scolaire » ;
« psychologie de travail et organisation des groupes », « clinique » et « orthophonie ».
Dans notre échantillon, nous avons pris le soin pour que toutes les spécialités y figure,
comme le tableau le montre nous avons pris :
- 04 étudiants de la psychologie scolaire
- 04 étudiants de la psychologie de travail et d’organisation des groupes
- 03 étudiants de la psychologie clinique
- 03 étudiants de l’orthophonie
67
2- élément descriptifs de la présence des langues dans les études en
psychologie : diversité et sectorialisation
Depuis l’indépendance, l’enseignement général s’est peu à peu fait, suite à la
politique de l’arabisation exclusivement en arabe, à l’exception de l’université où
l’enseignement des matières scientifiques est dispensé en langue française. Mais certains
départements au sein de l’université ont adopté la langue arabe comme langue
d’enseignement, parmi eux nous trouvons le département de psychologie dans lequel s’est
déroulé notre enquête, la totalité de nos informateurs sont des étudiants en psychologie.
2-1- En classe : prédominance de l’arabe
Concernant les langues avec lesquelles ces étudiants suivent leurs études et les
différents usages qu’ils en font à l’intérieur de l’université, nous leur avons posé la
question suivante : au sein de l’université dans quel contexte utilisez-vous les langue arabe
et française ? Onze d’entre eux affirment qu’ils utilisent la langue arabe dans la classe pour
communiquer avec les enseignants. Nous rapportons ci-dessous, les réponses qui nous
semblent pertinentes
INFA1
- au sein de l’université dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la langue
française ?
- « donc l’arabe en parlant, on communiquant avec tout le monde c’est à dire avec
les camarades, et le français quand ça nécessite, quand on expose par exemple ou
le travail où ça nécessite d’utilisez une autre langue, on explique, quand vraiment
ça demande »
- Dans la classe qu’est ce que vous utilisez ?
- « On utilise l’arabe »
68
INMK4
- au sein de l’université, dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la langue
française ?
- « généralement les étudiants en psychologie utilisent la langue française dans le
module de terminologie, si non pour les autres modules c’est la langue arabe,
même les enseignants exigent la langue arabe »
INFK3
- dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la langue française ?
- « on utilise l’arabe »
- Dans la classe avec l’enseignant ?
- « en arabe, on est obligé »
INFA2
- au sein de l’université, dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la langue
française ?
- « à l’intérieur de l’université (nekraw yaani) en arabe seulement en arabe
(manekrawche) le français »
- pour communiquer avec le prof ?
- « la langue arabe »
Il ressors de la lecture de ces réponses qu’en classe, pour communiquer avec les
enseignants, les étudiants utilisent la langue arabe, c’est la langue pédagogique, les
enseignants exposent leurs cours et leurs TD en langue arabe et exigent des étudiants de
faire de même, ils se voient donc dans l’obligation de répondre en utilisant la même
langue. Néanmoins, nous comptons trois informateurs qui affirment que les enseignants
utilisent la langue française et les autorisent à l’utiliser
69
INM1
- au sein de l’université ; dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la langue
française ? Dans la classe par exemple ?
- « de temps en temps le français »
- Avec l’enseignant ?
- « Avec l’enseignant c’est le français »
INMK3
- au sein de l’université dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la langue
française ?
- « je n’ai pas compris »
- Par exemple dans la classe quelle langue utilisez-vous ?
- « bien sûr si tu parles à l’enseignant en kabyle c’est pas ça, il faut lui parler en
arabe »
- Si vous lui parlez en français est ce que ça pose problème ?
- « Ça ne pose pas de problèmes, normal »
- Donc vous pouvez lui parlez en français ?
- « Oui bien sur »
Nous comprenons par là que l’utilisation de la langue française à l’intérieur des
classes au département de psychologie n’est pas interdite, un autre informateur nous
apporte quelques clarifications sur ce sujet
INMK5
- Quelle langue utilisez-vous dans la classe ?
- « malheureusement c’est l’arabe, des fois des mots en français »
70
Selon cet informateur, les étudiants en psychologie n’utilisent pas exclusivement la
langue arabe, mais ils peuvent bien faire recours, en cas de besoin, à la langue française.
Ce qui veut dire que si l’étudiant ne trouve pas les mots qui lui faut pour exprimer ses
idées, il peut naturellement utiliser la langue française sans poser aucun problème, la
langue française donc n’est pas totalement absente dans un cours dispensé en langue arabe.
2-2- la rédaction : prédominance de l’arabe
En ce qui concerne la rédaction des exposés, des mémoires et des rapports de stages
les avis se rejoignent sur l’utilisation de la langue arabe. Les réponses recueillies ci après
affirment cet avis
INFK3
- Pour la rédaction ?
- « en arabe on fait tout en arabe »
INMK3
- Et pour la rédaction des mémoire, des exposés ?
- « bien sur c’est l’arabe »
INMK5
- et pour la rédaction ?
- « c’est la même chose c’est l’arabe »
Il est donc évident que pour remettre un document à l’enseignent, qu’il soit un
rapport de stage, un exposé ou un mémoire, il doit être écrit en langue arabe, c’est l’avis de
la majorité, mais il y a eu une exception. Une informatrice (INFA1) nous a déclaré ; suite à
la question portée sur la langue utilisée lors de la rédaction des exposés ; « C’est en arabe
mais parfois ça demande le français, quand ça nécessite on utilise (thani) c'est-à-dire, un
paragraphe en français quand on ne peux pas traduire, même les profs nous autorisent, y a
pas de problèmes »
71
Selon cette informatrice, même l’usage écrit de la langue française est autorisé du
moment qu’ils peuvent rédiger des paragraphes en entier en français. Mais cet usage est
réduit comme elle l’a annoncé, ils n’utilisent cette langue que dans le cas ou ils ne peuvent
pas traduire en arabe. De ce fait on peut dire que le français n’est pas complètement absent
des rédactions des étudiants en psychologie bien qu’il soit conditionné.
2-3- En dehors de la classe : prédominance de la langue française
La langue utilisée dans la classe, nous l’avons déjà vu c’est la langue arabe dans la
plupart des cas, mais en dehors, c’est un autre état de fait. Aucun de nos informateurs
n’utilisent l’arabe standard si ce n’est pour communiquer avec les enseignants, le français
en revanche est présent partout, au sein de l’université.
INMK2
- au sein de l’université dans quel contexte utilisez-vous les langues arabe et
française ?
- « la langue arabe, tout ce qui concerne les exposés, les réponses aux examens,
l’intervention (dakhel) la classe soit en arabe ou en français, c’est la même chose.
Dehors dans des interventions, s’il y a une conférence ou un débat (elkoumité) ou
un CP (nesekhdam) le français toujours »
Selon les propos de cet étudiant, nous constatons que les interventions en dehors de la
classe se font en langue française que ce soit :
- dans des conférences où on note la présence des étudiants mais aussi des
conférenciers, des cadres, des docteurs, des enseignants, des dirigeants politiques
etc.
- dans des débats au sein des comités autonomes ou lors des assemblés générales
entre les étudiants et leurs représentants
72
- lors du CP (conseil pédagogique) avec la présence des délégués des groupes, les
enseignants et les chefs des départements.
Si quelqu'un veut intervenir lors d’un débat, l’utilisation de la langue française est
fortement recommandée car c’est la langue la plus utilisée pour aborder des thèmes
scientifiques, littéraires, politiques, pédagogiques, techniques, etc. Le recours au français
compense aussi la pauvreté lexicale des langues maternelles, ouvre de larges horizons
scientifiques et c’est une manière de participer au développement de la culture universelle.
Dans ce contexte, la langue française occupe les premiers rangs, les informateurs lui
attribue une place prestigieuse et la préfère à toutes autres langues.
Malgré la volonté des dirigeants d’arabiser cette filière, le français reste vivace chez
les étudiants en psychologie, dans la sphère informelle, autrement dit, dans la vie
quotidienne, dans les conversations de tous les jours, voila ce que pensent d’autres
informateurs à ce sujet
INFK1
- « non la langue arabe entre les étudiants et les enseignants »
- et la langue française ?
- « entre les étudiants »
Cette informatrice affirme que la langue française est présente dans les discussions
entre les étudiants, ce qui n’est pas du tout étonnant vue qu’ils sont des étudiants et ils sont
sensés connaître au moins quelque mots en langue française. D’autant plus qu’ils font
partie d’une société qui en fait usage. Un autre informateur, nous, assure qu’il utilise aussi
le français pour parler avec ses amis.
INMA1
- Avec vos amis et les gens que vous connaissez ?
- « La plupart du temps l’arabe mais des fois le français »
73
- De quel arabe parlez-vous ?
- « (edardja taana) bien sûr »
Notre informateur fait référence à l’arabe dialectal, sa langue maternelle, langue dans
laquelle sont exprimés les gestes quotidiens, les invocations, les émotions. Dans le réseau
amical, ce sont les langues maternelles qui sont le plus utilisées, le français intervient selon
les thèmes qu’ils abordent entre eux. Toutefois, la langue française apparaît souvent dans
l’alternance codique. Lors des échanges langagiers en arabe dialectal ou en kabyle, les
étudiants font recours au français, sans complexe, pour représenter une réalité ou une idée
que leurs langues maternelles ne peuvent pas représenter. L’avis de INMA2 va dans ce
sens « l’utilisation de la langue arabe avec les gens arabes, la langue française, en cas où
on a traité un sujet scientifique ou de la littérature »
Ici l’informateur, qui est de langue maternelle arabe, déclare qu’il n’utilise la langue
arabe qu’avec les locuteurs arabophones, mais même avec eux il utilise la langue française
quand il s’agit d’une discussion autours d’un thème scientifique ou littéraire. Il y a certains
sujets où le locuteur ne trouve pas les mots qu’il faut pour exprimer ses opinions et ses
idées dans sa langue maternelle, alors il fait recours à la langue française. Il y a aussi ce
qu’on appelle les sujets tabous (la sexualité par exemple) où le locuteur trouve que les
termes de sa langue maternelle sont offensifs vis-à-vis de son interlocuteur, alors il choisit
tous simplement la langue française avec laquelle il peut s’exprimer en aisance « la langue
arabe a une mémoire qui l’atrophie elle est passée à travers l’entonnoir de la pensée
islamique... une langue qui distingue le permis et l’interdit, Halal et Harem...L’arabe est
prisonnier de l’Islam »1. En effet le locuteur algérien a tendance à utiliser la langue
française pour transgresser ces sujets et contourner ces interdits, il est plus facile pour lui
de dire à une fille je t’aime en français que de lui dire ouhibouki en arabe.
1 TAIBI et A ZAOUI, in Algérie Actualité (hebdomadaire), n° 1068, avril 1986
74
2-4- vers la diversité des langues
Il est de plus en plus frappant de constater que la mondialisation est devenue l’objet
de réflexion de nos étudiants dans la mesure où elle met en évidence les enjeux de la
promotion des langues étrangères. La valorisation actuelle des langues étrangères provient
de la demande d’une société désirant être à jour. Voila ce que pense INMK5 à ce sujet :
« normalement, en réalité, (anmar ednekini) je n’utiliserais pas du tout la langue arabe,
ça sera le français ou une autre langue, l’allemand, l’anglais, le russe, ça dépend,
l’essentiel ce n’est pas l’arabe » nous voyons donc, à quel point notre informateur
dévalorise la langue arabe en faveur des langues étrangères sans distinction.
Dans la même optique mais sans pour autant dévaloriser la langue arabe, nous
recueillons les propos de INFA1 en guise de réponse à la question 2 : estimez-vous que la
langue arabe et la langue française soient essentielles dans votre cursus
- « certainement pour la maîtrise des langues (loukan) peux être l’anglais j’aurais
dit oui, de plus y a des langues de plus c’est meilleur, même à l’avenir (kitweli
tekhedmi wela tesheki) vraiment les langues, je trouve »
Le recours de cette informatrice à la langue française et la langue anglaise peut être
expliqué par le fait que :
- Pour ce qui concerne la langue française, nous rappelons que jusqu’à
l’indépendance (1962) le français était la langue officielle en Algérie. Même
aujourd’hui, le français conserve un rôle privilégié en tant que première langue
étrangère, la langue française a gardé des positions importantes dans le système
éducatif algérien, la politique, l’administration et les médias etc.
- Pour ce qui est de l’anglais, il faut noter que sa position reste encore faible sur le
marché linguistique algérien, mais son essor s’accentue lentement et sûrement en
raison de son statut sur le plan international.
75
2-5- vers le français comme langue de l’enseignement
Nous avons constaté d’après les réponses de nos informateurs que plusieurs d’entre
eux considèrent la langue française comme langue utile dans leur parcours universitaire et
cela pour différentes raisons. Un nombre important de ces étudiants disent que le français
est plus approprié aux études en psychologie et affirment que la langue d’enseignement de
cette filière doit être le français. Nous rapportons ci-dessous les réponses qui vont dans le
même sens.
INMK2
- estimez-vous que la langue française soit essentielle dans votre cursus ?
- « elle est très essentielle »
- Dans quelle mesure ?
- « Normalement nous allons étudier en français parce que les concepts, les
traductions (ighdetsawin) ils sont pas vraiment, ils n’ont pas la valeur comme les
concepts d’origine en français, en allemand, mais beaucoup plus (matrouhedh
atseghred) en français tu aura plus d’informations mieux que l’arabe »
INMA1
- estimez-vous que le français soit essentiel dans votre cursus ?
- « bien sûr »
- Comment ça ?
- « Normalement on l’utilise dans tous les cours »
INMK5
- estimez-vous que la langue française soit essentielle dans votre cursus ?
- « ça c’est sûr »
- Dans quelle mesure
76
- « Parce que déjà c’est impossible de faire la psychologie en arabe »
Ces trois étudiants s’entendent sur le fait que la langue française est très utile pour
poursuivre des études en psychologie, le premier nous dit qu’ils doivent normalement
étudier en français, le deuxième affirme que normalement ils doivent l’utiliser dans tous les
cours et le troisième affirme qu’il est impossible de faire la psychologie en arabe. Cela
veux dire que nos informateurs pensent qu’ils ne peuvent pas s’en passer de la langue
française, bien que l’enseignement de cette discipline soit pris en charge par la langue
arabe.
Pour exprimer son point de vue, l’un deux dit par ailleurs, que les concepts traduits
en arabe n’on pas la même valeur que les concepts d’origine qui sont en langue française.
En d’autres termes, même s’ils poursuivent leur étude en arabe (la langue pédagogique), le
recours à la langue française s’avère nécessaire voire indispensable puisqu’il y a des
termes qu’ils ne peuvent pas traduire. Le même informateur nous déclare « en français tu
aura plus d’informations mieux que l’arabe », par ces dires, il remet en cause la qualité de
l’enseignement en arabe, et valorise les informations acquises en langue française.
Cet avis n’est pas partagé par la totalité des étudiants. INFK3, sans pour autant nier
l’utilisation de la langue française dans des cas rares, elle estime que l’arabe est plus
essentiel « c’est sûr, elle est essentielle, mais puisque notre filière est en arabe, c’est rare
où on utilise le français, l’arabe est plus essentiel » la nécessité de la langue arabe semble
tout à fait logique puisque la majorité des modules à l’exception du module de
terminologie française sont dispensés en langue arabe
Quelques étudiants attestent que le français est très utile et même plus essentiel que la
langue arabe, pour justifier leurs propos ils font recours à l’argument de l’étranger
INMK1
77
- estimez- vous que la langue arabe et la langue française soient essentielles dans
votre cursus ?
- « la langue arabe est essentielle »
- Et la langue française ?
- « Elle est plus essentielle que l’arabe bien sur, car on peut l’utiliser peux être à
l’étranger »
INMK4
- estimez-vous que les deux langues soient essentielles dans votre cursus
- « la langue française bien sur est essentielle, normalement elle est nécessaire »
- Dans quelle mesure ?
- « Bon prenons l’exemple de quelqu'un qui veut poursuivre ses études en France, il
peut pas choisir une langue, c’est automatique il doit étudier uniquement en
français »
La langue française est vue par nos étudiants comme un moyen leur permettant
l’accès aux pays européens notamment la France, là où les études en psychologie se font
naturellement en langue française, ils considèrent donc cette langue comme la clé de
l’avenir qui leur facilitera l’ouverture sur le monde extérieur.
78
3- mise en mots des préférences linguistiques et argumentation
Pour l’analyse des représentations et des attitudes de nos informateurs à l’égard des
deux langues en question, l’arabe et le français, nous leur avons posé la question suivante :
aimerez- vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en arabe ?
3-1- Pour la langue française
La majorité des réponses (douze étudiants sur quatorze) est en faveur de la langue
française, les raisons sont multiples, nous les avons regroupées en trois catégories :
- des raisons liées au domaine du travail (la pratique)
- des raisons liées à la qualité de l’enseignement
- des raisons liées à la documentation
3-1-1- travail
Quatre de nos informateurs préfèrent étudier en français parce qu’ils pensent qu’ils
vont en avoir besoin le jour où ils vont occuper un poste de travail. Sachant que le français
est omniprésent dans la société algérienne, leur attitude est tout à fait explicable.
Conscients de l’utilité de la langue française dans la société algérienne, ils ont avancé
différents arguments
INMK1 : « moi personnellement je préfère la langue française, parce que
normalement le travail c’est en collaboration avec des médecins neurologues, avec des
pédiatres, alors, on peut pas utiliser la langue arabe pour communiquer avec des
médecins »
INMK4 : « sur le terrain, mon poste de travail évidemment, on utilise la langue
française parce que déjà je suis en stage pratique, j’utilise la langue française beaucoup
plus que la langue arabe, dans des entreprises, quand on dit par exemple une fiche de
79
poste, quand je demande à l’encadreur de me donner une fiche de poste, je ne peux pas le
dire en arabe »
Ces deux étudiants pensent que le jour où ils seront appelés à exercer leurs fonctions,
ils vont le faire en langue française, que ce soit dans un hôpital ou dans une entreprise
(selon la spécialité). Ils confirment que le français est la première langue utilisée dans ces
établissements et qu’ils ne peuvent pas s’en passer. En effet, pour communiquer avec des
médecins, avec des infirmiers dans des hôpitaux ou avec des cadres dans des entreprises
les futurs psychologues doivent avoir des connaissances en langue française
Pour aller plus loin, INMK5 nous informe qu’il suit des cours de langue française
pour éviter les problèmes de la communication et de non compréhension dans son futur
poste de travail. « Puisque la psychologie normalement (oustenkhedem ara) en arabe mais
malheureusement on la fait en arabe. (besah toura zaama nekini esiighe akhedim) en
même temps je suies des cours en français pour améliorer mon niveau. C’est vrai
(eghrighe ) le français au primaire, au CEM et au lycée, mais pas au point d’être capable
de travailler dans un poste de travail où ça demande le français, alors c’est pour ça que je
suis entrain de faire des cours(dagi dibara)dans une école privée, (bach esya arzdath)
quand j’aurais mon diplôme (adkhedmaghe) dans une société ou une entreprise où on
utilise le français c’est mieux que l’arabe ».
Cet informateur évalue la formation qu’il a reçue en langue française comme
insuffisante, chose qui l’a poussé à s’inscrire dans une école privée pour pouvoir acquérir
des compétences linguistiques en langue française qui vont lui permettre de bien exercer sa
fonction de psychologue. Cet intérêt à la langue française s’explique par le fait que dans le
domaine de pratique de la psychologie ainsi que dans tous les secteurs de la vie
quotidienne des Algériens, cette langue occupe une place prestigieuse et joue un rôle très
important dans les communications de tous les jours.
80
Les propos de INFA1 s’inscrivent dans la même lignée : « dans mon cas, je préfère
en français, en fin, par rapport, les étudiants (ehna) on a travaillé, c'est-à-dire, depuis le
primaire en arabe, mais changer complètement, il faut dire, il y a certain étudiants (eli
idjiw men deles maala baliche melakher). Ils n’ont pas fait une bonne formation en
français, ils préfèrent beaucoup plus l’arabe et ils comprennent mieux, mais pour voir,
c'est-à-dire, la profession prochainement (kitkoun) en contact avec des spécialistes des
médecins et tous. Moi je trouve que le français est beaucoup meilleur parce qu’on peut pas
communiquer (ila tkouni enti tekray) en arabe (emba3da etdji hadik elhadja ekritiha en
arabe emba3da etdjik win teshaki tehedriha) en français peut être tu n’arrive même pas à
traduire ou tu ne comprend pas, je trouve pas, je préfère mieux en français ».
Les étudiants en psychologie, à l’instar de tous les universitaires Algériens, n’ont
étudié la langue française qu’en tant que langue étrangère au primaire, au CEM et au lycée,
avec un volume horaire réduit. Notre informatrice, consciente de tout ça, a une vision plus
lointaine des choses, elle pense d’ores et déjà au domaine du travail, où elle sera en contact
avec des médecins, et là, la langue française est essentielle, pour éviter les problèmes de
non compréhension quand elle sera appelée à exercer son métier. Elle préfère alors étudier
en français.
HADDAR Yazid s’exprime à ce sujet à travers le quotidien d’Oran en ces termes : «
Le premier obstacle auquel le psychologue va se confronter, c'est la langue, car il travaille
avec des psychiatres ou des médecins, les correspondances se font en français avec une
terminologie médicale alors que toute sa formation s'est déroulée en langue arabe »1. En
effet le psychologue dans son domaine de travail est confronté à des collègues qui ont eu
une formation en langue française et qui s’expriment dans la plupart du temps en cette
langue. Il se trouve donc dans l’obligation de l’utiliser lui aussi, mais ayant suivi les études
1 HADDAR. Y, « La formation de psychologue en Algérie », in, le quotidien d’Oran, consultable sur le site
http://www.algerie-dz.com/forums/showthread.php?t=47203 pages consultées le 15-02-2010
81
en arabe, la chose n’est pas vraiment aisée. C’est pour toutes ces raisons que bon nombre
de nos informateurs préfèrent étudier en français.
3-1-2- qualité de l’enseignement
Outre ces raisons, certains de nos informateurs ont fait référence à la qualité de
l’enseignement de la psychologie en langue française. Ils justifient leur préférence
d’étudier en langue française par le fait que cette dernière est plus apte à assurer la
transmission du savoir que la langue arabe, voilà comment ils ont répondu à cette question
INFK4 :
- aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en arabe ?
- « en français c’est mieux, la psychologie normalement en anglais (arantsid) en
français, alors là en arabe (etrouhak) »
A défaut de la langue anglaise que cette étudiante favorise, la langue française
pourrait bien faire l’affaire et prendre en charge l’enseignement de la psychologie, mais
certainement pas la langue arabe.
A la même question, INMK1 nous répond ainsi : « le français est une langue
internationale, l’arabe on peut pas dire ce n’est pas une langue internationale, mais
revenons un peu à l’historique de la psychologie. Le créateur du premier laboratoire en
psychologie est un français, il a fait ses études et ses recherches en français, et nous les
étudiants de l’université Mouloud Mammeri on étudie en arabe, enfin en Algérie entière et
c’est pas ça ». Sans nier le fait que, même l’arabe est une langue internationale, notre
informateur préfère étudier en français pour des raisons historiques, étant donné que le
créateur du premier laboratoire en psychologie est un français et qu’il a fait ses recherches
et ses travaux en langue française, il se demande pourquoi eux les étudiants algériens
doivent étudier en arabe.
82
Pour plus d’informations, nous lui avons demandé s’il n’ y a pas d’autre raisons,
voila ce qu’il nous dit : « C’est vrai on aime la langue française, moi personnellement
j’aimerais bien étudier en français qu’en arabe parce que en français c’est vaste. En arabe
déjà il font une traduction intégrale, on prend le terme tel qu’il est dans le français et on le
prononce en arabe, c’est juste qu’on l’écrit en arabe ». Le dit informateur signale qu’il
aime bien la langue française. A coté de l’amour qu’il porte pour la langue française, son
attachement est justifié par les mêmes raisons que INMK5 : « Parce qu’en arabe on ne
peut pas comprendre. Par exemple, pour parler de la psychologie clinique, (matrouhedh)
en arabe le terme clinique, pour le traduire, on ne peut pas, ils nous disent (iilm enafs
eliklininki) ça n’existe pas en arabe. Ils l’ont pris du français, donc y a pas de termes en
arabe qui ont vraiment leur équivalents en français ». Dans ce cas, le problème se pose sur
le niveau de la terminologie, selon nos informateurs, il y a des difficultés à comprendre la
psychologie en langue arabe car il y a des termes qui n’existent pas en cette langue. Pour
s’y faire les spécialistes sont dans l’obligation de chercher leurs équivalents qui ne sont pas
toujours disponibles, et dans le cas échéant, ils vont jusqu’à les emprunter tel qu’ils sont de
la langue française, les prononcer et les écrire ensuite en arabe.
Le recours à la langue française s’avère donc nécessaire pour combler le manque
duquel souffre la langue arabe, pour toutes ces raisons nos informateurs préfèrent étudier
directement en français sans passer par ce détour qui leur fait perdre du temps et des
efforts.
3-1-3- documentation
Un autre point très important a été signalé par nos informateurs c’est celui de la
documentation. Nous avons dénombré trois étudiants qui ont évoqué le problème de la
documentation dans leurs réponses à la question : pourquoi aimerez-vous poursuivre vos
études en langue française ? Voila ci dessous les plus pertinentes d’entre elles :
83
INFA2 : « Parce que (nehtadjouha) parce que (rana nekraw) en arabe (tehtadji) le
français alors de préférence (nekrawha)en français, parce qu’en arabe (echwiya naksin)
les ouvrages ; en français c’est la vrai psychologie parce qu’en français ou en anglais
(kamel daroulhoum) la traduction en arabe mais (bessah) l’origine en français »
INFA3 : « parce qu’on a des ouvrages en français, on étudie l’anatomie en français
et puis on les nous demande en arabe (yaani) c’est du n’importe quoi (ki nekraw)
l’anatomie du larynx, de l’oreille, (ta3 lakher) en arabe c’est n’importe quoi, de
préférence en français parce que c’est quelque chose de scientifique, y a pas des mots de
l’anatomie en arabe y a pas de mots exacts en arabe »
Il ressort de la lecture des réponses de nos deux informatrices qu’elles renvoient
l’utilité de la langue française à la documentation. Ceci s’explique comme elles l’ont dit
par le manque d’ouvrages de qualité en langue arabe. Pour combler ce manque, elles font
recours aux ouvrages écrits en français qui répondent le plus à leur attente en ce qui
concerne les sujets du domaine scientifique. Pour recueillir les informations dont elles ont
besoin, elles doivent d’abord consulter des ouvrages en français, relever tout ce qui les
intéressent et le traduire ensuite en arabe, cette procédure leur fait perdre du temps
précieux et leur demande un effort de plus et une maîtrise des deux langues. Pour éviter
tous ces inconvénients nos informatrices préfèrent étudier tous simplement en langue
française.
3-2- pour la langue arabe
Malgré la prépondérance de l’attitude favorable à l’égard de la langue française chez
nos informateurs, nous recensons quelques uns qui préfèrent étudier en arabe pour
différentes raisons
84
3-2-1- travail
Deux étudiants de la totalité des informateurs déclarent préférer étudier en arabe
parce qu’ils vont utiliser cette langue dans leur travail, voila ce qu’ils nous ont dit à ce
sujet :
INMA1 : « parce que la société (taana), mes études à moi quand je serais
psychologue (netaamel maaa mardha) et sûrement, ils vont être des arabes sauf à Tizi-
Ouzou (ihedrou l’ekbayliya). Par exemple quand j’ai fait mon stage pratique (rouht elwad
aissi), la psychologue m’a ramené un malade (goultelha ila nestaamel aarbiya) je ne
savais pas que l’enfant parle le français, elle m’a dit on parle la langue du malade (ehna
etwekeft). Heureusement je comprend un peu le kabyle (hada wach koult lek) la
psychologie demande la langue maternelle ». Il ressort de ces propos que sa préférence
d’étudier en arabe est liée au domaine du travail, d'après lui, il est sensé être un jour un
psychologue, il aura affaire à des patients venant de la même communauté linguistique que
lui (arabophone). Pour communiquer avec eux, il va utiliser la langue arabe, leur langue
maternelle, c’est pour cette raison qu’il préfère étudier en langue arabe.
INFK4 quant à elle, pense utiliser exclusivement la langue arabe dans son poste de
travail « la langue arabe parce que scolaire, je vais travailler avec des élèves donc je vais
utiliser l’arabe ». Notre informatrice opte pour l’utilisation de l’arabe car (comme elle l’a
expliqué) elle est sensée travailler dans des écoles, vue qu’elle est en spécialité
« scolaire », elle va être en contact avec des élèves à qui, elle préfère parler en arabe
3-2-2- Documentation
Une autre raison pour laquelle nos informateurs préfèrent étudier en langue arabe et
celle de la documentation, ça leur permet de gagner du temps et d’économiser des efforts.
Du moment qu’ils doivent rédiger leurs travaux en langue arabe, ils préfèrent utiliser des
ouvrages écrits en arabe
85
INFK4 : « tellement les exposés en arabe, c’est mieux pour gagner du temps, si non c’est
un double travail »
INFK1 : « même ceux écrit en arabe parce qu’on a fait les exposés en arabe et bien sûr
les ouvrages en arabe, si non c’est un double travail avec la traduction »
Nous remarquons que les deux informatrices ont utilisé l’expression « double
travail » cela veut dire, dans le contexte de leurs propos, que le fait de lire un ouvrage en
langue française et le traduire en langue arabe est un effort fortuit, puisqu’elle peuvent
avoir les mêmes informations en consultants des ouvrages en arabe dans un temps réduit et
en fournissant moins d’efforts, pour cette raison les informatrices en question préfèrent
utiliser la langue arabe.
3-3- La position nuancée
Certains des étudiants interrogés ne sont ni pour la langue arabe ni pour la langue
française, en d’autres termes, ils sont pour l’utilisation des deux langues selon les besoins
3-2-2- Pour le travail
Grand nombre de nos informateurs pensent qu’ils vont être appelés à utiliser
différentes langues dans leur travail. Ce point de vue est tout à fait raisonnable puisque la
société algérienne, société dans laquelle ils vivent, est plurilingue, caractérisée par la
présence de plusieurs langues à savoir l’arabe standard, l’arabe dialectal, le français et les
différentes variétés du berbère.
Nos informateurs disent qu’ils doivent maîtriser plusieurs langues et tout dépendra
des langues que leurs patients parlent
INFA2 : « la langue française mais (nehtadj) l’arabe, le français, le kabyle, je suis
en psychologie (lazem nehdar kamel) les langues avec mes patients »
86
INMA2 : « je pense que les deux langues (...) Au poste de travail, tu ne peux pas
utiliser une seule langue, parce que tu travailles avec beaucoup de monde et chaque
individu a son langage, a sa culture, alors ça répond à des conditions bien précises »
INFA3 : « on utilise la langue française puisqu’on est à l’hôpital mais quand on
parle avec les enfants on parle en arabe, on parle les langues ça dépend (win enkounou)
.Pour la lettre médicale il faut qu’elle soit en français, avec les collègues c’est le français,
mais avec les patients même si tu es médecin il faut parler la langue du patient »
Nous comprenons par les propos de nos informateurs qu’en ce qui concerne la
communication avec les patients, toutes les langues se valent, il n’est plus question de
choisir une langue ou une autre mais ce qui prime c’est que le psychologue soit compris
par son patient et vice versa. La maîtrise des deux langues en question est donc
indispensable pour qu’il réussisse dans l’exercice de son métier
Une autre informatrice, INFA, nous a dit : « je vais essayer de maîtriser et de
travailler les deux langues, mais si ça nécessite comme je l’ai déjà dit. ( goultlek beli)
comme quoi, c'est-à-dire, dans les cas où ça nécessite l’arabe c’est l’arabe (win) le
français c’est le français (win)le kabyle c’est le kabyle (wela) une autre langue (encha
ellah) mais (bessah) d’après (ehna) comme on fait orthophonie, d’après les spécialistes,
les profs, c’est le français qui est le plus utilisé ». Cette étudiante aussi pense utiliser les
langues en fonction de la nécessité, mais avec une certaine insistance sur la langue
française, en avançant que dans sa spécialité « orthophonie » même les enseignants leur
disent qu’il faut maîtriser cette langue car à l’hôpital c’est la plus utilisée
Nous retenons de ce que nos informateurs on dit, que dans le domaine du travail, il y
a deux paramètres à prendre on considération : le lieu du travail et les patients
Il s’agit pour le premier du lieu où les futurs psychologues sont appelés à exercer leur
fonction, ça peut être un hôpital, un asile psychiatriques, une maison d’handicapés, un
87
centre de malentendants, une grande société, une simple entreprise ou une école etc. Dans
tous ces endroits la langue la plus fréquente, c’est la langue française, c’est la plus utilisée
dans ces différents établissements pour assurer leur bon fonctionnement. Pour parler aux
collègues et aux responsables, on a besoin de la langue française. Nos étudiants sont donc
conscients de cette réalité et affirment qu’ils doivent maîtriser la langue française
En deuxième lieu, il s’agit des patients que les futurs psychologues doivent examiner
et avec lesquels, ils vont avoir des entretiens. Ces derniers peuvent provenir des différentes
régions du pays, ils peuvent être des locuteurs arabophones, francophones, ou
berbérophones. Une autre fois nos étudiants conscients de cette réalité, nous ont dit qu’ils
doivent maîtriser toutes les langues que leurs futurs patients sont susceptibles de pratiquer
afin de pouvoir s’expliquer avec eux, car, c’est vraiment un grand handicap s’ils n’arrivent
pas à se faire comprendre et à comprendre la langue de leurs interlocuteurs.
2-3-2- Pour les études
Nous notons parmi nos informateurs un seul étudiant (INMA2) qui est indifférent à la
question de la langue qu’il préfère utiliser dans ses études « c’est la même chose pour moi,
l’essentiel c’est l’information, notre science ne se base pas sur les langues, elle se base sur
des règles et des techniques, la langue normalement c’est la même chose ». Il justifie son
attitude par le fait que la langue n’est qu’un moyen permettant d’obtenir un savoir, que ça
soit l’arabe ou le français, cela n’est pas d’une grande importance. Pour lui ce qui prime
dans le domaine de la psychologie c’est les règles et les méthodes et les langues ne sont
qu’un outil pour les acquérir, étudier donc en arabe ou en français ça ne change absolument
rien pour lui.
88
4- les langues et la documentation :
Dans la question précédente quelque uns de nos informateurs ont parlé d’une manière
brève de la documentation, mais ces réponses ne cernent pas tout à fait les problèmes liés à
la documentation. C’est pour ça que nous avons jugé nécessaire de revenir sur ce point et
de le détailler encore plus. Pour l’analyse de cette question nous l’avons divisée en deux
parties principales : les ouvrages écrits en français et les ouvrages écrits en arabe
4-1-Les ouvrages en français
Dans la bibliothèque du département de psychologie, il existe deux types
d’ouvrages : ceux écrits en français et ceux écrits en arabe. Nous allons commencer
l’analyse de la question relative à la documentation par les ouvrages écrits en français en
essayant de voir leur disponibilité, leur utilisation et leur intérêt
4-1-1- disponibilité
A la question « dans votre bibliothèque, les ouvrages écrits en français sont-ils
suffisants », cinq de nos informateurs en répondu que « oui » ; huit « non » et une seule
étudiante a dit qu’elle ne les consulte pas donc elle ne sait pas s’ils sont suffisants ou pas
4-1-2- utilisation
Pour éclaircir ce point, nous leur avons posé la question « est ce que vous les
consultez souvent ?» Six de ces étudiants ont affirmé qu’ils consultent souvent ce type
d’ouvrages, sept ont répondu qu’ils en font recours mais de temps en temps et une seule
étudiante déclare qu’elle n’utilise pas du tout les ouvrages en français.
4-1-3- Intérêt
Le but de cette question est de déterminer dans quelle mesure les ouvrages écrits en
français aident-ils les étudiants en psychologie à avancer dans leurs études ainsi que dans
leurs travaux de recherche. Comme suite à la question précédente, nous leurs avons
demandé si cette catégorie d’ouvrages est riche en informations et si elle répond à leur
89
besoin en matière de connaissances et de savoir. La plupart des réponses sont en faveur des
ouvrages écrits en langue française, treize d’entre eux, les trouvent intéressants. Parmi ces
treize étudiants, trois ont dit clairement qu’ils préfèrent les ouvrages en français pour les
raisons suivantes
INMK1 : « Ils sont très variés, il y a des choses, on les trouve dans des ouvrages
écrits en français et on les trouve pas en arabe »
INMA1 :« Ils sont mieux que l’arabe, c’est plus clair »
INFA3 :« les ouvrages en français sont riches mais les ouvrages en arabe ils ne
maîtrisent pas, puisque (tawaa masar tawaa el ourdoun). Ils n’utilisent pas, par exemple
(eendna) les troubles de langage, trouble de l’articulation (houma eendhoum kamel
idtirab elougha), ils ne font pas une différence entre ces troubles (wehna darnahoum)
parce que l’orthophonie en Algérie (tab3a) la France (homa eendhoum etawasoul) c’est
quelque chose de différent (eelina). Quand on fait un exposé avec les ouvrages écrits en
arabe on est hors sujet »
Il découle de ces réponses que nos informateurs préfèrent utiliser les ouvrages écrits
en français parce qu’ils sont plus clairs, plus faciles à comprendre, plus variés, et on y
trouves des thèmes et des sujets qu’on ne trouve pas dans ceux écrits en arabe. La dernière
informatrice a pris le soin de détailler un peu plus sa réponse, en disant que le contenu de
l’enseignement de l’orthophonie (une des branches de la psychologie) en Algérie est relié
au programme français, alors que les ouvrages en arabe qui sont écrits par des Egyptiens et
des Jordaniens ne respectent pas le même programme et ne reflètent pas la même réalité. Si
nos étudiants s’appuient sur ces ouvrages (écrits en arabe) pour leurs révisions et leurs
recherches, ils vont être hors sujet car ces derniers ne sont pas conformes au programme
tracé pour l’enseignement de la psychologie en Algérie. Nos étudiants, dans ce cas n’ont
pas, un autre choix, que l’utilisation des ouvrages écrits en langue française qui peuvent
90
répondre pleinement à leurs besoins, sans pour autant les introduire dans une fausse route,
ni les dévier du programme qu’ils sont sensés suivre.
Par ailleurs, deux de nos informateurs, nous, ont dit que les ouvrages, en langue
française, disponibles à la bibliothèque de leur département ne répondent pas à toutes leurs
attentes et ne s’étendent pas sur l’ensemble des modules et des spécialités, en revanche à
l’extérieur de l’université, ils peuvent bien se procurer des ouvrages plus intéressants pour
leurs études, ils signalent sur ce point l’insuffisance, et la difficulté d’accès à ces ouvrage
INMK5 :
- Sont-ils riches ?
- « Pas vraiment (dagi) à l’université pas vraiment »
- Et en dehors ?
- « (elan) on ne doit pas quand même (kouleche etestekledhe af) l’université, c’est la
recherche scientifique, dehors les ouvrages en français sont très riches»
Pour résoudre le problème de l’insuffisance des ouvrages en français, les étudiants ne
se penchent pas sur ceux écrits en arabe, mais ils cherchent plutôt à se procurer les livres
dont ils ont besoin à l’extérieur de l’université et probablement sur leur propre dépense,
comme notre informateur le signale, il ne faut pas compter uniquement sur l’université,
mais il faut aussi que l’étudiant se prenne personnellement en charge, c’est la recherche
scientifique.
INMA4 a parlé du même problème
- dans votre bibliothèque les ouvrages en français sont-ils suffisants ?
- « Pas vraiment, nous avons 3 dictionnaires de psychologie, et en plus on ne peut
pas les prendre à l’extérieur, toujours à la bibliothèque ils nous disent que ce ne
sont pas des livres qu’on peut vous donner à la maison »
91
- Donc c’est l’accès à ses ouvrages qui est difficile et si on parle des ouvrages à
l’extérieur de l’université sont-ils riches ?
- « Bien sur, je vais parler de ma spécialité travail et organisation, j’ai cherché
quand même sur des livres de psychologues spécialistes qui ont écrit sur la
psychologie de travail et de l’organisation, y a pas vraiment un grand nombre de
spécialistes qui ont écrit sur la psychologie du travail dans la bibliothèque du
département mais à l’extérieur il y en a»
De part notre connaissance de ce domaine, ayant déjà travaillé à la bibliothèque de
psychologie, nous pouvons certifier l’exactitude de ces informations fournies par nos
informateurs. Nous avons remarqué que la majorité des livres en français sont en un seul
exemplaire. La loi interne de la bibliothèque dit que dans le cas où il n’y aurait qu’un seul
exemplaire de n’importe quel ouvrage, il est soumis uniquement au prêt intérieur, ce qui
veut dire que l’étudiant n’est pas autorisé à le prendre chez lui car il est dans l’obligation
de le remettre le jour même avant la fermeture de la bibliothèque. Avec cet inconvénient,
l’étudiant ne peut pas travailler à son aise avec ce type d’ouvrages et ne peut pas en tirer un
grand profit. Pour faire face à cet obstacle, comme nous l’avons déjà énoncé, l’étudiant
doit chercher les livres dont il a besoin à l’extérieur de l’université.
Bien que la plupart des informateurs ont certifié que les ouvrages en français sont
riches et intéressants, nous avons recensé un étudiant (INMK2) qui ne partagent pas
vraiment cet avis sans qu’il soit pour autant d’un avis contradictoire, voila ce qu’il nous a
dit à ce sujet : « Quelque uns, ça dépend des modules, par exemple, le module du
développement les ouvrages en français sont mieux que l’arabe par contre les autres
modules (chwiya) »
Selon ces propos les ouvrages en français ne sont pas toujours meilleurs que ceux en
arabe, c’est suivant les modules, parfois c’est le cas et parfois c’est le contraire.
92
4-2- Les ouvrages en langue arabe
Après avoir étudié les ouvrages écrits en français, nous allons passer à l’étude de la
documentation en langue arabe au sein du département de psychologie
4-2-1- disponibilité
A propos de la quantité des ouvrages écrits en langue arabe tout le monde s’accorde
pour dire que le nombre est suffisant et dépasse de loin celui des ouvrages en français, et
en ce qui concerne la qualité et la richesse, les avis sont divergents
4-2-2- utilisation
Après la lecture des réponses de nos informateurs à cette question, nous avons pu
comprendre que la totalité des étudiants utilise les ouvrages écrits en arabe, de par leur
disponibilité et leur facilité à consulter. Parmi eux, on trouve INFK1 qui affirme qu’elle
utilise souvent les ouvrages écrits en arabe mais pas ceux écrits en français, sans expliquer
pourquoi. Sa réponse à cette question se présente ainsi
- dans votre bibliothèque les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants?
- « oui bien sur »
- les consultez-vous souvent ?
- « souvent non pas souvent, l’arabe c’est toujours »
Sachant que ces étudiants se sont familiarisés avec cette langue au fils des années, il
leur est donc plus commode d’utiliser les ouvrages écrits en arabe que ceux écrits en
français. Ce que nous a dit INMA2 illustre bien ce point de vue
« L’information qui est dedans est plus proche de moi en arabe, mais en français j’utilise
le dictionnaire » pour cet informateur l’utilisation du dictionnaire s’impose pour qu’il
puisse comprendre les ouvrages écrits en français. Ce qui veut dire que cet étudiant n’a pas
de connaissances linguistiques aussi larges en français lui permettant d’avancer dans ces
études, et pour faire face, il préfère utiliser des ouvrages écrits en langue arabe
93
4-2-3- intérêt
Nous notons après la lecture des réponses de nos informateurs à cette question que
trois étudiants ont affirmé que les ouvrages écrits en arabe sont indispensables, souvent
riches et répondent dans la plupart des cas à leurs besoins, pour des raisons que nous allons
expliquer après la présentation de leurs propos.
INFK1 : « même ceux écrits en arabe parce qu’on a fait les exposés en arabe et bien
sur les ouvrages en arabe, si non c’est un double travail avec la traduction »
INMA2 : « C’est la même chose, l’information qui est dedans est plus proche de moi
en arabe mais en français, j’utilise le dictionnaire »
Il émane de l’analyse de ces réponses, que si nos étudiants jugent que les ouvrages
écrits en arabe sont intéressant, ce n’est pas par rapport au contenu mais plutôt pour la
facilité qu’ils ont à les utiliser. Du moment qu’ils se sont familiarisés avec la langue arabe
qu’ils peuvent manipuler aisément, ils préfèrent utiliser cette catégorie d’ouvrages. Cela
leur permettra de gagner du temps et d’économiser des efforts, ça leur évitera l’utilisation
du dictionnaire pour l’explication des termes qu’ils n’arrivent pas à saisir et ça leur
épargnera le recours à la traduction qui s’avère une tache très difficile pour les étudiants
qui n’ont pas une grande compétence linguistique en français
Huit de nos informateurs ont dit que, des fois, ils trouvent ce qu’ils cherchent dans
des ouvrages écrits en arabe et des fois, non. INFK3, nous, a clairement affirmé « Des fois,
on trouve ce qu’on cherche, des fois non »
Pour faire face à cette situation, INFK2, fait appel a l’Internet « Pas toujours parce
qu’il y a des thèmes où nous sommes obligés de consulter l’Internet », INMK5, de sa part
fais recours aux ouvrages en français « Pas vraiment, juste quand j’ai un exposé, je préfère
me procurer des ouvrages en français de l’extérieur de l’université », INFA2, quant à elle
94
dit que ses ouvrages sont intéressants mais pas autant que ceux écrits en français « (kayen
bessah machi kima) en français »
D’autre part INFA1, nous explique sur quel plan les ouvrages écrits en arabe sont
défaillants « pour la langue arabe pour être sincère je ne consulte pas vraiment, mais
quand je consulte, très souvent le titre ne correspond pas au contenu (wela). Tu cherche
c'est-à-dire (hadja), tu a l’impression qu’elle est à l’intérieur et après tu ne la trouve
pas ». Selon notre informatrice, dans les ouvrages écrits en arabe, il y a un problème de
non concordance entre les titres et les contenus, ce qui rend les recherches et l’utilisation
de ses ouvrages difficiles et compliquées
Un autre problème concernant ce type d’ouvrages est signalé par INMK1 qui affirme
à ce propos « c’est des traductions, mal faites, ça change le sens ». Dans la même lignée,
INFA3, nous, déclare : « les ouvrages en arabe ils ne maîtrisent pas, puisque (tawaa
masar tawaa el ourdoun) n’utilisent pas, par exemple (eendna) les troubles de langage,
trouble de l’articulation (houma eendhoum kamel idtirab elougha). Ils ne font pas une
différence entre ces troubles (wehna darnahoum) parce que l’orthophonie en Algérie
(tabaa) la France (homa eendhoum etawasoul) c’est quelque chose de différent (eelina)
quand on fait un exposé avec les ouvrages écrits en arabe, on est hors sujet ». Ces deux
étudiants s’accordent sur le fait que ces ouvrages, écrits en arabe, sont des traductions
faites par des traducteurs de différentes nationalités et qui ne correspondent pas, dans la
plus part des cas, à leur programme et leurs attentes, en plus des inconvénients de la
traduction sachant qu’un livre traduit ne vaut jamais autant que l’original
95
5- Analyse des variables
Après avoir analysé les représentations que se font les étudiants en psychologie à
l’égard des deux langues (arabe, français) à travers leurs réponses apportées aux questions
que nous leur avons posées lors des entretiens, nous allons essayer dans cette partie
d’établir une relation entre leurs représentations, leurs attitudes linguistiques et les
différentes variables susceptibles de les influencer. Les variables sociales en question sont :
la variable sexe, la variable langue maternelle et la variable spécialité d’étude
5-1-La variable sexe
Pour vérifier l’influence de l’appartenance sexuelle de nos enquêtés sur leurs
attitudes et leurs représentations envers la langue arabe et la langue française, nous avons
croisé les réponses obtenues aux questions 2, 3, et 5, qui nous semble porter plus
d’informations sur ce sujet, avec cette variable. Les résultats obtenus sont rapportés dans
des tableaux que nous allons ensuite interpréter
5-1-1-Etude
En croisant les réponses de nos informateurs à la question : estimez-vous que la
langue arabe et la langue française soient essentielles dans votre cursus universitaire ?
Avec la variable sexe, nous avons pu dresser le tableau suivant
Féminin Masculin
Le français est essentiel 3 (42.85%) 5 (71.42%)
L’arabe est essentiel 1 (14.28) 0 (00%)
Les deux sont essentielles 3 (42.85) 2 (28.57%)
Total 7 (100%) 7 (100%)
96
Représentation graphique
0
10
20
30
40
50
60
70
80
féminin masculin
le français est essentiel
l'arabe est essentiel
les deux
Le tableau nous montre que le nombre de garçons, trouvant la langue française
essentiel dans leur parcours universitaire est de 5, il est plus élevé que celui des filles qui
est de 3. Pour l’arabe, nous notons une seule fille et aucun garçon qui dit que la langue
arabe (exclusivement) est plus essentielle dans leurs études. Parmi les informateurs qui ont
dit que les deux langues sont essentielles, nous dénombrons 3 filles et 4 garçons.
Nos informateurs et nos informatrices préfèrent-ils étudier en arabe ou en français ?
C’est ce que nous allons essayer de dégager à travers leurs réponses à cette question.
Féminin Masculin
En français 7 (100%) 5 (71.42%)
En arabe 0 (0%) 1 (14.28%)
Indifférent 0 (0%) 1 (14.28%)
Total 7 (100%) 7 (100%)
97
Représentation graphique
0
20
40
60
80
100
feminin masculin
en français
en arabe
indifférents
Ce qui est frappant dans ce tableau c’est que la totalité des informatrices préfère
étudier en langue française, en revanche, pour les garçons, 5 informateurs préfèrent étudier
en français, un seul en arabe et un seul indifférent.
5-1-2- travail
Par l’analyse de ce point, nous allons savoir s’il y a une différence entre ce que
pensent les garçons et les filles de la langue française à l’avenir et dans le domaine du
travail.
Féminin Masculin
Français 0 (0%) 4 (57.14%)
Arabe 1 (14.28%) 0 (0%)
Les deux 6 (85.71%) 3 (42.85%)
Total 7 (100%) 7 (100%)
98
Représentation graphique
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
féminin masculin
français
arabe
les deux
D’après le tableau, nous pouvons dire que les informateurs qui pensent n’utiliser que
la langue française dans leurs postes de travail, sont tous de sexe masculin, car nous ne
notons aucune fille qui déclare ça. Concernant la langue arabe, il n’y a qu’une seule
informatrice qui pense utiliser cette langue exclusivement dans son poste de travail. Pour
ce qui est des informateurs restants, 6 filles et 3 garçons, ils pensent qu’ils vont utiliser les
deux langues côte à côte.
Interprétation
Après la comparaison des différents tableaux, nous constatons que les pourcentages,
obtenus du croisement de la variable sexe avec les trois questions qui nous semble les plus
révélatrices des représentations et des attitudes, ne sont pas d’une grandes différence.
Même si à la question concernant l’importance des langues dans le cursus universitaire des
étudiants en psychologie, les garçons sont plus favorables à la langue française que la
langue arabe, pour la deuxième question ce n’est pas le cas, les filles semble plus favorable
à la langue française et voudraient à unanimité poursuivre leurs études universitaires en
cette langue. Nous constatons donc qu’elles n’adoptent pas une attitude de rejet pour le
français mais plutôt elles sont beaucoup plus pour la diversité des langues. La différence
entre les réponses des deux sexes est vraiment minime, les représentations des garçons et
99
celles des filles sont presque identiques. Ceci nous permet d’avancer que cette variable
n’est pas pertinente dans la détermination des attitudes et des représentations.
5-2- La variable langue maternelle
Pour l’étude de cette variable, nous avons retenu les mêmes questions qu’avec la
variable précédente. Ici, nous allons voir si la langue maternelle a un impact sur les
représentations et les attitudes de nos informateurs
5-2-1- Etude
Pour ce faire, nous avons croisé la variable langue maternelle avec la question qui
porte sur l’importance de la langue française dans les études en psychologie.
Kabylophones Arabophones
Le français est essentiel 5 (55.55%) 3 (60%)
L’arabe est essentiel 1 (11.55%) 0 (0%)
Les deux 3 (33.33%) 2 (40%)
Total 9 (100%) 5 (100%)
Représentation graphique
0
10
20
30
40
50
60
kabylophones arabophones
français
arabe
les deux
Soixante pour cent des informateurs arabophones déclarent que la langue française
est essentielle dans leurs études, les quarante pour cent qui restent jugent que les deux
100
langues sont essentielles et aucun d’entre eux n’a signalé la langue arabe toute seule. Pour
le groupe kabylophone, nous recensons 55.55% qui sont pour la langue française, 11.55%
pour la langue arabe et 33.33% pour les deux langues
En croisant la variable langue maternelle et la langue que nos informateurs préfèrent
utiliser dans leurs études, nous avons obtenu le tableau suivant :
Kabylophones Arabophones
En français 9 (100%) 3 (60%)
En arabe 0 (0%) 1 (20%)
Indifférents 0 (0%) 1 (20%)
Total 9 (100%) 5 (100%)
Représentation graphique
0
20
40
60
80
100
kabylophones arabophones
en français
en arabe
indifférents
La totalité des informateurs kabylophones préfère étudier en langue française,
constat, qui n’est pas le même pour les informateurs arabophones. Chez ces derniers,
soixante pour cent préfèrent étudier exclusivement en français, vingt pour cent en langue
arabe et vingt pour cent sont indifférent.
101
5-2-2- Travail
Dans le tableau qui suit, nous avons croisé la variable langue maternelle avec la
langue que nos informateurs pensent utiliser dans leurs postes de travail
Arabophones kabylophones
En français 00(0%) 4 (44.44%)
En arabe 00 (0%) 1 (11.11%)
Les deux 5 (100%) 4 (44.44%)
Total 5 (100%) 9 (100%)
Représentation graphique
0
20
40
60
80
100
arabophones kabylophones
en français
en arabe
les deux
Tous les locuteurs arabophones pensent qu’ils vont utiliser les deux langues
simultanément dans leur travail, aucun d’entre eux n’a mentionné la langue française seule,
ni la langue arabe. Pour les kabylophones, quatre étudiants pensent utiliser exclusivement
la langue française, un seul la langue arabe et quatre pensent qu’ils vont utiliser les deux
langues simultanément
Interprétation
D’après les résultats obtenus si dessus, nous pouvons avancer que sur l’ensemble des
trois questions posées, les informateurs kabylophones sont plus favorables à l’égard de la
102
langue française, alors que les informateurs arabophones ont un certain penchant vers la
langue arabe. Ces résultats ne sont pas fortuits, ils peuvent être expliqués par plusieurs
raisons :
Pour ceux qui soutiennent la langue arabe, l’arabisation de la filière de psychologie
ainsi que l’arabisation d’autres filières au sein de l’université qui est un domaine parmi tant
d’autres susceptible d’être arabisé, est un moyen de préserver la personnalité algérienne et
de s’attacher de plus en plus à l’idéologie arabo-musulmane et préserver l’unité du pays.
C’est une façon explicite de dénoncer la domination culturelle occidentale, sachant que la
langue française, est la seule langue qui a pu être un danger et une menace à la langue
arabe, dans le passé et même à l’avenir. Ils croient aux capacités de la langue arabe à
devenir une langue scientifique et implicitement refusent la conception langue arabe égale
langue archaïque. Ils pensent que l’enseignement en langue arabe des disciplines
universitaires peut avoir un caractère moderne et scientifique et que l’arabe est une langue
capable d’assumer linguistiquement les nouvelles réalités du monde moderne.
En revanche, les informateurs qui ne sont pas en faveur de la langue arabe, sont
automatiquement pour la langue française. Ceci peut s’expliquer par le fait que les
locuteurs considèrent la langue arabe comme l’une des langues n’ayant pas accès aux
domaines concernant la modernité et le progrès scientifique et technique. Par contre, le
français est une langue des secteurs clés du développement national, de l’industrie, de
l’économie et de la mondialisation.
Les locuteurs kabylophones qui refusent l’arabisation sont pour le maintien de la
langue française, « Les kabyles sont dés l’indépendance opposés à l’arabisation au nom de
la défense de leur langue et de leur culture, ce qui les a amené à marquer une préférence
103
pour le maintien du français puis à revendiquer l’utilisation officielle de leur langue. »1
Considérés comme victime de la politique centralisatrice du pouvoir algérien, la langue
française et kabyle évoluent en dehors des circuits officiels et institutionnels. La langue
arabe standard, la langue du pouvoir et non du peuple, se présente comme leur seul menace
et adversaire. La fréquence de l’attitude hostile vis-à-vis de la langue arabe chez les
étudiants ayant pour langue maternelle le kabyle peut s’expliquer par le fait que la
politique d’arabisation suivie depuis 1962 a étouffé des dialectes arabes et du berbère.
Raison pour laquelle les locuteurs kabylophones refusent l’arabisation.
5-3- La variable : spécialité d’étude
Comme, nous l’avons déjà signalé, les étudiants en psychologie, au bout de leur
deuxième année, sont orientés vers trois spécialités différentes. Nous proposons de voire
ici, si la spécialité a une influence sur les représentations et les attitudes de nos
informateurs
5-3-1- Etude
Nous allons voir ici, si les étudiants des différentes spécialités pensent la même chose
de l’importance des deux langues (arabe et française) dans leurs études.
1 GRANGUILLAUME.G, Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Maisonneuve et Larose, Paris,
1983. p. 12
104
orthophonie Psychologie de
travail
Psychologie
scolaire
Psychologie
clinique
Le français est essentiel 2 (66.66%) 2 (50%) 1 (25%) 3 (100%)
L’arabe est essentiel 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%)
Les deux 1 (33.33%) 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%)
Total 3 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 3 (100%)
Représentation graphique
0
20
40
60
80
100
orthophonie travail scolaire clinique
français
arabe
les deux
Nous remarquons en premier lieu que la totalité des informateurs en psychologie
clinique estime que seule la langue française est essentielle dans leurs études. En deuxième
lieu, 66.66% des orthophonistes pensent que le français est essentiel et 33.33% signalent
l’importance des deux langues. En troisième lieu et concernant la psychologie de travail et
organisation, 50% sont pour la langue française et 50% sont pour l’utilisation simultanée
des deux langues. En dernier lieu, nous notons pour la première fois, dans la spécialité
scolaire, 25% d’informateurs qui estiment que la langue arabe est essentielle, 25% sont en
faveur de la langue française et 50% pour les deux langues
105
Les différentes spécialités ont-elles une influence sur la volonté d’étudier en arabe ou
en français chez nos informateurs, nous allons essayer de répondre à cette question à
travers la lecture de ce tableau
Orthophonie Psychologie du
travail
Psychologie
scolaire
Psychologie
clinique
En français 3 (100%) 3 (75%) 4 (100%) 2 (66.66%)
En arabe 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33.33%)
Indifférent 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%)
Total 3 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 3 (100%)
Représentation graphique
0
20
40
60
80
100
orthophonie travail scolaire clinique
en français
en arabe
indifférents
La majorité des informateurs des quatre spécialités confondues préfère étudier en
langue française avec des pourcentages différents 100% chez les orthophonistes et les
étudiants en psychologie scolaire, 75% chez les informateurs en psychologie de travail, et
66.66% chez les cliniciens. En ce qui concerne la langue arabe, elle n’est cité que par
33.33% des informateurs en psychologie clinique. La position indifférente quant à elle n’a
eu que 25% de la totalité des informateurs en psychologie du travail
106
5-3-2- Travail
En croisant la variable spécialité et la question de la langue que les informateurs
pensent utiliser dans leurs postes de travail, nous avons obtenu le tableau suivant :
Orthophonie Psychologie du
travail
Psychologie
scolaire
Psychologie
clinique
En français 1 (33.33%) 3 (75%) 0 (0%) 0(0%)
En arabe 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%)
Les deux 2 (66.66%) 1 (25%) 3 (75%) 3 (100%)
Total 3 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 3 (100%)
Représentation graphique
0
20
40
60
80
100
orthophonie travail scolaire clinique
en français
en arabe
les deux
En orthophonie, nous recensons 33.33% qui pensent utiliser la langue française toute
seule dans leurs poste de travail et 66.66% qui pensent utiliser les deux langues. En
psychologie du travail, nous avons 75% qui spécule se servir de la langue française et 25%
des deux langues. En psychologie scolaire, aucun informateur n’a cité la langue française
seule, en revanche 75% penchent pour l’utilisation des deux langues et 25% pour la langue
107
arabe. En fin, pour la psychologie clinique, la totalité des informateurs ont dit qu’ils vont
utiliser les deux langues ensemble.
Interprétation
En analysant les trois tableaux précédents, nous percevons que les informateurs les
plus favorables à l’égard de la langue française sont les cliniciens et les orthophonistes,
vient ensuite les étudiants en psychologie du travail et en fin les étudiants en psychologie
scolaire. Nous allons nous appuyer sur leurs propos pour expliquer ces représentations. Les
raisons pour lesquelles les étudiants en orthophonie et en psychologie clinique préfèrent la
langue française sont les suivantes :
- La majorité des ouvrages et des documents dont ils se servent pour se documenter,
s’instruire, s’enrichir en informations est en langue française.
- Les ouvrages en arabe qui sont à leur disposition ne répondent pas dans tous les cas
à leur besoin, des fois ce sont des traductions mal faites et des fois çà ne correspond
pas à leur programme.
- Les termes médicaux et la terminologie scientifique ne peuvent pas être véhiculés
en langue arabe et cette dernière ne peut pas prendre en charge l’enseignement
d’une discipline scientifique sans faire recours à la langue française, vu la difficulté
de la traduction de certains mots.
- Les cliniciens et les orthophonistes sont sensés travailler dans des hôpitaux, à coté
des médecins et des infirmier et là c’est la langue française qui est la plus utilisée.
Néanmoins, les informateurs issus de ces deux spécialités disent qu’ils doivent
maîtriser le maximum de langues possibles, car dans leur travail, ils auront affaire à des
patients et ils doivent parler la langue que ces derniers parlent.
Pour les deux spécialités restantes, nous enregistrons une certaine indifférence vis-à-
vis de l’utilisation des deux langues, cela peut être expliqué par le fait que la langue arabe
108
peut répondre à leurs besoins plus que les deux spécialités précédentes. Une attitude
favorable à l’égard de la langue arabe est tout à fait raisonnée, elle est la langue de
l’enseignement en psychologie. L’Etat a promulgué tous les moyens possibles pour la
promotion de cette dernière, pour son intégration dans l’enseignement en général et dans le
supérieur en particulier. Les cours de psychologie sont dispensés en langue arabe, le grand
nombre d’ouvrages présent à la bibliothèque est en arabe, l’étudiant ne peut pas s’en passer
et pour qu’il réussisse dans ses études, il doit maîtriser cette langue.
Conclusion
D’après l’analyse des entretiens que nous avons effectués, il ressort que le français
est une langue aimée et jugée utile dans le quotidien des Algériens en général et dans le
contexte de nos étudiants en particulier, elle est nécessaire et doit être apprise puisque c’est
une langue du savoir et de la communication. C’est une langue qui a un haut statut
symbolique en Algérie. Elle représente la réussite sociale puisque c’est la langue de
l’instruction, des études supérieures et des débouchés professionnels. C’est aussi la langue
de la culture et de la connaissance, pour la simple raison qu’on l’utilise dans les ouvrages
scientifiques, les journaux et dans d’autres médias. D’après nos étudiants c’est aussi une
langue prestigieuse, puisque beaucoup d’Algériens l’utilisent et la comprennent.
Le français est toujours présent dans notre société parce que ce fut la langue du
colonisateur, un héritage qui fait partie de notre histoire, et qui fait désormais partie
intégrante du quotidien des Algériens. C’est pour cette raison qu’il est jugé facile, plus
facile que l’anglais, l’allemand et le russe (langues auxquelles nos informateurs ont fait
référence) qui représentent des langues complètement étrangères et donc beaucoup moins
fréquentes en Algérie.
En outre, la langue française est une langue de communication et d’ouverture sur le
monde. C’est une langue très fréquente en Europe mais aussi dans plusieurs pays du
109
monde. Elle est donc aussi utile à l’étranger. Dans ces images, C’est l’importance du
français en termes utilitaire qui est donc la plus évoqué, les étudiants interrogés ont justifié
leurs représentations favorables et leur attachement vis-à-vis de la langue française par
l’utilité de cette dernière dans la société algérienne en général et dans la ville de Tizi-
Ouzou en particulier
Pour ce qui est de la langue arabe standard, elle reste la seule langue officielle de
l’Etat algérien, elle jouit de tout les prestiges nécessaire pour sa promotion et son
développement mais elle n’est pas pour autant jugée utile par nos étudiants et ils
n’adoptent pas dans tous les cas des attitudes favorables vis-à-vis de cette dernière. Ils
reconnaissent son utilité pour le bon déroulement de leurs études mais, ils pensent qu’ une
fois le cursus achevé, la langue arabe ne leur servira plus à grand chose
111
Conclusion générale
Notre présente recherche s’est portée sur les représentations des étudiants en
psychologie de l’université de Tizi-Ouzou à l’égard des deux langues en présence dans
leurs études à savoir la langue arabe et la langue française. Nous avons essayé de vérifier, à
travers le discours épilinguistique tenu par ces derniers, si les représentations influent sur
les attitudes et si ces dernières ont des incidences sur le comportement socio langagier. Ce
qui nous a emmené à nous intéresser au statut des langues en rapport avec les attitudes des
locuteurs. Ces dernières sont-elles influencées par le statut de chaque langue ? Autrement
dit y a-t-il un rapport entre le statut politique et pédagogique des langues arabe et française
et les attitudes des locuteurs à leur égard ?
Après avoir pris contact avec les étudiants de cette filière pour nous fournir les
informations qui nous ont aidé, à cerner le cadre de notre travail.Nous avons constaté que
les rapports entre la langue arabe et la langue française ne sont pas établis d’une façon
définitive, bien que les rôles attribués à ces deux langues sembles différents, la langue
arabe pour tous types de rédaction et la langue française pour des occupations accessoires
telle que la documentation et les conversations. C’est de ce constat qu’a émergé notre
recherche durant la quelle nous avons essayé de dégager le rapport, si rapport il y a, entre
le statut pédagogique des différentes langues en présence et les représentations des
locuteurs à leur égard
En guise de réponse préalable à notre problématique nous avons signalé que le statut
politique et pédagogique d’une langue pourrait exercer une influence sur les
représentations linguistiques et que ces dernières déterminent les attitudes et les
comportements socio langagiers des locuteurs.
112
Dans la partie théorique, nous avons présenté la situation sociolinguistique de
l’Algérie a fin de cerner le bain linguistique dans lequel baignent nos étudiants, nous avons
ensuite défini quelques concepts clés relatifs à notre travail à savoir le bilinguisme, le
marché linguistique, sécurité/insécurité linguistique, les attitudes et les représentations
sociolinguistiques. Cette recension des écrits nous a amené à construire un cadre
conceptuel pour mieux cerner notre problématique.
Pour apporter des réponses à notre questionnement, nous avons effectué quatorze
(14) entretiens menés d’une manière semi directive auprès des étudiants qui ont accepté de
nous répondre. Après les avoir enregistrés, nous les avons transcrits et analysés et nous
avons tiré quelques conclusions.
Les langues génèrent chez les différents groupes sociaux, différentes représentations
qui façonnent d’une manière ou d’une autre leurs attitudes. Ces représentations
linguistiques présentent un moyen assez particulier pour observer, expliquer et comprendre
une multitude de phénomènes sociolinguistiques. Aussi nous pouvons affirmer le rôle
important qu’elles jouent pour l’évolution structurelle et statutaire de ces langues et son
impact sur les phénomènes sociolinguistiques ou le domaine d’application : planification
linguistique, apprentissage des langues, relations internationales, etc.
Ce que nous pouvons conclure d’après notre enquête, est que l’image du français et
de l’arabe chez ces étudiants est liée à l’usage et l’utilité de ces dernières au sein de leur
département en particulier et dans la société algérienne en général, car une langue jugée
utile a toutes ses chances pour jouir de l’intérêt de ses locuteurs. Le français est donc une
langue très présente et énormément utilisée par plusieurs étudiants, dans plusieurs
domaines, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Quant à l’arabe, il
est la langue officielle du pays, il est reconnu sur tous les plans à l’échelle national, il jouit
donc d’une fonction primordiale dans tous les secteurs publiques y compris l’université.
113
L’analyse que nous avons effectuée, démontre que le français semble être ressenti
comme un héritage utile, que comme un passé amer, il ne met pas en évidence l’existence
d’un conflit linguistique vis-à-vis de cette langue du colonialisme. Si conflit il y a, il
semble se manifester par une minorité et n’empêche pas ces derniers d’avoir des attitudes
positives à l’égard du français. Car selon nos informateurs, la puissance d’une langue à
l’échelle mondiale se mesure aujourd’hui en fonction de la puissance économique,
politique et militaire de ses secteurs, donc de sa valeur dans les différents marchés
mondiaux : le marché économique, technologique, etc. Il semblerais que dans notre corpus,
ce sont ces raisons qui motivent le plus l’intérêt que portent ces étudiants à l’égard de cette
langue. Ils adoptent une attitude favorable qu’il justifie par le fait que :
- les ouvrages les plus intéressants et les plus adéquats pour leurs études sont en
français
- l’enseignement de la psychologie serait mieux en français (langue de la modernité
et des sciences) qu’en arabe (langue de l’idéologie et de la religion)
- le travail d’un psychologue nécessite beaucoup plus la langue française que la
langue arabe vue qu’il est en contact permanent avec des médecins qui utilisent
dans la plus part des cas la langue française
Pour ce qui est de la langue arabe standard, nous avons constaté que les informateurs
ont une certaine réticence envers cette langue, nous n’avons recensé qu’une minorité qui
adopte une attitude favorable qui est explicable par le fait que : les études et la consultation
des ouvrages sont plus faciles en langue arabe qu’en langue française, vue qu’ils se sont
familiarisés avec cette langue qu’ils ont étudié depuis la première année de leur
scolarisation.
Nous pouvons conclure alors, que même si l’enseignement de la psychologie, à
l’université de Tizi-Ouzou, est dispensé en langue arabe standard, les étudiants n’ont pas
114
forcement adopté des attitudes favorables vis-à-vis de cette langue. D’un autre coté, nous
avons constaté une nette préférence pour la langue française, bien que celle-ci ne soit pas
introduite d’une façon officielle dans le cursus des études en psychologie
Nous pouvons affirmer donc qu’il n’y a pas automatiquement un rapport entre le
statut politique, pédagogique d’une langue et les représentations sociolinguistiques des
locuteurs. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’une langue est reconnue par l’Etat qu’elle
doit être aimée et jugée utile par ces différents utilisateurs. La présence des langue, élues
langues de prestige et d’enseignement, n’entraîne pas nécessairement l’élection de l’une et
l’exclusion de l’autre. L’arabe comme le français sont admis comme langue de travail et
d’enseignement légitimes. Que l’exclusion de l’une d’elle (par exemple l’arabe qui exclue
le français dans le cadre de l’arabisation de l’enseignement) est rejetée dans les faits. Le
français n’est pas proposé comme langue de substitution à l’arabe. Le bilinguisme est
considéré comme une réalité empirique pour des raisons pragmatiques évidentes : la
réussite des études.
Dans notre introduction, nous avons émis l’hypothèse que certaines variables
pourraient influencer les attitudes et les représentations de nos informateurs. Les variables
auxquelles, nous avons fait référence sont : la variable langue maternelle, la variable sexe
et la variable spécialité d’étude. A la suite de l’analyse des entretiens, nous avons retenu ce
qui suit :
Pour ce qui est des attitudes et des représentations des filles et des garçons, nous
pouvons dire que la vue d’ensemble des attitudes et des représentations des sujets
masculins et des sujets féminins montre qu’il n’y a pas une grande différence entre les
groupes de sexe. Néanmoins, nous tenons à préciser que les garçons sont plus catégoriques
dans leurs préférences linguistiques, sur l’ensemble des questions posées, la majorité
d’entre eux a adopté une attitude favorable à l’égard de la langue française, quant aux
115
filles, leurs réponses étaient changeantes et leurs représentations étaient relatives aux
questions posées, la plupart d’entre elles adoptent une attitude favorable pour les deux
langues réunies, elles sont donc pour la diversité des langues
Concernant la variable langue maternelle, d’après notre recherche, elle joue un rôle
dans la détermination des attitudes et des représentations. Nous remarquons que presque
tous les étudiants qui sont de langue maternelle kabyle ont un penchant pour la langue
française et un certain recul vis-à-vis de la langue arabe que, selon eux, est une langue qui
a été imposée. Nous pouvons expliquer cette attitude par l’influence de l’environnement
social dans lequel vivent ces derniers, où l’image de cette langue présente toujours
l’oppression, la violence, le conflit et une menace pour leur propre langue maternelle qui
est le kabyle. Pour les étudiants de langue maternelle arabe, ce problème identitaire ne se
pose pas, ils adoptent alors plus favorablement la langue arabe standard qui représente pour
eux la religion et l’unification du pays.
A propos de la dernière variable, la spécialité d’étude, nous pouvons avancer qu’elle
influence considérablement les représentations et les attitudes des informateurs. Nous
avons enregistré les attitudes les plus favorables à l’égard de la langue française chez les
étudiants en clinique et en orthophonie, cela peut être justifié par :
- le fait que ces deux disciplines sont proches de la médecine, et que cette dernière
se fait exclusivement en langue française dans toutes les universités du pays
- leurs caractères scientifiques, la terminologie de ces deux disciplines est difficile à
arabiser.
- le futur travail, à coté des infirmiers et des médecins c’est la langue française qui
est plus utilisée.
116
En contrepartie les deux spécialités restantes, psychologie scolaire et psychologie du
travail, les étudiants ont adopté des attitudes plus aux moins favorables vis-à-vis de la
langue arabe pour différentes raisons, entre autres :
- la langue arabe est une langue comme les autres, elle peut véhiculer l’enseignement
de la psychologie
- la langue arabe est maîtrisée par la totalité des étudiants, alors que la langue
française n’est maîtrisée que par certains d’entre eux
Nous pouvons conclure, d’après la fréquence des attitudes favorables à l’égard de la
langue française chez les étudiants en psychologie, qu’il serait intéressant d’envisager
l’enseignement de certains modules de cette filière en cette langue. Enfin nous pouvons
dire que toutes actions ayant un rapport avec les langues, devrait passer par une études des
représentations linguistiques et sociales
Suggestions pour des recherches ultérieures
Nous proposons des pistes de recherches qui pourraient être exploitées afin
d’approfondir la recherche sur les représentations et les attitudes des étudiants en
psychologie à l’égard des langues (arabe, français). Pour des contraintes de temps et de
moyens, nous avons restreint notre travail à l’analyse du contenu des entretiens enregistrés,
il serais intéressant, dans des nouvelles recherches d’envisager une analyse du discours à
partir d’autres entretiens pour dégager les représentations et les attitudes en repérant les
subjectivités langagières, les modalités nominales et les déictiques.
L’élargissement de la recherche sur d’autres universités du pays, permettrait
d’interroger un nombre plus important d’étudiants arabophones pour pouvoir comparer les
résultats avec ceux obtenus auprès des étudiants kabylophones. Il est vrai que dans notre
117
recherche, nous avons pris quelques étudiants arabophones mais vu que le nombre de ces
derniers est restreint, nous ne pouvons généraliser les résultas auxquels nous avons abouti
119
Bibliographie
ABDELHAMID. S, pour une approche sociolinguistique de l’apprentissage de la
prononciation du français langue étrangère chez les étudiants du département de
français université de Batna, thèse de doctorat, université de Batna, 2002.
ABRIC C. J, Méthodologie de recueil des représentations sociales, PUF, Paris, 1994.
AKOUN. A et ANSART. P, Dictionnaire de sociologie, Le Robert /Seuil, Paris, 1999.
BEACCO. J-C, « La méthode circulante et les méthodologies constituées » in Le
français dans le monde (recherches et applications), numéro spécial «Méthodes et
méthodologies», Hachette-Larousse, Paris, 1995.
BEACCO. J-C, Représentations linguistiques ordinaires et discours, Larousse, Paris,
2004.
BEN JELOUN. T, « La langue de feu pour la littérature maghrébine », in Geo n° 138,
Paris, Août, 1990.
BENRABAH. M, « L’arabe algérien véhicule de la modernité », dans Minoration
linguistique au Maghreb, éd. SUDLA, université de Rouen, France, 1993
BLANCHET. A et GOTMANE. A, L’enquête et ces méthodes : l’entretien, Nathan,
Paris, 1992
BLANCHET.P, La linguistique de terrain, Presse universitaire de Rennes, Rennes,
2000.
BOUMEDIENE. F, Etude des représentations, attitudes linguistiques et comportements
langagiers des locuteurs Tizi- Ouzéens à l’égard des langues arabe, kabyle et française,
mémoire de magistère, université de Tizi-Ouzou, 2002.
120
BOURDIEU. P, Ce que parler veut dire, l’économie des échanges linguistiques,
Fayard. Paris, 1982.
BOURDIEU. P, Question de sociologie, Minuit, Paris, 1984.
BOUZAE.W, La culture en question, ENAL, Alger, 1984.
BOYER. H, Langues en conflit, L’harmattan, Paris, 1991.
BOYER, H. Sociolinguistique : territoires et objet, Delachaux, Lausanne, 1996.
CALVET. L. J, La guerre des langues et les politiques linguistiques, Payot, Paris, 1987.
CALVET, J.L, La sociolinguistique, PUF, collection Que sais-je ? Paris, 1993
CALVET. J.L, Pour une écologie des langues du monde, Plon, Paris, 1999.
CALVET J-L, DUMONT. P, Enquête sociolinguistique, l’Harmattan, Paris, 1999.
CHAKER. S, Langues et pouvoir : de l’Afrique du nord à l’Extrême-Orient, EDISUD,
France, 1998.
CHAKER S. Manuel de linguistique berbère I, Bouchène, Alger, 1991.
CHAKER. S, Une décennie d’études berbère (1980- 1990), Bouchene, Alger,
CHIBANE. R, Etude des attitudes et de la motivations des lycéens de la ville de Tizi-
Ouzou à l’égard de la langue française : cas les élèves du lycée Lala Fatma N’soumer,
mémoire de magistère, université de Tizi-Ouzou, 2009
COMITI. J. M, Les Corses face à leur langue, de la naissance de l’idiome à la
reconnaissance de la langue, Squadradiv Finusellu Diacciu, 1992.
COMITI. J.M, "Théories sociolinguistiques et étude des comportements langagiers dans
une communauté de langue minorée", in Actes du symposium linguistique franco-
algérien de Corti 9- 10 août1993. Edités par George MORACCHINI, Studii Corsi,
Editions Bastia, Août, 1994.
Encyclopédie philosophique universelle, "Des notions philosophiques ", Dictionnaire n°
02, éd, PUF, France, 1990.
121
DE SINGLY. F, L'enquête et ses méthodes : le questionnaire, Editions Nathan. Coll.
128, Paris, 1992.
DUBOIS. J et al, Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage, Larousse,
Paris, 1994.
ELIMAM. A, Le maghribi, langue trois fois millénaire, ANEP, Rouïba, 1997.
FLAY.S.M, La compétence interculturelle dans le domaine de l’intervention éducative
et sociale, in cahier de l’actif, ACTIF, Paris, 1997.
GHIGLIONE R et MATALON B, Les enquêtes sociologiques, théories et pratique, éd.
Armand Colin, Col «U», Paris, 1978.
GRANGUILLAUME.G, Arabisation et politique linguistique au Maghreb,
Maisonneuve et Larose, Paris, 1983.
GRANGUILLAUME.G, La francophonie en Algérie, école des grandes études en
sciences sociales, Paris, 09-04-2008, [http://sinistri.canalblog.com/archives
/2008/04/09/8718521.html], pages consultées le 15-03-2009.
GRANDGUILLAUME. G, Langues et représentations identitaires en Algérie,
[http://grandguillaume.free.fr/ar_ar/langrep.html],Pages consultées le 22-05-2009.
GRAWITZ, M. Méthodes des sciences sociales. 3ème éd. Paris, Dalloz, 1976.
HADDAR. Y, « La formation de psychologue en Algérie », in, Le Quotidien d’Oran,
http://www.algerie-dz.com/forums/showthread.php?t=47203 pages consultées le 15-02-
2010
HARMES. J-F, BLANC. M, Bilingualité et Bilinguisme, Pierre Mardaga, éditeur, 2
galeries des princes, 1000 Bruxelles, 1983.
JODELET. D, Les représentations sociales, PUF, Paris, 1989.
122
KAHLOUCHE R, Le berbère (kabyle) au contact de l’arabe et du français, Thèse pour
le Doctorat d’Etat en Linguistique, université d’Alger, institut des langues étrangères,
Département de français, Alger, 1992.
KAHLOUCHE. R ; « l’auto-valorisation sociale et ses effets sur le sentiment identitaire,
les attitudes et les pratiques linguistiques en Kabylie », in. Actes du colloque
international : plurilinguisme et identité (s) au Maghreb, Rouen 1996.
LABOV. W, sociolinguistique, Minuit, Paris, 1976
LAROUSSI. F, « Processus de minoration linguistique au Maghreb », dans Minoration
linguistique au Maghreb, éd. SUDLA, université de Rouen, France, 1993
LAROUSSI. F, «Linguistique et anthropologie, Rouen Tizi-Ouzou» in cahier de
linguistique sociale, CNRSURA, 1996
LECLERC. J. Algérie dans « l’aménagement linguistique dans le monde, Québec,
TLFQ, université Loval, 24 février 2007. « http:// www. Ulaval.ce/ax/AFRIQUE/
Algérie-1demo. Htm ». Pages consultées le 26/01/2008.
LUDI. G et PY. B, Etre bilingue, Peter Lang, Berne, 1986.
MANONI. P, Les représentations sociales, PUF, collection que sais-je ? Paris, 1993.
MARCELLESI. J.B, THERRY. B, BLANCHET.P, Sociolinguistique, L’harmattan,
Paris, 2003.
MATTEY. M, Apprentissage d’une langue et interaction verbale, Peter Lang
MOLINER. P, Image et représentations sociales : de la théorie à l’étude des images
sociales, Seuil, paris, 2002.
MOREAU. M-L, Sociolinguistique, les concepts de base, Mardaga, Bruxelles, 1997.
MOSCOVICI. S, Social représentations Cambridge, Cambridge université Presse, 1984.
Moatassime A, Arabisation et langue française au Maghreb, un aspect sociologique des
dilemmes du développement, PUF, Paris, 1992.
123
MOUNIN. G, Dictionnaire de la linguistique, éd. P.U.F, Paris, 1974.
NYSSEN. H, « l’Algérie en 1970, telle que j’ai vue », in Jeune Afrique, collection B,
Arthaud, Paris, 1970.
SEBBA. R. L’arabisation dans les sciences sociales : le cas algérien. L’Harmattan.
Paris. 1996
RAHAL. S, « Culture et langues : place des minorités », dans, Initiatives, Ethiques et
nouvelles technologies, l’appropriation des savoirs en question, Beyrouth, Liban, 2001,
[en ligne], pages consultées le 14/01/ 2007.
RAHAL. S, La francophonie en Algérie : Mythe ou réalité,
http://www.initiatives.refer.org/Initiatives-2001/_notes/sess610.htm, pages consultées le
26/02/ 2008
SINI. CH, Analyse des attitudes des locuteurs amazighophones à l’égard des trois
systèmes en usage, mémoire de magistère, université d’Alger, 1997.
TAIBI et A. ZAOUI, Algérie actualité, hebdomadaire, n 1068, Avril 1968.
TALEB IBRAHIMI. K, Les Algériens et leur(s) langue(s), El Hikma, Alger, 1995.
TOCHON. F.V, Didactique du français : de la planification à ses organisations
cognitives, ESF éditeur 17, Paris, 1990.
VIGNER. G, Didactique fonctionnelle du français, Hachette, Paris, 1982.
WIDDOWSON. H. G, Une approche communicative de l’enseignement des langues,
Hatier-Credif, Paris.
ZABOOT.T, Un code switching algérien : le parler de Tizi-Ouzou, thèse de doctorat,
université de la Sorbonne, 1989
125
Questions de l’entretien
Question 1 : au sein de l’université ; dans quel contexte utilisez-vous les langues deux
langue (arabe et français) ?
Question2 : estimez-vous que les deux langues soient essentielles dans votre cursus ?
Question3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
Question 4 : que pensez-vous des ouvrages écrits en français et ceux écrits en arabe ?
Question 5 : dans votre futur travail, pensez-vous utiliser la langue française ou la
langue arabe ?
126
Fiche de renseignement :
Cochez la réponse qui vous convient
Sexe :
- masculin
- féminin
Langue maternelle :
- arabe
- kabyle
Spécialité d’étude :
- orthophonie
- clinique
- scolaire
- travail et organisation des groupes
Langue de la consultation des ouvrages :
- arabe
- français
Compétences linguistiques :
Arabe :
Écrire, lire, parler, comprendre
Français :
Écrire, lire, parler, comprendre
127
Transcription des entretiens :
INFK1
- Sexe féminin.
- Langue maternelle kabyle.
- 2ème
année psychologie.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe et le français.
- Compétences linguistiques.
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, comprendre, parler.
Question1 : au sein de l’université, dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la
langue française, dés que vous entrez du portail où utilisez vous la langue arabe ?
- «entre les étudiants »
- la langue arabe ?
- « non la langue arabe entre les étudiants et les enseignants »
- et la langue française ?
- « entre les étudiants »
- dans la classe qu’est ce que vous utilisez ?
- « l’arabe à cent pour cent »
- pour la rédaction ?
- « en arabe »
128
- Et pour la consultation des ouvrages ?
- « La langue arabe »
- tout le temps
- « mais pas tout le temps »
Question2 : estimez-vous que les deux langues soient essentielles dans votre cursus ?
- « elles sont essentielles »
Question3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
- « je préfère le français »
- pourquoi ?
- « parce que quand on travaille ailleurs c’est en français, et en plus je parle avec
les gents en français et la majorité préfère la langue française »
Question4 : dans votre bibliothèque les ouvrages écrits en français sont-ils suffisant ?
- « oui bien sûr »
- les consultez-vous souvent ?
- « souvent, non pas souvent, l’arabe c’est toujours »
- sont-ils intéressants ?
- « ils sont très riches »
- et pour ceux écrits en arabe ?
- « même ceux écrits en arabe parce qu’on a fait les exposés en arabe et bien sur les
ouvrages en arabe, si non c’est un double travail avec la traduction »
- vous pensez donc que c’est difficile de lire et comprendre en français et traduire en
suite en arabe ?
129
- « par exemple, il y a des enseignants qui nous donnent des textes en français et on
doit traduire en arabe, pour que l’étudiant (adyisin) les termes de la psychologie
en français et en arabe »
Question5 : une fois que vous aurez fini vos études pensez-vous utilisez l’arabe ou le
français dans votre poste de travail ?
- « je pense la langue française et la langue arabe parce qu’on a étudié en arabe el a
la plupart (etsefhamen) le français »
- de quel arabe parlez-vous ? de l’arabe de l’école ou de l’arabe de la maison ?
- « de l’arabe de la psychologie et on peut mélanger avec le français bien sur »
INFK2
- Sexe féminin.
- Langue maternelle kabyle.
- 3ème
année psychologie spécialité scolaire.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, comprendre, parler, écrire
Question 1 : dans quel contexte ou situation utilisez-vous la langue française et la langue
arabe à l’intérieur de l’université ? Dans la classe par exemple?
- « la langue arabe »
- Et pour la rédaction?
130
- « Aussi la langue arabe »
- Et pour la consultation des ouvrages?
- « La langue arabe »
Question 2 : estimez-vous que la langue arabe et la langue française soient essentielle dans
votre cursus?
- « oui je pense »
- les deux?
- « oui les deux arabe et française »
Question3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe?
- « je préfère qu’il soit en français »
- pourquoi en français?
- « j’aime bien le français »
Question 4 : dans votre bibliothèque, les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants?
- « je ne les consulte pas, donc je ne sais pas si c’est suffisant ou pas »
- Et pour la langue arabe?
- « Il sont suffisants »
- Est-ce qu’ils sont riches?
- « Pas toujours parce qu’il y a des thèmes où nous sommes obligés de consulter
l’Internet »
Question 5 : une fois que vous aurez fini vos études, pensez-vous utilisez l’arabe ou le
français dans votre poste de travail ?
- « l’arabe et le français »
131
INFA1 :
- Sexe féminin.
- Langue maternelle arabe.
- 3ème
année psychologie spécialité orthophonie.
- Langue de la consultation des ouvrages : le français
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, comprendre, parler, écrire
Question 1 : au sein de l’université dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et
la langue française?
- « donc l’arabe en parlant, en communiquant avec tout le monde, c'est-à-dire, avec
les camarades, et le français quand ça nécessite, quand on expose par exemple ou
le travail où ça nécessite d’utilisez une autre langue, on explique, quand vraiment
ça demande »
- Dans la classe qu’est ce que vous utilisez ?
- « On utilise l’arabe »
- Pour la rédaction des exposés?
- « C’est en arabe mais parfois ça demande le français, quand ça nécessite on utilise
(thani), c'est-à-dire, un paragraphe en français quand on ne peux pas traduire
même les profs nous autorisent, y a pas de problèmes »
132
- Et pour la consultation des ouvrages?
- « moi personnellement, j’utilise les ouvrages en français, même les profs
(igouloulna) la documentation de préférence (etkoun) en français pour une source
plus fiable »
Question2 : estimez-vous que la langue arabe et la langue française soient essentielles
dans votre cursus
- « certainement pour la maîtrise des langue (loukan) peux être l’anglais j’aurais dit
oui, de plus y a des langues de plus c’est meilleur, même à l’avenir (kitweli
tekhedmi wela tesheki), vraiment les langues, je trouve »
- L’arabe et le français ?
- « Oui pourquoi pas? »
Question3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en arabe ou en
français?
- « dans mon cas, je préfère en français, en fin, par rapport, les étudiants (ehna) on
a travaillé, c'est-à-dire, depuis le primaire en arabe, mais changer complètement, il
faut dire, il y a certain étudiants (eli idjiw men deles maala baliche melakher), ils
n’ont pas fait une bonne formation en français, ils préfèrent beaucoup plus l’arabe
et ils comprennent mieux, mais pour voir c'est-à-dire, la profession prochainement
(kitkoun) en contact avec des spécialistes, des médecins et tous. Moi je trouve que
le français est beaucoup meilleur parce qu’on peut pas communiquer ; (ila tkouni
enti tekray) en arabe (embaada etdji hadik elhadja ekritiha) en arabe (embaada
etdjik win teshaki tehedriha) en français peut être tu n’arrive même pas à traduire
ou tu ne comprend pas, je trouve pas, je préfère mieux en français »
Question4 : les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants ?
133
- « d’après ce que j’entends parce que moi j’ai pas de carte bibliothèque, il y a un
manque »
- Est-ce que vous consultez souvent des ouvrages écrits en français ?
- « oui quand ça nécessite oui »
- Les informations que vous cherchez est-ce que vous les trouvez là-dedans ?
- « oui »
- Et pour la langue arabe ?
- « pour la langue arabe, pour être sincère je ne consulte pas vraiment, mais quand
je consulte, très souvent le titre ne correspond pas au contenu (wela) tu cherche
c'est-à-dire, (hadja) tu a l’impression qu’elle est à l’intérieur et après tu ne la
trouve pas »
Question5 : une fois que vous aurez fini vos études pensez-vous utiliser la langue arabe ou
française dans votre poste de travail ?
- « je vais essayer de maîtriser et de travailler les deux langues, mais si ça nécessite
comme je l’ai déjà dit (goultlek beli) comme quoi, c'est-à-dire, dans les cas où ça
nécessite l’arabe c’est l’arabe (win) le français c’est le français (win)le kabyle
c’est le kabyle (wela) autre langue(encha ellah ) ; mais (bessah) d’après (ehna)
comme on fait orthophonie, d’après les spécialistes, d’après les profs, c’est le
français qui est le plus utilisé »
134
INMK1 :
- Sexe masculin.
- Langue maternelle kabyle.
- 3ème
année psychologie spécialité orthophonie.
- Langues de la consultation des ouvrages : arabe et français.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, comprendre, parler, écrire.
Question 1 : au sein de l’université ; dans quel contexte utilisez-vous les langues arabe
et la langue française ? Dans la classe par exemple ?
- « de temps en temps le français »
- Avec l’enseignant ?
- « Avec l’enseignant c’est le français »
- Pour la rédaction ?
- « Bien sur on peut s’exprimer en français mais (dagui) la soutenance surtout c’est
en arabe (akhatar), je ne sais pas, le mémoire c’est obligatoire en arabe, et je me
sentirais très, très bien si on expose en français »
- Et pour la consultation des ouvrages?
- « Bien sur ça me fait plaisir quand je trouve un ouvrage en français pour le
consulter, c’est pour améliorer ma langue mais (ma oufighe) en arabe, l’essentiel
c’est de trouver des informations »
135
Question2 : estimez- vous que la langue arabe et la langue française soient essentielles
dans votre cursus?
- « la langue arabe est essentielle »
- Et la langue française?
- « Elle est plus essentielle que l’arabe bien sur, car on peut l’utiliser peux être à
l’étranger »
- Et durant le cursus est ce que vous avez besoin du français?
- « Bien sûr »
- Quelqu'un qui ne connaît pas la langue française peut-il poursuivre des études en
psychologie ?
- « Il peut poursuivre ses études mais il va se trouver dans une situation très, très
naturelle s’il connaît le français »
Question3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
- « en français »
- Pourquoi ?
- « Je ne sais pas, parce que quand l’enseignant parle en français, j’aime bien retenir
certain mots pour améliorer mon niveau »
- Peut-être vous retenez plus les informations en français qu’en arabe ?
- « (adinighe kan essah) non, je comprend en arabe mieux que le français (akhatar)
on a pas beaucoup étudié en français au primaire, au CEM, au lycée, le volume
horaire est insuffisant et on a pas eu de bons profs »
Question4 : dans la bibliothèque les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants ?
136
- « les ouvrages sont disponibles, mais pas en orthophonie, en orthophonie ici à la
bibliothèque y en pas mais à l’extérieur de l’université y en beaucoup »
- Ces ouvrages là est ce que vous les consultez ?
- « ça me fait plaisir de consulter un ouvrage en français parce que je vais faire le
mémoire et notre spécialité orthophonie (dagui), à l’étranger c’est paramédical, on
a besoin des termes scientifiques qu’on peut pas trouver en arabe, même si on les
trouve, en français c’est plus exact »
- Est-ce qu’ils sont intéressants, riches ?
- « Ils sont très variés, il y a des choses, on les trouve dans des ouvrages écrits en
français et on les trouve pas en arabe »
- Les ouvrages écrits en arabe sont-ils d’origine en arabe ou sont-ils des traductions ?
- « c’est des traduction mal faites, sa change le sens »
Question 5 : une fois que vous aurez fini vos études, pensez-vous utiliser l’arabe ou le
français dans votre poste de travail ?
- « moi personnellement je préfère la langue française parce que normalement le
travail c’est en collaboration avec des médecins neurologues, avec des pédiatres,
alors on peut pas utiliser la langue arabe pour communiquer avec des médecins »
INFK3 :
- Sexe féminin.
- Langue maternelle kabyle.
- 4ème
année psychologie scolaire.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe.
137
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, comprendre, parler, écrire
Question1 : dans quel contexte utilisez-vous les langues arabe et française ?
- « on utilise l’arabe »
- Dans la classe avec l’enseignant ?
- « en arabe, on est obligé »
- Pour la rédaction ?
- « en arabe, on fait tous en arabe »
- Et la consultation des ouvrages ?
- « En arabe, c’est rare où on utilise le français »
Question2 : estimez-vous que la langue française est essentielle dans votre cursus ?
- « c’est sûr, elle est essentielle, mais puisque notre filière est en arabe, c’est rare où
on utilise le français, l’arabe est plus essentiel »
Question3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
- « j’aimerais que ça soit en français »
- Pourquoi ?
- « parce que c’est la langue française »
- Qu’est ce qu’elle a la langue française ?
- « Généralement on utilise la langue française, nous sommes obligés de parler la
langue française, mais malheureusement on le fait en arabe »
Question4 : dans votre bibliothèque les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants ?
138
- « oui »
- Les consultez-vous souvent ?
- « pas souvent »
- Est-ce qu’ils sont riches ?
- « oui bien sûr »
- Est-il de même pour la langue arabe ?
- « en arabe c’est plus disponible »
- Et question richesse ?
- « Des fois, on trouve se qu’on cherche des fois, non »
Question5 : une fois que vous aurez fini vos études pensez-vous utiliser la langue arabe ou
la langue française ?
- « bien sur, nous allons utiliser la langue française si c’est nécessaire et on peut
utiliser la langue arabe si c’est nécessaire »
INFK4
- Sexe féminin.
- Langue maternelle kabyle.
- 4ème
année psychologie scolaire.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : comprendre.
139
Question1 : au sein de l’université dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la
langue française ? Dans la classe avec l’enseignant quelle langue utilisez-vous ?
- « la langue arabe »
- Avec les amis et camarades ?
- « L’arabe et le kabyle »
- Pour la rédaction ?
- « L’arabe »
- Pour la consultation des ouvrages ?
- « Arabe et des fois le français »
Question2 : estimez-vous que la langue française soit essentielle dans votre cursus ?
- « oui »
- Dans quelle mesure ?
- « Pour les ouvrages »
Question 3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
- « en français c’est mieux, la psychologie normalement en anglais (arantsid) en
français, alors là en arabe (etrouhak) »
Question4 : dans votre bibliothèque, les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants ?
- « oui, largement »
- Les consultez-vous souvent ?
- « Pas beaucoup »
- Sont-ils intéressants ?
- « Oui »
- Et pour l’arabe ?
140
- « (machi bezaf) mais tellement les exposés en arabe, c’est mieux pour gagner du
temps, si non c’est un double travail »
Question5 : quand vous aurez fini vos études pensez-vous utiliser l’arabe ou le français
dans votre poste de travail ?
- « la langue arabe parce que scolaire, je vais travailler avec des élèves donc je vais
utiliser l’arabe »
INMK2
- Sexe masculin.
- Langue maternelle kabyle.
- 4ème
année psychologie clinique.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe et le français.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, comprendre, parler, écrire.
Question1 : au sein de l’université dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la
langue française ?
- « la langue arabe, tous ce qui concerne les exposés, les réponses aux examens,
l’intervention (dakhel) la classe, soit en arabe ou en français, c’est la même chose.
Dehors dans des intervention s’il y a une conférence ou un débat (elkumité) ou un
CP (nesekhdam) le français toujours »
- Et pour la rédaction ?
141
- « La rédaction en arabe mais pour les exposés (nesekhdam) des ouvrages en
français et en arabe »
Question2 : estimez-vous que la langue française soit essentielle dans votre cursus ?
- « elle est très essentielle »
- Dans quelle mesure ?
- « Normalement nous allons étudier en français parce que les concepts, les
traductions (ighdetsawin) ils sont pas vraiment, ils n’ont pas la valeur comme les
concepts d’origine en français et en allemand, mais beaucoup plus (matrouhed
atseghred) en français tu aura plus d’information mieux que l’arabe »
Question3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
- « en français »
- Pourquoi en français ?
- « la même chose, parce que la documentation en psychologie est en langue
française »
Question4 : dans votre bibliothèque les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants ?
- « c’est pas suffisant »
- Est-ce qu’ils sont riches ?
- « Quelque uns, ça dépend des modules, par exemple, le module du développement
les ouvrage en français sont mieux que l’arabe par contre les autres modules
(chwiya) »
Question5 : quand vous aurez fini vos études pensez-vous utiliser la langue arabe ou la
langue française dans votre poste de travail ?
- « les deux, ça dépend du pays où je vais travailler »
- Et si vous travaillez ici ?
142
- « (ma dagui) je vais utiliser les deux, la langue française et la langue arabe »
INF3
- Sexe masculin.
- Langue maternelle kabyle.
- 4ème
année psychologie de travail et organisation des groupes.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire ; écrire.
Question1 : au sein de l’université dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la
langue française ?
- « je n’ai pas compris »
- Par exemple dans la classe quelle langue utilisez-vous ?
- « bien sûr si tu parles à l’enseignant en kabyle c’est pas ça, il faut lui parler en
arabe »
- Si vous lui parlez en français est ce que ça pose problème ?
- « Ça ne pose pas de problèmes, normal »
- Donc vous pouvez lui parlez en français ?
- « Oui bien sûr »
- Et pour la rédaction des mémoire, des exposés ?
- « bien sûr c’est l’arabe »
Question2 : estimez-vous que les deux langues soient essentielles dans votre cursus ?
143
- « bien sûr »
- Le français comment il est essentiel ?
- « un poste de travail, l’arabe c’est impossible de l’utiliser dans un poste de travail,
actuellement si tu vas dans une entreprise, on utilise le français voilà, ceux qui font
le commerce et tous c’est en français (itsedoun) mais (taaravt outetsedouyara)
Question 3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
- « je préfère le français que l’arabe »
- pourquoi ?
- « parce que c’est la même chose c’est pour le travail »
Question4 : dans votre bibliothèque les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants ?
- « non c’est pas suffisant »
- les consultez-vous souvent ?
- « oui je les consulte souvent, mais c’est pas suffisant »
- est-ce qu’ils sont riche ?
- « oui bien sûr »
- et pour la langue arabe ?
- « l’arabe sa va »
Question5 : une fois que vous aurez fini vos études pensez-vous utiliser le français ou
l’arabe dans votre poste de travail ?
- « je préfère le français mieux que l’arabe »
144
INMK4
- Sexe masculin.
- Langue maternelle kabyle.
- 3ème
année psychologie de travail et organisation des groupes.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, écrire, parler, comprendre.
Question1 : au sein de l’université, dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la
langue française ?
- « généralement les étudiants en psychologie utilisent la langue française dans le
module de terminologie, si non pour les autres modules c’est la langue arabe,
même les enseignants exigent la langue arabe »
- et pour la rédaction ?
- « c’est en arabe »
- Pour la consultation des ouvrages ?
- « C’est la même chose, déjà, il y a un manque d’ouvrages en français au niveau de
la bibliothèque, on ne trouve pas assez d’ouvrages, le plus connu à la bibliothèque
c’est Henri Fayolle pas plus, même si dans la liste des ouvrage affichés y en a
beaucoup de titres mais réellement, ils n’existent pas »
Question 2 : estimez-vous que les deux langues soient essentielles dans votre cursus
145
- « la langue française bien sûr est essentielle, normalement elle est nécessaire »
- Dans quelle mesure ?
- « Bon prenons l’exemple de quelqu'un qui veut poursuivre ses études en France, il
peut pas choisir une langue, c’est automatique, il doit étudier uniquement en
français »
- Et pour l’arabe ?
- « C’est elle qu’on utilise le plus »
Question 3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
- en langue française
- pourquoi ?
- « le français est une langue internationale, l’arabe on peut pas dire ce n’est pas
une langue internationale mais revenons un peu à l’historique de la psychologie, le
créateur du premier laboratoire en psychologie est un français, il a fait ses études
et ses recherches en français, et nous les étudiants de l’université Mouloud
Mammeri on étudie en arabe, enfin en Algérie entière et c’est pas ça »
- Y a-t-il d’autre raison ?
- « C’est vrai on aime la langue française, moi personnellement j’aimerais bien
étudier en français qu’en arabe parce qu’en français c’est vaste, en arabe déjà il
font une traduction intégrale, on prend le terme tel qu’il est dans le français et on
le prononce en arabe, c’est juste qu’on l’écrit en arabe »
Question4 : dans votre bibliothèque les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants ?
- « la quantité est suffisante »
- et pour la qualité ?
146
- « pas vraiment, nous avons trois (3) dictionnaires de psychologie, et en plus on ne
peut pas les prendre à l’extérieur, toujours à la bibliothèque ils nous disent que se
ne sont pas des livres qu’on peut vous donner à la maison »
- Donc c’est l’accès à ses ouvrages qui est difficile et si on parle des ouvrages à
l’extérieur de l’université sont-ils riches ?
- « Bien sur, je vais parler de ma spécialité travail et organisation, j’ai cherché
quand même sur des livres de psychologues spécialistes qui ont écrit sur la
psychologie de travail et de l’organisation, y a pas vraiment un grand nombre de
spécialistes qui ont écrit sur la psychologie du travail dans la bibliothèque du
département, mais à l’extérieur il y en a»
- Et pour la langue arabe ?
- « L’arabe c’est plus au moins »
Question5 : une fois que vous aurez fini vos études pensez-vous utiliser la langue arabe ou
la langue française ?
- « sur le terrain, mon poste de travail évidemment on utilise la langue française
parce que déjà je suis en stage pratique, j’utilise la langue française beaucoup plus
que la langue arabe. Dans des entreprises, quand on dit par exemple une fiche de
poste, quand je demande à l’encadreur de me donner une fiche de poste, je ne peux
pas le dire en arabe »
147
INMA1
- Sexe masculin.
- Langue maternelle arabe.
- 3ème
année psychologie clinique.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, écrire, parler.
Question1 : au sein de l’université dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la
langue française ?
- « (nestaamel) la langue arabe »
- Dans la classe ?
- « La langue arabe »
- De quel arabe parlez-vous ?
- « (edardja taana) bien sûr »
- Avec vos amis et les gents que vous connaissez ?
- « La plupart du temps l’arabe mais des fois le français »
- Et pour la rédaction des exposés, des mémoires ?
- « En arabe »
- Pour la consultation des ouvrages ?
- « Des fois on utilise le français quand les enseignants le demandent parce que (ila
matelboulnache) on l’utilise pas et en plus (ma eendiche) le niveau (mlih) en
français c’est pour ça (manestaemelhoumche), des fois, je les utilise »
148
Qustion2 : estimez-vous que le français soit essentiel dans votre cursus ?
- « bien sûr »
- Comment ça ?
- « Normalement on l’utilise dans tous les cours »
Question3 : préférez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
- « je préfère en arabe »
- pourquoi ?
- « parce que la société (taana), mes études à moi quand je serais psychologue
(netaamel maa marrdha) et sûrement ils vont être des arabes sauf à Tizi-Ouzou
(ihedrou l’ekbayliya). Par exemple quand j’ai fait mon stage pratique (rouht elwad
aissi) la psychologue m’a ramené un malade (goultelha ila nesteamel aarbiya), je
ne savais pas que l’enfant parle le français, elle m’a dit on parle la langue du
malade (ehna etwekeft) heureusement je comprend un peu le kabyle (hada wach
goult lek) la psychologie demande la langue maternelle, mais en français c’est
mieux parce qu’il est mondial »
Question4 : dans votre bibliothèque les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants ?
- « (kaynin) sa va »
- Les consultez-vous souvent ?
- « Non, pas souvent »
- Sont-ils riches ?
- « Ils sont mieux que l’arabe, c’est plus clair »
- Dans votre spécialité seulement ou c’est valable même pour les autres ?
149
- « Même pour les autres »
Question5 : une fois que vous aurez fini vos études pensez-vous utilisez l’arabe ou le
français dans votre poste de travail ?
- « les deux »
- et pour l’arabe, vous allez utilisez l’arabe classique ou l’arabe dialectal ?
- « (ederdja taana), il faut que je parle la langue du patient »
INMK5
- Sexe masculin.
- Langue maternelle kabyle.
- 3ème
année psychologie de travail et d’organisation.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, écrire, parler, comprendre.
Question1 : au sein de l’université, dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la
langue française ?
- « normalement, en réalité, (anmar ednekini) je n’utiliserais pas du tout la langue
arabe, ça sera le français ou une autre langue, l’allemand, l’anglais, le russe, ça
dépend, l’essentiel ce n’est pas l’arabe »
- dans la classe ?
- « malheureusement c’est l’arabe, des fois des mots en français »
- et pour la rédaction ?
150
- « c’est la même chose c’est l’arabe »
- et pour la consultation des ouvrages ?
- « malheureusement c’est la même chose »
Question 2 : estimez-vous que la langue française soit essentielle dans votre cursus ?
- « ça c’est sûr »
- Dans quelle mesure
- « Parce que déjà c’est impossible de faire la psychologie en arabe »
- Donc c’est mieux en français ?
- « Bien sûr »
- Et la langue arabe ?
- « pas vraiment »
- Soyez objectifs, du moment que vous suivez vos études en arabe, il doit être
essentiel non ?
- « Mais pourquoi elle est devenue essentielle parce que (ednitni iyisghrayen) en
arabe c’est pas moi qui le veux, je suis obligé (madafaghe) le programme en
arabe, les profs enseignent en arabe, automatiquement (ihetem feli adeghraghe) en
arabe, c’est pas parce que je le veux »
Question3 :aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
- « le français bien sûr »
- pourquoi le français ?
- « parce que en arabe on ne peut pas comprendre, par exemple pour parler de la
psychologie clinique (matrouhedh) en arabe le terme clinique, pour le traduire, on
ne peut pas, ils nous disent (iilm enafs eliclininki) ça n’existe pas en arabe, ils
151
l’ont pris du français, donc y a pas de termes en arabe qui ont vraiment leur
équivalents en français »
Question4 : dans votre bibliothèque, les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants ?
- « non »
- Vous les consultez ?
- « Des fois »
- Sont-ils riches ?
- « Pas vraiment (dagui) à l’université pas vraiment »
- Et en dehors ?
- « (elan) on ne doit pas quand même (kouleche etetsekledhe af) l’université, c’est la
recherche scientifique »
- Est-il de même pour la langue arabe ?
- «en arabe malheureusement le nombre est suffisant »
- Vous les consultez ?
- « Pas vraiment, juste quand j’ai un exposé, je préfère me procurer des ouvrages en
français de l’extérieur de l’université »
Question5 : quand vous aurez fini vos études pensez-vous utiliser la langue arabe ou la
langue française dans votre poste de travail ?
- « je pense la langue française »
- Pourquoi ?
- « Puisque la psychologie normalement (outsenkhedem ara) en arabe mais
malheureusement on la fait en arabe. (besah toura zaama nekini essiighe
akhedim) en même temps je suis des cours en français pour améliorer mon niveau,
c’est vrai (eghrighe) le français au primaire, au CEM et au lycée, mais pas au
152
point d’être capable de travailler dans un poste de travail où ça demande le
français. Alors c’est pour ça que je suis entrain de faire des cours (dagui
dibara)dans une école privé (bach esya arzdath) quand j’aurais mon diplôme
(adxedmaghe) dans une société ou une entreprise où on utilise le français c’est
mieux que l’arabe »
INFA2
- Sexe féminin.
- Langue maternelle arabe.
- 4ème
année psychologie clinique.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe et français
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire ; écrire, parler, comprendre
Question1 : au sein de l’université, dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la
langue française ?
- « à l’intérieur de l’université (nekraw yaani) en arabe seulement en arabe
(manekrawche) le français »
- pour communiquer avec le prof ?
- « la langue arabe »
- pour la consultation des ouvrages ?
- « en arabe et en français (embaada endirou) la traduction en arabe »
153
Question2 : estimez-vous que la langue française soit essentielle pour poursuivre vos
études ?
- « ah oui elle est essentielle (nehtadjouha)»
- ou est ce que vous avez besoin de ça ?
- « dans le domaine de la pratique, le terrain, surtout (ehnaya) la plupart
(yekhedmou ef) les hôpitaux alors (nehtadjouha) »
Question3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
- « en français »
- Pourquoi ?
- « Parce que (nehtadjouha) parce que (rana nekraw) en arabe (tehtadji) le
français alors de préférence (nekrawha)en français parce qu’en arabe (echwiya
naksin) les ouvrages ; en français c’est la vrai psychologie parce qu’en français ou
en anglais (kamel daroulhoum) la traduction en arabe mais (bessah) l’origine en
français »
Question4 : dans votre bibliothèque les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants ?
- « la quantité n’est pas suffisante »
- Les consultez-vous souvent ?
- « Pas souvent »
- Sont-ils intéressants ?
- « Ils sont riches »
- Est ceux écrits en arabe
- « (kayen bessahmachi kima) en français »
154
Question5 : quand vous aurez fini vos études pensez-vous utilisez la langue arabe ou la
langue française ?
- « la langue française mais (nehtadj) l’arabe, le français, le kabyle, je suis en
psychologie (lazem nehdar kamel) les langues avec mes patients »
INMA2
- Sexe masculin.
- Langue maternelle arabe.
- 4ème
année psychologie de travail et organisation.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe et français.
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire, écrire, parler, comprendre.
Question1 : au sein de l’université dans quel contexte utilisez-vous la langue arabe et la
langue française ?
- « l’utilisation de la langue arabe avec les gents arabes, la langue française, en cas
où on a traité un sujet scientifique ou de la littérature »
- dans la classe ?
- « l’arabe »
- pour la rédaction des exposés, des rapports de stage ?
- « les exposés en arabe, les rapports de stage c’est différent, en cas de parler avec
l’enseignant en classe c’est en arabe logiquement, c’est la langue pédagogique,
155
mais au sein de l’hôpital ou de l’entreprise, c’est l’utilisation de la langue
française avec le médecin ou l’infirmier »
- et pour la consultation des ouvrages ?
- « j’utilise les deux langues, en français et en arabe »
Question2 : estimez-vous que les deux langues soient essentielles dans votre cursus ?
- « notre spécialité nous oblige sûrement d’utiliser la langue française avec les
patients premièrement et l’action de bouquiner. Même la psychologie c’est une
science qui a des racines française »
- Et la langue arabe ?
- « La langue arabe c’est autre chose par exemple lorsque tu traite un cas arabe, on
utilise la langue arabe avec lui, en plus de ça, ce n’est pas l’arabe académique,
c’est l’arabe brut ou quelque chose comme ça, le dialecte »
Question3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
- « c’est la même chose pour moi, l’essentiel c’est l’information, notre science ne se
base pas sur les langues, elle se base sur des règles et des techniques, la langue
normalement c’est la même chose »
Question4 : dans votre bibliothèque les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants ?
- « pas du tout, ce qui concerne la religion, la littérature, c’est en arabe en plus de
ça notre maison est arabe, donc l’utilisation de la langue française chez nous est
réduite »
- Est-ce que vous utilisez ces ouvrages écrits en français ?
- « Premièrement c’est les ouvrages de Freud, l’ouvrage de Victor Hugo c’est les
misérables, Piaget la psychologie de l’enfant, c’est ce qui concerne notre spécialité
en plus de ça quelques poèmes de Baudelaire
156
- Sont-ils riches ?
- « Bien sûr, en cas de bouquiner dans un ouvrage de Freud, réellement tu sens
Freud lui-même parler avec toi »
- Est-ce que c’est la même chose quand vous le lisez en arabe ?
- « C’est la même chose, l’information qui est dedans est plus proche de moi en
arabe mais en français j’utilise le dictionnaire »
Question5 : une fois que vous aurez fini vos études, pensez-vous utiliser la langue arabe
ou la langue française dans votre poste de travail ?
- « je pense que les deux langues ou il y a une troisième langue disponible comme
l’anglais par exemple. Au poste de travail, tu ne peux pas utiliser une seule langue,
parce que tu travaille avec beaucoup de monde et chaque individu a son langage, a
sa culture, alors ça répond, à des conditions bien précises »
INFA3
- Sexe féminin.
- Langue maternelle arabe.
- 3ème
année psychologie, spécialité orthophonie.
- Langue de la consultation des ouvrages : l’arabe et français
- Compétences linguistiques :
L’arabe : écrire, lire, parler, comprendre.
Le français : lire ; écrire, parler, comprendre.
157
Question1 : au sein de l’université dans quel contexte ou situation utilisez-vous la langue
arabe et la langue française ?
- « on utilise les deux langues »
- Avec l’enseignant ?
- « C’est l’arabe »
- Et pour la rédaction des exposés et des mémoires ?
- « Toujours la langue arabe »
- Et pour la consultation des ouvrages ?
- « L’arabe et le français »
Question2 : estimez-vous que les langues arabe et française soient essentielles dans votre
cursus ?
- « la langue française est essentielle parce que notre domaine à l’hôpital, on doit
parler en français, même si dans la vie quotidienne la langue française est la plus
essentielle »
- La plus utilisée ?
- « La plus utilisée oui »
Question 3 : aimerez-vous que l’enseignement de votre filière se fasse en français ou en
arabe ?
- « je préfère en français »
- pourquoi en français ?
- « parce que on a des ouvrages en français, on étudie l’anatomie en français et puis
on les nous demande en arabe (yaani) c’est du n’importe quoi (ki nekraw)
l’anatomie du larynx, de l’oreille, (taa lakher) en arabe c’est n’importe quoi, de
158
préférence en français parce que c’est quelque chose de scientifique, y a pas des
mot de l’anatomie en arabe, y a pas de mots exacts en arabe »
- vous les emprunter donc de la langue française ?
- « voilà »
Question4 : dans votre bibliothèque les ouvrages écrits en français sont-ils suffisants ?
- « Non ce n’est pas suffisant »
- est ce que vous les consultez souvent ?
- « oui c’est obligé c’est tous ce qu’on a »
- sont-ils riches ?
- « les ouvrages en français sont riches mais les ouvrages en arabe ils ne maîtrisent
pas, puisque (tawaa masar tawaa el ourdoun) n’utilisent pas, par exemple
(aendna) les troubles de langage, trouble de l’articulation (houma aendhoum
kamel idhtirab elougha,) ils ne font pas une différence entre ces troubles (wehna
darnahoum) parce que l’orthophonie en Algérie (tab3a) la France (homa
aendhoum etawasoul) c’est quelque chose de différent (aelina ). Quand on fait un
exposé avec les ouvrages écrits en arabe on est hors sujet »
Question5 : « une fois que vous aurez fini vos études pensez-vous utiliser la langue arabe
ou la langue française dans votre poste de travail ?
- « on utilise la langue française puisqu’on est à l’hôpital mais quand on parle avec
les enfants on parle en arabe, on parle les langues ça dépend (win enkounou) pour
la lettre médicale il faut qu’elle soit en français, avec les collègues c’est le
français, mais avec les patients, même si tu es médecin il faut parler la langue du
patient »