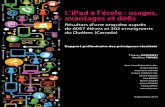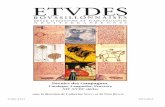Les médecines amériennes d'Amazonie : la médecine créole, ses origines
Le patient formateur auprès des étudiants en médecine : un modèle effectif
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le patient formateur auprès des étudiants en médecine : un modèle effectif
© Les Études Hospitalières
Références. – Extrait mis à jour du mémoire en droit de la santé Le Patient formateurauprès des étudiants en médecine, émis en septembre 2007 à l’université Paris-VIII.
Les évolutions de la médecine, du XXe siècle jusqu’à nos jours, ont profondémentmodifié la pratique de l’exercice médical et demandent aujourd’hui encore unemise à jour. Des changements se sont produits à divers degrés. Parmi ces mutations, l’image même du malade a été transformée : l’allongement de ladurée de vie, les différentes maladies pour lesquelles la médecine n’avait pas de réponse hier et l’augmentation du nombre de patients vivant avec de multiples pathologies. Avec cette nouvelle donne, il a fallu pour nombre de citoyens apprendre à « vivre avec ».
Par ailleurs, de nouveaux champs se sont ouverts. Des avancées diagnostiquespermettent maintenant d’exercer dans le domaine de la médecine préventive,au point que s’en est devenu un enjeu de santé publique. Une modification desrapports de force s’opère depuis le début des années 1990. Préalablement, lemédecin était celui qui « savait ». Il avait fait de longues études pour s’approprierla science médicale. Il avait acquis au cours d’une formation graduée, basée surune forme de compagnonnage ou de tutorat, les moyens nécessaires pour décoder le corps du malade selon diverses perspectives avec un large éventail detechnologies de plus en plus efficaces. Avec les avancées de la science médicale,un sentiment de toute-puissance pouvait le conduire à une relation de domi -nation via un savoir qu’il était le seul à maîtriser. Or, depuis la fin du XXe siècle etplus encore en ce début de XXIe, la relation de type « paternaliste » est devenue
115 Revue générale de droit médical
n° 34 mars 2010
Le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
Luigi fLoraCentre de recherche interuniversitaire EA 3971 EXPERICE,
chargé de cours à l’université Paris-VIII (droit et santé),
conseiller pédagogique à l’université Pierre-et-Marie-Curie
(éducation thérapeutique du patient)
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:57 Page115
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
un modèle obsolète1. Ceci est autant confirmé par les attentes d’une partie deplus en plus importante de la population, qu’amplifié par les textes de lois et recommandations de ces dernières années. L’autorité basée sur une suprématiede la connaissance scientifique du corps médical s’estompe aujourd’hui, notamment en raison de la mise à disposition d’une somme d’informations médicales toujours plus importante.
La multiplication d’une presse d’information médicale plus ou moins grand public, le foisonnement de publications associatives et surtout l’avènement d’Internet illustrent ce changement. En effet, les médecins constatent de plus enplus lors des consultations2, que les malades arrivent en ayant auparavant surfésur le Web ou s’y réfèrent après l’annonce d’un diagnostic. Si ces derniers nemaîtrisent pas la science médicale en intégralité, ils sont, ou pensent être, sur unsujet spécifique, presque aussi bien informés que leur médecin.
Les nouvelles attitudes d’une majorité de la population ont également gagné eninfluence. Les exigences de type consumériste ont, entre autres, eu pour conséquences d’amener la profession médicale à adopter une attitude différentedans les relations avec leurs patients tant à titre individuel que collectif. Cet ensemble de facteurs a particulièrement affecté un champ essentiel de la pratiquemédicale : la relation « médecin-patient ». Cette relation a de tout temps été etreste encore au cœur de l’histoire de la médecine. D’Hippocrate à la médecinescientifique du XXIe siècle, les rapports du médecin avec son « patient » ont évoluésuivant les progrès de la science et l’évolution des consciences individuelles etcollectives3.
La médecine d’aujourd’hui comprend : les interrogations individuelles du « patient » sur son corps et son mal-être psychique ; auxquelles s’ajoutent également les exigences collectives de protection de la santé et les enjeux économiques et politiques qui en résultent. Le médecin répond donc à une demande duale, elle correspond autant à une nécessité qu’à un désir de soin du« patient ». Cela atteste de l’évolution de la société dans laquelle le citoyen devient toujours plus « acteur » dans le domaine de la santé. Ainsi, la relation« médecin-patient » est devenue un cadre d’échange et donc d’éducation à lasanté de nature à promouvoir des idées de progrès.
Le patient est de plus en plus considéré comme un partenaire et un acteur dusoin. La pratique s’éloigne ainsi inexorablement du modèle paternaliste. Ce sontles raisons pour lesquelles la question de la relation est, aujourd’hui plus qu’hier,au cœur du rapport entre soignant et soigné.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
116
n° 34 mars 2010
Revue générale de droit médical
1. Ce qui est maintenant inscrit dans la loi du 4 mars 2002, dite loi Koushner ; O. FAURE, Histoire socialede la médecine, 1994.2. Le rédacteur en chef de Lancet constate qu’un tiers des lecteurs de son journal n’appartient pas audomaine médical et souligne que les patients construisent l’histoire de leur maladie ; voir Richard HOR-TON, « The Unmasked Carnival of Sciences », The Lancet, 351 (1998), p. 688-692.3. D. GRMEK, Histoire de la pensée médicale en Occident, t. III, Du romantisme à la science moderne, 1999 ;t. II, De la Renaissance aux Lumières, 1997 ; t. I, Antiquité et Moyen âge, 1995.
© Les Études H
ospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:57 Page116
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
Cette relation est construite autour de la confiance, celle-ci rend le plus souventindispensable des explications nécessaires et adaptées à chaque situation clinique. En effet, cette relation médecin-malade, principalement dans le cadredu colloque singulier, est basée sur la confiance et le respect. Elle est, aujourd’hui,partie intégrante de la démarche thérapeutique. Il s’agit, de nos jours, d’une relation qui se noue entre deux personnes autonomes, deux parties d’un ensemble déterminant pour la réussite du traitement.
L’information et le consentement éclairé du patient, c’est-à-dire la possibilitédonnée au patient à se déterminer en toute conscience avec des informationscomprises puisque adaptées, sont donc essentiels. Chaque individu, même malade, demande à être considéré avec respect et dispose du droit de participeraux décisions importantes qui conditionneront son avenir. Le consentementéclairé d’un patient ne peut être obtenu que dans le cadre d’une informationclaire et adaptée à la situation de chaque malade.
Le médecin remplit là une mission de conseil, qui lui interdit maintenant deprendre une décision en lieu et place du « patient ». Le consentement éclairé correspond à l’approbation d’une démarche thérapeutique en toute connaissance de cause. Pour cela, une attention particulière doit être apportéesur la manière dont les médecins sont préparés durant leur formation à ces fonctions de conseil.
Face à ces mutations, aux diverses interrogations qu’elles suscitent, cet articletraite d’ajustements nécessaires à l’exercice d’une médecine de qualité en adéquation avec son temps. Une médecine capable de répondre aux aspirations,tant à titre individuel, collectif que sociétal. Une pratique médicale qui puisseprendre la mesure du vécu du malade, et plus largement de la personne, ce quipermettrait d’en optimiser les bénéfices là où cela peut l’être, et ce aux différentsniveaux où la nécessité s’en fait sentir, où le droit l’impose. Les contours et enjeuxse dessinent en fonction des attentes actuelles dont quelques-unes sont corroborées par certaines limites reconnues de la médecine, particulièrement auniveau relationnel. Cette légitimité tient à divers textes de lois. Un certain nombrede ceux-ci encadre justement la relation médecin-malade.
Nous présenterons une introduction aux articles et codes qui motivent cette étude,il sera également énoncé les principes juridiques, une présentation des enjeux.
Quelques constats sur l’évaluation de la formation médicale illustreront la pertinence de la proposition d’ajustement des études médicales avec les objectifspédagogiques et les moyens de les atteindre, puis le cas de la compliance4 seraévoqué comme un indicateur de qualité, avant une présentation de l’existanten France, avec une mise en perspective non exhaustive internationale de pratiques qui restent pilote en France et donc le questionnement d’une institutionnalisation.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
117 Revue générale de droit médical
n° 34 mars 2010
4. Compliance : capacité du patient à se plier aux prescriptions médicales.
© Les Études Hospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:57 Page117
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
Quelle légitimité juridique? Bien que la formation médicale française soit degrande qualité, des ajustements paraissent comme de tout temps nécessairesdu fait de la rapidité des mutations de la société.
En ce XXIe siècle, la mondialisation demande et propose elle aussi de regarder cequi se fait hors de nos frontières. Le droit international « modifie » effectivementle droit français et l’enseignement de la médecine a tout à gagner à ne pas resteren vase clos. La recherche scientifique médicale en est une parfaite illustration. Onpeut constater que celle-ci ne peut plus évoluer hors de la scène interna tionale.Face à ces évolutions, l’enseignement de la médecine apparaît actuellement in-complet. La communauté médicale française l’a d’ailleurs constaté ces dernièresannées. Des carences ont été identifiées dans la formation initiale. La plus mar-quante est liée à l’apprentissage d’une écoute concernant le vécu du malade,principalement dans les maladies chroniques et les maladies à caractère morbide.Intégrer une autre approche sur l’expérience du malade dans le cursus paraît au-jourd’hui nécessaire, à l’image de ce qui se fait dans de nombreux autres pays. Lesprincipes actuels de droit de la santé, dans lesquels une médecine de qualité estexplicitement mentionnée, nécessitent d’en tenir compte. Un des moyens d’at-teindre cet objectif serait donc de se doter de médecins bien formés sur ces as-pects. Le citoyen du XXIe siècle a droit à la santé, à l’accès aux soins et à unemédecine de qualité. Ces droits ont été strictement encadrés avec la loi du 4 mars2002 (relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) et pluspleinement ré encadrées par la loi de santé publique du 9 août 2004. Le manquede l’intégration du vécu du malade est explicite dans les évaluations existantes au-tour de la « compliance » aux prescriptions et aux traitements5.
De très nombreux concepts d’éducation pour la santé mettent en avant l’importance de la communication.
Or pour communiquer il est nécessaire de comprendre l’univers de l’autre. L’introduction de modules de « patient formateur » permettrait d’appréhenderla sphère du malade plus largement. Ce type d’intervention au sein des cursusde médecine pourrait être un réel apport pour impulser cette dynamique. Desfacteurs comme l’observance6 et la capacité à communiquer avec l’autre, sonten mesure d’améliorer cette qualité grâce à l’expertise profane du malade.
Donner les moyens aux praticiens de respecter au plus près les responsabilités juridiques est précisé par l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, articleissu de la loi du 4 mars 2002 :
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informationset des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé [...]. Aucunacte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libreet éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
118
n° 34 mars 2010
Revue générale de droit médical
5. RDSS, septembre-octobre 2007, n° 5, « Les droits des malades, cinq ans après ».6. Observance : capacité du patient à observer au plus près la prescription médicale.
© Les Études H
ospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:57 Page118
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
Par l’article 16-3, alinéa 2, du Code civil qui prévoit :
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son étatde santé rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas àmême de consentir.
▪ Des principes juridiques clairement définis
• L’article 35, alinéa 1er, du décret du 6 septembre 1995 (Code de déontologiemédicale) :
Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une in-formation loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’illui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patientdans ses explications et veille sur leur compréhension.
• Les textes internationaux prévoient, pour leur part, avec la Convention euro-péenne des droits de l’homme et de la médecine (1997), au chapitre II, ar-ticle 5 – Règle générale :
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que lapersonne concernée y a donné son consentement libre et éclairé […].
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à lanature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques […]. La per-sonne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a elle-même souligné quatre pointsimportants d’éducation thérapeutique des « patients » et de leur information7 :
1. Former le malade pour qu’il puisse acquérir un savoir-faire adéquat afin d’ar-river à un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de la maladie ;
2. L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu qui fait partieintégrante des soins médicaux ;
3. L’éducation thérapeutique du malade comprend la sensibilisation, l’informa-tion, l’apprentissage, le support psychosocial, tous liés à la maladie et au trai-tement ;
4. La formation doit aussi permettre au malade et à sa famille de mieux colla-borer avec les soignants.
Même si cette obligation de consentement existait déjà, elle est de plus en plusencadrée par la loi quant à la forme qu’elle doit prendre, aux contours qu’elledoit suivre, aussi bien sur le plan international que national.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
119 Revue générale de droit médical
n° 34 mars 2010
7. OMS, Therapeutic patient education. Continuing education programs for health care providers in the fieldof prevention of chronic diseases, octobre 1998.
© Les Études Hospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page119
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
Son origine est issue de l’élaboration du premier Code de déontologie international appelé Code de Nuremberg. Un document réalisé suite au jugement du procès de Nuremberg (1947) sur l’expérimentation humaine perpétrée durant la Seconde Guerre mondiale lors des expériences médicalesnazies menées sur l’homme.
L’appel au consentement est également plus important aujourd’hui du fait dupassage du mode de relation paternaliste au mode de relation négociée dans larelation médecin-malade. La mise en lumière de l’existence de droits subjectifsdes patients implique, pour le corps médical, la responsabilité de donner lesmoyens optimaux au médecin de faire face aux sollicitations et obligations réglementaires dans la société du XXIe siècle.
Le fait d’insister sur les moyens donnés pour l’obtention du consentement libreet éclairé du patient par la délivrance d’une information simple, intelligible et loyaledans le cadre de la relation médecin-patient, est, en effet, une obligation légale.
Ces devoirs sont aujourd’hui clairement détaillés dans la loi précitée (loi du4 mars 2002), laquelle encadre les obligations des médecins en termes de droità l’information et orientent ainsi vers une meilleure qualité des soins, telle qu’elleest inscrite dans le Code de déontologie et dans le Code de la santé publique (loidu 9 août 2004). Il est à noter d’ailleurs qu’en ce qui concerne l’acte médical, ils’agit le plus souvent d’une obligation de moyen et non de résultat, du moinsen ce qui concerne l’exercice médical à visée thérapeutique. On pourraitd’ailleurs regretter que les responsables, surtout en termes économique et politique, ne semblent pas pour leur part être soumis à l’obligation de prouverqu’ils ont bien mis tous les moyens en œuvre, sauf en cas de catastrophe sanitaire(sang contaminé…) dans le domaine de la santé.
Juridiquement, les droits des « patients » correspondent à des obligations pourle médecin. Pour que ceux-ci soient appliqués, des moyens doivent lui être donnés. En effet, si l’on définit les droits subjectifs de la manière suivante : Lesdroits subjectifs reconnus aux patients sont des prérogatives positives, cela a poureffet de créer des obligations à la charge du corps médical. Une partie de cecorps médical organise la formation. Elle doit donc planifier des actions permettant aux autres éléments de ce corps d’accéder à la capacité d’assumerau mieux ces obligations.
La loi du 4 mars 2002 encadre les obligations des médecins en termes de droità l’information, mais elle ne parle pas de rapport contractuel explicitement.
La loi du 9 août 2004 prévoit, elle, dans le cadre des maladies à affections delongue durée, un contrat signé par le médecin et le patient, or une des règlesqui régissent le contrat est la liberté de s’engager. Celle-ci inclut la liberté deconclure et celle de définir l’étendue du rapport contractuel. Cette loi a en faitvocation à s’appliquer à tous les rapports médecin-patient. Pour ce, la garantie del’autonomie du patient maintient cette qualification de rapport contractuel.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
120
n° 34 mars 2010
Revue générale de droit médical
© Les Études H
ospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page120
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
En dehors des références contractuelles sur le paiement d’honoraires des médecins, un élément important réside en la notion de capacité juridiquepuisque nous sommes dans le cadre d’une relation contractuelle avec capacité,consentement et cause.
Elle est encadrée par l’article 1108 du Code civil :
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
– Le consentement de la partie qui s’oblige ;
– Sa capacité de contracter ;
– Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
– Une cause licite dans l’obligation8.
Le consentement est donc un déclencheur : c’est en premier lieu un principegénéral du droit.
Ce n’est pas une particularité du droit médical, mais un principe qui fait partieintégrante du domaine des libertés de l’individu.
Le caractère libre et éclairé du consentement est un élément essentiel à la formation d’un contrat. Dans le cadre médical, le consentement est essentiel àl’établissement de la relation, à l’instauration d’un climat de confiance, à la pratique de l’acte de soin ou de traitement et au processus qu’il peut induire, etce avec renouvellement de celui-ci tout au long du processus.
Ceci est rappelé dans l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, article issude la loi du 4 mars 2002 :
Toute personne prend avec le professionnel de santé, et compte tenu des informationset des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
L’alinéa suivant stipule également :
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentementlibre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
C’est un fondement basé sur le respect de la dignité humaine. Il reste à prendreen compte que la mutation de la notion de consentement n’est certainement pasachevée. Au cours d’un processus médical très complexe, le parcours échappeà la logique purement juridique et médicale. On peut anticiper que les transfor-mations se poursuivront dans les années à venir dans le cadre du droit médical.
Cette discipline est aujourd’hui à l’avant-garde du droit car elle précède la complexification de la société.
Le droit de refuser les soins est une liberté réelle énoncée par l’article L. 1111-4,et réaménagé par la loi du 21 avril 2005.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
121 Revue générale de droit médical
n° 34 mars 2010
8. Legifrance :http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CSANPU&code=&art=L1108&exp=.
© Les Études Hospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page121
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
Le consentement peut être donné par oral bien que les médecins préfèrent un consen-tement par écrit, et il faut que ce consentement soit exempt de vice (sous pression,sous le fait d’une information tronquée).
C’est, en premier lieu, une obligation d’origine professionnelle issue du Codede déontologie médicale du 6 septembre 1995 : article 35 :
Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soinsqu’il lui propose.
Cette obligation est rappelée à l’article 41 :
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans aucun motif médical sérieux et sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans sonconsentement.
En deuxième lieu, c’est une obligation d’origine légale : article L. 1111-1, articlesL. 1111-2 jusqu’à 9 du Code de la santé publique, issus de la loi du 4 mars 2002.
Enfin, la jurisprudence9 a contribué à préciser le contenu et l’étendue de l’obligation d’information en matière médicale. Elle a enrichi le contenu contractuel en greffant sur certains contrats des obligations accessoires quin’avaient été expressément prévues ni par les contractants ni par le législateur.
L’exemple le plus fameux de cette façon de faire parler le contrat est fourni parl’obligation de sécurité découverte dans un nombre de plus en plus croissant decontrats.
Il en est de même de l’obligation d’information, de mise en garde et de conseilactuellement admise à la charge de professionnels qui s’engagent à fournir unservice ou à livrer un produit. Le fondement de l’œuvre de la jurisprudence résidedans l’article 1135 du Code civil. Ainsi, l’équité implique l’insertion dans certainscontrats des obligations de sécurité et d’information. Cet enrichissement par lajurisprudence du contenu contractuel sur le fondement de l’article 1135 du Codecivil a notamment profité au contrat médical. Le médecin est tenu à l’égard deson patient d’une obligation d’information accessoire à sa prestation principaleet dont l’inexécution engage sa responsabilité contractuelle.
En fait, l’obligation d’information a elle aussi toujours existé, d’abord par le droit jurisprudentiel, puis, ensuite, par l’inscription dans les normes déontologiquesque l’on trouve aujourd’hui inscrites selon l’article 35 :
Le médecin doit à la personne qu’il examine, soigne ou conseille une informationloyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.
Selon l’article 41 :
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
122
n° 34 mars 2010
Revue générale de droit médical
© Les Études H
ospitalières
9. Cass. civ. 1re, 5 mai 1981, GP, 1981, 2, somm. 352 ; Cass. civ. 1re, 27 mai 1998 ; Cass. civ. 1re, 21février 1961.
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page122
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans aucun motif médical sérieux et sauf urgence ou impossibilité sans information de l’intéressé et sans sonconsentement.
On peut donc constater que le consentement est une notion juridiquement inscrite jusque dans des situations spécifiques. La grande loi du 4 mars 2002 regroupe maintenant tous les textes.
On les retrouve, dans le Code de santé publique, sous le titre « Information desusagers du système de santé et expression de leur volonté » dans les articlesL. 1111-1 à L. 1111-910. Ils délimitent le cadre, signifient les contours et prévoient les situations dérogatoires. L’information, préalable au consentementéclairé, a un contenu de plus en plus large au fur et à mesure de l’évolution dela jurisprudence.
Elle concerne maintenant l’état de santé, les évolutions prévisibles, les investigations à mener, les traitements ou les actions de prévention, leurs utilités,leurs urgences, les alternatives thérapeutiques, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs risques et les critères financiers, les coûts et conditions deprises en charge. L’information donnée doit être simple, intelligible et loyale. Laloi de 2002 impose également que le patient soit informé s’il existe des risques,préalablement ou a posteriori déclarés. Toutefois, si le médecin ne se plie pas àces règles, il ne peut être sanctionné que s’il a commis une faute d’une part, sile patient a subi un préjudice et qu’un rapport de causalité entre la faute et lepréjudice est prouvé, d’autre part. Jusqu’à un arrêt de la Cour de cassation du25 février 1997, la charge de la preuve incombait à celui qui l’invoquait, mais cetarrêt a inversé cette charge en décidant que :
Vu l’article 1315 du Code civil : « Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter lapreuve de l’exécution de cette obligation […] Le médecin étant tenu d’une obligationd’information, il lui incombe de prouver qu’il a délivré cette information11. »
Ainsi, dès lors que la victime subit un préjudice, directement lié à un défaut d’information, la faute à l’origine de ce préjudice est présumée. Cette jurisprudence a été considérée comme un élargissement du droit d’information.Ensuite, la loi du 4 mars 2002 l’a intégrée. Elle apparaît aujourd’hui dans le Codecivil à l’article L. 1111-2 qui stipule :
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette informationporte sur les différents traitements, investigations ou actions de prévention qui sontproposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquentsou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutionspossibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Des recommandationsde bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la Santé.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
123 Revue générale de droit médical
n° 34 mars 2010
10. Legifrance, préc. supra note 8.11. Cass. civ. 1re, 25 février 1997, arrêt n° 426, pourvoi n° 94-19.685.
© Les Études Hospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page123
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
En cas de litige, il appartient aujourd’hui au professionnel ou à l’établissementde santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dansles conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée partout moyen.
Les trois critères de distinction de droits (publics comme privés), le but, le caractère et la sanction apparaissent donc :
1. Le but, en droit public, a pour mission de donner satisfaction aux intérêts collectifs de la nation en organisant la gestion des services publics, dont ledomaine de la santé fait partie. Il prend sa source, en droit interne, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 par l’alinéa 10 : La nationassure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.Le droit à la santé, ou plus exactement le droit à la protection de la santé, estdonc un droit fondamental. En droit privé, celui-ci doit assurer la satisfactionde l’intérêt individuel. La loi du 4 mars 2002 l’explicite ;
2. Le caractère, en droit public, est, lui, pour l’essentiel, impératif. C’est-à-direque le médecin ne pourra déroger à la loi qui lui impose d’obtenir le consentement libre et éclairé du « patient » par la délivrance d’une information simple, intelligible et loyale. Tandis qu’en droit privé est laisséeune large part à la volonté individuelle, la responsabilité est encadrée par lecontrat liant les deux parties à partir de la même délivrance de l’informa-tion ;
3. La sanction, qui a été citée, assure, selon sa nature, la légitimité de la règlede droit.
Le médecin est tenu à certaines obligations spécifiques envers les « patients ».Celles-ci relèvent du Code de déontologie du 6 septembre 1995, aujourd’huiinséré dans la partie réglementaire du Code de la santé publique. En premier,le non-respect de ces règles relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre. En second, il donne lieu à un contrat médical relevant, lui, du droit commun.
L’effet obligatoire du contrat médical découle de l’article 1134 du Code civilselon lequel :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
Le contrat, dont le médecin est partie dans le cadre de la relation médecin- patient, soulève toutefois certaines particularités. En effet, depuis l’arrêt Mercier,le contrat du médecin s’est éloigné du contrat type de droit civil dans le cadrede la relation médecin-patient, puisqu’il tend vers une obligation de moyen etnon de résultat.
Arrêt Mercier, Cour de cassation civile du 20 mai 1936 :
[...] Attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement sinon bien évidemment de guérir le malade [...] du moins de lui donner des soins, non pas quelconques [...] mais
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
124
n° 34 mars 2010
Revue générale de droit médical
© Les Études H
ospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page124
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformesaux données acquises de la science [...]12.
Au XXIe siècle, dans le cadre de la loi du 4 mars 2002, le législateur a cherché àrééquilibrer les obligations des parties, mais il n’en reste pas moins que l’essentielde ces obligations pèse sur le médecin. Dès lors, les références issues de la loi deviennent précisément un élément de la norme contractuelle, même si on peutse poser la question de la prépondérance de la décision médicale prise au finalpar le « patient », au vu des informations délivrées par le professionnel de santé.
Le contrat ressemble d’ailleurs à un contrat réglementaire. Enfin, le médecin s’insère par son activité professionnelle dans une mission de service public, carmême si le médecin travaille dans le privé, il doit se plier au Code de la santé publique.
Un cadre qui pose bien les contours du questionnement : pour une bonne compréhension, il faut savoir entrer dans la sphère de l’autre ; une règle essentielle de communication lorsqu’on veut s’assurer de la compréhension dela personne que l’on informe. Une condition qui reste cependant nécessaire à unconsen tement libre, loyal et éclairé, d’où la piste qui peut optimiser cette condition, celle du patient formateur.
Évaluation de la formation médicale : la formation médicale initiale commefacteur de qualité, elle est réglementée et a des objectifs pédagogiques clairement définis, l’Académie de médecine a réalisé des autoévaluations de laformation médicale, celles-ci étaient d’autant plus nécessaires que les lois intracommunautaires européennes demandent l’harmonisation des diplômespar la loi LMD (licence, master, doctorat).
De plus, la profession est consciente de l’importance de l’évolution de la formation médicale initiale comme de la loi du 4 mars 2002 qui incite les praticiens à assumer de nouvelles obligations de formation continue et de perfectionnement en fonction de l’évolution des connaissances médicales. L’Académie nationale de médecine a, par exemple, émis des recommandationsdans le rapport 05.1513 au nom de la Commission XIV (enseignement et problèmes hospitalo-universitaires) en 2005.
Ces recommandations étaient formulées sous le titre Recommandations de l’Académie nationale de médecine pour la formation clinique initiale des étudiantsen médecine. En synthèse, le rapport souligne que : La formation clinique initialedes étudiants en médecine devrait être améliorée par le développement de coursthéoriques et de stages hospitaliers permettant une véritable intégration de l’étudiant
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
125 Revue générale de droit médical
n° 34 mars 2010
12. Ibid.13. Sources : [site éditeur : Académie nationale de médecine] : http://doccismef.churouen.fr/serv-lets/Simple? Mot=relations+m%E9decinmalade.mc&afftri=20&datt==4&1&debut=0. Bibliographie :enquête auprès des médecins hospitalo-universitaires sur l’enseignement clinique (Académie nationalede médecine, février-mars 2005).
© Les Études Hospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page125
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
dans l’équipe hospitalière. Former le plus tôt possible le comportement de l’étudiant dans la relation avec le malade est souhaitable. Ceci impose une forteimplication des personnels hospitaliers, qui devrait être prise en compte dans la carrière de ceux-ci.
Elle souligne que l’apprentissage de la relation médecin-malade est déterminantpour la qualité future du jeune médecin :
L’étudiant doit développer ses aptitudes psychoaffectives, apprendre à ajuster sa présentation et son comportement aux exigences du malade et aux circonstances. Ildoit apprendre à susciter le dialogue avec le malade. Il doit se faire accepter par lemalade et le contact est un des éléments importants de ce « colloque singulier ».
La réflexion est proposée par les penseurs mêmes de cet enseignement, on a puconstater que l’enseignement, dans son ensemble, est, de longue date, organiséautour de la pratique. Pourtant, en interrogeant différents praticiens enseignants,les dispositions prises ne semblent pas combler le fossé créé par les attentes actuelles des patients, des consommateurs, des citoyens et de la société, quisemblent demander toujours plus.
Or nous le verrons dans ce qui suit, nombre de ces seniors ont opté pour la formation par le biais de « patients formateurs », sans que cela ne soit réellementconsidéré comme une méthode de tentative de comblement dudit fossé. À cejour, ces pratiques se poursuivent sur le terrain, mais de manière expérimentaleet non pérenne.
Le cas de la « compliance » : ce terme, autrement nommé « observance » ou« adhésion », défini comme la capacité à se plier ou à suivre la prescription médicale, a largement été utilisé par les différents auteurs, professionnels desanté ou patients questionnés dans le cadre de ce travail. Quelques lignes sur cetaspect du processus de soins permettent de mieux situer les enjeux qui en découlent.
D’après les statistiques de l’INPES, dans le cadre des maladies chroniques, la « compli ance », c’est-à-dire les capacités du patient à adhérer au traitement quilui est prescrit, ne dépassait pas, en 2000, dans le meilleur des cas, les 50 %14.Cela signifie clairement que la médecine d’aujourd’hui sait correctement soignerun patient sur deux dans les pathologies ayant dépassé la phase aiguë. C’est doncmaintenant un facteur majeur de santé publique. On peut considérer la maladiechronique comme une crise identitaire qui devrait être accompagnée par la relation médecin-patient. Le médecin devrait se donner des objectifs éducatifs. Eneffet, si le patient est en confiance, s’il est suivi, informé, voire éduqué, il sera àmême de réduire les conséquences des problèmes qu’il rencontre.
En 2004, quelques exemples de non-compliance sont détaillés dans une publication15 :
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
126
n° 34 mars 2010
Revue générale de droit médical
14. L’Éducation pour la santé des patients, Éd. INPES, juillet 2001, p. 44.15. J.-F. D’IVERNOIS, Médecine & Hygiène, 2004.
© Les Études H
ospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page126
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
Environ 25 % des boîtes de médicaments sont à peine entamées, 20 % des personnescardiaques ne prennent pas leurs hypolipémiants, parmi les diabétiques, 36 % prennentdes doses insuffisantes de leurs médicaments et 9 % ne prennent jamais rien ; chez lesadolescents porteurs du virus VIH, 79 % ont arrêté au moins une fois leur traitement.
À ce jour, de nombreuses communications ont tenté de proposer des pistes d’intervention pour améliorer la compliance des patients.
Les pistes sont nombreuses à cet effet et les interventions délivrées par les soignants, donc dans le cadre de la relation médecin patient, tiennent une placeimportante parmi elles.
La responsabilité de ces professionnels de santé est donc grande16,17,18,19,20,21. Lesétudes référencées ci-dessus et autres publications confirmant l’importance de cetaspect de la prise en charge se multiplient. Le médecin en tant que professionnelde santé doit intégrer cette approche. Il en va de sa responsabilité dans le cadrede l’obligation de moyen. Les doyens des facultés de médecine et autres respon-sables de la formation devraient être aujourd’hui conscients de l’importance dedonner les moyens aux étudiants en médecine d’exercer au plus vite selon cesprincipes dans le cadre de l’esprit des lois déjà exposées.
Cet indicateur est un facteur qui influe largement sur les politiques d’éducationthérapeutique, qui sont des recommandations internationales, comme nousl’avons déjà cité (p. 119) et qui est explicitement repris dans la toute récente loin° 2009-879, de juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,à la santé et aux territoires :
L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soin du patient. Elle a pour ob-jectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitementsprescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et nepeut conditionner le taux de remboursement de ses actes et médicaments afférents àsa maladie.
Une loi qui entre depuis le début de l’année 2010 dans son organisation modulable au travers de la mise en place des agences régionales de santé (ARS).
Le « patient formateur » : la place de l’expérience du malade dans la formationde médecine a donné lieu à une étude de terrain. Sera successivement présentéel’expérience de « patient formateur » existante en France au travers d’un panel
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
127 Revue générale de droit médical
n° 34 mars 2010
16. C. JAMES et al., Intensive Adherence Program. Optimizing adherence to HAART, WePeB5810, 2006.17. Un autre terme définissant la compliance, tout comme le terme adhésion au traitement.18. L. WEISS, Adherence support : The importance of linkages to clinical care, MoPeB3284, 2006.19. M. FIGUEIRO et al., Adherence.20. L. BENTZ et al., Efficacy of a counseling intervention on adherence to HAART : results of a French prospec-tive controlled study, WePeB5867.21. B. GRANGER, K. SWEDBERG, I. EKMAN, « for the CHARM investigators. Adherence to candesartan andplacebo and outcomes in chronic heart failure in the CHARM programme : double-blind, randomised,controlled clinical trial », Lancet, 2005, 366, p. 2005-201. Plusieurs références de cette section sont is-sues du site Internet http://www.grouperechercheactionsante.com/adherence_3_2006.htm.
© Les Études Hospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page127
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
non exhaustif d’expériences pilotes initiées dans les CHU; mise en perspective parl’expérience internationale par l’illustration d’un dispositif initié au États-Unis et reproduit dans divers pays dont la France ; de la rencontre avec quelques ressortissants étrangers, acteurs et usagers de santé. En second lieu, des dispositifs innovants seront cités. Une conclusion sera ensuite l’occasion de présenter une réflexion sur les bénéfices d’une généralisation de la pratique du patient formateur.
Les expériences « patient formateur » en France : les rapports entre malades etmédecins, entre tissu associatif et réseaux médicaux ont énormément évolué cesdernières décennies.
De relations difficiles au départ, instaurées avec méfiance de part et d’autres, avecdes médecins craignant des revendications irréalistes, des associations et des mem-bres associatifs devant trouver leur place, au fil de l’expérience la situation a évo-lué pour aboutir à des relations de respect et de confiance mutuels. Deuxillustrations en témoignent. La collaboration entre associations et médecins,comme celle de l’ANRS22 dans le VIH, puis les hépatites virales qui, grâce à la volonté des professeurs Jean-François Delfraissy aujourd’hui et de son prédécesseurle professeur Michel Kazatchkine hier, a su intégrer patients ou représentants de pa-tients dans toutes les strates de cette agence de recherche médicale clinique pu-blique unique en Europe. La coopération engagée avec l’Association française dusyndrome de Marfan décrite par le docteur Françoise Weber dans un article de laLettre de la fondation Groupama, du 17 février 200623, sur un dialogue constructifet un réel partenariat instauré.
Les patients ont donc peu à peu pu exprimer leur expertise, leur savoir être, leurexpérience, leur ressenti, leur savoir profane. Ils en prouvent l’utilité. Ils permettentune perception de l’autre face du miroir.
Ces aspects permettraient au médecin en exercice d’appréhender cette dimensionet d’optimiser ainsi la si précieuse relation médecin-malade pour une médecinede qualité.
La Direction générale de la santé souhaite promouvoir, à l’instar d’initiatives prises pourcertaines maladies chroniques, comme la polyarthrite chronique de l’adulte, la notionde « patient formateur ». Ces patients formateurs sont des malades spécialement for-més pour transmettre une formation aux étudiants en médecine. Ces initiatives sont trèsappréciées par les étudiants qui ont ainsi une autre vision que celle du seul profession-nel de santé. Les associations de patients ont un rôle important à jouer à ce niveau, ex-plique Lydia Valdès, de la Direction générale de la santé, lors de son interventionau dernier Forum des associations de maladies rares24.
Cette promotion est engagée et relayée dans les faits : lors des dernières Journéesnationales de l’INPES25, les 29 et 30 mars 2007, un atelier était alors organisé
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
128
n° 34 mars 2010
Revue générale de droit médical
22. ANRS : Agence nationale de recherche du sida et des hépatites virales.23. Article paru dans la Lettre de la fondation Groupama, du 7 février 2006.24. Ibid.25 INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
© Les Études H
ospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page128
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
autour de cette réflexion. Lors de cet atelier le professeur Euler Ziegler présentaitl’expérience des « patients partenaires » de l’association AFLAR autour d’une formede polyarthrite rhumatoïde ayant pour objectif de participer à la formation de spécialistes de cette maladie ; Catherine Tourette-Turgis26, docteur en psycho logie,qui a introduit « le counselling27 » en France, coprésentaient avec une « patienteformatrice » stomisée28, les modules de formation permettant de mettre en placedes sessions pour d’autres malades et des étudiants en médecine. Un panel d’associations était ainsi invité afin de présenter des expériences susceptibles deprovoquer une réflexion collective.
Cette somme de déclarations et de manifestations légitime la recherche qui suit.Voici donc ce qu’a révélé l’enquête réalisée sur le patient formateur ou patient partenaire auprès des étudiants en médecine, en France, en 2007.
Une enquête de terrain a permis d’identifier des expériences de terrain qui restent,à ce jour, non généralisées, malgré l’ancienneté de certaines d’entre elles et l’appréciation positive des professeurs de médecine sollicitant ces interventionsdepuis maintenant plus d’une décennie (1995), autour de différentes pathologies.
Le point commun de ces expériences pilotes est la participation des premiersbénéficiaires de la science médicale, les patients eux-mêmes. Les pathologiesconcernées sont des pathologies chroniques, dont une maladie orpheline.
Deux autres portent une image collective de danger de mort même si le VIH estde plus en plus considéré comme une maladie chronique, ce qui n’est pas encorele cas du cancer dans sa diversité.
Les pathologies sur lesquelles nous avons directement enquêté sont :
– Les maladies orphelines et plus particulièrement la dysplasie ectodermique29 ;
– Le VIH ;
– La stomie dans et hors champs cancer ;
– Les addictions ;
– La polyarthrite rhumatoïde ;
– Les hépatites virales.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
129 Revue générale de droit médical
n° 34 mars 2010
26. Catherine Tourette-Turgis est maître de conférences des universités en psychologie sociale de lasanté et en sciences de l’éducation à l’université de Rouen et également en Californie (USA).27. Counsellingmiser les stratégies de traitement par la participation du patient à celle-ci.28. Les stomisés sont des patients ayant subi une intervention, une stomie digestive. Celle-ci consisteen l’abouchement de l’intestin à la peau de la paroi abdominale de manière provisoire ou définitive. Lesmatières et gaz s’évacuent par la stomie et le contrôle des émissions n’est plus possible, ce qui nécessitele port d’une poche de recueil.29. Maladie génétique généralement héréditaire à l’origine d’un mauvais fonctionnement de l’organismeou d’une structure anatomique absente provenant normalement de l’ectoderme. La dysplasie est uneanomalie de développement d’un organe s’accompagnant de problèmes de fonctionnement et d’altération de ceux-ci.
© Les Études Hospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page129
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
Toutes ces pathologies donnent lieu à des prises en charge conséquentes et ontpour conséquence une altération de la qualité de vie significative.
Les interventions ont lieu sur des sites universitaires différents. En 2007, 19 CHUet l’institut Gustave-Roussy ont expérimenté ce concept sur le terrain avec majoritairement des actions dans les polyarthrites rhumatoïdes, et ce type d’intervention s’est étendu en 2008. Il s’inscrira, par exemple, en 2009, au seind’un réseau d’oncologie (Oncologie 93) dans le cadre des formations initiales etcontinues, et dans le cadre d’une recherche-action mise en œuvre dans le secteurde santé mentale de Paris-Nord (Maison-Blanche) ou une formation de « patient formateur » est mise en place en partenariat avec la FNAPSY30.
Qui sont les patients formateurs ? Toutes les interventions de « patients formateurs » observées sont réalisées par des usagers faisant partie d’associations.Elles ont en majorité à ce jour leurs propres critères de sélections et de formation.
Des modes d’interventions qui diffèrent : les interventions varient selon lescaractéristiques associatives, les attentes de professeurs les programmant et lesparticularités des pathologies concernées.
Cependant, des points communs se dégagent : l’expression de l’expérience personnelle et de l’expérience collective des usagers au travers des expériencescollectées sur le terrain ; les informations spécifiques aux services disponibles ausein des leurs ou des associations, et l’ouverture à l’échange. Un autre aspect aretenu notre attention comme d’ailleurs celle des enseignants, c’est l’intérêt desétudiants pour cette forme d’enseignement très différent de l’ensemble de ce quileur est prodigué tout au long de la formation.
Certains patients formateurs utilisent également des supports : petit film(URILCO), sur l’hygiène, la pose et l’entretien de leur matériel, de différents matériels, et expliquent, par exemple, que les choix de ceux-ci ne sont pas disponibles dans chaque hôpital ; diaporama de type Powerpoint®.
Toutes les associations mettent à disposition leur documentation (ou celle dupanel associatif du domaine). Dans le VIH, par exemple, Marianne L’Henaffamène de la documentation de l’ensemble des grandes associations afin de faireconnaître l’ensemble du tissu associatif de cette pathologie. Les interventionssont réalisées seules par Olivia Niclas, présidente de l’association AFDE, et parfoispar Marianne L’Henaff d’ARCAT et du TRT5, les membres de l’AFLAR, les patientspartenaires de SOS Hépatites ; à deux ou en groupe par Narcotiques anonymes,URILCO, ARCAT et TRT5. L’intervention à laquelle j’ai assisté auprès d’étudiantsen deuxième cycle au CHU Bicêtre sur le VIH était coanimée en binôme par unpatient formateur et un médecin salarié de l’association. L’intervention auprèsdes étudiants en faculté dentaire de Nantes est, elle, assez technique sur la génétique, mais émise de manière profane et illustrée d’histoires vécues.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
130
n° 34 mars 2010
Revue générale de droit médical
30. FNAPSY : Fédération nationale des associations d’usagers de la psychiatrie.
© Les Études H
ospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page130
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
Ceci permet d’évoquer ce domaine au travers du prisme des familles et des malades eux-mêmes, avec des réflexions que n’entendront jamais ces professionnels de santé31. De plus, dans son cas, elle ne parle pas uniquementde la problématique de son association, mais des maladies génétiques en général.
D’autres types d’interventions sont toutefois réalisés, comme celles de l’organisation de l’AFLAR chez les internes et externes, sur la polyarthrite rhumatoïde ou dans les addictions. La première consiste à faire intervenir mensuellement un patient partenaire auprès d’un petit groupe d’étudiants. Il yest question de vécu, il y a de nombreux échanges. Une réflexion peut être entamée par les étudiants praticiens entre les sessions. Là encore, l’expériencedes actes simples du quotidien est abordée et permet au praticien d’aborder lepatient dans les meilleures conditions comme le dit Karine Renaud32, du laboratoire Pfizer. Dans le domaine des addictions, il arrive que le patient formateur participe en tant que patient expert au sein d’un jury.
Les interventions peuvent donc varier selon les objectifs pédagogiques des enseignements dans le cadre desquels elles s’insèrent. Les patients formateurs démontrent alors une capacité d’adaptation.
Le tronc commun reste toutefois le vécu du patient et leur champ d’expertise,dans le rapport médecin-patient, mais également dans leur vie de tous les jours,y compris dans la sphère intime souvent restée secrète dans l’échange avec lemédecin lors de la consultation. Une zone de secret est souvent induite par lemalaise dans ce domaine du médecin lui-même. C’est une nouvelle piste d’optimisation du travail sur l’observance.
Les professeurs qui organisent ces modules, ont pour leur part trouvé ce moded’intervention pertinent et apportant réellement une plus-value, car une fois lapremière expérience réalisée, ils les réitèrent année après année.
Ce concept expérimenté du patient formateur ou patient partenaire a doncmaintenant un vécu de plus d’une dizaine d’années en France.
Les expériences se multiplient sur certaines pathologies chroniques, mais enFrance moins qu’ailleurs et surtout plus tardivement.
Le professeur Euler Ziegler, médecin spécialiste et initiateur en France de cettedémarche a souligné lors d’une interview déjà citée33, l’apport sur l’impact detels dispositifs sur l’efficacité des stratégies thérapeutiques mises en place dansle cadre de la relation médecin-patient.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
131 Revue générale de droit médical
n° 34 mars 2010
31. Interview réalisée auprès d’Olivia Niclas le 12 décembre 2006, présidente de l’association de l’AFDE,et du docteur Brigitte Light de l’école dentaire de Nantes.32. K. Renaud était, en 2007, déléguée du laboratoire auprès des associations de patients.33. Article de David BILHAUT paru dans Le Quotidien du médecin du 13 février 2007, n° 8104.
© Les Études Hospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page131
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
Le « patient formateur » hors de nos frontières : le programme patient partenaire sur l’arthrite rhumatoïde a commencé en France après une expérience internationale déjà bien éprouvée. Initié au Kansas en 1992, poursuivi à partir de1995 au Canada et en Scandinavie, en 1996 au Royaume-Uni et aux Pays Bas,il a fallu attendre 1997 pour que, en même temps que l’Afrique du Sud et l’Australie, la France, par le biais de l’AFLAR et du professeur Euler Ziegler lanceà son tour ce projet. La littérature internationale sur le sujet est importante et lesexpériences sont multiples34 nous indique Tim Greacen, un Australien docteuren psychologie, aujourd’hui responsable du laboratoire de recherche en santémentale de Maison-Blanche, à Paris. Il explique qu’en tant que chef de laboratoire de recherche en santé mentale au niveau européen il a pu constaterque cette pratique est largement utilisée. Que ce soit donc en santé mentale, discipline de prédilection de ce chercheur, ou dans de nombreuses autres disciplines de la médecine, l’intervention des patients est fortement utilisée. LeNHS (Système de santé britannique) utilise largement des patients formateursnommés « patient-partners », et ce de manière professionnelle pour enseigner,élément inscrit sur le plan légal35.
Il apparaît que l’enseignement de la médecine en France, sur ce terrain, soit enretrait des pratiques internationales. L’expérience internationale sur le sujet estdonc multiple et devrait être aisément reproductible en France pour le plus grandbien des patients, également des médecins et au bout du compte de notre système de santé, comme en témoignent d’ailleurs les expériences déjà existantes sur le territoire.
Une intervention européenne menée sur le territoire français illustre le changement susceptible de modifier en profondeur la formation des étudiantsen médecine si elles donnaient lieu à généralisation. Il s’agit de la recherche – action « EMILIA ». C’est un projet de type « recherche-action » initié par « ENTERMental Health », un consortium européen d’établissements publics de santémentale et d’universités, et financé par la Commission européenne. C’est uneétude multisites avec 16 partenaires européens sur l’accès à la formation tout aulong de la vie et à l’emploi comme moyens de lutte contre l’exclusion sociale etprofessionnelle de personnes vivant avec un handicap psychique.
Ce projet peut d’ailleurs être interprété comme une mise en œuvre dans l’espritdes lois constitutionnelles françaises, puisque directement liées au préambule dela Constitution du 27 octobre 1946 dans lequel on trouve à la suite ces deux alinéas :
– Alinéa 10 : La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires àleur développement.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
132
n° 34 mars 2010
Revue générale de droit médical
34. Interview de Tim Greacen réalisée au laboratoire de santé mentale de Maison-Blanche le 4 avril2007.35. G. IKKOS, « Engaging patients as teachers of clinical interview skills », Psychiatric Bulletin (2003), 27,312-315, 2003
© Les Études H
ospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page132
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
– Alinéa 11 : Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux tra-vailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
Une réelle valeur constitutionnelle porte donc cette démarche, puisque la normede droit constitutionnel a pour objectif de rassembler les règles qui régissentl’organisation politique de l’État, son fonctionnement et la mise en œuvre deses devoirs dont la protection de la santé est partie. Les représentations de lasanté ne sont plus aujourd’hui limitées « au silence des organes » comme l’ontdéfini Descartes au XVIIe siècle, puis R. Leriche en 1937, mais à une vision globaleintégrant pleinement les aspects psychiques.
En plus de l’objectif premier d’accès à l’emploi, d’autres objectifs sont alloués àce protocole de suivi sur trois ans. L’un d’eux concerne directement notre sujet.Les patients qui intègrent ce dispositif ont une certaine pratique en tant qu’usa-ger du système de santé. De ce postulat leur est proposé un certain nombre demodules d’accompagnement et de formation. Parmi ceux-ci, il est question doncde fédérer un groupe de patients formateurs d’étudiants en médecine. Ce pro-jet ambitieux a l’avantage d’être expérimenté et d’évoluer en collaboration conti-nue avec des évolutions en temps réel dans plusieurs États de l’UE.
En France, c’est à Paris, au laboratoire de recherche de l’établissement public desanté Maison-Blanche que le projet est mené depuis fin 2005.
▪ Bénéfices d’une généralisation de la pratique du patient formateur
Comme l’a étudié Sylvie Fainzang, spécialisée en anthropologie de la santé et ti-tulaire d’un doctorat en ethnologie de l’École des hautes études en science socialede Paris, les bases et l’essence de la relation médecin-malade devraient être étu-diées, approfondies et éprouvées très tôt au cours de la formation. Elle délivredans un livre écrit sur l’intimité au sein de ce colloque singulier36 une sommed’informations étayant cette réflexion. L’auteur décortique également ce qui danscette étude décèle de stratégies obsolètes basées sur la volonté de bien faire,d’actes motivés par une interprétation du Code de déontologie médicale. Cetteréflexion renforce la pertinence des commentaires des initiateurs et bénéficiairesdes diverses expériences décrites tout au long de cette étude, qui suggère unemodification pérennisée de l’enseignement au cours de la formation médicale. Ildevient nécessaire de proposer des réponses à cet état des lieux. Ce besoin de for-mer des étudiants en médecine à de nouvelles pratiques et attitudes en adéqua-tion avec les nouvelles perceptions et usages de la société. Un constat qui pourraitdevenir de plus en plus criant aux vues des évolutions des mentalités, au regarddes lois déjà votées, publiées au Journal officiel et peut-être à venir. Le patient estaujourd’hui à considérer comme un individu dans toute sa dimension.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
133 Revue générale de droit médical
n° 34 mars 2010
36. S. FAINZANG, La Relation médecins-malades : information et mensonge, PUF, 2006 ; « Vérité et mensongedes composantes de la relation médecin-patient », La Santé de l’homme, INPES, n° 386, novembre- décembre 2006, p. 55-56.
© Les Études Hospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page133
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
Le cadre législatif a, lui, pour rôle, d’encadrer la vie en société. Il élabore celui-ci en formalisant le reflet du mouvement des consciences. Si l’objectif est de permettre à notre corps médical d’appliquer, dans le respect de l’esprit de la loi,des pratiques en adéquation avec la société du XXIe siècle, alors ce concept de patient formateur peut y répondre.
Aujourd’hui, une médecine qui a vocation à être de qualité ne se résume plus àla réalisation d’actes de hautes technologies, à la prescription de thérapeutiquespharmaceutiques toujours plus perfectionnées, mais également à une attentionparticulière à la qualité de la relation, ce qui, nous l’avons vu, est et reste unecondition sine qua non de « compliance ».
Un aspect de la prise en charge qui optimise la stratégie thérapeutique et permetau patient de participer, produit le plus souvent de meilleurs résultats. Des résultats dorénavant attendus, autant en titre individuel que collectif, avec desaspirations dont les priorités peuvent être différentes.
À titre individuel, la principale volonté est tournée vers la médecine de qualité.Alors qu’au niveau de la collectivité, c’est d’une optimisation du système dont ils’agit, ce qui permettrait de réduire les coûts. Une volonté déclarée par les politiques de santé publique régies par la nécessité de réguler économiquementle système de soins.
Dans le cadre de la formation de médecine, où la quantité d’information à engranger est si importante, initier les étudiants le plus rapidement aux aspectsdu vécu des malades, à une lecture émotionnelle qui ne serait alors plus, oumoins, en concurrence avec l’aspect cartésien, pourrait produire un nouveautype de praticien.
Au regard des relations de collaboration qui ont su se construire entre le mondemédical et le tissu associatif, comme cela a été mis en lumière, il est certain quesi ce type d’intervention était généralisé, les associations entreprendraient l’effortqui garantirait la qualité des interventions pour une médecine de qualité.
Bibliographie
FAINZANG (S.), La Relation médecins-malades : information et mensonge, Paris, PUF,159 p., 2006.
FAURE (O.), Histoire sociale de la médecine, Paris, Economica, Anthropos, 272 p.,1994.
GRMEK (D.), Histoire de la pensée médicale en Occident, t. I, Antiquité et Moyen âge,Paris, Seuil, 382 p., 1995.
– Histoire de la pensée médicale en Occident, t. II, De la Renaissance aux Lumières,Paris, Seuil, 376 p., 1997.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
134
n° 34 mars 2010
Revue générale de droit médical
© Les Études H
ospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page134
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
– Histoire de la pensée médicale en Occident, t. III, Du romantisme à la science mo-derne, Paris, Seuil, 422 p., 1999.
IKKOS (G.), « Engaging patients as teachers of clinical interview skills », Psychi-atric Bulletin (2003), 27, 312-315, 2003.
LUNEL (A.), La maison médicale du roi : XVIe-XVIIIe siècles : le pouvoir royal et les pro-fessions de santé (médecins, chirurgiens, apothicaires), Seyssel, Champ-Vallon,442 p., 2008.
le concept de patient formateur auprès des étudiants en médecine, un modèle effectif
Revue générale de droit médical
n° 34 mars 2010
© Les Études Hospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page135
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières
07-art-FLORA_Mise en page 1 01/03/10 11:58 Page136
téléchargé le 2010-04-07 à 15:36:13 par [email protected] interdite © Les Études Hospitalières