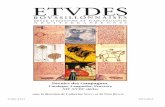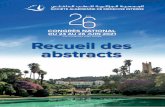Soigner, guérir, convertir. Les étudiants en médecine de Bangui (République centrafricaine) et...
Transcript of Soigner, guérir, convertir. Les étudiants en médecine de Bangui (République centrafricaine) et...
Psychopathologie africaine ,
2009-2010, XXXV, 3 : 277-307.
SOIGNER, GUÉRIR, CONVERTIR. Les étudiants en médecine de Bangui
(République centrafricaine) et leur rapport à la médecine traditionnelle :
une analyse du discours
Andrea CERIANA MAYNERI
En République centrafricaine, comme ailleurs en Afrique
équatoriale, commencer des études de médecine signifie se me-
surer avec des sources d’autorité médicale traditionnelles et
négocier son identité professionnelle par la confrontation quo-
tidienne avec les étiologies du mal qui font appel à l’occulte et à
la sorcellerie. Entre 2006 et 2010, nous avons réalisé une série
d’enquêtes auprès des étudiants de la Faculté des Sciences de la
Santé de l’Université de Bangui (FACSS) à propos de leur rap-
port à la médecine dite « traditionnelle »1. Les opinions de nos
interlocuteurs, que nous nous proposons d’exposer et commen-
ter, représentent une voie d’accès privilégiée à la compréhen-
sion des dynamiques qui régulent la cohabitation de la méde-
cine conventionnelle et des savoirs médicaux autochtones.
Pour de nombreux étudiants, la situation d’apprentissage
universitaire s’accompagne d’une réflexion épistémologique sur
la légitimité du savoir biomédical, dans un contexte caractérisé
1 Les enquêtes ont bénéficié d’une aide de l’Agence nationale de la Re-
cherche dans le cadre du programme Apprentissages/SYSAV (ANR-06-
APPR-009-01). Les recherches de terrain ont été menées à deux reprises
entre 2007 et 2008 à Bangui et à Bambari (à 400 km au N-E de la capitale).
Un supplément d’enquête a été effectué en janvier 2010 à Bangui. Nous
remercions Roberto Beneduce pour ses commentaires critiques.
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 278
par le pluralisme des compétences et des pratiques de soins.
La question de la relation entre connaissance scientifique d’un
côté, et reconnaissance professionnelle et sociale du médecin de
l’autre, est explicitement posée par les étudiants que nous avons
interviewés. Néanmoins, chacun d’entre eux répond différem-
ment à ce questionnement, le plus souvent en s’appuyant sur un
vécu personnel qui informe considérablement son approche de
la discipline médicale. Tandis que sur le terrain notre méthodo-
logie prévoyait le recours à l’entretien semi directif, nos interlo-
cuteurs ont fréquemment choisi d’orienter les entretiens vers le
récit de vie, pour nous faire part des raisons personnelles à
l’origine de leur choix professionnel et de leur rapport (de con-
fiance ou de méfiance) à la médecine traditionnelle. L’attention
« au singulier des pratiques et des connaissances » (Vidal 2004 :
193) nous amènera à proposer des extraits d’entretiens effec-
tués avec les futurs médecins de Bangui. Nous nous arrêterons
sur des passages qui, bien qu’exprimant les idées personnelles
de nos interlocuteurs, témoignent aussi d’opinions récurrentes
chez les étudiants banguissois. L’objectif de ce texte n’est pas
d’établir une différence culturaliste entre deux conceptions et
étiologies de la maladie. Il s’agit plutôt de montrer qu’en Cen-
trafrique, parmi les étudiants de la FACSS, la “tradipratique”2
constitue une véritable provocation épistémique avec laquelle
ces derniers essaient de composer tout au long de leur parcours
2 En Centrafrique, le terme désigne les savoirs et techniques des guérisseurs
traditionnels (nganga). D’après une classification locale, on pourrait faire une
distinction entre « herboristes » et « spiritualistes » : les premiers s’appuyant
sur la connaissance de la pharmacopée, les seconds fondant leur autorité et
leur pouvoir sur des visions à caractère religieux ou sur des relations person-
nelles avec des êtres spirituels. En réalité, sur le marché de la guérison,
chaque nganga doit s’appuyer sur des compétences diverses et complémen-
taires, en combinant la maîtrise de la pharmacopée avec le registre de
l’invisible et des dangers sorcellaires. Ce genre de classifications locales
semble plutôt viser à s’accaparer les ressources — pourtant modestes en
Centrafrique — allouées par les projets de « valorisation » de la médecine
traditionnelle, projets qui se défient évidemment des arguments sorcellaires
(sur ce type de problème, cf. Geschiere 2006 : 110).
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 279
de formation. Nous voudrions montrer, par l’analyse de
leurs discours, que certains étudiants empruntent un certain
nombre d’éléments à l’appareil épistémologique des tradiprati-
ciens via l’adoption d’un registre discursif que nous qualifions
— avec Byron Good — de « sotériologique », puisqu’il exprime
la dimension « de la souffrance et du salut » présente dans le
vécu du malade et du médecin (Good 1998 : 154). Ce processus
d’emprunt entretient une relation complémentaire et spéculaire
avec le « mimétisme de la structure bureaucratico-hospitalière »
(Tonda 2002 : 110) propre aux guérisseurs équatoriaux, qui
reprennent à l’univers de la biomédecine non seulement des
gestes, des objets, des vêtements, mais également son registre
linguistique3.
Avant de proposer des extraits d’entretiens, nous voudrions
introduire le contexte dans lequel nos recherches ont été me-
nées, en particulier les caractéristiques du marché de la guéri-
son auquel les étudiants et médecins centrafricains sont con-
frontés quotidiennement.
Le marché de la guérison en République centrafricaine
Nos entretiens ont eu lieu dans deux types de contexte :
d’une part à Bangui, à la FACSS ou dans les structures hospita-
lières de la capitale ; d’autre part à Bambari, la 5e ville du pays,
située à quelque 400 km au Nord-Est de Bangui4. La différence
3 Y. Jaffré et J.-P. Olivier de Sardan parlent à ce propos d’une « utilisation
allusive des gestes et des techniques sanitaires modernes » (2003 : 100). Dans
ces pages, nous qualifierons de « spéculaire » le rapport de mimétisme qui
amène les étudiants à emprunter des éléments discursifs et nosologiques à la
tradipratique. 4 Les chiffres cités sont extraits de la Synthèse des résultats du Recensement Général
de la Population et de l’Habitation (RGPH), publiée à Bangui le 30 juin 2005 par
le Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale.
Bambari est le chef-lieu de la préfecture de la Ouaka, où nous avons mené
entre 2005 et 2010 nos enquêtes. Un important hôpital universitaire y ac-
cueille les étudiants de la FACSS qui effectuent leur stage de terrain, ainsi
que les futurs assistants de santé et infirmiers diplômés d’État.
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 280
des sites n’est pas anodine, puisque l’arrière-pays, où chaque
étudiant doit effectuer un stage rural (ou stage de terrain) avant
de terminer ses études, demeure une référence cruciale pour les
futurs médecins5. Pour les stagiaires l’arrière-pays est souvent
associé à la tradipratique, au fétichisme, à la superstition : autant
de termes derrière lesquels on entrevoit un ensemble riche de
représentations émiques sur la médecine traditionnelle et, plus
généralement, sur la vie en dehors de Bangui. Ainsi, lorsqu’il
envisage les difficultés qui l’attendent durant son stage, un étu-
diant de 28 ans estime que Bangassou, sur la rivière Oubangui,
à quelque 800 km à l’Est de la capitale, pourrait être un bon
terrain « parce que c’est un peu évolué : comme Bangui, il y a
l’électricité »6. La stigmatisation de l’arrière-pays et de ses habi-
tants est un réflexe courant parmi les étudiants qui connaissent
peu et mal le contexte socioculturel en dehors de la capitale.
La République centrafricaine est un pays essentiellement ru-
ral et Bangui regroupe à elle seule une large partie de la popula-
tion, ainsi que la plupart des structures sanitaires et le personnel
de la santé7. Dans d’autres localités, les centres de santé se révè-
lent rares. Plus rares encore les spécialistes de santé (moins d’un
5 Au début de nos investigations, lors d’une réunion à l’Hôpital Général de
Bangui, et par la suite lors des rencontres individuelles avec chaque étudiant,
nous avons présenté notre travail comme une recherche anthropologique
sur le rapport entre les médecines conventionnelle et traditionnelle, en spéci-
fiant que nous étions intéressé plus particulièrement par l’opinion des étu-
diants qui s’apprêtaient à effectuer ou qui revenaient de leur stage de terrain. 6 Selon le RGPH, Bangassou est la 9e ville du pays (± 31 500 hab). Dans
l’arrière-pays, le réseau électrique est effectivement médiocre, mais les cou-
pures d’électricité sont fréquentes même à Bangui : les structures sanitaires
doivent s’appuyer sur des groupes électrogènes. 7 En 2003 le pays comptait 3,9 millions d’hab., dont 622 700 à Bangui
(RGPH). Cinq ans plus tard, l’OMS estimait la population à 4,339 millions
d’habitants. Si dans l’arrière pays la densité de la population varie entre 0,7 et
14,2 habitants au km2, à Bangui ce taux atteint les 9 295 habitants au km2
(RGPH). Pour les chiffres de l’OMS, voir la note suivante.
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 281
médecin pour 10 000 hab. en Centrafrique, selon l’OMS)8.
Dans ces conditions, le recours aux soins traditionnels est, plus
encore qu’un choix, une nécessité : le manque de moyens, de
connaissances, de personnel et l’insuffisance, voire l’absence,
des structures sanitaires favorisent l’épanouissement du marché
local de la guérison. Ce dernier comprend les savoirs et pra-
tiques des guérisseurs, des experts de la pharmacopée indigène,
des devins, des pasteurs des Églises prophétiques et pentecô-
tistes qui proclament avec insistance l’origine occulte ou diabo-
lique de la maladie. L’explication sorcellaire du malheur de-
meure largement diffusée, d’autant qu’elle s’appuie sur l’extra-
ordinaire plasticité d’une croyance qui ne cesse de changer de
forme, tant il est vrai qu’elle exprime les conflits sociaux, poli-
tiques et générationnels les plus récents des populations équato-
riales9. Comme l’ont souligné, entre autres, Florence Bernault et
Joseph Tonda, la sorcellerie s’affirme aujourd’hui comme une
catégorie fondamentale de la vie publique et domestique afri-
caine (Bernault & Tonda 2000 : 5 ; Bernault 2005 : 24). La Cen-
trafrique ne fait pas exception, ce dont témoignent deux articles
du Code pénal définissant et sanctionnant le crime de sorcelle-
8 Données extraites du Country Health System Fact Sheet et du General Health Statistical Profile de l’OMS, disponibles respectivement à l’adresse http://www.who.int/gho/countries/caf/en/ et http://www.who.int/gho/countries/caf/country_profiles/en/index.html [25/05/2011]. Ces statistiques se réfèrent à la période 2004-2007. 9 Il nous est impossible d’analyser ici l’importante littérature sur la croyance à la sorcellerie en Afrique équatoriale. Nous nous limiterons à signaler, par-mi les recherches incontournables, celles d’Evans-Pritchard, menées dans les années 1920 chez les Azandé (1972) et, celles, plus récentes, de Peter Ges-chiere au Cameroun (1995), sans oublier les critiques adressées par Marc Augé (1974) au paradigme « hyperfonctionnaliste » de l’École de Manchester et son analyse des logiques réglant le passage des soupçons aux accusations de sorcellerie (1975 ; 1976). Victor Turner (1964) et Malcolm Crick (1976 ; 1979) ont souligné les limites des classifications scientifiques des croyances à la sorcellerie, ainsi que l’influence des conceptions occidentales sur l’appré-hension anthropologique de la sorcellerie en Afrique. On se référera aussi utilement au numéro thématique « Territoires sorciers » des Cahiers d’Études africaines (2008), coordonné par Christine Henry et Emmanuelle Kadya Tall).
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 282
rie10. L’imaginaire sorcellaire local est peuplé d’une multipli-
cité de figures, dont le sorcier (zô ti likundu en sango ; lit. “la
personne de la sorcellerie” [likundu]) et le “métamorphoseur”
(zô ti urukuzu), que nous retrouverons aussi dans le discours de
nos étudiants11. Tandis qu’à la sorcellerie est associé un vaste
éventail de maladies et de malheurs, l’action du métamorpho-
seur déclencherait des symptômes plus spécifiques. Selon
l’opinion commune, la victime d’un urukuzu serait contrainte à
l’immobilité ou au mutisme, elle serait comme absente de la
réalité puisque, tandis que son corps demeure au lit ou à la mai-
son, son « âme »12 serait transformée en bête de somme et, sous
10 Les art. 149 et 150 du nouveau Code Pénal centrafricain (adopté en 2010), sanctionnent les pratiques de charlatanisme et de sorcellerie par des peines allant de cinq ans d’emprisonnement aux travaux forcés à perpétuité. Ces articles reprennent les art. 162 et 162bis de l’ancien Code Pénal, à l’exception de la peine capitale, remplacée par les travaux forcés. Sur le problème du traitement judiciaire des accusations de sorcellerie en Afrique équatoriale, voir l’ouvrage dirigé par Eric de Rosny (2006), ainsi que Fisiy (1990), Fisiy & Geschiere (1990), Geschiere (2006). 11 Sur l’assimilation du likundu à un organe abdominal ou à un animal qui résiderait dans le ventre des sorciers, voir Vansina (1990 : 299-300). Pour la diffusion du mot likundu au Gabon, Cameroun, Congo, en Centrafrique et en République Démocratique du Congo, voir Retel-Laurentin (1974 : 168). Pour les caractéristiques et la diffusion de diverses croyances à la sorcellerie en République centrafricaine, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse de doctorat (Ceriana Mayneri 2010). 12 Le terme français « âme » est fréquemment utilisé par nos interlocuteurs, aussi bien par les étudiants banguissois que par les tradipraticiens avec les-quels nous avons pu travailler dans l’intérieur du pays. Il désigne à la fois le « double » du sorcier qui quitterait son corps la nuit pour nuire à ses vic-times, et celui des personnes métamorphosées, dont le corps physique de-meurerait au lit, malade et immobilisé. « Âme » traduit le mot sango yingo qui désigne l’ombre, l’image (par ex. dans un dessin), le principe vital de la per-sonne humaine et donc l’âme dans son acception chrétienne. Le terme est tout à fait exemplaire de l’échange de significations inauguré par la rencontre coloniale dans l’ex-Oubangui-Chari : adopté par la population au moment où les premiers missionnaires s’empressaient de traduire la Bible et les caté-chismes dans les langues vernaculaires, le mot « âme » a suivi une trajectoire complexe, tout comme celui de « sorcellerie » ou d’autres termes du vocabu-laire mystique en Afrique équatoriale.
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 283
cette forme, attachée à un arbre ou vendue au marché13. Syl-
vie Fainzang (1982) s’est arrêtée sur la « mystification » qui sou-
tiendrait de nombreuses explications divinatoires de la maladie
en Afrique subsaharienne. Selon elle, le terme « mystification »,
loin d’être péjoratif, réfère à une composante fondamentale du
complexe idéologique qui soutient l’étiologie et le traitement de
la maladie : l’occultation de la « catégorie du naturel » de la ma-
ladie et l’explication de cette dernière « sur le modèle des caté-
gories de l’ordre établi » admises tant par le malade que par le
médecin. (ibid. : 420)14. Pour revenir aux étudiants, et plus géné-
ralement au personnel biomédical centrafricain, on comprend
que l’occultation de la catégorie du naturel de la maladie repré-
sente un défi épistémologique que chaque étudiant doit affron-
ter avant, pendant et après le stage rural. Ce dernier permet en
effet aux futurs médecins de penser leur rapport à ce que Fain-
zang appelle les catégories de « l’ordre établi », défini comme
le code partagé par une large partie des patients hospitalisés (et
de leurs parents) et autorisant l’explication de la maladie par
l’étiologie sorcellaire. La présence fréquente des tradipraticiens
13 Pour Serge, étudiant en 7e année, « Quand une personne métamorphosée
crie, on peut distinguer que sa voix n’est plus humaine mais ressemble à celle
d’un animal ». L’image d’hommes et de femmes transformés en « zombies »
ou en animaux et obligés de travailler dans les plantations des sorciers, est
largement répandue dans toute l’Afrique équatoriale. Pour le cas camerou-
nais, voir de Rosny (1981) et Geschiere (1995 ; 2000). Luise White (2000) a
analysé l’émergence des rumeurs de vampirisme en Afrique centrale et orien-
tale pendant la période coloniale. Sur ce sujet, voir également les travaux de
Florence Bernault (2005 ; 2006). 14 Une interprétation similaire était déjà proposée par Evans-Pritchard lors-
qu’il analysait l’utilisation des plantes médicinales dans l’association zande
mani (1931 : 143). Le texte de S. Fainzang — que nous ne pouvons résumer
ici — aborde la question de la mystification à partir de la « production so-
ciale des mythes » (1982 : 421) et du consentement, des thèmes déjà traités
par Lévi-Strauss dans deux textes célèbres (1958a et 1958b). Sur le problème
du « consentement », nous renvoyons également à la façon dont Max Weber
a décrit la « domination rationnelle », dont la légitimité repose sur la croy-
ance au fait qu’elle est fondée en raison : voir à ce propos les observations
de Benoît de L’Estoile (2000 : 297-99).
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 284
aux côtés des malades hospitalisés15, ainsi qu’une certaine
rhétorique politique prônant le rapprochement de la médecine
conventionnelle et de la tradipratique, se greffent sur
l’expérience personnelle de chaque étudiant et favorisent une
réflexion individuelle et originale sur la précarité identitaire et
les stratégies de reconnaissance professionnelle auxquelles les
futurs médecins ont recours.
Biomédecine et créativité
Jean-Pierre16, 32 ans, est en 7e année à la FACSS. Il souhaite
se spécialiser en biologie médicale pour continuer à faire de la
recherche. Lors de notre rencontre à l’Hôpital Communautaire
de Bangui, il revenait de son stage rural. Pour lui, les différences
avec la capitale sont énormes : d’après sa description, il n’y a à
l’hôpital de Bangassou que très peu de médicaments et les équi-
pements médicaux sont vétustes ou inexistants. Surtout « les
gens [y] sont vraiment attachés à la tradipratique ». Ce serait
donc « une question de mentalité » : à Bangassou les gens vont
à l’hôpital ne serait-ce que « pour la forme », alors qu’à Bangui,
le malade serait appelé à choisir entre des soins traditionnels et
les structures hospitalières17. Bref, un médecin dans l’arrière-
15 Un étudiant en 5e année nous explique : « Souvent […] ici, on manque de
moyens diagnostiques : le diagnostic tarde et on ne peut pas mettre en place
un traitement. Alors je crois que les parents sont amenés directement à
penser à la sorcellerie, et puis, bon, soit ils te le disent ouvertement soit,
quand on est absent, au milieu de la nuit, ils font sortir le malade pour
l’amener chez le féticheur ou alors ils le font venir à l’hôpital ». 16 Les noms des personnes interviewées ont été changés. 17 Un étudiant de 2e année revient sur ce problème : « On est Africains […] il
y a des gens qui sont déjà habitués à traiter avec l’indigénat [avec les tradi-
praticiens]. Donc, c’est impossible de leur enlever ça de la tête ». Et pour un
autre étudiant qui connaît l’arrière-pays : « Oui, je peux dire la même chose :
en milieu rural c’est plus fréquent [que les gens aillent chez les tradiprati-
ciens] ! Parce que, la zone que j’ai connue… ce qu’ils font, ils le font, surtout
en milieu musulman, avec le marabout… et puis il y a les voyants, et ceux
qui dans leur pratique utilisent des moyens… par exemple une écorce, pour
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 285
pays doit « avoir de la créativité » pour lutter contre le
manque de moyens et négocier son rôle professionnel à côté
des tradipraticiens. Pourtant, au-delà de ces considérations gé-
nérales, le discours de Jean-Pierre oscille continuellement entre
l’appréciation modérée et la condamnation sans appel des tra-
dipraticiens et de leurs compétences. C’est par ailleurs
l’expérience personnelle qui, en s’insinuant dans son discours,
soutient cette incertitude épistémologique. Jean-Pierre a perdu
son père des suites d’une grave maladie que les membres de sa
famille choisirent de soigner de manière traditionnelle. Le ma-
lade, accueilli chez un tradipraticien à Bangui, ne vit pas son
état s’améliorer et fut hospitalisé dans un état grave : il décéda
peu après. Le même dilemme se représenta à l’occasion de la
maladie d’un oncle paternel. De nouveau, la famille opta pour
un traitement traditionnel qui n’aboutit à aucun résultat satisfai-
sant. Hospitalisé suite aux pressions que Jean-Pierre lui-même
exerça sur sa famille, le malade, cependant, décéda lui aussi.
Dans le récit de notre interlocuteur, marqué par une charge
émotionnelle évidente, il ne semble y avoir aucune place pour la
tradipratique. Pourtant, à travers un exemple récurrent dans les
récits d’autres étudiants, cette dernière est réintroduite dans le
discours et partiellement réhabilitée : c’est lors du stage à Ban-
gassou, en constatant le succès des techniques traditionnelles
pour soigner les fractures18, que Jean-Pierre dit avoir compris
« qu’il y a quelque chose de positif qui aide ces gens démunis à
survivre. Face à des phénomènes qu’il définit comme « specta-
culaires » et qui échapperaient à l’appréhension biomédicale, il
estime que le médecin ne doit « pas tomber dans la confusion :
si ça [les symptômes du malade] te dépasse, tu acceptes que le
tradipraticien vienne t’aider, et tu contrôles ce qu’il fait ». Dans
la donner à boire au malade ». Bref, comme le résume un étudiant de 5e
année : « Le Centrafricain passe toujours chez le féticheur ». 18 Pour Nicolas, 35 ans, aspirant gynécologue de 7e année : « S’il s’agit de
soigner un cas de fracture, alors on est d’accord [médecins et tradipraticiens
peuvent trouver un accord]. Mais si on parle de la sorcellerie, du diable et de
la prière, alors non ».
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 286
son discours, l’introduction d’une distinction culturaliste
signe le passage du registre des pathologies conventionnelles
(les cas de fracture) à celui des maladies d’origine sorcellaire :
« En effet, il y a des choses spectaculaires. [Par exemple] la métamor-
phose : un bon médecin suit la logique. Tu gardes la rigueur méthodolo-
gique. Tu soignes ce que tu trouves comme symptôme. Mais en tant
qu’Africain, tu dois reconnaître qu’il doit y avoir collaboration avec les
tradipraticiens : le médecin doit contrôler les médicaments que ce dernier
utilise et il doit suivre la posologie ».
Cette fluctuation entre le registre médical et celui des « cho-
ses spectaculaires » caractérise également le discours d’autres
étudiants19. Dans les entretiens, le passage d’un registre à l’autre
— qui se fait, souvent, à travers la médiation discursive d’un
argument culturaliste (« Mais, en tant qu’Africain... ») — intro-
duit le problème des étiologies sorcellaires et de l’approche
qu’un médecin devrait adopter face aux patients qui se plai-
gnent de symptômes « spectaculaires ».
Médecine et métamorphose
Arrêtons-nous à présent sur un bref exemple qui nous per-
mettra de présenter une autre stratégie de définition profession-
nelle à laquelle certains étudiants ont recours face aux pro-
blèmes de métamorphose. Paulin, 20 ans, est originaire du Ni-
géria : il est arrivé à Bangui avec sa famille à l’âge d’un an. De-
puis, il a toujours vécu dans la capitale. Lors de notre entretien,
il manifeste d’emblée une profonde méfiance vis-à-vis des tra-
dipraticiens. Son opinion nous intéresse parce que, comme dans
le cas précédent, c’est un argument culturaliste qui permet à
notre interlocuteur d’introduire dans le discours la tradipratique
et les étiologies sorcellaires de la maladie :
19 Plus direct, un autre nous dit : « Ici, nous sommes en Afrique, nous sa-
vons qu’il y a des choses [mystiques] qui arrivent, il faut faire avec ça ».
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 287
« Ce que je ne comprends pas, c’est qu’en Afrique la tradipra-
tique est toujours liée à la spiritualité… aux sacrifices… ça prend
une tangente quoi [ça devient rapidement de l’escroquerie] !
Paulin se méfie de la Fédération nationale des Tradiprati-
ciens (FnT) de Centrafrique, qui a son siège à Bangui, à côté de
l’Hôpital Général et du Ministère de la Santé Publique :
« Officiellement, ils font leur travail avec les plantes, mais en réali-
té c’est comme s’il prenaient la tangente. » 20
Même s’il ne connaît du pays que la capitale, Paulin stigma-
tise immédiatement l’arrière-pays lorsqu’il s’agit d’évoquer ce
qu’il sait des symptômes de métamorphose. Mais un glissement
subtil s’insinue ensuite dans son discours ; de la critique des
tradipraticiens, il passe soudainement à l’adhésion à une noso-
logie « mystique » :
« Ici à Bangui je n’ai jamais vu de cas de métamorphose, mais [j’en
verrai] peut-être lorsque je ferai mon stage rural, en 6e année… Il
semble que la personne commence à crier comme un animal. Les
cas sont différents selon que la personne crie comme un cabri, ou
comme un bœuf… Donc en premier lieu je chercherai à savoir
comment cette personne vit, son milieu social, si elle a désobéi à
quelqu’un, si elle a fait un tort à quelqu’un. Comme ça je cherche à
comprendre de quel type de métamorphose il s’agit ».
En nous réservant de revenir sur le genre d’intervention en-
visagée par Paulin, penchons-nous maintenant sur un exemple,
où la conviction religieuse de notre interlocuteur influence pro-
fondément ses opinions sur la médecine conventionnelle.
20 La méfiance vis-à-vis des nganga est exacerbée non seulement par la
proximité de la FnT, mais aussi par le fait que ces derniers circulent dans les
hôpitaux à la demande de certains patients et de leurs parents : « Des fois ils
viennent, parce que les parents les amènent, comme ça. Mais nous, quand
même, on ne peut pas accepter que quelqu’un vienne pratiquer sans [de-
mander] notre avis, de faire ces pratiques-là dans notre service, on ne peut
pas accepter » (étudiant de 2e année).
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 288
Médecine, fétichisme et foi chrétienne
Marcel, 32 ans, est en 5e année : il prépare son départ pour le
stage rural dans le sud-ouest du pays. Il se dit sceptique à pro-
pos des tentatives de collaboration entre les deux médecines :
« Moi je ne vois pas tellement l’importance de ça, hein. D’abord,
je n’ai pas une bonne connaissance de la médecine traditionnelle,
mais mon impression est que… c’est… un domaine qui est, je
pourrais dire, d’une manière générale, rattaché à la sorcellerie. Oui,
parce que les tradipraticiens d’ici … ils font le métier de féticheur
et puis on mélange un peu tout, quoi. Voilà, c’est un peu ça »
Pour renforcer le rapprochement entre les deux systèmes
Marcel introduit dans le récit son expérience personnelle :
« Ma position vis-à-vis de cette médecine traditionnelle est basée
sur ma foi, ma foi chrétienne parce que dans mes expériences j’ai
eu à… à côtoyer ce milieu du fétichisme […] [A l’époque], si j’en
avais l’occasion, moi même j’en prenais [des médicaments propo-
sés par les tradipraticiens] pour pouvoir peut-être avoir de la
chance, ou me protéger, et tout ça. Mais plus tard, je ne sais pas
comment, Dieu m’a fait la grâce que je puisse voir que ça c’est un
péché, hein… Excusez-moi, peut-être que ça n’est pas dans le
domaine de votre étude ? »
Rassuré sur notre intérêt pour la dimension personnelle et
religieuse de son parcours professionnel, notre interlocuteur
continue :
« Mon opinion ? Bon, ce que je peux dire… d’abord, je sais qu’il y
a des problèmes, des maladies qui ont une origine spirituelle. Ça je
le sais. Il y a des maladies qui peuvent même être déclenchées par
les pratiques de la… par les mécanismes de la sorcellerie. Par
exemple, les cas de métamorphose, ça c’est… on peut dire par
exemple que c’est de la folie, le mécanisme de la folie, et tout ça.
Même certaines maladies qui peuvent être diagnostiquées en mé-
decine moderne, hein : il y a, d’après certaines conclusions, des
gens qui pratiquent la sorcellerie [même certaines maladies qui
peuvent être diagnostiquées par la médecine moderne ont une
origine sorcellaire] ».
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 289
Dès qu’il s’agit de l’étiologie sorcellaire, les présupposés
épistémologiques de la profession médicale, sa méthodologie et
sa déontologie sont remis en question, parfois en fusionnant les
vocations médicale et religieuse, comme dans le cas de Marcel :
« Je crois que quand j’aurai à traiter ce genre de problèmes [des
maladies « mystiques »], je crois que ce n’est pas dans la foi chré-
tienne de forcer les gens. Donc, il ne m’appartient pas de m’impo-
ser aux gens, [et de leur dire] que effectivement voilà, la prière ça
suffit… non. Si le cas dépasse les règles de la santé, alors moi je ne
vais pas m’opposer [à ce que le malade et ses parents s’adressent à
un tradipraticien] s’ils le font discrètement. Et puis, si j’ai l’occa-
sion de leur parler de ma foi, de parler de la possibilité de la guéri-
son par la foi, par la prière, alors je leur en parlerai […] Et s’il y a
la possibilité que moi même je puisse [les] baptiser… seulement
pour [leur] indiquer la direction, ce que le Seigneur donne… »21.
Et lorsque nous intervenons pour demander : « Donc, dans
un cas pareil tu leur parles de la foi et de la prière, mais en tant
que médecin, comment est-ce que tu devrais essayer de soigner
ce malade ? », Marcel revient rapidement au registre biomédi-
cal :
« Mais c’est ce que je ferais ! Ça c’est mon devoir ! Si je suis encore
à l’hôpital c’est pour soigner, pour utiliser les moyens modernes
de la médecine pour faire ça, d’après mes connaissances ! ».
Du soin à la guérison, de la guérison à la conversion
Confrontés à la cohabitation des médecines les étudiants in-
terviewés utilisent la rhétorique de la scientificité biomédicale,
alliée à une stigmatisation de l’arrière-pays, des paysans et des
tradipraticiens. Ici il n’est pas question de juger des opinions
21 Un étudiant en 7e année nous explique que s’il avait en face de lui un
malade se disant métamorphosé, il commencerait par lui dire « qu’[il] accepte
[sa croyance] » pour pouvoir procéder aux soins. Mais en même temps il
s’intéresserait « à son côté spirituel : s’il est animiste, j’essaie de lui expliquer
dans ses termes à lui que c’est mieux de croire en un dieu unique ».
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 290
personnelles. Il s’agit d’analyser les discours que nous avons
recueillis pour en dégager des indications sur la façon dont des
apprentis médecins perçoivent la coprésence, dans leur société,
de diverses étiologies médicales et pratiques des soins.
Nous l’avons vu, pour certains de nos interlocuteurs, en de-
hors de Bangui la population serait “vraiment attachée à la tra-
dipratique”, les malades n’iraient à l’hôpital que “pour la
forme”, ils “passeraient toujours chez le féticheur” et les autres
villes du pays seraient, selon les cas, plus ou moins “évoluées”
par rapport à la capitale. En même temps, un bon médecin
“suit la logique”, utilise “les moyens modernes de la médecine”,
“garde la rigueur méthodologique” et, éventuellement, épaule
les tradipraticiens en supervisant leurs prescriptions.
Comme dans toute rhétorique22, l’insistance sur la scientifici-
té de la pratique médicale doit être appréhendée en fonction de
ce qui, dans le discours, est explicité mais aussi en fonction de
ce qui demeure un non-dit. Le recours au stéréotype nous four-
nit quant à lui une indication précieuse sur le contenu de ce
non-dit : loin d’être une simple image ou une manière de parler
inoffensive, le stéréotype est un outil discursif qui intervient
dans des situations où des identités sont remises en question
(Herzfeld 1992 : 67). Le stéréotype comporte en effet « un
double contenu d’information et d’évaluation dans le rapport à
soi et aux autres » (Martinelli 1995 : 367). Le recours répété à la
rhétorique biomédicale et aux stéréotypes est donc avant tout
une stratégie de définition identitaire à laquelle nos interlocu-
teurs ont recours dans une situation qui remet quotidiennement
en cause l’autorité professionnelle à laquelle ils aspirent. Leur
discours est rituel, au sens explicité par Michel Foucault, parce
qu’il s’efforce de définir « la qualification que doivent posséder
les individus qui parlent […] les gestes, les comportements, les
circonstances, et tout l’ensemble de signes qui doivent accom-
22 Nous prenons ici le terme « rhétorique » dans son acception courante, soit
un discours essentiellement formel dont le contenu est masqué par cette
forme même.
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 291
pagner le discours ; il fixe enfin l’efficace supposée ou impo-
sée des paroles, leur effet sur ceux auxquels elles s’adressent »
(Foucault 1971 : 41).
La mystification et l’occultation de la catégorie du naturel de
la maladie (pour reprendre l’expression de S. Fainzang) opèrent
comme une provocation épistémique pour des étudiants con-
frontés en famille, au quartier et à l’hôpital, à l’exception-
nelle polysémie des catégories explicatives mobilisées par les
tradipraticiens. Dans ce discours rhétorique, quel est le rôle de
l’argument culturaliste, si souvent évoqué par les étudiants in-
terviewés ? Cet argument, selon nous, intervient pour « démas-
quer » la fiction rhétorique précédemment évoquée : “mais en
tant qu’Africain tu dois reconnaître…”, “ici en Afrique…”, “on
est Africains, donc…”, “par rapport à notre mentalité et à notre
conception de la maladie”. Autant de formules à travers les-
quelles le non-dit du discours rhétorique s’insinue dans le récit
des jeunes étudiants pour être finalement prononcé. Ce n’est
pas seulement la cohabitation plus ou moins difficile avec
d’autres catégories nosologiques qui pose problème : comme l’a
souligné E. Kadya Tall (1992 : 68) pour le cas béninois, le dis-
cours culturaliste du personnel biomédical (psychiatrique dans
le cas étudié) exprime les divisions entre un savoir occidental
auquel il est reproché de ne pas considérer les variantes cultu-
relles en présence sur le terrain, et un savoir populaire auquel le
médecin voudrait apporter une certaine caution scientifique
(ibid.). Cette dernière est en effet l’ambition des étudiants qui
estiment possible une collaboration avec la tradipratique à con-
dition que les nganga acceptent d’être relégués aux cas de frac-
ture et autres diagnostics communs, en s’éloignant ainsi
du fétichisme, de « la spiritualité » et des « sacrifices »23. Quant
23 Ce qui n’est pas le cas le plus souvent. Un étudiant de 2e année nous ex-
plique : « Si c’est un praticien légalement reconnu, qu’il vienne d’abord [à
l’hôpital] pour se présenter et [nous verrons] si on peut l’accepter. Donc là,
ça ne dépend que de nous. Mais dire que ce praticien-là vient de lui-même
pour commencer à travailler, non, là c’est du désordre qu’on ne peut pas
accepter ». Non seulement il semble difficile d’imaginer que les nganga accep-
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 292
au « reproche » qui serait adressé à la médecine convention-
nelle, nous allons analyser en premier lieu la façon dont il est
exprimé. Nous avons vu que le récit de vie permet aux étu-
diants banguissois d’exposer leurs opinions sur la tradipratique
et les nganga. Le recours au récit de vie s’accompagne d’un glis-
sement discursif que révèle parfaitement l’hésitation avec la-
quelle Marcel nous introduisait à son expérience personnelle
(« Excusez-moi, peut-être que ça n’est pas dans le domaine de
votre étude ? »). Du registre rhétorique, qui se borne au point
de vue biomédical, on passe alors au registre « sotériologique ».
Byron Good (1998) utilise cette expression dans son étude des
dimensions formatives de la pratique médicale chez les étu-
diants en médecine de Harvard : l’expérience personnelle fait
irruption dans le langage biomédical des jeunes étudiants améri-
cains au moment où l’enquêteur leur demande d’expliquer
quand et pourquoi un cas clinique peut être considéré comme
« intéressant ». Le contenu moral et sotériologique « présent
dans le vécu des malades et de leur famille, présent en filigrane
chez ceux qui entrent dans la profession, présent chez le méde-
cin et son patient confrontés à une maladie grave » (ibid : 190)
exige l’abandon du langage rhétorique scientifique au profit
d’un registre qui exprime « la dimension de la souffrance et du
tent cette position subordonnée vis-à-vis de la médecine conventionnelle
mais surtout, comme tout marché, celui de la guérison s’épanouit en suivant
la demande de soins et d’explications des patients. Comme Evans-Pritchard
(1972) l’avait déjà montré en reprenant une métaphore zandé, la croyance à
la sorcellerie agit comme une « seconde lance » : elle ne contredit pas la
connaissance des causes et des effets à l’origine d’une maladie, d’un accident
mortel, ou d’un autre événement, mais explique pourquoi cette causalité
néfaste s’est manifestée à un moment et dans un lieu précis, chez telle ou
telle personne (ibid. : 106). Dès lors, la sorcellerie et les étiologies mobilisées
par les nganga s’empressent de répondre à cette demande de sens que les
malades leur adressent. S’agissant de la relation médecin-tradipraticien, E.K.
Tall parle explicitement du « leurre positiviste [qui] permet [au médecin]
d’imaginer un emploi rationnel des croyances et des savoirs traditionnels »
(Tall 1992 : 73 ; voir aussi Bernault 2009 : 763, et Beneduce 2010).
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 293
salut » (ibid. : 154)24. En ce sens, le schéma récurrent dans les
entretiens avec les étudiants de Bangui ne diffère pas de celui
reconnu par Good auprès de leurs collègues américains ou par
Barry et al. (2001) dans l’étude de la relation médecin-patient en
Angleterre : selon la situation d’énonciation et le contenu scien-
tifique ou sotériologique que l’on veut exprimer, le discours
bascule entre la « voix de la biomédecine » et « la voix du
monde vécu, qui s’exprime par un langage populaire en inté-
grant les faits dans un récit et en les associant à des effets »
(Leanza 2008 : 136). Cependant, la comparaison avec les cas
américain et britannique ne peut pas être poursuivie puisque, à
la FACSS et dans les hôpitaux de Bangui, cette « voix du
monde vécu » prononce un discours dont le référent premier
est ce même marché de la guérison que les étudiants banguis-
sois s’étaient empressés, au préalable, de critiquer. Non seule-
ment « les choses spectaculaires » (par exemple les symptômes
d’une métamorphose) sont réintégrées dans le discours de cer-
tains étudiants, mais ces derniers reprennent, comme en miroir,
les discours et des pratiques mobilisées par le nganga. Nous utili-
sons l’image du reflet dans un miroir car la stratégie mise en
œuvre par ces étudiants est analogue à celle qui, dans de nom-
breux contextes d’Afrique équatoriale, règle le rapport des tra-
dipraticiens avec la médecine conventionnelle. Ce rapport
s’appuie, pour reprendre l’expression de Didier Fassin, sur les
« usages magiques des attributs modernes de la médecine » qui
interviennent dans des cliniques de soins traditionnels où « le
stéthoscope et le tensiomètre […] ont plus pour fonction de
manifester le pouvoir du soignant que de lui permettre un dia-
gnostic […], les injections de vitamines B faites pour n’importe
quel symptôme associé à une fatigue, l’effet du mot “vitamine”
se conjuguant à l’effet du mode d’administration pour un gain
24 Pour Jean Benoist (1996), « les rencontres entre explications et entre trai-
tements de la maladie sont toujours des échanges, et si les anathèmes sont
souvent proclamés à haute voix, les compatibilités sont, elles, murmurées à
voix basse ».
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 294
d’efficacité symbolique » (Fassin 1992 : 210)25. Or, du côté
de la biomédecine, les étudiants banguissois semblent repro-
duire ce mimétisme d’une manière pour ainsi dire spéculaire en
s’appropriant les éléments discursifs et étiologiques de la tradi-
pratique. Ainsi, lorsque Paulin déclare que, face à un patient qui
se dit métamorphosé, il chercherait d’abord « à savoir comment
cette personne vit […] si elle a désobéi à quelqu’un, si elle a fait
un tort à quelqu’un », sa description n’est pas sans rappeler ce
qu’Evans-Pritchard écrivait à propos des witch-doctors azandé :
« les devins exorcistes […] sont très au courant des inimitiés et
des chamailleries locales […]. Un devin exorciste demande à
son client les noms de ses voisins, de ses épouses, ou de ses
égaux à la cour, selon le cas […]. Avant toute chose, il se livre à
un examen contradictoire de son client. Il souhaitera probable-
ment savoir le nom de ses voisins, ou de ses épouses, ou de
ceux qui ont pris part avec lui à quelque activité » (1972 : 213-
214). Ce qui nous intéresse ici est moins l’adhésion d’un jeune
étudiant à une nosologie populaire se référant à la sorcellerie
que la façon dont il envisage d’agir à l’intérieur de ce système de
représentations de la maladie. Comme un nganga, il procéderait
lui aussi à la reconstruction des conflits qui traversent la vie du
malade pour dégager, à partir des tensions interpersonnelles,
25 Voir aussi M. Augé & J.-P. Colleyn (1990 : 19) : « On assiste […] à un
phénomène dont le terme “acculturation” risquerait de ne rendre compte
qu’en le trahissant. La médecine moderne, qui ne fonctionne pas comme
principe de sens, est condamnée à une efficacité technique dont elle n’a pas
souvent les moyens. Elle prend place dans l’univers sémantique et la logique
sociale qui l’ont précédée : l’hôpital figure entre autres parmi les recours
divers qu’essaient les malades ; des guérisseurs empruntent aux aspects en
apparence les plus rituels de la pratique occidentale, mettant par exemple des
blouses et des bonnets blancs à des aides qu’ils appellent infirmiers. Bref,
des éléments épars de modernité sont absorbés par le seul univers de sens
qui tienne un peu le coup face au caractère discontinu, baroque et souvent
injuste du monde officiel ». R. Beneduce (2010 : 108) parle, à propos des
tradipraticiens camerounais, d’une « métamorphose souvent baroque de
gestes, de signes, de mots qui n’a pas laissé sans changement la logique de la
cure ».
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 295
des indications sur l’origine de sa maladie26. A travers le glis-
sement du registre bio- médical au registre sotériologique, puis
de ce dernier à l’argument culturaliste, l’ouverture du discours
sur les maladies “spectaculaires” ou “d’origine spirituelle”
semble répondre au besoin, parfois très fort chez certains étu-
diants, de dépasser le cadre des soins pour accompagner le pa-
tient vers sa guérison ou, du moins, accéder à la sphère de signi-
fications qui accompagne l’expérience de la maladie et de la
mort dans le contexte centrafricain27. Toutefois, si certains étu-
diants ont tendance à « mimer » les nganga dès qu’une patholo-
gie échappe à l’appréhension médicale, ils risquent aussi de res-
ter prisonniers de la « circularité » des discours des guérisseurs
traditionnels sur la sorcellerie et la métamorphose. Peter Ges-
chiere a analysé à plusieurs reprises cette circularité (1995 : 77-
81 ; 2006 : 98-103). Les discours (et les pratiques) des nganga
semblent destinés à reproduire ce même schéma d’inter-
prétation sorcellaire de la réalité qui, en définitive, contribue à la
diffusion des rumeurs circulant en Afrique équatoriale sur une
prolifération supposée de la sorcellerie et des dangers mys-
tiques. Autrement dit, en tant qu’ “entrepreneur de la guéri-
son”, le nganga, en cautionnant l’explication sorcellaire de la
maladie, confirme, et éventuellement exagère, la perception
d’un danger mystique omniprésent dans la vie publique et pri-
26 Pour l’analyse d’une « enquête » similaire, à travers laquelle le désorceleur
parvient à la désignation du sorcier dans le Bocage de l’Ouest français, on se
référera à Favret-Saada (2009 : 33-51). 27 Sans prétendre présenter ici la littérature sur le sujet, nous nous limiterons
à rappeler que la distinction entre soigner (curing) et guérir (healing) découle
de celle, tout aussi importante, entre disease et illness, le premier terme ren-
voyant à la dimension biologique de la maladie et à ses manifestations, et le
second à l’expérience subjective de souffrance du malade (Kleinman, Eisen-
berg & Good 1978 ; Kleinman 1980). Allan Young (1982) a repris et critiqué
cette dichotomie en introduisant la notion de sickness, qui désigne la produc-
tion sociale de la maladie et du savoir médical, en déplaçant ainsi l’attention
du rapport individuel entre le médecin et le patient à celui, plus large, des
valeurs et significations que chaque société attribue aux pathologies et aux
techniques des soins.
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 296
vée de nombreuses sociétés équatoriales. En outre, le carac-
tère secret et souvent initiatique de ses compétences rapproche
dangereusement le nganga de ces mêmes figures de sorciers qu’il
s’empresse de combattre. Bref, le nganga est fréquemment soup-
çonné de connivence avec le monde de la nuit auquel il dit
s’opposer (Augé 1974 : 57 ; 1975 : 89 ; Tonda 2000 : 49). Cer-
tains étudiants banguissois perçoivent le risque implicite dans le
mimétisme de l’ethos et des discours de la tradipratique :
« Ce que moi j’ai retenu, c’est que quand une maladie est déclen-
chée sur un plan spirituel, qu’on sait avec certitude qui en est
l’origine, que c’est la sorcellerie, la magie et tout ça, donc ceux qui
vont faire [intervenir] pour soigner cette personne ils sont encore
du domaine satanique ».
Avec l’évocation du “domaine satanique”, on assiste à un
dernier glissement discursif que l’on peut résumer comme suit :
du soin on passe à la guérison, et de la guérison à la guérison
divine, c’est-à-dire à « l’ensemble de pratiques et de représenta-
tions organisées dans les églises ou ailleurs autour du traitement
de l’infortune, du mal, du malheur (dont la maladie est une
forme), et dont les résultats sont mis sur le compte de la puis-
sance divine de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit » (Tonda 2002 :
18). C’est alors à l’étudiant qui a évoqué le “domaine satanique”
d’ajouter :
« Donc, comment régler le problème en tant que tel ? Mais c’est
seulement l’esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui peut gagner,
transformer la situation ! ».
Lorsque la guérison divine fait irruption dans le parcours
thérapeutique envisagé par ces étudiants, les soins médicaux
s’accompagnent de l’effort pour convertir le patient stigmatisé
comme “animiste” (voir l’étudiant qui nous a dit : « J’essaie de
lui expliquer dans ses termes que c’est mieux de croire en un
dieu unique »), pour lui montrer les bienfaits de la guérison par
la foi et, finalement, pour le baptiser (« Et s’il y a la possibilité
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 297
que moi même je puisse baptiser... »)28. Comme ailleurs en
Afri-que, à Bangui l’épanouissement des Églises indépendantes,
prophétiques et pentecôtistes entraîne l’expansion du champ de
la guérison divine (Cimpric 2009), « là où le charisme et les mi-
racles connaissent un véritable triomphe à répétition » (Bene-
duce 2010 : 109). La méfiance à l’égard de la tradipratique
s’inscrit dans la condamnation du passé et dans la rupture avec
la tradition (Meyer 1998 ; Fancello 2006 : 108 ; Tonda 2011 :
43), perçus comme des sources du fétichisme, de la sorcellerie
et des « sacrifices » auxquels certains étudiants font référence.
Si, dans le milieu des étudiants en médecine, ce genre de dis-
cours semble également destiné à élargir le capital sorcier (Ton-
da 2002 : 60) — c’est-à-dire, à accentuer la perception d’un
danger sorcellaire omniprésent et à reproduire la chaîne de
soupçons et d’accusations (voir aussi Cimpric 2009) — ici, nous
préférons revenir au contexte dans lequel nos entretiens ont été
recueillis, et aux contradictions avec lesquelles nos interlocu-
teurs s’efforcent de composer.
C’est le récit de vie de Jean-Pierre, qui assista à l’hôpital au
décès de son père et de son oncle, qui retient encore une fois
notre attention. Cet entretien — qui débutait par la stigmatisa-
tion des paysans, se poursuivait par un récit de vie pour se con-
clure, via l’argument culturaliste, sur une ouverture modérée à la
tradipratique et à la prise en compte des « choses spectacu-
laires » — est en effet l’un de ces récits exemplaires qui expose
dans « un schéma simple et uniforme »29 les caractéristiques
d’une maladie (éventuellement, d’origine sorcellaire) et l’itiné-
raire thérapeutique emprunté par le malade et ses parents. Lu-
dovic Lado (2009) a reconstitué l’« itinéraire médical » de cer-
28 C’est le même qui ajoute : « Quand on me montre un jeune en disant que
c’est un sorcier, moi je n’ai pas peur […]. Je vais l’orienter du côté spirituel,
qu’il aille à l’église qu’il préfère ». 29 L’expression est empruntée à Jeanne Favret-Saada, qui écrit à propos des
récits exemplaires : « Ces histoires de sorcellerie réduites à une démonstra-
tion éclatante de l’efficacité magique sont, comme toutes les histoires, faites
pour être dites et répétées » (2009 : 38).
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 298
tains patients camerounais qui, devant l’inefficacité d’une
hospitalisation ou d’un séjour chez des guérisseurs, ont fini par
s’adresser à Meinrad Hebga, fondateur du mouvement Ephpha-
ta. Après avoir analysé des extraits des lettres adressées à Heb-
ga, l’auteur écrit :
« when dealing with a serious biomedical disease, patients who can afford
modern medicine will first go to a hospital. It is when the hospital treatment
fails to satisfy them that they start suspecting that it may not be a « simple »
sickness. At this stage, it depends whether they are staunch Christians or not.
If they are, they will seek the prayers of a priest by having masses said for the
patient for example ; or they will consult a herbalist free from connections with
traditional rituals. If they are not staunch Christians, they may first go to a
diviner (marabout or guérisseur) before thinking of a priest » (ibid. : 63).
Un schéma similaire structure les récits de guérison les plus
communs, que celle-ci advienne par la voie « traditionnelle » ou
« divine » : l’insuccès des soins biomédicaux convainc le malade
et ses parents de s’adresser au nganga ou au pasteur auprès des-
quels ils espèrent finalement atteindre la guérison (pour le cas
Centrafricain, voir par exemple Cimpric 2009 : 202). André
Corten (1997) qui analyse la narration stéréotypée des témoi-
gnages à l’Église Universelle du Royaume de Dieu au Brésil,
parle à ce propos d’une véritable « dramatisation » du récit :
« Pour pouvoir aboutir à un véritable dénouement du type du
« miracle », il faut en effet une dramatisation de la phase anté-
rieure […] malgré les tentatives de solutions (opérations chirur-
gicales, traitement rigoureux, etc.), le mal qui dure déjà depuis
longtemps (dramatisation 10, 20, 30 ans !) continue » ; dans le
récit, un changement de l’état morbide se produit alors à partir
du moment où le malade décide d’aller à l’Église Universelle et
entre en contact avec le divin (ibid. : 286). Pour revenir à la tra-
dipratique au Cameroun, Roberto Beneduce a bien montré que
les récits des nganga et de leurs patients s’expriment dans un
registre épique : « Dans les scènes […] esquissées, la banalité de
[la] vie quotidienne et la répétition de leurs malheurs […] sont
projetées d’un coup dans un registre proprement épique, sur la
scène d’un théâtre où le mal n’est pas seulement cherché et
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 299
nommé, mais aussi convoqué, rendu présent, affronté »
(2010 : 120). Au regard de cette dramatisation des récits
d’itinéraires thérapeutiques, comment pouvons-nous interpréter
celui de Jean-Pierre ? Il s’agit selon nous d’un récit dont
l’exemplarité ne réside pas dans la solution du dilemme “méde-
cine conventionnelle versus tradipratique” : la mort des deux
malades à l’hôpital ainsi que les opinions de notre interlocuteur
sur la tradipratique invitent à nuancer l’interprétation dichoto-
mique de son récit. Il s’agit au contraire d’une narration exem-
plaire de l’ambiguïté que ressentent nos interlocuteurs à l’égard
du contexte socioculturel banguissois, celui-là même qu’ils re-
trouvent chaque jour après les cours à la FACSS et le travail à
l’hôpital. C’est ce que montre par exemple ce témoignage d’un
étudiant de 23 ans, au début de ses études de médecine :
« Ah bon, ça [le sujet de notre étude]… c’est une question
d’actualité ici, en ce sens qu’ici en Faculté on nous forme dans le
cadre de la médecine moderne. Et si c’est au niveau du quartier, là
maintenant nos parents essayent de nous former aussi dans le
cadre de la médecine traditionnelle ».
Dans l’interprétation que Jean-Pierre semble proposer, ce se-
rait la divergence d’opinions au sein de sa famille qui aurait en-
traîné ce “nomadisme thérapeutique” d’un guérisseur à l’autre,
avant qu’il ne soit trop tard et que son père et son oncle ne
succombent à l’hôpital. Dans ce récit exemplaire et atypique, le
cœur de la narration coïncide avec la dénonciation du différend
entre la tradipratique et la médecine conventionnelle, dont
l’ensemble des protagonistes de ces faits — les malades, leurs
familles, les guérisseurs et les médecins — semblent, en der-
nière instance, être les victimes. Si le renversement du schéma
thérapeutique qui débute par le soin médical et s’achève avec la
guérison traditionnelle ou divine s’accorde à la formation uni-
versitaire dans laquelle Jean-Pierre s’est engagé, la “non-
solution” du récit semble situer notre interlocuteur dans cet
entre-deux culturel que Joseph Tonda résume dans la notion de
« syndrome du prophète » (2001 ; 2002 : 99-122). Ce « syn-
drome » interviendrait pour combler des déficiences identitaires
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 300
et professionnelles ressenties par différentes figures du
champ de la guérison équatoriale, en promouvant le fusionne-
ment des registres religieux, magique et médical « envers et
contre les orthodoxies, et donc dans une perspective d’innovation
à l’intérieur du champ thérapeutique et religieux » (2002 : 104).
« Le médecin », poursuit Tonda, « n’est pas épargné par les pro-
cessus caractéristiques du syndrome du prophète » (ibid. : 118),
ce que certains de nos étudiants semblent en effet confirmer.
Dans une situation où le pouvoir de guérison déployé par le
dispositif biomédical rivalise quotidiennement avec d’autres
sources d’autorité médicale, la précarité professionnelle et iden-
titaire à laquelle les étudiants banguissois sont confrontés est un
indicateur précieux pour analyser la quête de sens qui accom-
pagne, chez les jeunes universitaires d’Afrique équatoriale,
l’expérience quotidienne de la maladie et de la mort — des col-
lègues, des amis, des parents et des patients. Tonda écrit du
reste à ce propos : « La quête de sens répond au besoin de certi-
tude que produit un monde social régi par l’incertitude,
l’anxiété, la fragilité des significations ou des connaissances en
concurrence exacerbée. Le choix d’un seul système de sens ou
cadre d’interprétation n’est pas facile, ni objectivement pos-
sible » (ibid. : 209). En Centrafrique, l’Université et les hôpitaux
sont le véritable théâtre qui accueille un drame moral, ainsi que
l’a écrit Byron Good (1998) à propos du milieu estudiantin et
médical américain. Dans les entretiens que nous avons analysés,
l’intrusion de la sphère intime et privée bouleverse l’ordre épis-
témologique et la routine de l’hôpital : les étudiants interviewés
dénoncent – éventuellement dans l’idiome de la sorcellerie et de
la guérison divine – les limites d’un apprentissage qui dédaigne
la persistance d’un sentiment religieux et d’une dimension mo-
rale (ou « sotériologique ») dans toute entreprise qui se veut
scientifique (Vidal 2004 : 104-107).
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 301
Conclusion
Nous avons essayé de montrer comment certains jeunes
étudiants de Bangui envisagent leur rapport aux étiologies de la
maladie et de la mort qui se réfèrent à la sorcellerie et à la mé-
tamorphose. Comme l’a rappelé Jean-Pierre Olivier de Sardan
(1992 ; 2010), l’attention accordée au répertoire de l’occulte en
Afrique risque d’entraîner l’analyse anthropologique vers une
dérive culturaliste qui exagère l’importance des croyances et
pratiques de l’invisible au détriment d’autres répertoires discur-
sifs et d’action. Sans prétendre trancher la question soulevée par
Olivier de Sardan, notre propos a été d’interroger les arguments
culturalistes tels qu’ils se présentent dans le milieu estudiantin
centrafricain30. Nous avons reconnu dans la rhétorique cultura-
liste et la stigmatisation du “paysan animiste” une valeur per-
formative qui permet aux étudiants banguissois de penser leur
rapport « avec l’institution biomédicale, c’est-à-dire [avec] la
connaissance scientifique qui la supporte, le pouvoir social
qu’elle implique et l’identité professionnelle qu’elle définit »
(Tonda 2002 : 99). Mais — pour parler comme Foucault (1971 :
12) — ce genre de discours est aussi frappé d’interdits qui
s’avèrent en fait intimement liés au désir et au pouvoir. Il s’agit
donc d’un discours traversé par des procédures d’exclusion et
par l’apparition de ces interdits — « On sait bien qu’on n’a pas
le droit de tout dire, qu’on ne peut pas parler de tout dans n’im-
porte quelle circonstance, que n’importe qui, enfin, ne peut pas
parler de n’importe quoi » (ibid. : 11) —, dont les étudiants ban-
guissois perçoivent toute la force contraignante et contre (ou
avec) lesquels ils s’efforcent de définir leur identité profession-
30 Tout en s’éloignant des postures culturalistes et essentialistes, Joseph
Tonda a récemment rappelé que les différences et inégalités dans l’accès aux
ressources du système capitaliste mondial alimentent « les idéologies cultura-
listes ou ethnocentristes à travers lesquelles “civilisés” et “autochtones”,
“évolués” et “indigènes”, “chrétiens” et “païens” se mystifient en mystifiant
les autres, se disqualifient en disqualifiant les autres, se déshumanisent en
déshumanisant les autres » (2011 : 44).
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 302
nelle, à l’hôpital, à la FACSS mais aussi “au quartier” et en
famille.
Comme l’écrit Jean-François Bayart, dans de nombreuses
sociétés africaines, la dimension de l’invisible « a toujours été
une “frontière” de choix sur laquelle s’effectuait l’innovation
culturelle, en relation avec le monde étranger » (1996 : 137)31.
En Centrafrique — où, comme en témoignent les quotidiens, se
succèderaient, aussi bien à Bangui que dans l’arrière-pays, des
faits divers de type mystique, et où les tribunaux n’hésitent pas à
infliger aux sorciers présumés de lourdes peines — le marché
des soins et de la guérison est l’un des lieux socioculturels où
cette confrontation avec l’« altérité » (des pratiques, des dis-
cours, des étiologies, etc.) demeure difficile et souvent conflic-
tuelle. Le registre de l’invisible, qu’il soit critiqué, refusé ou sté-
réotypé, permet aux jeunes apprentis médecins d’exprimer leurs
aspirations et d’apaiser l’angoisse ou la peur d’échouer dans leur
confrontation quotidienne avec ces “choses spectaculaires” que
sont les étiologies populaires de la maladie.
Andrea CERIANA MAYNERI
Postdoctoral fellow (FSR + Marie Curie actions)
Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP),
Bureau A386, Collège Jacques Leclercq
Université catholique Louvain,
1, Place Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)
Chercheur associé au CEMAf-Paris
Courriel : [email protected]
31 Nous renvoyons à Olivier de Sardan (2010 : 429-434) pour une discussion
de la position de J.-F. Bayart sur l’importance des phénomènes occultes dans
l’analyse des représentations et pratiques politiques en Afrique subsaha-
rienne.
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 303
Bibliographie
AUGÉ Marc (1974) « Les croyances à la sorcellerie », in Marc AUGÉ (dir.) La
construction du monde : religion, représentations, idéologie. Paris, Maspero, 52-73.
(« Dossiers africains »).
(1975) Théorie des pouvoirs et idéologie. Étude de cas en Côte-d’Ivoire. Paris, Her-
mann. XXIII-439 p. (« Savoir »).
(1976) « Savoir voir et savoir vivre : les croyances à la sorcellerie en Côte
d’Ivoire », Africa XVIL, 2 : 128-139.
AUGÉ Marc & COLLEYN Jean-Paul (1990) Nkpiti. La rancune et le prophète.
Paris, Éditions de l’EHESS, 87 p., pl. ill. (« Anthropologie visuelle », 2).
BARRY Christy et al., (2001) “Giving voice to lifeworld. More humane, more
effective medical care? A qualitative study of doctor-patient communica-
tion in general practice”, Social Science & Medicine 53 : 487-505.
BAYART Jean-François (1996) L’illusion identitaire. Paris, Fayard, 310 p.
(« L’espace du politique »).
BENEDUCE Roberto (2010) « Soigner l’incertitude au Cameroun. Le théâtre
épique du nganga face aux économies du miracle », in Ludovic LADO
(dir.) Le pluralisme médical en Afrique. Paris & Yaounde, Karthala &
UCAC : 101-131.
BENOIST Jean (1996) « Introduction : Singularités du pluriel ? », in Jean
BENOIST (dir.) Soigner au pluriel. Essais sur le pluralisme médical. Paris, Kar-
thala : 5-16.
BERNAULT Florence (2005) « Magie, sorcellerie et politique au Gabon et au
Congo-Brazzaville », in Marc MVÉ MBEKALE (dir.) Démocratie et mutations
culturelles en Afrique noire. Paris-Budapest-Torino, L’Harmattan : 21-39.
(2006) “Body, Power and Sacrifice in Equatorial Africa”, Journal of African
History 47 : 207-39.
(2009) « De la modernité comme impuissance. Fétichisme et crise du poli-
tique en Afrique équatoriale et ailleurs », Cahiers d’études africaines, 195, 3 :
747-774.
BERNAULT Florence & TONDA Joseph (2000) « Dynamiques de l’invisible
en Afrique », Politique africaine, 79 : 5-16.
CERIANA MAYNERI Andrea (2010) « La rhétorique de la dépossession. Ou l’imaginaire de la sorcellerie chez les Banda de la République centrafri-caine », Université Aix-Marseille 1, avril 2010, Thèse d’anthropologie cul-turelle, 458 p.
CIMPRIC Aleksandra (2009) « La violence anti-sorcellaire en Centrafrique »,
Afrique contemporaine, 232, 4 : 195-208.
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 304
COLLECTIF « Territoires sorciers » Cahiers d’Études africaines XLVIII (1-2),
189-190 : 381 p. (Numéro thématique coordonné par Christine HENRY
& Emmanuelle Kadya TALL)
CORTEN André (1997) « Miracles et obéissance. Le discours de la guérison
divine à l’Église Universelle », Social Compass 44, 2 : 283-303.
CRICK Malcolm (1976) “Recasting Witchcraft”, in Malcolm CRICK Explora-
tions in Language and Meaning. Towards a Semantic Anthropology. New York,
Wiley : 109-127.
(1979) “Anthropologists’ Witchcraft: Symbolically Defined or Analytically
Undone?”, Journal of the Anthropological Society of Oxford X, 3 : 139-146.
EVANS-PRITCHARD Edward E. (1931) “Mani, a Zande Secret Society”,
Sudan Notes and Records XIV, II : 105-148.
(1972) Sorcellerie, oracles et magie chez les Azandé. (Trad. Fr. Louis Evrard). Paris,
Gallimard, 637 p., ill. (« Bibliothèque de Sciences humaines »). [1re éd.
anglaise 1937].
FAINZANG Sylvie (1982) « La cure comme mythe : le traitement de la mala-
die et son idéologie à partir de quelques exemples ouest-africains », Ca-
hiers de l’ORSTOM XVIII, 4 : 415-423.
FANCELLO Sandra (2006) Les aventuriers du pentecôtisme ghanéen. Nation, conver-
sion et délivrance en Afrique de l’Ouest. Paris, Karthala-IRD, 378 p. (« Reli-
gions contemporaines »).
FASSIN Didier (1992) Pouvoir et maladie en Afrique : anthropologie sociale dans la
banlieue de Dakar. Paris, PUF, 359 p. (« Les champs de la Santé »).
FAVRET-SAADA Jeanne (2009) Désorceler. Paris, Éditions de l’Olivier, 172 p.
(« Penser/Rêver »).
FISIY Cyprian (1990) « Le monopole juridictionnel de l’État et le règlement
des affaires de sorcellerie au Cameroun », Politique africaine, 40 : 60-71.
FISIY Cyprian & GESCHIERE Peter (1990) “Judges and Witches, or How is
the State to Deal with Witchcraft? Examples from Southeast Came-
roon”, Cahiers d’Études africaines 30, 118 : 135-156.
FOUCAULT Michel (1971) L’ordre du discours. Paris, Gallimard, 88 p. (Coll.
« Blanche »).
GESCHIERE Peter (1995) Sorcellerie et Politique en Afrique. La viande des autres.
Paris, Karthala, 303 p. (« Les Afriques »).
(2000) « Sorcellerie et modernité : retour sur une étrange complicité », Poli-
tique africaine, 79 : 17-32.
(2006) “The State, Witchcraft and the Limits of the Law – Cameroon and
South Africa”, in Éric de ROSNY (dir.) Justice et Sorcellerie. Paris & Yaoun-
dé, Karthala & UCAC : 87-120.
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 305
GOOD Byron (1998) Comment faire de l’anthropologie médicale ? Médecine,
rationalité et vécu. Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo, 433 p. (« Les
empêcheurs de penser en rond »).
HERZFELD Michael (1992) « La pratique des stéréotypes », L’Homme XXII,
121 : 67-77.
JAFFRÉ Yannick & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre (2003) Une médecine
inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales
d’Afrique de l’Ouest. Marseille & Paris, APAD & Karthala, 464 p.
(« Hommes et sociétés »).
KLEINMAN Arthur (1980) Patients and Healers in the Context of Culture. An
Exploration in the Borderland between Anthropology, Medicine and Psychiatry.
Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 427 p.
KLEINMAN Arthur, EISENBERG Leon & BYRON Good (1978) “Culture,
Illness and Care. Clinical Lessons from Anthropologic and Cross-
cultural Research”, Annuals of Internal Medicine 88 : 251-58.
LADO Ludovic (2009) Catholic Pentecostalism and the Paradoxes of Africanization.
Processes of Localization in a Catholic Charismatic Movement in Cameroon. Lei-
den, Brill, VIII-245 p. (« Studies of Religion in Africa »).
LEANZA Yvan (2008) « La reconnaissance comme principe d’une éthique de
l’altérité », in Jean-Paul PAYET & Alain BATTEGAY (dir.) La reconnaissance
à l’épreuve. Explorations socio-anthropologiques. Villeneuve d’Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion : 133-140.
L’ESTOILE Benoît de (2000) « Science de l’homme et “domination ration-
nelle” : savoir ethnologique et politique indigène en Afrique équatoriale
française », Revue de synthèse, 3-4 : 291-323.
LÉVI-STRAUSS Claude (1958a) « Le sorcier et sa magie », in Claude LÉVI-
STRAUSS, Anthropologie structurale. Paris, Plon.
(1958b) « L’efficacité symbolique », in Claude LÉVI-STRAUSS, Anthropologie
structurale. Paris, Plon.
MARTINELLI, Bruno (1995) « Trames d’appartenances et chaînes d’identité.
Entre Dogons et Moose dans le Yatenga et la plaine du Séno (Burkina Fa-
so et Mali) », Cahiers des Sciences Humaines 31, 2 : 365-405.
MEYER Birgit (1998) “ ‘Make a Complete Break with the Past’. Memory and
Post-Colonial Modernity in Ghanaian Pentecostalist Discourse”, Journal
of Religion in Africa XXVIII, 3 : 316-349.
OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, (1992) “Occultism and the Ethnographic
“I”. The Exoticizing of Magic from Durkheim to Post-modern Anthro-
pology”, Critique of Anthropology 12, 1 : 5-25.
(2010) « Le culturalisme traditionaliste africaniste. Analyse d’une idéologie
scientifique », Cahiers d’Études africaines, 198-199-200 (L-2-3-4) : 419-453.
Psychopathologie africaine, 2009-2010, XXXV, 3 : 277-307. 306
RETEL-LAURENTIN Anne (1974) Sorcellerie et ordalies. L’épreuve du poison en
Afrique Noire. Essai sur le concept de négritude. Paris, Éditions Anthropos.
ROSNY, Éric de (1981) Les yeux de ma chèvre. Paris, Plon, 458 p. (Terre hu-
maine »).
(2006) (dir.) Justice et sorcellerie, Colloque international de Yaoundé, 17-19
mars 2005. Paris & Yaoundé, Karthala & Presses de l’UCAC, 383 p.
TALL Emmanuelle Kadya (1992) « L’anthropologue et le psychiatre face aux
médecines traditionnelles. Récit d’une expérience », Cahiers des Sciences
Humaines 28, 1 : 67-81.
TONDA Joseph (2000) « Capital sorcier et travail de Dieu », Politique africaine,
79 : 48-65.
(2001) « Le syndrome du prophète. Médecines africaines et précarités identi-
taires », Cahiers d’Études africaines, 161, 1 : 139-162.
(2002) La guérison divine en Afrique centrale (Congo, Gabon). Paris, Karthala.
(2011) « Pentecôtisme et “contentieux matériel” transnational en Afrique
centrale. La magie du système capitaliste », Social Compass 58, 1 : 42-60.
TURNER Victor (1964) “Witchcraft and Sorcery : Taxonomy versus Dyna-
mics”, Africa 34, 4 : 314-325.
VANSINA Jan (1990) Paths in the Rainforests. Toward a History of Political Tradi-
tion in Equatorial Africa. Madison, The University of Wisconsin Press,
428 p.
VIDAL Laurent (2004) Ritualités, santé et sida en Afrique. Pour une anthropologie du
singulier. Paris, Karthala-IRD, 209 p. (« Hommes et Sociétés »).
WHITE Luise (2000) Speaking with Vampires. Rumor and History in Colonial
Africa. Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 384 p.
(« Studies on the History of Society & Culture »).
YOUNG Allan (1982) “The Anthropologies of Illness and Sickness”, Annual
Review of Anthropology 11 : 257-285.
Andrea Ceriana Mayneri – Soigner, guérir, convertir (Bangui) 307
RÉSUMÉ :
En République centrafricaine, la biomédecine cohabite avec d’autres sources
d’autorité médicale. C’est le cas notamment des étiologies et des thérapies
« traditionnelles », qui ont souvent recours à des arguments mystiques dans
l’explication de la maladie et de l’infortune. Parmi les étudiants de la Faculté
des Sciences de la Santé de Bangui, les étiologies non-conventionnelles sont
à l’origine de profondes interrogations épistémologiques, qui engagent la
légitimité même de leur parcours d’études dans un contexte marqué par un
pluralisme thérapeutique. En s’intéressant aux opinions de certains de ces
étudiants, cet article met en exergue leurs inquiétudes de futurs médecins, et
analyse les stratégies discursives — notamment le glissement du registre
scientifique au récit de vie — au moyen desquelles ils s’efforcent de réinté-
grer des éléments étiologiques empruntés à la médecine non-conventionnelle
dans leur propre perception du métier de médecin.
Mots-clés : • République centrafricaine • Bangui • Biomédecine • Étudiants
• Sorcellerie • Guérison.
ABSTRACT: CURING, HEALING, CONVERTING.
MEDICAL STUDENTS FROM BANGUI (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC) AND THEIR RELATIONSHIP TO TRADITIONAL MEDICINE:
A DISCOURSE ANALYSIS.
In the Central African Republic biomedicine co-exists with other agencies of
medical authority, including “traditional” aetiologies and therapies who
often resort to mystical arguments in the explanation of illness and misfor-
tune. In fact, in Bangui, among students of the local Faculty of Health Sci-
ences, non-conventional aetiologies rise important questions about the le-
gitimacy of their career path in a context deeply marked by therapeutic plu-
ralism. This paper illustrates the personal opinions of some of these stu-
dents: it highlights concerns of future doctors, and analyses the discursive
strategies – including continuous shifts from scientific discourse to life sto-
ries – through which they try to recover some aetiological elements bor-
rowed from non-conventional medicines in their own perception of the
medical profession.
Keywords : • Central African Republic • Bangui • Biomedicine • Students
• Witchcraft • Healing.