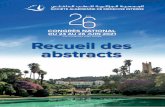L'épopée moderniste — Construction d'un imaginaire politique au Brésil (1917-1930)
'Les Mains d'Orlac' entre imaginaire, médecine et corps modifié
-
Upload
univ-lyon1 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of 'Les Mains d'Orlac' entre imaginaire, médecine et corps modifié
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
« LES MAINS D’ORLAC »ENTRE IMAGINAIRE, MÉDECINE
ET CORPS MODIFIÉ
Jérôme Goffette & Hugues Chabot
Maîtres de conférenceUniversité Lyon 1, Université de Lyon
Lab. d’Etude du Phénomène Scientifique (LEPS, EA 4148)
Les Mains d’Orlac de Maurice Renard est un curieux roman. Il commence dans le genre fantastique, avec son ambiance de spirites, de spectres et de décrochage du réel, puis se transforme en roman policier quand un inspecteur dévoile les supercheries, avant de se transformer en roman de science-fiction. Vu d’aujourd’hui, il serait même possible d’en faire un roman d’anticipation : la première double greffe de mains n’a-t-elle pas été réalisée le 13 janvier 2000 sous la direction du Pr. Jean-Michel Dubernard à l’Hôpital Edouard Herriot de Lyon ?1 M. Renard n’aurait fait qu’anticiper une prouesse technique et médicale qui devait ouvrir le troisième millénaire.
Pourtant, la situation est plus complexe qu’il n’y paraît. M. Renard lui-même ne conçoit pas sa littérature comme un travail d’anticipation dont le but serait de deviner ce qui sera techniquement possible dans le futur. Il n’a
1 Une première greffe de main avait déjà été réalisée par le Pr Dubernard en septembre 1998. Cette opération avait suscité nombre de critiques, car le receveur avait encore une main normale, ce qui lui permettait d’accomplir une grande partie des gestes quotidiens. Le rapport entre effets positifs et négatifs de la greffe était donc controversé : d’un côté l’apport d’une deuxième main, toutefois à peine fonctionnelle, d’autre part des traitements immunosuppresseurs avec de nombreux effets secondaires. De plus, l’intégration dans le schéma corporel et dans l’image de soi de cette main étrangère était une inconnue. De ce fait, l’indication médicale légitime pour la greffe de main a été par la suite restreinte à des patients ayant perdu leurs deux mains, ce qui fut réalisé pour la première fois en janvier 2000.
289
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
pas non plus pour but de faire une sorte de roman de la science, de fiction scientifique. L’appellation « science-fiction » (qui n’existait pas en 1920), si elle n’est pas fausse, ne dit rien de son but, qu’il a d’ailleurs expliqué dans un article de 1908 paru dans le journal Le Spectateur. Cet article, joint à la présente réédition des Mains d’Orlac, explique qu’il veut explorer le retentissement humain de situations nouvelles, dues à une innovation scientifique. Pour le dire en une formule, il veut rendre compte à la fois des effets de science et des effets de merveilleux. Il propose d’ailleurs un nom, le « merveilleux scientifique », pour ce nouveau genre littéraire dont à ses yeux les maîtres sont à son époque Herbert George Wells (La Machine à explorer le temps, L’Île du Dr Moreau, L’Homme invisible, etc.) et son ami Joseph-Henri Rosny aîné (La Guerre du feu, Les Xipéhuz, Un autre Monde), sans parler des auteurs déjà classiques que sont Edgar Alan Poe (La Vérité sur le cas de M. Valdemar) et Robert Louis Stevenson (L’étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde)2.
Le cas de la greffe de mains réalisé par l’équipe du Pr Dubernard montre cette conjonction du scientifique et du merveilleux. Si les journaux ont parlé de « L’homme à la main greffée » (Le Monde, Annick Cojean, 11 oct. 1998), ils eurent aussi d’autres mots, pétris d’inquiétude et d’enthousiasme. Dans une même édition du journal Le Monde, on trouve ainsi un article à cet intitulé inquiétant : « Le dépeçage des corps »3 et un autre comprenant cette phrase : « Une greffe totale de la main, un exploit inouï, vertigineux, insensé »4. De plus, ce dernier article pose quelques questions-clefs sur l’identité composite de la personne greffée, sur l’intégration psychologique d’un greffon si visible, si chargé de sens, de symboles et d’identité. N’est-on pas allé jusqu’à qualifier l’être humain d’Homo faber, ce qui, soit dit en passant, est plus juste que l’appellation officielle, Homo sapiens – l’homme étant si peu sage. Il y a donc bien quelque chose d’à la fois scientifique et merveilleux (au sens où cela suscite l’imagination) dans cette affaire de greffe de mains.
En fait, M. Renard, en 1920, à une époque où la technique n’était pas encore au point, lance un grand coup de sonde dans l’univers des
2 On aura bien sûr noté l’absence remarquable de Jules Verne. Selon M. Renard, son œuvre n’a pas sa place dans le registre littéraire qu’il cherche à caractériser : « Jules Verne n’a pas écrit une seule phrase de merveilleux-scientifique. De son temps, la science était grosse de certaines trouvailles ; il s’est borné à l’en croire accouchée, avant qu’elle ne le fût. Il a à peine anticipé sur des découvertes en germination. » (« Mer. Sc. », p. 1208-1209)
3 Jean-Yves Nau, Le Monde, 26 sept. 1998.4 Pierre Georges, Le Monde, 26 sept. 1998.
290
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
retentissements humains potentiels de cette opération. En poursuivant sa démarche, nous voudrions ici tenter de mieux appréhender ce qui se noue autour de ces mains, à la fois objets d’une technique chirurgicale et sujets d’une personne, amas de chair et vecteurs de gestes, anatomies savantes et représentations psychologiques et sociales.
Pour finir cette introduction, il faut rappeler que ce travail de Maurice Renard a fortement impressionné les décennies qui suivirent, non seulement en France mais aussi à l’étranger. En 1924, il fut porté une première fois à l’écran par l’autrichien Robert Wiene (Orlac’s Hände5) qui donne une touche expressionniste correspondant assez bien au roman. En 1929, une traduction anglaise est publiée. En 1935, aux Etats-Unis, Karl Freund le porte une seconde fois à l’écran sous le titre Mad Love6, qui deviendra un grand succès au point de faire désormais partie des classiques du cinéma d’horreur. Il sera une troisième fois porté à l’écran en 1961, en France, par Edmond T. Greville7 et avec des acteurs internationaux. Autant dire que le thème intrigue, fascine et se prête à des visions multiples, à des interprétations différentes, comme tous les grands récits. Il ne s’agit pas d’un mythe, comme Faust et ses innombrables versions, mais d’un véritable thème, susceptible d’être repris, resaisi, rejoué, comme celui de Frankenstein ou celui de Jekyll-Hyde, par exemple. En cela, il indique qu’il porte en lui une densité humaine et une tension dramatique qui font sa richesse et qui ne s’épuise pas. Même si la forme littéraire peut paraître un peu démodée, le thème en lui-même garde sa vivacité et son intérêt.
« L’application des méthodes scientifiques à l’étude compréhensive de l’inconnu et de l’incertain »
Commençons tout d’abord par regarder la façon dont M. Renard entend la scientificité, ainsi que la méthode d’exploration qu’il emploie.
Les philosophes qui reconnaissent un intérêt à la science-fiction mettent en avant la parenté de ses « protocoles d’expérimentation » avec les
5 Wiene (Robert) : Orlac’s Hände, film autrichien muet de 1924, 93 min., Production Pan-Film. Avec Conrad Veidt, Alexandra Sorina, Carmen Cartelieri.
6 Freund (Karl) : Mad Love, USA, Metro Goldwin Mayer, 1935, 68 min. Avec Peter Lorre, francis Drake, Colin Clive.
7 Gréville (Edmond T.) : Les Mains d’Orlac, France, SOVIC (Société Française des Studios de la Victorine), 1961, 105 min. Avec Mel Ferrer, Christopher Lee, Dany Carel.
291
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
« expériences de pensée » de la philosophie8. M. Renard s’inscrit dans cette proximité lorsqu’on lit son article. En effet, le merveilleux-scientifique est « le mode de la littérature contemporaine qui confine le plus à la philosophie – qui est la philosophie mise en scène, de la logique dramatisée » (« Mer. Sc. », p. 1207). Il résume en une formule le principe, la finalité et la méthode de ce nouveau genre :
« Le roman merveilleux-scientifique est une fiction qui a pour base un sophisme ; pour objet, d’amener le lecteur à une contemplation de l’univers plus proche de la vérité ; pour moyen l’application des méthodes scientifiques à l’étude compréhensive de l’inconnu et de l’incertain. » (« Mer. Sc. », p. 1213)
Le programme est ambitieux et de prime abord paradoxal. Comment peut-on prétendre tirer d’un sophisme une part de vérité ? Comment peut-on revendiquer d’appliquer les méthodes scientifiques à ce qui s’affiche comme de la fiction ? L’objectif est en fait de cultiver « l’intelligence du progrès » chez le lecteur et de le préparer aux découvertes futures. C’est à titre d’exercice de préparation à la science à venir que M. Renard justifie l’élaboration de récits qui mettent en scène des simulacres-simulations de recherche scientifique. Reconstituer « l’aventure d’une science poussée jusqu’à la merveille ou d’une merveille envisagée scientifiquement » (« Mer. Sc. », p. 1207) au moyen de « procédés de logique expérimentale » (« Mer. Sc. », p. 1205) suggère alors une analogie entre méthode scientifique et procédés du merveilleux-scientifique, même si M. Renard les distingue quant à leur valeur de vérité :
« Qu’est-ce qui distingue le raisonnement merveilleux-scientifique du raisonnement scientifique ? C’est l’introduction volontaire, dans la chaîne des propositions, d’un ou plusieurs éléments vicieux, de nature à déterminer, par la suite, l’apparition de l’être, ou de l’objet, ou du fait merveilleux. » (« Mer. Sc. », p. 1208)
En somme, il s’agit d’user d’un élément inexact ou incertain dans une logique juste. À part ce manque de fondement expérimental, les procédés exploratoires de l’écrivain miment donc les processus intellectuels de la création scientifique. M. Renard en propose trois :
1. « admettre comme certitudes [des] hypothèses scientifiques, et en déduire
8 Nous renvoyons au travail pionnier de Guy Lardreau, Fictions philosophiques et science-fiction, Arles, Actes Sud, 1988, ainsi qu’à une contribution d’Isabelle Stengers, « Science-fiction et expérimentation », dans Gilbert Hottois (dir.), Philosophie et science-fiction, Paris, Vrin, 2000, pp. 95-113. L’ouvrage collectif intitulé Matrix machine philosophique, Paris, Ellipses, 2003, et l’essai de Gilbert Hottois, Species Technica, Paris, Vrin, 2002, mobilisent eux aussi la science-fiction comme outil philosophique.
292
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
les conséquences de droit » ;
2. « confondre deux notions : prêter à l’une certaines propriétés de l’autre, subterfuge qui nous permettra d’appliquer à la première tel système d’investigation en réalité impraticable mais qui nous aidera à solutionner un problème en le supposant résolu » ;
3. « appliquer des méthodes d’exploration scientifique à des objets, des êtres ou des phénomènes créés dans l’inconnu par des moyens rationnels d’analogie et de calcul, par des présomptions logiques » (« Mer. Sc. », p.1208).
Chacun de ces trois subterfuges mêle une part de rationalité (déduire les conséquences logiques, appliquer tel système d’investigation, appliquer des méthodes d’exploration scientifique) et une part d’imagination (admettre comme certitudes des hypothèses, confondre deux notions, créer dans l’inconnu). Cette mixité du scientifique et du merveilleux est au cœur de la démarche d’invention du romancier, mais aussi de celle prêtée au chercheur : ces conjectures élevées au rang de certitudes, ces transferts de propriétés connues à des objets qui leur sont étrangers, ces créations ex nihilo par l’analogie, le calcul ou le raisonnement, sont leur œuvre par procuration. Nous pouvons montrer ici comment Les Mains d’Orlac utilisent deux de ces procédés.
« Admettre comme certitudes des hypothèses scientifiques »
Le premier procédé est manifeste : le romancier admet comme techniquement possible la greffe de main à l’époque où il écrit son roman. Il s’agit là d’une hypothèse de faisabilité, pour laquelle aucune certitude scientifique, expérimentale, n’existe alors.
L’exemple des greffes végétales
La vraisemblance du pari n’est toutefois pas saugrenue9. Le thème choisi par M. Renard est lui-même significatif. Les Mains d’Orlac est le roman merveilleux-scientifique de la greffe. En la matière, M. Renard prend assise sur la solide expérience acquise dès son époque en matière de greffe végétale. En 1920, l’Europe était encore sous le coup de la destruction des vignobles par le phylloxera, dont les premières manifestations remontaient à 1863. De nombreux traitements chimiques avaient été essayés, mais le seul véritable moyen de sauver les cépages avait été le recours systématique à la greffe, en
9 Contrairement au sujet apparent et trompeur du roman, le spiritisme , où le facétieux le dispute à l’inquiétant : « Le spiritisme est fait de saugrenu, avec un peu de mystérieux » (MdO, p. 577).
293
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
implantant un greffon sur un porte-greffe de vigne américaine résistante à l’insecte ravageur. Dans le domaine horticole, la greffe est en fait une technique connue depuis l’Antiquité, permettant d’associer la qualité d’un greffon à la vigueur d’un porte-greffe. L’ouvrage de Charles Baltet, L’art de greffer (1868), a historiquement marqué la maturité de cette technique, et le phylloxera en a systématisé l’application. Ainsi, au début du XXe siècle, la greffe pouvait paraître une voie particulièrement prometteuse. M. Renard avait d’ailleurs publié en 1909 son premier roman, magnifique, Le Dr Lerne, sous-dieu10, sur ce thème de l’hybridation et de la greffe, mettant en scène des greffes entre espèces, et même une des premières figures de cyborg. En même temps, loin de la littérature, toutes les tentatives sur l’animal, hormis quelques greffes osseuses ou dentaires, s’étaient soldées par des échecs. Dans Les Mains d’Orlac, M. Renard transformait donc de nouveau l’hypothèse de greffe d’organe humaine en une certitude. Le pari était moins hardi que celui du Dr Lerne, se contentant ici de greffe humaine, mais il approfondit assez minutieusement l’exploration des répercussions humaines.
L’essor de la chirurgie
Le second terrain scientifique sur lequel il s’est appuyé est sans conteste l’essor de la chirurgie. Grâce au travaux de Louis Pasteur contre la théorie de la génération spontanée, de Joseph Lister sur l’antisepsie en chirurgie, grâce aussi à l’invention des anesthésiques (anesthésie au chloroforme, 1847, Sir James Young Thompson), la chirurgie avait cessé d’être une technique d’ultime recours, avec d’abominables douleurs opératoires et une mortalité post-opératoire très élevée. En 1920, c’était l’image d’une technique d’avant-garde, risquée, audacieuse, mais aussi porteuse de grandes réussites. D’où cette figure du chirurgien qu’on trouve dans le roman :
« Le docteur Cerral était l’as de la chirurgie. Sa célébrité s’étendait sur tout le globe. Chacun connaissait la vie de ce Français génial, révélé à l’admiration du monde par la lutte triomphale contre les plus affreux ravages des engins meurtriers, et, depuis lors, continuant, rue Galilée, dans sa clinique, les merveilleuses prouesses qui lui valaient chaque jour plus d’honneurs et plus de reconnaissance. » (MdO, p.42)*
Ou encore, un peu plus loin, plus proche encore des devises gravées sur les frontispices ou des distinctions honorifiques :
10 Renard (Maurice) : Le Dr Lerne, sous-dieu, Paris, Société du Mercure de France, 1908. Réédité plusieurs fois.
* La pagination indiquée correspond à la dernière édition française des Mains d’Orlac : Les Moutons Electriques Editeur, Lyon, 2008.
294
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
« Cerral. Ses yeux clairs sont des miroirs de loyauté. Les statues qu’on lui érigera sur les places publiques n’auront pas la prestance de sa personne. On cherche un socle sous ses pieds. Et qui verrait ce socle, y lirait se trionyme : Savoir, Puissance, Bonté. » (MdO, p.76)
Le Dr Cerral, après l’apocalypse de la première guerre mondiale, ses millions de morts et ses figures de « gueules cassées », est ainsi présenté comme un sauveur de vie, un bienfaiteur de l’humanité, mais aussi un révolutionnaire de la science (allusion à Galilée). La science médicale, œuvre de vie, contrebalance ici la science militaire, convoyeuse de morts. De plus, cette science chirurgicale paraît si brillante, si inespérée, que Cerral est un personnage presque statufié de son vivant. M. Renard ne le peint-il pas ainsi :
« Il était grand, svelte, sportif, avec un torse d’athlète et un visage de statue étrangement pur et froid. [...] Le surhomme blanc s’avançait » (MdO, pp. 44).
La chirurgie est ici doublement prestigieuse : prestige merveilleux de sauver des vies, prestige (prestidigitation) technique de la virtuosité manuelle de l’homme de l’art. On peut noter à ce propos que bien des éléments de ce merveilleux-scientifique se retrouvent dans les greffes de mains réelles du Pr Dubernard. Les deux figures, celle du roman et celle du réel sont des figures hors normes, des personnages-personnalités. Les deux sont aussi des figures qui, bien que plutôt oritentées vers la blancheur du bien – qui est aussi la blancheur médicale de la pureté et de l’hygiène – sont des figures controversées. Voici la double face de la réputation de Cerral telle qu’elle apparaît dans un dialogue entre Rosine et de Crochans :
« – Il peut guérir par des moyens effrayants. [...]
– Ma petite Rosine, ne prononcez pas des paroles dont vous vous repentiriez aussitôt ! [...]
– Vous n’empêcherez pas que cette maison n’ait abrité des choses...
– Presque miraculeuses ! dit M. de Crochans. Et c’est fort heureux pour Stéphen, dont le cas me paraît plutôt grave ! Oui : presque miraculeuses. Des choses qui auraient effrayé les vieux alchimistes et les sorciers d’antan, au fond de leurs caves pleines de cornues et de chauves-souris. Des choses presque divines et pourtant bien réelles !... Mais cette maison est celle de la bienfaisance [...]. C’est ici même que se tient l’homme des découvertes, celui qui le premier tenta ce que tous les autres pratiquent à son exemple, celui dont la dextérité professionnelle lui permet de guérir là où d’autres échoueraient. Et c’est cela qui donne à sa clinique un prestige aussi formidable ! » (MdO, p.65)
En fait, le roman merveilleux-scientifique, de même que le chirurgien tentant une grande première, sont des franchisseurs de seuil : à l’un le seuil de la projection d’imagination, de l’expérience de pensée, à l’autre le seuil de la
295
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
réalisation inédite, de la prouesse novatrice. D’où cette proximité de regards portés sur Cerral et sur Dubernard. D’où aussi la proximité que ces franchisseurs de seuil entretiennent avec les frontières vers l’irréel, vers le rêve dans le cas du Pr Dubernard, vers la magie, le miracle, voire l’abomination dans le cas des romans de M. Renard. La nature hésite à être surnaturée ou dénaturée – l’humanité hésite devant un seuil qui peut aussi bien être celui conduisant au divin qu’au diabolique, à la sainteté qu’à la barbarie. Dans un ouvrage collectif, le titre du texte du Pr Dubernard est en soi une illustration : « La greffe de mains : du rêve à la réalité »11 et le Pr. Jacques Petit, qui présente le texte, rappelle qu’à Florence on trouve déjà une fresque de Fra Angelico où Saint Côme et Saint Damien procèdent à une greffe de membre. Il insiste sur l’audace de J.-M. Dubernard : « [il va vous présenter] ce qu’il a osé faire. Je dis bien ‘osé faire’, comme Christian Cabrol avait osé sa première transplantation cardiaque ». Il s’agit donc bien de mythes, de rêves et de toute une tradition d’hommes qui osent.
Un modèle de chirurgien scientifique
A l’époque du roman, l’essor de la chirurgie, en France, est marqué par une personnalité scientifique. En 1912, le prix Nobel de physiologie et de médecine avait été décerné à Alexis Carrel pour ses travaux de chirurgie thoracique et de culture de tissus. Ce brillant médecin scientifique développait de nouvelles techniques de sutures vasculaires et de transplantation d’organes, qui sont encore aujourd’hui rappelées sur le site internet de l’Académie Nobel. On peut affirmer sans trop de risque que Carrel et le modèle de Cerral. La proximité des noms – il suffit de permuter les voyelles – ne laisse aucun doute.
L’importance de l’apport d’Alexis Carrel est si manifeste que le Pr. Dubernard rappellera sa dette à son égard et prononcera un vibrant éloge de son devancier, alors même qu’évoquer Carrel fait aujourd’hui problème12
du fait de ses positions eugénistes des années 1930 et 194013 (en 1941, le
11 Jean-Michel Dubernard : « La greffe de membre : du rêve à la réalité », p. 131, in Jean-Charles Boulanger Plus tôt que la vie, plutôt que la mort, John Libbey, 2001.
12 Alexis Carrel est d’origine lyonnaise, si bien qu’une des facultés de médecine de cette ville a porté pendant longtemps son nom. Suite à une controverse à rebondissements, où l’emportaient tantôt les réels apports scientifiques et tantôt l’indignation contre l’eugénisme de Carrel, le changement de nom a été décidé (1996). Elle s’appelle aujourd’hui Faculté de Médecine R. T. H. Laennec (Université Lyon 1 Claude Bernard).
13 Pour découvrir son projet eugéniste, il suffit de lire le chapitre 8 de l’ouvrage d’Alexis Carrel : L’homme cet inconnu, Plon, 1935 (dernière réédition : 1997). Le racisme exacerbé à l’encontre des
296
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
maréchal Pétain le nomme directeur de la « Fondation française pour l’étude des problèmes humains », dont l’activité avait entre autres une visée eugéniste). En somme, on trouve dans la personne de Carrel une sorte d’origine commune au Cerral des Mains d’Orlac et aux greffes de mains du Pr. Dubernard. Le premier est une transposition analogique de Carrel, un Carrel de roman, médecin scientifique porté un cran plus loin, dont le chemin se poursuit imaginairement, le second est effectivement dans la filiation scientifique des travaux de Carrel, avec, entre temps, l’apport de l’immunologie moderne des années 1960 et des traitements immunosuppresseurs pour maîtriser le phénomène de rejet du greffon.
M. Renard devait donc avoir à l’esprit ces techniques de chirurgie vasculaire, et il ne lui fallait guère d’imagination pour faire de l’hypothèse de la greffe une certitude romanesque. En même temps, il reprend un phénomène culturel à l’existence bien réelle, la vogue du spiritisme, dont il joue pour obtenir un effet de vraisemblance humaine et sociale. Les Mains d’Orlac paraît à une date charnière dans la réception du spiritisme. Les premières manifestations de tables tournantes remontent à l’orée des années 1850. Les investigations expérimentales menées sur des médiums par des savants de renom – par exemple William Crookes en Angleterre dans les années 1870, et Charles Richet (autre médecin, prix Nobel et eugéniste) en France de 1905 à 1907 – connaissent un large écho médiatique et suscitent un fort intérêt, scientifique et public, comme en témoigne l’ouvrage de synthèse que publie Camille Flammarion (Les Forces naturelles inconnues, 1907). Pourtant, la situation du spiritisme bascule dans les années 1910-1930. Les fraudes médiumniques sont démontées publiquement, en particulier par des prestidigitateurs14. L’intrigue des Mains d’Orlac accompagne, et précède pour une part, le discrédit du spiritisme et son exclusion du champ scientifique. Mais M. Renard ne se contente pas de se faire l’écho d’un contexte culturel. Il le fait résonner en contrepoint avec son modèle du merveilleux-scientifique appliqué à la chirurgie. À travers sa démystification,
ouvriers, des malades mentaux, des handicapés, ainsi que le sexisme à l’égard des femmes et l’adulation de la noblesse, sont exprimés ouvertement. En 1936, dans la préface à l’édition allemande, il déclara son soutien à la politique nazie. Mélange de modernisme des moyens techniques, d’idéologie réactionnaire et de programme d’amélioration de l’espèce humaine calqué sur la zootechnie (stérilisation des « tarés », reproduction favorisée des individus valorisés), le projet de Carrel fait frémir.
14 Pour un tour d’horizon de ces épisodes fascinants de l’histoire sociale et culturelle des sciences au tournant du XX
e
siècle en France, nous renvoyons aux contributions rassemblées par Bernadette Bensaude-Vincent et Christine Blondel, Des Savants face à l’occulte, 1870-1940, Paris, La Découverte, 2002.
297
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
le spiritisme joue en effet le rôle de faire-valoir pour la mystification littéraire au cœur du roman : celle de la prouesse scientifique de la greffe « admise comme certitude ».
« Des phénomènes créés dans l’inconnu par des moyens rationnels d’analogie et de calcul, par des présomptions logiques »
Si le second procédé du merveilleux-scientifique identifié par M. Renard – « confondre deux notions » pour résoudre en apparence un problème – est peu utilisé dans Les Mains d’Orlac, le troisième est bien présent : « appliquer des méthodes d’exploration scientifique à des objets, des êtres ou des phénomènes créés dans l’inconnu par des moyens rationnels d’analogie et de calcul, par des présomptions logiques » (« Mer. Sc. », p.1208).
Le romancier se trouve confronté à une innovation radicale – la double greffe de mains. Face à ce que pourrait sentir, ressentir et penser l’individu greffé, il se trouve donc devant une situation tout à fait inconnue. Pour en renforcer la portée, il a choisi pour héros un pianiste virtuose, dont les mains sont des atouts essentiels. Comment imaginer, de façon vraisemblable, ce qui se passerait pour un tel patient ? M. Renard utilise ici à la fois l’analogie et la présomption logique.
Pour rendre compte de sa réponse, nous pouvons reprendre la typologie des facettes du corps que nous avons développée par ailleurs15, à savoir la distinction entre corps senti, corps approprié, corps affectif et corps pensé et représenté (conceptions du corps).
Greffe de mains et corps senti
Par corps senti, nous entendons l’ensemble des perceptions du corps. Ce sont les données sensorielles brutes que nous avons de notre corps. A cet égard, M. Renard n’est guère bavard. On ne sais trop ce que sent Stéphen Orlac, mais la sensibilité des mains semble avoir été atteinte et nécessiter un travail de restauration. Stéphen, tout à son projet de reconquête de sa virtuosité, entreprend de front le travail de sa dextérité et la renaissance de sa
15 Goffette (Jérôme) : article « Corps », in Bagros P., Le Faou A.-L., Lemoine M., Rousset H., de Toffol B. (dir.) : ABCDaire de science humaines et sociales en médecine, Paris, Ellipses, 2004, pp. 46-47.Goffette (Jérôme) : « Le corps et la présence humaine : de la psychogenèse du corps à la relation de soin avec la personne handicapée », in Association InterMas Rhône-Alpes, Actes du Troisième Colloque InterMas : Corps... Accords, (2008, à paraître).
298
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
sensibilité manuelle. Mademoiselle Yamanchi, masseuse nippone, apporte son savoir-faire professionnel :
« Tour à tour, les mains de Stéphen furent étalées [sur le coussin de velours], sur la paume, sur le dos, et longuement subirent l’onction des huiles, l’attouchement subtil des doigts, les repassages des fers chauds, le martellement des trembleurs, les claques, les caresses, les chatouilles et les pichenettes d’instruments si ingénieux et maniés avec tant d’agilité que Stéphen n’en pouvait croire ses sens éberlués. » (MdO, p.101)
Puis vient une manucure experte, recommandée par une harpiste :« Stéphen connut avec elle les picotements de l’épilation, la tiédeur parfumée des bains émollients, le supplice du repoussage. Ses ongles, rognés dextrement [...] devinrent sous la lime des festons impeccables. Il les sentit, pâteux de rouge, s’échauffer au frottement du polissoir, puis se glacer sous une couche de vernis. » (MdO, p.101).
On imagine, à travers ces descriptions, l’état de raideur et d’insensibilité partielle des mains du pianiste. On imagine le travail à accomplir pour amener de nouveau la peau rougeâtre de ses mains – griffées de multiples blessures – vers une apparence plus normale. On ne peut s’empêcher de penser que la greffe, bien que techniquement réussie, oppose encore des problèmes de micro-circulation sanguine dus aux sutures, au tissus cicatriciel, etc. Il faut du temps pour que l’organisme retrouve ou mette en place une circulation satisfaisante, non seulement dans les veines et les artères les plus importantes, mais aussi dans le fin réseau de veinules, d’artérioles et de capillaires qui a subi de plein fouet l’aboutement d’une main sur un poignet qui ne lui correspond qu’imparfaitement. M. Renard passe sous silence les détails techniques, mais il les avait vraisemblablement à l’esprit avec le modèle d’Alexis Carrel.
En revanche, la question des nerfs devait être plus épineuse. La transmission de l’influx nerveux était déjà bien connue, mais la connexion nerveuse entre greffon et membre n’était pas maîtrisée. M. Renard la suppose donc acquise, à la façon des techniques d’aboutement vasculaire (analogie) bien qu’avec un degré de difficulté supérieur.
Sur le modèle de cette circulation sanguine à rétablir plus complètement, il imagine ainsi une sensibilité tactile et proprioceptive fonctionnelle, mais altérée. On imagine la sensation des doigts gourds et raides cédant place, peu à peu, dans la profondeur des articulations et des muscles lésés, à une souplesse plus habituelle. A la manucure le travail de surface, à la masseuse le travail en profondeur. Mais tout cela, tout ce travail sur la sensibilité
299
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
corporelle et l’aspect « matériel » n’est que le préambule à ce qu’on appellerait aujourd’hui un travail de psychomotricité.
Greffe de mains et appropriation corporelle
Nous rencontrons ici la seconde facette du corps, à savoir celle du corps approprié16. Celle-ci correspond à la façon dont nous habitons notre corps, dont nous nous approprions notre corps, dont nous transformons la motricité en geste, c’est-à-dire en une volonté qui traverse le corps et le meut, sans avoir à y penser. Naturellement, une telle fluidité gestuelle n’est pas innée. Elle provient d’un apprentissage, parfois long et ardu, qui, d’abord permet le geste maladroit, puis va vers l’habileté jusqu’à atteindre, parfois, la virtuosité corporelle. A cet égard, le cas du pianiste Stéphen Orlac est exemplaire : il sait combien il faut exercer son corps pour parvenir à le « transcender », jusqu’à cet état où le pianiste n’a même plus conscience de l’effort physique et peut concentrer son attention sur le style et l’expressivité du morceau qu’il interprète. Stéphen est un travailleur du corps approprié. Il sait à quel point l’apprentissage de l’appropriation corporelle doit être minutieux et constamment poursuivi pour garder le niveau du virtuose. Non seulement il s’agit de s’approprier ses bras et ses mains, mais aussi, comme avec tout apprentissage d’un outil, de s’approprier l’instrument. Le geste ne s’arrête pas au bout des doigts ; il se prolonge jusqu’au son, jusqu’à la phrase musicale. Dans le geste du jeu, le pianiste virtuose n’a plus vraiment conscience de frapper des doigts sur des touches ; sa conscience est dans le son, dans la mélodie, dans l’expression. L’instrument piano, pour ce qui est de cette coordination psychisme-musique, est devenu un élément de son corps. Rosine, son épouse, l’exprime dans cette image :
« Stéphen au piano !... Il n’est vraiment lui-même qu’à cette place, ajusté à l’objet merveilleux, comme une pièce humaine habilement conçue ! » (MdO, p.91).
16 Nous nous inspirons ici des ouvrages suivants :Wallon (Henri) : Les origine du caractère chez l’enfant, Paris, PUF, 1949. La deuxième partie, « Conscience et individualisation du corps propre » reprend un article paru en nov.-déc. 1931 dans le Journal de Psychologie.Lhermitte (Jean) : L’image de notre corps, Paris, Nouvelle Revue Critique, 1939 (réédition : L’Harmattan, 1998).Schilder (Paul) : L’image du corps. Etude des forces constructives de la psyché (1935), Paris, Gallimard, 1968.Husserl (Edmund), Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pures, Livre second : Recherches phénoménologiques pour la constitution, Deuxième section, Paris, PUF, 1996.Merleau-Ponty (Maurice) : Phénoménologie de la perception, partie 1, Paris, Gallimard, 1945.
300
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
Voici donc Stéphen perçu comme un prolongement du piano, instrument lui-même anthropomorphisé au point d’avoir sa propre existence et sa propre volonté : image d’un geste qui traverse l’instrument pour exprimer son âme : une mélodie. C’est peu ou prou une figure de cyborg, une figure d’hybridation homme-machine, bien qu’éloignée des représentations contemporaines. L’essentiel est ici l’expression, l’attention toute entière immergée dans la musique. Stéphen, porté par ses souvenirs et ses habitudes de virtuose, se sent prêt à s’y laisser porter, si ce n’est que la raideur de ses mains lésées rompt le charme et tord le geste. Ses mains, parce qu’elles sont mutilées, se rappellent dramatiquement à lui :
« La Fantaisie [de Liszt] est là ; elle s’est avancée derrière le silence, prête à bondir, à tournoyer, dansante et magnifique, folle et divine. Stéphen la sent à fleur de chair, qui veut s’échapper de ses mains. Rosine l’entend déjà. Les mains d’Orlac s’élancent !... Il n’y a plus là le pianiste illuminé qui se dispose à attaquer brillamment la Fantaisie hongroise de Liszt pour piano et orchestre. Il n’y a plus qu’un homme qui pleure dans les bras d’une femme douloureuse. » (MdO, p.91)
L’effort de Stéphen serait désespéré s’il n’avait pas encore ce désir de redevenir pianiste, de redevenir ce qu’il est. C’est bien d’un travail, au sens contemporain, dont il s’agit, une tâche faite de peine et de souffrance pour parvenir à un résultat :
« Les avez-vous assez travaillées, pour leur faire perdre tout souvenir de leur ancien propriétaire, pour vous les approprier et tâcher de les façonner à la ressemblance de vos mains mortes ! Les avez-vous assez bichonnées, entraînées ! » (MdO, p.236)
Greffe de mains et corps affectif, ainsi que corps pensé et représenté
Dès lors, on conçoit à quel point l’accident est pour Stéphen un événement traumatique. La troisième des facettes du corps, le corps affectif, est massivement présente et, dans l’analyse, elle doit être associée à la quatrième, celle du corps comme concept ou représentation. Il y a, d’une part, la répugnance face à ces mains rougeâtres et malades, qui introduit une affectivité douloureuse là où, naguère, il n’y avait que l’aristocratique distinction de mains fines et élégantes. Mais, d’autre part, il se sent oppressé par la terrible pensée que ce ne sont pas ses mains. A la fin du roman, on apprend ce dont on se doutait : Cerral a dut l’amputer et lui greffer d’autres mains :
« Mme Orlac téléphone : ‘Sauvez ses mains, docteur, c’est le virtuose Stéphen Orlac !’ […] Cerral médite. [...] il pense à la greffe humaine ! il faudrait, sur
301
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
vos poignets, à la place de vos mains broyées, greffer deux mains neuves, saines, coupées à un vivant ou bien à un mort qui vient de mourir, ou bien encore conservée en bocal, baignant dans un liquide physiologique, de Rintgen ou autre... » (MdO, pp. 234-235)
Il y a donc le premier effroi, celui de l’image de ses mains réduites en bouillie par l’accident, et le second, celui d’avoir désormais des mains issues d’un cadavre, des mains portant le signe de la mort, des mains issues d’un tour de passe-passe scientifique avec la mort (Alexis Carrel s’était aussi rendu célèbre en faisant vivre in vitro pendant plus de deux décennies un cœur de poulet dans un milieu nutritif). Stéphen est hanté par la mort.
Mais il y a plus encore – une autre mort et une autre horreur :« [Cerral] ne vous a-t-il pas dit que désormais vous auriez, au bout de vos bras, des mains d’assassin ? [...] Ces mains de meurtrier qui avaient poignardé une femme, un vieillard et une petite fille ! » (MdO, p.236)
Le conflit d’identité, là encore, est porté à l’extrême par le romancier, qui a choisi pour mains greffées les mains d’un criminel (du moins jusqu’au chapitre final, où l’on apprend que le guillotiné était en fait innocent). On sait à quel point la greffe d’organe chahute ces conceptions de l’identité. Le récit-méditation autobiographique de Jean-Luc Nancy17, philosophe greffé du cœur, montre les relations complexes qu’il peut entretenir avec son cœur greffé, venu d’un autre, menacé sans arrêt de rejet, mais en même temps organe qui, parce qu’il lui a permis de vivre, lui est cher – un cœur entre accord et discorde. La situation d’Orlac, à cet égard, est une expérience de pensée sur le vécu identitaire et affectif d’un hypothétique greffé de la main – une expérience de pensée qui, par bien des traits, est une présomption rationnelle, comme on peut s’en apercevoir aujourd’hui.
Orlac est en proie à un tiraillement extrême. Lui qui ne vivait que par ses mains, lui dont les mains étaient à la fois l’outil de travail, l’élément de cristallisation de son identité et l’emblème symbolique, se retrouve avec des mains malhabiles, des mains étrangères, des mains criminelles. Réalisé en 1924, le film de Robert Wiene18 exprime exactement cette tension lorsque Stéphen s’exclame : « Mains maudites ! ». Peu avant, Stéphen, pensant à sa douce Rosine et à ces mains tueuses, murmure avec effroi, pour lui-même, l’impossibilité affective de poser ses objets impurs et menaçants sur le corps
17 Nancy (Jean-Luc) : L’Intrus, Paris, Edition Galilée, 2000.18 Wiene (Robert) : Orlac’s Hände, film autrichien muet de 1924, 1h33, Production Pan-Film. Le
passage concerné se situe à la 40ème minute.
302
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
de son aimée : « jamais plus ces mains ne toucheront quelqu’un ! »19. Dans le roman, l’élaboration psychique de cette situation rend compte de cette tension radicale :
« Depuis le jour [où Cerral vous a dit d’où venaient vos mains], quelle torture ! Quelle obsession, favorisée par la faiblesse de votre cerveau, si gravement atteint, et par cette nervosité qui vous est naturelle !... Vous n’avez plus pensé qu’à faire de vos secondes mains des mains d’artiste et d’honnête homme, à les naturaliser orlaciennes, ces intruses, ces réfugiées, ces parasites si nécessaires ! [...] Vous les aviez en horreur ! » (MdO, p. 236)
« Naturaliser », c’est bien de cela dont il s’agit, comme lorsqu’une personne étrangère se voit conférer une nouvelle identité nationale : faire que des étrangères soient désormais des membres de la famille, des familières. Mais il y a, dans le jeu psychologique d’Orlac, une dialectique pathétique : au lieu d’aborder la chose de façon pragmatique, en artisan, il l’aborde de façon affective et sensible, en artiste. Il est horrifié de ces mains d’assassin et c’est sur cette horreur qu’il bâtit son travail. Il lutte contre elles plutôt que de s’entretenir avec elles. Et plus il lutte, plus il les construit conceptuellement et symboliquement comme des ennemies. La tension atteint son comble dans le dernier chapitre, au moment où il s’apprête, par un élan irrépressible, à les brûler sur le poêle d’un bistrot, geste de guerre interrompu juste à temps par l’inspecteur Cointre, qui lui révèle alors que ces mains n’ont jamais tué, qu’elles sont les mains d’un innocent condamné à tort.
Nous ne savons rien de la suite, de ce que peut devenir Stéphen Orlac avec ces mains dévoilées, réhabilitées. Ce ne sont plus des mains d’assassin et de brute maniant « le surin », mais des mains d’innocent et d’horloger. Symboliquement, ce sont donc des mains pures. Identitairement, ce sont des mains habituées à un métier de dextérité et d’adresse. Il est ainsi probable que Stéphen Orlac, vis-à-vis de ces mains, puisse quitter le paradigme de la guerre pour entrer dans celui de la co-construction et de l’adoption, de la conciliation. Non seulement l’énigme policière est résolue, mais aussi le nœud d’identités, de représentation et d’affectivité projetées.
La question de la projection psychologique, des « sollicitations [du] subconscient » (MdO, p.152), apparaît alors au premier plan. M. Renard donne au lecteur tous les éléments pour qu’il puisse cheminer avec elle et se familiariser avec cette théorie. Il a besoin qu’elle ait été assimilée pour que le lecteur puisse comprendre le dénouement de l’intrigue. Cela commence,
19 Wiene (Robert) : Idem. Cette phrase se situe à la 29 ème minute. Quelques moments plus tard, on le voit ne pouvoir étreindre Rosine avec ses mains.
303
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
habilement, par la question de la crédulité et de la suggestibilité dans les pratiques d’occultisme. Lorsque Cointre démontre les « subterfuges et supercheries » (MdO, p.217), la théorie de la suggestion s’impose comme pierre angulaire. L’hypothèse adverse, celle de la véracité de la théorie occultiste n’est plus qu’une façon « d’abuser de la crédulité et de la bonne foi ! » (MdO, p.217). Stéphen l’avait d’ailleurs déduit lui-même :
« – Mais, dit Rosine, les tables tournantes ou parlantes, qu’en penses-tu ?
– Ce que tu en penses toi-même. Ce qu’en pensent tous les gens raisonnables. Il est indéniable qu’elles tournent et qu’elles frappent ; mais les esprits n’y sont pour rien. Elles se meuvent sous l’influence de pesées inconscientes ; et ces pesées, exercées à son insu par l’un des participants, traduisent la pensée profonde de son subconscient. » (MdO, p. 153)
« Mes deux essais [de spiritisme] avec M. de Crochans m’ont rassuré. Les âmes ne reviennent pas. Tout cela n’est qu’illusion. Le subconscient de l’évocateur joue le rôle de l’Esprit. Le spirite s’entretient donc avec lui-même. » (MdO, p. 250)
Puis, lors du chapitre X, le faux Vasseur révèle à son tour les supercheries dont il a usé pour contraindre psychologiquement Stéphen : par les stratagèmes cinématographiques des faux rêves extériorisés, par les couteaux, par les billets énigmatiques, il explique comment il a préparé Stéphen à cette confusion mentale, comment il l’a renforcé dans la haine de ses mains et la terreur de leur supposé pouvoir. M. Renard, n’hésitant pas à parler du rôle du subconscient, se fait ici l’écho d’un ensemble de théories de l’esprit bien présentes en 1920 : on pense aux débuts de la psychanalyse20, mais il faut surtout évoquer, plus vraisemblablement, les théories psychiatriques de l’époque et les théories de la suggestibilité. En 1913, le pharmacien Emile Coué21 avait établi à Nancy un cabinet de psychothérapie devenu célèbre dans le monde entier. Dès 1883, il avait participé, avec le médecin Ambroise-Auguste Liébault et le neurologue Hypolite Bernheim, à la fondation de cette « Ecole de Nancy » qui apporta nombre de travaux sur la faculté de suggestibilité et d’hypnose, et leur école s’était opposée avec beaucoup de force à l’« Ecole de la Salpêtrière » du célèbre Pr. Jean Martin Charcot. Le début du XXe siècle, avec sa mode de l’occultisme d’un côté, et ses controverses scientifiques sur l’hypnose et la suggestibilité, était familiarisée avec l’étude de l’inconscient, du subconscient et de leurs manifestations
20 Sigmund Freud écrit en 1895 Etudes sur l’hystérie, en 1909 Cinq leçons sur la psychanalyse, en 1917 Introduction à la psychanalyse entre autres ouvrages.
21 Coué (Emile) : Des suggestions dénaturées, suivi de De la suggestion et de ses applications, Lyon, Jacques André Editeur, 2006.
304
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
mentales et psychosomatiques.
La situation que décrit le roman pousse même cette projection très en avant. Il s’agit non seulement de projeter une tendance psychologique, mais aussi une histoire personnelle. Stéphen, obsédé par ses mains, a fait aussi de sa « chambre des mains » un cabinet de criminologie :
« Vous aviez acheté tous les journaux du 17 et du 18 décembre, veille et jour du supplice de Vasseur. Ils racontaient sa vie, ses crimes, sa mort. Et dans l’isolement, vous vous repaissiez de cette lecture ! Les coups de poignard en forme d’X, dont Vasseur signait ses meurtres, vous faisaient comprendre la marque des couteaux... Vous pensiez reconnaître, en certains de vos gestes, de vieilles habitudes gardées par vos mains... Et, un jour, vous avez voulu contrôler si elles savaient encore jeter des couteaux dans des portes. [...] Et elles savaient ! Elles se souvenaient ! C’est ce qu’il y a de mieux ! Elles ne savaient pas jouer du piano, mais elles savaient jouer du couteau ! » (MdO, p. 238)
En fait, dès que Cerral lui en eut parlé, il s’est senti menacé par ces mains :« Elles vivaient sur vous d’une vie personnelle. Ou plutôt c’est Vasseur qui, grâce à vous, survivait, à la faveur de ses mains !... Entées sur votre chair, elles étaient là comme des greffons sur une plante. Et vous aviez peur que cette pousse vigoureuse vous envahît, par la propagation de sa sève violente ! Vous redoutiez de devenir Vasseur ! [...] En dépit de vos efforts, [elles] tournaient mal, et vos mains vous menaient au crime, – selon vous ! » (MdO, p. 236-237)
On comprend que cette sensation de se sentir possédé par Vasseur provienne à la fois de la peur initiale, due à l’association d’idées entre ces mains d’un autre et le crime, mais on saisit aussi que l’effet psychologique de contamination mentale est issu de la hantise-même de Stéphen Orlac et de ses lectures sur Vasseur et ses crimes. Tout élément de dextérité était rapproché avec l’habileté criminelle, comme si son subconscient, avide de vérifier ses craintes, s’était focalisé à les réaliser. Si l’être humain est un Homo faber, alors le type de faber en question détermine l’homme : des mains de criminel engendreraient une personnalité de criminel. La reconstruction d’identité se joue dans le roman sur ce pivot d’associations et d’identifications.
À bien y regarder, ce sur-investissement des mains correspond plus, au fond, à une structuration psychologique de pianiste qu’à une structuration de criminel, orienté vers le mal. Il y a là une véritable réussite du romancier à avoir agencé les éléments du syllogisme : primo un pianiste s’identifie à ses mains, secundo il a désormais des mains de criminel, tertio il est donc désormais un criminel. Ainsi, même dans cette conviction d’être de plus en plus possédé par Vasseur, on s’aperçoit, à la lumière de l’explication par la
305
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
suggestion du subconscient, que Stéphen Orlac pense encore foncièrement en pianiste car, pour un pianiste, les mains c’est l’homme.
A la fin du récit, on peut imaginer que l’habileté à manier le couteau n’apparaît plus à Stéphen que comme une projection de sa phobie envers ces mains qu’il croyait assassines, et il est probable qu’avec l’image de mains d’horloger il puisse à nouveau projeter sur elle une autre image et une autre attente, toute de minutie et de dextérité. Le film de Robert Wiene se conclut d’ailleurs par ces mots : « Si Vasseur est innocent, alors mes mains le sont aussi »22 et l’on voit Conrad Veidt les porter vers la lumière et les regarder comme une révélation, un sourire se dessinant sur ses lèvres.
Greffe de mains, désajustement et réajustement de facettes du corps
Ainsi se trouverait bouclé cet extraordinaire complexe de facettes corporelles qui, désajustées par la greffe, cherchent un nouvel assemblage. Car chacune des facettes du corps retentit sur les autres : le corps senti, matériellement senti, conditionne les appropriations, l’affectivité et les différents registres de conceptions, mais à leur tour ces registres conditionnent aussi une affectivité, une habileté et une certaine capacité à sentir. On le pressent à l’évocation de la Fantaisie hongroise : le souvenir artistique est intact, le souvenir psychomoteur est encore en place, mais la croyance en des mains de brute fait obstacle tout autant que le traumatisme physique. Une fois levée la symbolique des mains impures et souillées de sang, une fois établies comme mains honorables, voire expertes, il n’est pas dit qu’il parvienne à retrouver son talent virtuose, mais à tout le moins la perspective n’en est plus interdite.
Conclusion :« L’apparition de l’être, ou de l’objet, ou du fait merveilleux. »
Lorsque M. Renard prend une hypothèse comme assertion vraie, ou crée des phénomènes dans l’inconnu, il en explore aussi les retentissements émotionnels. L’article de 1909 se termine en effet par des réflexions sur l’effet d’émerveillement. Il souligne qu’il peut se produire par la satisfaction nouvelle d’une attente ancienne (par exemple un moyen d’aller plus vite), mais aussi par l’irruption d’une capacité technique inattendue (« Mer. Sc. », p. 1208). Le roman merveilleux-scientifique joue sur les deux tableaux :
22 Wiene (Robert) : Orlac’s Hände, le passage concerné se situe à la 93ème minute.
306
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
« Avec une force convaincante puisée à même la raison, [le roman merveilleux-scientifique] nous dévoile brutalement tout ce que l’inconnu et le douteux nous réservent peut-être, tout ce qui peut nous venir de désagréable ou d’horrible du fond de l’inexpliqué, tout ce que les sciences sont capables de découvrir en se prolongeant au-delà de ces inventions accomplies qui nous en paraissent le terme, toutes les conséquences à côté, toutes les suites imprévues et possibles de ces mêmes inventions, et aussi toutes les sciences nouvelles qui peuvent surgir pour étudier des phénomènes jusqu’alors insoupçonnés, et qui peuvent nous créer de nouveaux besoins en créant par avance la manière de les flatter ou de les repaître. » (« Mer. Sc. », p. 1212)
L’effet de merveilleux ne vient pas d’une évasion du réel, mais d’une vision nouvelle du réel et du vécu possible d’une technique inédite. Lorsqu’on relit Les Mains d’Orlac, on s’aperçoit avec un brin d’admiration que les deux premiers tiers baignent dans l’ambiance fantastique de l’occultisme, avec le saisissement sensationnel du décrochage du réel, avant que toute cette extraordinaire superstructure fantastique ne soit peu à peu désossée et mise à nu en tant qu’effet de merveilleux engendré par une infrastructure vraisemblable et réaliste. M. Renard prend le merveilleux non seulement comme un artifice littéraire, mais aussi et surtout comme un objet à étudier, comme un fait dont il faut rendre compte rationnellement pour bien en apprécier la portée.
Dès lors, il n’est pas étonnant que les figures principales du roman soient des figures de rationalité. La plus spectaculaire est celle de l’inspecteur Cointre, car il est celui qui déjoue les subterfuges. La seconde est celle d’Eusebio Nera, le faux Vasseur, car il est le cerveau de ce mécanisme à multiples rouages ; il est celui qui explique les techniques du prestidigitateur. La troisième est Stéphen Orlac, qui se débat avec son choc, ses suites, et ne cesse d’essayer de remettre tous ces éléments en cohérence. La quatrième, et non la moindre, est Rosine Orlac. Bien qu’on ne puisse pas dire que ce roman est un roman féministe, l’un de ses mérites est de ne pas avoir repris le cliché de la femme fantaisiste et irrationnelle. Rosine, à l’inverse, est peut-être le personnage le plus rationnel du livre, celui qui, au fond, conduit l’enquête, lance les investigateurs, met bout à bout les éléments récoltés tout en observant Stéphen pour percer son mystère. Sans doute est-ce en fait l’incarnation la plus proche de M. Renard, sa projection dans le roman. Une seule chose, à la fin, la turlupine, comme si, éprise d’explication, elle n’avait cessé de tout passer en revue pour remarquer tout élément d’incohérence (c’est une obsession de tout auteur de science-fiction) : cette image initiale, blême, qu’elle a surnommé « Spectrophélès ». Elle sait alors saisir à point nommé l’explication possible, lorsqu’elle entend l’inspecteur et le médecin
307
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
légiste parler de la théorie de l’empreinte rétinienne. Ainsi prend corps l’explication par les scotomes :
« Scotomes : taches ténébreuses, silhouettes laissées sur la rétine par la contemplation d’un objet lumineux ou trop illuminé. [...] Vous savez que la vision n’est autre qu’une suite de photographies. L’œil est la chambre noire, la rétine la plaque sensible, et le pourpre rétinien la couche de sels que la lumière décompose. En temps normal, le pourpre se recompose assez instantanément pour que chaque photographie s’efface aussitôt prise. Mais si vous commettez l’imprudence de regarder longuement un point splendide, ou si quelque objet éblouissant frappe votre regard, c’en est fait : le pourpre, trop vivement impressionné, ne se régénère qu’avec lenteur. » (MdO, p. 261-262)
Or, voici ce qui est écrit précisément au début du roman, juste après qu’elle ait identifié Stéphen dans les décombres du train :
« Un craquement se produisit, et, comme si ce craquement eût été solidaire d’un mécanisme mystérieux, au même instant une lumière éblouissante, un brusque rayon de soleil illumina les choses. Le projecteur du train de secours fonctionnait, braqué sur eux. Rosine avait reculé. Démasqué par le déblaiement, surgi des décombres, immobile et debout, un être fantômal, qui n’était pas Stéphen, fixait sur elle ses yeux cadavériques. Son costume était d’une blancheur aveuglante. » (MdO, pp. 38-39)
On peut alors comprendre comment, d’abord penchée sur Stéphen, puis saisie par la lumière, elle se soit reculée, ait posé les yeux sur un autre voyageur, tout de blanc vêtu et violemment éclairé, image qui, dès que le faisceau se fut orienté ailleurs, laissa à la fois un scotome d’autant plus visible que, l’instant d’après, Rosine se trouva de nouveau dans le noir et ne put voir le cadavre qui lui était violemment apparu. La conjonction du scotome et du souvenir rend l’explication vraisemblable. Le dernier élément fantastique trouve son explication. Il n’en est pas moins merveilleux, mais c’est une merveille dont on connaît les rouages, les causes et les effets.
Comment conclure ? Par cette exploration à la fois de la rationalité scientifique et de la logique du merveilleux, au final c’est un tableau de la médecine moderne qui se donne à voir, une médecine à multiples facettes : une médecine de la recherche de pointe et de l’innovation technique, une médecine inquiétante des altérations et des greffes, une médecine de la suggestibilité et de la psychosomatique, et une médecine des traces physiologiques et psychologiques.
Quand, après mesure des mains et vérification des empreintes digitales, le médecin légiste Frouardet comprend qu’il s’agit bien d’une greffe de mains, on l’entend s’exclamer :
308
CHABOT Hugues & GOFFETTE Jérôme (2008) : « Les mains d’Orlac entre imaginaire, médecine et corps modifié » (Postface), pp. 289-309, in Renard Maurice, Les mains d’Orlac,
Lyon, Les Moutons Electriques, 1920 rééd. 2008.
« Vous me voyez confondu. Je crois vivre en l’an 2000. » (MdO, p. 265)
13 janvier 2000 : le Pr Dubernard réalise la première double greffe de mains, et, dans son commentaire, salue, non pas Cerral, mais Carrel, à titre d’initiateur de ces techniques. Il évoquera avoir rêvé depuis longtemps de cette greffe de mains, comme un rêve d’enfance qui se réaliserait enfin – le merveilleux et la science médicale se sont ainsi conjugués pour aboutir à l’apothéose d’une carrière médicale – rien moins.
309