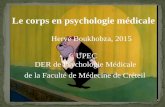Psychologie de l'adolescent en situation d'apprentissage - la conception de la faute
Transcript of Psychologie de l'adolescent en situation d'apprentissage - la conception de la faute
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES Faculté de Philosophie et Lettres
ANNÉE ACADÉMIQUE 2012-2013
PSYCHOLOGIE DE L'ADOLESCENT EN SITUATION
D'APPRENTISSAGE
La conception de la "faute"
PATOUT
Pierre-André
Travail présenté dans le cadre du cours
Psychologie de l'adolescent en situation d'apprentissage
PSYC-E-532
Y. Robaey
2
1. Introduction Dans le cadre du cours intitulé « Psychologie de l’adolescent en situation
d’apprentissage », il nous a été proposé de rendre un travail selon les consignes suivantes : produire un rapport écrit de vingt à trente pages relatant une situation d'apprentissage et dont la présentation est libre mais qui nécessite une clarification du contexte sur lequel repose le présent travail.
Étant étudiant en master de « Langues et Littératures françaises et romanes » et étant titulaire d’une maîtrise en linguistique, il nous a semblé fort intéressant de nous pencher sur le statut de ce que l’on appelle la « faute ». Cependant, n’ayant que vingt-quatre heures de stages à notre actif et, malheureusement, aucune expérience dans la préparation et la correction d’une évaluation, nous ne traiterons pas d’un cas particulier de situation d’apprentissage et nous limiterons donc à une vision fonctionnaliste, un point de vue de linguistique, c’est-à-dire que nous ne nous placerons absolument pas dans une démarche purement normative – que nous ne favorisons d’ailleurs pas.
Nous partons du principe que toute « faute » est motivée, autrement dit, derrière chaque erreur se trouve des causes ou conséquences, et c’est ce sur quoi nous prenons le parti de travailler. Notre travail se basera essentiellement sur les documents, articles, travaux,… que nous avons eu l’occasion d’étudier lors de la rédaction de notre mémoire en linguistique. Nous nous arrêterons donc sur des théories cognitivistes, des thèses fonctionnalistes, des ouvrages sur la réforme orthographique, etc.
Trop souvent, la « faute » est synonyme d’encre rouge, de sanction, de retrait de points,… alors que, au contraire, elle devrait être synonyme de progrès, d’avancée, d’amélioration. En effet, nous n’apprenons qu’en nous trompant, nous nous améliorons par rapport à des erreurs passées, nous assimilons et nous évoluons.
Si nous parlons de « fautes », deux références viennent spontanément en tête : la Bible et l’encre rouge. Dans la Bible, la « faute » réfère essentiellement au péché originel, c’est-à-dire un acte très fortement connoté, un acte qui a eu pour conséquence une sanction divine. Nous voyons déjà, ici, une trop lourde imprégnation dans l’histoire du mot. Ensuite, si nous prenons les premiers mots de la définition du dictionnaire Le Littré, à l’article « faute », nous rencontrons ceci : « Action de faillir, manquement contre… ». Cette définition rend compte de l’idée que tout le monde se fait d’une « faute », certes, mais « manquement » contre quoi ? Contre la langue française (pour ce qui nous concerne) ? Nous dirons
3
catégoriquement que non ! C’est un manquement contre la norme, c’est-à-dire contre une construction sociale. Car, en effet, ce n’est pas la norme qui fait la langue, ce sont les usages que nous en faisons qui la crée !
C’est à partir de cette vision que nous allons travailler. Nous privilégierons donc davantage des termes tels que « erreurs »1, « dysfonctionnements » ou « écarts », à celui de « faute ».
2. Un travail de terrain Comme nous l’avons dit dans l’introduction, n’ayant que trop peu
d’expérience dans l’enseignement, le présent travail sera avant tout basé sur trois positionnements de notre part.
Le premier point est que nous partons, comme déjà mentionné, du fait – acquis, selon nous – que les élèves, les adolescents, tout autant que les étudiants d’université, les adultes,… ne font pas de « fautes » dans le sens où ils se trompent aveuglement. En effet, tout écart par rapport à une norme, tout écart par rapport à un élément de la doxa (autrement dit, quelque chose de difficilement modifiable dans les mentalités ; c’est notamment le cas de l’orthographe dans les pays francophones et particulièrement en Europe, c’est-à-dire en France et en Belgique, nids de grammairiens et théoriciens de la langue) est « motivé », il n’est pas issu du néant, quelque chose (un fait ou un processus) a engendré cette erreur.
Le second point est que nous nous baserons sur les documents que nous avons utilisés pour notre travail de mémoire et portant sur la « faute » dans des copies de quatrième, cinquième et sixième année du secondaire de l’enseignement général. Autrement dit, nous utiliserons le produit concret que sont les copies d’examens, d’interrogations et de dissertations d’adolescents (dont l’âge est estimé entre quinze et dix-neuf ans, en voyant large). Nous ne fonderons donc pas notre travail sur rien.
Enfin, nous utiliserons un bagage théorique varié afin d’offrir à notre étude une variété d’approches différentes qui tendrons à confirmer notre point de vue « de linguiste » selon lequel il y a toujours une origine à rechercher derrière une erreur.
De plus, il nous paraît inconcevable, aujourd’hui, d’imaginer un enseignant qui pointerait des « fautes » chez ses élèves sans chercher à faire
1 « Erreur », qui vient, d’ailleurs, d’errare, « errer, se tromper » ou encore, plus précisément,
d’error, « action de s’égarer, écart, détour, méprise, erreur, fausses croyances, etc. ».
4
comprendre à l’élève pourquoi sa réponse, sa production, est erronée. C’est la raison pour laquelle, lors de notre travail de mémoire, lorsque nous avons recensé, dans les copies2 d’adolescent(e)s de Namur, Arlon et Tubize, les erreurs3, nous avons créé deux grilles d’analyses – l’une très générale, l’autre extrêmement détaillée. Ces grilles nous ont aidé à deux niveaux, le premier était la classification, pour nous, des erreurs commises ; le second était, dans le même ordre d’idée, la répartition des erreurs en fonction de catégories générales et plus précises – selon la grille – pour l’Élève.
Notre première grille d’analyse était donc assez générale :
La seconde, bien plus précise, est fournie en annexe4 pour plus de simplicité. Nous pouvons, cependant, signaler que nous la partageons de la manière suivante : en reprenant chaque catégorie de la première grille, nous avons séparé les sous-catégories pour les préciser encore davantage en « types d’erreurs » et en « sous-types », avec un regard sur l’incidence sur la phonétique5.
Ainsi, à part pour ce qui est du point de vue sur la phonétique, nous avons tenté de créer une grille très détaillée afin de cibler au plus près le « problème » que l’Élève avait.
Cependant, ne nous le cachons pas, ce deuxième type de grille n’est absolument pas pertinent dans le cadre d’une évaluation certificative. Et cette précision nous permet d’affirmer notre position quant au rapport que nous établissons quant à l’erreur (Cf. schéma ci-à-droite).
2 Le nombre de copies s’élevait à, environ, quatre-vingt. 3 Le nombre d’erreurs total pour toutes les copies des trois régions confondues était d’environ 1.500. 4 Cf. Annexe 1. 5 Cette démarche reste dans le domaine de l’extrapolation car nous avons pris comme « étalon » notre propre rapport à la langue.
5
3. Un rapport triangulaire à l’Erreur En effet, ainsi que le montre le schéma ci-dessus, nous appréhendons le
rapport à l’erreur dans l’enseignement comme un processus qui impliquerait des interactions entre le Professeur, l’Élève et l’Erreur. Autrement dit, l’Erreur est vue comme centrale dans le rapport Professeur-Élève, ces deux acteurs ont un rapport (ou des rapports) différent(s) quant à l’Erreur, ces relations sont connues et reconnues « tacitement » par le Professeur et par l’Élève, et ils trouvent un « terrain d’entente », ils se mettent d’accord, ils partagent une même vision quant à leur relation avec l’Erreur.
Plus clairement, la notion d’erreur est commune au Professeur et à l’Élève. Cependant, le Professeur n’aborde pas celle-ci de la même manière que l’Élève. Selon nous, le Professeur doit appréhender l’erreur de manière objective et dans un but formatif. Par « objectif », nous entendons qu’il s’agit, pour l’Enseignant, d’identifier une « faute » comme étant le résultat d’un manquement à quelque niveau et non suivant un point de vue qui voudrait que « ce n’est pas étonnant pour un tel élève, cancre / « bon à rien » comme il est » ou encore « ce n’est pas dans l’habitude de cet élève de faire des fautes / ce genre de fautes, sans doute est-il fatigué / a-t-il eu des soucis / était-il distrait /… » - en somme, un regard subjectif. Et par « but formatif », nous entendons que, trop souvent, il nous semble que le Professeur décèle des « fautes » dans des exercices / interrogations / dissertations /… cotées. Il s’agit donc, selon nous, de renverser ce système en faisant en sorte que les élèves produisent le moins de « fautes » possibles dans les évaluations qui débouchent sur une note et qu’ils aient la possibilité d’en faire et de se corriger le plus régulièrement possible lors d’exercices non cotés, c’est-à-dire que l’enseignant, par des séances répétées d’exercices, fera en sorte de mettre des embûches – progressivement plus grandes – dans le travail de production de l’élève de sorte que ce dernier puisse acquérir des connaissances théoriques et procédurales pratiquement « à toutes épreuves » pour qu’il fasse le moins d’erreurs possible lorsque l’enseignant décidera qu’il est temps de procéder à une évaluation certificative.
Ensuite, l’Élève, quant à lui, a un rapport à l’Erreur qui, en règle générale, n’est pas « sain ». C’est-à-dire qu’il « sait » que faire des erreurs c’est « mal ». Il doit donc les éviter sous peine de sanction (de quelque sorte). Ou alors, l’Élève a décroché et il ne porte plus aucune attention à sa production, il fait peu de cas des éventuels écarts qu’il produira. Mais il y en a d’autres pour qui l’erreur n’est ni synonyme de sanction (et qui n’ont donc pas de sentiment de crainte potentiel quand ils écrivent) ni synonyme d’abandon. Ceux-ci ont un rapport « sain » quant à la « faute ». Ils font de leur mieux, ils font en sorte de ne pas faire d’erreurs et
6
s’il advenait qu’ils en fissent, ils prennent le temps de regarder ce qu’il en est, pourquoi une telle erreur est arrivée et comment l’éviter.
Enfin, malgré ces deux approches différentes de l’Erreur – dues aux « métiers » différents que sont celui d’Élève et celui de Professeur –, il existe un accord tacite entre Élève et Professeur sur le statut commun de l’Erreur. Un peu comme un jeu de rôle où le premier acteur ne doit commettre aucune erreur et où le second traque les « fautes », les cherche minutieusement. En somme, l’Erreur est aussi commune et première dans les relations Professeur – Élève que l’est l’institution « École » elle-même.
4. Le statut (fluctuant) de l’Erreur et de l’Échec Comme nous l’expliquons depuis le début de ce travail, nous cherchons à
apporter un regard moins rigide sur la langue et ses usages. La langue évolue perpétuellement, on pourrait presque dire qu’elle se modifie à chaque instant, tant à l’écrit qu’à l’oral. Ainsi, nous pouvons citer Nina Catach qui disait qu’« un mot a deux formes, orale et écrite, qui évoluent toutes les deux, la première retardant avec juste raison sur la deuxième »6.
Nous pensons que si les « dérives » de l’oral sont plus facilement acceptées, alors il est normal que nous devions faire l’effort d’essayer de comprendre les formes qui s’éloignent de la norme à l’écrit.
Tout francophone natif a un avis et porte un jugement sur sa langue. Qu’il soit de France – « patrie et terre maternelle » de la langue française (érigée au rang d’Institution avec l’Académie française) –, qu’il soit du Canada – où l’on s’est battu pour promouvoir un français en perdition face à l’anglais (voyez la loi 101) – ou qu’il soit de Belgique – pays qui a vu naître des théoriciens et spécialistes de la langue française et dont nous gardons, encore aujourd’hui, un héritage certain (pensons, notamment, au Bon Usage de M. Grévisse). Cependant, nous avons aussi nos belgicisme, nos façons de parler, nos expressions, etc. qui nous rappellent qu’en fait, rien ne peut brider la Langue (qu’elle soit française ou tout autre).
C’est cette tension duelle (entre norme et « liberté d’expression », entre « bon usage » et belgicisme) qui nous a donné envie de discuter le sujet de la notion de « faute », certes, mais nous ne prétendrons pas « recréer » de nouvelle pratique, de nouveaux dictionnaires ou tout serait accepté ! Une erreur demeure
6 CATACH Nina, Les délires de l’orthographe en forme de dictioNaire, préface de Philippe de
Saint-Robert, Paris, Plon, 1989, p.101.
7
une erreur… L’intérêt est de modifier le regard que l’on a sur celle-ci. Nous pensons qu’il convient grandement de nuancer notre point de vue qui est, trop souvent, teinté d’esthétisme (« Ce n’est pas beau... », « c’est plus joli de dire… », « il ne faut pas dire… mais… », etc. ) et trop peu fondé sur des arguments solides.
Ensuite, nous l’avons déjà mentionné, donc, nous ne reviendrons pas sur le fait que notre point de vue par rapport à l’Erreur n’est absolument pas prescriptif (ni même proscriptif) ni normatif.
Nous venons aussi d’expliquer la façon dont nous envisageons les rapports que le Professeur et l’Élève ont et/ou devraient avoir quant à l’Erreur, ainsi que l’idée selon laquelle l’Erreur est une des pierres qui soutiennent l’édifice des relations scolaires (tant de la perspective professorale que de la perspective estudiantine).
Nonobstant, une question primordiale relative à la relation de l’Élève et de l’Erreur est « à quoi l’Élève attribue-t-il son échec / sa faute ? » ou encore, dans la même optique mais d’un point de vue plus positif « à quoi l’Élève alloue-t-il sa réussite ? ».
En effet, plus haut, nous avons envisagé le rapport de l’élève par rapport à l’Erreur selon trois grandes modalités : 1. La « crainte » de l’Erreur (sans doute à cause de la sanction), 2. Le défaitisme et l’abandon face à celle-ci, 3. L’« émulation » (dans le sens où la « règle du jeu » est de ne pas faire d’erreur(s) et, si cela arrivait, observer, apprendre, retenir et assimiler les façons de ne plus en faire).
Désormais, l’idée d’évaluation formative permet d’accorder à l’Erreur un statut plus positif. En effet, à l’instar de nombreuses avancées scientifiques basées sur l’expérimentation, c’est en cherchant, en essayant et modifiant constamment qu’on arrive à atteindre la solution. Ainsi, l’Erreur n’est que le premier pas du processus d’amélioration. Cependant, il convient grandement de préciser que commettre une erreur et recevoir la bonne réponse sans explication ne sert à rien. L’intérêt est de comprendre pourquoi une erreur a été commise, chercher une manière de résoudre la cause de la « faute » et l’intégrer. Cependant, il semblerait que ce nouveau regard sur l’erreur s’accompagne d’un effet secondaire : l’insécurité cognitive. En effet, tant que la « faute » restait purement et simplement « faute », il « suffisait » de retenir par cœur la bonne réponse pour la reproduire. Désormais, si l’on accepte que l’Erreur doit « se comprendre » (dans le sens où l’on se montre plus ouvert d’esprit vis-à-vis d’elle, mais aussi, et surtout, qu’il faut en chercher les causes), la coupure épistémologique peut être
8
difficile à accepter, les repères se désagrègent, il faut en créer de nouveau et cela peut mener, comme nous le disions plus haut, à un sentiment d’insécurité.
Remarquons que cette rupture dans l’épistémologie rejoint ce que Laroche et Désautels (didacticiens des sciences) affirmaient quant à l’évolution de la Science qui se décrit en termes de « sauts ».
Quoi qu’il en soit, cette nouvelle approche de la faute met en œuvre, pour une grande part, des démarches métacognitives. Un retour sur soi, sur ses méthodes, sur ses cheminements réflexifs, sur ses processus et productions, etc. permet de les optimiser, de s’améliorer (en rendant plus performant ce qui fonctionne bien et en corrigeant / éliminant les dysfonctionnements). Dans un second temps, il s’agira de rendre ces nouveaux « outils » transférables, et il s’avère que cette tâche n’est pas aisée. Il semblerait que ce qui empêche la bonne qualité des transferts de compétences soit, entre autres, des « effets de contexte »7 (nous en reparlerons dans les pages qui suivent).
5. Analyse de copies d’élèves de quatrième, cinquième et sixième année du secondaire issues de production écrite à Arlon, Tubize et Namur
5.1. Présentation Nous l’avons déjà mentionné plus haut, n’ayant pas, à notre avis, assez
d’expérience dans le domaine de l’enseignement (seulement seize heures de stage en français et huit heures de stage en latin), nous avons préféré nous baser sur des théories traitant de la fautes et qui adoptent un point de vue qui n’est pas normatif, qui cherche à comprendre les raisons des fautes. Ainsi, dans la présente section, nous nous donnerons pour tâche d’étudier, dans les copies d’adolescent(e)s de Namur, Arlon et Tubize, les « fautes » sous différents angles.
Nous ne reprendrons pas tous les tableaux comparatifs et nous attèlerons à retranscrire directement les conclusions auxquelles nous sommes arrivé. En effet, le but de ce travail n’étant pas d’apporter de quelconques preuves – que nous ne pourrions prétendre présenter étant donné que nous n’avons pas opéré un travail à assez grande échelle – mais bien d’induire une réflexion sur la notion de « faute », sur l’erreur.
7 ROBAEY Yves, Psychologie de l’adolescent en situation d’apprentissage, Bruxelles, Presses
Universitaires de Bruxelles, 2013, p.10.
9
5.2. Premières observations après lecture des données recueillies
Notre travail de mémoire pour l’obtention de la maîtrise en linguistique nous a amené à retranscrire au moyen d’un traitement de texte les erreurs que nous avions relevées dans nos copies, et grâce à cela, nous avons eu la possibilité de faire ressortir quelques constatations.
Tout d’abord, nous avons remarqué que dans les copies tapuscrites, l’Élève avait tendance à faire essentiellement des erreurs en orthographe d’usage dont, notamment, des inversions, commutations, gémination, dégémination et oubli de lettres. On pourrait dès lors s’imaginer que ces types de fautes sont dus au moyen utilisé pour écrire, mais nous écartons d’emblée cette option car ces écarts se retrouvent dans des copies manuscrites. Ainsi, ce que nous aurions pu appeler « fautes de frappe » sont bel et bien des erreurs. De plus, toujours quant à l’instrument électronique d’écriture, nous posons l’hypothèse que l’attention de l’Élève-scripteur est relâchée à cause de sa trop grande confiance dans les capacités de son correcteur automatique et fait donc bien moins attention aux erreurs éventuelles.
En retapant les erreurs dans notre grille de correction de base, nous avons relevé une différence dans l’apparition des dysfonctionnements entre les élèves de sexe masculin et les élèves de sexe féminin. En effet, il semblerait que certains types d’erreurs concernant l’accord en genre soient le fait de filles. On remarque, chez elles, un accord au masculin – ou pas d’accord du tout, nous ne pouvons le déterminer – pour des adjectifs dont le référent n’est autre que leur propre personne. Nuançons tout de même notre point de vue car, ne sachant pas s’il s’agit plutôt d’un accord au masculin que d’une absence d’accord, nous n’avons pas la possibilité de vérifier si les garçons ne pratiquent pas non plus cette « absence d’accord ».
Il a été très étonnant d’observer, lors de l’étude des écarts concernant l’expression du sujet, que deux grands groupes d’erreurs étaient associés à deux catégories d’élèves. D’un côté, nous avons les élèves qui commettent surtout l’erreur d’utiliser un pronom anaphorique sans qu’un référent ou un sujet ne soit exprimé ; d’un autre côté, nous avons ceux qui font des erreurs dans, à peu près, tous les sous-types relevés (reprise avec erreur dans le genre, référence ambigüe et floue, reprise par syllepse,…). Ces deux groupes, comme nous l’avons dit, sont relatifs – semble-t-il ! Car, en effet, nous n’avons pas assez de matériau pour corroborer cette hypothèse – à deux genres d’élèves : les filles et les garçons ! Les filles « appartenant » au premier groupe, les garçons au second.
10
Quand nous avons abordé le cas des erreurs de type « temps, concordance, conjugaison », nous avons surtout remarqué un manque total d’homogénéité, comme si chaque erreur était presque un cas unique. Nous avons pu, cependant, remarquer que les corpus namurois, arlonais et tubizien semblent, à première vue, compter un nombre équivalent d’erreurs de ce type. Cela dit, la presque totalité des déficits8 entraine une modification dans la phonétique.
Lorsque nous nous sommes penchés sur le cas de la phraséologie, nous avons retiré de l’analyse que les élèves ont, surtout, des soucis avec l’utilisation des minuscules, des majuscules et de la négation. Nous pensons que ces erreurs sont dues à l’oralité car, quand nous parlons, nous ne distinguons absolument pas majuscules et minuscules. Ensuite, il est indéniable que la double négation de l’écrit (quand le style ne se fait pas familier) n’existe plus (ou très rarement) à l’oral et tend à devenir une négation simple.
D’ailleurs, toujours lié à cette idée d’oralité, nous avons relevé, dans les textes écrits, ce que nous appellerons des « popularismes », c’est-à-dire des tournures, des expressions,… du registre populaire, voire bas, et qui ne sont « normément » pas admis dans des productions écrites. Il en va de même pour les nombreuses redondances et répétitions que nous avons trouvées (cela allait de la simple répétition de mots à la reprise de syntagmes entier, et même des phrases).
5.3. Deuxième lecture, nouvelles observations Après avoir rempli notre première grille de lecture des erreurs et établi les observations que nous avons reprises ci-avant, nous avons réparti les erreurs dans la seconde grille typologique afin de préciser, confirmer et/ou informer, nos premières observations.
Dans la partie « orthographe grammaticale », nous voyons de grandes « tendances » : des problèmes dans l’usage des signes diacritiques corrélés à des cas d’homophonie et leur non-maîtrise concernant l’aspect graphémo-phonétique (autrement dit, les élèves ne distinguent pas les sons qui provoquent l’absence ou la présence de ces signes).
Nous avons découvert des cas, très étonnants pour des élèves du troisième degré du secondaire de l’enseignement général de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de confusions entre le domaine verbal et le domaine nominal. Malgré leur caractère extrêmement surprenant, nous ne les rencontrons que dans quelques occurrences – dont le nombre est très minime mis en rapport avec les autres types
8 Terme repris à Henri Frey : FREY H., La Grammaire des Fautes, Genève, Stalkine Reprints,
1971, 319p.
11
d’erreurs – et nous décidons de les considérer davantage comme des incorrections dues à l’inattention.
Au sein-même du domaine verbal, nous constatons que les adolescent(e)s confondent les désinences de certaines personnes. Cela ne provoque aucune modification phonétique, ce qui est plutôt révélateur d’une stratégie – que nous retrouvons dans d’autres cas, notamment en ce qui concerne les erreurs dysorthographiques – de la part des élèves : supplétion d’une graphie par une autre qui lui est homophone. D’ailleurs, le même constat s’applique, selon nous, dans les dysfonctionnements touchant la flexion au pluriel (<s> que l’on lit, que l’on voit, mais qui ne se prononce pas).
De plus, toujours en ce qui concerne l’incidence sur la phonétique, les cas de déficits dans l’accord en genre (que ce soit au masculin pour les termes féminins ou que ce soit au féminin pour les termes masculins) se répartissent équitablement entre la présence ou non d’une modification.
Dans le cas de l’orthographe lexicale – aussi nommée orthographe d’usage – nous remarquons que pour l’unité « mot » les erreurs sont essentiellement de scissure ou soudure de mot erronée, ainsi que celles relatives à une mauvaise utilisation de la césure. Autrement dit, nous en revenons encore au cas de l’oralité qui ne connaît pas ces règles.
Nous pouvons donc déjà dire que l’influence de l’oral et une mauvaise acquisition de l’orthographe d’usage (et/ou une mauvaise maîtrise / utilisation de celle-ci) peuvent être des causes privilégiées pour expliquer ces erreurs. Toutefois, cette explication, même si elle paraît très adéquate, nous semble un peu trop simpliste lorsque nous l’appliquons à des élèves qui ont entre quinze et dix-neuf ans… Nous n’avons malheureusement pas la possibilité de vérifier cette hypothèse par une étude de terrain à plus grande échelle.
Outre cela, pour ce qui est de la sous-catégorie « phraséologie », nous découvrons un nombre assez élevé d’erreurs qui mettent en cause l’absence d’éléments dans la phrase, mais aussi la présence superflue d’éléments de tous types. Pour ces cas-ci, nous postulons qu’une fois que l’attention de l’adolescent(e)-scripteur doit être mobilisée un peu plus fortement que d’habitude et qu’en même temps il doit faire attention à ce que le langage qu’il utilise soit soutenu, des moments de « faiblesse » cognitive, une certaine fatigue s’installe et entraîne une décontraction. Ainsi, nous posons l’hypothèse qu’étant donné le fait que nous écrivons et pensons en même temps, dès lors qu’il y un relâchement de l’attention, de l’effort cognitif, la « synchronisation » entre le mouvement (écriture) et la pensée « souffre » un décalage qui tend à provoquer des erreurs.
12
Ensuite, quand nous avons étudié la catégorie « choix lexicaux », nous nous attendions à voir une majorité d’erreurs pour ce qui est des problèmes de « vocabulaire spécialisé / spécifique / élevé ». En effet, malgré le niveau d’instruction élevé des élèves, nous pensions trouver de mauvaises utilisations d’un vocabulaire qui ne leur est pas familier, trop spécifique ou trop élevé. Or, ce ne sont même pas les erreurs les plus représentées ! Il s’avère que ce sont les phénomènes – nombreux et variés – de confusion qui sont prédominant. Les confusions entre verbes sont les plus importantes, mais nous trouvons des confusions de nature. Ce type de « fautes » peut paraître incroyable et aberrant pour des adolescent(e)s avec leur niveau d’instruction, mais nous pensons que deux phénomènes entrent en jeu et permettent d’expliquer ces erreurs : l’oralité et la longueur des phrases. En effet, il est des écarts que nous avons relevés qui, oralement, ne nous choqueraient même pas. Ensuite, la « longueur des phrases » – c’est-à-dire le nombre moyen de mots qu’une phrase peut contenir9 – nous paraît un critère important dans l’explication de ces dysfonctionnements puisque nous prétendons que plus une phrase sera longue, plus il y aura de risques d’erreur.
9 En ce qui concerne la longueur des phrases, nous avons établi – sur base d’un corpus littéraire
(livre, articles, articles scientifiques,…) et sur base de notre propre production – une moyenne qui
s’échelonne entre vingt et trente-six mots par phrases.
13
5.4. Études critériées
Nous avons, pour cette partie, choisi de nous baser sur les données que nous avons recueillies lors de notre travail de mémoire. Ainsi, nous avons repris, pour chaque critère (et pour leur comparaison), le tableau ci-dessous :
Nombre
total
Moyenne
Erreurs Nombre moyen de « fautes » par copie Copies
Orthographe grammaticale Nombre de « fautes » de chaque type par copie
Orthographe lexicale
Temps, concordances, conjugaison
Reprise et expression du sujet et du référent
Phraséologie
Choix lexicaux
Redondances
Longueur moyenne d’une phrase Nombre moyen de mots par copie Nombre moyen de phrases par copies
Moyenne du nombre de mots par copie divisé
par la moyenne du nombre de « fautes » par
copie.
5.4.1. La région Les données récoltées à travers le corpus namurois nous montrent que les
erreurs touchant à l’orthographe (en général) prennent environ quatre-vingt pourcents « de la place » et, plus précisément, ce sont les déficits en matière d’orthographe grammaticale qui sont majoritaires, viennent ensuite les erreurs d’orthographe lexicale, les problèmes liés aux choix lexicaux, la phraséologie, l’expression et la reprise du sujet et du référent, ce qui touche aux temps, à leurs concordance et à leur conjugaison, et enfin les « erreurs de redondances ».
À Arlon, les « fautes » d’orthographe prennent aussi plus de la moitié de la place (soixante-deux pourcents), puis arrivent les catégories : choix lexicaux, redondances et phraséologie qui sont à égalité, la conjugaison, et l’expression du sujet.
Enfin, à Tubize, la répartition est la même qu’à Namur, si ce n’est que les erreurs d’expression et reprise du sujet et les erreurs de redondances sont
14
inversées. Remarquons que Tubize ne déroge pas à la règle et les dysorthographies dominent avec soixante-six pourcents des occurrences d’erreurs.
Nous pensions que Namur représenterait une sorte de « zone de transition » entre Arlon et Tubize, comme si nous nous attendions à voir une sorte de lente modification entre les deux villes qui passerait par Namur, mais il n’en est rien, comme nous le voyons. Cela dit, nous pensons que Tubize figurerait bien cette « espace pivot ». Tubize – ou plutôt Bruxelles – serait un centre, Namur et Arlon se situeraient à son côté est et, suivant cette logique, les « pratiques de la faute » des régions situées à l’ouest de Bruxelles seraient ordonnées différemment. Cela restera, évidemment, au stade d’hypothèse jusqu’à ce qu’une étude de plus grande envergure confirme ou infirme nos suppositions.
5.4.2. Le niveau d’étude Ici, malheureusement, nous n’avons pas eu la chance d’avoir trois corpus
identiquement proportionnés. En effet, le corpus arlonais ne comportent que des copies de cinquième année et sixième année du secondaire de l’enseignement général. Ensuite, toujours en ce qui concerne Arlon, nous ne possédons de copies, pour la cinquième année, que d’un seul élève, ce qui ne rend pas spécialement pertinent la comparaison avec les autres corpus. Enfin, en ce qui concerne le corpus de la sixième année, nous n’avons pas, cette fois-ci, en notre possession de copies tubiziennes.
Toutefois, malgré ces corpus hétérogènes, nous pouvons tirer quelques conclusions. En quatrième et en cinquième année, le nombre d’erreurs par phrases est bien plus élevé qu’en sixième année ; les élèves de cinquième année faisant légèrement plus d’erreurs par phrase que ceux de quatrième année.
Les « fautes » d’orthographe sont, dans les trois niveaux, encore une fois, les plus représentées avec quatre-vingt-trois pourcents des occurrences en quatrième année, septante-deux pourcents pour la cinquième et soixante-cinq pourcents pour la sixième. Cependant, il convient grandement de nuancer ces résultats en distinguant orthographe lexicale et orthographe grammaticale, dont le nombre d’occurrences fluctue en fonction de l’année d’étude. En effet, les erreurs d’orthographe grammaticale sont plus nombreuses en cinquième année qu’en quatrième année, et en quatrième année qu’en sixième année ; les écarts d’orthographe d’usage étant plus fréquents en quatrième année qu’en sixième année, et en sixième année qu’en cinquième année.
Pour expliquer ces variations, nous pouvons émettre plusieurs hypothèses. La première est que l’enseignant porte une attention plus accrue en cinquième et en sixième année en ce qui concerne les règles d’accord. La seconde est que
15
l’élève aurait acquis une certaine « maturité » dans la maîtrise (et donc l’acquisition) de l’orthographe lexicale.
Nous appuyons cette hypothèse avec l’état de fait qui veut que dans le dernier cycle de l’enseignent secondaire les lectures obligatoires sont plus nombreuses pour les deux dernières années que pour la quatrième, mais aussi avec le fait que les règles de grammaire ne sont plus enseignées après la troisième année du secondaire. De ce fait, le peu de lectures en quatrième année trouverait une corrélation directe avec la fréquence d’occurrences d’erreurs lexicale et, proportionnellement, les élèves de cinquième et sixième année tendraient à commettre moins d’erreurs grâce à leurs lectures imposées plus nombreuses. De même, la mémoire des élèves de quatrième année est encore fraîche en ce qui concerne les règle de grammaire, ce qui serait lié à la moindre fréquence de « déviances » en orthographe grammaticale pour cette année qu’en cinquième et en sixième année où les règles sont de moins en moins « fraîches » dans les mémoires des adolescent(e)s.
Concernant les erreurs de « choix lexicaux », il apparaît que l’Élève de sixième année en commettra davantage. Nous trouvons dans cette donnée un argument qui tend à appuyer l’idée selon laquelle les lectures obligatoires plus fréquentes y seraient corrélées directement car elles enrichiraient le vocabulaire de l’Élève qui ne sait pas encore en faire bon usage.
5.4.3. Le type de copie Comme précédemment, nous nous trouvons devant des corpus qui ne se
valent pas : nous ne possédons, malencontreusement, pas d’exemplaire qui appartiendrait à chaque type (Examen / « Travail régulier »10) pour chacune de nos trois régions. Arlon et Tubize ne comportent que des copies de « travaux réguliers » et, de ce fait, seul Namur compte dans son corpus des copies d’examens. Mais ce n’est pas tout puisque le problème que nous avons eu pour la partie concernant le niveau d’étude se retrouve identiquement ici.
Ainsi, nos observations et surtout les hypothèses que nous en tirerons seront encore plus difficiles à présenter comme pertinentes sans une deuxième étude plus complète.
Nous retiendrons donc de cette analyse que les copies issues d’examens, qui présentent plus de mots, comportent un nombre moyen d’erreurs plus
10 Nous appelons « travail régulier » tout ce qui n’appartient pas au champ « examen », c’est-à-dire
tout ce qui est dissertation, contrôle, interrogation, etc.
16
important (par copie) que dans les « travaux régulier » alors que les phrases, en examen, sont plus courtes que dans l’autre condition.
Nous tirons, tout de même, de ce constat, une hypothèse qui lie cette donnée aux modalités qui concernent ces productions écrites. Ainsi, l’Élève, en examen, dispose de moins de temps pour écrire, pour produire sa dissertation, et pour se relire, ce qui le rend plus susceptible de « laisser passer » des erreurs en nombre.
Quoi qu’il en soit, nous n’avons à notre disposition aucune données contextuelles ou situationnelles qui permettraient de corroborer ou non ces idées.
5.4.4. Le genre sexué Comme le dit le titre, nous avons décidé de comparer les tableaux
d’erreurs chez les garçons et chez les filles.
Il s’avère que, dans notre corpus, les filles produisent moins d’écarts par phrases que les garçons. Or, ces derniers écrivent des phrases qui ne contiennent que dix-huit mots (donc moins que la fourchette moyenne que nous avions donnée) alors que les premières en rédigent qui comptent vingt-six mots. Cela rend donc compte d’une plus grande propension aux déficits chez les garçons alors que, justement à cause de la moindre longueur de leur phrase, nous nous serions attendus à moins d’erreurs. Alors que dans les cas précédents, nous pouvions expliquer cette tendance à faire plus de « fautes » dans de plus petites phrases par un nombre plus élevé de phrases par copie, ici, ce n’est même plus le cas.
Lorsque nous regardons plus en détail les catégories et sous-catégories, nous constatons que les filles commettent plus fréquemment des écarts dans le domaine de l’orthographe lexicale, dans la phraséologie, dans les choix lexicaux et dans la reprise et l’expression du sujet et de son référent ; les garçons faisant, dès lors, plus d’erreurs dans les cas de redondances, d’orthographe grammaticale, et dans la catégorie « temps, concordances, conjugaison ».
5.4.5. Synthèse Après cette vue d’ensemble de travail de terrain, nous avons relevé
plusieurs tendances qui avaient, parfois, une valeur générale, et qui, parfois, étaient plus spécifique à un contenu, à un domaine.
Nous pensions trouver une sorte de variation diatopique qui aurait pour « plaque tournante » Namur et qui s’étendrait d’Arlon à Bruxelles. Nous n’avons rien observé de tel, mais nous avons avancé l’idée qu’une explication similaire pourrait se trouver en modifiant le centre que nous voyions en Namur sur
17
Bruxelles, qui serait le lieu de transition entre la zone est et la zone ouest de la Belgique pour ce qui est des types d’erreurs représentées. Il conviendrait de vérifier ces suppositions par une étude à plus large échelle.
Quand nous avons abordé le corpus par niveau d’étude, nous avons observé très clairement une amélioration dans les données concernant l’orthographe entre la quatrième année et la sixième année du secondaire. Cependant, quand nous regardions les sous-types d’erreurs, nous voyions des variations d’année en année. Nous avons été amené à poser l’hypothèse qu’il y a un lien étroit entre l’augmentation des lectures imposée en cinquième et en sixième année par rapport à la quatrième, et, en même temps, « l’éloignement » dans la mémoire des règles grammaticales chez les élèves au fur et à mesure qu’ils passent à l’année d’étude suivante. De même, nous avons, corrélativement, supputé que le lexique mental des adolescents s’enrichissait progressivement car les lectures obligatoires se faisaient plus nombreuses. Ce qui tendrait à expliquer les erreurs de « choix lexicaux » par la non-maîtrise et/ou le mauvais usage de ce nouveau vocabulaire.
Malgré le fait que nos corpus ne soient pas homogènes quant à l’analyse par « type de copies », entraînant un souci de rigueur scientifique, nous avons tout de même pu, grâce au corpus namurois qui présente tous les types de copies, établir le fait que les examens comptent plus d’occurrences de dysfonctionnements que les « travaux réguliers ». Nous expliquons cela par l’hypothèse qui met en jeu les contextes de production de ces deux types de travaux : les « travaux réguliers » (namurois) comportent moins d’erreurs que les examens. Nous pensons que lors des examens, parce que le temps est défini et plus court pour des tâches plus diverses et nombreuses que lors des travaux réguliers, les élèves sont surchargés cognitivement et n’ont pas autant de temps pour procéder aux exercices / dissertations /… et à leur(s) relecture(s).
Nonobstant, quand nous avons analysé et comparé les « travaux réguliers », nous avons revu les suppositions que nous émettions quant au fait que les notes tapuscrites engendraient plus d’erreurs à cause d’une baisse d’attention due à la trop grande confiance dans les capacité du traitement de texte. En effet, ces notes bénéficiaient d’une « révision » grammaticale et orthographique et grammaticale, mais aussi de plusieurs relecture par un professeur particulier – nous avons donc plusieurs versions d’un même texte au fur et à mesure des corrections – et cela tend à diminuer grandement le nombre de « déviances » de manière générale.
Quand nous avons comparé les copies de filles aux copies de garçons, nous avons dénoté une tendance, chez ces derniers, à commettre plus de « fautes »
18
que les filles, pour des phrases plus courtes, certes, mais en moins grand nombre aussi ! Nous ne nous expliquons pas réellement ce phénomène, mais nous avançons la thèse sociolinguistique qui veut que les femmes seraient « gardiennes de la norme », que celle-ci se transmettrait grâce à elle. Nous extrapolons donc à partir de cette idée et les données que nous venons de recueillir seraient, dès lors, « logiques ».
Outre ces observations et hypothèses concernant des champs distincts, nous avons mis au jour quelques idées, hypothèses,… qui ont un caractère plus général.
Nous partions de l’hypothèse que plus une phrase sera longue, plus les « chances » d’y trouver des erreurs seront nombreuses. Nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises de vérifier cela, bien que certaines données de notre corpus infirmaient cette supposition. Cela nous a permis d’affiner, de préciser notre point de vue en prétendant que le nombre de phrases par copie entrait en jeu. Cela s’est vu confirmer partout, sauf dans le cas du corpus « masculin », comme nous l’avons déjà mentionné.
5.5. Analyse de la grille typologique « détaillée » : quelques causes possibles
Quand nous regardons la partie « orthographe grammaticale » remplie, d’emblée, nous remarquons que l’oralité joue un grand rôle dans la propension à commettre des erreurs. Ce sont, essentiellement, des problèmes liés à l’homophonie, notamment, mais on remarque aussi qu’il peut y avoir incidence des erreurs sur la phonétique ou non. Dès lors, lorsqu’il n’y a pas répercussion phonétique, nous pouvons, encore, avancer que l’oralité y est pour quelque chose.
Nous supposons que, au vu des cas d’homophonie et d’homonymie, l’Élève qui ne maîtrise pas les différences internes des graphies homophones va élaborer des stratégies de substitutions en prenant appui sur ses connaissances graphémo-phonétiques. Cela dit, ces types d’écart touchent essentiellement des mots d’une ou deux syllabes (ou phonèmes) et dont la morphologie n’est pas complexe (C-V ; C-V-C ; C-V-C-C ; V)11. Dès lors, nous pensons que dans ces cas-là, l’erreur est surtout due à des règles non-assimilées concernant les différences graphiques de termes homophones (a – à ; se – ce ; ou – où ; etc.).
Nous ne prétendons pas trouver nous-même de causes pour chaque erreur, mais nombreuses sont celles qui peuvent s’expliquer par de l’hyper-correctisme ou par de l’analogie (entre paronymes, entre conjugaison, entre natures, etc.).
11 C = consonne ; V = voyelle.
19
Toutes ces « stratégies » répondent à peu près au même besoin de l’Élève : tendre à plus d’uniformité. On écrit comme ça se prononce ; on écrit sur un autre modèle plus commun ; on écrit en ayant à l’esprit que la graphie usuelle n’est pas correcte car elle ne suit pas les règles générales et on corrige donc ce qu’il ne faut pas.
Ainsi, ces mêmes dysfonctionnements se retrouvent de la même façon – mais exprimés différemment – dans les cas d’erreurs en orthographe lexicale. Par exemple, quand nous abordons les cas de scissions de mot qui s’écrivent en un « tout » ou, inversement, la soudure de mots ou locutions qui s’écrivent avec trait d’union, apostrophe, etc., on remarque que toutes ces incorrections sont en réalité motivées et logiques ! Elles participent d’une analyse : « auxquelles » qui devient « aux quelles » (qui se comprends totalement, puisque que c’est issu d’une recherche de rationalité : à qui // « au quel »*), par exemple, ou encore « parceque » au lieu de « parce que » (dont la première partie n’existe que dans ce cas de figure et ne signifie rien sans que l’on ait fait un travail étymologique).
D’ailleurs, nous trouvons une nouvelle explication pour certaines erreurs, ce que nous avons appelé dans notre mémoire de maîtrise en linguistique, une « volonté étymologisante »12. On le remarque surtout dans les cas d’ajout de lettres dont, pour l’essentiel, le < h > (« thyran », « éthymologiquement », « marthyrs »,…).
Toujours concernant l’ajout de lettres, nous constatons que les adolescents tendent à ajouter des < -s > à des mots qui ne doivent pas en porter. Nous expliquons ce cas par le fait que ces mêmes mots se trouvent dans des contextes au pluriel. On découvre donc une nouvelle cause aux erreurs : une « contamination » morphologique et/ou sémantique.
Si nous passons à la catégorie « syntaxe » et, plus précisément, à la sous-catégorie « Reprise et expression du sujet de du référent », nous ne pouvons que répéter les observations émises supra : les filles montrent un déficit qui se manifeste par l’usage d’un pronom qui ne connaît aucun référent exprimé ; les garçons, quant à eux, commettent des erreurs de manière égale dans la reprise avec changement en genre, dans les références floues, dans les pronoms sans références et dans les cas d’anaphores par syllepse.
12 PATOUT Pierre-André, La « faute » dans les copies du cours de français chez des élèves de
quatrième, cinquième et sixième années du secondaire de l’enseignement général, Mémoire,
Bruxelles, 2012.
20
Nous ne dégageons donc, ici, aucune cause à ces erreurs, mais plutôt des tendances. Nous pensons – et cette remarque a une valeur générale, voire « universelle » – qu’une fois que l’on connaît la/les cause/s ou bien une fois que l’on sait où chercher les erreurs potentielles, la « rééducation »13 se fait plus facilement et de façon plus ciblée.
Pour ce qui est des erreurs de « choix lexicaux », les erreurs sont, pour nous, nettement issues d’une connaissance dans le domaine du lexique qui est lacunaire, bancale, mauvaise. Mais cela s’applique aussi à l’utilisation erronée d’expressions, locutions, etc. et dans le mauvais usage sémantique et syntaxique de ces mots, formules,…
Finalement, pour les erreurs concernant les « redondances », nous ne nous les expliquons que par de l’inattention, quelques lacunes dans le style, un manque de relecture (flagrant quand nous voyons répéter la même phrase, mot pour mot, successivement) et une tendance à l’hyper-correctisme qui se traduit par la volonté d’user d’un style ampoulé mal maîtrisé (produisant, notamment des tournures pléonastiques).
6. Confrontations avec différentes thèses et théories Dans les chapitres précédents, nous avancions en cherchant des
explications et en tentant de confirmer ou infirmer nos présupposés. Ici, nous reprendrons diverses théories issues de la littérature scientifique qui nous permettront de découvrir d’autres raisons aux erreurs des adolescent(e)s en français, en quatrième, cinquième et sixième années du secondaire de l’enseignement général.
6.1. Henri Frei et sa « Grammaire des fautes » Contrairement à M. Frei qui a étudié un corpus oral en faisant des retours
sur l’écrit, nous, nous avons choisi de travailler sur un corpus écrit, ne retournant que ponctuellement sur des considérations orales. Autrement dit, nous avons pris le parti d’étudier un système de signes qui rend compte des sons de la langue… ou plutôt qui en rendait compte car, en effet, le français écrit est très (voire « trop », selon certains) conservateur, même archaïque, malgré les réformes orthographiques, les nouveaux termes qui rentrent dans les dictionnaires, la féminisation de plus en plus courante de certains termes, etc. C’est pourquoi,
13 Nous parlons de « rééducation » car, en quelques sortes, à ce niveau-là, les règles – qu’elles
soient correctes ou erronées – sont fortement imprégnées dans l’esprit de l’Élève qui doit
déconstruire ses conceptions fausses / incorrectes et en apprendre de nouvelles.
21
quand Henri Frei voit, dans un déficit, une marque d’évolution, nous ne pourrons pas en dire autant.
Le point de vue fonctionnaliste de M. Frei fait qu’il a une vision de la langue comme à moyen de communication et dont les principes régisseurs sont l’économie, l’expressivité et la simplicité. De là, si la langue écrite suit les mêmes règles, un écart, une déviance par rapport à ce système (contraignant et conventionnel), tendrait à rendre la communication moins facile, son respect permettant, alors, un transfert favorable de l’information.
De plus, pour ce qui est du langage écrit et du langage oral, en linguiste qu’il est, Henri Frei nous dit que « toute vérité entre par les oreilles, toute sottise par les yeux »14. Il verra, tout de même, dans les deux modalités d’expression, une accumulation, en quantité variable, de « besoins ».Et donc, à l’instar de M. Frei, nous chercherons les mécanismes qui sont sous-jacents aux changements. En effet, comme Charles Bally, son maître, il prétend – et nous partageons cette idée – que les erreurs remplissent, en réalité, des fonctions. Cela mène Frei à proposer une typologie des « fautes » qu’il applique au langage oral mais que nous pouvons rapprocher sans heurts du langage écrit.
Nous avons cité les phénomènes d’analogie, mais Henri Frei approfondit cette idée en précisant quelle(s) sorte(s) d’analogie entre(nt) en jeu. Nous avons donc une analogie sémantique qui explique que, par ricochet, une erreur orthographique rend compte d’un changement d’interprétation (péage qui s’écrira payage, par exemple).
Ensuite, les cas de confusions que nous retrouvions dans la catégorie « choix lexicaux » se trouvent expliqués par « l’instinct analogique »15 qui peut conduire à faire passer un signe dans une catégorie grammaticale toute différente.
Ensuite, vient l’analogie formelle, c’est-à-dire, le fait de modifier un mot, un groupe de mot,… suivant le modèle d’un autre syntagme proche et dominant. Selon Henri Frei, cela arriverait par méconnaissance de la bonne forme : « il faut mieux » plutôt que « il vaut mieux », ou encore « desur » qui mêle « dessus » et « sur ». Ainsi, nous rapprochons cette analogie formelle de notre conception de l’hyper-correctisme.
Les « popularismes », l’analogie et les confusions que nous trouvons dans les copies analysées nous semblent expliquées par ce qu’Henri Frei ajoute sur
14 FREI H., La Grammaire des Fautes, Genève, Stalkine Reprints, 1971, p.36 15 Ibid. p.46
22
l’instinct analogique, il « joue un rôle particulièrement important dans l’absorption, par le langage populaire, des éléments savants, étrangers ou relativement inconnus. Le français avancé cherche à s’assimiler ces éléments en les pétrissant à la populaire, c.à.d. en les ramenant à la norme la plus commune et la plus fréquente »16.
Plus loin, dans le chapitre III de sa Grammaire des fautes, il nous parle de
« bachysémie », qu’il définit comme le « figement d’un syntagme, c.à.d. d’un
agencement de deux ou plusieurs signes, en un simple » 17. C’est un concept que
l’on retrouve plus tôt chez Saussure sous le nom d’agglutination. Tous deux y
voient un processus diachronique tandis que nous le voyons aussi comme
totalement synchronique. C’est le cas, dans nos copies, de « parceque » ;
« desur » ; « enfait » ; etc. Cela, Henri Frei l’explique comme : « la condition
essentielle qui domine toute brachysémie est (…) l’incompréhension plus ou
moins forte des éléments. Cette incompréhension se produit (…) lorsque la
mémoire ne parvient pas à rattacher les éléments du syntagme au reste du
système, puisque l’entendeur tend toujours à interpréter les syntagmes en les
ramenant à l’usage le plus communément reçu »18.
Enfin, un dernier concept qu’Henri Frei avance et qui explique plusieurs dysfonctionnements écrits (que nous retrouvons dans nos copies) est le besoin d’invariabilité19. Nous l’entendons comme l’explication pour l’utilisation de termes dans des registres, domaines et contextes inappropriés, ainsi que comme l’usage des « mots passe-partout ». De même, l’absence d’accord / accord au masculin singulier semble participer de ce phénomène, sorte de « transposition syntagmatique »20 où sont mis en jeu les liens qui unissent les mots et les syntagmes entre eux.
16 Ibid. p.52 17 Ibid. p.109 18 Ibid. p.112 19 Ibid. p.131 20 Ibid. p. 161
23
6.2. Approches psycholinguistiques et cognitives Il est clair que notre approche, en plus de coller à la vision fonctionnaliste
de Frei, part de l’idée que des processus mentaux sont pour une certaine part dans les erreurs que nous avons retrouvées. Les thèses cognitivistes et psycholinguistiques que nous reprenons ici nous aident à y voir plus clair dans cette optique.
Notons, cependant, que les théories que nous reprenons, n’abordent que de loin notre sujet de préoccupation qui est « les « fautes » chez l’adolescent de quinze à dix-neuf ans dans des copies de « travaux réguliers » ou d’examens ». Ainsi, bien que la littérature que nous utilisons traite essentiellement de l’acquisition et de l’apprentissage de l’orthographe, les « vérités » qui y sont proposées trouvent un écho à caractère général dans les erreurs relevées dans nos copies.
6.2.1. Acquisition de l’orthographe Dans l’ étude21de Sylvie Bousquet, Danièle Cogis, et al., se trouve l’idée
déjà avancée par Henri Frei que les erreurs n’arrivent pas par hasard. Pour ces auteurs, « les erreurs d’orthographe résultent de calculs « de bonne foi » et ne sont ni le fait du hasard, ni celui d’une inattention de leurs auteurs »22. En effet, ces chercheurs prétendent que dans nos sociétés profondément liées à l’écriture, l’Homme apprend à écrire et à lire seulement s’il a développé certaines compétences. Mais plus, il analyse de manière explicite et consciemment sa parole, son langage.
Les auteurs de cette étude se basent, notamment, sur les expertises que Jaffré23 a opérées concernant les « orthographes inventées ». Ces travaux nous démontrent que la compétence en orthographe découle de diverses activités que l’on qualifierait de « pré-orthographiques », ou juste « graphiques », durant le développement. Cela se résume en disant que plus l’individu-sujet sera jeune, plus sa conception du langage sera fonctionnelle, sorte d’outil servant uniquement à la
21 BOUSQUET Sylvie, COGIS Danièle, DUCARD Dominique, MASSONNET Jacqueline, JAFFRE Jean-
Pierre, « Acquisition de l’orthographe et modes cognitifs », Revue française de pédagogie, 126
(1999), pp.23-37.
22 Ibid. p.24 23 Ibid. p.26
24
communication. Dès lors, Jaffré (JAFFRÉ : 1995)24 dira que « le mot est bien une unité à « géométrie variable » ».
Plus loin dans leur étude, les chercheurs nous proposent comme raison que l’on peut vérifier que, pour les cas de dysorthographie, « la mémoire des formes est toujours sujette à des confusions provoquées par l’homophonie, qui reste une zone de fragilité dans des situations où l’effort ne porte pas principalement sur l’orthographe et où un contrôle en différé est toujours nécessaire »25.
Dès lors, cela corrobore ce que nous avancions plus haut quant aux erreurs plus nombreuses présentes dans les copies d’examen : le contexte (stressant), ajouté au travail à opérer (plusieurs exercices et tâches variés en plus d’une dissertation en un temps imparti) et au manque de temps pour la relecture (autrement dit, le « contrôle en différé ») entraineraient comme conséquence logique ces nombreuses erreurs.
6.2.2. L’orthographe et le cas de l’illettrisme Marie-Anne Schelstraete et Christelle Maillart expliquent, dans leur
étude26, que, pour l’acquisition et la maîtrise de la compétence d’écriture d’un langage, la mémoire phonologique est essentielle, première et même primordiale.
Leur thèse s’articule surtout autour de l’oralité, c’est pourquoi elles estiment que « la connaissance puis l’application des règles de grammaire à l’écrit ne sont possibles que si elles sont maîtrisées à l’oral »27. Cela les amène à poser qu’il existe une réserve, limitée, dans laquelle, tous les éléments qui sont mobilisés pour produire un écrit, trouveront leurs ressources. Ainsi, pour éviter les surcharges cognitives, il résulte de ce que nous venons d’exposer que les éléments seront sans cesse réorganisés et coordonnés.
Lorsque l’on acquiert un système d’écriture, les processus d’activité scripturale spécifiques ne font pas encore l’objet d’automatisations / d’automatismes. Dès lors, plus une langue et son code écrit seront complexes, plus les ressources nécessaires à mobiliser pour la production seront nombreuses. C’est justement le cas, entre autres, de l’« opacité » du français.
24 Ibid. p. 32 25 Idib. P.32 26 MAILLART Christelle, SCHELSTRAETE Marie-Anne, « Approche psycholinguistique des
difficultés orthographiques des personnes illettrées », à paraître dans Question de Logopédie, 22p. 27 Ibid. p.15
25
Ainsi, nous prenons conscience que la dimension orale ainsi que la conscience métalinguistique et la conscience métaphonologique, de même que les capacités cognitives, ont un rôle extrêmement important à jouer lors de l’acquisition et de la maîtrise d’un système graphique d’écriture nécessitant l’usage de règles orthographiques et grammaticales.
6.2.3. Apprendre l’orthographe Généralement, les études concernant l’orthographe et son apprentissage
s’axent essentiellement sur la phonétique et la phonologie. Or, l’étude28 de Murielle Rogis Radebaugh (et al.) montre combien la vision et l’aspect sémantique occupent une place et un rôle non négligeables.
L’analyse et l’étude des orthographes et écritures inventées ont mis en lumière divers processus mentaux successifs dans le développement d’un système d’écriture, d’un code écrit. L’une de ces étapes est ce qu’elles nomment la phase phonétique, où chaque phonème a son graphème univoquement. Viendra plus tard dans le développement la phase de transition, où l’enfant utilisera toutes les lettres d’un mot pour le construire sans systématiquement pouvoir les organiser dans le bon ordre, « tâtonnant » en quelque sorte. C’est lors de cette phase qu’il acquerra l’intuition de l’écriture d’un terme, sans qu’il ne le connaisse, sur seules bases de modèles visuels et de modèles morphologiques, « juste » par reconnaissance.
Dès lors, cette étude nous amène à penser que les adolescent(e)s qui présenteront beaucoup d’erreurs par copies auront un déficit à l’un de ces deux niveau et, selon nous, plus particulièrement, lors de la phase de transition.
6.2.4. L’orthographe, une approche fonctionnelle Dans l’article « Une approche cognitive fonctionnelle de l’orthographe
grammaticale »29 de Largy et Fayol, nous abordons le sujet des causes cognitives dont certaines erreurs seraient les conséquences. Ces deux théoriciens se centrent surtout sur l’orthographe grammaticale mais, comme précédemment, nous voyons dans leurs théories et dans leur approche des données à caractère général, pouvant s’appliquer divers types d’erreurs. Ainsi, pour eux, une « même erreur peut avoir
28 ROGIS RADEBAUGH Muriel, DISTEFANO Philipp P., HAGERTY Patricia J., MOUSSEAU
Jacques, RICHAUDEAU Elina, « Apprendre l'orthographe », Communication et langages. 67
(1986), pp. 60-69. 29 FAYOL Michel, LARGY Pierre, « Une approche fonctionnelle de l’orthographe
grammaticale », La langue française, 95 (1992), pp.80-96.
26
des causes bien différentes selon le niveau de développement et/ou d’apprentissage »30.
Alors que la plupart des enseignants « drillent » leurs élèves par des exercices répétés et réguliers dans le but de leur faire assimiler des règles, Fayol et Largy estiment que l’on peut « faire apparaître que, au moins à partir d’un certain niveau scolaire, des erreurs, même si elles sont les mêmes qu’avant, ne relèvent pas des mêmes mécanismes »31.
Les concepts sur lesquels ils basent leur étude sont ceux concernant les connaissances déclaratives et les connaissances procédurales32. Et ce sont bien ces dernières qui semblent à l’origine de certains dysfonctionnements. En effet, quand il s’agit d’appliquer des règles, plusieurs phases/stratégies s’activent. Celles-ci ont été reprises par le domaine de l’informatique et de l’ingénierie et, spécialement, dans le cadre du développement de l’intelligence artificielle :
1. Le « déclenchement à bon escient » 33, c’est-à-dire qu’il y a des conditions spécifiques nécessaires qui président au déclenchement des processus cognitifs à mettre en jeu.
2. Leur « maintien en activité »34, qui veut que ces processus restent actifs jusqu’à ce qu’une ou plusieurs autres conditions enclenchent leur « arrêt ». Ce qui peut être très coûteux cognitivement.
3. L’acquisition de ces processus cognitifs. Cela se déroule en plusieurs étapes :
a. Le repérage et la détection des contextes dans lesquels les procédures seront déclenchées.
b. Une fois la/les condition/s assimilée/s, une association se fait avec la/les action/s à produire.
c. Plus la phase (b) sera sollicitée et plus les associations, les processus et les actions seront automatisés.
Pour éviter que le coût cognitif ne soit trop élevé, des stratégies sont mises en place. D’abord, comme mentionné ci-dessus, l’automatisation, ensuite, la
30 Ibid. p.80 31 Ibid. p.83 32 Les premières appartiennent au « savoir » (maîtrise de l’orthographe des mots et connaissance
des règles, mais pas leur utilisation) et les secondes au « savoir faire » (application des règles). 33 FAYOL Michel, LARGY Pierre, « Une approche fonctionnelle de l’orthographe
grammaticale », La langue française, 95 (1992), p.81 34 Ibid. p.82
27
« conduite « en parallèle » de plusieurs activités »35 (conduire simultanément deux « activités contrôlées »36 est moins aisé que lorsque l’une d’elles, au moins, est automatisée), et enfin « l’utilisation de stratégies »37 (autrement dit, « l’agencement, contrôlé dans le temps, des diverses composantes d’une activité donnée »38).
Ce sera durant ces procédures que les erreurs apparaitront. Cela peut se déroulé à des niveaux divers : (1) Le sujet écrivant ne parvient pas à enclencher systématiquement une procédure qui lui est trop coûteuse cognitivement ; (2) les règles sont totalement méconnues ; (3) la « seule connaissance déclarative (…) sans capacité à mettre en œuvre la procédure correspondante »39 ; (4) parce qu’un processus continue d’être activé alors que des conditions qui limitent sa mobilisation sont remplies et doivent, normalement, mener à une « gestion contrôlée » 40.
Ainsi, après de multiples expériences portant sur ces différents niveaux, Fayol et Largy ont mis en avant ce qu’ils appellent des « erreurs d’experts » 41. Celles-ci concernent les point (1) et (4) que nous venons d’expliciter. Quand la tâche à effectuer sollicite plusieurs processus et procédures, cognitivement, le coût et la charge augmentent significativement, entraînant donc une détérioration des performances alors que, en réalité, les procédures sont connues et maîtrisées, et que leur mobilisation se fait sans problème dans d’autres contextes moins « coûteux ».
Ils précisent leur thèse par des expériences portant sur « l’accroissement des difficultés de gestion en temps réel »42. Ils expliquent leur théorie comme suit :
« Quel que soit le niveau de maîtrise de la procédure requise, il semble possible, à condition d’augmenter le poids des contraintes de gestion, d’amener n’importe quel élève (ou enseignant ?) à commettre des erreurs (…). Il semble donc que l’erreur soit inhérente au fonctionnement même de notre système cognitif et que son occurrence soit liée non seulement à l’existence des connaissances (déclaratives ou procédurales) mais aussi à
35 Ibid. 36 Ibid. p.83 37 Ibid. 38 Ibid. 39 Ibid. 40 Ibid. 41 Ibid. p.86 42 Ibid. p.95
28
leur gestion en temps réel dans le cadre d’activités plus ou moins complexes à conduire en parallèle avec d’autres »43.
Ainsi, les données que nous avons recueillies plus haut et qui nous amenaient à dire que les copies d’examens comportaient plus d’occurrences d’erreurs que les copies de « travaux réguliers » trouvent une explication dans la théorie de ces deux chercheurs.
6.2.5. Danielle Leeman-Bouix, « Les fautes de français existent-elles ? »44
Dans le chapitre intitulé « D’où viennent les fautes ? », elle reprendra les invectives puristes qui dénoncent « l’anglomanie des Français » 45 et, plus précisément, les incriminations portant sur l’arrangement syntagmatique qui place le déterminant devant le déterminé. Ainsi, elle déconstruit les idées réactionnaires voulant que cela soit une tournure anglophone en prouvant que le grec et le latin, langues que les puristes aiment à invoquer, pratiquaient les mêmes procédés. C’est pourquoi, Danielle Leeman-Bouix proteste : « cette explication par l’ignorance ou l’inculture est difficile à accepter dans la mesure où les erreurs ainsi signalées ne sont pas le fait d’illettrés »46 (au contraire, d’ailleurs, puisque nous retrouvons ces écarts chez des journalistes, politiciens et autres personnages publiques).
L’auteure tend à expliquer ces erreurs par nos conditions de travail et, surtout, par nos conditions de vie qui veulent que nous vivions dans la rapidité, dans l’instantané, dans la précipitation. Les conditions-mêmes dans lesquelles nous produisons nos textes sont à la fois causes et origines de la plupart des dysfonctionnements que nous repérons.
Ensuite, quand il s’agit d’expliquer les erreurs, nous entendons aussi qu’il est plus facilement permis de manipuler le vocabulaire et le lexique que la morphologie et/ou la syntaxe. Or, selon Mme Leeman-Bouix, ce n’est que fantasme. Le lexique n’est pas plus accessible et compréhensible que la syntaxe ou la morphologie, on ne peut pas faire dire à un mot (qu’il soit substantif, verbes, ou autre) tout ce que l’on voudrait. « Les changements concernent en quelque
43 Ibid. p.96 44 LEEMAN-BOUIX Danielle, Les fautes de français existent-elles ?, Paris, Seuil, 1994, 155p.
45 Ibid. p.99 46 Ibid. p.101
29
sorte des impératifs (…) dont le non-respect n’altère pas l’intercompréhension, qui donc permettent la variation »47.
Nous le voyons, la notion d’erreur, de « faute », est très largement empreinte de subjectivité. Cet ouvrage nous permet de jeter un regard plus nuancé sur les justifications souvent avancées pour expliquer les erreurs.
6.2.6. Nina Catach, défenseuses des réformes Pour elle, et nous rejoignons ce point de vue, une erreur devient « faute »
uniquement par le « refus » et le manque d’explication mais aussi, et surtout,
uniquement en fonction d’une norme. Elle s’explique en rapportant que
« l’ignorance de ce qui concerne l’évolution de la langue, de ce qui s’est fait à
l’étranger, des changements inéluctables de l’écrit comme de l’oral compte pour
beaucoup dans les hésitations et la perplexité (…) quand on leur propose [aux
Français] de toucher à quoi que ce soit. Mais compte aussi, et davantage peut-être,
l’absence de théories (…) cohérentes et unifiées à ce sujet »48.
De plus, l’une des thèses que Mme Catach défend – et que nous retrouvons
plus ou moins chez Henri Frei – est que « ce qu’on appelle les « fautes » forme
une part obligée des messages, la trace d’une évolution (…). Les fautes
d’aujourd’hui font la langue de demain »49.
La langue française – comme toute langue – s’apparente donc à tout
organisme vivant, qui vit, qui évolue, qui n’est qu’une somme complexe de
variantes et de variations. Ainsi, pour la chercheuse, pour qu’il y ait évolution des
variantes, il faut qu’entrent en jeu :
« Les principes de base d’une évolution à long terme sont d’abord, bien entendu, la prise en compte de l’histoire, l’expérience du passé, le respect des usages établis ; le choix de revendications progressives et raisonnables, sur des points inscrits dans l’évolution et demandés depuis longtemps, biens connus et délimités par l’ensemble des usagers.
Mais surtout et avant tout, à notre époque, deviennent nécessaires une approche globale de la langue et de l’écriture, l’étude préalable des dossiers sur des bases scientifiques, à la fois quantitatives et qualitatives ; en particulier, une bonne description de notre système linguistique actuel, oral et écrit » 50.
47 Ibid. p.125 48 CATACH Nina, « Mythes et réalités de l'orthographe », Mots, 28. (1991), p.6 49 Ibid. p.11 50 CATACH Nina, « Le problème des variantes graphiques : variantes du passé, du présent et de
l’avenir », Langue française, 1995, p.31
30
7. Conclusion
Par une analyse « de terrain » faite sur des copies d’élèves du dernier cycle du secondaire de l’enseignement général de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons tenté de dégager de faire ressortir des « constantes » et d’élaborer des hypothèses servant à expliquer les erreurs.
Ensuite, nous avons comparé et confronté ces mêmes pistes d’explications à des thèses et théories éprouvées de manières scientifiques et rigoureuses. Certaines de nos propositions se sont vues confirmées à plusieurs reprises, quelques points que nous n’arrivions pas à expliquer ont trouvé des précisions et, enfin, nous avons réussi à dégager plusieurs perspectives d’explicitation diverses.
Nous nous étions donné pour but de mettre en avant des « forces » et des mécanismes qui sous-tendent la production d’erreurs dans des copies du cours de français chez des adolescent(e)s – dont l’âge varie entre quinze et dix-neuf ans – de l’enseignement général. Plus déficits sont revenus de manière récurrente, quelques fois nous avons eu affaire à des hapax,… et nous n’avons pu découvrir, à chaque fois, pour tous ces écarts, quelque raison plausible.
Nous avons ainsi tenté de trouver des explications dans divers théories et dans des domaines variés mais, comme l’expose Danielle Leeman-Boouix, « expliquer ne veut pas dire nécessairement excuser, explication n’est pas synonyme de laxisme ; mais on peut alors découvrir que bon nombre de condamnations se fondent – lorsque les justifications sont données – sur des « règles » contestables »51.
Le problème latent que nous nous efforçons d’étouffer est que la conception de l’erreur est, quoi qu’on en dise, toujours liées à la notion de « faute ». Malheureusement, depuis le « péché originel », en passant par la « faute de goût », et jusqu’à la fameuse « faute de français »52, toutes acceptions du mot ont toujours été connotées négativement. C’est pourquoi nous pensons que si l’on fait l’effort de COMPRENDRE l’erreur et ses causes, si nous tentons d’y trouver une explication, la « faute » ne sera plus synonyme de « mauvais » mais de progrès. Danielle Leeman-Bouix résume à peu près ce sentiment en expliquant qu’« il
51 LEEMAN-BOUIX Danielle, Les fautes de français existent-elles ?, Paris, Seuil, 1994, p.133 52 Notion pour le moins floue, d’ailleurs.
31
s’avère que la « faute » est très difficile à prouver dans la mesure où l'innovation trouve en général sa justification dans le système linguistique lui-même »53.
Malgré l’abondance de littérature sur le sujet, nous pensons très clairement que nous ne sommes encore qu’aux prémices de la recherche dans le domaine de l’explication de l’erreur. Et nous ajouterons que les mentalités ne sont, malheureusement, pas prêtes de changer de sitôt leur rapport à l’erreur et à la norme.
Cependant, comme Henri Frei et d’autres avant nous, nous aimons à croire qu’une « faute » n’est que la manifestation concrète d’un besoin, d’un manque, dans la langue. Nous pensons même qu’il serait possible qu’il s’agisse d’un phénomène particulier, propre à un individu, et dont les causes pourraient des explications dans d’autres facteurs (psychiques, cognitifs, psychologiques, voire physiques). Ainsi, si ce cas « particulier » se retrouve chez d’autres individus – peut-être même dans d’autres populations, d’autres langages, etc. –, il ne serait pas vain de prétendre qu’à l’origine de ce dysfonctionnement se rencontrent les mêmes raisons.
Nous synthétiserons donc notre exposé en présentant le fait qu’une erreur connaît, au moins, une cause, et cette dernière est relative à un besoin ou à un déficit, un dysfonctionnement. Cette cause se trouvera être soit conséquence d’une lacune ou d’une altération, soit résultat ou facteur d’une évolution.
53 LEEMAN-BOUIX Danielle, Les fautes de français existent-elles ?, Paris, Seuil, 1994, p.137
32
Table des matières 1. Introduction ..................................................................................................... 2
2. Un travail de terrain ........................................................................................ 3
3. Un rapport triangulaire à l’Erreur ................................................................... 5
4. Le statut (fluctuant) de l’Erreur et de l’Échec ................................................. 6
5. Analyse de copies d’élèves de quatrième, cinquième et sixième année du secondaire issues de production écrite à Arlon, Tubize et Namur .......................... 8
5.1. Présentation .............................................................................................. 8
5.2. Premières observations après lecture des données recueillies .................. 9
5.3. Deuxième lecture, nouvelles observations ............................................. 10
5.4. Études critériées ..................................................................................... 13
5.4.1. La région ......................................................................................... 13
5.4.2. Le niveau d’étude ............................................................................ 14
5.4.3. Le type de copie .............................................................................. 15
5.4.4. Le genre sexué................................................................................. 16
5.4.5. Synthèse .......................................................................................... 16
5.5. Analyse de la grille typologique « détaillée » : quelques causes possibles 18
6. Confrontations avec différentes thèses et théories ........................................ 20
6.1. Henri Frei et sa « Grammaire des fautes » ............................................. 20
6.2. Approches psycholinguistiques et cognitives ......................................... 23
6.2.1. Acquisition de l’orthographe........................................................... 23
6.2.2. L’orthographe et le cas de l’illettrisme ........................................... 24
6.2.3. Apprendre l’orthographe ................................................................. 25
6.2.4. L’orthographe, une approche fonctionnelle .................................... 25
6.2.5. Danielle Leeman-Bouix, « Les fautes de français existent-elles ? »28
6.2.6. Nina Catach, défenseuses des réformes .......................................... 29
7. Conclusion .................................................................................................... 30
Table des matières ................................................................................................. 32
Bibliographie ......................................................................................................... 33
Annexes ................................................................................................................. 36
Annexe 1 ........................................................................................................... 37
33
Bibliographie
ANONYME. Manuel de l'orthographiste, ou cours théorique et pratique
d’orthographe (…) suivi d’un traité des participes et d’un recueil d’exercices par
F. Trémery, seconde édition, Paris, Librairie Encyclopédique de Roret, 1883,
356p.
ANTOINE Grégoire, « Frei (Henri). La Grammaire des Fautes », Revue belge de
philologie et d’histoire, vol. 10, 1 (1931), pp.212-218.
BACCUS Nathalie, Grammaire française, Paris, Librio, 2006, 126p.
BOUSQUET Sylvie, COGIS Danièle, DUCARD Dominique, MASSONNET Jacqueline,
JAFFRE Jean-Pierre, « Acquisition de l’orthographe et modes cognitifs », Revue
française de pédagogie, 126 (1999), pp.23-37.
BOVET Ludmila, « Les fautes de français existent-elles ? », Québec français, 112
(1996), pp.98-100.
CATACH Nina, « La ponctuation », Langue française, 45 (1980), pp.16-27.
CATACH Nina, Les délires de l’orthographe en forme de dictioNaire, préface de
Philippe Saint-Robert, Paris, Plon, 1989, 351p.
CATACH Nina, « Mythes et réalités de l'orthographe », Mots, 28. (1991), pp. 6-18.
CATACH Nina, « Les enjeux sociaux de l’orthographe », Le Langage et l’Homme,
1 (1994), pp. 03-14.
CATACH Nina, « Le problème des variantes graphiques : variantes du passé, du
présent et de l’avenir », Langue française, 1995, pp.25-32.
CHEVALIER Jean-Claude, « Henri Frei, La grammaire des fautes », Histoire
Épistémologie Langage, Vol. 27, 1 (2005), pp.210-211.
DUBOIS Jean, SUMPF Joseph, MEYRAT Michèle, « L'orthographe », Langue
française, N°5, 1970, pp.100-117.
FAYOL Michel, « Une approche psycholinguistique de la ponctuation. Étude en
production et en compréhension », Langue française, 81 (1989), pp.21-39.
FAYOL Michel, LARGY Pierre, « Une approche fonctionnelle de l’orthographe
grammaticale », La langue française, 95 (1992), pp.80-96.
34
FREY Henri, La Grammaire des Fautes, Genève, Stalkine Reprints, 1971, 319p.
GHAYE B., MAINGUET Ch., REGINSTER I., Jauniaux N., TALBOT B., « Spécificités
locales de parcours scolaies en Fédération Wallonie-Bruxelles », Working Paper
de l’iweps, 8 (mai 2012), 25p.
GUION Jean, « A propos de l’orthographe », Langue française, 20 (1973), pp.111-
118.
HACHEZ Théo, WYNANTS Bernadette, « Les jeunes du secondaire et la norme du
français écrit », Français & Société 3 (1991) (Publication de la Communauté
Française de Belgique).
HELGORSKY F., « La grammaire des fautes de Henri Frey », Le Français
Moderne, 423 (1973), pp.423-428.
JUNG Edmond, « Causes des fautes d’orthographe », Langue française, N°20,
1973, pp.97-110.
LEEMAN-BOUIX Danielle, Les fautes de français existent-elles ?, Paris, Seuil,
1994, 155p.
MAILLART Christelle, SCHELSTRAETE Marie-Anne, « Approche psycholinguistique
des difficultés orthographiques des personnes illettrées », à paraître dans Question
de Logopédie, 22p.
MERVIN Morgane, La faute d’Orthographe, mémoire, Bruxelles, 2010.
MILOT Jean-Guy, « L’institution Orthographe », Québec français, 17 (1975), p.
34-35.
MULLER Charles, « L’orthographe est une norme », Conseil international de la
langue française, 18 juin 2009, http://www.cilf.fr/f/index.php?sp=page&c=9,
consulté le 19 octobre 2010.
PATOUT Pierre-André, La « faute » dans les copies du cours de français chez des
élèves de quatrième, cinquième et sixième années du secondaire de
l’enseignement général, mémoire, Bruxelles, 2012
PAVEAU Marie-Anne, ROSIER Laurence, GADET Françoise, Langue française,
passions et polémiques, Paris, Vuibert, 2008, 380p.
35
PECH Marie-Estelle, « Comment sont corrigées les copies du baccalauréat », Le
Figaro, 16 juin 2008, http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/06/16/01016-
20080616ARTFIG00283-comment-sont-corrigees-les-copies-du-
baccalaureat.php, consulté le 28 février 2012.
PETITJEAN Luce, « Nina Catach, Les délires de l’orthographe en forme de
dictionnaire », Mots, 26 (1991), pp.134-136
PETITJEAN Luce, TOURNIER Maurice, « Repères pour une histoire des réformes
orthographiques », Mots, 28 (1991), pp. 108-112.
REY Véronique, Écriture, orthographe, dysorthographie, Aix-en-Provence,
Publications de l’Université de Provence, 2008, 190p.
ROGIS RADEBAUGH Muriel, DISTEFANO Philipp P., HAGERTY Patricia J.,
MOUSSEAU Jacques, RICHAUDEAU Elina, « Apprendre l’orthographe »,
Communication et langages. 67 (1986), pp. 60-69.
ROSIER Laurence, « Nouveaux regards sur le purisme », Le Français Moderne,
76e année, 1 (2008), pp.38-50.
SLACK Anne, « Le coin du pédagogue », The French Review, vol.50, 1 (1976),
pp.83-85.
Simon Jean, « Étude psychopédagogique de l’orthographe », Enfance, Numéro
Spécial, 1952, pp.481-490.
SIOUFFI G., VAN RAEMDONCK, D., 100 fiches pour comprendre la grammaire,
Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007, « Fiche 29 – La faute » (pp.64-65).
SIOUFFI G., VAN RAEMDONCK, D., 100 fiches pour comprendre la linguistique,
Rosny-sous-Bois, Bréal, 2009, 224p.
TOURNIER Maurice, « Nina Catach (dir.), Dictionnaire historique de l’orthographe
française », Mots, 46 (mars 1996), pp.134-137.
TOURNIER Maurice, « Nina Catach, L’orthographe en débat. Dossier pour un
changement », Mots, 31 (juin 1992), pp.133-134.
GROUPE D’ETUDE EN HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE (G.E.H.L.F.),
Grammaire des fautes et français non conventionnel, Actes du IVe Colloque
International, (Paris, décembre 1989), 400p.
37
Annexe 1 ORTHOGRAPHE Types Sous-types Incidence
de la phonétique
Erreurs
GRAMMATICALE Homophonie Diacritique Ajout // Absence
Homonymes Confusion Mode Avec
changement phonétique
Sans changement phonétique
Flexion Verbale – Flexion Nominale
Avec changement phonétique
Sans changement phonétique
Flexion entre 2 conjugaisons OU entre 2 verbes phonologiquement proches
Avec
Sans
Flexion de la personne Avec Sans
Flexion du pluriel Avec Sans
Accord Genre Féminin au lieu de masculin
Avec
Sans
Masculin / pas d’accord au lieu de féminin
Avec
Sans
Nombre Singulier / pas d’accord au lieu de pluriel
Avec
Sans
Pluriel au lieu de singulier
Avec
Sans
Genre et Nombre Avec
Sans
38
Absence de flexion Avec Sans
Absence de consonne épenthétique phonologique
Avec
Sans
Inclassables
LEXICALE Types Sous-types Incidence de la
phonétique
Erreurs
Mots Soudure Avec Sans
Scission de mots simples
Avec Sans
Scission de mots composés par absence de trait(s) d’union ou d’apostrophe
Avec
Sans
Mauvais découpage syllabique
//
Graphème(s) Homophonie hors contexte
//
Homophone en contexte déterminé
//
Lettre(s) Ajout Avec Sans
Absence Avec Sans
Commutation Avec Sans
Confusion Avec
Sans Gémination de consonnes simples
Avec Sans
Simplification de consonnes géminées
Avec Sans
Diacritiques Absence Avec Sans
Ajout Avec Sans
Confusion Avec
39
Sans Nom propre Graphème homophone Avec
Sans Scission Avec
Sans Soudure Avec
Sans
Absence de lettre Avec Sans
Homonymie Avec Sans
Néologisme / erreur complexe
Avec
Sans Finale de mot(s) erronée Avec
Sans Confusion avec une orthographe étrangère
Avec Sans
Abréviations // Homonymie //
Néologismes / Erreurs complexes //
Grammaire Ce qui est écrit
Ce qui aurait dû être écrit
Incidence de la phonétique
Erreur
TEMPS, CONCORDANCES
ET CONJUGAISON
Subjonctif imparfait 3e sg.
Indicatif imparfait 3e sg.
Sans
Infinitif Indicatif présent 3e sg.
Avec
Indicatif présent 3e sg.
Participe passé Avec
Subjonctif présent 1e sg.
Indicatif présent 3e sg.
Avec
Subjonctif présent 3e sg.
Indicatif présent 3e sg Avec
Indicatif présent 3e sg.
Subjonctif présent 3e sg.
Sans
Indicatif présent « avoir » 1e sg.
Indicatif présent « être » 3e sg.
Avec
Indicatif présent 3e pl.
Indicatif imparfait 3e pl.
Avec
Indicatif Subjonctif présent 3e Avec
40
présent 3e pl. pl. Indicatif futur simple 1e sg.
Conditionnel présent 1e sg.
Avec
Indicatif futur simple 3e sg.
Conditionnel présent 3e sg.
Avec
Indicatif passé composé 3e sg.
Indicatif présent 3e sg.
Avec
Indicatif imparfait 3e sg.
Indicatif présent 3e sg.
Avec
Participe passé
Participe présent Avec
Indicatif passé simple 3e sg.
Indicatif présent 3e sg.
Avec
Indicatif passé composé 3e sg.
Indicatif passé simple 3e sg.
Avec
Indicatif présent 3e pl.
Indicatif passé simple 3e pl.
Avec
Conditionnel présent 1e sg.
Indicatif futur simple 1e sg.
Avec
Indicatif futur simple 3e sg.
Infinitif Avec
Subjonctif présent 3e sg.
Conditionnel présent 3e sg.
Avec
Indicatif futur simple 3e pl.
Conditionnel présent 3e pl.
Avec
Indicatif passé simple 2e sg.
Indicatif passé composé 2e sg.
Avec
Conditionnel présent 1e sg.
Indicatif imparfait 1e sg.
Avec
Indicatif présent 1e sg.
Indicatif passé composé 1e sg.
Avec
Indicatif 3e pl. Indicatif 2e pl. Avec
Indicatif 3e pl.
Indicatif futur simple dans un contexte au passé
Avec
Indicatif imparfait dans un contexte au passé simple
Avec
Mélange de temps //
41
Syntaxe Implique Causes de l’erreur Erreur REPRISE ET
EXPRESSION DU
SUJET ET DU
RÉFÉRENT
Pronom personnel
Sans sujet ou référent exprimé
Sans sujet exprimé mais dont le référent peut être reconstruit
Renvoyant à un terme qui n’en est pas le référent
Confusion due à la multiplication des pronoms personnels ne renvoyant pas au même référent
Pronom possessif
Renvoyant à un mauvais référent
Sans référent exprimé
Pronom démonstratif
Référent inaccessible / hors de portée
Syntagme nominal
Mauvaise reprise anaphorique
Sans sujet ou référent exprimé
Dont la référence est sous-entendue
Cataphore ?
Anaphore Reprise erronée du genre
Sur syllepse
« Par métonymie »
Par inférence
Cataphore et anaphore
Confusion
PHRASÉOLOGIE Type Sous-type
Casse Majuscule au lieu de minuscule
Minuscule au lieu de majuscule
Pronom Pronom personnel indirect au lieu de pronom personnel direct
Pronom démonstratif manquant dans
42
locution interrogative
Absence de pronom démonstratif
Négation Troncation
Absence
Mauvais agencement sur l’axe syntagmatique
Adverbe
Adverbe du degré de comparaison
Locution adverbiale
Complément circonstanciel
Adjectif
Proposition conditionnelle « si… comme… »
Absence du premier élément
Absence du deuxième élément
Élément superflu
Proposition COD
Article
Préposition
Négation
Adverbe
Pronom personnel
Élément absent
Article
Verbe
Conjonction de coordination / ponctuation
préposition
Substantif
Adverbe
Proposition relative
<Affirmative + indicatif> au lieu de «<Négative + subjonctif>
À la place d’un substantif
Zeugme Énumération incomplète dans sa forme
Confusion d’éléments
Conjonction de coordination au lieu d’une virgule
43
Interrogation redoublement
Avec inversion et sans pronom personnel
Structure corrélative
Absence du premier terme
Élision Absence
Ordre logique et temporel
Non respecté
Rappel d’un élément inaccessible au lieu de continuer sur l’idée en cours de « traitement »
Syntagme verbal
Deux verbes principaux dans une même phrase
<Proposition à un mode impersonnel> au lieu de <Proposition à un mode personnel>
Inclassables / Complexes
Style Types Sous-type Spécification supplémentaire
Erreurs
CHOIX
LEXICAUX Métonymie
Similarité Forme Locutions
Verbes
Sens Adverbes / locutions adverbiales
Verbes
Substantifs
Syntagme
Vocabulaire spécialisé / spécifique / élevé
Erreurs orthographiques
Erreurs d’utilisation
Confusion Pronoms relatifs
Prépositions
Conjonctions Subordination
44
Coordination
Monosyllabes
Expressions De sens proche
De forme proche
Verbe Sens proche mais forme différente
Forme proche mais sens différent
Construction transitive indirecte d’un verbe intransitif
Construction impersonnelle au lieu d’une construction personnelle
Vocabulaire
Adverbes / locutions adverbiales
Diathèses Voix active au lieu de voix passive
Voix passive au lieur de voix active
Voix active au lieu d’un emploi causatif
Natures COD au lieu d’un COI
Pronom possessif au lieu d’un article
Article au lieu de préposition
Article au lieu d’un pronom possessif
Article indéfini au lieu d’un article défini
45
<Article défini + substantif> au lieu d’un adverbe
Proposition relative au lieu d’un adjectif
Adjectif au lieu d’un adverbe
Adverbe au lieu d’un complément circonstanciel
Adverbe au lieu d’une conjonction de subordination
<Conjonction de coordination + indicatif> au lieu de <Conjonction de subordination + subjonctif>
Préposition au lieu d’un pronom relatif
Conjonction de coordination au lieu d’un pronom possessif
Proposition ‘complément circonstanciel de but’ au lieu d’une proposition au participe présent
<Pronom personnel représentant réfléchi 3e sg.> au lieu d’un
46
<Pronom personnel réfléchi 1e pl.>
Compléments circonstanciels
Conjugaison
Pronoms réfléchis
Nombre Pluriel au lieu de singulier
Construction prépositionnelle erronée
Pléonasmes
Paronymie
Antonymie
Élément superflu Préposition
Ponctuation
Zeugme
« ? » Complexité
Aucun sens
Inclassables
Mots passe-partout
Verbes
Substantifs
« Popularismes » Forme du mot
Tournure de la phrase
Expression populaire
Utilisation de connecteurs logiques
Élision incorrecte
Verbe pronominal
Absence du pronom
Erreurs de construction
Tournures ampoulées
Mal construites
« Surenchère »
Erreurs utilisation conjonction coordination
47
Ambiguïté sémantique
Structure corrélative
Périphrase erronée
Types Sous-types Erreurs REDONDANCES Pléonasme
Ajout Adverbe
Cataphore
Répétition du même au même
Substantif
Syntagme nominal
Adjectif
Phrase
Locution adverbiale
Adverbe
Syntagme verbal
Syntagme prépositionnel
Pronom relatif
Conjonction de coordination
Déterminant numéral
Verbe
Nom propre
SN + verbe + substantif
SN + substantif
Substantif + verbe
SV + adjectif