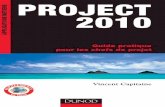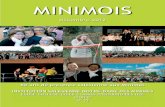AAC058 - MATERIALITE EN PROJET 05 - LYON
Transcript of AAC058 - MATERIALITE EN PROJET 05 - LYON
A t e l i e r . M a t é r i a l i t é - M A S T E RE N S A L - 2 0 1 2 - H AY E T- L a v i l l e e t l ’ e a u
05MATERIALITÉ EN PROJET
29012013
FRANCHIR LA SAONE BALME
MONTÉE DES 700 MARCHESSUR LES PENTES DE LA SAINTE FOY
de POULET OLIVIER
MATERIALITE EN PROJET 05
Synthèse des travaux pédagogiques des étudiants dans le cadre de l'Atelier "Matérialité - Architecture - LA VILLE ET L’EAU", MASTER MATÉRIALITÉ, École Nationale Supérieure d'Architecture de LYON, sous la direction de William HAYET, et encadré par Jean-Pierre MARIELLE, et Jean TABOURET.
AAC058-7657
SOMMAIRE AAC058-7659PLANCHES AAC058-7664INTRODUCTION AAC058-7672CHAPITRE 01 AAC058-7674DIAGNOSTIC GLOBAL - NOV 2011 AAC058-76741- Présentation globale de Lyon métropole:2- Un territoire, un parcours, des séquences: Lônes & Coteaux du RhôneObjectifs généraux du SCOT3- Diagnostic: Géographie - Géologie4- Diagnostic: Paysages5- Diagnostic: Infrastructures et flux6- Diagnostic: Les temps de la ville7- Diagnostic: social et économique8- Conclusion: Émergence d’enjeuxCHAPITRE 02 AAC058-7704LES ENJEUX - JANV 2012 AAC058-77041- Premières pistes de réflexions et de recherches2- RENDU E02: Expression des enjeux territoriauxUn parc urbain - Une respiration urbaineCHAPITRE 03 AAC058-7718SCHÉMA DIRECTEUR - FEV 2012 AAC058-77181- RENDU E03: HABITER LE FOND DE SCÈNEIntégrer St Foy à l’agglomération lyonnaise dans son propre développementet en préservant ses propres spécificitésCHAPITRE 04 AAC058-7728PROJET ONE SHOT - MARS 2012 AAC058-77281- Recherches: Analyse de dénivelé2- Recherches: Analyse PLU et Cycle de l'eau
3- RENDU E04: Franchir la Saône balme, la montée des 700 marchesCHAPITRE 05 AAC058-7750IN PROCESS - AVRIL 2012 AAC058-77501- Échelle urbano-architecturaleGrille thématique: le cercle MOWATT2- Recherches sur la composition du village dans la pente3- RENDU E05: Franchir la Saône balme, la montée des 700 marchesCHAPITRE 06 AAC058-7768IN PROGRESS - JUIN 2012 AAC058-77681- Problématiques urbainesStory baord de phasage2- Réflexions sur une école d'architectureCONCLUSION AAC058-7786QU'EST-CE QU'UN LIEU ? AAC058-7786BIBLIOGRAPHIE AAC058-7790LEXIQUE & ABRÉVIATIONS AAC058-7792ANNEXE 01 - SYNTHÈSE DES NOTES M1 AAC058-7798GRILLET, Yves, 2011 : SEM MATERIALITE 01, confé-rence, DEM Matérialité, École Nationale Supé-rieure d'Architecture de Lyon, le 14 octobre 2011.GAUVIN, Florimond, 2011 : SEM MATERIALITE 02, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 21 octobre 2011.MARIELLE, Jean-Pierre, 2011 : SEM MATERIALITE 03, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 04 novembre 2011.MASTRORILLI, Antonella, 2011 : SEM MATERIALITE 04, conférence, DEM Matérialité, École Nationale
AAC058-7658
SOMMAIRE
Supérieure d'Architecture de Lyon, le 18 novembre 2011.PETRI, Agnès, 2011 : SEM MATERIALITE 05, confé-rence, DEM Matérialité, École Nationale Supé-rieure d'Architecture de Lyon, le 25 novembre 2011.TABOURET, Jean, 2012 : SEM MATERIALITE 06, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 06 janvier 2012.RITZ, Emmanuel, 2012 : SEM MATERIALITE 07, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 13 janvier 2012.MACHUREY, Pierre-Marie, 2012 : SEM MATERIALITE 08, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 20 janvier 2012.GRAS, Pierre, 2012 : SEM MATERIALITE 09, confé-rence, DEM Matérialité, École Nationale Supé-rieure d'Architecture de Lyon, le 27 janvier 2012.MARIELLE, Jean-Pierre, 2012 : SEM MATERIALITE 11, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 17 février 2012.BOYADJIAN, C., 2012 : SEM MATERIALITE 12, confé-rence, DEM Matérialité, École Nationale Supé-rieure d'Architecture de Lyon, le 03 mars 2012.CHAVARDES, Benjamin, 2012 : SEM MATERIALITE 13, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 09 mars 2012.PERRREAU, Grégory, 2012 : SEM MATERIALITE 14, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 16 mars 2012.DESEVEDAVY, Gilles, 2012 : SEM MATERIALITE 15, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 30 mars 2012.DE BUSSIERRE, Arnaud, 2012 : SEM MATERIALITE 16, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 27 avril 2012.CHAVARDES, Benjamin, 2012 : SEM MATERIALITE 17, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 04 mai 2012.MASTRORILLI, Antonella, 2011 : 731-01 COURS MÉTHODOLOGIE MÉMOIRE RECHERCHE, cours, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure
d'Architecture de Lyon, le 05 novembre 2011.CHAVARDES, Benjamin, 2011 : 731-02 COURS MÉTHODOLOGIE MÉMOIRE RECHERCHE, cours, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 05 novembre 2011.MARIELLE, Jean-Pierre, 2012 : 812-02 COURS MATERIALITE-TERRITOIRE, cours, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 10 février 2012.DE BUSSIERRE, Arnaud, 2012 : 821-01 COURS MAÎTRISE D'OEUVRE, cours, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 11 février 2012.DE BUSSIERRE, Arnaud, 2012 : 821-02 COURS MAÎTRISE D'OEUVRE, cours, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 17 février 2012.DE BUSSIERRE, Arnaud, 2012 : 821-03 COURS MAÎTRISE D'OEUVRE, cours, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 03 mars 2012.ANNEXE 02 - EXTRAITS M1 AAC058-7842TABOURET, Jean, 2012 : SEM MATERIALITE 06, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 06 janvier 2012.DE BUSSIERRE, Arnaud, 2012 : SEM MATERIALITE 16, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 27 avril 2012.ANNEXE 03 - ÉTUDES M1 AAC058-7866POULET, Olivier, 2011 : Étude sur le Grand Paris, Travaux d'étude de cas, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon.POULET, Olivier, 2012 : Thèmes MIXITÉ, PAYSAGE et MOBILITÉ dans les Europan 05,09 et 10, Travaux d'étude de cas, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon.ANNEXE 04 - LECTURES M1 AAC058-7880MONGEREAU, Noêl, 2001 : Géologie de Lyon, Editions Lyonnaises d'Art et d'HistoireMONGEREAU, Noêl, 2001 : Géologie de Lyon, Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire
AAC058-7659
MONGEREAU, Noêl, 2001 : Géologie de Lyon, Editions Lyonnaises d'Art et d'HistoireSALES, Christian, Lyon secrets et légendes, DVD 182 minutesSALES, Christian, Lyon secrets et légendes, DVD 182 minutesVIDOR, King,1949 The fountainhead, fim d'après une nouvelle de Ayn RANDVIDOR, King,1949 The fountainhead, fim d'après une nouvelle de Ayn RANDVIDOR, King,1949 The fountainhead, fim d'après une nouvelle de Ayn RANDDANTEC, Maurice G., 2004, Villa Vortex, Edition Galimard FolioANNEXE 05 - TRANSECTS AAC058-7896POULET, Olivier, 2011 : Transect sur le quai des étroits, Travaux d'étude de cas, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon.ANNEXE 06 - PROTOTYPE AAC058-7908POULET, Olivier, 2011 : Workshop prototype bois cordé, DEM Matérialité, École Nationale Supé-rieure d'Architecture de Lyon.ANNEXE 07 - ÉTUDE DE CAS D'UN ÉDIFICE AAC058-7916POULET, Olivier, 2012 : Architecture des "trente glo-rieuses", Travaux d'étude de cas, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon.ANNEXE 08 - RÉFÉRENCES PROJETS AAC058-7924DURRER, Richard et LINGGI, Patrick 2003-2007 : Projet urbano-architectural, GONDO (Canton du Valais, Suisse)CITÉE PRÉCOLOMBIENNE - CUIDAD PERDIDA, Sierra Nevada de Santa Marta (Colombie)ZUMTHOR, Peter 2005 : Pension brion et maison Annalisa, LEIS (Canton des Grisons, Vals, Suisse)RENAUDIE, Jean 1976-1982 : Les étoiles, GIVORS (France)SNOZZI, Luigi 1963-65 : Row Houses Taglio, ORSE-LINA (Canton du Tessin, Suisse)
SCHINDLER, Rudolf M. 1931 : WOLFE Summer House, SANTA CATALINA (California, USA)SOUTO de MOURA, Zduardo 2001-2002 : Deux maisons à Ponte de Lima, PONTE DE LIMA (Por-tugal)VENEZIA, Francesco 1973-76 : Plaza en Lauro, LAURO (Italie)UTZON, Jorn 1956-58 : Kingo Houses, ELSENEUR (Danemark)SIZA, Alvaro 1986-93 : École d'Architecture, PORTO (Portugal)ANDO, Tadao, 1978-83: Rokko housing 1, ROKKO KOBE, Hyogo (Japan)ANDO, Tadao, 1985: Rokko housing 2, ROKKO KOBE, Hyogo (Japan)ANNEXE 09 - PLANCHES DE RENDU AAC058-7948CARNET DE CROQUIS AAC058-7966MAQUETTE AAC058-8110
AAC058-7660
É C O L E N AT I O N A L E S U P É R I E U R E D ' A R C H I T E C T U R E D E LY O N © D E M M AT E R I A L I T E M A S T E R 1 - 2 0 11 - 2 0 1 2
LA VILLE ET L'EAU
M A S T E R D ' A R C H I T E C T U R E 1P R O J E T A R C H I T E C T U R A L E T U R B A I N - M AT E R I A L I T É
s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e W I L L I A M H AY E T
É C O L E N AT I O N A L E S U P É R I E U R E D ' A R C H I T E C T U R E D E LY O N
é q u i p e e n s e i g n a n t e : W I L L I A M H AY E T
J E A N - P I E R R E M A R I E L L EA N TO N E L L A M A S T R O R I L L I
D AV I D M A R C I L L O N A R N A U L D D E B U S S I E R R E
P R . T H I E R RY V E R D I E R J E A N TA B O U R E TC Y R I L G A U T H I E R
B E N J A M I N C H AVA R D E S
FRANCHIR LA SAONE BALMEMONTÉE DES 700 MARCHES
SUR LES PENTES DE LA SAINTE FOY
01 - PLAQUETTEPOULET OLIVIER
AAC058-7663
Un travail sur la ville de Lyon impose le thème de la ville et l'eau. Le Grand Lyon est abordé par l'étude des rives droites du Rhône et de la Saône, définissant un territoire qui s'étend de Jonage et Collonges sur Saône au nord jusqu'à Givors au sud.
Les digues érigées le long du Rhône et de la Saône depuis le XVIIIe siècle ont protégées Lyon d'inondations récurrentes, en modifiant peu à peu la pratique du fleuve et de la rivière. Avec le développement du trafic automobile à partir des années 60', le choix de faire passer une autoroute au coeur de la ville, de construire des voies sur berge et des parking automobiles, Lyon se coupe définitivement de son rapport à l'eau. L'enjeu de se travail est de reconnecter la ville avec fleuve et rivière.
Le projet est abordé au travers d'une approche sensible du territoire et du paysage. La méthodologie en entonnoir partant de l'échelle du grand territoire jusqu'au détail d'un projet permet la conception d'un projet urbano-architectural, en articulant tour à tour les échelles. Il est résulte une réinterrogation permanente et salutaire du projet.
Le territoire d'étude considéré dans ce travail s'étend sur l'aval du Rhône et de la Saône, depuis Lyon Confluence jusqu'à Givors. A ce stade, le travail est réalisé en groupe. Le territoire de projet se limite in fine à la balme de Sainte Foy lès lyon et à sa relation avec le nouveau pôle de Lyon Confluence. Différents projets sont explorés débouchant sur un sujet de projet de fin d'étude et de mémoire.
Les différents chapitres abordent successivement le diagnostic global du territoire et les zones à enjeux identifiées, les enjeux proprement dits, un schéma directeur, puis un master plan et les bases d'un projet "one shot". Les deux derniers chapitres sont consacrés à l'affinage et la précision de deux projets.
Le thématique de l'habitat dans la pente est explorée pour accompagner un cheminement piéton, prétexte à une découverte architecturale.
AAC058-7673
1- Présentation globale de Lyon métropole:
INTRODUCTION:Le diagnostic est un travail de découverte à l'échelle du grand territoire, il est réalisé en groupe de trois binôme.
Le diagnostic est nécessaire pour appréhender les différentes facettes d'un site, avec une hauteur de vue suffisante pour n'en retenir que l'essentiel. Différentes thématiques générales sont explorées, l'objectif étant d'identifier des secteurs à enjeux.
DÉVELOPPEMENT:De confluence en confluence, la rive droite du Rhône, de la balme de Sainte Foy lès lyon à Givors
Une concurrence de Métropoles Européennes: Lyon à la 19e place
L'agglomération lyonnaise, la plus importante de la Région Rhône-Alpes, elle occupe une situation privilégiée au cœur de la vallée du Rhône, sillon fluvial naturel.Elle est bordée au Nord par le Pays Beaujolais, à l'Ouest par les Monts du Lyonnais, à l'Est et au Nord par la plaine de la Dombes et de l'Isère.A mi-chemin entre mer et montagne, la cité, située dans sa partie basse à une altitude de 170 mètres et est placée sous le signe de la dualité.A la fois métropole européenne et capitale de la région Rhône-Alpes, Lyon s'étend sur 4 787 hectares. C'est la deuxième agglomération de France (1,2 million d'habitants sur 55 000 hectares).Elle attire chaque année un nombre important de visiteurs pour un tourisme de loisirs ou d'affaires. Située au coeur de l'Europe, la région
lyonnaise a de tout temps constitué un lieu de passage, une ville étape et un point de rencontres et d'échanges. Une position qu'elle confirme aujourd'hui encore dans de nombreux secteurs.
AAC058-7675
Source: SCOT du Grand Lyon
S5 – La Mulatière et la balme de Sainte Foy
S3 – De Irigny nord à Pierre Bénite
S2 – De Grigny à Irigny
S4 – La Mulatière
S1 – De Givors nord à Grigny
AAC058-7676
Source: SCOT du Grand Lyon
2- Un territoire, un parcours, des séquences: Lônes & Coteaux du RhôneObjectifs généraux du SCOT
La zone étudiée se situe sur la partie Sud Ouest de Lyon, sur la rive droite du Rhône. Elle exprime une continuité territoriale de la communauté urbaine .Continuité de la confluence, du centre historique de Lyon et de la ville périurbaine jusqu’à Givors. Ville, elle-même au confluent du Rhône et du Giers.De Confluence à confluence….
Une première reconnaissance sur le terrain permet de distinguer cinq secteurs.
AAC058-7677
Sources: Sara PEREZ, Didier GAUCHON, Charlène AZE, Pierre DUMAS, Philippe MOUCHET, Olivier POULET
Sources: Sara PEREZ, Didier GAUCHON, Charlène AZE, Pierre DUMAS, Philippe MOUCHET, Olivier POULET
AAC058-7678
S1 – De Givors nord à Grigny
GIVORSAlti: mini. 152 m - maxi. 245m.La ville de Givors se trouve au confluent du Rhône et du Gier .Elle est située à 25 km au sud de Lyon et à mi-chemin sur la route menant à St Etienne.Enserrée entre les monts Lyonnais, au nord et à l’ouest, et les contreforts du Pilat, au sud et à l’ouest, elle est un véritable carrefour grâce à son réseau autoroutier et portuaire.Sa typologie est de type habitat col-lectif groupé et habitat individuel.
GRIGNYAlti: mini. 152 m - maxi. 245m.Ville en continuité avec la ville Givors, elle a une typologie d’habitat indivi-duel, en opposition à Givors .A 15 mn au sud de Lyon, 30 mn de Saint-Étienne, à 1h30 des Alpes, 3h de Marseille et 2h de Paris (TGV). Si les infrastructures routières, fluviales et ferroviaires la raccordent aux grandes métropoles régionales, Grigny a souhaité entretenir son caractère de ville à la campagne en protégeant un patrimoine naturel de grande qualité.
AAC058-7679
Sources: Sara PEREZ, Didier GAUCHON, Charlène AZE, Pierre DUMAS, Philippe MOUCHET, Olivier POULET
Sources: Sara PEREZ, Didier GAUCHON, Charlène AZE, Pierre DUMAS, Philippe MOUCHET, Olivier POULET
AAC058-7680
S2 – De Grigny à Irigny
IRIGNYAlti : mini. 155 m - maxi. 271 m.Ville qui se développe sur la colline, bordée par de grandes surfaces agri-coles, elle a une typologie dominante d’habitat individuel.Elle se distingue de la ville qui la précède (Pierre Bénite) par son caractère isolé (par les montagnes qui la bordent, par l’autoroute, par les surfaces agricoles qui l’encerclent et par le Rhône).
S3 – De Irigny nord à Pierre Bénite
PIERRE BENITEAlti: mini. 155 m - maxi. 232 m.Situé à 6 km de Lyon, elle se situe dans la banlieue lyonnaise.C’est une ville dense mais comportant de nombreux parcs et espaces verts présents sur les différents quartiers de la commune.Habitations de type collectif, indivi-duel et industriel.
AAC058-7681
Sources: Sara PEREZ, Didier GAUCHON, Charlène AZE, Pierre DUMAS, Philippe MOUCHET, Olivier POULET
Sources: Sara PEREZ, Didier GAUCHON, Charlène AZE, Pierre DUMAS, Philippe MOUCHET, Olivier POULET
AAC058-7682
S4 – La Mulatière
LA MULATIEREAlti: mini 163- maxi.249m.Ville limitrophe de Lyon, située au confluent du Rhône et de la Saône, là où se mélangent les deux eaux.Ce secteur est un espace d’expansion métropolitaine majeur conjuguant un potentiel foncier considérable, une situation exceptionnelle en terme de desserte, et des atouts paysagers de grande valeur.Habitations de type habitat collectif groupé.
S5 – La Mulatière – La Balme de Ste Foy
La Balme de Ste FOY-LES-LYONAlti: mini. 170 m - maxi. 322 m. Surplombe Lyon par l’Ouest, au dessus du confluent de Rhône et de la Saône. Proximité immédiate de Lyon.Majoritairement de l’habitat dense collectif ou individuel qui qualifie le paysage. D’importants espaces vert, parcs et balme offrent un rideau végétal qui qualifient le paysage, mais reste un délaissé.
Objectifs généraux du SCOT:- une métropole attractive- une métropole multi-polaire- une métropole nature- une métropole accessible
Le territoire→ démarchage commun entre SCOT.
L’habitat et organisation urbaine→ répartir / développer / densifier.
Le développement économique→ accueillir / ancrer / soutenir / favo-riser les entreprises, les pôles d’excel-lence et les commerces.
Les déplacements, le mouvement→ accessibilité / création des réseaux.
Le réseau bleu→ conserver / protéger / valoriser les espaces en eau. Y compris échange fluviaux.
Les ressources naturelles→ conserver / protéger / valoriser / récupérer. pro-duire de l’eau, de l’énergie et des espaces.
Les espaces naturels et agricole→ conserver / protéger / valoriser / créer.
Agir dans le temps et sur le territoire en conservant l’existant.
AAC058-7683
3- Diagnostic: Géographie - Géologie
TOPOLOGIE:Densification du bâti dans les vallées,sur les flans des collines et en bordure du Rhône.Plantation arboricoles et agriculture sur les plateaux et les versants.Une discontinuité entre vieille ville et ville nouvelle / secteur industriel permettant l’interpénétration de la végétation.Limitation des transports et dessertes.Des déplacements plus long en temps.
TERRITOIRES:Une large place aux espace verts et terres agricoles
GÉOLOGIE - LES RESSOURCES NATURELLES:l’eau pour:- une alimentation en eau potable- une conservation équilibre faune /flore- un arrosage- une énergie produiteQualité médiocre du Rhône en classe 2
GÉOLOGIE - CLIMAT – AIR - POLLUTIONCLIMAT:Un climat de type semi-continental, dans lequel les précipitations sont plus importantes en été (dues principalement aux orages relativement fréquents) qu'en hiver, la sensation de froid étant renforcée par la bise. Le climat en région lyonnaise est tempéré et ensoleillé. La région subit parfois les conséquences d‘épisodes méditerranéens violents (très fortes pluies).Lyon est une ville possédant à la fois des influences continentales, océaniques, et méditerranéennes.Le climat change avec une
augmentation de température de +2°C d’ici à la fin du siècle à ne pas dépasser contre 5°C annoncé.L’évolution des précipitations et l’ampleur des conséquences est pour l’instant moins bien cernée.
Air et pollution:Le vent souffle souvent du fait de la compression d'air dans le sillon rhodanien créant ainsi une brise qui disperse les polluants de l'air.Un important complexe industriel dénommé couloir de la chimie, implanté le long du fleuve au sud de l'agglomération, constitue une menace de pollution. (de Lyon jusqu’à Feyzin) La qualité de l'air est surveillée par des détecteurs de niveau de pollution qui donnent l'alerte en cas de besoin. Le sud du quartier de Gerland est classé site à risque par la directive Seveso.La zone présentée est majoritairement une zone à risque et polluée.
Le SCOT envisage la protection de la zone de Lyon et de ces environs avec des actions ciblées: - une réduction de 7.6 à 6.1 millions de tonnes de CO² pour 2020. Lyon se positionne dans la moyenne nationale en terme de rejet de CO².- consommer moins en menant des actions de sobriété énergétique.- consommer mieux par des actions sur les technologies "énergivores".- produire autrement en utilisant des énergies naturelles tel que le solaire.
AAC058-7685
Source: SCOT du Grand Lyon
Source: SCOT du Grand Lyon
Allégorie du Rhône et de la Saône à l’entrée de la CCI de Lyon
AAC058-7686
4- Diagnostic: Paysages
Le fleuve joue un rôle majeur dans la structuration du territoire:- Givors, ou la confluence du Gier- Le long du vieux Rhône- La porte Sud de Lyon- Rencontre du Rhône et de la Saône : Confluence
Les divers ensembles géologiques qui composent l’agglomération Lyonnaise offrent des paysages assez contrastés.
L’organisation urbaine s’est développée dans ce cadre étonnamment complexe que l’on peut représenter comme le mariage d’un fleuve, d’une rivière et d’un ensemble de collines.
Les orientations du SCOT:Une ville apaiséeUne ville embellieUne ville équilibrée
Les moyens d’actions:Améliorer le cadre bâtiMettre en valeur le paysagePréserver le patrimoine
Givors, ou la confluence du Gier:Un site phagocyté par les infrastructures routières (A47 et N386), ferroviaires et les installations pétrolières.Un pôle porteur d’une forte ambition urbaine et paysagère (vallée du Gier, Porte du Pilat,…)De vastes espaces naturels existants à valoriser. Une trame verte à recomposer
Le long du Vieux Rhône:Marqué par les développements industriels lourds, ce territoire est constitué d'une double image .A l’Est, les alignements réguliers des cuves de la raffinerie, la présence forte des torchères, des architectures singulières
associées aux odeurs de ces lieux confèrent à ce site une identité particulière.A l’Ouest, le Vieux Rhône s'écoule dans un site constitué d'îles couvertes principalement de boisements alluviaux.La ripisylve sur la rive Ouest fait l’objet d’une campagne du SMIRIL1, ayant pour objectif une restauration véritable du milieu du Vieux Rhône, et de maintient de la biodiversité.
Sur le plateau, les vergers des communes de Millery, Charly, Vourles, et Irigny, représentent les principales zones de production arboricole de l’agglomération. Gage de qualité de vie pour les territoires avoisinants, et l’ensemble de la population locale.
La porte Sud de Lyon:Pierre-Bénite : Les usines chimiques et l’autoroute A7 séparent brutalement le centre ville du Rhône. Oullins – La Mulatière : L‘autoroute A7 rompt toute communication avec le fleuve. La reconquête du fleuve ne peut être envisagée que par le déclassement de l’autoroute en boulevard urbain.
Rencontre du Rhône et de la Saône:Aux pieds de la balme verte de St Foy-les-Lyon, le renouvellement urbain, du quartier et de la pointe de la confluence.
1 SMIRIL : Syndicat Mixte du Rhône des Îles et des Lônes
AAC058-7687
5- Diagnostic: Infrastructures et flux
Le réseau ferré1850 – Apologie du réseau ferréFusions des compagnies Paris-Lyon (PL) et Lyon-Méditerranée (LM). Les deux tronçons se rejoignent à Perrache. L’axe Paris – Lyon – Marseille est né.
Les aménagements fluviaux1933 – Le Port Edouard Herriot1966 – L’écluse de Pierre Bénite
Le réseau routier1970 – Construction de l’échangeur de Perrache1971 – Ouverture du tunnel de Fourvière, les autoroutes A6 et A7 se rejoignent au cœur de la ville
Les conséquences:-Accidentalité forte-Pollution atmosphérique, Mars 2011 l’agglomération Lyonnaise enregistre plus de 38 jours de pollution aux particules émises par la circulation automobile-Nuisances sonores-Congestion routière
Le cas du réseau ferré:L'évolution du trafic se traduit par des trafics diversifiés fret ou voyageurs, des destinations variées, régionales, nationales et internationales, une infrastructure unique. En conséquence, le réseau est saturé avec 1500 trains/jour en Gare de La Part Dieu, 1 Train toutes les 1min.30 et une vitesse effective de circulation fret : 30 km/h.
Préconisations du SCOTNe pas développer le réseau de voirie:Optimiser son exploitationBoucler les périphériquesHiérarchiser les voies
Favoriser la ville des courtes distances :Privilégier les Transports en commun et le Fer.Créer le réseau de l’aire métropolitaine(RER Lyonnais)Optimiser l’accessibilité aux garesOptimiser le nombre de parcs relais
Les 3 projets majeurs:Le C.O.L : Contournement Ouest de LyonLa ligne TGV Lyon-TurinLe prolongement du métro B de Lyon-Gerland à Oullins
Les alternatives:-Janvier 2007 – Le réseau TCL s’étend aux communes de Givors et Grigny-Vallée de la chimie: plan de déplacement inter-entreprises par transport collectifs-Edition d'un guide de co-voiturage-Autolib-Le Vélo'v-Halte fluviale de la Sucrière et les vaporetti.
AAC058-7689
Principe de la ville à l’époque médiévale
Principe de la ville du XIX siècle
Source: P.DUMAS et CH. AZE
DES HOMMES ET UN FLEUVE:
Du moyen age au XIXe siècle, la ville au bord de l’eau.
Deuxième moitié du XIX ème siècle, le Rhône maîtrisé
AAC058-7690
6- Diagnostic: Les temps de la ville
L’ÉPOQUE ROMAINE:1ère trace de peuplement à l’âge du bronze. En l’an – 43 avant JC Lugdunum devient la capitale des Gaules.Lugdunum devient un lieu de convergence des voies romaines. Aqueduc du Giers et habitats disparates
L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE:Fin de l’Empire Romain. Mise en place du système féodal. La paroisse comme ancêtre de la commune. Le Village, la maison et la polyculture
RENAISSANCE: les maisons de champsExtension de la cité Lyonnaise sur les campagnes environnantes.
DU MILIEU XVIIIe ET XIXe SIÈCLE : les grands bouleversementsLe contexte:Poursuite du développement dans les campagnes d’un habitat de plaisanceCréation de voies de communication plus performantesProgression des activités industriellesVers une maîtrise du Rhône.
Les voies de communication:1830, les bateaux à vapeur permettent la mise en place de transports de voyageurs et de marchandises Création des ports importants et gares d’eau1832, la ligne de chemin de fer Lyon-St Etienne1854-56, la ligne Paris Marseille via Lyon est en service. Transformation des rives du fleuve, le chemin de fer sépare les bourgs du Rhône.
La Maîtrise du fleuve:La grande crue du Rhône de 1856 entraîne un programme de lutte contre les inondations qui va modifier la physionomie des berges. Fermeture des bras fleuve avec
un ensemble de barrages submersibles. Équipement du Rhône de digues en épis. Installation de seuils pour élargir le lit du fleuve.Construction de ponts. Assèchement des brotteaux par les travaux qui permettrons le développement de l’industrie sur ce nouveau territoire foncier le long du Rhône. 1881, construction de l’écluse de la Mulatière.
Industrialisation:Maintien d’une industrie diversifiée. Installation de verreries royales.Passage des proto-fabriques aux usinesDéveloppement de l’industrie métallurgique.Développement de l’industrie chimique.Expansion de la démographie des villes et exodes des campagnes.Mutation des activités, des emplois.
LE XXe SIÈCLE:Contexte:Mise en place de schémas d’aménagement globaux à l’échelle de l’agglomération. Deuxième révolution industrielle, essor et déclin des industries.Étalement urbain conséquence de la croissance démographique. Développement des infrastructures routières et grand travaux d’aménagement sur le Rhône. Début d’une prise de conscience du patrimoine naturel.
Mise en place de schémas d’aménagement globaux à l’échelle de l’agglomération:1905, Premier projet de planification urbaine à l’échelle d’une agglomération en France initié par le président Edouard Herriot.
1938, Création du groupement d’urbanisme de Lyon.
AAC058-7691
La ville de demain ?
Principe de la ville au XX ème siècle
Source: P.DUMAS et CH. AZE
DES HOMMES ET UN FLEUVE:
XXe siècle, la perte de contact avec le fleuve
XXIe siècle, la reconquête du fleuveUne réécriture du territoire à composer avec un patrimoine fortement contrasté entre industries, espaces naturels, espaces agricoles, et habitats.
AAC058-7692
1956, Naissance et affirmation du Grand Lyon.1992, schéma directeur du Grand Lyon2004, Le SCOT
Essor et déclin de l’industrie:Avant les années 30', développement d’industries multiples, profitant des innovations de la révolution industrielle et d’un meilleur réseau de transports, au détriment des espaces agricoles.Années 30', création de cités ouvrières, (cité SNCF de Grigny), et premières « HBM » ( 4 cités HBM à Oullins)Après la seconde guerre mondiale, fermeture d’ateliers et usines, la question de la reconversion des sites industriels se pose. Maintien et essor des industries chimiques (St Fons, Pierre-Bénite, Feyzin).
Étalement urbain conséquence de la croissance démographique:Crise du logement des années 50', les communes du Rhône aval se couvrent de petites opérations dans un grand désordre. Mode des lotissements consommatrice de terrain. Réaction par création du POS qui protège les terrains agricoles et les zones naturelles. Entrelacement d’espaces agricoles et naturels avec des zones urbaines
Infrastructures routières et grand travaux d’aménagement sur le Rhône:Réalisation de grands équipements d’infrastructure routière, (A7…) formant une coupure dans les tissus urbains. Déclin de la navigation.1933, création de la Compagnie Nationale du Rhône qui obtient une concession jusqu’en 2023.Lancement d’une série de grands aménagements par la Compagnie Générale du Rhône (CNR) : port Edouard Herriot, usine-écluse et barrage et canal de Pierre-
Bénite…
Début d’une prise de conscience du patrimoine naturel:La CNR s’engage à participer à des actions en faveur de l’environnement.Création du SMIRIL (Syndicat Mixte du Rhône des Iles et des Lônes), qui porte sur un projet de requalification paysagère des rives.Volonté affichée par l’état de restaurer les milieux naturels.Exemple de l'île de la table ronde et des berges des Selettes à Irigny.
Et demain?Orientations du Document d’Orientations Générales:Développement résidentiel, avec la construction de 150 000 logements en 20 ans dans des secteurs déjà riche en équipements. Réduire les distances et le temps de transport.
Développement économique et culturel :Renforcement de l’art urbain. Renforcement de l’accessibilité internationale, valorisation de l’axe Rhône-Saône du point de vue du transport Fluvial.Chaque bassin doit être auto-suffisant.Penser une meilleure insertion urbaine, environnementale, paysagère et architecturale
Espaces naturels et agricoles:Développement de trames vertes Développement des espaces naturels et de l’agriculture urbaine. Développer des circuits courts entre producteur et consommateur. « Préserver > Protéger > Valoriser »
AAC058-7693
Source: analyse Ph. Mouchet et O. Poulet
Source: analyse Ph. Mouchet et O. Poulet Source: analyse Ph. Mouchet et O. Poulet et SCOT du Grand Lyon
SEREZIN DU -
RHONE
FEYZIN
CHASSE/RHONE
ST.FONS
SOLAIZE
TERNAY8563 hab. en 201 09548 hab. en 2030
1 9345 hab. en 201 021 570 hab. en 2030 5003 hab. en 201 0
5503 hab. en 2030
501 8 hab. en 201 0551 9 hab. en 2030
2461 hab. en 201 02707 hab. en 2030
4365 hab. en 201 04867 hab. en 2030
1 6964 hab. en 201 01 8660 hab. en 2030
9935 hab. en 201 01 1 098 hab. en 2030
1 9345 hab. en 201 021 570 hab. en 2030
2496 hab. en 201 02745 hab. en 2030
25652 hab. en 201 028550 hab. en 2030
1 0000 hab. en 201 020000 hab. en 2030 221 51 hab. en 201 0
24698 hab. en 2030
1 9345 hab. en 201 021 570 hab. en 2030
6540 hab. en 201 07292 hab. en 2030
2687 hab. en 201 02955 hab. en 2030
9254 hab. en 201 01 01 79 hab. en 2030
VERNAYSON
IRGNY
MONTAGNY
MILLERY
GIVORS
GRIGNY
ST FOY LES LYON
OULINS
LA MULATIERE
CONFLUENCE
PIERRE BENITE
De -8 à -7
Indicateur de précaritémonétaire
De 4 à 6
De -3 à 0
De 1 à 3
SEREZIN DU -
RHONE
FEYZIN
ST.FONS
SOLAIZE
TERNAY
VERNAYSON
IRGNY
MONTAGNY
MILLERY
GIVORS
GRIGNY
ST FOY LES LYON
OULINS
LA MULATIERE
CONFLUENCE
PIERRE BENITE
Revenu mensuel net
AAC058-7694
Evolution des profils socio-économique des conférences des maires entre 1999 et 2007Source: SCOT du Grand Lyon
7- Diagnostic: social et économique
Les grandes tendances du développement des Lônes et Coteaux du Rhône:
SOCIALObjectifs du SCOT:l’habitat et organisation urbaine1- Répartir l’offre de logements sur l’ensemble du territoire2- Développer le logement social3- Densifier les logements
Une démographie• 1 330 000 habitants dans le Sepal en 2008• + 77 300 habitants entre 1999 et 2008, une hausse de 0,7% par an.• Le Sepal a gagné entre 1999 et 2008 autant d’habitants que sur la période 1982-1999.Le total d’habitants pour le bassin retenus est de 152 204 hab. pour l’année 2010, il est prévu pour l’année 2030 selon les statistique autour de 166 282 hab., soit 14 000 habitants supplémentaires en 20 ans, ce qui correspond à un peu moins que la taille de la ville d’Ecully.
Une sociologie128 800 habitants en 2005 (estimation Insee)10% de la population du Grand Lyon7% des emplois (Sirène 1 er janvier 2007)9% de la construction neuve entre 2000 – 200554% de propriétaires en 199922% de locataires du parc privé en 199921,94% de logements sociaux (inventaire SRU 2005)32% de maisons individuelles en 19991 592€ par mois de revenu net moyen en 2005
AAC058-7695
Source: analyse Ph. Mouchet et O. Poulet
Un parc d’habitations
TERNAY
VERNAYSON
IRGNY
MONTAGNY
MILLERY
GIVORS
GRIGNY
OULINS
CONFLUENCE
LA MULATIERE
PIERRE BENITE
ST FOY LES LYON
Pays de l’Ozon 6 649
Lônes et coteaux du Rhône 53 1 53
De 35 à 50 %
Parc locatif social
De 25 à 35 %De 15 à 20 %De 10 à 15 %Moins de 5 %
Plus de 50 %
AAC058-7696
Source: analyse Ph. Mouchet et O. Poulet
Des mobilités Est-Ouest et Ouest vers le centre de Lyon très marquées.
Vers Porte des Alpes
Vers Porte du sud
Vers SCOT sud-est
Vers mont du Lyonnais
ouest
Vers plateau du Lyonnais
Vers Plateau nord
Vers centre Lyon
Mobilité résidentielle 1 990-1 999Flux départs – arrivéMobilité interne : 1 1 350
Flux faible
Flux fort
3 000 et +
1 000 à 2 000
500 à 1 000
200 à 500
2 000 à 3 000
AAC058-7697
SEREZIN DU -
RHONE
FEYZIN
ST.FONS
SOLAIZE
TERNAY
VERNAYSON
IRGNY
MONTAGNY
MILLERY
GIVORS
GRIGNY
ST FOY LES LYON
OULINS
LA MULATIERE
CONFLUENCE
PIERRE BENITE
Source : SCOT 2030
Diagnostic des zones de moteurs économiques
LES RONZIERES
LES TOURNAIS
FIVES LILLE
LE FAVIER
LA MOUCHE
Une présence de moteurs économiques limitée, sur la rive droite du Rhône
SEREZIN DU -
RHONE
FEYZIN
ST.FONS
SOLAIZE
TERNAY
VERNAYSON
IRGNY
MONTAGNY
MILLERY
GIVORS
GRIGNY
ST FOY LES LYON
OULINS
LA MULATIERE
CONFLUENCE
PIERRE BENITE
Source : PLU
Zones de risque industriel 2004
La reconversion de la vallée de la chimie (production vers recherche) va considérablement réduire la zone de risque, et dégager des potentiels d’habitation
AAC058-7698
ÉCONOMIQUEObjectifs du SCOT:Développement économique:1- L’Accueil et le développement des entreprises2- Ancrer le développement des pôles d’excellence et de compétitivité3- Soutenir une économie créatrice d’emplois4- Favoriser l’offre commerciale.Le SCOT vise à la mixité des fonctions sur le territoire urbain afin de limiter les déplacements.
INDUSTRIE
SEREZIN DU -
RHONE
FEYZIN
ST.FONS
SOLAIZE
TERNAY
VERNAYSON
IRGNY
MONTAGNY
MILLERY
GIVORS
GRIGNY
ST FOY LES LYON
OULINS
LA MULATIERE
CONFLUENCE
PIERRE BENITE
Enveloppe foncière du développement économique
Source : SCOT 2030
Carré dela soie
Confluence
Dans les sites mixtes à dominante économique
Dans les sites économiques dédiés
Sites économiques métropolitains
Givors - Loire
Gerland
Vallée de La chimie
Un potentiel sur Pierre Bénite et St Genis Laval
AAC058-7699
SEREZIN DU -
RHONE
FEYZIN
ST.FONS
SOLAIZE
TERNAY
VERNAYSON
IRGNY
MONTAGNY
MILLERY
GIVORS
GRIGNY
ST FOY LES LYON
OULINS
LA MULATIERE
CONFLUENCE
PIERRE BENITE
Les principaux équipements logistiques métropolitains
Source : SCOT 2030
Des équipements logistiques au plus près de l’industrie
Site logistique fer-route PROJET
Site logistique fer-route
Equipement fleuve-fer-route
Site logistique fleuve-fer-route PROJET
Equipement ferroviaire dédier
Equipement fer-route
Grenay
Rhône aval
Givors-Loire
Port Edward Herriot
Venissieux
Lyon sud-est
SEREZIN DU -
RHONE
FEYZIN
ST.FONS
SOLAIZE
TERNAY
VERNAYSON
IRGNY
MONTAGNY
MILLERY
GIVORS
GRIGNY
ST FOY LES LYON
OULINS
LA MULATIERE
CONFLUENCE
PIERRE BENITE
Source : SCOT 2030
Une présence de pôles tertiaires et pôles d’excellence de compétitivité limitée sur la rive droite du Rhône
La rive droite est une zone majoritairement d’habitat.La présence industrielle, tertiaire et logistique faible, est surtout développée de l’autre coté du Rhône avec la Vallée de la chimie et Confluence
Vallée deLa chimie
Gerland
Pôles tertiaires
Epicentres des pôles d’excellence et de compétitivité
Chimie & environnement
Santé
Au sein des polarités
Dans les sites d’accueildes fonctions stratégiques
AAC058-7700
LOGISTIQUE
TERTIAIRE & PÔLES D’EXCELLENCE
COMMERCESur le territoire Lônes & Coteaux du Rhône:- Stabilité démographique mais diminution de la taille des ménages- Faible densité du petit commerce- Forte emprise des grandes surfaces en alimentaire- Attraction forte en alimentaire- Évasion forte en équipement de la maison et en culture loisirs
- Divergence de fonctionnement entre le sud (très équipé et exerçant une attraction forte sur les communes au sud du Grand Lyon) et le nord de ce territoire
SEREZIN DU -
RHONE
FEYZIN
ST.FONS
SOLAIZE
TERNAY
VERNAYSON
IRGNY
MONTAGNY
MILLERY
GIVORS
GRIGNY
ST FOY LES LYON
OULINS
LA MULATIERE
CONFLUENCE
PIERRE BENITE
Source : SDUC 2009-201 5
Evolution des pôles commerciaux à l’horizon 201 5
Une présence commercialelimitée génératrice de flux de part et d’autre du Rhône.Un redéploiement / dynamisation commercial en cours
Redéployer
Conforter
Renforcer
Stabiliser
AAC058-7701
Préc
onis
atio
nSC
OT
Pays
d’
Ozo
n
Préc
onis
atio
nSC
OT
Lône
s &
Rhô
neD
ével
oppe
men
tH
isto
riqu
e +
SCO
T
Dév
elop
pem
ent
hist
oriq
ue
Confluence+
Pôle économique
Confluence+
Pôle économique
AAC058-7702
8- Conclusion: Émergence d’enjeux
Les propositions du SCOT (en termes économiques, déplacements, énergies, ...) sont essentiellement orientées Nord Sud
Le Rhône, les axes routiers et ferrés qui le longent ainsi que la topographie , eux-aussi orientés Nord Sud, marquent nettement une limite de développement non franchie.Chacune des rives s’est développée dans des directions opposées, se tournant le dos mutuellement, tant sur le plan économique, que des réseaux ou du point de vue politique et stratégique: Les rives droites du Rhône et de la Saône sont extrêmement préservées avec une qualité urbaine certaine, à l'exception du secteur d'Oullins. La rive gauche du Rhône en aval de Lyon est en revanche particulièrement marqué par l'essor industriel de la deuxième moitié du XIXe et le XXe siècle, avec l'implantation de la vallée de la chimie.
Des liens physiques Est-Ouest sont à imaginer entre la rive droite principalement dédiée à l’habitat et la rive gauche qui est un bassin d’emploi futur important avec la reconversion de la vallée de la chimie pour passer d'un secteur de production à un site de recherche, accompagné de ses potentiels de dépollution.
Les Zones à enjeux de la rive droite seraient alors:-La balme de St Foy, le dernier poumon vert du centre de Lyon, pour son extrême proximité de Confluence récemment aménagée.-Les berges de Pierre Bénite et Oullins, très marquées par l'industrialisation, et au potentiel de reconversion avec
leur proximité avec la vallée de la chimie et ses berges inaccessibles.-Les berges de Grigny et du Rhône au niveau de Millery extraordinairement préservées et qui contrastes avec celles de la vallée de la chimie.
CONCLUSIONPhilipe MOUCHET et moi-même choisissons à stade de nous concentrer sur la balme de St Foy qui semble particulièrement étonnante de part sa situation face au nouvel aménagement de Lyon Confluence, sorte de fond de scène à la fois fascinant et inquiétant par le vert sombre de sa végétation en fin d'après -midi. Cette balme va révéler quelques trésors architecturaux que nous découvrirons ultérieurement.
AAC058-7703
CHAPITRE 02LES ENJEUX - JANV 2012
Pont Raymond BARRE(tram T1 et modes doux)
Passerelle "La Transversale" (modes doux)
Passerelle "La Transversale" (modes doux)
Pont des Girondins(automobiles)
Source: Herzog et De Meuron - MDP / Desvigne Conseil - JP Restroy
Viaduc SNCF de la Quarantaine
Viaduc_SNCF de la Mulatière
Pont_A6 MulatièrePhoto Pont_A6 Fourvière
AAC058-7704
1- Premières pistes de réflexions et de recherches
INTRODUCTION:L'objectif de ce chapitre est de se focaliser sur un site précis: la balme de Ste Foy et sa relation avec la Confluence, en approfondissant les thématiques les plus pertinentes.
LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR BALME DE ST FOY ET CONFLUENCE:Les recommandations du Plan Bleu consistent en un accueil d’emplacements pour des bateaux / logement quai des Étroits (Lyon 5eme) et quai JJ Rousseau (La Mulatière), l'aménagement de jeu de boules et établissements de bain sur le quai Fulchiron (Lyon 5eme), en deux Ports de plaisance, l'un à port Rambaud, l'autre dans la darse de Lyon Confluence, et des compagnie de bateaux «d’animation» (une seule à Lyon, quai Rambaud à ce jour).
Projet de construction de nouveaux ponts pour desservir le sud de Confluence dans le cadre de la ZAC 2 du projet.
Projet d’aménagements des quais de Saône rive droite et gauche (50km) de Genay à la pointe de Confluence en 8 séquences, dont la scène 8 : Espace kitchener-marchand et bas-port rambaud. Le site:La confluence a été au fil du temps gagnée sur la Saône et le Rhône pour devenir aujourd’hui un nouveau territoire d’avenir. Le quartier de la confluence, longtemps délaissé et encore séparé de la Presqu’île historique par un vaste réseau routier et ferroviaire, fait ainsi l’objet d’une ambitieuse réhabilitation depuis une dizaine d’années (immeubles de bureaux, rénovation du bâtiment des Subsistances, qui accueille notamment
la biennale d’art contemporain de Lyon...). Sur une longueur de 700 mètres, le site de l’Espace Kitchener-Marchand comprend trois séquences : respectivement, depuis le sud, le théâtre de verdure et le parc de Saône, le quartier et les maisons flottantes, les ponts situés à proximité de l’ancien port d’Occident. Proche de la confluence du Rhône et de la Saône, ce parcours s’étend de part et d’autre de trois ponts très proches les uns des autres : le viaduc de la Quarantaine (voie ferrée aboutissant à la gare de Perrache), le viaduc de l’A6 (l’autoroute débouche ici du tunnel de Fourvière pour s’engouffrer dans la vallée du Rhône, après avoir traversé la Presqu’île), et le pont Kitchener-Marchand. Ce triple axe de circulation reflète un urbanisme complexe (l’alliance de la gare multimodale de Perrache et de l’échangeur autoroutier) qui scinde la Presqu’île en deux parties distinctes. Ce nouveau coeur de ville dynamique qu’est la Confluence sera relié au quartier historique de la Presqu’ile notamment par cette nouvelle liaison. L’enjeu est important tant au niveau des usages que de la qualité du site qui est à révéler.l’action:Les maîtres d’oeuvre et les artistes qui seront sélectionnés auront pour tâche d’assurer la continuité du cheminement piéton dans le cadre plus général du projet des Rives de Saône. Ils devront aussi imaginer une liaison attractive entre la nouvelle polarité du quartier de la Confluence et la Presqu’île – en particulier sous la voûte ingrate formée par la succession des trois ponts –, ainsi que diverses manières d’instaurer de la convivialité autour de l’eau, compatibles avec les usages actuels et à venir (bateaux d’habitation, restaurants, loisirs, détente et navigation).
AAC058-7705
2- RENDU E02: Expression des enjeux territoriauxUn parc urbain - Une respiration urbaine
UN LIEULe site de la balmes de la Mulatière, appelé également balme de Sainte Foy lès lyon, est un lieu très particulier. De forme allongée, il borde la Saône sur sa rive droite du Nord au Sud et regarde en face la presqu’île de Lyon (2 ème arrondissement). Sur le plateau ce trouve la ville de Ste Foy lès lyon, au Nord le 5ème arrondissement et au Sud la ville de la Mulatière dont la balme dépend en grande partie.
Si ces qualités paysagères et environnementales sont indéniables, cette zone représente pour la ville de Lyon un obstacle à l’organisation de son urbanité. Elle coupe physiquement par une différence d’altitude d’environ 300 mètres et la présence de la rivière, l’est de l’Ouest de cette partie de l’agglomération, créant de ce fait une séparation géomorphologique entre Ste Foy, la ville haute, et la presqu’île, la ville basse.
UNE SOCIOLOGIESociologiquement nous sommes dans une partie de Lyon plutôt aisé, 43,1% de la population est composée de cadres et de professions intermédiaires. Le secteur économique se compose de 350 entreprises (dont 72% du secteur tertiaire) pour la zone du plateau, pour la balme, hors-mis les habitations, la seule activité repérée est une série d’établissements scolaires (lycée technique Don Bosco, école-collège et lycée technique de l’Assomption Bellevue, groupe scolaire des Etroits, ancien site de l’INRA (institut séricole), et groupe scolaire du confluent).Il y a peut être dans ce lieu, le calme propice à l’étude et à la réflexion.
Dans l’ensemble le bâti de la balme est ancien, voir en mauvais état. La plupart des accès depuis le quai Jean-Jacques Rousseau sont condamnés. La modernité c’est montré plus généreuse sur la presqu’île avec les industries, le chemin de fer, et aujourd’hui les constructions aux audacieuses architectures du nouveau quartier de la confluence. Il y a dans cette opposition un marqueur bien visible de l’histoire de la ville.
AAC058-7709
UNE GÉOGRAPHIEDe part et d’autre de la balme existe deux nœuds autoroutiers et ferroviaires que sont le passage de l’A7 et des voies de chemins de fer au Nord vers le tunnel de Fourvière et au Sud au dessus de la Saône pour aller sur la presqu’île. Ils créent des verrous urbains pour les déplacements en mode doux, et développant ailleurs des contraintes de circulations. Mais la balme permet également de faire un lien végétal entre le corridor du vallon de la Saône pour allez fleureter avec la pointe de la confluence, retrouver le parc de Gerland puis de là, remonter les berges du Rhône jusqu'au parc de la Tête d’or et ensuite le parc de Miribel-Jonage. Il en va de même pour les déplacements en mode doux qui suivent peu ou prou un cheminement identique si l’on prend en compte les aménagements futurs des berges de Saône et des passerelles à venir au dessus du fleuve et de la rivière.
La géologie de la balme est particulièrement fragile, elle est constituée d’une moraine extrêmement friable. C’est une zone très instable, sujette à de fréquents éboulements, ce qui explique que le site soit peu construit. Le dernier éboulement remonte à Janvier 2009. Il existe à Lyon un service dédié à l’étude de la surveillance et de la sécurisation des balmes, appelé « La commission des balmes ».
La balme est généreusement boisée, et parsemée ça et là de belles demeures et maisons de maîtres du XVIIIe siècle, ainsi que quelques bâtiments de logements datant du début du XX e siècle. Seul le bas de la
AAC058-7711
balme, la partie la plus constructible, a connu récemment la construction de deux bâtiments de logements. L’un dans les années 80', l’autre en 2009. Il n’en demeure pas moins qu’une grande partie du piedmont de la balme est largement délaissé, et ce trouve être une zone de mitage. L’histoire a cependant épargnée cette partie de l’agglomération, qui en fait une zone exceptionnelle en plein centre d’une grande ville telle que Lyon. La géographie de la presqu’île a évolué au cours du temps par des aménagements successifs pour gagner de l’espace constructible sur les lônes
UNE HISTOIRE1773:Le confluent prend sa forme actuel par l’édification d’une digue par l’ingénieur Antoine PERRACHE, le nouveau confluent devient l’île Perrache.
1782:Construction du pont de la Mulatiète à l’extrémité du nouveau confluent qui deviendra un viaduc ferroviaire de la première ligne de train reliant Andrézieux-Bouthéon à Lyon.
1840:Grande crue: destruction du pont de la Multière.
1844:Construction des digues et berges de la Saône: éloignement des constructions des berges de la rivière.
1855:Percement du tunnel ferroviaire St Irénée et construction du viaduc ferroviaire de Perrache (viaduc de la Quarantaine).
1856:Deuxième grande crue
XIXe et début XXe siècle:Persistance des animations au bord de l’eau (baignades, jeux de boules, joutes).
1947-1949:Reconstruction du pont Kitchener-Marchand
Après-guerre:Industrialisation et arrivée de la pollution qui entrave la baignade, les jeux de boules sur les bas ports font place aux parking pour automobiles. Les travaux de voirie, comme l’aménagement de l’axe Nord-Sud, ont amplifié la désertification des berges.
1968:Percement du tunnel autoroutier de Fourvière
1972-1976:Construction de l’échangeur de Perrache, du pont de l’autoroute A6 sur la Saône
AAC058-7713
LES SECTEURS D’INTERVENTION POSSIBLE:Zone à enjeux N°1La zone se situant de part et d’autre du pont Kitchener-Marchand (1949) du pont autoroutier et du pont de chemins de fer. (Viaduc de la Quarantaine 1856) Cette partie de la balme a une morphologie très complexe. Elle reçoit à la fois les différents ouvrages d’art, toutes les voiries, mais aussi les tunnels qui passent sous la colline de Fourvière. C’est un verrou urbain bruyant et complexe qui marque la fin de la ville active des arrondissements, pour rentrer dans une zone plus calme, presque « rurale ». Ce verrou nuit particulièrement aux déplacements de type mode doux, vélos, piétons
Les enjeux :En faire un lieu de transition.Créer un mariage entre les zones de part et d’autre des franchissements, mais aussi de bas en haut de la balme.
La stratégie :- Déclassement de l’autoroute pour un boulevard urbain avec la construction du TOP et du COL-En faire une entrée de parc-Créer un secteur d’activité-Aménager l’espace viaire libéré du nœud routier-Développer les transports de type mode doux-Relier le plateau de Ste Foy à la confluence-Créer la continuité des aménagements des berges de Saône-Aménager les berges de Saône ainsi qu’une partie de la balme en parc urbain et jardins partagés.
Zone à enjeux N°2Situé au milieu de la balme, l’ancien site de l’INRA est installé dans une maison de maître. Il s’agit d’une ancienne ferme de production de la soie. Elle fait partie intégrante de l’histoire de Lyon. En effet Lyon fut une grande zone de production de soieries dés le XVe siècle. Le bâtiment est plongé dans parc arboré particulièrement fourni.
Les enjeux : Permettre de faire un écho historique à la modernité de Confluence. Permettre des déplacements transversaux de la balme, du haut du plateau, à la berge.Faire de ce site le point d’ancrage d’un parc urbain, et par ce biais permettre un travail sur la fortification de la géologie de la balme et revaloriser la qualité de cette zone boisée.
La stratégie :-En faire une entrée de parc -Prendre en compte les passerelles à venir (projet urbain de Herzog et De Meuron)-Créer un secteur d’activité en revalorisant l’ancien site de la soierie par un projet culturel ou éducatif.-Développer les transports de type mode doux, vélos, piéton mais aussi fluviale sur la berge de Saône.-Relier le plateau de Ste Foy à Confluence en réaménageant les venelles existantes.-Créer la continuité des aménagements des berges de Saône.-Aménager les berges de Saône ainsi qu’une partie de la balme en parc urbain et jardins ouvriers
AAC058-7715
Zone à enjeux N°3:La zone se situant de part et d’autre des ponts autoroutier et du pont de chemins de fer. (XXe siècle). Comme pour la zone mutable N°1, cette partie de la ville reçoit un ensemble d’infrastructures routières importantes qui en fait là aussi un verrou propre à nuire au bon fonctionnement de la circulation, et en particulier des modes de déplacement environnementaux.
Les enjeux : Répondre au mieux au nouveau paysage architectural de ConfluenceLibérer du foncier par la réappropriation de la surface dédiée au voitures.
La stratégie :-Déclassement de l’autoroute pour un boulevard urbain avec la construction du TOP et du COL-En faire une entrée de parc-Créer un secteur d’activité-Aménager l’espace viaire libéré du nœud routier-Développer les transports de type mode doux, vélos, piéton mais aussi fluvial-Relier le plateau de Ste Foy à la confluence-Créer la continuité des aménagements des berges de Saône-Aménager les berges de Saône ainsi qu’une partie de la balme en parc urbain et jardins partagés
CONCLUSION:Le travail d'analyse urbaine est réalisé en binôme avec Philipe MOUCHET et moi-même. Nous pensions à ce stade d'analyse, orienter notre travail de projet urbano-architectural sur les verrous que représentent les zones à enjeux N°1 et N°2.
Le transect présenté en annexe traite de la partie amont (zone N°1, depuis le pont Kitchenenr-Marchand) qui devait être mon propre secteur de travail.
L'expérience sensitive du terrain et les différentes discussions montrent que nous faisions fausse route. Pourquoi se concentrer sur les verrous, véritables non-lieux, alors que la balme de Ste Foy offre un véritable écrin de nature, un contraste saisissant vis à vis de Confluence et un potentiel indéniable ?
Cette prise de conscience a été pour moi décisive en terme de cheminement intellectuel, il est alors devenu évident d'interroger la confrontation de ces deux espaces.
C'est le point de départ d'un projet de cheminement à travers la balme, sorte de promenade architecturale permettant de découvrir à la fois les dernières réalisations de Confluence et le patimoine des villas florentines de la balme, en reliant deux mondes distincts: Confluence et le centre historique gentrifié de St Foy par la montée des 700 marches.
AAC058-7717
CHAPITRE 03SCHÉMA DIRECTEUR - FEV 2012
L’AGGLOMERATION LYONNAISE Des CONTINUITES VERTES depuis Collonges, le long des quais de Saône jusqu’à Confluence, pour remonter le Rhône en direction du parc de la Tête d’Or et Jonage
STE FOY LES LYON
LA MULATIERE
1 er ARR
2 éme ARR3 éme ARR
4 éme ARR
5 éme ARR
6 éme ARR
7 éme ARR 8 éme ARR
VILLEURBANNE
9 éme ARR
STE FOY LES LYON
LA MULATIERE
1 er ARR
2 éme ARR3 éme ARR
4 éme ARR
5 éme ARR
6 éme ARR
7 éme ARR 8 éme ARR
VILLEURBANNE
9 éme ARR
AAC058-7718
1- RENDU E03: HABITER LE FOND DE SCÈNEIntégrer St Foy à l’agglomération lyonnaise dans son propre développementet en préservant ses propres spécificités
INTRODUCTION:L'objectif de ce chapitre est de définir un schéma directeur qui rassemble les orientations stratégiques de développement pour la balme de Ste Foy, en identifiant deux secteurs d'intervention pour Ph. MOUCHET et moi-même.
DÉVELOPPEMENT:LE PROJET:"HABITER LE FOND DE SCÈNE"Lyon a su, au fil des siècles, accepter toutes les opportunités pour se développer, malgré une géomorphologie difficile, des pentes escarpées, une rivière et un fleuve et des zones marécageuses. L'agglomération s’est agrandie pour compter aujourd’hui 2 200 000 habitants faisant de Lyon la troisième commune de France et la communauté urbaine la plus peuplée de France.Avec Confluence, Lyon saisi l’opportunité de doubler la surface de son hyper centre, en restructurant la partie sud du confluent Saône Rhône, un délaissé industriel, en un véritable pôle de loisir high-tech conçu par de grands noms de l’architecture avec comme point d’orgue : le musée de la confluence de Coop Himmelb(l)au.
Il est resté cependant une zone suffisamment escarpée qui a échappée par son enclavement, à l’urbanisation intense : la balme de Sainte Foy. Cela a permis à Lyon de conserver en son sein, un espace quasiment naturel. Un grand vide presque hors territoire et pourtant extrêmement proche de la grande intensité de l’hypercentre. - L’absence de franchissement au-dessus de la Saône, sur toute la longueur du quai, continue de faire de ce lieu un simple fond de scène pour la nouvelle urbanité de Confluence.- Le contraste entre la pauvreté
d’aménagement du quai de la balme et la qualité et modernité de Confluence est saisissant.- Un projet de passerelle Herzog & De Meuron reliant Confluence à la balme pose question. Quelle en est la signification? Que faire sur cette berge désolée? Par extension, serait-ce un lien jeté vers le reste du territoire?
Notre propos sera de profiter de l'impulsion créée par le nouveau quartier de Confluence et des propositions de passerelles pour venir faire une continuité de territoire. Pourquoi ne pas imaginer un métro ou un funiculaire depuis le futur pôle multimodale (tramway/train) de Confluence, desservant St Foy, puis le fond du plateau et enfin rejoignant le futur pôle multimodale d’Oullins? Et l’on désenclavait et densifiait Ste Foy en répondant d’avance aux grands enjeux des mégapoles de demain?
Ce désenclavement et cette densification ne prendrait pas la forme quelle a pu prendre sur Confluence, mais au contraire, elle prendrait en compte les spécificités de la commune de Ste Foy lès lyon. Le tissus pavillonnaire lâche et le vieux bourg existants sur la commune en font un village dans la ville et apportent à ses habitants un certain bien vivre qu’ils ne souhaitent pas perdre : un village gentrifié.
Nous proposons d’aborder différents enjeux en terme de MOBILITE, d’IDENTITE, de MORPHOLOGIE URBAINE et de PAYSAGE. Le possible réaménagement se ferait à moyen ou long terme, voir même très long terme.Les points d’appui possibles sur le site qui pourraient créer un déclencheur sont: le fort militaire et l'esplanade Lichfield
AAC058-7719
STE FOY LES LYON
LA MULATIERE
1 er ARR
2 éme ARR3 éme ARR
4 éme ARR
5 éme ARR
6 éme ARR
7 éme ARR 8 éme ARR
VILLEURBANNE
9 éme ARR
STE FOY LES LYON
LA MULATIERE
1 er ARR
2 éme ARR3 éme ARR
4 éme ARR
5 éme ARR
6 éme ARR
7 éme ARR 8 éme ARR
VILLEURBANNE
9 éme ARR
Le gros caillou
Le skylinede la Part-Dieu
Le stade de Gerland
Les toursde Con�uence
La basiliquede Four�ère
Le télégraphe
STE FOY LES LYON
LA MULATIERE
1 er ARR
2 éme ARR3 éme ARR
4 éme ARR
5 éme ARR
6 éme ARR
7 éme ARR 8 éme ARR
VILLEURBANNE
9 éme ARR
GARE DE VAISE
CUIRE
CROIX ROUSSE
HOTEL DE VILLE
BELLECOUR
PERRACHE
CONFLUENCE
STADE DE GERLAND
STE FOYCENTRELA GRAVIERE
GARE DE VENISSIEUX
GRANGE BLANCHE
CHARPENNE
VIEUX LYONFOURVIERE
OULLINS
Un DEVELOPPEMENT HISTORIQUE depuis Fourvière: Saint Foy et La Mulatière en retrait …
Des LANDMARKS URBAINS pour signaler la ville
Une MORPHOLOGIE très marquée:Les Balmes
Un MAILLAGE DE TRANSPORTS URBAINS intense, Sainte Foy non desservie. Une proposition de bouclage avec Oullins
AAC058-7720
derrière l’église, ils sont de véritables balcons visuels sur la ville de Lyon. Relier à la rivière ses deux zones permettrait de reconnecter le plateau aux berges. Faire redécouvrir les anciennes venelles et valoriser le patrimoine.
IDENTITÉ TERRITORIALE:Une identité par l’isolementUne morpho-typologie prégnanteUne sociologie et une histoire marquéeL’absence de franchissementsUn village dans la villeAménité de la balmeLa balme lieu d’écologie
LES ENJEUX COMMUNAUXMOBILITÉ.Connexion entre le plateau et la rivière..Connexion intercommunale entre St Irénée, Ste Foy les Lyon vieux bourg et La Mulatière..Développer de nouveau mode de transport et abandon à terme de la voiture.
IDENTITÉ.Comment conserver à Ste Foy les Lyon son identité ?.Donner une identité à la commune au regard de l’agglomération
MORPHOLOGIE URBAINE.Permettre à Ste Foy les Lyon de préparer dès aujourd’hui son urbanisation future..Développement de la centralité du bourg historique..Densification du bâti pavillonnaire en vue des enjeux urbanistiques de demain..Prendre en compte de la mutabilité par l’héritage.
PAYSAGE.Développer l’aménité des berges de la Saône..Valorisation de la balme par le patrimonial et l’agri-urbain. Mise en
cohérence des parcs d’agglomération..Mise en cohérence de la trame verte.
PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENTMOBILITÉ.Le bouclage de Confluence avec la balme par le boulevard urbain.Mise en service de nouvelles passerelles au-dessus de la Saône..Création d’une station de métro avec bouclage sur la future station d’Oullins.
IDENTITÉ.Créer un signal visuel sur la commune pour être vus de l’agglomération.
MORPHOLOGIE URBAINE.Recomposer le maillage urbain à partir d’éléments déclencheurs..Créer un village sans voitures à proximité du vieux bourg.Revalorisation des axes longitudinaux, quai – chemin de Fontanière – avenue Vialloud
PAYSAGE.Ouvrir des vues afin de faire de la balme un véritable balcon sur la ville de Lyon. Revalorisation des particularités de dessertes transversales traditionnelles (venelles) avec accès au quai. Revalorisation de la balme et de la trame verte. Compléter le réseau mode doux en continuité des aménagements des quais du Rhône.
AAC058-7721
LONGITUDINALES (Nord-Sud)Les circulations principales et secondaires longitudinales. Les murets sont des limites de vues
TRANSVERSALES (Est - Ouest)Absence de circulations principales et secondaire transversales. Les murets sont des limites de propriété
AAC058-7724
CONCLUSION:Ma zone d'étude contient intrinsèquement les germes d'un projet de franchissement et de lien depuis un centre névralgique futur - le pôle mutli-modal tram-train de Confluence- vers le centre de Ste Foy et son esplanade en belvédère qui offre un magnifique point de vue sur Lyon.
AAC058-7727
1- Recherches: Analyse de dénivelé
INTRODUCTION:Il s'agit d'une phase de travail personnelle, volontairement courte, afin de poser les bases d'un projet urbano-architectural.La difficulté réside dans l'appréhension concrète du territoire, il faut cette fois, franchir la balme !Ce projet synthétise et concrétise les orientations décrites dans les chapitres précédents à savoir la volonté de franchir et relier, tout en permettant la découverte du patrimoine architectural,et compléter le centre historique de Ste Foy avec un village dans la pente.
ANALYSE:Un tel dénivelé est-il franchissable à pied ? Une analyse comparative de différents sites permet d'apporter des premiers éléments de réponses.
AAC058-7729
MONTÉE DE LA GRANDE COTE (Lyon-Croix Rousse)
Pour visualiser et dimensionner un tel ouvrage, deux ouvrages lyonnais sont précieux à analyser: la montée des 400 marches et la montée de la grande côtes permettent toutes deux d'accéder à la Croix Rousse. Ces deux exemples permettrons, notamment, de dimensionner les places.
AAC058-7731
3- RENDU E04: Franchir la Saône balme, la montée des 700 marches
Avec CONFLUENCE, la ville de Lyon double la surface de son hypercentre avec l'édification d’un quartier d’affaires et de loisirs et comme point d’orgue l’aménagement en partie sud du champ de la Confluence et du musée, un parc habité en lien direct avec le parc de Gerland.Cet ensemble marque l’entrée de la ville et en façonne l’image.
CONFLUENCE se confronte aussi par sa modernité et son extrême proximité à la balme de Sainte Foy lès lyon, dernier espace naturel en plein coeur de ville. Et si l’on tissait, depuis ce nouveau coeur de ville, un lien vers Sainte Foy et le fond du plateau ?
A l’instar des pentes de la Croix Rousse, les pentes de St Foy deviendraient accessibles par un cheminement piéton dans la continuité du projet de passerelle imaginé par Herzog et De Meuron depuis Confluence. Il autoriserait l’aménagement d’un village dans la pente sans voiture complétant le centre historique de St Foy et d’un pôle culturel / annexe de l’école d’architecture en pied de balme.Proche des commerces du centre historique, le village pourrait accueillir des logements pour le personnel du centre de recherche et du pôle numérique du parc de Confluence, ainsi que des étudiants en architecture.
La montée des 700 marches serait une véritable promenade en belvédère permettant à la fois la découverte architecturale de la ville et de relier st Foy à la Saône.
AAC058-7737
La balme est parsemée d’eaux de ruissellement qui provoquent une érosion constante du point de vue géologique.Le secteur d’étude se situe dans un talweg évasé vers le haut.Le nouveau village envisagé sera de l’habitation pour l’essentiel, où l’usage de la voiture sera restreint, donc pas de pollution particulière.Création de deux noues suivant les lignes de plus grande pente sur les bord du talweg, servant de collecteur des eaux pluviales et de ruissellement.La noue sera urbaine dans la partie densifiée supérieure, elle sera paysagère dans la partie parc inférieure.Plantation d’essences locales pour reformer le paysage et diminuer l’impact des 3 tours existantes.
PAYSAGE ÉTAT FUTUR
VIAIRE ÉTAT FUTUR
AAC058-7739
EAU POTABLE:La station relais des Fontanières alimente St Foy par un surpresseur. Les deux niveaux supérieurs du site sont desservis en eau potables (avenue Vialloud et chemin des Fontanières)
EAUX PLUVIALES:Collectées par drainage suivant les courbes de niveaux et rejetées dans les deux noues avec stockages dans des réservoirs tampon permettant l’arrosage des jardins.
ASSAINISSEMENT:St Foy et La Mulatière font partie du bassin versant n°8 qui est équipé d’une station d’épuration à Pierre Bénite.L’est de St Foy est raccordé à l’égout sur la rive droite de Saône (quai JJ. Rousseau).Une augmentation de capacité de la station d’épuration de Pierre Bénité est prévue (de 476000 Eq Hab. à 950000 Eq Hab.)Le collecteur du quai JJ Rousseau et la station d’épuration ont la capacité de recevoir les eaux usées du nouveau village.
e nouveau village complète la centralité historique et profite des commerces locaux existants
HYDROLOGIE:
BÂTI ÉTAT FUTUR
AAC058-7741
Dans un deuxième temps, un funiculaire ou télécabine depuis le pôle multimodale pourrait desservir les pentes et le fond du plateau.Le village dans la pente est installé. Il complète naturellement le centre historique de Ste Foy. L'esplanade Lichfield, toute proche de l'église, devient la place centrale de cet nouvel ensemble avec une station de téléphérique.
Le cheminement piéton s'organise à la fois en fonction de l'analyse paysagère et du cadrage de vue sur les éléments architecturaux remarquables de Confluence. C'est aussi un parcours de découverte de patrimoine architectural de la balme: les châteaux et les villas florentines.
Une première approche programmatique est réalisée.
CONCLUSION:Franchir la balme, plus que la Saône, est possible. Le parcours piéton imaginé offre des potentiels d'aménagements certains.Il est nécessaire à ce stade, d'affiner le village, dont la forme urbaine est encore trop rudimentaire, de travailler le belvédère pour mieux comprendre l'intégration du cheminement piéton dans Ste Foy. Enfin il reste à dimensionner l'école d'architecture.
AAC058-7743
1- Échelle urbano-architecturaleGrille thématique: le cercle MOWATT
INTRODUCTION:L'objectif de cette phase est de réinterroger le projet à l'aide d'un outil mettant à l'oeuvre différents questionnements: le cercle de MOWATT.
DÉVELOPPEMENT:Le cercle de MOWATT est une grille d'analyse de projet issue d'un processus de concertation. Cette démarche permet de ré-interroger le projet sous différents angles:
01- ÉNERGIE. Efficacité énergétique. Utilisation des énergies renouvelables. Gaz à effet de serre: Quartier sans voiture, silos de parking mutualisé, proximité de transport en commun (funiculaire vers pôle multimodale). Orientation Sud et Est, performance thermique de l’enveloppe, coefficient de forme des logements. Compacité des îlots et maisons en bandes.
02- EAU. Consommation d’eau potable. Utilisation d’eau pluviale. Gestion des eaux pluviales. Réseau d’assainissement: Citernes de récupération d’eau de pluie pour arrosage des jardins partagés, alimentation WC et machine à laver. Noue paysagère et urbaine + drainage transversal des eaux de ruissellement et de pluie vers la Saône. Voiries et cheminements piéton perméables. Réseau EP avenue Vialloud et Collecteur d’égout sur le quai.
03- ESPACE. Optimisation de la consommation d’espace. Requalification des friches urbaines et des sites pollués. Préoccupations environnementales: Densité des îlots et place centrale. Revégétalisation du parc au sud du village (copropriété 80’). Densité des îlots. Noues et drainage des eaux de ruissellement.
04- MATÉRIAUX. Réutilisation de matériaux
dans les infrastructures et les espaces publics. Réutilisation de matériaux dans la construction / réhabilitation: Point mineur. Concassage des matériaux de démolition après tri sélectif pour sous-couche de voirie ou fond de forme des bâtiments.
05- PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL. Mise en valeur de la qualité du patrimoine architectural. Préservation / valorisation du patrimoine naturel: Appui sur le parc du château de Bellerive. Confortation des murets et murs de soutènement.
06- PAYSAGE. Qualité visuelle du paysage urbain. Qualité visuelle du paysage naturel: C’est l’objet du projet.
07- LOGEMENTS. Qualité du bâti. Qualité des logements. Satisfaction des usagers: Construction bois performante et de qualité issus d’une filière locale. Terrasse, jardin privatif et jardins partagés.
08- SANTÉ, HYGIÈNE. Propreté du quartier. Insalubrité des logements. Droit et accès aux soins de santé: Cf point 13
09- SÉCURITÉ, RISQUE. Sécurité des personnes et des biens. Amélioration de la sécurité routière. Gestion locales des risques technologiques et naturels: Noues et drainage des eaux de ruissellement. Confortations des muret. Pas ou peu de circulation automobiles. Sécurité des personnes sans objet compte tenu du site. 10- AIR. Qualité de l’air intérieur. Qualité de l’air extérieur: Utilisation de matériaux sains sans COV (Construction bois, laines de bois, pas de traitement fongicide, séchage moins de 11% ...). Vie dans un parc habité.
AAC058-7751
LE PÔLE MULTIMODALETRAM-TRAIN
(départ de funiculaire)
LA TRANSVERSALE
LE PARKING MUTUALISE
LA PLACE CENTRALE(station de funiculaire)
LE VILLAGE
LA NOUE URBAINE
LES NOUES PAYSAGERES
LE THEATRE DE PLEIN AIR
LE PÔLE CULTUREL & ANNEXE ENSAL
L’EMBARCADERE
LE CENTRE HISTORIQUE
LE BELVEDERE(station de funiculaire)
AAC058-7752
11- BRUIT. Nuisance de voisinage. Pollution sonore liée au trafic: Sans objet compte tenu du site.
12- DÉCHETS: Gestion des déchets ménagers: Mise en place de bacs de compostage dans les jardin partagées, espace de tri sélectif dans chaque logement.
13- POPULATION. Diversité sociale et économique. Diversité intergénérationnelle: Accession à la propriété, location et co-location étudiant par incitation fiscale. Logement pour personnes âgées valides avec partenariat avec maison de retraite du centre de St Foy pour assistance médicalisée de jour, participation des volontaires à la garderie pour matin et soir ?
14- FONCTIONS ET ACTIVITÉS. Présence d’activités économiques. Présence de commerces. Présence d’équipements et de services: Complément du centre historique de St Foy (écoles, commerces, vie associative), proximité de Confluence (écoles, travail, culture, loisir). Théâtre de plein air et centre culturel / annexe école architecture. Prévoir une crèche / halte garderie dans le village.
15- LOGEMENTS. Diversité des logements: Maisons en bande (108 et 144m²). Prévoir T1, T2 et T3 ?
16- ÉDUCATION ET FORMATION. Lutte contre l’échec scolaire. Renforcement du rôle de l’école dans le quartier: Point mineur, compte tenu de la catégorie socioprofessionnelle et du nombre d’écoles à proximité.
17- LIAISONS AVEC LA VILLE. Amélioration
de l’intégration des habitants dans la ville: Cf point 1918- ATTRACTIVITÉ DU QUARTIER. Présence d’activités ou d’équipements attractifs dans le quartier: Cf point 14. Point de vue sur la ville, situation de belvédère, proximité de la nature à proximité du centre-ville.
19- DÉPLACEMENTS. Développements de cheminements piétons et cyclistes. Mise en place des systèmes peu ou non polluants, efficaces, diversifiés et cohérents: Escalier de liaison depuis le nouveau village et le centre historique de St Foy et la passerelle vers Confluence. Quartier sans voiture, silos de parking mutualisé dans un premier temps, proximité de transport en commun dans un deuxième temps (funiculaire vers pôle multimodale)
20- COHÉSION SOCIALE ET PARTICIPATION. Engagement des habitants et des usagers dans le processus de DD. Participation des habitants aux décisions et projets du quartier: Village pilote du sans voiture dans l’ouest lyonnais. Processus de participation et de concertation à mettre en place avec la municipalité et les habitants de St Foy pour partage du projet et établissement d’un cahier des charges.
21- SOLIDARITÉ ET CAPITAL SOCIAL. Renforcement de la vie collective. Participation des habitants au développement d’une économie locale. Solidarité Nord/Sud. Liens avec la planète: Certainement le point le plus difficile à mettre en place, travail avec le diocèse de Lyon ?
AAC058-7753
Travail sur l'esplanade Lichfield
Travail en coupe
Travail sur la composition du village
AAC058-7754
2- Recherches sur la composition du village dans la pente
A l'issue de l'étape 04, il devient nécessaire d'affiner la composition du village dans la pente pour être plus en accord avec le centre historique de St Foy afin que l'ensemble forme un tout.Un travail en coupe et plan masse , sera suivi d'un travail sur la composition des îlots et blocs.
La place de l'église bordée de nombreux commerces est un élément centrale de la vie fidésienne. L'esplanade Lichfield, située juste derrière l'église, est le belvédère de St Foy.
Avec l'ajout du village dans la pente, ces deux éléments se retrouve au centre du nouvelle ensemble.
La question se pose de rassembler la place de l'église et l'esplanade Lichfield s'impose d'elle-même, pour créer une véritable centralité pour St Foy, reliée à l'hypercentre de Lyon.
AAC058-7755
ligne
de pl
us gr
ande
pente
ligne de plus grande pente
ligne de plus grande pente
ligne de plus grande pente
le coteau
Fort sainte Foy
Stade municipal
ParcM. Bourrat
Parcde Brûlet
Tennis
Poste
CrêcheMaison communale
EcoleRobert Schumann
EcoleLouise Chassagne
EgliseSt Luc
EcoleGrange Bruyère
EcoleFranco-Canadienne
MJC
ParcMont Riant
Tennis
Fontanières
les étroits
le petit sainte foy
orange bruyère
Fort saint irénée
les dames
St Foyles lyon
Les Jardins desFontanières(partagés)
JardinAgniel
Roseraie la bonnemaison
Chateaude Bellerive
(Maristes)-> Vente enpropriétés
Villaflorentine
Eglise
Poste
GarageRenault
Foyer depersonnes agées
Goupescolaire
Maternelle
ChapelleSt Marguerite
Mairie
MaisonNotre Dame
PontRaymond BARRE
Musée desConfluences
Parc desConfluences
PontPASTEUR
Viaduc
Projet depasserelle «Transversale»(Herzog & De Meuron)
Projet depasserelle «Transversale»(Herzog & De Meuron)
Sucrière
Hotel de région
Pôlede loisirs
Palaisdes glaces
Gymn.L. Chanfrey
GroupescolaireAlix
EgliseSt. Balndine
QuartierGénéral Frère
Ex PrisonSt Paul
Ex PrisonSt Joseph
CollègeJ. MonnetGendarmerie
Gendarmerie
Archivesmunicipales
Gare de Perrache
Bureaux
Bureaux
Bureaux
PensionnatBellevue
ex Soirieex-Institut séricol INRA
->Vente en VFA
Pont des Girondins
Perrache
Chem
in d
e Sa
int J
acqu
es d
e Com
poste
lle
Ancienne voie Romaine
Plateaude St Foy
Mon
tée
de la
Fo
urnache
Gra
nde
Rue
du M
arai
s
Chem
in d
e la
Cro
ix Pi
vort
Aven
ue V
alio
ud
Rue du Vingtain
Gra
nde
Rue
du M
arai
s
Rue
du C
hateau
Avenue Maréchal Foch
Aven
ue V
alio
ud
Montée de la Fournache
Rue
Jose
ph R
icar
d
Rue des Frères Lumière
Chemin de Fontanières
Hyper centre
Che
min
des
Fon
tani
ères
Addu
ctio
n EP
Addu
ctio
n EP
Addu
ctio
n EP
Collecteur EU
800 m. - 50mn. en bus
Aménagementdu quai
Aménagementdes Fonctanières
Aménagementdu «Balcon»
vers GERLANDvers St ETIENNE
vers pôlemultimodaled’OULLINS
Aménitédu quai
Densité
vers GARE DE PERRACHE
Pôle multimodal
AUTO
ROUT
E A6
20.000 HABITANTS
22.200 HABITANTS
DESSERTES PRINCIPALES
AUTOROUTE A6
DESSERTES SECONDAIRES
VENELLES
TRAIN
TRAMWAY
SECTEUR D’INTERVENTION
ARCHITECTURE REMARQUABLE
HABITAT COLLECTIF
HABITAT SANS VALEUR PATRIMONIALEA DEMOLIR
COMMERCES DE PROXIMITE
N
km 62.5 125 250
ECHELLE 1/2500
SCHÉMA DIRECTEUR
AAC058-7758
ligne
de pl
us gr
ande
pente
ligne de plus grande pente
ligne de plus grande pente
ligne de plus grande pente
le coteau
Fort sainte Foy
Stade municipal
ParcM. Bourrat
Parcde Brûlet
Tennis
Poste
CrêcheMaison communale
EcoleRobert Schumann
EcoleLouise Chassagne
EgliseSt Luc
EcoleGrange Bruyère
EcoleFranco-Canadienne
MJC
ParcMont Riant
Tennis
Fontanières
les étroits
le petit sainte foy
orange bruyère
Fort saint irénée
les dames
St Foyles lyon
Les Jardins desFontanières(partagés)
JardinAgniel
Roseraie la bonnemaison
Chateaude Bellerive
(Maristes)-> Vente enpropriétés
Villaflorentine
Eglise
Poste
GarageRenault
Foyer depersonnes agées
Goupescolaire
Maternelle
ChapelleSt Marguerite
Mairie
MaisonNotre Dame
PontRaymond BARRE
Musée desConfluences
Parc desConfluences
PontPASTEUR
Viaduc
Projet depasserelle «Transversale»(Herzog & De Meuron)
Projet depasserelle «Transversale»(Herzog & De Meuron)
Sucrière
Hotel de région
Pôlede loisirs
Palaisdes glaces
Gymn.L. Chanfrey
GroupescolaireAlix
EgliseSt. Balndine
QuartierGénéral Frère
Ex PrisonSt Paul
Ex PrisonSt Joseph
CollègeJ. MonnetGendarmerie
Gendarmerie
Archivesmunicipales
Gare de Perrache
Bureaux
Bureaux
Bureaux
PensionnatBellevue
ex Soirieex-Institut séricol INRA
->Vente en VFA
Pont des Girondins
Perrache
Chem
in d
e Sa
int J
acqu
es d
e Com
poste
lle
Ancienne voie Romaine
Plateaude St Foy
Mon
tée
de la
Fo
urnache
Gra
nde
Rue
du M
arai
s
Chem
in d
e la
Cro
ix Pi
vort
Aven
ue V
alio
ud
Rue du Vingtain
Gra
nde
Rue
du M
arai
s
Rue
du C
hateau
Avenue Maréchal Foch
Aven
ue V
alio
ud
Montée de la Fournache
Rue
Jose
ph R
icar
d
Rue des Frères Lumière
Chemin de Fontanières
Hyper centre
Che
min
des
Fon
tani
ères
Addu
ctio
n EP
Addu
ctio
n EP
Addu
ctio
n EP
Collecteur EU
800 m. - 50mn. en bus
Aménagementdu quai
Aménagementdes Fonctanières
Aménagementdu «Balcon»
vers GERLANDvers St ETIENNE
vers pôlemultimodaled’OULLINS
Aménitédu quai
Densité
vers GARE DE PERRACHE
Pôle multimodal
AUTO
ROUT
E A6
20.000 HABITANTS
22.200 HABITANTS
DESSERTES PRINCIPALES
AUTOROUTE A6
DESSERTES SECONDAIRES
VENELLES
TRAIN
TRAMWAY
SECTEUR D’INTERVENTION
ARCHITECTURE REMARQUABLE
HABITAT COLLECTIF
HABITAT SANS VALEUR PATRIMONIALEA DEMOLIR
COMMERCES DE PROXIMITE
N
km 62.5 125 250
ECHELLE 1/2500
3- RENDU E05: Franchir la Saône balme, la montée des 700 marches
Lyon double la surface de son hyper centre avec le projet d’aménagement de CONFLUENCE.
Il est resté cependant une zone suffisamment escarpée qui a échappée par son enclavement, à l’urbanisation intense : la balme de Sainte Foy. Cela a permis à Lyon de conserver en son sein, un espace quasiment naturel. Un grand vide presque hors territoire et pourtant extrêmement proche de la grande intensité de l’hyper-centre. - L’absence de franchissement au-dessus de la Saône, sur toute la longueur du quai, continue de faire de ce lieu un simple fond de scène pour la nouvelle urbanité de Confluence.- Le contraste entre la pauvreté d’aménagement du quai de la balme et la qualité et modernité de la Confluence est saisissant.- Un projet de passerelle Herzog & De Meuron reliant Confluence à la balme pose question. Quelle en est la signification ? Que faire sur cette berge désolée ? Par extension, serait-ce un lien jeté vers le reste du territoire ?
Le propos serait de profiter de la nouvelle impulsion créée par le nouveau quartier des Confluences et des propositions de passerelles pour venir faire une continuité de territoire. Pourquoi ne pas imaginer relier St Foy depuis le futur pôle multimodale (tramway / train) ? Et l’on désenclavait et densifiait Ste Foy les Lyon en répondant d’avance aux grands enjeux des mégapoles de demain ?
Ce désenclavement et cette densification ne prendrait pas la forme quelle a pu prendre sur Confluence,
Hyper centre
Philippe signal & patrimoine
Olivier interface & mobilité
La Mulatièreles chassagnes
les verzières
le coteau
fort sainte Foy
fontanières
les étroits
le petiit sainte foy
orange bruyère
fort saint irénée
résidenceAllixONISEP
les dames
les coutures
chateau de Bramafan
Gerland
St Irénée(5eme)
Fourvière
St Foy
Les Jardins desFontanières(partagés)
JardinAgniel
Roseraie la bonnemaison
Chateaude Bellerive(Maristes)-> Vente en propriétés
PontRaymond BARRE
Musée desConfluences
Pont de La Mulatière
PontPASTEUR
Viaduc
PontKitchenerMarchand
Viaduc
Projet depasserelle
Sucrière
Projet depasserelle
ex Soirieex-Institut séricol INRA->Vente en VFA
Pont des Girondins
BELLECOURS
PERRACHE
VERSPOLE MULTIMODALE
D’OULLINS
Ch
emin de Saint Jacques d
e Compostelle
Ancienne voie Romaine
Plateaude St Foy
Dynamiquede développemntfuture
Dynamiquede développemntfuture
Dynamiquede développemntfuture
Aménitédu quai
Aménagementdu quai
Aménagementdes Fonctanières
Aménagementdu «Balcon»
vers Perrache
vers Gerland
vers pôle multimodale
d’Oullinspar métro
Aménitédu quai
Densité
Densité
Densité
AAC058-7759
Travail en coupe
JardinAgniel
Chateaude Bellerive
(Maristes)-> Vente en
propriétés
Villaflorentine
Eglise
Poste
GarageRenault
Foyer depersonnes agées
Parc desConfluences
Projet depasserelle «Transversale»(Herzog & De Meuron)
Projet depasserelle «Transversale»(Herzog & De Meuron)
Sucrière
Hotel de région
Bureaux
Pont des Girondins
Monté
e de
la F
ourn
ache
Gra
nde
Rue
du
Mar
ais
Aven
ue V
alio
ud
Rue du Vingtain
Gra
nde
Rue
du
Mar
ais
Rue
du C
hate
au
Avenue Maréchal Foch Aven
ue V
alio
ud
Montée de la Fournache
Rue des Frères Lumière
Chemin de Fontanières
Addu
ctio
n EP
Addu
ctio
n EP
Add
uctio
n E
P
Collecteur EU
N
km 37.5 75 150
ECHELLE 1/1500
Habitatcollectif 60’R+8 (3150m²)
Eglise(770m²)
Habitatcentre historiqueR+1 à R+6
Habitatpavilonaire 60’R+1 (160m²)
Maisonde maître 19eR+2 (870m²)
Maisonde maître 19eR+2 (380m²)
Maisonde maître 19eR+2 (1260m²)
ChateauBellerive(entrée 19e)R+4 (2400m²)
Sucrière 20eR+4 (14000m²)
IGH (projet)R+30 (43000m²)
Villaflorentine 19eR+4 (3500m²)
Habitatcollectif 90’R+4 (1400m²)
Habitatcontemporain 00’R+1 (270m²)
ZONEPFE 1
ZONEPFE 2
6mn. en téléphérique, 35mn. à pied
Crèche
BibilothèqueR+3 (1080m²)
RestaurantPanoramique(250m²)
Nouvelle MairieR+4 (2160m²)
Epicerie - Bar
Ecoled’architectureR+4 (12000m²)
Théatrede plein air(390m²)
VUE SUR HOTEL DES REGIONS & EGLISE ST BLANDINE
VUE SUR PAR & MUSEE DE LA CONFLUENCE
VUE SUR TRANSEVERSALE
Dépose minute
Dépose minute
Dépose minute
PLACECENTRALE
PLACEDE
L’ECOLE
EMBARCADERE
PÔLE MULTIDALETramwayTrainTéléphérique
PLACEDU
MARCHE
CENTREHISTORIQUE
DE St FOY
Arrêttéléphérique
N°3
Arrêttéléphérique
N°2
Arrêttéléphérique
N°1
Arrêttéléphérique
N°4
Alt: 249m.
Alt: 220m.
Alt: 297m.
Alt: 190m.
Alt: 182m.
Alt: 190m.
Entrée
Parking
mutualisé
Noueurbaine
Noueurbaine
Nouepaysagèrere
Nouepaysagèrere
Nouepaysagèrere
Nouepaysagèrere
HabitatcollectifR+4 (4*130m²/1*100m²)
HabitatcollectifR+2 (1*100m²/1*140m²/1*70m²)
Habitaten bandeR+2-1 (170m²)+ garage
Habitaten bandeR+1-1 (120m²)
HabitatcollectifR+2-1 (3*110m²/4*120m²)
Habitaten bandeR+3 (185m²)+ garage
MaisonindividuelleR+2 (280m²)+ garage
VERS FOND DU PLATEAU
MASTER PLAN ACTION
AAC058-7760
JardinAgniel
Chateaude Bellerive
(Maristes)-> Vente en
propriétés
Villaflorentine
Eglise
Poste
GarageRenault
Foyer depersonnes agées
Parc desConfluences
Projet depasserelle «Transversale»(Herzog & De Meuron)
Projet depasserelle «Transversale»(Herzog & De Meuron)
Sucrière
Hotel de région
Bureaux
Pont des Girondins
Monté
e de
la F
ourn
ache
Gra
nde
Rue
du
Mar
ais
Aven
ue V
alio
ud
Rue du Vingtain
Gra
nde
Rue
du
Mar
ais
Rue
du C
hate
au
Avenue Maréchal Foch Aven
ue V
alio
ud
Montée de la Fournache
Rue des Frères Lumière
Chemin de Fontanières
Addu
ctio
n EP
Addu
ctio
n EP
Add
uctio
n E
P
Collecteur EU
N
km 37.5 75 150
ECHELLE 1/1500
Habitatcollectif 60’R+8 (3150m²)
Eglise(770m²)
Habitatcentre historiqueR+1 à R+6
Habitatpavilonaire 60’R+1 (160m²)
Maisonde maître 19eR+2 (870m²)
Maisonde maître 19eR+2 (380m²)
Maisonde maître 19eR+2 (1260m²)
ChateauBellerive(entrée 19e)R+4 (2400m²)
Sucrière 20eR+4 (14000m²)
IGH (projet)R+30 (43000m²)
Villaflorentine 19eR+4 (3500m²)
Habitatcollectif 90’R+4 (1400m²)
Habitatcontemporain 00’R+1 (270m²)
ZONEPFE 1
ZONEPFE 2
6mn. en téléphérique, 35mn. à pied
Crèche
BibilothèqueR+3 (1080m²)
RestaurantPanoramique(250m²)
Nouvelle MairieR+4 (2160m²)
Epicerie - Bar
Ecoled’architectureR+4 (12000m²)
Théatrede plein air(390m²)
VUE SUR HOTEL DES REGIONS & EGLISE ST BLANDINE
VUE SUR PAR & MUSEE DE LA CONFLUENCE
VUE SUR TRANSEVERSALE
Dépose minute
Dépose minute
Dépose minute
PLACECENTRALE
PLACEDE
L’ECOLE
EMBARCADERE
PÔLE MULTIDALETramwayTrainTéléphérique
PLACEDU
MARCHE
CENTREHISTORIQUE
DE St FOY
Arrêttéléphérique
N°3
Arrêttéléphérique
N°2
Arrêttéléphérique
N°1
Arrêttéléphérique
N°4
Alt: 249m.
Alt: 220m.
Alt: 297m.
Alt: 190m.
Alt: 182m.
Alt: 190m.
Entrée
Parking
mutualisé
Noueurbaine
Noueurbaine
Nouepaysagèrere
Nouepaysagèrere
Nouepaysagèrere
Nouepaysagèrere
HabitatcollectifR+4 (4*130m²/1*100m²)
HabitatcollectifR+2 (1*100m²/1*140m²/1*70m²)
Habitaten bandeR+2-1 (170m²)+ garage
Habitaten bandeR+1-1 (120m²)
HabitatcollectifR+2-1 (3*110m²/4*120m²)
Habitaten bandeR+3 (185m²)+ garage
MaisonindividuelleR+2 (280m²)+ garage
VERS FOND DU PLATEAU
mais au contraire, elle prendrait en compte les spécificités de la commune de Ste Foy les Lyon. Le tissus pavillonnaire lâche et le vieux bourg existants sur la commune en font un village dans la ville et apportent à ses habitants un certain bien vivre qu’ils ne souhaitent pas perdre : un village gentrifié.
Le propos est d’aborder différents enjeux en terme de MOBILITE, de MORPHOLOGIE URBAINE et de PAYSAGE.
Le possible réaménagement se ferait à moyen ou long terme, voir même très long terme. Un point d’appui possible sur le site qui pourrait créer un déclencheur est l’esplanade Leichfield, jardin et parking en dessous de l’église. C’est un véritable balcon visuel sur la ville de Lyon. Relier à la rivière ce point central permettrait de reconnecter le plateau aux berges. Faire redécouvrir les anciennes venelles et valoriser le patrimoine.
A l’instar des pentes de la Croix Rousse, les pentes de St Foy deviendraient accessibles par un cheminement piéton et autoriserait l’aménagement d’un village sans voiture, à termes, complétant le centre historique de St Foy, la nouvelle mairie, un restaurant panoramique et l’école d’architecture de Lyon en pied de balme.Proche des commerces du centre historique, le village pourrait accueillir des logements pour le personnel du centre de recherche et du pôle numérique du parc de Confluence, ainsi que des étudiants en architecture.
La montée des 700 marches serait une
AAC058-7761
véritable promenade en belvédère permettant à la fois la découverte architecturale de la ville et de relier st Foy à la Saône.
Dans un deuxième temps, un téléphérique depuis le pôle multimodale pourrait desservir les pentes et le fond du plateau.
CONCLUSIONLa forme urbaine du village retravaillé est plus en adéquation avec le centre historique de Ste Foy. Deux zones de Projet de Fin d'Etudes sont imaginées à ce stade: L'école d'architecture en bas de la balme et la place centrale de St Foy.
AAC058-7763
PHASAGE
CHEMINEMENTPIETON
TELEPHERIQUE
EP
PLUVIAL
EU
PAYSAGE ETAT EXISTANT PAYSAGE ETAT FUTUR VIAIRE ETAT EXISTANT VIAIRE ETAT FUTUR HYDROLOGIEECOMOBILITES
CONSTRUCTIONdu bâti
REVEGETALISATIONdu parc
ÉTAT EXISTANT DÉMOLITIONdu bâti sans intérêt patrimoniale
ÉCLAIRCISSEMENT VÉGÉTALminimum
AAC058-7764
CHEMINEMENTPIETON
TELEPHERIQUE
EP
PLUVIAL
EU
PAYSAGE ETAT EXISTANT PAYSAGE ETAT FUTUR VIAIRE ETAT EXISTANT VIAIRE ETAT FUTUR HYDROLOGIEECOMOBILITES
ÉTAT FINAL
ÉTAT APRÈS DÉMOLITIONET DÉBOISEMENT
CONSTRUCTION- Passerelles ‘La Transversale»- Montée des 700 marches- Trois plates-formes- Deux dessertes secondaires- Deux noues paysagères et urbaines
AAC058-7765
1- Problématiques urbainesStory baord de phasage
INTRODUCTION:Cette dernière étape comporte un travail de phasage du projet global sous forme de story board. La hiérarchisation et l'organisation dans le temps des éléments du projet permettent de vérifier leurs pertinence.Le travail sur le site du château Bellerive met en lumière de nouveaux potentiel pour améliorer le cheminement piéton. Cette phase est aussi l'occasion de s'interroger sur le programme d'une école d'architecture.
AAC058-7769
2- Réflexions sur une école d'architecture
LIEUTrouver le lieu d'implantation idéal d'une école d'architecture ? Compte-tenu du fait que 50% de la population mondiale vit aujourd'hui en ville, le travail du futur architecte se fera en majeur partie sur le thème de la ville. Il me semble donc nécessaire qu'une école soit au contact de la ville; certaines écoles sont même "disséminée dans la ville". La ville permet symboliquement de prendre de la hauteur de vue ne serait-ce que par sa richesse culturelle. Le quartier de Confluence intègre les dernières réalisations des "archistars" internationaux. Implanter une école d'architecture au pied de la balme de Ste Foy, en face de ce quartier permettra au étudiants de profiter de la diversité possible de la production actuelle. Le site du château Bellerive destiné à la vente par appartements, est tout à fait approprié.
AAC058-7773
Perspective du Chateau Bellerivesource Archipat, 2003
Un cheminement existant sur le site dans l'axe du cheminement du projet offre une formidable opportunité d'en modifier le tracé pour être plus respectueux du site.
La découverte tardive de document d'archive montre que le tracé du cheminement piéton imaginé dans les étapes précédentes impacte trop le site.
Nouveau tracé du cheminement piéton de la "montée des 700 marches"
AAC058-7774
Accroche à la passerelle
Passage du cheminement piéton sous l'école/extension du château & accès à l'école.
Vers le village dans la pente
ACCROCHE AU SITE:Différentes accroches au château sont possibles, mais l'analyse à cette étape d'un document d'archive du château montre des éléments forts:- Le parcours piéton imaginé en pied de balme vient traverser un aménagement intéressant du parc (ferme, talweg, orangerie).- L'existence un chemin piéton desservant le château par la gauche vient en alignement du parcours piéton amont.Ces deux éléments sont une formidable opportunité d'amélioration du projet global en modifiant le tracé du parcours et impose naturellement le concept d'accroche de l'école au château.Le hasard fait parfois bien les choses ...
AAC058-7775
EXHIBITION / DISCRÉTION:Le bâtiment enseigne-t-il ou bien reste-il discret pour laisser libre cours à l'ouverture d'esprit et l'imagination?Confluence est composé de bâtiments très marqués du point vue architectonique.Implanter une école d'architecture sur la rive opposée dans le parc arboré d'un château implique un bâtiment plus discret, en tous cas respectueux du site. Il s'agit plus exactement de prendre en compte le site sans être dans l'effacement, avec un retour en arrière possible. La modification du tracé du cheminement piéton réutilisant les traces de l'existant en est l'illustration.
Je prendrai en référence l'école de Porto de SIZA pour sa situation dans la pente et le respect du site et bien d'autres choses encore, le Millstein Hall du college of Architecture, Art and Planning de l'univesité de Cornell (New York) de Rem KOOLHAAS pour sa proximité avec un élément patrimonial et enfin le travail de Christian PEREZ avec Holcim béton pour l'originalité de la structure.
École d'architecture de PORTO - PortugalArchitecte: Alvaro SIZAPhotos: Kenneth FRAMPTON et José Paulo DOS SANTOS
AAC058-7777
PROGRAMME:-La place de l'amphithéâtre est effacée dans les écoles d'architectures françaises post-68'. Il serait intéressant de redonner de la magie à ce lieu en regard de l'exemple de la Sorbonne.L'amphithéâtre et l'atelier sont pour moi les deux éléments clés de l'enseignement de l'architecture.
-L'avènement du travail sur ordinateur reinterroge la pédagogie de l'architecture. On encourage durant les premières années de licences le travail à la main, pour ne pas être contraint pour l'outil, en revanche, les rendus en cycle de master s'effectuent majoritairement en CAO. Les techniques de travail nécessitent des apports en lumière naturelle et artificielle bien différents dans les ateliers de travail. Cette questions est majeur pour un tel projet.
-Un espace suffisant pour affichage des rendus.
- Des salles de cours avec une acoustique satisfaisante.
- Un espace de travail dédié et personnel où l'on peut laisser son travail d'une semaine sur l'autre, où l'on peut venir travailler durant la semaine. Idéalement, un espace de travail ouvert 24/24 avec badge.
-Un atelier maquette équipé de machines et magasin de fournitures de bases.
-Un espace d'expérimentation des techniques constructives en grandeur nature (béton, brique, acier, bois, ...) en supplément des GIAI ou des chantiers
AAC058-7779
HOLCIM COMPETENCE CENTER - Holderbank, Switzerland, -2008 [Competition First PrizeArchitecte: Christian PEREZ
Millstein Hall du college of Architecture, Art and Planning de l'univesité de Cornell (New York)Architecte: Rem KOOLHAAS
AAC058-7780
Différentes accroches possible au château Bellerive
réels (idem CAP).
CONCLUSION:Ce travail ne sera abouti par manque de temps. Un travail important et passionnant reste réaliser pour atteindre les objectifs de programme.Mais plus encore, la question du lieu et de l'intégration d'un tel programme reste à approfondir.
AAC058-7781
" ATMOSPHÈRES"
Le titre « Atmosphères » vient d'une question qui m'intéresse depuis longtemps — intérêt qui, évidemment, constitue un préalable: qu'est-ce, au fond, que la qualité architecturale ? Pour moi, c'est relativement simple. La qualité architecturale, ce n'est pas avoir sa place dans un guide d'architecture ou dans l'histoire de l'architecture ou encore être cité ici ou là. Pour moi, il ne peut s'agir de qualité architecturale que si le bâtiment me touche. Mais qu'est-ce qui peut bien me toucher dans ces bâtiments ? Et comment puis-je le concevoir ? Comment puis-je concevoir quelque chose comme l'espace qui est représenté sur cette photographie ? C'est pour moi une icône, je n'ai jamais vu l'édifice, je crois qu'il n'existe plus, et je le regarde avec un immense plaisir. Comment est-il possible de concevoir des choses qui ont une présence si belle, si évidente, et qui me touche toujours ?
Il y a une notion qui exprime cela, c'est celle d'atmosphère. C'est quelque chose que nous connaissons tous. La première impression que nous avons d'une personne en la voyant. J'ai appris qu'il ne faut pas s'y fier, qu'il faut lui laisser une chance. Aujourd'hui, je suis un peu plus âgé et je dois dire que j'en suis revenu à dette première impression.
AAC058-7782
C'est un peu la même chose en architecture. J'entre dans un bâtiment, je vois un espace, je perçois l'atmosphère et, en une fraction de seconde, j'ai la sensation de ce qui est là.
L'atmosphère agit sur notre perception émotionnelle. C'est une perception d'une rapidité inouïe et qui nous sert, à nous autres êtres humains, apparemment pour survivre. Toutes les situations ne nous laissent en effet pas le temps de réfléchir longtemps si elles nous plaisent ou non, si nous devons prendre la fuite ou non Il y a quelque chose en nous qui nous dit instantanément beaucoup de choses. Une compréhension immédiate, une émotion immédiate, un rejet immédiat, Quelque chose d'autre que cette pensée linéaire que nous possédons aussi, et que j'aime aussi, qui nous permet de penser intégralement le chemin de A à B. Nous connaissons bien sûr la perception émotionnelle grâce à la musique. Le premier mouvement de cette sonate pour alto de Brahms, l'entrée de l'alto —et en quelques secondes, l'émotion est là ! (Sonate op, 120 0° 2 en mi bémol majeur pour alto et piano).
Et je ne sais pas pourquoi C'est un peu aussi la même chose pour l'architecture.
Pas aussi fort que dans la musique, le plus grand des
AAC058-7783
arts, mais c'est là. Je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit à ce propos dans mon carnet de notes. Pour vous donner une idée de ce que j'entends. Jeudi saint 2003. Je suis là, assis, une place au soleil, une grande arcade, longue, haute, bien au soleil. La place — le front de maisons, l'église, les monuments — comme un panorama devant moi. Le mur du café dans mon dos. Il y a du monde, juste ce qu'il faut. Un marché aux fleurs. Soleil Onze heures. La façade de l'autre côté de la place dans une ombre agréablement bleutée, Des bruits enchanteurs discussions proches, pas sur le dallage de la place, oiseaux, légers murmures de la foule, pas de voiture, pas de bruit de moteur, par moments des bruits de chantier au loin Je m'imagine que les jours fériés qui s'annoncent ont déjà ralenti le pas des gens.
Deux religieuses — c'est de nouveau la réalité, sans imagination — deux religieuses traversent d'un pied léger la place en gesticulant, leurs coiffes agitées par le vent, chacune porte un sac en plastique. Température agréablement fraîche, chaude. Je suis assis sous l'arcade, sur un canapé capitonné vert clair, devant moi la statue de bronze sur son socle élevé au milieu de la place me tourne le clos et regarde comme moi vers l'église à deux tours. Leurs flèches sont inégales. Elles sont semblables à la base puis s'individualisent progressivement vers
AAC058-7784
Texte extrait de : ZUMTHOR, Peter, 2008 :Atmosphères, Éditions Birkhauser
le haut. L'une est plus haute et porte une couronne d'or autour de son sommet B ne va pas tarder à arriver en traversant la place en biais depuis la droite. Qu'est-ce qui m'a touché alors ? Tout.
Tout, les choses, les gens, l'air, les bruits, le son, les couleurs, les présences matérielles, les textures, les formes aussi. Des formes que je peux comprendre, que je peux essayer de lire, que je trouve belles
Et quoi encore ? Mon état d'âme, mes sentiments, mon attente d'alors, lorsque j'étais assis là. Et je pense à cette célèbre phrase en anglais renvoyant à Platon : « Beauty is in the eye of the beholder » Cela signifie que tout est seulement en moi. Mais je fais alors l'expérience suivante j'élimine la place et je n'éprouve plus les mêmes impressions Une expérience simple — vous excuserez la simplicité de ma pensée. Mais j'élimine la place — et mes impressions disparaissent Je ne les aurai jamais eues sans son atmosphère. C'est logique. Il existe une interaction entre les êtres humains et les choses C'est à quoi je suis confronté comme architecte C'est ma passion. Il existe une magie du réel. Je connais bien sûr la magie de la pensée. La passion de la belle pensée Mais je parle ici de ce que je trouve souvent encore plus incroyable , la magie des faits, la magie du réel.
AAC058-7785
Le travail d'analyse développé dans les premiers chapitres permet d'étayer les intuitions des premières visites in situ.
Sainte Foy s'est préservé du développement urbain de l'agglomération lyonnaise grâce à sa balme. La configuration de la balme, notamment par son dénivelé, n’a pas facilité la réalisation de liaisons transversales.Les propriétés que l’on trouve implantées dans la balme ont été également, par leur contenance, un frein à la circulation. Les rares venelles transversales permettant de rejoindre la Saône depuis Sainte Foy sont aujourd'hui murées ou en mauvais état. Les murs de soutènement des propriétés ne sont plus entretenus et s’effondrent, témoignant ainsi d’une certaine désaffection de la Saône et de son quai. Le quai Jean-Jacques Rousseau, bien que pourvu d'un patrimoine architectural d'une qualité certaine est un véritable délaissé urbain. Le potentiel architectural est immense.
Cette situation est extrêmement étonnante puisqu’elle témoigne d’un isolement et d’un éloignement temporel vis-à-vis du centre de Lyon. La balme se contourne, elle ne se traverse pas. Nous ne sommes pourtant qu’à huit cent mètres à vol d’oiseau du centre de Confluence.
La pratique de la rivière a disparue peu à peu avec d’une part, l’empierrement du quai au XVIIIe siècle, et d’autre part l’orientation des accès aux propriétés vers l’amont et vers Sainte Foy. Les accès aux propriétés depuis le quai semblent avoir disparus.
Pour autant, la beauté du site donne envie de permettre un renouveau de ce lieu et de retrouver le faste d’antan.L’enjeu du projet urbano-architectural présenté dans ces lignes est de tenter de tisser un lien depuis Confluence avec Ste
Foy. Ce lien est à la fois symbolique, il s’agit en effet de créer une connexion visuelle entre les deux éléments, mais aussi réelle : le projet permettrait de réaliser une montée piétonne et publique de la balme. Cette montée des sept cent marches est conçue comme une promenade de découverte architecturale, tant du patrimoine existant dans la balme avec ses villas florentines, que des dernières réalisations du gotha d’architectes internationaux sur Confluence.La construction d’un téléphérique permet de pallier aux aléas d’un important dénivelé pour un usage quotidien. Cela permet un gain de temps pour les personnes en activité et autorise la flânerie et la découverte pour les visiteurs du site.L’enjeu de taille pour le développement futur de Sainte Foy.
Ce projet met en lumière les potentiels du site avec différents projets d'aménagement possible donnant matière à projet de fin d'étude, le choix d'un sujet restant à déterminer:- Une école d'architecture en pied de balme- Un village dans la pente pour compléter le centre historique de Sainte Foy.- Un édifice public, une mairie par exemple, comme base d'aménagement d'une véritable centralité pour Sainte Foy.- Le cheminement en lui- même
C’est en soi, d’une petite révolution, puisqu’il s’agit d’un projet public qui vient s’intégrer dans un site historique privatif.
LA QUESTION DU LIEU:J'ai tenté, en tant que designer de produit de jouer des contraintes économiques, techniques, d'usage, sociologique ou tendances de consommation. Le marketing est le plus prégnant des facteurs extérieurs, puisqu’un designer est toujours au service
AAC058-7787
Bibliographie à étudier:
CHOAY Françoise, 1965: L'urbanisme, utopies et réalités, éditions Seuil.
AUGE Marc, 1992: Non-lieux, éditions Seuil
NORBERG-SCHULZ Christian, 1997: Genius loci, paysage, ambiance, architecture, éditions Mar-gada
NORBERG-SCHULZ Christian, 1997: Art du lieu, architecture et paysage, éditions Le Moniteur
NUSSAUME Yann, 2000: Tadao ANDO et la ques-tion du milieu, éditions Le Moniteur
MANGEMATIN, Michel , NYS, Philippe et YOUNES Chris, 1996 : Le sens du lieu, éditions Ousia, BRUXELLES
ZUMTHOR Peter, 2008: Penser l'architecture, éditions Birkhaûser
ZUMTHOR Peter, 2008: Atmosphère, éditions Birkhaûser
VON MEISS Pierre, 1986: De la forme au lieu, une introduction à l'étude de l'architecture, éditions Presses polytechniques romandes
AAC058-7788
d’une marque. Son travail, vu de cette marque, consiste à en traduire les valeurs dans le design des produits. J’ai essayé et parfois réussi à donner un sens au produit, ce petit supplément d'âme que Clino CASTELLI appelle emotional design.
La pratique de l'architecture vue par les yeux du designer, semble accessible, la démarche de conception est connue, seule l'échelle de travail change. Le travail à l'échelle urbano-architecturale montre pourtant bien autre chose: l'importance du lieu et la façon dont il influence l'architecture, bien au-delà du programme.
Appréhender la notion de lieu n'est pas forcément immédiat et fût en tout cas, longtemps éloigné de mes premières préoccupations professionnelles. Percevoir la magie du lieu est une chose, essayer de comprendre comment la générer en est une autre. Je comprends une partie du métier d'architecte comme cette quête.
Il y a une relation ambiguë entre le lieu et l’architecture, l’architecture venant soit s’intégrer, soit se confronter. Par ailleurs, il est incontestable que si le lieu renforce l’émotion de l’œuvre de l’architecte, l’architecture crée le lieu. L’émotion peut donc être apportée par l’architecture. Comment expliquer l’émotion ressentie devant certaines réalisations telles que les termes de Vals de Peter ZUMTHOR, l'école d'architecture de Porto de SIZA ou l'Alhambra à Grenade ?
Ce questionnement est au cœur de mes préoccupations et me semble essentiel pour compléter le parcours d’un architecte en formation. S’interroger sur la nature du lieu, comme préalable à un projet de fin d’études, permet de mettre en place les prémices d’une réflexion qui sera mûrie tout au long d’une carrière. Le mémoire ne sera qu’une
tentative de compréhension et tout au moins un état de la question.
Au stade d’avancement du projet du chapitre 06 où il s’agit de sortir de la stratégie et de se confronter à la réalité, la question prend tout son sens.
Qu’est-ce qu’un lieu ?Quelles en sont les composantes indispensables ?Que-ce qui fait l’aménité du lieu ?Quelles représentations y sont associées, d’ordre social, mémoriel ou physique ?
Après avoir tenté de définir le lieu, la question est de savoir comment articuler les notions de confrontation et d’intégration de l’architecture à ce lieu, et l’intérêt selon l’architecte du choix de ce site pour édifier ?
Enfin, revenir sur une étude de cas pour illustrer le propos. Le contraste crée par la proximité de Confluence avec la balme de Sainte Foy. Cette analyse sur le lieu devrait permettre, dans le cadre du projet d’implantation d’un bâtiment sur la balme, de répondre à la question :Comment se positionner par rapport à l’architecture de Confluence ?Comment prendre en compte l’histoire du lieu et assurer la pérennité d’un site protégé ?
AAC058-7789
ARNOLD Françoise, DAVOINE Gilles, DEBARRE Anne, FORT Francine, JOFFROY Pascal, 1997: 36 modèles pour une maison. Éditions Périphériques
CHEMETOV Paul,1996: 20000 mots pour la ville. Éditions Flammarion
DANTEC Maurice G., 2008:Villa Vortex. Éditions Gallimard
LIPSKY Florence, 1999: San Francisco, la grille sur la colline. Traduction Cynthia SCHOCH. Éditions Parenthèses
Mc COY Esther, 1961: Richard NEUTRA. Éditions R.R. Donnnelley & sons Company, USA
MENGIN Christine, 2007: Guerre du toit et modernité architecturale. Loger l'employé sous la république de Weimar. Publications de la Sorbonne
MONGEREAU Noël, 2010: Géologie de Lyon. Éditions Lyonnaises d'Art et d'Histoire
MOZAS Javier ae FERNANDEZ PER Aurora, 2006: Density, New collective housing. A+T editiones
PIANO Renzo, 2009: La désobéissance de l'architecte. Conversation avec Renzo CASSIGOLI. Traduit de l'italien par Olivier FAVIER. Éditions Diffusion Seuil
VENEZIA Francesco, 1988: Catalogos de arquitectura contemporanea. Introduction de Alvaro SIZA. Éditions Gustavo Gili
SALES, Christian,2006: Lyon secrets et légendes, DVD Éditions Simples
SIZA Alvaro: Works & Projects 1954-1992. Introductions de Peter TESTA et Kenneth TRAMPTON. Éditions Gustavo Gili
STERN Michael et HESS Alan, 2007: Julius SCHULMAN: Palm Springs. Publications Rizzoli International
BIBLIOGRAPHIE
AAC058-7790
FILMOGRAPHIE:
COMPAIN Frédéric, COPANS Richard, NEUMANN Stan, ADDA Catherine, 2011: Architectures volume 1,: Le bauhaus de Dessau,L'école de Siza, Le falilistère de Guise, Nemausus 1, Le centre Georges Pompidou, La caisse d'épargne de Vienne. DVD Arte vidéo
SALES, Christian, Lyon secrets et légendes, DVD 182 minutes
VIDOR, King,1949 The fountainhead, fim d'après une nouvelle de Ayn RAND
KAHN Nathaniel, 2003 My Architect, a son's journey
AAC058-7791
LEXIQUE & ABRÉVIATIONS
AEU: abréviation. Approche environnementale de l’urbanisme
ABNÉGATION: (n.f.) (latin ecclésiastique abnegato renoncement) : sacrifice total au bénéfice d’autrui de ce qui pour soi est essentiel : faire preuve d’abnégation.
AMÉNITÉ: (n.f.) politesse, affabilité qui charme : accueillir quelqu’un avec aménité
ANASTOMOSÉ: (adj.) abouchement de deux vaisseaux, confluence de plus fines nervures d’une feuille, permettant une circulation harmonieuse des sèves. Quand un vaisseau sanguin est bouché, le fait de couper et raccorder les deux nouvelles extrémités est une anastomose.
ARACHNÉEN: (adj.) propre à l’araignée, qui a la légèreté d’une toile d’araignée
BALME: (n.f.) rive d’un fleuve en relief sculptée par l’eau. Vient du gaulois balma qui signifie « grotte d’ermite ». Les falaises et/ou parois abruptes des vallées étaient souvent creusées de cavernes de dissolution servant d’abris ; le nom de « balme » a ensuite été appliqué à l’ensemble du versant.
BAROQUE: (n.m.)style artistique qui s’est développé au XVIe et XVIIe siècle, à partir de l’Italie, dans la plus part des pays d’Europe et d’Amérique latine. Arrive après le maniérisme
BASSIN VERSANT: représente l’ensemble d’un territoire drainé par un cours d’eau et ses affluents. Son contour est délimité par des frontières naturelles, les crêtes des sommets (ce que l’on appelle la « ligne de partage des eaux »), qui déterminent la direction de l’écoulement des eaux de pluie vers un cours d’eau. Par exemple, le bassin Rhône-Méditerranée correspond
au territoire sur lequel toute goutte d’eau de pluie ruisselle vers les rivières qui alimentent le Rhône, ses affluents et les fleuves côtiers, pour se jeter finalement dans la Méditerranée (surface du bassin versant du Rhône: 95000km²).
BASTIDE: (n.f;) point de colonisation mis en place par « l’état »Béton romain : mélange de brique plus chaux
CADAVRE EXQUIS: jeu collectif pratiqué par les surréalistes et consistant à composer une phrase en écrivant tour à tour un mot sur un morceau de papier que l’on plie et passe à son voisin (il existe aussi des cadavre exquis dessinés)
CARROYAGE: (n.m.) découpage en carreaux. Cf. plan de New York
CENTIPÈDE: (n.m.) Les centipèdes sont une classe d’arthropodes myriapodes : «les mille-pattes». Le centipède est une créature imaginaire littéraire. Centipede est un jeu vidéo.
COSTIÈRE: (n.f.) bord relevé d’une ouverture ménagée dans une dalle ou dans une toiture pour la trémie d’un lanterneau (sur mur d’entrée de jardin)
DÉCENTRATION: (n.f.) Les processus de décentration. Piaget appelle décentration le processus conduisant de l’égocentrisme et du phénoménisme à l’objectivité, du sujet individuel (subjectivité déformante) au sujet épistémique (activité structurante). Cette décentration du sujet par rapport à sa perspective et à son point de vue propre (égocentrisme) ainsi que par rapport aux apparences les plus immédiates des objets (phénoménisme) est elle-même solidaire de la différenciation et de la coordination
AAC058-7792
progressives des actions (structures initiales de la connaissance) en fonction de leurs interactions adaptatives avec les objets. Elle dépend donc étroitement de l’élaboration même des nouvelles structures de la connaissance. Le principe de la différenciation repose sur le fait qu’une même activité est amenée à se spécifier par accommodation aux caractéristiques propres aux divers objets qu’elle assimile (assimilations et accommodations des schèmes aux objets). Le principe de la coordination repose sur le fait que plusieurs actions distinctes peuvent s’appliquer sur (donc assimiler) un même objet d’où la nécessité non seulement de s’accommoder chacune à cet objet, mais de s’accommoder également l’une à l’autre (assimilations et accommodations réciproques entre schèmes).
DÉCONVOLUTION: (n.f.) clarifier une image brouillée de l’urbanisme
DYSTOPIE (ou contre-utopie): (n.f.) est un récit de fiction peignant une société imaginaire organisée de telle façon qu›elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur et contre l'avènement de laquelle l›auteur entend mettre en garde le lecteur. La dystopie s›oppose à l'utopie : au lieu de présenter un monde parfait, la dystopie propose une des pires qui soit. La différence entre dystopie et utopie tient moins au contenu (car, après examen, nombre d’utopies positives peuvent se révéler effrayantes) qu’à la forme littéraire et à l’intention de son auteur.
EPANNELAGE:(n.m.) de épanneler.Taille d’un bloc de pierre ou d’un autre matériau dur par pans et chanfreins, en laissant autour des formes à sculpter une certaine quantité de matière. (Précède le dégrossissage.) En architecture, on
parle d’épannelage du bâti pour illustrer le rapport de volume entre bâtiments, la morphologie du bâti.
EXORDE: (n.m.) entrée en matière d’un discours, introduction
FLEUVE: (n.m.) se jette dans la mer
GENIUS LOCI: expression latine pouvant être traduit en français : «esprit du lieu»
GENTRIFICATION: (n.f.) zone «sans pauvres», c’est un phénomène urbain d’embourgeoisement. C’est le processus par lequel le profil économique et social des habitants d’un quartier se transforme au profit exclusif d’une couche sociale supérieure.
HOMOCHROME: (adj.) se dit de stimulus de couleur produisant des sensations colorées identiques (effet caméléon)
ICU: ilot de chaleur urbain
IDIOSYNCRASIQUE: (adj.) personnel, populaire, relatif aux caractères et comportement propres d’un individu. Le fait de copier le comportement de quelqu’un.IMMANENT: (adj.) à partir des raisons qui ont fait cette architecture / cet objet. Qui est contenu dans un être, qui résulte de la nature même de cet être et non pas d’une action externe.
IPSEITÉ: (n.f.) ce qui constitue l’individualité d’un être en tant qu’il est lui-même et différent des autres.
LÔNE: (n.f.) bras de fleuve variant à chaque inondations qui génère des pièces d’eaux éphémères.
MACROMOBILITÉ: (n.f.) Mise en place
AAC058-7793
de liaisons tangentielles rapides pour relier les pôles intenses d’une métropole polynucléaire. Ces liaisons sont implantées entre couloirs de transport sur rail existants afin de court-circuiter les grands axes existants dans le paysage urbain: systèmes BRT (Bus Rapid Transit) qui utilisent les liaisons routières existantes.
MICROMOBILITÉ: (n.f.) Mise en place et intégration de petits systèmes individuels de feeders et navettes vers de nouvelles tangentes (rayon d’action 3 km) qui permettent de desservir les zones qui s’ouvrent entre les grands couloirs de transport (taxi collectif, systèmes d’appel (mobility on demand), vélo, scooter...).
MANIÉRISME: (n.m.) (1520-1580 -> mort de Raphael) mouvement artistique de la période renaissance qui constitue une réaction face aux conventions artistiques de la haute renaissance. Ex : rompre délibérément avec l’exactitude des proportions. Le maniérisme pictural : on invente une manière d’outrepasser le réel pour dépasser la peinture de Raphael. Exagération des pigments, des corps et des lumières.
MATÉRIALITÉ: (n.f.) caractère, nature de ce qui est matériel. Matérialisation du sens d'un matériaux par ex.
MODÉNATURE: (n.f.) traitement ornemental de certains éléments structurels d’un édifice pour en exprimer la plastique. (La modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief, continu (moulures) ou répétitif (modillons, bossages, caissons, etc, …)
PALIMPSESTE: (n.m.) parchemin sur lequel on réinscrit sans cesse l’histoire, couches après couches
ONTOLOGIE: (n.f.) En philosophie, l’ontologie est la branche de la métaphysique concernant l’étude de l’être. En médecine, l’ontologie s’intéresse à la genèse des maladies. En informatique, une ontologie est un système de représentation des connaissances.
PARADIGME: (n. m.) (bas latin paradigma, du grec paradeigma, modèle)En grammaire traditionnelle, ensemble des formes fléchies d’un mot, pris comme modèle. (C’est, par exemple, la déclinaison d’un nom ou la conjugaison d’un verbe). En linguistique structurale, ensemble des unités qui peuvent commuter dans un contexte donné. En doctrine économique, choix de problèmes à étudier et des techniques propres à leur étude
PIEDMONT: (n.m.) territoire « au pied du mont », plaine en pente douce autorisant un développement urbain
PIETRA SERENA: l’usage d’une pierre sombre pour souligner les arrêtes d’un bâtiment (modénature visible)
PHYTOREMÉDAITION: (n.f.) dépollution des sols par des plantes adaptées (bambou par ex, qui stocke les métaux lourds dans leur cannes)
PROLÉGOMÈNES: (n. m. pluriel) du grec pro, devant, avant et de legein, dire. Il s’agit d’une longue introduction placée en tête d’un ouvrage ou bien de l’ensemble des notions préliminaires à une science. Il s’utilise toujours au pluriel. On doit ainsi à Kant des Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science. Aux environs de 1400, Ibn Khaldoun a publié ses prolégomènes connu aujourdhui comme El Moukadima.En 1827, Pierre-Simon
AAC058-7794
Ballanche a publié des Prolégomènes pour sa Palingénésie sociale, et en 1945 André Breton a publié des Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non
PROCRASTINER: (v.) reporter au lendemain, remettre à plus tard quelque chose, généralement par manque de motivation ou par paresse.
PROPÉDEUTIQUE: (n.f.) (du gr. paideuein « enseigner ») fut en France, jusqu’en 1966, le nom de la première année d’études supérieures, préparatoire aux licences dans certaines universités.
RESTANQUE: (n.f.) est la francisation du provençal restanco (en occitan normalisé restanca), terme employé en basse Provence et désignant au sens propre un mur de retenue en pierres sèches construit dans le lit d’un torrent intermittent pour provoquer un atterrissement en amont (tout en laissant passer l’eau) et créer ainsi une terrasse de culture.
RIPISYLVE: (n.f.) milieu naturel /écosystème dont la flore est adaptée au bord de rivière (saule, aulne, bambou, …)Rivière : se jette dans un fleuve
RIVIÈRE: (n.f.) se jette dans un fleuve
ROUE DE MADEC: permet de définir l’optimum de proximité des équipements publics
SAUVETÉ: (n.f.) point de colonisation mis en
place pour constituer un village, on en trouve souvent dans le sud-ouest le long du tracé de St Jacques de Compostelle.SCOLASTIQUE: (n.f.) Le terme de « scolastique », dérivé du terme schola, provient du grec scholê au sens d’oisiveté, de temps libre, d’inactivité, qui a donné à une période un peu plus tardive : « tenir école, faire des cours ». C’est qu’en effet, au Moyen Âge, seuls les religieux avaient la « scholê », c’est-à-dire le loisir d’étudier, laissant aux autres (le clergé séculier, les frères convers, les laïcs…) le soin dévalorisé de s’occuper des affaires matérielles.
SENTE: (n.m.) chemin /venelle entre deux mus
SMIRIL: abréviation. Syndicat mixte du Rhône, des îles et des lônes. Institution, son objectif est de restaurer le Rhône naturel et ses berges et de renouer les liens entre l’homme et le fleuve.
STÉRÉOTOMIE: (n.f.) science de la coupe/taille des pierres. La stabilité de la structure était pensée comme un monolithe fait de petits morceaux. La coupe de chaque pierre était étudiée finement.
SYNCRÉTISME: (n.m.) mélange d’influences. Le terme de syncrétisme vient d’un mot grec signifiant « union des Crétois ». Initialement appliqué à une coalition guerrière, il s’est étendu à toutes formes de rassemblement de doctrines disparates.
UCHRONIE: (n. f.) (du grec ou, non, et khronos, temps) Reconstruction fictive de l’histoire, relatant les faits tels qu’ils auraient pu se produire.
VRU: abréviation. Voie rapide urbaine
ZUMTHOR PETER: architecte suisse, montagnard, froid et réfléchi. Son architecture est massive, simple formellement et réflective.
AAC058-7795
É C O L E N AT I O N A L E S U P É R I E U R E D ' A R C H I T E C T U R E D E LY O N © D E M M AT E R I A L I T E M A S T E R 1 - 2 0 11 - 2 0 1 2
LA VILLE ET L'EAU
FRANCHIR LA SAONE BALMEMONTÉE DES 700 MARCHES
SUR LES PENTES DE LA SAINTE FOY
02 - ANNEXESPOULET OLIVIER
M A S T E R D ' A R C H I T E C T U R E 1 M AT E R I A L I T É s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e W I L L I A M H AY E T
É C O L E N AT I O N A L E S U P É R I E U R E D ' A R C H I T E C T U R E D E LY O N
é q u i p e e n s e i g n a n t e : W I L L I A M H AY E T
J E A N - P I E R R E M A R I E L L EA N TO N E L L A M A S T R O R I L L I
D AV I D M A R C I L L O N A R N A U L D D E B U S S I E R R E
P R . T H I E R RY V E R D I E R J E A N TA B O U R E TC Y R I L G A U T H I E R
B E N J A M I N C H AVA R D E S
AAC058-7797
GRILLET, Yves, 2011 : SEM MATERIALITE 01, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 14 octobre 2011.
« Matière, substance initiale »
Cette conférence explique la démarche d’Yves Grillet pour l’élaboration de son projet urbain pour Rillieux-la-Pape au sein de l’Atelier Matérialité en 2010-2011. Il aborde successivement différents thèmes :
La matérialité : consiste à concrétiser une pensée. L’acte d’appropriation ne va pas de soi, il se professionnalise et devient en soi, objet de conception, par le fait qu’il devienne le problème à résoudre.
La Prospective : imaginer un scénario prospectif d’une journée type en 2025 …La Notion d’appropriation mutable : les projets doivent être réversibles.
Sa Volonté : retrouver l’histoire, l’origine des champs maraîchers de Rillieux.
Le Diagnostic : situer Rillieux au sein de l’agglomération lyonnaise avec le SCOT du Grand Lyon.
Sa Matérialité : le Pisé, mode constructif utilisant la terre crue.
Les Enjeux : social (faire en sorte que l’agriculture devienne la fierté des Rillards), économique (devenir du site de l’usine à briques PERICA).
Les problématiques : l’appropriation (comment faire accepter un nouveau quartier), la nature dans la ville (agriculture), la mixité sociale.
Les Thèmes : agriculture urbaine, environnement et partage.
Parenthèse d’explication de texte par l’exemple:-Diagnostic : J’ai la grippe-Enjeu : guérir vite-Stratégie:« un suppositoire et au lit »-Problématique : le temps qui passe-Thème : Corps, éviter la contagion
Y.Grillet note que le processus d’élaboration nécessite un bon binôme et considère l’année de M1 comme un tout, une synthèse des différents apports (étude des villes grecques, lectures, cours, conférences, ...). Il recommande de donner un titre à son projet ; un énoncé simple peut tenir dans la durée (ex : Granges urbaines) et de travailler sur un petit périmètre. Il détaille enfin les différents aspects de son projet tels que : le processus d’élaboration (à partir de la notion de sillon), le projet (constitué de « Granges urbaines », un mail, une institution BTS agricole, des immeubles en sillon), le phasage du projet sur 10 ans et un processus constructif (logements mutables, …)
Le débat portera sur le choix du rendu informatique vs le rendu à la main, qui fût pour lui, ne maîtrisant pas les outils informatiques un véritable enjeu.
Avis personnel: cette conférence permet de visualiser un exemple concret de démarche de projet urbain, mais la question des contextes sociaux et économiques ne me semble pas avoir été vraiment approfondie.
AAC058-7799
GAUVIN, Florimond, 2011 : SEM MATERIALITE 02, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 21 octobre 2011.
« l’Aire d’interface des Lônes – Révéler / Habiter / Retrouver »
Cette conférence explique la démarche de Florimond GAUVIN pour l’élaboration de son projet urbain pour Rillieux-la-Pape au sein de l’Atelier Matérialité en 2010-2011. Il découpe le travail en quatre actes :
Acte I : il s’agit d’un diagnostic territorial de Rilleux sur les thématiques géographique, géophysique, sociale et économique en regard des éléments du SCOT (Novembre 2010). C’est travail en binôme.
Acte II : Identification de zones à enjeux et choix d’une zone d’intervention (on est là et pourquoi) : Aire d’interface des Lônes (Décembre 2010).
Définition des enjeux (qu’est-ce que l’on fait), du schéma d’aménagement prenant en compte la topographie, le parcellaire et l’hydrographie (fin S7 – Février 2011)
Acte III : Définition du schéma directeur accompagné d’explications (type d’habitat et densité souhaitée). (Mars 2011). Le binôme se split à ce moment-là en ayant choisi les zones d’intervention respectives.
Acte IV : Projet d’habitat « ROC DE LA COSTIERE » composé d’un front bâti en bas de pente contre les lônes, coupé d’interstices et recouvert en partie arrière d’une membrane organique et poreuse, sorte de serre habitable.
La démarche est structurée, du moins en présentation, le graphisme est magnifique, mais la réalité semble, quant à elle, plus erratique. Le projet s’appuie sur une utopie, sans trop la signifier, et propose d’en pousser le raisonnement jusqu’aux limites. Le spectateur est alors plongé dans une ambiance oppressante, par trop de nature et d’humidité. Le projet est-il finalement habitable ?
Avis personnel: le concept de serre arrière au bâtiment plantée de palmiers, vient en contradiction du concept originel : réinvestir les berges et Lônes du Rhône en vivant au plus près de la nature.
AAC058-7800
MARIELLE, Jean-Pierre, 2011 : SEM MATERIALITE 03, conférence, DEM Matéria-lité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 04 novembre 2011.
« Agriculture urbaine : les murs à pêches de Montreuil »
Cette conférence présente une technique de culture ancestrale des fruits et légumes qui fût délaissée avec l’arrivée du train. Il s’agit de murs de 3m. de haut, composées d’un blocage de pierres et d’un enduit de gypse. Ce dispositif orienté nord/sud dans le cas de Montreuil permet d’emmagasiner la chaleur par une exposition maximum au soleil, et d’obtenir de très beaux fruits. Culture urbaine avant l’heure, cette technique composait autrefois des milliers d’hectares autours de Paris. Un territoire délaissé de 40 ha subsiste à Montreuil, laissant apparaître les dernières traces de cette technique.
Le projet de réhabilitation de ce territoire présente des enjeux de différents ordres :-Stratégiques : produire, cueillir, manger et transformer la ville. Légitimité pour Montreuil, lieu d'expérimentation, d’innovation et de transmission (agri-culturel)-Politiques : élus vert contre socialistes sortants-Sociaux : reloger une communauté Tzigane-Programmatiques : un projet de dépôt de tramway et de piscine biologique déjà lancé-Économiques : moyen d’inventer un modèle alternatif de société-Écologiques : continuité avec les parcs voisins, traitement de la pollution par phytoremédiation-Sociologiques : le cheminement doit-il être ouvert à tout le monde et de quel
type ?
Deux points durs :-Le rapport de subordination des services techniques des mairies avec la municipalité (fonctionnement par règles +budget)-Difficulté pour faire adhérer les différents acteurs au projet (associations locales, …)
Pour mener à bien le projet, il est nécessaire de définir des actions court et moyen terme, créer une régie du site, phaser les actions 2012-2015 et mettre en place une démarche de concertation.
Une comparaison peut être faite avec le fonctionnement d’un éco-quartier en termes de diagnostic, de définitions d’enjeux et de cibles, et de gouvernance dans la durée.
Avis personnel: cette présentation illustre bien la difficulté d’implémentation d’un projet en fonction du facteur humain. On est en droit de se poser la question du réalisme de ce projet du point de vue de son fonctionnement, une utopie sociale en quelque sorte. Des enquêtes sociologiques sont nécessaires pour valider l’acceptation d’un tel type d’organisation social.
Ce choix délibéré ne risque-t-il pas de mettre en péril l’idée de base de l’agriculture urbaine ?
AAC058-7801
MASTRORILLI, Antonella, 2011 : SEM MATERIALITE 04, conférence, DEM Maté-rialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 18 novembre 2011.
« Relire l’entre-deux guerres, modernité et tradition »
Cette conférence présente une relecture de l’histoire de l’architecture, le point de vue personnel d’Antonella MASTRORILLI sur ce thème et met en avant la question de la sélection de l’œuvre.
Antonella constate que certain bâtiments visités dans des villes sont absents des livres d’histoire de l’architecture (grandes synthèses) et l’explique par les éléments suivants :
-La littérature architecturale est capable d’influencer l’architecte autant que l’architecture elle-même
-Comprendre les histoires de l’architecture nous permet d’avoir un point de vue sur l’architecture. A titre d’exemple, Le Corbusier a pu faire table rase du passé et devenir un précurseur du mouvement moderne parce qu’il connaissait l’histoire de l’architecture.
-Les critères de choix des bâtiments correspondent avec ceux des auteurs d’une époque donnée.
Ce choix n’est donc pas totalement subjectif, la confrontation durant l’entre-deux guerre entre Modernistes et Traditionnalistes qui aura lieu en Angleterre, Italie, France et Allemagne, en est le parfait exemple.
Le traditionalisme est une vision du monde, non passéiste, qui utilise les dernière techniques et matériaux en
assurant continuité et transmission du savoir. Ce mouvement est absent des livres d’histoire de l’architecture, bien qu’il représente la majorité de la production architecturale de cette période.
Il faut connaître l’histoire pour pouvoir la refuser, avoir un regard critique sur l’architecture et fonder le projet.
Avis personnel: cette conférence pose la question de l’inscription d’une architecture dans son époque, devant être en avance sur la tendance de fond pour entrer dans l’Histoire de l’architecture en regard d’une architecture conçu pour l’homme en accord avec le lieu. Est-ce vraiment incompatible ?
AAC058-7802
PETRI, Agnès, 2011 : SEM MATERIALITE 05, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 25 novembre 2011.
« L’eau, elle-même »
Agnès Petri présente une première partie de son travail d’artiste : « les terrains vagues » : une motte de terre découpée, décollée puis prélevée est photographiée sur ses différentes faces. Une boite en résine transparente est confectionnée, ses lignes s’inspirent du paysage alentour du champ où la motte de terre a été prélevée. Des tirages numériques des photographies sont marouflées à l’intérieur de la boite. Chaque brin d’herbe est ensuite repeint à l’endroit et à l’envers de la boite transparente, apportant en effet saisissant. Une deuxième phase de ce travail consiste à prélever des échantillons de motte de terre à l’aide d’un plantoir et les photographier de façon systématique dans leur état respectif.
L’herbe vue en tant que degré zéro du paysage devient alors le paysage lui-même, une sorte de mise en perspective, par le jeu de disproportion des échelles de l’herbe et du paysage. L’analyse quasi scientifique par prélèvement de petites mottes de terre est pour moi une sorte de mise en scène de la matérialité. La démarche d’Agnès Petri peut être vue comme une analyse du paysage, comme une relecture. Elle utilise les outils de l’analyse : prélèvements systématiques, représentation plan/coupe pour reconstituer le volume et le transect. C’est une démarche de découverte et de reconstruction, que je trouve finalement comparable à notre travail de diagnostic sur la
grande échelle.
La deuxième partie est un travail sur l’eau. La technique utilisée est similaire à la précédente. Le résultat est fascinant. La boite, avec une brillance immaculée, devient une « fraction d’eau » dont le mouvement presque perceptible est figé, par un instantané : le temps est arrêté. On peut aussi bien imaginer l’objet chaud comme froid, dur comme mou. La perception est altérée.
AAC058-7803
TABOURET, Jean, 2012 : SEM MATERIALITE 06, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 06 janvier 2012.
« La matière de l’architecte. Actualisation de l’architecture»
La matérialité pose la question d’une matrice, de tout ce qui est antérieur à une création, des forces latentes dans la création, du passage du virtuel à l’actuel : l’actualisation.
Beaucoup d’éléments de la culture japonaise expriment cette notion, telle que la volonté de ne pas trouver une beauté dans la symétrie, sinon dans l’imperfection (WABISABI), s’illustre dans le bol de la cérémonie du thé qui symbolise le zen, le recueillement et la concentration.
L’idée est de décrire un nouveau paradigme dans notre société d’immédiateté. Les penseurs de notre temps sont subjugués par ce nouveau paradigme et le décrivent. C’est en traitant du latent, de l’indicible et des concepts que l’on pourra les redéfinir. Le signe se manifeste par le concept. Max Weber, un sociologue allemand, décrit la notion de « désenchantement du monde », un monde où tout est démagéifié que l’on peut mettre en regard de la spiritualité qui est le fait d’avoir conscience de ce qui est imperceptible.
On peut approfondir cette idée au travers des notions de répétition, de renaissance et de reconstruction. La base de la pensée Japonaise repose sur les cycles de vie de la nature. Le temple shintoïste d’ISE JINGU est un sanctuaire reconstruit tous les 20 ans, miroir de temples identiques,
l’ancien temple jouxtant le nouveau. Seule persiste SHIN NO MAHASHIRA la niche sacrée, sur laquelle on vient reconstruire le temple. Deux poteaux enfoncés dans le sol restent toujours cachés sous le SHODEN. Cet exemple qui fonde la société japonaise permet de comprendre comment une architecture peut s’appuyer sur ce principe de construction, déconstruction et reconstruction : l’idée de l’impermanence.
Le temple TAKAYUKA à la gloire de la déesse de la récolte, est construit sur ce principe en reprenant le style penché surélevé des greniers à grain. Ici, le poteau incliné n’a aucune fonction.
Le MA est un concept important de la culture japonaise qui définit différentes dimensions :- Le KEN = 1.80m : unité de mesure - Le MA est contenu dans le signe de la porte qui contient lui-même le signe du soleil et originellement le signe de la lune : vision de l’encadrement de la porte sur le monde : interstice / interface.- Le TEA MEA : une pièce est définie en nombre de TATAMIS- Le MA DORI est celui qui saisit l’espace : l’architecte- Le TOCONUMA : l’alcôve, pour marquer le vide- « Prendre du MA » signifie « prendre des pierres », donner la juste distance entre les pierres (instaurer les éléments pour que l’un ne dérange pas l’autre)
AAC058-7804
Le temple KODENSHI est un site vide, une scène sans architecture qui est plus porteur de l’idée du temple que le temple lui-même. De la même manière, on remarque que TOKYO s’est constituée autour d’un centre vide (le palais impérial) très signifiant entouré de demeures nobles, loin de tout ce qui n’était pas désiré dans la ville et l’idée de la vie insignifiante.
L’idée du temps est marquée par différentes représentations :- La reconstruction du temple- La fleur de cerisier est l’acceptation de l’éphémère-La répétition des cycles de la nature est marquée par les festivals
IWASAKA est la dissimulation, la séparation (du sacré et du profane) s’exprime de différentes manières :- Dans les temples par les poteaux obliques- Le TORI : entrée du sanctuaire- EN : espace de transition dans la maison- La cloison japonaise- Les débords de toits imposants des maisons japonaises en raison des intempéries, génèrent des pièces sombres : les japonais en ont fait une vertu et leur goût pour l’ombre et l’obscurité.- SHIN NO MAHASHIRA : la niche sous le SHODEN où se trouve le pilier sacré enterré dans le sol- TAMAGAKI : la clôture
Avis personnel: Le sujet de cette conférence nous renvoie à l’essence du projet comme fil conducteur de
la démarche de conception et de matérialisation du projet architectural : le parti, le concept. L’idée ici est de baser le parti sur le latent et l’indicible en prenant appui sur des exemples de la culture japonaise. Intéressant.Cette approche du projet complète la démarche « archéologique » de diagnostic du projet urbano-architectural.
AAC058-7805
RITZ, Emmanuel, 2012 : SEM MATERIALITE 07, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 13 janvier 2012.
« Commune de La RAVOIRE, opération centre-ville, développement et restructuration d’un quartier sans voiture»
E. Ritz est l’architecte en chef de la ZAC de Valmar. Et nous présente la démarche du projet.
Le projet est ambitieux, il consiste à aménager 20ha sur 15 ans d’urbanisation, soit 1000 logements et 2500 habitants sur une commune de 8000 habitants. Il s’inscrit dans la politique de développement du sillon ronfleur. Les objectifs sont de développer des services publics et commerces (surface 3500 à 4000m²), atteindre un niveau de performance BBC et valoriser des modes doux.La commune de La Ravoire n’a pas de centre clairement identifiable et est constituée essentiellement d’une zone pavillonnaire.
L’exposé illustre dans une première partie un diagnostic historique, géographique, topographique et hydrologique. Un pêle-mêle photographique illustre les usages et coutumes.
Dans une deuxième partie, les limites territoriales sont clairement identifiées. Un plan guide est établi, il définit 4 axes :- Privilégier un shunt- Des liaisons modes doux entre 2 parcs- Des parkings de stationnement espacés d’un rayon de 300 m. (Limite maximum admissible par l’usager)- Une zone de centralité de 100 îlots
Différentes recommandations :- On ne peut pas construire la ville, si on ne structure pas l’espace public.- On structure le plein par le vide.- L’urbanisme consiste à établir des cartographies- L’ossature végétale structure l’espace public- L’espaces public est un sol qui se prolonge (cohérence du sol et du Rdc)
Les différentes cartographies réalisées sont :- Le maillage viaire primaire et secondaire- La nature des sols (enrobé, stabilisé, dallage béton, pelouse, surface privée, ...)- Zone de PPRI (inondation)- Propositions d’usage pour espace public- Stationnements sous-terrain- Environnement lumineux de nuit- Équipements publics et commerces
La Définition des îlots et leur découpage est réalisé. Le cahier des charges par îlot à destination des architectes défini une architecture évocatrice de ce que serait l'îlot et sa typologie.
Une troisième reconstitue le puzzle et explique le schéma directeur : « il faut suivre le fil de l’eau ».
Avis personnel: Cette conférence arrive à point nommé dans le travail de diagnostic et de schéma directeur, comme un exemple concret. PARFAIT.
AAC058-7806
MACHUREY, Pierre-Marie, 2012 : SEM MATERIALITE 08, conférence, DEM Maté-rialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 20 janvier 2012.
« Une rétrospective sur un PFE »
PM MACHUREY explique les différentes étapes qui lui ont permis d’arriver au PFE. Le travail de projet urbain de Master 1 est réalisé en binôme sur Rillieux la Pape. Le binôme se concentre en Master 2 sur un secteur particulier du projet urbain, chacun développant in fine son propre projet. Les deux projets peuvent être complémentaires et interagir.Quelques conseils et recommandations :Dès le master 1, il faut se « sentir architecte » pour parler avec plus conviction et de sensibilité devant le jury.Le binôme doit être complémentaire pour permettre une critique réciproque objective des projets.
La phase préalable de projet urbain au projet architectural semble capitale, car l’on se doit d’adapter le projet à la ville et non l’inverse (histoire, viaire, pittoresque, …). Le projet se mature à l’étude de l’urbain, il répond à une carence de la ville.Les projets consistent en la restructuration d’un centre culturel et d’un supermarché.
Les grandes orientations seront :- un renouvellement des infrastructures culturelles et commerciales- une restructuration d’un front de rue par réorientation des façades sur le boulevard principal (orientation sud)- une réduction de la barrière constituée par le boulevard en lui-
même (réduction du nombre de voies, zone 30 et aménagement paysagé)- un aménagement d’une place entre les deux nouveaux bâtiments- la création d’un parc
Le parti du projet de centre culturel: permettre l’accès à la culture à personnes n’ayant pas eu forcément le corpus minimum au départ pour l’intégrer.
Le travail de définition du programme sera réalisé en collaboration avec la municipalité et sera complété par un échange avec le centre culturel et différentes enquêtes auprès de la population et commerçants.
Le projet intégrera notamment une salle de cinéma et un restaurant dimensionner à l’échelle de la commune (300 places pour 20000 habitants). La question de la réutilisation du bâtiment existant sera posée.
La matérialité s’exprimera à travers le choix de la brique qui symbolise un lien entres différentes époques. De plus, ce matériau nécessite un temps de chantier relativement long autorisant ainsi un délai d’appropriation suffisant pour la population.
Un travail de maquettage du quartier complémentaire à la modélisation 3D permet de mieux appréhender la volumétrie des bâtiments et le dimensionnement d’une place (ratio calculé avec la dimension de la place du Capitol à Toulouse par rapport à la
AAC058-7807
taille de Rillieux).
La maquette finalisée avec des options avant/après permet au jury une compréhension immédiate du projet, en plus de montrer le travail d’épannelage du bâtiment.
Le travail de notice doit se faire tout au long du projet avec le processus suivant : écrire/dessiner – dessiner/écrire sur un cahier unique. La notice sera annotée de citations en rapport avec le propos et d’écrits personnels. Ce travail aide à construire le projet et le propos.En cas de doute, il n’y a que le travail pour trouver la solution.PM. MACHREY conseille de se projeter dans une attitude responsable vis-à-vis de son projet : « …on ne vend plus, on sensibilise, on construit une part d’humanité … »
Concernant l’organisation, PM. MACHUREY recommande de penser au logo du projet et de préparer la présentation orale avec des fiches.
Avis personnel: cette conférence extrêmement pratique montre les différentes étapes de la construction d’un PFE vue de l’intérieur. PM. MACHUREY nous fait ressentir sans détour l’état d’esprit et les doutes qui l’ont accompagné tout au long de cette période. C’est une façon de dédramatiser ce travail.Personnellement, je trouve intéressant la mise en perspective de la continuité pédagogique entre le Master 1 et le Master 2.
Du point de vue architectural, le bâtiment me semble un peu hors d’échelle par rapport au site. Cette impression est certainement due à la conjonction des immenses parois verticales de l’entrée et de la place à l’intérieur au bâtiment, qui évoque une sorte de gueule béante. Les entrées de lumières semble sous dimensionnées, compte tenu de la taille du bâtiment. La matérialité de la brique est, en revanche, bien traitée.Le programme est très ambitieux, une réduction de cette ambition n’aurait-elle pas permis de dimensionner plus justement ce bâtiment ?
AAC058-7808
GRAS, Pierre, 2012 : SEM MATERIALITE 09, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 27 janvier 2012.
« L’eau, la ville, le port – La ville portuaire comme laboratoire de la mondialisation»
Pierre GRAS est journaliste et éditeur, son parcours professionnel la conduit à s’intéresser aux thèmes de l’eau, du fleuve et enfin du port.Il est aussi auteur de récit de voyage urbain (Le temps des ports, ed. Taillandier) qui traite de l’évolution de la ville depuis la 2eme guerre mondiale.
Les restructurations récentes de certain port avec des constructions monumentales (ex. Porto Madeiro – ancien port de Buenos aires) sont de véritables faire-valoir / objets de communication pour les villes.
Image de l’eau :« Les images de l’eau, nous les vivons encore (…) dans leur complexité première en leur donnant souvent notre adhésion irraisonnée. » G. BACHELARD, l’eau et les rêves, 1942.Au début était l’eau : une nature sauvage aux origines d’un monde nouveau dont l’élément aquatique reste déterminant pour l’homme (un élément essentiel de notre patrimoine naturel, une dimension sociale et économique incontournable).L’eau comme loisir / plaisir hier (thermalisme, villes d’eau à l’architecture néoclassique), comme aujourd’hui (thalassothérapie, thermes de Vals de P. Zumthor, piscine des docks au Havre de J. Nouvel, piscine de Matosinhos à Porto de A. Siza)L’eau comme nécessité ici … et ailleurs : un bien commun à mieux partager.L’eau comme danger ailleurs et ici (Tsunami japonais et tempête Xinthia), mieux vaut prévenir que guérir (PPRI)
La ville et l’eau :
Une valeur foncière réaffirmée et vecteur de valeur ajoutée immobilière (Givors, Shanghai, Tanger,…)Une « reconquête » architecturale (opéra de Sydney en 70’, musée MAS en Anvers) et sociale (Paris plage, les guinguettes au bord de Rhône,…), mais avec quelle urbanité ? (plage bondée de Coney Island Beach, New York)Une utopie toujours renouvelée (hier, le ponte veccio, aujourd’hui le projet Odyssée 21pour le port du Havre de J. Nouvel), mais jusqu’à quel point ? (Tours à Dubai)
Le port entre confluences et contradictions : (le port Edouard Herriot à Lyon, le port de NY en 1930 avec les paquebots arrimes au pied des skyscraper avec une échelle verticale et horizontale comparable, les containers du nouveau port de Buenos Aires)
1-Vers l’économie-monde : (Reconversion du port Edouard Herriot) Le monde est devenu à la fois fluide et plus liquide (marchés financiers, 90% des transports de marchandises sont maritimes du fait des délocalisations, …) La globalisation touche en priorité les villes portuaires. La hiérarchie des ports bouleverse la géographie mondiale (NY N°1 en 1950, Rotterdam en 1965, Singapour en 1980, Shanghai en 2010)La conteneurisation est « un choc équivalent à celui du passage de la marine à voile à la navigation à vapeur » (15 M de conteneurs voyagent en permanence aujourd’hui, première traversée transatlantique d’un porte-conteneur en 1966). Les ports quittent les villes à partir des 60’. La question des friches urbaines devient récurrente à partir de 1985.Le conteneur, symptôme de la mondialisation. Les grands armateurs mondiaux font la loi : un
AAC058-7809
seul en France.Une déréglementation du secteurLes conséquences en termes d’emploi sont évidentes : le conteneur divise par dix le temps de déchargement du bateau et réduit considérablement le besoin de main d’œuvre.
2-Le temps des conversions :La reconversion des friches portuaires devient un fait de société (US en 1960, Shanghai en 1990, en Europe aujourd’hui) : il faut « recomposer les villes ». La relation ville/industrie se délite lorsque le port se retire (la seule exception est Dunkerque)La question du développement durable émerge (sommet de Rio en 1992, montée des eaux, le dernier Tsunami au Japon a détruit 10% des équipements portuaires)Les enjeux urbains, patrimoniaux et sociaux sont plus complexes et récurrents. J.Levy défini l’urbanité comme le produit de la densité et de la diversité
3-Un peu de prospective portuaire :Le porte-conteneur rencontre ses limites (délocalisation de productions, coût de l’énergie qui augmente)Les risques environnementaux ne sont plus une prospective improbable. (Scénario catastrophe de type Alexandrie)La tendance sécuritaire de l’administration des ports l’emporte sur la tendance à l’ouverture. (La procédure américaine confère un statut douanier au port E. Herriot et impact fortement l’aménagement urbain)Mais trois tendances « plus optimistes » :- Les coopérations des acteurs des villes portuaires se multiplient.- L’imperium « du développement durable » aussi dans les ports- La redécouverte du potentiel et de l’intérêt du patrimoine portuaire (nouveaux usages
et recherche de cohésion sociale)L’imaginaire produit un certain « effet de levier » (JO de Barcelone)Le « grand public » prend peu à peu conscience des enjeux.L’histoire montre que le déclin des villes n’est pas fatal.
Questionner le futur d’un port à Lyon ?Le port E. Herriot n’a jamais été conçu comme un véritable port :-> Transport des hydrocarbures uniquement-> Zone industrielle en bordure du Rhône-> Une bonne partie des entreprises présentes n’utilisent que la voie d’eau en import, la distribution étant réalisée par transport terrestres !-> Le plus grand port intérieur français-> Le plus gros volume de conteneur en France
Pour réaménager ce port, il faut tenir compte du plan Vigipirate, de la norme SEVESO, de la forte segmentation du territoire. Des atouts, mais aussi des questions :- Un grand paysage ouvert sur le fleuve et sur la ville- La patrimonialisation de certains éléments d’architecture est envisagée- Le modèle industriel du port fonctionne, mais il touche à ses limites (centré sur les hydrocarbures et pas d’usage fluvial)- La proximité du paysage : la vallée de la chimie
Construire une réponse citoyenne, professionnelle et partagée:- Interroger le futur- Imaginer un nouveau modèle portuaire pour Lyon- Miser sur de nouveaux usages à inventer et
AAC058-7810
à négocier (prendre en compte que le port Rambaud, ancienne gare d’eau de la Saône, a finalement disparu) qui restent à écrire avec chacun : « une utopie réaliste ».
Une exposition a eu lieu en Octobre 2012 sur le thème PORTe OUVERTe, organisée par les Robins des Villes avec l’association Des Villes et des Rêves.
Questions :D’où vient ce rejet du fleuve et du port de Lyon ?La maison du Rhône explique que les ports étaient historiquement sur la Saône, car plus calme que le Rhône (construction du port E. Herriot en 1934 et du port Rambaud en 1926). Ces ports permettaient l’arrivée des fleurs et du vin par la Saône. Le Rhône était dangereux et ne sera régulé qu’après-guerre. Le port E. Herriot est un port tardif pour les hydrocarbures. En synthèse, on peut dire que les lyonnais ont un lien historique avec la Saône et une peur du Rhône (inondations) et dans le même temps, ils ont des difficultés à localiser sur une carte le port E. Herriot t la vallée de la chimie.Une idée serait d’installer les services publics du 7eme arrondissement en lisière du port, pour «le rendre visible et accessible ». En effet, il n’y a aujourd’hui qu’un seul restaurant à l’intérieur et il est interdit d’errer dans le port.
N’y a-t-il pas une différence entre port maritime et port fluvial ?Il y a une différence de ligne d’horizon et la marée génère une diversité de paysages.
N’est-on pas au début d’un cycle, comme l’était la question des espaces verts dans les années 80’ ?
Oui, on commence par le plan bleu. Il faut noter que les aménagements des quais du Rhône n’auraient pu se faire sans l’aménagement préalable du parc de la Feyssine et la construction de la cité internationale.Le projet paysagé pour Confluence de Devignes est un peu daté, la construction d’une darse ludique à la place d’une ancienne gare d’eau est un raccourci facile et le rapport aux Balmes de St Foy n’est pas à la bonne échelle.
Avis personnel :Je trouve que cette conférence offre un magnifique préambule à un travail de projet urbano-architectural, bien que la question de la stratégie administrative du port soit très prégnante (réglementation douanière, accès limité par de vigiles, activité pétrolière mono centrée). Elle élargie encore le champ d’investigation du diagnostic et éclaire le recentrage sur le port E. Herriot.
AAC058-7811
MARIELLE, Jean-Pierre, 2012 : SEM MATERIALITE 11, conférence, DEM Matéria-lité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 17 février 2012.
« Site papeteries – Cran Gevrier «
Cette conférence présente un exemple de mission de JP Marielle à Cran Gevrier, près d’Annecy.Cran Gevrier présente une topographie marquée avec 40m de dénivelé entre Cran Gevrier le haut et Cran le bas. Une coupure par les réseaux le long de la rivière, le Thiou, divise la commune en deux. Le site d’une ancienne papèterie s’étend le long du Thiou, en plein cœur de la commune.Cran Gevrier rassemble l’ensemble des typologies architecturales depuis l’après-guerre :-De l’auto construction des années 50’-Des grands ensembles 60’-Une citée jardin-Du pavillonnaire sur parcelle de 400m²-Du pavillonnaire diffus
La mission de JPM consiste en la réactualisation du PLU, accompagné d’un travail de stratégie urbaine avec un approche environnementale de l’urbanisme (AEU). Dans ce cadre, JPM contre, avec l’aide de la mairie, la réalisation d’une opération immobilière classique sur le site des papèteries, pour en faire une opération partenariale entre un promoteur privé et la commune : l’éco-quartier des passerelles. Ce point souligne l’importance du choix stratégique pour le devenir de la commune.
Une AEU est réalisée afin de déterminer les enjeux avec notamment :-un diagnostic des bâtiments existants permettant de justifier la réhabilitation
ou la destruction-un repérage des parcours et distances entre les grands équipements, prenant en compte le dénivelé : -> un projet d’habitat dense sur le site des papèteries ne nécessitera pas la construction d’un groupe scolaire supplémentaire. Des raccourcis piétons montrent que tout est à portée.-Un repérage des lignes de bus et projet de tramway + établissement des cheminements mode doux exclusifs avec rampes pour franchir le dénivelé.-Une perception du site par des photos repérées sur un plan de situation démontrent la nécessité de détruire un bâtiment en entrée de ville, pour faire ressortir la limite ville/suburbain, et font redécouvrir aux élus les qualités visuelles du paysage montagneux environnant.-Une analyse en plan masse et en coupe des niveaux des terrasses existantes.-La production de bruit de la voie ferrée représenté en coupe.-Le contexte géologique impose des fondations profondes-La gestion de l’eau : .Eaux pluviales .Eaux usées industrielles .Eaux usées domestiques ->Le parti pris sera un quartier sans voiture, nécessitant un très faible niveau de filtrage-Le contexte faunistique et floristique-L’analyse des données bioclimatiques: exposition au vent du nord dominant ->Le bâti doit préserver des vents dominants-Une simulation en 3D des ombres
AAC058-7812
portées sur le site (masque par les immeubles de grande hauteur)-Les enjeux paysagés : un parc et un parc urbain : le Thiou dans le projet urbain. Aménagement des espaces publics par la collectivité, avec l’objectif de relier le haut et le bas.-Maîtriser la place de la voiture avec des parkings en sous-sol, au bénéfice des espaces piétonnier.-Le réseau de chaleur et le traitement des déchets.
Les orientations du projet :-Les grandes halles comme une opportunité d’une place urbaine sur l’e devant de celles-ci-L’entrée de ville comme une avenue en balcon sur le paysage-Cos de 2.4 soit 54000m²-Établissement d’un premier schéma directeur accompagné de quelques indications constructives ->Le schéma directeur est zoomé par rapport à l’échelle de notre propre travail de projet urbain ->Le travail architectural est similaire à ce que l’on doit produire pour le « oneshot »-Un plan masse Illustrator + photo-Coupes +végétation avec élévation de Cran Gevrier en arrière-plan-Plan masse des vues-Plan de circulation indiquant les poches de parking et la disposition du bâti (qui s’oppose aux vents) -Modélisation 3D type « morceaux de sucre » présentant : .les cheminements piétons (pentes handicapés à 4% !) .le statut des espaces (publics / privés)
.les plates-formes supportant le bâti et ménageant des coursives horizontales d’accès aux plots .le jardin central .le bâti en barrette formant plot en décalé mettant en valeur la vision sur le lointain (les montagnes), les terrasses vers le sud en surélévation car la pente est orientée nord.Les vues 3D sont accompagnées d’images de références architecturales-l’étude d’ensoleillement en 3D-Plan masse Illustrator
Avis personnel :Cette conférence illustre et synthétise notre démarche dans le cadre de l’atelier de projet urbano-architectural.Je suis particulièrement intéressé par ce cas réel de projet d’habitat dans la pente, mon sujet d’étude, en tenant compte du dénivelé beaucoup plus prononcé de mon propre site.Cette conférence mériterait d’être donnée en début du premier semestre pour cerner plus tôt l’objectif de l’année.
AAC058-7813
BOYADJIAN, C., 2012 : SEM MATERIALITE 12, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 03 mars 2012.
« Métropoles fluviales, Ranstad, Pays Bas »
Objectif de la conférence :Une présentation de l’historique de la delta métropole de Hollande : la Ranstad.Une présentation d’un concours d’urbanisme de la Ranstad, il y a quelques années.Regarder comment un dessin d’architecte participe à la caractérisation du projet de chaque métropole.
Historique :Les fleuves ont marqués la forme urbaine des grandes métropoles européennes (Rhin-Ruhr : 10 M d’habitants, Rhin-Main : 3 M d’hab., Ranstad : 4M ; d’hab.). Les moyens de transports européens, par leurs propres temps de transport, déforment les distances sur une carte. La Hollande n’est pas un pays, mais plutôt une constellation de provinces. Ce sont les relations tendues entre les villes hollandaises qui vont développer le territoire et constituer un véritable réseau de ville circulaire, avec : Amsterdam, Almere, Utrecht, Rotterdam, La Haye, Leyde, Haarlem.La constitution de ce réseau s’explique par différents points :-Le mythe culturel Batave qui uni les villes à partir du 3eme siècle-L’adhésion de cette partie de la Hollande à l’église réformée-Le « Big Four » qui rassemble ces villes de taille moyenne (1 M hab), mais de très forte densitéIl n’y a pas un paysage spécifique
à chaque ville, on habite « communément ».Du point de vue géologique, 25% du territoire est recouvert d’eau, la plus grande partie du sol se situe en dessous du niveau de la mer, avec une portance de terrain très faible due au delta du Rhin et de la Meuse. Les hollandais en ont fait un atout d’ingénierie dès le XVI eme siècle.1670 : construction des premiers canaux pour assécher les terres et urbaniser les premiers polders en Cardo Decumanus. Les différentes couches d’urbanisation du territoire suivront cette trame. On note au passage le plan orthogonal de New York imaginé par des ingénieurs hollandais.La ligne d’eau hollandaise sert de ligne de défense (cf. La grammaire de Clemens Steenbergen) : on immerge les alentours de la ville pour la rendre imprenable. Ce concept de défense agricole sera optimisé dès les XVII et XVIII eme siècles. Le premier port sur la Meuse sera édifié par Napoléon pour prendre une ville.1931 : construction de digues et d’écluses pour gagner sur la mer dans le delta du Rhin de Rotterdam à Anvers, tout en conservant le centre du cercle des villes en réseaux intact.1902-1917 : Plan d’aménagement du sud d’Amsterdam de Berage qui pose ce concept spatial à l’inverse du courant de pensée de l’époque : penser l’extension des villes en termes de vides et de pleins, car le sol durement « acquis » sur l’eau est précieux pour l’agriculture (trésor agricole commun par la construction des cannaux). Les
AAC058-7814
ilôts de bord de ville seront alors très concentrés.1926 : Plan de Rotterdam de Witteven : du concept spatial à l’inscription régionale intégrant la notion de paysage.1924 : Carte de Théo Van Loohuizen définie le « C » des principales hollandaise, apparition du concept de Ranstad pour donner une limite à l’extension des villes : le cœur vert de la Hollande devient inconstructible, une distance de 4km ( 1 heure à pied) maximum sépare chaque ville, permettant à quiconque à l’époque de travailler d’une ville à l’autre.1929 : le « C » n’est pas vide en réalité. Instauration d’une politique de limitation de l’extension des villages du cœur vert.1935-39 : de l’îlot à la barre : plan d’extension1966 : un rapport mentionne un développement asymétrique des villes1984-2004 : évolution vers l’agriculture intensive. Les réseaux modernes ont niés les canaux orthogonaux par une implantation anarchiqueUne étude synthétise les différents réseaux,, digues, chemins de fer, canaux, étangs et bâtiments et montre que l’évolution contemporaine tend à transformer l’idéal de ville sans banlieue en une succession de banlieue sans centre.2000-2004 : Nomination d’un architecte en chef de l’état : Jo Coenen (musée d’architecture d’Amsterdam). Il met en place une idée de l’architecture nationale synthétisée en 10 points dont l’autoroute A12, le renaturation des zones agricoles et la définition de
la delta métropole en 2 scénarii.-scénario 1 : densification autours du cercle intérieur et création d’un train à sustentation magnétique parallèle à l’autoroute pour desservir les différentes villes.-scénario 2 : densification autours du cercle extérieur (Ranstad)Sa tactique sera de faire trancher la question par des experts extérieurs (L. SNOZZI, H.CIRANI, …) pour légitimer la décision. SNOZZI arrivera directement avec un projet dans le but de faire organiser un véritable concours d’architecture et d’y participer. Le concours antérieur de 10 ans au Grand Paris sera constitué de L. SNOZZI, HM+S Dirk SIMONS (paysagiste), OMA Rem KOOLHAAS, Teun KOOLHAAS (cousin de KOOLHAAS, Urban Design planning)
Synthèse des projets :HM+S propose une revitalisation du cœur vert avec la trame des canaux par désalinisation et reconstitution des bocages.T. KOOLHAAS propose une forme urbaine spécifique à chaque ville (arcs de cercles pour La Haye, plan orthonormé pour Rotterdam, …)R. KOOLHAAS compare les densités de L.A. (2500 hab/km²), Amsterdam (2000 hab/km²) et Manhattan (22000 hab/km²). L’aéroport de Schiphol est situé au centre du cœur vert depuis l’après-guerre. Il propose de créer un aéroport offshore à croissance illimitée et de densifier le vide constitué par l’arrêt de Schiphol à 22000 hab/km², ce qui permet d’absorber l’accroissement de population pendant 25 ans. Enfin,
AAC058-7815
il propose un projet de ville « trame » de Rotterdam à La Haye à la place de l’autoroute A13 !L. SNOZZI propose de rendre visible la perfection du plan orthogonal des canaux vue d’avion, en créant un cercle parfait reliant les 11 villes par un train à sustentation magnétique. Il compare ce cercle parfait à un cadran d’horloge, propose de créer la 12eme ville manquante et d’interdire la construction à l’intérieur du cercle. Enfin chacune des 12 stations de train est érigée sous forme d’un signal de 15 m. de haut, pour qu’elles puissent être vues, à l’instar des clochers d’église, depuis n’importe quel point.
Comment utiliser ces propositions pour les appliquer au réel ?Réunir le consensus des points les plus forts de chaque projets, car les spécialités de chaque intervenant ont été judicieusement sélectionnées au préalable :-Renaturation du cœur vert-Autonomie d’Amsterdam-Lien La Haye / Amsterdam-Renouvellement du littoral-Le cercle de SNOZZI comme limite inconstructible
Remarques :Les projets semblent en distance dans leur rapport à l’eau.Le projet de L. SNOZZI reprend le dessin d’A. PERRET pour Paris en réaction au plan VOISIN de LE CORBUSIER.Ranstad est une manière de comprendre comment se construit le paysage, car toutes les couches sont
visibles et lisibles facilement, rein est innocent. L’intérêt est de dégager une vision synthétique malgré la très grande échelle.
Avis personnel :C’est un cas d’école remarquable pour aborder et comprendre la grande échelle, mais qui me semble très rigide et monotone en regard de l’histoire des villes françaises. Je suis curieux de faire l’expérience du lieu en réel pour vérifier ou infirmer cette impression.
AAC058-7816
CHAVARDES, Benjamin, 2012 : SEM MATERIALITE 13, conférence, DEM Matéria-lité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 09 mars 2012.
«Paolo PORTOGHESI, de la recherche à la matérialisation»
Benjamin CHARVARDES est diplômé de Montpellier et a travaillé en temps qu’étudiant dans l’atelier de PORTOGHESI à Rome, sur le travail du quel il prépare actuellement une thèse.
Objectif de la conférence : appréhender le processus de recherche de PORTOGHESI.
Contexte :A l’ occasion du concile Vatican II (1969 -1972), Jean XXIII puis Paul XI imposeront de revoir totalement la liturgie. Les églises construites après cette période devront en intégrer les principes et notamment de renforcer la participation des fidèles à la liturgie en les plaçant au centre de l’édifice.Cette période sera marquée de plus par la mort des fondateurs du modernisme (LE CORBUSIER, Mies VD ROHE, W. GROPIUS), la nouvelle génération d’architecte (POROGHESI, SAMONA et QUARONI) sera surnommée la « génération de l’incertitude ».1966 sera marquée par la grande inondation de Florence au cours de laquelle de nombreux livres rares seront détruits.
Paolo PORTOGHESI (né en 1931)Il dirigera la première biennale d’architecture de Venise en 1980.Il publie de nombreux livres et articles
depuis 1956, dont le dictionnaire et encyclopédie d’architecture et d’urbanisme, et dirige plusieurs revues d’architecture (Eupalino, Materia, .... Il sera le recteur de la Polytechnico de Milan à partir en 1968. Il est plus connu, en France, pour sa théorisation de l’architecture que pour ses réalisations :
Immeuble de logement à Berlin
Grande mosquée de Rome
Grande mosquée de Strasbourg
BORROMINI comme maître :PORTOGHESI voue une véritable passion pour BORROMINI, jusqu’à s’identifier à lui dans un autoportrait.Il théorise le post-modernisme en Europe.
AAC058-7817
Construction de la casa BALDI (1959) :
Il s’inspire des formes courbes du Tibre, utilise le tuf et une disposition en strates pour symboliser l’histoire de ROME. Il reprend le principe d’A. PERRET : « l’architecture est ce qui fait de belles ruines » et celui du « plan ouvert » de FL. WRIGHT pour faire entrer l’extérieur à l’intérieur : le mur n’est plus une clôture, mais un plan ouvert. Il s’inspire des angles ouverts de BORROMINI :
Dans une maison en 1964 : Le plan est organisé en séries de cercles concentriques dont les centres restent à l’extérieur du bâtiment : c’est l’extérieur qui construit l’espace. L’espace est aussi déterminé par le parcours humain. Le plan reprend les trois moments de l’HABITER : le séjour, le moment du repas et le moment du repos, qui sera le seul espace composé de murs droits.
Dans la maison Bevilacqua (1964),il fera référence à lalanterne de la Sapiensade BORROMINI,à MICHELANGELOet Bernardo VITTONE :
Chiesa de la sacra familia :Pour concevoir l’édifice,PORTOGHESI reprend leprincipe de recherchebasé sur des cerclesconcentriques.Il fera référence à la foisau plan de la Sapiensaet à l’église des quatrefontaines de BORROMINI :
Il fait un constat selon lequel le corps humain peut être symbolisé par un cylindre de base elliptique et devient générateur d’un champ, en parallèle à la théorie des champs magnétiques et à la théorie de l’espace comme système de lieu de Ch. NORBERG-SCHULTZ. Ce constat vient appuyer son principe de recherche sur l’espace à partir de cercles concentriques.L’architecture peut alors être vue
AAC058-7818
comme une figure de langage :-La métaphore : trois grands arbres forment la voûte de l’église :-L’opposition convexe / concave-Le parallèle entre la couverture en gradin de l’église (assemblée de fidèle) et les gradins de l’amphithéâtre romain (assemblée de spectateur)-La reprise de la lanterne et la modénature des corniches de BORROMINI avec l’application du « sfumato » de DA VINCI à l’architecture en jouant sur des dégradés de lumière.-La continuité d’espace intérieur / extérieur, entre paroi verticale et horizontale-La reprise des angles ouverts
Questions :-L’influence de Bruno ZEVI sur PORTOGHESI ? B. ZEVI, théorise l’architecture organiquePlus que la transition et la gestion de l’épaisseur, l'influence sera forte du point de vue de l’abstraction. L’autre influence importante sera elle de FL. WRIGHT avec le plan ouvert.Leur scission aura lieu en 1967 après une exposition sur BORROMINI.
-Le rapport au corps ?En rupture avec le mouvement moderne, durant cette période troublée, il cherche un retour aux sources. Il reprend le modulor et le travail de P. VIRILLO et Cl. PARENT avec le plan incliné comme remise en cause du corps, qui est plus avant-gardiste.
-La justification des ondes ?Une vraie modernité formelle avec le travail sur la lumière.
-Le concept est intéressant mais qu’en est-
il de la qualité d’espace intérieur ?Il ne s’agit pas seulement d’extrusion du plan, il y a un vrai travail de raccord des plans (horizontale/Verticale)La perception de la qualité d’espace reste tout à fait personnelle.
-Intérêt de cette démarche ?Utiliser ses propres références dans la construction géométrique et non au niveau pictural.
-Un conseil ?Lire ALBERTI pour les points de contact et de rayonnement, ainsi que DESCARTES.
-Qu’est-ce que le post-modernisme ?Un mouvement en contradiction avec le mouvement moderne (dogmatique) à partir des années 60’, qui se veut éclectique.
-Que retenir de cette conférence ?Une démarche où quelqu’un prend une culture, au-delà de son point de vue personnel, et la réinterprète.
Avis personnel :La démarche de travail des cercles concentrique est extrêmement riche car centrée sur l’homme et l’usage. Je suis en revanche moins convaincu par la prise en compte du contexte.La ré-interprétation des références est essentielle et nécessite l’acquisition d’un corpus minimum.
PORTOGHESI Paolo, 1981: Au-delà de l’architecture moderne, Éditions L'Équerre.
AAC058-7819
PERRREAU, Grégory, 2012 : SEM MATERIALITE 14, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 16 mars 2012.
« Métropoles Parisiennes : gouvernances & politique du logement »
Gregory PERREAU est architecte de formation, diplômé de La Villette. Il travail auprès de l’adjoint au logement à la mairie de Paris et est responsable du montage et de la planification des différentes opérations de logement sociaux.
Dynamique de la mairie de Paris :La ville de Paris est en retard en regard de la loi SRU avec un rythme de construction de 13% de logement sociaux par an pour 2011, l’objectif étant de 20% en 2020. Paris est une ville de passage, cette question est donc d’importance.
Sous la première mandature de Pierre DELANOË (2001-2008) seront subventionnés les financements de 30000 logements sociaux. L’objectif de la deuxième mandature (2008-2014) est d’atteindre un subventionnement de 40000 avec un rythme de 6000 à 7000 /an. On note néanmoins que plus l’on produit de logements, plus l’on crée de la demande et donc de la frustration (90000 demandes en 2008 et 120000 en 2010, provenant majoritairement de personnes de banlieue).
L’objectif est d’élargir la réflexion au-delà de la ville de Paris par la mise en place « d’une conférence métropolitaine » portant la discussion à l’échelle de l’Ile de France (300 communes et 5.5 Mo. d’habitants).
La volonté est aussi de changer la perception de Paris, la plus grosse municipalité de France.Certaines communes étant satisfaites de ne pas avoir de logements sociaux, le sujet est à haut risque. Plutôt que d’aborder le sujet frontalement, la réflexion a porté, par un acte politique important, sur moyen de trouver du foncier et de financer du logement à un prix accessible, en créant un effet fédérateur face aux lobbies des propriétaires fonciers (hôpitaux, Institutions, …).
Paris Métropole compte 200 collectivités adhérentes de toutes sensibilités politiques, sous la forme d’un syndicat mixte (commande d’étude et institutionnalisation). Les différentes réflexions envisagées portent sur les thèmes suivants :-Le logement étudiant : une production risquée, mais une population qui ne génère pas de besoins supplémentaires en équipements publics. Etablissement d’une carte des projets à proximité des campus en évitant l’effet d’aspiration vers Paris (3000 logements étudiant produits en 2008) : le premier effet de la métropolisation du logement.-Le logement précaire : Paris représente les 2/3 de la capacité d’accueil de la métropole pour 2% de la surface du territoire. Projet mis en sommeil !-Le traitement du logement insalubre : éradication de 1000 immeubles insalubres sur Paris après les incendies de 2005. Cet enjeu existe en banlieue (Aubervilliers et St Denis). Il se produit l’effet inverse du logement social
AAC058-7820
avec un renvoi du problème sur les communes limitrophes ; les marchands de biens profitant du système pour imposer des loyers élevés à des personnes en situation irrégulières. Quand on s’attaque au problème à Paris (20000 personnes relogées), l’on fait fuir les marchands de biens de l’autre côté du périphérique. Des débats dans la cadre de Paris Métropole ont permis de mettre en place des outils opérationnels préservant des clashes politiques. La SORECAM est une SPLA dont le capital est détenu par les villes de Paris, Aubervilliers et St Denis.
Il y a eu en parallèle de ce travail une évolution législative à l’occasion du Grand Paris. Après une période d’observation respective entre Grand Paris (le gouvernement) et Paris Métropole (les municipalités), un motus vivendi a été mis en place, avec 70000 logements prévus par le Grand Paris et 60000 par Paris Métropole, pour une production réelle de 37000 par an en Ile France (50000 logements par an dans les années 80’). Cette baisse s’explique par l’effet d’augmentation du prix du foncier à partir de 2000 et par une baisse constante du subventionnement du financement (600M€ en 2010 pour 500M€ en 2011, soit 20% du budget national).
Le plan local d’habitation (PLH) n’existe pas officiellement dans les textes à cette échelle, il a été mis en place avec Paris Métropole. C’est un espace de discussion ouvert qui permet de démocratiser le débat et de rendre
visible les chiffres réels de production de logement. Le premier axe du PLH est de confronter et compiler les différents PLH des communes. Construction d’une communauté de destin avec des élus de tout bord politique, sans se braquer sur les divergences. C’est le premier des outils de gouvernance qui ne passe pas par la voie législative et réglementaire.
Paris Métropole s’est dotée d’une présidence tournante pour éviter les débats politique et la « toute-puissance parisienne » créatrice d’un sentiment de suspicion. En effet, avant la mise en place de cette gouvernance, la ville de Paris relogeait ses populations précaires en banlieue.
Exemples de projets d’aménagement métropolitains :-Réaménagement du doc de St Ouen (110 Ha) :10 Ha sont la propriété de la ville de Paris (usine d’incinération principalement). L’objectif a été d’instaurer un dialogue entre Paris et St Ouen inexistant jusqu’alors, et de permettre un échange de bons procédés. Paris vend son terrain à prix bas permettant à St Ouen de négocier d’autres terrains avec la SNCF par ex. En échange, Paris construit des logements sociaux dans cette ZAC et récupère de droits au logement pour ses propres demandeurs. Le projet constitue 4000 logements dont 20% sociaux, ce qui représente 1000 usagers en 2020. Cette ZAC est équivalente à celle de Clichy – Batignolles en plein Paris.
AAC058-7821
-Programme de primo-accédant à St Denis :Paris possède des terrains à St Denis, mise en place de la même démarche
Ce sont des projets précurseurs dans un mouvement historique dans une situation de clivages forts (unique en Europe) entre Paris et sa banlieue.Les chiffres 2012 montrent une réelle inflexion avec 17.83 % de logements sociaux livrés sur la ville de Paris, (50% de logements sociaux dans le total de logement construits, avec une diversification du type (niveau de gamme) de logements sociaux pour éviter les phénomènes de concentration). Le temps de réalisation des logements sociaux est de 5 ans en moyenne.
Avis personnel :Cette conférence est une description très intéressante du processus de gouvernance, vu de l’intérieur.C’est une vision stratégique d’un homme d’appareil de la question du logement, avec un discours mesuré, très proche du politique. Le bras de levier et les moyens d’action de G. PERREAU n’en restent pas moins colossaux du point de vue sociétal, même s’il ne produit personnellement rien du point de vue architectural. C’est une vraie question sur sa propre source de satisfaction.Le processus mis en place est extrêmement habile et pertinent. Il semble efficace quantitativement.J’aurai aimé voir des visuels pour se faire une idée du qualitatif.
J’aurai aussi aimé voir le résultat de ce processus (avant/après) du point de vue géographique, sur une carte de Paris et la grande couronne, pour vérifier la déconcentration de la production de logements sociaux en banlieue Est et Nord, point sur lequel je reste sceptique.
AAC058-7822
« Ontologie de l’architecte de campagne star »
Gilles DESEVEDAVY est l’ancien associé de de François ROCHE et enseignant à l’ENSAL (L2, M1, M2 en FI, Double Cursus et HMONP).
Après une exposition des contenus pédagogiques des cursus précités, G. DESEVEDAVY défend la cohérence de la posture architecturale du futur diplômé en architecture et plus précisément au stade de la HMONP «on ne peut pas faire une architecture totalitaire, à la Corbu, dans une démocratie ».
Il compare le courant d’uniformisation de la pensée architecturale ambiante matérialisé par « les cubes oranges en bord de Seine » à une forme de « shoa intellectuelle».Il propose un minimum de recul « La technique ne sauve pas de la barbarie, l’art non plus, on ne réalise pas tout ce qui est possible de réaliser ». De même, il explique qu’avec l’ordinateur, la courbe devient possible, et refuse la phrase « je le fais parce que c’est possible », car ce serait le retour à la barbarie. Pour lui, les courbes, les bulbes, la végétation partout, la gentillesse et les bons sentiments mènent à la « shoa » et explique « pour qu’il y ait la lumière, il faut qu’il y ait l’ombre, il faut des lieux de détestation, … ».
Il se demande pourquoi certains étudiants issus du cursus FPC entrant en HMONP s’excusent et prend l’exemple d’une étudiante, exerçant en province, dont l’ambition est simplement d’être respectée par son boulanger. Pour lui, l’important est la sincérité du travail et la cohérence de la posture. Si l’on fait bien son rôle sa mission
sociale d’architecte, on a une chance d’être un jour reconnu. Il faut développer sa propre « religion », son syncrétisme.En HMONP, on doit convaincre nos pairs que l’on s’ouvre sur quelque chose, que l’on est au début d’un processus.
II n’y a donc pour lui pas de différence entre cette étudiante et un PRTIZKER et explique tour à tour les parcours de LACATON & VASSAL, F. GEHRY et P. ZUMTHOR qui n’ont pas cherché la célébrité et la reconnaissance en suivant la tendance architecturale ambiante. Ils ont fait leur travail avec sincérité. Aucun architecte « respecté » ne fonde sa production sans la confronter à un regard critique sur la théorie. Les grands architectes ont leur propre cohérence, leur priorité étant de faire leur propre architecture et non d’être reconnu.
Il défend en conclusion, la nécessité à la fois d’une accumulation de savoir sur l’histoire de l’architecture et d’une bienveillance sur le territoire.
Avis personnel : au-delà de la forme provocatrice du discours qui peut être fini par lasser ( ?), mais parfaite pour une heure de conférence et remarquablement administrée de surcroît, cette posture vis-à-vis du métier d’architecte me convient tout à fait. Il est intéressant de remarquer que le ton durant l’échange en fin de conférence était beaucoup plus serein et à l’écoute.
DESEVEDAVY, Gilles, 2012 : SEM MATERIALITE 15, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 30 mars 2012.
AAC058-7823
DE BUSSIERRE, Arnaud, 2012 : SEM MATERIALITE 16, conférence, DEM Matéria-lité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 27 avril 2012.
« Matière & Forme »
Dans cette conférence, Arnaud de BUSSIERE fait état du contenu d’un cours atelier qu’il dispense à l’EPFL de Lausanne : « Skyscrapers, faut-il encore y croire ? ».L’univers de la construction des tours est accaparé majoritairement par les ingénieurs (ARUP et SOM) et d’autre part, la production architecturale se cantonne à des tours « objets ».
Première histoire : la production des toursL’objectif N°1 de l’histoire de la production de tous est de faire de la ville. La première ville où seront édifiées des tours est Chicago, la deuxième est New York. Du point de vue architectural, l’école de Chicago sera prépondérante, venant édifier jusqu’à N.Y., l’importance de cette école est due à la forte immigration à Chicago depuis l’Europe au début du XXeme siècle.
L’engouement pour les tours s’explique plus encore par l’importance du contexte foncier que par l’invention de l’ascenseur. A Chicago, une loi impose de respecter le foncier des maisons environnantes, l’îlotage étant défini, les tours définissent la ville et viennent au raz de la rue. A New York, une loi impose d’avoir une écriture urbaine sur les sept premiers niveaux pour les tours. Beaucoup de tours ne seront pas terminées du fait de la crise de 1929, on reprend aujourd’hui la construction sur des tours existantes.Exemple de la « Hearth tower » à New York de N. Foster avec deux systèmes de fondation différents, le pied de la tour devenant un hall :
New York et Hong Kong seront les principaux foyers de construction tours.
Une autre histoire :Dans le cas de Sydney et Melbourne, on a demandé aux architectes de réfléchir au plan d’urbanisme.D’autre part, dans le cas des tours « objet », le pied de tour « chasse » la ville. Des exemples comme la tour Agbar de J. Nouvel à Barcelone, d’autre à Shangai et Dubai comme des émergences « du fond de la terre » illustrent bien ce phénomène. La réflexion architecturale porte sur la forme, mais rarement sur le contenu.La réflexion de l’école de Los Angeles porte sur « comment occuper l’îlot ». Des tours sont de véritables sujets de science-fiction, où elles seront liaisonner entre-elles en hauteur.Les tours construites actuellement sont retard en regard des différentes théories structurelles telles que :-la pixellisation : pixellised tower, Seoul, MRDV
-Le tressage où les deviennent nervurés et non plus en poutrelles / hourdis.L’évolution structurelle passe du « noyau béton + structure acier externe », puis à une « réduction du noyau », c’est le cas
AAC058-7824
des Twin Tower, et aujourd’hui à une « structure externe + noyau périphérique » : Exemple d’aplication de la théorie des systèmes Voronio où les noyaux de structure sont liaisonnés entre eux (projet – écoles) :
En conclusion, les tours sont en train de changer d’optiques.
Utopies et réalités :Des tours qui se justifient par des gadgets comme le fait de produire sa propre énergie. Il faudrait une tour dont le volume serait entièrement dédié à la production d’énergie, ce qui la rendrait inhabitable.De tours en pleine nature.
Rappel sur le mythe de la tour de Babel :Nemrod récupère les naufragés de l’arche de Noé et entreprend avec eux la construction de la tour de Babel dont le sommet en censé toucher le ciel. Ils perdent peu à peu leur langage commun, ce qui empêche l’achèvement de la construction.
Cette superstition historique pose la
question de l’usage du haut d’une tour. Deux courants de pensée s’affronteront sur ce sujet : les Irlandais catholiques y verront un lieu de recueillement à la gloire du catholicisme, pour les protestants, ce sera un temple.Cette référence biblique est renforcée par l’incendie de Chicago de 1871, l’école de Chicago sera fortement influencée par ce phénomène.Ces deux tendances sont nettement visibles sur le haut des gratte-ciels de Chicago :
Le plan directeur de San Francisco imaginé par l’école de Chicago décrit une ville haute. Il sera remis en cause à la fois par l’incendie de la ville et par la superstition : la ville sera finalement basse.
L’école de Chicago :Suite à l’incendie de 1871, un plan directeur est établit et les promoteurs rachètent non pas des îlots, mais les empreintes des bâtiments existants. Un concours d’idées de systèmes constructifs capable de résister au feu est lancé pour des ingénieurs. Le Baron JENNEY puis SULLIVAN inventerons un système de structure acier ignifugée avec une façade en pierre ou terre cuite. La façade en pierre est posée sur chaque niveau.Ce système permet une protection au feu extérieure et intérieure.
AAC058-7825
Daniel BURNHAM imaginera les plans directeurs de Chicago et San Francisco.La règle d’urbanisme en vigueur à l’école de Chicago divisera la tour en trois parties : le socle, la partie centrale et le haut (sculpture). La agences d’architecture seront organisées en conséquences avec des sculpteurs, qui s’inspireront tant de la cathédrale de Rouen que des temples protestants. On trouve à N.Y. la réplique complète du chapiteau de la cathédrale sur certain gratte-ciels.La tour fera successivement référence à l’art gothique, puis à l’art nouveau, puis à l’art déco. Après 1930, elle s’affranchira définitivement de la religion et de la peur de monter en hauteur.
La contre école : l’école de la patrie : (en attendant la 2eme école de Chicago avec Gropius et Mies van des Rohe)Louis SULLIVAN et son élève F.L. WRIGHT ne chercheront plus la grande hauteur, mais l’architecture de l’espace. Les façades seront rapportées en parement et suspendues à chaque niveau avec une conception poteau/poutre.
Avis personnel :Cet éclairage autours des croyances et mythes de la grande hauteur est particulièrement intéressant pour un européen et permet de mieux comprendre
l’architecture américaine, sachant que la question de la grande hauteur est plus que jamais d’actualité en regard des enjeux de développement durables.
PICON-LEFEBVRE Antoine, Architecture numérique
AAC058-7826
«La mosquée occidentale : recherche d’une altérité typologique»
Benjamin CHAVARDES Paolo PORTOGHESIpasse un PFE en 2007lié au travail de PaoloPORTOGHESI sur lesmosquées de Rome etStrasbourg
Un candidat à l’élection présidentielle de 2007 avait abordé la question du financement d’une mosquée et plus largement relancé le débat sur l’Islam en France : un sujet éminemment délicat. Ce fut l’occasion pour B. CHAVARDES d’explorer le thème de la mosquée occidentale. Le travail de diplôme est pour lui avant tout un travail de recherche et de compréhension, non une simple reproduction du travail d’autrui. Ce doit être l’occasion de réinterroger le programme architectural.
Le thème de la mosquée occidentale soulève deux questionnements majeurs :-Comment composer une mosquée ?-Comment une mosquée connecter à la ville ?
Comment composer une mosquée ?La mosquée est un lieu où l’on se prosterne devant dieu.
Dans la religion musulmane, lorsque vient l’heure de la prière, le fidèle prie là où il se trouve. Cela signifie que la terre est une mosquée.Le prophète Muhammad émigre à Médine en 622, l’an 1 du calendrier musulman, et construit la première mosquée. L’édifice carré de cinquante mètre de côté comportait déjà un patio soutenu par des troncs de palmier. On note l’orientation vers Jérusalem et l’absence de minaret. L’orientation vers la Mecque et le minaret viendront ultérieurement.
Les différentes fonctions :-fonctions religieuses: mariage, décès, …-fonctions sociales: lieu de réunion, lieu où il y a de l’eau courante et des toilettes, lieu d’enseignement avec aussi une fonction politique, un point mal perçu en occident et à la fois un espace de liberté dans certains pays, et enfin une fonction symbolique avec le minaret symbolisant la conquête d’un pays ou d’une ville.
Les éléments constitutifs :-Le minaret : terme Turc qui signifie « lieu » ou « phare ». C’est le lieu d’appel de la population à la prière. On utilise aujourd’hui des haut-parleurs, il n’a donc plus de sens fonctionnel, mais seulement symbolique. Le premier minaret est celui de la mosquée de Bassora (Irak) construit en 660, mais n’existe plus aujourd’hui.-La cour : passage obligé, car contient souvent le bassin des ablutions (parfois dans une pièce séparée).-La salle des prières : constituée
CHAVARDES, Benjamin, 2012 : SEM MATERIALITE 17, conférence, DEM Matéria-lité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 04 mai 2012.
AAC058-7827
d’un mur orienté vers la Mecque, devant lequel les prient fidèles. Une niche (mihrab) à l’intérieur de ce mur symbolise le prophète. Une chaire, comme dans les églises catholiques, permet de prononcer le sermon. Il n’y a pas de sièges, mais des tapis, il n’y a pas non plus d’éléments décoratifs. Les hommes et les femmes sont séparés.
Deux types de mosquées :-La mosquée de la semaine pour tous les jours.-La grande mosquée du Vendredi (différents plans de mosquée)
Les permanences architecturales :-L’orientation vers la Mecque-La constance avec les cultures rencontréesEn revanche, la coupole et le minaret ne sont pas obligatoires et sont une image « simplifiée » de la mosquée.
Emplacement dans la ville occidentale:Les points suivants tentent d’expliquer les réactions de rejet envers la mosquée occidentale :-Les mosquées occidentales sont souvent implantées en périphérie des villes, un choix peut être dicté par le raccourcis intellectuel suivant : c’est le lieu où l’on trouve la population concernée !-Le minaret est perçu comme une domination de la ville et cristallise les réactions de rejet.-La grande mosquée de Paris est une architecture du Maghreb à Paris et non pas une mosquée parisienne.-L’orientation systématique de la salle des prières vers la Mecque complexifie
l’implantation urbaine et le plan de la mosquée.
Etude de cas : la grande mosquée de Strasbourg :L’objectif est de favoriser le dialogue pour un Islam européen. Le lieu choisi pour édifier est en périphérie de la ville, dans un quartier notoirement connu pour la prostitution ! Des différentes équipes d’architectes retenues pour le concours, Zaha HADID réinterprétera la calligraphie arabe à travers sa proposition en sortant de la moquée traditionnelle. Paolo PORTOGHESI proposera pour sa part une structure classique avec coupole et supprime le minaret et les centres culturels alentours prévus au programme. Il remporte le concours.
Etude de cas : la grande mosquée de
AAC058-7828
Rome :Implantation en périphérie de la ville et à condition que le minaret ne dépasse pas la hauteur de la coupole de St Pierre de Rome. Le projet sera retardé par les habitants du quartier résidentiel, de 1974 à 1995.Il y aura deux gagnant du concours, on demandera à PORTOGHESI de faire une synthèse des deux projets.Le plan carré s’organise autour de la salle des prières avec une mezzanine pour les femmes. La salle des ablutions se place au sous-sol. Une coupole nervurée coiffe l’ensemble. Des matériaux locaux seront employé tels que le travertin et la brique locale avec joint le plus réduit possible « à la romaine ». PORTOGHESI reprend sa théorie du système d’espace comme système de lieu (cercles concentriques). La forme des colonnes reprend celle du palmier. La coupole fait référence à la mosquée de TLEMCEN en Algérie, à celle de CORDOU, un lieu entre Islam et Chrétienté et à la coupole de Turin.Le raccordement de la forme carrée (symbole de la terre) de l’édifice avec la forme circulaire (symbole du ciel) de la coupole illustre la quadrature du cercle. Cette mosquée fait référence à la fois aux cultures orientale et occidentale.
Avis personnel :
Cette conférence illustre parfaitement ce que peut être un sujet de mémoire et de projet de fin d’étude.
AAC058-7829
MASTRORILLI, Antonella, 2011 : 731-01 COURS MÉTHODOLOGIE MÉMOIRE RECHERCHE, cours, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 05 novembre 2011.
« Mots clefs pour la critique architecturale »
La connaissance de l’histoire de l’architecture est importante pour pouvoir fonder et nourrir les principes de notre projet, mais aussi pour acquérir et se forger un avis critique. A titre d’exemple, LE CORBUSIER n’a pu refuser l’histoire de l’architecture et créer le mouvement moderne qu’à partir de la connaissance même de cette histoire.
Un mémoire est la synthèse de notre réflexion personnelle et professionnelle. C’est l’occasion d’essayer de trouver comment les racines de notre réflexion personnelle se projettent dans le futur, de trouver ses propres questionnements.
L’histoire est donc un outil d’évaluation de l’architecture. Les livres d’histoires de l’architecture ont influencés le regard de l’architecture, qui influence les mouvements de pensée. Les textes traitant de l’histoire de l’architecture sont nombreux. Chaque auteur en présente a propre interprétation.
A partir du constat de l’absence de certains édifices des livres d’histoire (la question de la sélection), Antonella nous propose son interprétation personnelle de l’histoire de l’architecture au travers de mots clefs (catégories) :
1) SÉLECTION PROFONDEUR / RACINES
2) MOUVEMENT PROCESSUS / DÉVELOPPEMENT PÉRIODISATION / EXORDES
3) ÉPOQUE ESPRIT DU TEMPS STYLE
4) HÉROS / PRÉCURSEURS ESPRIT DU PEUPLE CONTEXTE/MILIEU/CATASTROPHES
Avis personnel:Je comprends le raisonnement théorique à ce stade, mais j’ai des difficultés à décoder certains recouvrements comme : PÉRIODISATION et ÉPOQUE. Pour simplifier l’appropriation de la méthode, je propose la lecture tridimensionnelle :
- Axe 1 : le parti pris de l’auteur (Catégorie 1) - Axe 2 : le contexte (Catégorie 2,3 et partie du 4) - Axe 3 : le positionnement de l’architecte (partie du 4 : Héros/Précurseurs)
La grille de lecture demeure complexe et nécessite certainement une lecture de plusieurs ouvrages pour commencer à distinguer les différentes composantes proposées par Antonella.
A.MASTRORILLI nous propose finalement l’histoire comme source de création : certainement nécessaire, mais est-ce suffisant ?
AAC058-7830
CHAVARDES, Benjamin, 2011 : 731-02 COURS MÉTHODOLOGIE MÉMOIRE RECHERCHE, cours, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 05 novembre 2011.
«La mémoire, matière d’architecture»
La question de la mémoire interactive dans le processus de création. La mémoire est un des matériaux primaire de l’architecture.
B. CHAVARDES nous propose sa propre lecture de la mémoire comme suit :
1- Mémoire du lieu : c’est un diagnostic à la fois historique et sensible
2- Mémoire de l’architecte : c’est le matériau interne de l’architecte / sa capacité créatrice
3- Dialogue et adéquation entre les deux
Avis personnel:Je suis assez en phase avec cette approche mixte mettant en jeu la combinaison d’une composante historico / mémorielle et des capacités propre de l’architecte. La création ex nihilo n’existe pas, elle s’appuie forcément sur des contraintes, telles que l’histoire dans le cas de l’architecture. L’homme et l’usage me semblent, en revanche, cruellement absent de cet exposé.
AAC058-7831
MARIELLE, Jean-Pierre, 2012 : 812-02 COURS MATERIALITE-TERRITOIRE, cours, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 10 février 2012.
« Lecture du grand territoire »
Ce cours présente le projet de la ZAC 2 de Lyon Confluence. En accord avec Gérard Colomb, ce projet se veut être une critique de la ZAC 1 dans une démarche d’amélioration. L’objectif est d’obtenir l’appropriation du projet par les politiques et la population locale (ateliers de concertation). L’équipe qui accepte ce changement d’orientation est composée des architectes Herzog & De Meuron, du programmiste Initial Consultant (JP. Marielle) et du paysagiste M. Desvignes.
L’objectif du cours est de s’inspirer de la méthodologie d’Herzog et De Meuron + Desvignes, et de reprendre quelques outils.
Pendant la durée du chantier, la ville est détruite, c’est une sorte de coupure entre l’histoire passée et future : l’idée est de conserver le plus longtemps possible les bâtiments du marché gare aux toitures en shed, dans lesquels on essaie d’implanter les activités futures qui existeraient dans les nouveaux bâtiments. Cette idée de mémoire se traduit in fine, par une conservation des quelques fragments de shed : un véritable projet urbain qui traduit la notion de mémoire et induira ensuite la question des usages. De même, les arbres du futur parc (champ des Confluences) sont mis en jauge sur les parkings actuels.
Le concept du projet : le champ des Confluences doit devenir un lieu visité.Les facteurs clé de succès sont une locomotive (le musée de Coop Himmelblau), un lien parc/musée, un lien avec le parc des berges (rive gauche du Rhône) qui sera lui-
m^me en lien avec le parc de Gerland.Dans le champ des Confluences seront implantés une résidence de chercheurs, la nouvelle maison de la danse et des industries culturelles (Design, Architecture, Recherche scientifique et imagerie de synthèse) qui par leur association doit générer une émulation.
Ce projet se présente sous forme de:- règles de typologie de bâti (R+2, R+8, R+16)- règles de constitution des îlots (effet de masque, règle de prospect, saillie et espaces extérieurs, traitement des toitures, …)- illustrations par des références- illustrations paysagères- propositions de commerces à thème- coupes de silhouette urbaine- ambiance nocturne- circulations et besoin en stationnement- sections de rue- plan masse et statut des espaces (privés, public, ...)
Avis personnel :Ce cours donne des outils de présentation d’un projet urbano-architectural. Le sujet du champ des Confluence tombe à point nommé pour mon projet d’aménagement des Balmes de St Foy, dans lequel il sera important de tenir compte de ce que l’on donne à voir depuis la Confluence et inversement.
AAC058-7832
DE BUSSIERRE, Arnaud, 2012 : 821-01 COURS MAÎTRISE D'OEUVRE, cours, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 11 février 2012.
« Forme et espace 01 »
Arnaud de Bussierre est à la fois mathématicien, ingénieur et architecte. Après une longue expérience avec Jean Nouvel, il dirige aujourd’hui un bureau d’étude structure spécialiste de l’enveloppe. Ses clients sont de grandes entreprises de constructions répondant à des appels d’offres des plus grands architectes actuels (N. Foster, Z. Hadid, Coop Himmelblau, J. Nouvel, M.Gautrand, …).
Arnaud de Bussierre se pose en dissident de la philosophie de l’ingénierie d’étude de structure du bâtiment classique, qui aborde le calcul de structure par la STATIQUE et prône une vision de structure DYNAMIQUE du bâtiment. Son objectif est de comprendre là où l’on peut enlever de la matière superflue.La forme du bâtiment participe alors à sa structure et autorise celui-ci à se déformer. On perlera de surfaces actives.
Deux facteurs sont à l’origine de ce point de vue :
1-Les modeleurs informatiques (splines) autorisent l’architecte, depuis deux décennies, à explorer des registres de formes sans limites au stade de la conception. La difficulté de mise en œuvre de tels bâtiments nécessite une remise en cause drastique des méthodes de calcul de structure et de mise en œuvre de ces derniers.
2-Le mouvement de pensée déconstructiviste + destructuration (Coop Himmelblau, D.Liebesskine, P. Heisermann)
Il y a un intérêt certain à comprendre et assimiler les contraintes de structure pour concevoir une architecture cohérente. En effet, différents exemples de bâtiments de cette tendance architecturale montrent qu’il n’y a pas toujours une cohérence entre forme et structure (conception dynamique et surface actives) et que dans bien des cas, l’approche structurelle est encore statique, et directement dépendante du savoir-faire de l’entreprise qui construit le projet. D’autre part, ces exemples nous montrent l’attitude, pas toujours conciliante, de différents architectes faces aux acteurs du projet.
Exemples de projet :
ROLEX Learning center – Lausanne – SAANA
-> Le concept de coque mince ne fonctionne pas : incohérence forme / structure
AAC058-7833
Show room CITREON – Champ Elysée, Paris – Manuelle Gautrand
-> Conception de la structure interne et de la façade par 2 BE différents. La synthèse n’a pas été réalisée correctement par l’architecte : de sérieux problèmes lors de l’assemblage
BMW museum – Mûnchen – Coop Himmelblau
-> Démarche de co-conception Architecte /Ingénieur structure : une vraie réussite, bâtiment cohérent
Avis personnel :Ce cours particulièrement intéressant, ouvre d’un côté des possibles formelles qui semblent sans limites au prime abord,
et de l’autre, nous permet d‘entrevoir les aléas de réalisation de tels bâtiments.Il pose la question de la responsabilité des choix esthétiques de l’architecte en regard de la bonne évaluation de la faisabilité technique et financière de tels projets et du savoir-faire des entreprises et bureaux d’étude constituant l’équipe de maîtrise d’œuvre.De tels registres de formes sont-ils finalement toujours justifiés ?Un travail architecte / ingénieur doit être effectué le plus en amont possible du projet.
Bibilographie :
THOM, René, 1999, Paraboles et Catastrophes, édition Flammarion
D'ARCY THOMPSON, traduit par Dominique TEYSSIE, 2009, Forme et croissance, édition Seuil
AAC058-7834
DE BUSSIERRE, Arnaud, 2012 : 821-02 COURS MAÎTRISE D'OEUVRE, cours, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 17 février 2012.
« Forme et espace 02 »
Thème de cours : l’ENVELOPPE-l’enveloppe structurelle,-l’enveloppe thermique bioclimatique-la 5eme façade : les verrières
Quand on parle d’enveloppe, on ne parle plus de façade. Dans les années 70’, la notion d’enveloppe apparait avec les premiers murs rideau et les brises soleil. Aujourd’hui, l’enveloppe a un rôle dans la stabilité du bâtiment.
L’enveloppe structurelle :Cette thématique s’applique particulièrement aux immeubles de grande hauteur (IGH). Historiquement, les IGH sont conçus autours d’un noyau central très consommateur de place, puis on dispatche différents noyaux dans le bâtiment dans les années 70’. Aujourd’hui, on se sert de l’enveloppe comme élément structurant (tube ajourée qui génère une structure et des ouvertures).
En parallèle en Europe, Jean Prouvé développe le concept de mur rideau, l’enveloppe est accrochée au bâtiment. Ces deux approches seront réunies dans les années 80’ pour concrétiser cette philosophie.
World Trade Center est le premier bâtiment de ce type
Les IGH sont soumis à différentes
sollicitations extérieures. On ne s’intéresse ici qu’aux charges horizontales, les charges verticales étant gérées par les calculs classiques de statique pour les descentes de charges. Dans ce cas, l’enveloppe qui encaisse les déformations horizontales (enveloppe déformable ayant pour objectif de réduire le volume de matière), la difficulté est de lier l’enveloppe avec l’intérieur du bâtiment.
Le vent, en plus des risques sismiques, est une source majeure de contraintes horizontales qui sont fonction de :-la vitesse du vent-la hauteur-la forme aérodynamique du bâtiment-l’état de surface (rugosité) de sa peau extérieure
L’IGH réagit aux effets de pression et de succion du vent par une dépression qui génère une mise en phase du bâtiment. Ce phénomène est amorti par un système de masse accordée (Tuned Mass Damper), une sphère suspendue à la cime de l’IGH pesant (3% du poids de la tour).
On distingue trois types de conception, d’IGH :-la structure rigide-la structure déformable avec étages de rigidification (déformation par secteur successifs, 1950’)-la structure déformable continue (structure de plus en plus souple en fonction de la hauteur, en jouant sur la souplesse des assemblages, actuel)
AAC058-7835
Deutsche Post Tower (Bonn-2003)
Ce projet est totalement en verre sans noyau avec une structure métallique. Conceptuellement, l’enveloppe règle les problèmes de structure (Dynamique) ainsi que les problèmes bioclimatiques. Il s’agit d’une enveloppe absorbante :-son épaisseur de double peau varie en fonction de la déformation (analogie avec la déformation d’une masse en caoutchouc)-le volume d’air contenu dans la section de la double peau entre donc en mouvement-deux ailettes latérales au profil de la tour dévente les deux façades-des évents équipés de volets d’ouverture créent une rugosité de façade et permettent l’entrée de l’air dans la double peau. Sous l’action du vent, l’effet de pression sur la peau extérieure se transforme en courant ascendant à l’intérieur de la double peau, qui génère lui-même un effet de succion sur la peau intérieure.
L’enveloppe thermique bioclimatique:Après un rappel sur le vocabulaire, la composition du verre, la protection incendie et le facteur solaire (transmission énergétique), nous nous intéressons aux différentes mises en œuvre des produits verriers :-le système à parcloses-le vitrage extérieur avec serreur (VES)
Marques (RAIKO, STABA et SCHÜKO) Variante avec serreur intégré-le vitrage extérieur collé Utilisé pour les façades pressurisées dans les années 80’-le verre agrafé
Remarque : faire attention aux vitrages avec sérigraphie horizontale progressive, cela génère des maux de tête pour les usagers du bâtiment, du fait de l’absence de ligne d’appui du regard fixes (cas chez Gehry et Foster)
Meiso no Mori Crematorium - TOYO ITO
Le toit est un véritable exemple de structure dynamique, la façade est en verre agrafé suspendu.
Un rappel historique des murs rideau:1- A l’origine, l’enveloppe suit la déformation dynamique du bâtiment = une grille rigide suspendue au bâtiment2- Aujourd’hui, la grille est redivisée avec des joints de dilatation = grille déformable3- Les systèmes cadre suspendus + joints de dilatation entre chaque cadre4- Aujourd’hui, c’est un mixte des techniques en fonction de la déformation du bâtiment
AAC058-7836
Le mur rideau est ventilé (dynamique des fluide de la lame d’air), on distingue deux approches :-Le mur rideau respirant (Français) Fonctionne mal en inter-saison Pb de condensation Système non modulable, car global (tout en un) Présente un intérêt dans des cas particuliers Remarque : faire attention à OUEST ALU-Le système ventilé (Anglosaxon) Système modulaire : une couche = une fonction Gestion du flux d’air différenciée (été ou hiver)
Étanchéité de la façade :-Étanchéité par occlusion (étanchéité totale de la première peau) Technique ancienne Génère des pb de condensation La pluie et le vent finissent toujours par entrer Étanchéité « parapluie » (principe de l’écran pluvial) On admet que l’eau rentre dans la première peau On organise le drainage
Magasin Hermès à Tokoy – R. Piano
Beekman Tower à NY – F.Gehry
La 5eme façade : les verrièresLes premières verrières double peau
Postsparkasse à Vienne, O. Wagner 1906
AAC058-7837
Usine Johnson, de FlL WrightOn distingue 3 types de toitures :-Toiture chaude Légère Lourde Toiture froide Légère Lourde -> principe de la double peau en verre (c’est une enveloppe horizontale)-Toiture inversée Légère Lourde
On peut y associer les différents types de vitrage (VEC, VES, pareclose,…) + un drainage continu
Le raisonnement est identique à l’enveloppe en terme de structure, la forme même de la verrière gère les efforts horizontaux (théorie des formes ou déformation de la verrière)De même du point de vue thermique, on retrouve 2 philosophies :-Système global-Système modulaire en plusieurs épaisseurs
Remarque : il faut toujours régler l’ensoleillement par l’extérieur de la façade pour éviter la surchauffe
Maxxi Museum à Rome – Z. Hadid
AAC058-7838
DE BUSSIERRE, Arnaud, 2012 : 821-03 COURS MAÎTRISE D'OEUVRE, cours, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 03 mars 2012.
« Forme et espace 03 »
PARASISMIQUE : 1ere théorie : on travaille avec des bâtiments hyperstatiques en termes d’ingénierie. Valable pour les maisons individuelles et petits immeubles collectifs -> c’est la théorie pour tous les bâtiments traditionnels
2eme théorie : Pour les bâtiments élevés, les tours, les bâtiments en longueur, on travaille avec une certaine forme de déformation.
Pour les bâtiments hyperstatiques :-Il se produit une forme de fatigue à force d’encaisser des séismes jusqu’à la rupture possible.-Le sol est surcomprimé par le bâtiment (bulbe de compression, effet de rotule et cisaillement pour les bâtiments sur pieux)En termes de séisme, tout est dans la conception, plus que dans le calcul.
1- Tremblement de terre :L’origine est due à un déplacement de plaque tectoniqueLa magnitude (échelle de Richter) ne prend pas en considération les effets locaux : c’est l’énergie totale.L’intensité prend en compte les dégâts sur les bâtimentsOn distingue l’amplitude et la fréquence sur la sinusoïde.
2- Les différents types d’ondes:-Les ondes de LOVE sont des ondes de compression/dilatation (primaires) : HORIZONTALES (les plus rapides)-Les ondes de Rayleigh sont des
ondes de cisaillement (secondaires) : VERTICALES
3- Typologie de dégâts :-Effondrement en galette (pancake)-Fissures en croix-Étages souples-Colonnes captives et colonnes courtes (short column)-Dégâts d’armature-Martèlement-Longueur d’appui insuffisante (bâtiment préfabriqué)-Liquéfaction du sol (perte de portance des fondations, séparation des grains de l’eau contenue dans le sol sous l’effet de la vibration)
4- Conception des bâtiments :-Enjeux : un bâtiment bien conçu vs bien calculé-Forme du bâtiment : . en plan : décomposer une forme complexe en plusieurs formes simples . en élévation : les étages à hauteur variable et les discontinuités de contreventement sont défavorables.-Les systèmes de contreventement : . Hyperstatique pour les petits bâtiments . Cadre (portique) acier ou béton armé : attention à la réalisation des nœuds, ancrage et stabilisation des barres d’armature, acier= instabilité ou rupture locale non-ductile) . Cadre bois très efficace pour le sismique . Système mixte béton/acier
5- Diaphragme :Les contreventements sont verticaux, le diaphragme et le plancher horizontal,
AAC058-7839
c'est à dire le principe de distribution de l’effort dans les contreventements verticaux.
LA PRE-CONTRAINTE : LES BETONS-Fil adhérent : le câble adhère à la matière-Câble dans une gaine (ancrage fixe, déviateur, gaine et ancrage actif)
PROJETS
Médiathèque à Sendai (Japon) : Toyo Ito 1995
- Tous les éléments secondaires (façades et cloisons) sont suspendus de la même manière pour bouger de la même façon.- Éléments capteurs de lumière en toiture : puits de lumière- Le sol est une sorte de tapis déformable pour ne pas mettre le bâtiment en résonance- Cuvelage périphérique (paroi moulée)- Raccord des planchers par cadres acier maillé- Les pylônes en treillis métalliques comportent des éléments amortissant et des rotules « plastiques » en vertical.
Lou Ruvo Brain fundation à Las Vegas : F.Gerhy
Forum for music, dance, art & cultur – Ghent (Belgique) : Toyo Ito 2001Projet non réalisé qui met en œuvre des caténoides. (Théorie des chainettes mise à l’horizontale)->La surface et l’épaisseur minimale pour transmettre l’effort->Série de caténoides empilés les uns sur les autresCe travail débouche ensuite sur le projet suivant :
Taichung metropolitan opera house – Taichung city – Taiwan : toyo Ito- La forme définie l’espace- Variation de l’épaisseur en section- Essais de réalisation : ->Caténoide acier + remplissage placo : uniquement pour caténoides fermés NOK ->Résille métallique et béton projeté : pb de tenue au feuLES SPLINES :
AAC058-7840
Taichung metropolitan opera house – Taichung city – Taiwan : zaha Haddid
Opéra de Sydney : Jorg Oberg Utzon (1957)
Millstein Cornell College, Itheca (USA) : R. Koohlaas
Tour Morphosis, la défense : Thom Main
Prada, tokoy : Herzog & De Meuron
AAC058-7841
ANNEXE 02 - EXTRAITS M1
Bol RAKU de cérémonie du thé, connu sous le nom d’ « Amadera », attribué à Chojiro, 16ème siècle
WABI SABI侘寂
AAC058-7842
SEM MATERIALITE 06 – TRANSCRIPT DE LA CONFERENCELa matière de l’Architecte. Actualisation de l’architecture Conférence à l’ENSAL le 06 janvier 2012© Jean TABOURET, janv. 2012
"Excusez-moi si j’ai des baisses de niveau sonore à certain moment, je vous dois quelques excuses parties rapport au titre en fait, parce que cela ne dit pas du tout de quoi je vais traiter… hésitation …en fait … hésitation …dans la matérialité pose la question de la matrice en particulier en architecture, quelles sont toutes les parties antérieures à la création ? Et qu’est-ce qui est en puissance à la création architecturale et urbaine. Et voila pourquoi je traite dans ma thèse du virtuel, et donc plus généralement du passage du virtuel à l’actuel et donc de l’actualisation, et il me semblait important de replacer la création dans ce cadre-là des forces latentes de ce qui est en puissance et qui va permettre de la créationDonc j’avais heu j’avais un programme assez long en fait, dans cette présentation, j’avais prévu de traiter du WABI SABI et bon j’avais assez peu de temps. Mais bons cette image me parlait énormément par rapport à mon sujet
J’y trouve une certaine résonance par rapport à cette idée de l’immaîtrisable, de l’indicible et de l’imperceptible. Parce que dans cette création qui est parfaite dans le sens du geste, du travail de la main, et bien finalement la volonté n’a pas été d’atteindre une symétrie et une perfection et finalement la beauté, on la trouve dans l’imperfection. Donc c’est un type de gout esthétique, en fait, des Japonais qui est le WABI SABI. C’est le beau de l’imperfection et donc ce type de
bol est utilisé depuis le XVI e siècle dans la cérémonie du thé et c’est d’une certaine façon la quintessence du zen, du recueillement et de la concentration. Bon, c’est un chapitre que j’aurais aimé développer dans ma thèse, mais je me suis pour le moment plutôt concentré sur la théorie.
Je suis parti du début donc, d’Aristote. Aristote ne parle pas du virtuel puisque le terme n’existe pas à l’époque, le terme est créer au moment de la scolastique il est virtualis qui signifie en fait ce que Aristote d’écris comme « étant en puissance ». Donc à l’époque de la scolastique les gens redécouvres les écris Grecques par l’intermédiaire des savants Arabe Averroès et Abissince et ils trouvent
TABOURET, Jean, 2012 : SEM MATERIALITE 06, conférence, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 06 janvier 2012.
AAC058-7843
au XIII ème siècle, avec le développement de l’université, on réinterprète, on redécouvre les concepts développer par les savants Grecques. Donc Aristote est arrivé à la postérité, c’est peut être dus à son influence en politique. C’était le précepteur de d’Alexandre le Grand. Donc il avait un rôle assez central en Macédoine et donc peut être une raison pour laquelle son œuvre a été autant diffusé, et atteint la postérité, même si il y avait d’autres savants qui traitaient des mêmes sujets. Donc ça parais assez loin par rapport à nous, par rapport à contemporanéité mais le propos est très clair et très proche finalement. Je peu vous conseiller de la lire, c’est très simple finalement, et donc voila je me suis plutôt concentré sur Aristote et j’ai mis de coté le terrain qui m’intéresse, en l’occurrence qui est le Japon pour son coté antipodique. Finalement … on va pouvoir ce mettre de sensation et de concept de façon objective et pouvoir découvrir ce qui sourd derrière ces concepts et cette culture, ce qu’on n’aurait pas vu quand on est plongé dans le bain de l’Europe et de l’Euro centrisme.… hésitation …L’idée c’est de vraiment, par la décentration, d’arriver à un nouveau paradigme dans une société d’intensité et d’instantanéité, et donc un nouveau paradigme de … hésitation …en fait, on peut observer au japon que… hésitation …En fait Christine Lucie Glusmann qui à écris un très beau livre sur l’esthétique du temps au Japon, du zen au virtuel, décris ce paradigme d’un labyrinthe de destiné réversible propre a échapper à la mort tant l’expérience est de forme parfois … bande son inaudible … Par la mise en réseau des informations et des flux à grande échelle, et donc finalement les penseurs du Japon sont assez subjugués par le mot de « paradigme » et donc ils écrivent
… hésitation … finalement, c’est en traitant du latent que… hésitation … c’est au travers du concept que l’on va pouvoir dans ce nouveau cadre, définir le paradigme contemporain. En fait, le concept permet de … hésitation … En fait, le signe ce manifeste par … hésitation ... .
Le nouveau paradigme amène à ce que Max VEBER définit comme le désenchantement du monde. On est passé à l’époque moderne d’un monde où tout est « démagéifié », et donc le passage au paradigme moderne vers un poste modernisme serait justement la réinterprétation de ce qui sourd, et finalement d’une certaine spiritualité et conscience de ce qui est imperceptible. La connaissance finalement de la culture Japonaise, puisqu'elle a perduré dans les siècles, permet de comprendre cette situation. Bon, en fait, toujours dans la même démarche de partir du début de l’histoire donc Aristote et la théorie, m’a amené à m’intéresser ISE JINGU qui est le grand sanctuaire ISE …
伊勢神宮ISE JINGU
AAC058-7844
Extrait Shinto Art : ISE and IZUMO
… qui est dédié à MATERASU, qui serait l’aïeul des descendants de la famille impérial, et donc elle est lié au cercle solaire, et donc c’est la déesse du soleil, et donc par extension du temple. C’est donc devenu par la famille impériale et donc l’empereur la déité centrale du SHINTO.Donc ISE JINGU est constitué de deux sanctuaires et alors là on en voit un seul c’est NAIKU.
Plan de NAIKU, Extrait Shinto Art : ISE and IZUMO
Il est caractéristique car c’est un sanctuaire qui est reconstruit tous les vingt ans. Donc là, on se trouve en 1953. Donc là, on a le nouveau temple et ici l’ancien temple que va être démolis par la suite. Donc l’intérêt de montrer NAIKU c’est d’amener sur certains concepts qui font la société japonaise et qui ont fait la création du sanctuaire. Je vais essayer de dénouer les fils et comprendre pourquoi une telle architecture a pu se développer au travers de ces concepts traditionnels.
En fait, on a deux terrains qui sont constitués du SCHODEN, qui est le temple principal qui contient en fait les trésors impériaux. Donc principalement le miroir, qui est censé représenter la déesse AMATERASU . Et les deux ON DEN qui sont des temples secondaires qui contiennent d’autres trésors. Donc, ces temples n’existent qu’a un seul exemplaire, sauf que tous les vingt ans, ils sont reconstruit à l'identique sur un terrain parallèle
Question de l'auditoire:« Il semble que l’on voie sur la nouvelle construction qu’il y a un mur d’enceinte,
AAC058-7845
comment cela se passe ? On construit plus haut à chaque fois ? »
En fait … hésitation … les deux plates-formes sont à peu près au même. Si on voit le mur d’enceinte, c’est qu’il vient d’être construit et le bois est encore très clair. Mais on a exactement la même enceinte ici. C’est vrai, l’image est un peu sombre!Ici on est dans la phase où le nouveau temple vient d’être construit on est en 1953 et l’autre temple va être déconstruit, et le même processus se refera dans vingt ans, en 1973, le temple sera reconstruit là. Et de même en 1993, le temple est reconstruit ici. Et c’était la dernière construction, la prochaine, qui a déjà commencé, sera achevé en 2013 sur ce terrain ci.
Je voulais vous présenter le terrain de l’étude qui va amener les concepts par la suite (situation géographique du temple sur la carte du japon).On est au centre du Japon et c’est le lieu qu’ont choisi les empereurs pour installer leur sanctuaire principal.Sur cette photo, on aperçoit le SHIN NO MIHASHIRA, qui est le poteau enfoncé dans le sol, et qui censé toujours rester caché, et cette niche n’est jamais déconstruite. Elle reste toujours en place même quand on construit le temple au-dessus.
Shin No Mihashira
Question de l’auditoire"Il serre à quoi ce poteau ?"
C’est juste pour marquer la présence de la déesse, et finalement pour marquer la sacralité du lieu. Ce n’est pas juste un terrain libre recouvert de galets blanc, c’est un espace sacré, c’est un moyen de marquer le lieu. Et du coup, il y en a deux, il y en un autre sur l’autre terrain. Il se trouve sous le temple actuel.Donc la reconstruction a un an, c’est un des principes fondateur, c’est l’idée de l’impermanence, et en fait, tout ce temple est construit sur un mode, un style, qui est le TAKAYUKA, qui signifie le plancher surélevé, qui était le style utilisé pour les greniers. On voie bien là-dedans le fond agraire de la culture Japonaise
AAC058-7846
Takayuka
Et donc on verra plus tard, le temple était dédié à une déesse, une déité des récoltes et de la fertilité, qui est devenu par extension celle du soleil. Donc on a tout un type de caractéristiques de construction, notamment ce poteau oblique qui n’a quasiment aucune fonction structurelle, sinon qu’il a la même fonction que le poteau qui est censé être enterré sous le temple donc un concept important dans la culture Japonaise … et donc important dans tout ce qui est d’être la construction et la création d’espace. C’est la question du MA.
Munamochi Bashira
Diagramme des mesuresLe MA défini des dimensions, donc à ce moment-là on appelle ça le KEN. Cela correspond selon les régions, a 6 pieds ou 10 pieds qui correspondent à 1,80 m à 3,00 m. Toute construction est conçu suivant ce mode. Le signe MA est fait du signe de la porte et qui contient le signe du soleil et à l’origine le signe de la lune. Et donc le sens, c’est l’espace, le vide mais c’est plus que du vide, c’est l’intervalle, l’interstice. C’est donc la vision que l’on pouvait avoir de l’encadrement de la porte du monde. Donc c’est la première dimension du MA, on en a une deuxième que l’a nome AI DA, qui a la même ambiguïté que le milieu en français, qui signifie cette
MA間
AAC058-7847
polarité mais qui représente l’étendue. Ensuite on a le TAI MA. On a le tatami qui associé à MA indique un nombre des pièces, qui sont compté en tatami.
Il y a aussi le SHA NO MA, le TOKO NO MA. Et on a aussi la dimension du temps qui se dit JI DAN. Originellement, l’architecte était appelé MA DORI c'est-à-dire celui qui saisit l’espace. Sur le MA on a une expression qui veut dire « prendre du MA » pour l’agencement des pierres. On a un terrain sur lequel on dispose des pierres c’est un carré, SEN SU étant le paysage, le carré sec brulé, c’est un paysage sec qui est censé représenter des îles, et ce que l’on décrit comme la mer c’est plutôt des flux entre les éléments et donc prendre la juste distance entre les pierres.
Karesansui du RYOAN-JI
KODENCHI
Augustin Berque, dans « le geste à la cité », décrit ce processus instauré entre les éléments, pour que l’une ne dérange pas l’autre, tout en gardant avec l’autre une dynamique.Donc cette manière de présenter les éléments est propre à aider à la méditation. La MA peut être caractérisé par cet espace vide, le KODENCHI. Cette scène sans architecture pourrait nous en apprendre.On est bien dans la construction de 1993, elle tant a nous en apprendre sur cette idée du temps. … hésitation …La fréquence des reconstructions a énormément changé au cours des siècles, et il est resté pendant une période de 130 ans sans reconstruction, car c’est extrêmement couteux, et de même, ça nécessite une administration extrêmement puissante.
Question de l’auditoire"Quelle est l’origine de tout cela ? C’est la pérennité des matériaux ou un rite ?"
C’est vraiment un rite de la répétition et de la renaissance et de la reconstruction. C’est à la foi l’impermanence et l’immuabilité des cycles de la vie des cycles de la nature. C’est en fait le fond de culture animiste SHINTO japonaise.Donc on va le voir plus loin, mais cette façon de traiter de ses rites de l’éphémère est très sophistiqué part rapport à tout ce qui est au départ. La pérennité est un faux problème, étant donné que nous avons un des plus vieux
TAE - MA絶え間
AAC058-7848
bâtiments du monde qui est à Nara, qui date du VII ème siècle. C’est une pagode à plusieurs niveaux et elle est en bois, et elle est là depuis le VII ème siècle.
Une des images préférées des Japonais concernant l’éphémère c’est les fleurs de cerisier, puisque finalement leur fleurissement ne dur qu’un instant.
Sakura No HanaCela a inspiré énormément le samouraï au travers du ZEN, et de cette idée de l’impermanence de la vie et de l’acceptation, finalement, de l’éphémère et de notre propre périssabilité.Ici, un charpentiers qui travaille une pièce de bois avec un outil traditionnel, depuis des générations, depuis la première construction.
Charpentier maniant unyari-ganna
Comme je vous le disais, il y a eu énormément de mode de représentation de l’espace au Japon. Et finalement le SHIKINEN SENGU est l’aboutissement de toutes ses étapes.
Shikinen Sengu de 1993, Photo de Haruo NakanoJ’ai mis ici le festival, parce que finalement, la répétition des cycles est marquée au Japon par les festivals. Et ils continuent, et malgré la modernité, ils ont toujours perdurés et ils ont t toujours marqué, finalement, ces cycles.
AAC058-7849
Festival du Nouvel An, iîle de Kami-Jima Hi-no-wa, anneau du soleil
Je vais citer le concept de la dissimulation, qui est le fait de ne pas tout montrer, qui est le secret TAKA, qui signifie la démarcation. Les Japonais apportent une grande attention à séparer ce qui est du sacré du profane. Un peu partout, on trouve des signes sacrés qui sont marqués de différentes manières et notamment des barrières.
Il y a le SHI ME NA WA qui sont des cordes en paille de riz
Et finalement, on a eu une progression dans la manière de marquer les territoires, pour arriver au TAKA WUKA qui est la manière du bâtiment à plancher surélevé, qui été en fait, le grenier à grains. Et donc qui a servi de modèle à la création d’ISE JINGU. Et donc là, on trouve un exemple d’un petit pavillon qui n’est pas sur le terrain même, parce que finalement, on avait tout un tas d'administrations, donc tout un tas de bâtiments autour du Temple principal.
Et donc là, c’est pour vous montrer en fait, le style d’architecture. On a des planches emboitées, d’où une obligation d’avoir une ouverture centrale, comme c’est le cas sur le temple, alors que d’habitude c’est en pignon.
IWASAKA結界
AAC058-7850
Donc on retrouve ce poteau oblique qui n’a pas réellement d’utilité, car tout est tenu par la charpente. Il est là plus par rappel d’une architecture primordiale qui existé avant la création du sanctuaire.
Donc une autre manière de marquer les frontières qui sont les TORI. Donc là, on est à l’entrée du sanctuaire, juste avant le pont, le passage de l’autre côté.
D’autres exemples les SHI ME NA. … hésitation …
Une autre manière de montrer la dissimulation, c’est dans les maisons. Dans toutes les maisons, on a un espace de transition entre l’extérieur et la pièce même, c’est le EN qui signifie le passage, la transition.En fait je vous citerais Tanizaki qui a écrit « Éloge de l’ombre ». C’est un essai vu par un Japonais : « Si dans la maison Japonaise l’auvent du toit avance si loin, cela est dû au climat, au matériau de construction et à divers autres
facteurs sans doute, si bien que les Japonais qui eurent préférés une pièce claire à une pièce obscure ont été entraînés à faire de nécessité vertu »C’était pour traduire le fait que ce sont les conditions climatiques et géographiques qui ont amené les Japonais à traiter leurs maisons de cette manière.
Et donc le EN, c'est cet espace de transition, le passage est présent.
AAC058-7851
Et donc là on en a d’autres exemples qui deviennent un espace de circulation. Comme on le voit, souvent il était fermé par des panneaux en bois à cause des typhons, entre autres, de manière à protéger l’intérieur des maisons.Les SHODI sont les petites cloisons de papier tendu sur une ossature en bois, et donc, lors des périodes de grosses pluies et de tempête, on fermait par des panneaux en bois. Et on vivait ainsi reclus dans l’obscurité totale. D’où un gout prononcé des Japonais pour l’ombre
et l’obscurité, et d’où l’essais de Tanizaki sur «l’ Éloge de l’ombre ».
Un autre exemple, au passage, et c’est intéressant. C’est des exemples de MA SHIA globalement.
Ah oui, une autre manière de marquer le passage, c’est le NO REN, que l’on trouve aussi dans les échoppes et dans tous les commerces. Alors le TOKOYAMA, qui est en fait une alcôve, qui est cet espace vide qui ne montre pas grand-chose finalement, et donc sa principale qualité c’est ça, c’est ce vide.
Alors toujours Tenisaki « moi-même, du temps de mon enfance, quand je risquais un coup d'œil au fond du TOKOYAMA ou fond du salon ou de la bibliothèque que jamais le soleil n’effleure, je ne pouvais me défendre d’une indéfinissable appréhension, mais alors où est la clef des mystères ? Et bien je trahirais le secret, tout bien considéré, ce n’est que la magie de l’ombre. Traquer cette ombre dans tous ces recoins et le TOKOYAMA retournera à sa réalité banale, espace vide et nu ».
AAC058-7852
Donc on voit bien dans les maisons contemporaines, on a souvent utilisé le TOKOYAMA pour créer une alcôve de présentation, et on a installé un bandeau de lumière. Et donc, ce TOKOYAMA perd son ombre et donc perd l’intérêt que lui portait TENIZAKI.Et donc là, on revient à l’idée de la dissimulation. Donc la niche où se trouve le pilier enterré … hésitation … En fait il semblerait que cette niche est existé avant la construction du temple. … hésitation … SHIN NO MIHASHIRA, c’est une manière de construire et d’enterrer les poteaux, on n'a pas de vraies fondations, les poteaux sont directement enterrés dans le sol. Et en fait, c’est une manière très archaïque qui a été réutilisé par la suite pour créer le sanctuaire d’ISE JINGU. Ce temple a une architecture primordiale, notamment à l’époque où il a été construit, les chevrons de rive devrait être recourbés comme on le voit sur d'autres temples, alors que là, comme sur le grenier à grains, comme sur la photo précédente.Donc les TAMAGAKI c’est les clôtures, donc autour de ISE JINGU, on en quatre rangées, toujours pour dissimuler. On est toujours à distance du Temple, on l'entr'aperçoit, et on voit finalement, que ce qui le représente, est en fait un artifice, car à notre époque, on a plus l’utilité à utiliser ces manières de construire.
Espaces Aliénés
Donc, tous ces gros troncs d’arbres étaient censés, à l’origine, de peser un poids sur le faîtage pour le protéger en cas de typhon. Mais c’est une technique qui date d'une période antérieure à la création du temple, et donc ça a été réutilisé il y a 1300 ans lors de la première construction, pour marquer une sorte de « japanéité » dans la construction d’ISE JINGU.Donc je vais revenir sur l’histoire du temple, c’est TEMMU TENNO l’empereur qui a institué le culte de MATERASU pour le famille impériale. En fait, l’empereur qui était auparavant le frère de l’empereur, a dû se battre contre son neveu, et il semblerait qu’il ait eu la victoire sur son neveu face au Temple de ISE JINGU, et que le neveu aurait été aveuglé par le soleil, donc dans l’axe du temple, donc ça c’est le mythe !Et le mythe a servi la politique de TEMMU TENNO, qui a dédié le temple à MATERASU, qui l’a institué comme aïeul de la famille impériale.Pour asseoir aussi son importance et son influence, il a fait institué sa nièce, la princesse, en tant que grande prêtresse du sanctuaire. Et depuis cette période, toute personne qui est grand prêtre ou grande prêtresse du sanctuaire ISE JINGU est forcément une personne issue de la famille royale. À différentes périodes, ça servait les intérêts politiques.Depuis la famille royale n’a plus de pouvoir, sinon une aura spirituelle pour la population
AAC058-7853
Japonaise.
Temmu TennoJe vais revenir sur la « japanéité » du temple. À l’époque du frère de TEMMU TENNO, on avait une grosse influence des Chinois qui ont importé le Confucianisme. Toute l’administration de l’empereur était basée sur cette doctrine, et donc les Chinois avaient une énorme influence, donc les mandarins. On avait énormément d’échange entre les deux cultures.Finalement, TEMMU TENNO a voulu couper avec cette influence, et donc a voulu instituer dans le sanctuaire de ISE JINGU, une forme de « japanéité », d’où une utilisation de tous les artifices, dont on parle, qui étaient abandonnés depuis très longtemps. On a, entre autre, les chevrons de rive qui dépassent, on a les planches sur le faitage et les toits de chaume, aussi parce que à l’époque, on était surtout sur des bardeaux de cèdre. Donc tout ce que vous voyez là est un parfait artifice, un simulacre, en fait, pour servir une volonté politique. … hésitation … Ces artifices sont appelés MUSHI KAKE … hésitation …Avec l’arrivée du confusianisme et l’influence de l’écriture Chinoise, et donc parallèlement à la création d’une « japanéité » de l’artifice architectural, est arrivé la création du Japonais. On a deux récits de l’époque, l’un écrit en chinois qui a été condamné par l’empereur, et l’autre écrit en Japonais. Ces deux récits font en fait toute l’antériorité à la famille royale, et finalement avant l’arrivée
du Chinois, on n'a pas d’histoire sur le Japon. On a que des signes des périodes antérieurs, et donc voila pour vous dire que ce temple ISE JINGU est un simulacre pour assoir une suprématie, et en même temps de servir de modèle à une forme d’écriture japonaise et de philosophie et de concept qui a servi par la suite, même dans la culture profane et pas uniquement sacrée.
QUESTIONS DANS L’AUDITOIREC’est de quelle époque à peu prés ?
Alors oui,j’ai oublié de vous donner les dates.En fait, l’empereur TEMMU TENNO est arrivé au pouvoir en 673, c’est l’année de sa victoire, et du coup, quand la construction tous les vingt ans s’arrête, on est dans la période TOROMASHI, c’est juste avant l’ère EDO, c’est avant le XVIème siècle et pendant 130 ans on n’a pas eu de reconstruction.Et finalement, c’est à la période d’EDO que le Japon s'est refermé, l’empereur a à nouveau renforcé le culte d’ISE JINGU et augmenté l'influence du sanctuaire.Évidemment mon sujet n’est pas aboutis je suis au milieu de ma thèse, mon projet est un peu celui d’Augustin Berque.Je voulais terminer en fait sur une petite bibliographie surtout si je n’ai pas été très clair ! Elle est hyper accessible."
Duré de la conférence 54mn
Bibliographie:sur le Japon
BARTHES Roland, 2005: L’empire des signes, Essais, éditions du Seuil, France. 1ère édition en 1970, Editions d’Art Albert Skira
AAC058-7854
BERQUE Augustin, 1993: Du Geste à la cité. Formes urbaines et lien social au Japon, Bibliothèque des sciences humaines, NRF, éditions Gallimard, France. BUCI-GLUCKSMAN Christine, 2001: L’esthétique du temps au Japon. Du zen au virtuel, éditions Galilée, Paris. ISOZAKI Arata, traduit du japonais par SABU Kohso, 2006: Japan-ness in Architecture, The MIT Press, Massachussets Institute of Technology NITSCHKE Günter, 1993: From Shinto to Ando, Academy Editions, London. TANIZAKI Junichiroo, traduit du japonais par René SIEFFERT, 2011: Eloge de l’Ombre, éditions Verdier, Lagrasse.1ère édition de la traduction en 1978, Publications Orientalistes de France, 1ère édition en langue originale en 1933. WATANABE Yasutada, traduit du japonais par Robert RICKETTS, 1974: Shinto Art : ISE and IZUMO Shrines, Weatherhill/Heibonsha, New-York/Tokyo1ère édition anglaise, précédemment publié en japonais en 1964, par Heibonsha, Tokyo. Sur le virtuel: ARISTOTE, présenté, traduit et annoté par Marie-Paule DUMINIL et Annick JAULIN, 2008: Métaphysique, éditions Flammarion, Paris. BAUDRILLARD Jean, 1981: Simulacres et simulation, éditions Galilée, Paris. DELEUZE Gilles, 1996 (8ème édit.): Différence
et répétition, Epiméthée, PUF, Paris.1ère édition en 1968 LEVY Pierre, 1998: Qu’est-ce que le virtuel ?, Essais, éditions La Découverte/Poche, Paris. ELIADE Mircea, Le profane et le sacré
AAC058-7855
DE BUSSIERRE, Arnaud, 2012 : SEM MATERIALITE 16, conférence, DEM Matéria-lité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le 27 avril 2012.
SEM MATERIALITE 16 – TRANSCRIPT DE LA CONFERENCEMatière et FormeConférence à l’ENSAL le 27 avril 2012© Arnaud de BUSSIERRE, avril 2012
"Dans l’histoire de la grande hauteur, ce qui s’est passé, ce sont plutôt les ingénieurs qui se sont accaparés cet univers-là. Et puis c’est un univers qui suit les crises économiques, qui montent et qui descendent. Et aujourd’hui, si on regarde la production, il y a des tours qui sont produites par les architectes et des tours qui sont directement construites par de l’ingénierie. Par exemple, vous avez deux grandes agences qui produisent de la tour avec des architectes intégrés ou qui viennent de temps en temps dans ces agences, c’est évidemment A.R.E.P. d’un côté et S.O.M. de l’autre. Et vous avez des tours qui sont, elles, directement gérées par les architectes, qui sont aujourd’hui des tours « objets ». Mais pour comprendre toute cette production il faut revenir à l’histoire des tours, et c’est ce que je vais essayer de faire.
Dans un premier temps, je vais faire une rapide présentation de ce qui se passe aujourd’hui autour des tours. Alors pour tout vous dire en ce qui concerne notre travail, aujourd’hui les tours représentent environ 70% de notre travail parce que ce qui concerne les grands projets a disparu. La pre-mière des choses dans l’histoire de la production des tours est qu’au départ, les tours sont faites pour faire de la
ville. Elles n›ont jamais été faites pour faire des objets comme c’est le cas ac-tuellement.
Historiquement la préoccupation des deux grandes villes qui ont produit des tours, la première étant Chicago avec la première École de Chicago, la deu-xième, c’est évidemment New-York. Sachant que toutes les tours de New-York ont d’abord été construites en fait, par l’École de Chicago. Et ça c’est une affaire culturelle. C’est en fait l’im-migration qui c’est faite, j’allais dire intelligente entre guillemets, au début du siècle, fin 19e, début 20e. L’intelli-gence, « l’Intelligencia », a immigré d’abord à Chicago, et c’était plutôt une immigration qui a donnée naissance à une classe de commerçant à New-York. Donc New-York ne faisait pas de tours. C’est Chicago qui a produit des tours. Ça c’est une première chose.
La deuxième chose, le contexte fon-cier est extrêmement important. On raconte toujours que la tour est née par ce que quelqu’un a inventé l’as-censeur, oui c’est vrai, mais ce n’est pas la première des raisons. Les vrais raisons sont en fait un foncier qui est très vite monté aux États-Unis à cause de ses problèmes d’immigration, et puis Chicago à cause de l’incendie de Chicago.
Pourquoi le foncier a défini les tours ? Il y a eu tout de suite des plans qui ont été fait quand les tours sont apparus, l’obligation était de respecter le foncier des maisons qui se trouvaient là. C›est-à-dire des petits immeubles et la seule
AAC058-7856
chose qu’on autorisait, c'était éven-tuellement, et si la tour le nécessitait et terme d’assise, c’était de prendre un ilot entier. Alors soit on prenait l'îlot entier, soit ont prenait l'îlot coupé en quatre mais il y avait des règles très précises pour faire ces tours. Donc j’al-lais dire que cet îlotage était déjà défi-ni. Le fait de faire de cette manière-là, les tours définissaient la ville. C›est-à-dire quand vous êtes à New-York, vous pouvez être en bas de l’Empire State, vous regardez, et bien l’Empire State descend au raz de la rue, et en fait, il définit la ville.
L’autre chose importante était que les tours suivent les crises économiques. Beaucoup de tours ont été abandon-nées en cours de chemin. Et comme elles étaient abandonnées il y a une autre loi, un autre code de l’urbanisme qui est apparu, plutôt à New-York qu’à Chicago, car la crise est plutôt apparue à New-York qu’à Chicago au départ, imposant que les 5, 6, 7 premiers niveaux aient une écriture urbaine. C›est-à-dire l’écriture d’un immeuble. Et puis vous avait une partie intermé-diaire et puis le haut où chacun écrit la partie haute de la tour. Parce que beaucoup de tours se sont arrêté à mi-chemin. En fait si vous regardez New-York vous avez des blocs entiers. Ces blocs entiers font 8 niveaux et vous n’avez plus rien. Et aujourd’hui dans New York, il y a une série de projets où il n’y a plus de place et on reprend les tours qui ont été coupées et l’on essaye de construire dessus. C’est ce que font Daniel Libeskind et Foster. Alors je montre ces deux images.
New-York et Hong Kong sont les deux pôles qui ont toujours eu des poli-tiques de tours, les deux villes qui on été construites à partir de tours. Je mets Chicago et New-York dans la même histoire. L’autre pôle c’est Hong Kong. Ce sont les deux seuls endroits où l’on trouve la définition de la ville générée par la tour. Cette position fait que les architectes ont un peu laissé de coté ces problèmes de tours, parce qu’ils estimaient que ce n’était pas des constructions qui étaient au départ, symbole de référence pour les archi-tectes. On va voir comment ça l’est devenu.
L’autre histoire aujourd’hui est que vous avez des villes comme Sydney ou comme Melbourne, un paquet de villes, qui on produit des tours, un petit peu épars, en fonction de la libération du foncier. Aujourd’hui, on définit les projets de tours que l’on va faire, on va dire à un architecte : « on va vous donner cet endroit-là par exemple mais vous devez faire un plan d’urba-nisme général pour occuper les autres sites potentiels par des formes ». Et on va voir les architectes faire leur projet et mettre à côté un certain nombre de formes. En général ils prennent un parallélogramme et ils le posent là, sur le site, pour voir comment pourraient renaître les villes sur la base des tours.
Et puis le critère des deux systèmes évidemment antinomique, New-York d’une part et Los Angeles d’autre part. J’ai pris celle-là tant que l’on est à Dubaï. C’est des tours et en bas de la tour il y a un cratère qui raconte une
AAC058-7857
histoire de place, qui raconte une his-toire totalement fausse par rapport à l’urbanisme. C’est Jean Nouvel sur la « Tour sans fin », c’est encore Jean Nouvel sur la tour Akbar. C›est-à-dire, on fait une tour, et en bas de la tour, on chasse la ville pour mettre en évidence la tour. Et bien évidemment, toutes ces tours ont des formes carrées, ovale etc. Et la tour est devenue aujourd’hui un véritable objet singulier qui ne fait ni la ville ni la densification.
De plus, avec l’histoire de monter de plus en plus haut, qui finalement crée un véritable problème, car les grandes hauteurs empêchent de créer de la ville. Donc Voilà l’exemple typique de la tour qui symbolise tout cela. Je fais un cratère, j’élimine tout le monde. Plus personne ne pourra venir autour et j’émerge du fond de la terre. On va expliquer que ce n’est pas rien d’émer-ger du fond de la terre, et on va s’aper-cevoir d’une autre chose, c’est que dans tous les discours sur les tours, le discours est assez light, j’allais dire primaire. C’est très rare de trouver un oral sur la tour qui est un véritable oral mettant en jeu les questions architec-turales. Vous avez donc des exemples comme Shanghai qui est l’exemple type de l’occupation. Premièrement, on va occuper le front et donc là c’est les miteux, les « sans grades » qui sont mis ici et qui regardent évidemment les grandes vedettes se mettre en scène au milieu. Il n’y a pas plus caricatural que ce système-là de tour. C’est le système qui continu de prévaloir à Dubaï, en Chine, un peu moins maintenant. Mais chacun met son objet, qui un décapsu-
leur, qui de la tour Perle, qui du plagiat de tour de New York comme l’Empire State par exemple.
Autre présentation ici, vous avez un plan urbain qui commence à définir les choses, on se met en bordure, on va aligner, puis autour on va attendre les grands projets. Et c’est tout à fait récemment que les choses ont chan-gées. Les permis de construire qui sont délivrés sont des permis de construc-teurs. Personne ne regarde la tour qui est faite. C’est depuis deux, trois ans que les pays des émirats ont commen-cés à dire stop, on ne peut pas laisser faire ces systèmes de tours qui ne sym-bolisent plus rien du tout. On com-mence donc à voir des tours qui ont une certaine réflexion architecturale, mais toujours plus dans la forme que dans le contenu. C’est qui ce passe à Dubaï, à ce niveau-là quand passe une couche de nuages, c’est exactement ce qui se passe au niveau du sol. Au sol, vous avez exactement la même figure, c›est-à-dire des blocs qui sont construits de cette manière. La chose la plus évidente est qu’il y a tout un travail sur les hauts de tours plus que sur les pieds de tours. On va expliquer pourquoi. Ensuite, dans ce système de typologie, c’est l’école de Los Angeles notamment, la côte Ouest des Etats-Unis : « Comment occuper un îlot ? »
Comme l’on n›a pas de foncier pour occuper cet îlot en termes de com-merce ou autre, on construit de cette manière-là une tour et puis à la traîne les petits bébés tours. Et ça, c’est un petit peu nouveau, c’est dû au fait qu’il
AAC058-7858
y a une imposition d’occuper un îlot. Ce sont des configurations que l’on va retrouver.
Autre sujet posé par les tours, c’est un sujet qui relève de la science-fiction. Les tours suggèrent les circulations ver-ticales et toutes les circulations se font à l›horizontale. Une série de concours sont lancés et vous voyez celui-ci dans lequel on va re-liaisonner les tours en hauteur. Pour le moment, ce sont des concours qui peuvent paraître de l’utopie, ou de la science-fiction. Mais en fait, pas du tout, il y a de véritables programmes qui sont des programmes annexes. Par exemple dans cette co-lonne-là, ce ne sont pas des colonnes de circulation mais vous aller avoir des logements, des écoles, des crèches, des jardins.
Il y a donc toute une série de concours qui sont lancés, notamment à New York, on ne sait pas ce qui va se faire ou pas, mais sur lesquels il y a ce type de programmation. J’ai parlé de New-York, vous avez là un exemple par-fait avec la tour Earth de Foster, de ce qui était au départ juste avant la crise de 29. Une tour était prévue ici. Elle était définie sur 5 ou 6 niveaux, avec un véritable travail de façades urbaines, de telle manière que si la tour ne se faisait pas, on n›avait pas une tour complètement arrêtée. Je vais vous montrer des exemples de tours à New-York. Après la crise, les gens de-vaient reprendre la construction, bien évidemment cela ne s’est jamais fait parce que les propriétaires avaient disparus, les locaux avaient été loués.
Paradoxalement, ces tours ont été construites avec des éléments structu-raux qui devaient permettre l’élévation ; sauf qu›aujourd’hui, on ne construit plus du tout de la même manière. Et par exemple, lorsque Foster construit ce bâtiment, tout cela va devenir un énorme hall d’accueil et la structure de la tour va passer au travers et l’on va avoir deux systèmes de fondation com-plètement différents.
En général, tous ces éléments (les pieds de tours) sont devenus des halls, vous voyez ici un autre exemple, de Da-niel Libeskind, ici Herzog et de Meuron. On voit donc ces systèmes de tours qui viennent s›implanter en plein milieu de socles existants.
Toutes les tours que vous voyez sont déjà en retard en regard de la théorie des tours. En effet, grâce à l’informa-tique ou à cause de l›informatique, on va dire presque malheureusement, vous avez toute une théorie qui s’est faite sur « comment s’élever ». Vous avez alors différentes théories : la théorie de la tresse, la théorie de l’em-pilement, la théorie de la pixellisation. Ce sont toutes des théories sur les-quelles les architectes travaillent pour construire la grande hauteur.
J’ai mis ici un exemple de la pixellisa-tion. Je peux vous montrer beaucoup de projets. Mais il faut savoir que ces théories sont couplées avec des théo-ries structurelles. Par exemple, le tres-sage va permettre d’avoir une struc-ture globale de la tour, c›est-à-dire de quitter les conceptions à noyau por-
AAC058-7859
teur, ou même d›autres conceptions qui sont avec des noyaux porteurs faibles, et l’on est porté par la péri-phérie. Aujourd’hui, on essaie de cher-cher est une tour où la structure soit génératrice de l’espace. Je montre ces quelques exemples plus liés à la struc-ture.
Comment la structure a été, dans l’his-toire de la tour, chassée à l’extérieur ?
Au départ vous aviez un noyau en bé-ton, et une construction périphérique, en général en acier. La stabilisation de l’acier était complètement faite par le noyau intérieur d’où des pertes en ligne en matière de mètres carrés.
Ensuite de cela, on a réduit les noyaux et est apparu en extérieur des sys-tèmes de treillis.
Ensuite on a diminué les noyaux, on a fait des systèmes à façade à tubes, comme le World Trade Center par exemple, avec des noyaux de plus en plus réduits.
Aujourd’hui, on porte tout par l’exté-rieur et l’on se sert de la partie inté-rieure comme un noyau creux pour des systèmes de fonctionnement bioclima-tiques. On fait faire aux étudiants des exercices de stabilité, justement en passant de l’intérieur vers l’extérieur. Et puis vous avez tous les systèmes d’empilement avec cette fascination qu’ont les architectes aujourd’hui.
Je voulais parler de ce livre excellent qui s’appelle « Architecture Numé-
rique » d’Antoine PICON-LEFEBVRE. Il faut que vous relisiez ce livre très intéressant, qui explique comment l’outil informatique a permis à l’archi-tecte d’engendrer des formes pour des formes. Les premiers à utiliser cet outil sont les architectes qui se sont occupé de conception de tours. On regarde actuellement des systèmes qui ont des noyaux de structure que l’on va liaison-ner entre eux. Chacun de ces noyaux devenant une cellule d’espace de plu-sieurs étages, cela permet d’organiser toutes les circulations de fluides, qui sont le gros problème des tours. Cette solution permet d’organiser les fluides dans les interstices entre noyaux, qui sont donc des noyaux auto-stables. Ce sont des projets écoles pour l’instant, mais on commence à voir un certain nombre de projets qui sont conçus de cette manière-là. On peut donc dire qu’aujourd’hui, les tours sont en train de changer d’optique de façon structu-relle, et cela va évidemment changer toutes les notions d’espace que l’on avait dans les tours.
Voilà quelques exemples de tours, ici la tresse. Je présente cet exemple pour essayer de montrer qu›évidemment tout ce qui se passe à la verticale, on le voit ici, se retrouve dans le fonction-nement structurel des planchers. C’est fini le plancher avec simplement une poutre, ou poutrelles et hourdis, ou tout ce que vous voulez. On va cher-cher des planchers nervurés et l’outil informatique nous permet de calculer en fonction de la hauteur, la manière dont on va nervurer les planchers selon les mouvements de la tour.
AAC058-7860
Et puis toutes les symboliques …
Ici un projet de Zaha Hadid, La bouteille de Klein, enfin bref, tous les écueils for-mels mais qui dans le même temps ne sont pas des écueils d’un point de vue structurel.
Alors pourquoi l’on parle d’utopies et de réalité ?
Depuis très longtemps les tours se jus-tifient par des gadgets, comme le fait que la tour produise sa propre énergie et distribue de l’énergie aux autres etc … C’est en réalité quelque chose d’en-tièrement faux. On a fait des études là-dessus, si l’on veut que la tour produise un minimum d’énergie pour ne serait-ce qu’un ilot, il faut que la tour entière soit vouée à la récupération d’eau, soit voué à la production de l’énergie par l’éolien, ou par le panneau solaire. Il y aujourd’hui des études qui sont faites, je crois que j’en ai montré quelques une. Voilà par exemple un projet où les tours ne sont que des machines à pro-duire de l’énergie, c’est ce que l’on ap-pelle des tours génératrices. Quand on dit aujourd’hui qu’une tour va produire ceci et cela et que tout le monde va être heureux, c’est totalement faux ! Une tour pour elle-même est énormé-ment consommatrice d’énergie !
Ici un exemple dans le cadre de l’uto-pie, une tour où l’on habite sous terre. Et ça c’est pour le pont habité. Je vais passer là-dessus…
Autre point qui devient aujourd’hui important, on parle toujours de la tour
en milieu urbain, et chose plus inquié-tante, qui d’ailleurs a été lancé par Jean Nouvel, c’est la tour paumé en pleine nature. Avec des espèces de dis-cours sur l’analogie qui pourrait être faite avec le site. Alors, sachez qu›au Mexique, il y a deux ou trois projets qui étaient presque sur le point d’être réalisés dans des contextes analogues, c›est-à-dire les tours mises en pleine nature !
Je vais juste faire un petit rappel sur le mythe de la tour de Babel. Ce mythe vous le connaissez tous, c’est Nemrod qui récupère tous les gens de l’Arche de Noé, qui sont paumés. Il va construire une tour, et Dieu qui n’est pas très content de voir les hommes s’élever jusqu›à lui, souffle sur cette tour. Les hommes sont tombés et non jamais pu construire en hauteur et de ce fait ont perdu le langage commun. Le mot jargon vient de là. Une fois que les hommes eurent perdu le langage com-mun, chacune des corporations qui construisait la tour, parlait son propre langage et parlant son propre langage, n’était pas comprise, les ouvriers ne comprenaient pas ce que disaient les ingénieurs, etc… du coup cela empê-chait la tour d’être construite…Ça c’est la petite histoire.
Il y a une histoire qui est plus réelle que cela, les tours sont nées d’une énorme superstition. Qu’était-il fait en haut de la tour ? Il y avait deux conceptions de cela. Une conception que l’on retrouve avec tous les émi-grants qui sont arrivés en Amérique du nord : la conception « des Irlandais
AAC058-7861
catholiques », et une autre conception des Protestants. Alors cette concep-tion était la suivante. Je simplifie, pour le protestant en haut de la tour, les hommes devaient installer un temple qui devait dire à Dieu de ne pas s’éner-ver, et il y a des textes où il est dit que le temple est occupé par une femme nue dans un lit. Mais c’était l’idée du temple. Et au contraire, des tours où le haut était un lieu de recueillement, on devait donc y construire quelque chose lié à la référence de la cathédrale.
Si vous regardez Chicago, je vais faire vite un bref aperçu sur Chicago, on va retrouver exactement les mêmes choses. Allez voir les terminaisons des gratte-ciel de Chicago, vous aurez la théorie du temple et la théorie de la cathédrale, au mimétisme près.
Autre chose qui est peut-être anecdo-tique, est que dans un certain nombre de textes, la tour nait de l’apocalypse. C›est-à-dire qu’il y a eu l’apocalypse et que l’on va construire une nouvelle ville. Avec un certain nombre de réfé-rences bibliques que l’on va « se trai-ner » dans toute l’École de Chicago, pas simplement de manière théorique mais d’une manière assez complexe.
Chicago a été construite suite à un incendie que l’on connaît tous, et l’on devait construire San Francisco sur le même schéma directeur que Chicago. Au moment où le plan directeur a été établi, avec les mêmes architectes, on va le voir, il y a eu un énorme incen-die qui s›est déclaré à San Francisco. San Francisco y a vu un présage abso-
lument catastrophique, que tous les tours allaient s’effondrer, on a alors tout arrêté, sachant que le plan direc-teur devait en faire une ville encore plus densifiée en tour que New York. Ce plan ne s›est pas réalisé unique-ment à cause de cela.
Je vais aborder l’École de Chicago.
Un énorme incendie en 1871. Je passe sur les origines de cet incendie, mais il y a quand même des espèces de symboles qui sont fait à l’époque, sur Chicago en feu et sur le feu qui est en-voyé du ciel : voilà comment est repré-senté Chicago.
Le plan directeur de Chicago est assez compliqué parce qu’en réalité, une foi qu’il y a eu cet incendie, il y a une toute une politique d’expropriation, dont je passe les détails, un certain nombre de promoteurs ont acheté des empreintes des anciens bâtiments qui ce trouve là. Il y a eu un foncier qui était coupé par un quadrillage et dans le foncier et dans le quadrillage vous aviez quelqu’un qui possédait, là pour le coup en pixellisation, sur un îlot, tel cube et tel cube. La naissance des tours de Chicago a commencé par une énorme tractation sur le foncier pour que quelqu’un puisse retrouver un îlot complet.
Donc il y a eu ça, et bien évidemment cela précède l’incendie et l’arrivée de l’ascenseur qui a fait que l’on a pu s’élever. On s›est levé d’une assez mauvaise manière, car on s›est levé d’une manière assez classique. Ce type
AAC058-7862
d’élévation interdisait d’avoir de la grande hauteur. Le Home Insurance buildings est considéré comme le père de la grande hauteur. Le Baron Jenney va être le fondateur des bâtiments de grandes hauteurs. Tout de suite est ar-rivé l’histoire de la construction métal-lique. Il y avait des délais extrêmement cour, il y a eu des concours purement constructif. Comment pouvait-on trou-ver un moyen de construire, un, très rapidement, deux, de construire par un système constructif qui puisse être pro-tégé du feu. Les premiers gratte-ciels sont donc nés d’un concours d’idées d’ingénieur.
Vous avez donc ici les réponses, vous construisez mais avant on définit un système constructif. En voilà un qui est venu d’un système relativement classique, charpente métallique, une protection au feu sur les poutres, un plancher évidemment en dur et systé-matiquement des façades en pierres. Les façades en pierres ont deux rai-sons. La première était la protection de l’incendie par l’intérieur du bâtiment, la deuxième était l’incendie qui pou-vait arriver par l’extérieur. De plus, une résistance quasiment viscérale contre la construction en acier.
C’est seulement Sullivan qui va com-mencer à écrire quelque chose qui aura une écriture d’enveloppe qui cor-respondra à la structure du bâtiment. Tous les bâtiments vont être construits de la même manière, c›est-à-dire un système de poteau poutre.
L’autre chose qui est devenue inté-
ressante du point de vue constructif, est comment les éléments sont tenus. Vous voyez que chacun des éléments est porté de niveau à niveau, même peut être trois fois sur le même niveau, mais on n’est pas encore dans un sys-tème de façade qui va être un système suspendu. On est dans des systèmes posés et pour la petite histoire, il a fallu, pour pouvoir construire ces sys-tèmes posés, changer les systèmes de joint entre les parements qui ont été remis au point. La tour était déjà un la-boratoire de mise au point d’un certain nombre de conceptions techniques. Beaucoup de ces gratte-ciels ont dis-paru pour permettre de construire de nouveau gratte-ciels plus hauts. On considère que le plus ancien bâtiment à charpente d’acier date de 1892.
Daniel Gram va faire le plan directeur de Chicago, le Baron Genet étant plu-tôt celui qui a trouvé le système et la technique du bâtiment. Il va faire tout le plan directeur et aussi celui de San Francisco.
Il reste un sujet que je n’ai pas encore abordé : les histoires de règle d’urba-nisme.
C’est Chicago qui va inventer l’idée du socle de la partie central de la tour et du haut de la tour, avec systématique-ment des références prises à l’archi-tecture classique. Dans l’organisation des agences d’architecture, il y avait de l’ingénierie bien sûr, mais l’un des postes les plus importants dans les agences, était le sculpteur. Vous aviez des ateliers de sculpture dans lequel
AAC058-7863
vous aviez des commanditaires qui disaient : « moi ce n’est pas le temple c’est plutôt la cathédrale ». Des bâti-ments sont de véritables copier-coller du haut de la cathédrale de Rouen ou des espèces de mélanges pris un petit peu à Milan et un peu à Rouen.
Si Rouen a beaucoup servi de modèle, c’est parce que c’est la première ca-thédrale qu’ils voyaient en arrivant en France, avec Notre-Dame de Paris.
L’autre typologie était la typologie du temple. Quand vous regardez le sommet des tours vous pouvez savoir l’appartenance religieuse du comman-ditaire. Cette histoire d’imitation est assez curieuse car historiquement ils ont commencé à prendre les cathé-drales et au fur et à mesure, Chicago va prendre les cathédrales.
New York va reprendre les cathédrales mais ira encore plus loin, les com-manditaires vont commencer par re-prendre tous les systèmes de représen-tations de chapiteau en les recopiant sur le gothique ou sur la renaissance. A l’intérieur d’un certain nombre de gratte ciel de New-York, que l’on ne trouve pas à Chicago, vous avez une réplique complète de chapiteaux d’édi-fice religieux français et Italien.
Le Flat Iron, tout le monde le connaît, est le premier bâtiment construit par l’École de Chicago à New York. Time square, voilà le bâtiment qui a été dés-habillé et puis le voilà aujourd’hui. Sur la Tribute Tower à l’intérieur et sur les façades il y a des éléments qui ont été
volés à Notre-Dame de Paris, qui sont mis dans la tour, et notifier. Il y a des éléments qui ont été pris sur les World Trade Center et qui ont été intégré. Il y a même des choses qui ont été pillées à Venise, et qui sont notifiés comme trophée. Alors voilà pour l’École de Chicago.
Quand je dis que les tours on suivit à peu près cette espèce de référent à l’histoire de l’architecture en Europe, on est passé de la tour gothique avec des finitions plus ou moins classique, puis à l’Art Déco, puis l’Art nouveau que l’on va d›abord retrouver à New-York et qui va revenir ensuite à Chica-go. On va se rendre compte qu’il y a toujours les trois parties, mais évidem-ment aujourd’hui, les références au religieux sont complètement effacées. C’est simplement à partir de 1930 que la tour va s’affranchir de cette réfé-rence et de cette peur de monter en hauteur.
Philosophiquement, le fait d’accepter de monter en hauteur, c’est s’affran-chir d’avoir des édifices religieux en hauts des tours qui n’étaient jamais occupés.
Suite à cela, la tour a généré sa contre-école. Sullivan va être le maître de Chicago, fin des tours, jusqu›à ce que l’on attende la deuxième École de Chicago qui va être faite par les gens du Bauhaus, Mies, Gropius et toute la suite.
Entre les deux, on a Sullivan qui lui est le premier à poser la question de
AAC058-7864
l’architecture dans la tour, non pas en termes décoratifs, mais un véritable processus conceptuel de la tour et de son espace intérieur. C’est lui qui va commencer à dire que le problème de la tour n’est pas la grande hauteur, mais plutôt son organisation. On ne cherche plus à faire de la grande hau-teur, on cherche à faire de l’architec-ture des espaces intérieures etc…
L’élève de Sullivan, Frank Lord Wright qui toute sa vie, même si l’on peut considérer la Johnson Wax comme une Tour, aura une répulsion de la tour, va être l’initiateur de l’école de la prairie.
L’école de la prairie est le contre-pied et va sonner le glas de la première École de Chicago. Sullivan est le premier à travailler des éléments de parement extérieurs, on ici voit des éléments répétitifs. C’est quelqu›un qui est très préoccupé par les problèmes d’orne-mentation, je dis bien ornementation. C’est la première façade qui va être faite avec des habillages rapportés et qui vont être suspendus de niveau à niveau. Je parle simplement de la tech-nique de parement. Sullivan sera le premier également, à faire apparaître la typologie structurelle en façade, il le fera petit à petit. On retrouve assez souvent le système cadre et poteau-poutre et au final un de ces derniers bâtiments, la façade apparaît comme un système de poteau poutre."
Bibliographie:
PICON-LEFEBVRE Antoine, Architecture numé-rique
AAC058-7865
ANNEXE 03 - ÉTUDES M1
source livret LIN - Grand Paris
Grand Paris
Métropole Douce
«vers une métropole douce»
. Pertinence de vision spatiale de la métropole post-Kyoto
. Écologie et réappropriation du fleuve. Principe d’intensification urbaine et
paysagère. Mobilité graduée
. Application des différents axes aux Lônes et coteaux du Rhône
AAC058-7866
POULET, Olivier, 2011 : Étude sur le Grand Paris, Travaux d'étude de cas, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon.
Grand Paris – Équipe LIN – 18/11/2011 O. Poulet
Ce travail d’analyse des dossiers présentés dans le cadre de la consultation du Grand Paris a été commencé sous l’angle économique et social, thème actuellement traité par notre groupe. Il m’est apparu que les équipes NOUVEL, STUDIO 09 n’abordent pas la question économique, MRDV met en avant un outil magique, effrayant pour modeler la ville de demain. Enfin ROGERS propose dix principes proches des « dix commandements ».
L’équipe LIN a une vision intéressante sur les deux thèmes précités et propose une méthode pragmatique. Elle prône une métropole douce, accompagnée d’une démarche qui s’apparente moins au master plan qu’a une multitude de situation-maquettes pour illustrer le propos, c’est vers elle que ce porte mon choix. Cette méthode semble applicable au site des Lônes et Coteaux du Rhône et porte sur les différents axes ci-après.
Pertinence de vision spatiale de la métropole post-Kyoto :L’organisation spatiale actuelle de la métropole parisienne est radiocentrique, tout converge vers le centre, l’évolution du système est bloqué, le rendant incapables d’accueillir 13 M. de personnes en 2030. L’équipe LIN émet une hypothèse : le modèle spatial de la métropole post-Kyoto sera polynucléaire, composée de « villes intenses » et de « villes
légères » reliées par des macro/micro mobilités.Écologie et réappropriation dufleuve :Aujourd’hui, l’urgence est connue, l’idée est la gestion de la résilience. Le pari est de rendre la région et ses habitants capables de gérer les futurs changements. La résilience étant définie comme la capacité d’un système à résister aux chocs tout en conservant ses fonctions, structures, réactions et son identité. Les chocs peuvent être d’ordres écologiques ou sociaux.
Les raisons d’une résilience amoindrie sont dues à la surexploitation des sols (ex: inondations importantes dues à l’imperméabilité des sols, au drainage artificiel, et canalisation des rivières) et à une baisse du niveau d’éducation.
Pour une résilience optimum, LIN imagine des Paysages multifonctionnels qui englobent l’aspect résidentiel, la rétention des eaux, la production alimentaire, la conservation de la biodiversité et la production alimentaire. La diversité des services d’un site est supposée renforcer les performances de l’ensemble du système social et écologique.
Pour obtenir un paysage multifonctionnel fondé sur la fluvialité, il faut principalement :
-améliorer la qualité de l’eau (redy-namiser le territoire grâce aux aires de baignades). Cela passe nécessairement par le
AAC058-7867
traitement des eaux usées et l’auto purification de l’eau.
-aménager des berges par des ac-tions permettant d’éviter le ruissellement et l’érosion (décana-lisation, désendiguement, zones humides).
-fournir l’énergie nécessaire à ce regain d’activité en installant des turbines hydroélectriques en fond du lit du fleuve(évitant un barrage)
-redonner au fleuve sa capacité autonettoyante et autogénérative pour faire naître des paysages iné-dits.
Le concept de Seine Parc met en œuvre les principes ci-dessus et englobe l’ensemble des fleuves et rivières de la métropole parisienne.
Principe d’intensification urbaine et paysagère:Les grandes plates-formes de mobilité constituent autant de germes pour développer des polarités fortes, des « villes intenses ». Ces villes sont des repères pérennes pour l’ensemble de la métropole. Les tissus intermédiaires, perçu aujourd’hui comme banlieue se transforme en « villes légères » de faible densité et très paysagère. On y trouve logements, PME, écoles, commerces, services et micro-mobilité. C’est le lieu de l’agriculture urbaine. Les grands ensembles seront densifier et intégrer de fait aux villes légères.
AAC058-7875
Source EUROPAN 10, BE009, Gembloux Belgique, Regarder à travers
Source EUROPAN 10, MD902, Liège Belgique, Oasis urbaine.
AAC058-7876
POULET, Olivier, 2012 : Thèmes MIXITÉ, PAYSAGE et MOBILITÉ dans les Europan 05,09 et 10, Travaux d'étude de cas, DEM Matérialité, École Nationale Supé-rieure d'Architecture de Lyon.
Analyse Europan 27/01/2012 - O. Poulet Cet exercice d’analyse Europan représente un début de synthèse entre le diagnostic réalisé dans le cadre du projet urbano-architectural et le projet architectural en lui-même. Lyon crée un nouveau quartier hi-tech sur le site de la confluence, doublant la surface de son hypercentre.Le secteur de travail se situe dans la balme de St Foy les lyons, dernier vide urbain de la ville, une sorte de fond de scène pour ce nouveau quartier.Le contraste et la proximité de deux entités est saisissant et donne matière à projet. La conclusion du diagnostic interroge la mobilité sous l’angle d’un métro lancé depuis le nouveau pôle multimodal de la Confluence, comme élément déclenchant d’une nouvelle intensité urbaine.St Foy se démarque par une nette gentrification de sa population. Le site est remarquable par sa topographie en balcon sur l’agglomération lyonnaise. Le point d’impact envisagé se situe entre la centralité historique de St Foy et le fort, tout en gardant à l’esprit une relation avec la Saône. J’imagine y créer un éco-quartier sans voiture.Je choisi d’illustrer trois thèmes par deux projets Europan chacun :-Mixité – Typologie d’habitat-Paysage / Habiter la nature – Relation ville /nature-MobilitéJ’ai choisi les Europan 5,9 et 10 pour le lien qu’ils évoquent en regard des enjeux et thématiques du site de St Foy.
Europan 05 aborde les questions de nature et habitat, du déplacement et de l’accessibilité résidentielle.Europan 09 aborde les réseaux en mouvement.Europan 10 traite du thème de la régénération de site où la question principale de développement se pose dans les termes suivant : comment adapter les espaces aux nouvelles dynamiques d’usage dans des secteurs à fortes identités, mais avec des fonctions obsolètes ?
MIXITE – Typologie d’habitat :
MD 902 - europan 10 : oasis urbaine à Liège en BelgiqueCe projet traite la régénération d’un site par une reconversion programmatique.Recréer un ilot dans un délaissé industriel, connexe et conforme à un bâti constitué voisin, en créant rue, place, patio, jardin et différente typologies d’habitat.Cette approche pertinente me semble applicable au site de St Foy constitué d’un tissus lâche d’immeubles collectifs, à l’intérieur du quel j’imagine recréer différents ilots.
BE 009 – europan 10 : regarder à travers à Gembloux en BelgiqueCe projet traite de la régénération par une reconversion programmatique du parc d’une maison forte au milieu de la ville. Souligner les symboles de la ville, établir un dialogue fort entre le nouveau pôle communal et le contexte, en imaginant les symboles comme extension du projet.Les points de vue sur les symboles fragmentent le nouveau centre
AAC058-7877
Source EUROPAN 09, AN109, Ardenne Belgique, Anamorphose du paysage
Source EUROPAN 10, ZY987, La Chaux-de-fonds Suisse, Remonte Pente
AAC058-7878
municipal.St Foy comporte de nombreux éléments architecturaux remarquables tels que le fort, les édifices religieux et les villas florentines qui pourraient être mis en valeur par ce principe.
PAYSAGE / HABITER LA NATURE – Relation ville /nature :
ZY 987 – europan 10 : Remonte pente à la Chaud de fond en SuisseCe projet traite la colonisation d’un site en créant une nouvelle communauté. Il se situe dans au milieu d’une forêt et dans la pente àproximité d’une gare de chemin de fer. La combinaison astucieuse de blocs d’habitat disposés sur un parking/rampe sous-terrain reprenant le thème du rocher autorise des liaisons modes doux dans la pente. Les caractéristiques topographiques du site de St Foy sont très comparables.
XX 000 – europan 10 : Connex(cité) à la Sainte en FranceCe projet traite de la régénération par une mutation paysagère d’un site urbain. Il s’agit d’interconnecter visuellement les éléments de patrimoine remarquables de la ville, par l’intermédiaire d’un pôle culturel, sorte de belvédère ouvert sur la ville avec un nouvel éco-quartier. Je ne peux m’empêcher de faire le rapprochement avec le site de St Foy qui de par sa situation, est un véritable balcon sur la ville de Lyon entouré d’éléments remarquables.
MOBILITE
PORT 015 – europan 05 : Proceed by level
à Vila nova de gaia (Porto) au PortugalLe site jouxte le pont Dom-Luis d’un disciple d’Eiffel sur le quel passe une nouvelle ligne de métro.La topographie est très marquée. La similitude avec la situation du site de St Foy est frappante.C’est un projet d’habitat dense posé dans la pente afin préserver la morphologie géologique.
AN 109 – europan 09 : Anamorphose du paysage à Ardenne en BelgiqueCe projet traite des réseaux en mouvements ayant un effet de polarisation.En regard des différentes échelles locales et territoriales, le projet propose une déformation visuelle et temporelle du paysage (anamorphose) : un jeu du paysage en fonction du déplacement de l’observateur sur la voie de circulation proche, généré entre les constructions. Des jardins privatifs en liaison directe avec les logements et des jardins en cœur d’ilots mis en rapport avec le paysage lointain génèrent des terrasses sur le paysage et des jardins sylvestres. Cette idée est applicables au site de St Foy comme aux balmes à mi-pente.
AAC058-7879
ANNEXE 04 - LECTURES M1
MONGEREAU, Noêl, 2001 : Géologie de Lyon, Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire
AAC058-7880
La prévention des risques naturels est un des enjeux majeurs de la Ville de Lyon. Le risque lié au terrain nécessite une connaissance géologique.
A grande échelle la région lyonnaise se situe au sein du fossé d’effondrement rhodanien. Le site de Lyon est caractérisé par le lit du Rhône (cote moyenne 160), des collines à l’Ouest et la Plaine à L’est.
Les ressources du sol :-les minerais sont en trop faible quantité pour être exploités-la nappe est superficielle et ne permet pas la géothermie-la houille pourrait être exploitée avec une gazéification in situe
La géologie, les coupes permettent d’indiquer :-la colline de Fourvière se compose de bas en haut: (cote 300) . socle cristallin (granitique) . molasse marine . dépôts marins (argileux) . conglomérats et graviers . moraine du glacier wurmien argilo-sableuse . loess localement recouvert d’éboulis ou de remblais-la colline de la Croix Rousse se compose de bas en haut:(cote 250) . socle cristallin (granitique) . sédiments tertiaires . alluvions d’origine glacière ou fluvio-glaciaire-en bordure du rivage, le long du Massif Central (balmes): . sables calcaires consolidés en molasse et d’origine alpine-la plaine de Lyon :
. molasse . alluvions sur 20 à 50 m. d’épaisseur
En résumé:-Plateau lyonnais constitué de terrains granitiques ou gneissiques.-Mont d’Or lyonnais constitué essentiellement de terrains d’âge secondaire.-Collines de la Croix-Rousse et de Fourvière à ossature granitique et couverture molassique et morainique.-Presqu’île entre Saône et Rhône constituée d’alluvions ou de remblais pour la partie la plus au sud.-Plaine de Lyon constituée d’alluvions
L’eau dans les formations :-La géologie et l’hydrogéologie des collines donnent lieu à des circulations d’eau et expliquent le risque de mouvement de terrain.-Plaine de Lyon: . molasse: ce matériau renferme une nappe aquifère puissante (réservoir molassique) . alluvions fluviatiles sur 20 à 50 m: contient une nappe présentant de nombreuses variations. Possibilité de forage mais peu d’étude encore actuellement. La molasse est hétérogène dans sa composition (sable argile) et sa texture (perméabilités diverses).-Les bordures (les balmes) ont été façonnées par les eaux de ruissellement pour créer des versants plus ou moins abrupts pouvant atteindre 40 à 100m.
Rôle de la commission des balmes :Dès l’origine les habitations ont été construites sur les plateaux des collines et les rebords. Diverses galeries ont été
MONGEREAU, Noêl, 2001 : Géologie de Lyon, Editions Lyonnaises d'Art et d'His-toire
AAC058-7881
construites pour permettre l’alimentation en eau en captant les venues d’eau observée en surface, dont 40km sont reconnus et entretenus. Avec la conjonction de ces deux phénomènes, les balmes ont progressivement été affectées par des mouvements de terrain :-840 : chute d’une partie du forum romain, après de fortes pluies-Début XVI : glissement de terrain suite à un tremblement de terre-1795 : effondrements de maisons-1930 : éboulement quartier St Jean-1932 : éboulement cours d’Herbouville (Caluire et Cuire)-1935 : éboulement au droit du 113 rue St Georges-1977 : effondrement d’un immeuble 14 cours d’Herbouville (Lyon)-1981 : effondrement d’un mur lors de la démolition de l’immeuble du 14 cours d’Herbouville (Lyon)
La commission des balmes a été mise en place pour étudier les risques d’éboulement suite aux mouvements de terrains. Les murs de soutènement sont finalement dangereux. La pluviométrie est une donnée importante pour les différents éboulements. Sur les collines l’eau de pluie est stockée temporairement et ruisselle en profondeur ou en bordure. Peut-on prévenir le risque d’éboulement ? L’auteur pense que l’on ne peut qu’essayer de réduire les risques.
Conclusion :La constitution géologique des balmes lyonnaises entraîne des risques
d’éboulement périodiques. Désendiguer et décanaliser le Rhône ou la Saône augmenterait ce risque par effet d’érosion. Cette idée semble donc inappropriée contrairement à ce que je pouvais l’imaginé après étude du projet de l’équipe LIN pour le Grand Paris.
Nota étymologique :Balme : vient du gaulois balma qui signifie « grotte d’ermite ». Les falaises et/ou parois abruptes des vallées étaient souvent creusées de cavernes de dissolution servant d’abris ; le nom de « balme » a ensuite été appliqué à l’ensemble du versant.Il est intéressant de noter que les noms des villes périphériques de Lyon ont souvent une étymologie se rapportant à l’eau :-L’Arbresle, Tarare : « ar » signifie eau en pré-celtique-St Cyr au Mont d’Or : « dor » signifie eau en Celtes-Eveux sur l’Arbresle, …, de même que Evire, Evian (Haute-Savoie) : « ewe » signifie eau en vieux latin
Bibliographie :
ROUSSET, Paul-Louis, 1988 : Les Alpes et leurs noms de lieux , 444 pages
AAC058-7883
Le DVD aborde les thèmes suivants :-Lyon souterrain-Traboules du Vieux-Lyon -Parc de la Tête d’Or - les 4 Saisons -Fête des Lumières - 8 Décembre -Les premiers films des Frères Lumière -Guignol-Les spécialités de Lyon -Musée Gallo-Romain -Lions à Lyon -Lyon, la nuit-Gravures anciennes -Lyon XIX e -Lyon sous la neige -Fourvière insolite -Horloge astronomique de Saint-Jean
Lyon est une ville double, elle est entourée de deux collines (Fourvière et la Croix-Rousse) et de deux « fleuves » (le Rhône et la Saône qui est une rivière).
-44 av JC : mort de Jules César, fondation de Lugdunum qui vient du latin « lug » (corbeau) et « num » (colline), car un vol de corbeau aurait survolé le site ce jour-là.
Au 2eme siècle, Lugdunum atteint son apogée avec 50000 habitants. Ecritures des tables Claudiennes par l’empereur Claude.4 aqueducs apportent l’eau à cette capitale.
117 : le christianisme arrive d’orient et rencontre des difficultés avec les Romains. Les Chrétiens seront persécutés. St Blandine sera donnée aux lions dans l’amphithéâtre de Fourvière, ils refuseront de la dévorer.
La chute de l’empire romain entraine la fin de Lugdunum, les populations se regrouperont alors autours de la Saône au pied de la colline de « Fourvière », nom donné en souvenir du vieux forum.
472 : l’installation des barbares de Burgonde marque la fin de l’antiquité.
Au moyen-âge, Lyon devient le primat des Gaules.
Du 12eme au 14eme siècle : construction de la cathédrale St Jean, à l’intérieur de laquelle on trouve la « main qui soigne » et la plus vieille horloge astronomique du monde (14eme siècle, on croit à cette époque que le soleil tourne autour de la terre).La plus vieille église de Lyon est St Martin d’Ainay. St Nizier est l’église des marchands avec les statuts de St Pierre et St Paul, les martyres lyonnais seront surnommés les « vaudois ».
1463 : Lyon est une ville prospère où il y a 4 foires annuelles. Lyon est située sur la route de la soie et devient la capitale de la soie. Les traboules (du latin « transambulare » : passer à travers) permettent de traverser un ilot d’immeuble en étant à l’abri. On leurs attribue pour Lyon le statut de ville secrète.
1831 : révolte des canuts.
1852 : Fête du 8 Décembre pour l’inauguration de la vierge dorée et
SALES, Christian, Lyon secrets et légendes, DVD 182 minutes
AAC058-7885
crue de la Saône.
1856 : création du Parc de la Tête d’or par le paysagiste Büller. On donne deux explications à ce nom : une tête de christ en or aurait été enfouie sur les lieux (anciens marais) ou la tête d’un voleur venant de dévaliser la cathédrale St Jean ce serait transformée en or au moment de sa décapitation à l’épée.
1870 : construction de la cathédrale de Fourvière.
1874 : construction de la tour métallique en contrebas de la cathédrale de Fourvière, elle est la réplique du 3eme étage de la tour Eiffel.
28 Décembre 1895 : projection du 1er film par les frères Lumière : « l’arroseur arrosé », le gouter de bébé » et « l’arrivée du train dans la gare de la Ciotat ».
Fin 19eme : Tony Garnier rêve d’une cité idéale.
Après la première guerre mondiale, il construit sous l’impulsion d’Edouard Herriot, le quartier des Etats Unis, les Abattoirs (Hall Tony Garnier), l’hôpital Edouard Herriot (Granges Blanches) et le stade de Gerland.
1930 : effondrement de la colline de Fourvière (environ 10%) : 40 morts
1943 : arrestation de Jean Moulin
Lyon possède plus de 70 km de galeries
souterraines composée de réservoirs d’eau et de passages secrets, portant des noms évocateurs : le Puits de l’enfer, la Chapelle de Belzébuth, les Arrêtes de poissons. On y trouve une pierre mystérieuse située exactement à l’aplomb du Gros Cailloux de la Croix Rousse. Il existerait un lac souterrain juste en dessous du cimetière de Loyasse.
Lyon et les secrets :-Un radiesthésiste célèbre : Jacques Aymard
-Le Fran maçonnerie s’implante à Lyon au 18eme siècle,JB Villermoz fonde le « rite écossais » et Cagliostro fonde le « rite égyptien ». Lyon devient le carrefour européen de la Franc maçonnerie.
-Au 19eme siècle, Allan Kardec fonde le spiritisme dans le quartier des Terreaux.
-Le Maître Philippe invente une « poudre pour prolonger la vie » dans son atelier du 6 rue du bœuf, il devient conseiller du tsar de Russie et meurt en 1905.
AAC058-7887
Ce film traite de la posture de l’architecte vis à vis de son métier.
Garry COOPER, alias Howard ROARK jeune architecte, refuse de se soumettre au dictat du goût esthétique de son époque en matière d’architecture, de recopier le travail de ses prédécesseurs pour développer sa propre vision de l’architecture. Il refusera tout compromis et de tomber dans la facilité, au détriment de sa réussite sociale et amoureuse. Le parcours sera long et difficile mais Howard ROARK vaincra et réussira à s’imposer comme un grand architecte.
Le film aborde toutes les situations de compromission possible et s’articule autour de cinq personnages :-l’architecte de génie refusant le compromis-l’architecte médiocre acceptant toutes les compromissions-la femme fatale-le patron de presse selfmade man symbolisant le pouvoir et la réussite sociale, ayant soumis son journal à la voie du peuple, et vouera une admiration son borne à Howard ROARK, plus peut-être à l’homme sans compromis, qu’à l’architecte.-un critique d’architecture tyrannique, travaillant pour le plus grand journal populaire de New York, The Banner (le bandeau, l’étendard) défendant l’idée que l’architecture doit être au service du plus grand nombre et que la posture esthétique doit correspondre au goût du peuple, uniquement comme prétexte pour assouvir sa soif de pouvoir.
Sa vision du pouvoir : supprimer l’esprit critique et la liberté de pensée de l’individu pour mieux le soumettre. Il s’applique à anéantir tout architecte de génie qui refuserait de se soumettre à cette abnégation.
Ce film retrace une époque où la presse écrite était le principal média dotée d’un pouvoir immense, où le niveau d’éducation de la population et donc l’esprit critique était moins développé qu’aujourd’hui. Ces deux éléments facilitaient la manipulation de l’opinion publique. Bien que le film semble aujourd’hui désuet dans sa forme, le fond n’en reste pas moins d’actualité vis-à-vis de la posture architecturale. Intéressant.
Ce film n’aborde malheureusement pas les questions de la prise en compte du contexte, de l’essence du lieu et de la prise en compte de l’humain et des usages dans le projet architectural. De plus, l’architecte est présenté comme l’unique participant du processus, ce qui est une vision bien ancienne de ce métier.
Enfin, au-delà de l’aspect architectural, le film est un pamphlet contre le communisme et « la dictature du prolétariat » en défendant les « valeurs américaines » de la soi-disante liberté de l’individu dans une période d’après-guerre et laisse déjà entrevoir les prémices du maccarthisme.
VIDOR, King,1949 The fountainhead, fim d'après une nouvelle de Ayn RAND
AAC058-7889
PRÉSENTATION
Maurice G DANTEC est né en 1959 à Grenoble, il est naturalisé canadien et se défini comme « un écrivain nord-américain de la langue française ». Il a été l’élève de Gilles DELEUZE et fonde en 1998 avec Richard Pinhas, le duo de musique expérimentale Schizotrope en hommage à ce dernier.
SYNTHÈSE
« L’an 2000 aurait dû être la Fin des temps … Finalement il n’en est rien.Le 11 Septembre 2001 sera le Dernier Jour du Monde tel que nous l’avions connu.Quatre sites. Quatre cavaliers venus du ciel. Le Monde d’ici-bas avait trouvé son régime de croisière : la destruction généralisée enclosait l’homme dans l’éternel recommencement du même, la mort, d’infinie différence, était devenue la finitude équivalente qui se refermait sur Porbicule où l’homme avait décidé de s’éteindre ».
Le narrateur, Kernal, jeune flic de la banlieue parisienne nous fait revivre les dix dernières années avant sa mort. Le 11 Septembre 2001 à midi, Kernal explose dans son bureau de banlieue,
victime lui aussi d’un attentat. Avant son décès il raconte :
«Les dossiers criminels dont j’avais, ou avais eu la charge, recoupaient en partie cette ligne de fuite vers la catastrophe, ma vie personnelle n’était plus à l’évidence que le prolégomène à un effondrement plus général, j’en avais pris conscience peu à peu, lors de mon lent éveil à ce monde qui venait de naître. Ces chemises de carton, je les contemplais bien moins comme les ruines d’une vie à moitié ratée, semblables en cela à toutes les autres, que comme la promesse d’un avenir déjà ruiné par l’ensemble de nos actions. Dix ans, c’était à la fois largement suffisant pour comprendre qu’on pouvait en savoir beaucoup trop, et pas assez pour pleinement assimiler à quel point on n’apprenait jamais rien.»
Au fil des pages, nous partageons sa vie depuis son entrée dans la police en 1991 alors qu’il est témoin des grands événements internationaux. Kernal plante le décor et nous fait découvrir la Préfecture de Police en 2001, son collègue Mazarin raciste misogyne et violent.Il décrit les rouages de la bureaucratie et s’identifie comme rouage de la Machine, de la Préfecture de Créteil, flic de la France républicaine de la « fin des temps ». Il revient ensuite sur l’année 1991 et l’assassinat d’une jeune fille dans une centrale à charbon désaffectée, la « centrale Arrighi» près de Vitry.L’enquête révèle un crime odieux :
DANTEC, Maurice G., 2004, Villa Vortex, Edition Galimard Folio
AAC058-7891
les organes ont été remplacés par des électro-mécanismesPuis, Kernal nous ramène quelques années en arrière lors de sa rencontre en 1989 avec Milena et Maroussia en Hongrie. Avec elles il assistera à la Chute du Mur de Berlin, Porte de Brandebourg.Lors de ses digressions autour du crime, il repart sur les plages du Déparquement (le D day) pour mieux comprendre la guerre en Irak (la Guerre du Désert).Il nous fait découvrir la centrale EDF voisine de la scène de crime, ses ouvriers et Rungis. Il rencontre Nitzos, cameraman sur le site, chargé de filmer la destruction de la « Centrale Arrighi » : ce dernier sera d’abord suspecté par Kernal puis deviendra pendant les premiers mois d’enquête presque intime. Ils sont tous deux photographes, pro ou amateur et ancien rockeur pro ou amateur:
«Nous partagions cette maladie de l’œil, cette nécrose du regard qui faisait de nous des enregistreurs de la vie»
Il découvrira avec lui les nouvelles techniques vidéo et la cybercriminalité.Au départ de Nitzos pour l’ex Yougoslavie en 1992, après avoir mis au point un logiciel de profilage psychologique, il va avoir comme nouvel équipier Mazarin.La résolution du meurtre de la centrale est toujours au cœur de son activité et Mazarin lui ouvre les portes de Carnaval, indic-journaliste et surtout de Wolfmann ancien flic, de
sa bibliothèque et de sa « Théorie du crime absolu ».
«Grâce à lui je faisais se rejoindre la police de l’état des lieux et l’anti-police des non lieux de l’Etat»
Il aura grâce à eux des recoupements sur d’autres victimes de pédophiles et des réseaux en Europe. Il découvrira également le Méthédrine (Juillet 1994), une amphétamine lui permettant de tenir le rythme en dormant un minimum. Un deuxième crime va être commis 7 mois après le premier dans la centrale de Belleville sur Loire, la Gendarmerie va filmer le corps : «La marionnette est humaine. Ou plus précisément elle l’a été. Son corps est devenu la prothèse organique d’un ensemble de composants technologiques.»
Les deux enquêtes sont menées en parallèle, Kernal pour le premier corps et la gendarmerie pour les trois autres.
«Ce sont des types généralement éduqués alphabétisés et cultivés. Je dirais même que c’est ça leur problème : la culture. Il n’y a rien de pire qu’une connaissance dont on ne sait rien faire. D’inutile, elle devient vite nuisible.»
Un an après la centrale Arrigy, on retrouve le corps de Catherine Traussner, près d’une usine de pétrochimie à côté de l’étang de Berre. Alors que le 4ème crime est commis près de la centrale de Creys-Malville, le corps de Nadia, une jeune bosniaque,
AAC058-7892
le couperet tombe. Kernal et son équipe se voient retirer l’enquête au profit de la gendarmerie.
Nous sommes en 1995 et Kernal apprend à surfer sur le WEB et décide de continuer l’enquête en off.Nitzos est tué à Sarajevo et lui adresse à titre posthume son manuscrit. Parallèle étonnant, alors que Kernal découvre la bibliothèque de Wolfmann, Nitzos découvre la bibliothèque du docteur Yossip Shapin.Dans le même temps Wolfmann quitte Paris, le quartier qu’il connait a été rasé pour faire place à la Grande Bibliothèque Mitterand. Kernal se réfugie dans les livres et la religion.
LA VILLE DANS LE ROMAN
« Voici la ville, la mégapolis de Grand-Paris, celle qui désormais s’étend en tous sens à cinquante kilomètres du point zéro gravé sur le parvis de Notre-Dame : c’est le Paris que personne n’ose encore décrire. C’est le Paris du siècle qui s’en vient, et qui est déjà là.Il fallait envisager le territoire mégapolitain de nos existences comme une sorte de fantastique simulateur chargé de sélectionner de nouvelles formes de vie. La ville, jusqu’il y a peu construite et élaborée contre les principes du monde naturel, se voyait désormais pro¬pulsée dans un au-delà de la nature et de l’artifice, elle laissait alors apparaître les flux parfaitement schizoïdes d’un cerveau dont les centres de commandement dispa¬raissaient au profit de périphéries autonomes.
Au quadrillage urbain se substituait le biotope réticulaire. La ville devenait à son tour une machine cyber-nétique, elle présupposait la mise en circulation cons¬tante de signaux et de paquets d’informations au service desquels les humains s’agitaient. Dans cette ville rendue au régime sauvage de la jungle, quelque chose pourtant s’agençait comme caché dans un pli secret à la beauté, plastique fulgurante, quelque chose qui faisait de cette ultime terminaison de la maladie un spectacle autre¬ment plus poignant et-tragique que toutes les Très Gran¬des Bibliothèques du socialisme universel.Cela indiquait en tout cas quelque chose : la beauté ne pouvait naître désormais que de sublimes désastres agencés dans quelques cerveaux solitaires, elle ne pou¬vait surgir que d’une vision, une vision supraterrestre née de machines perdues dans la nuit, en compagnie des derniers hommes.Je comprenais peu à peu que Paris n’existait plus, que la ville de Paris, ce musée métropolitain qui ne rassem¬blait désormais plus qu’un sixième de la population de toute la conurbation, n’était pas plus réelle que le Village du Prisonnier. L’idée en vogue prenait corps : Paris ressemblerait peu à peu à un village médiéval de téléfilm régionaliste, ou bien à la capitale du XIXe siècle style Balzac joué par Depardieu, le tout reconstitué façon Hollywood-le-Pont. Autour du parc à thèmes pour touristes s’étendraient les territoires en imblocation de la réalité, un monde d’échangeurs géants, de lignes de TGV et de RER, de tours de bureaux, d’espaces posturbains
AAC058-7893
en friche, de centres commerciaux, de zones industrielles, d’usines, de centrales, de souterrains, de tunnels, de cités à jeunes délinquants et à réseaux ter¬roristes.Le futur de la ville lui échappait. Aucun plan d’urba¬nisme ne serait en mesure de rendre compte de la grâce d’un aéroport à la tombée de la nuit, lorsque chaque avion suit un ami qui ne vous attend pas. Aucun programme politique ne serait en mesure de prévoir le casse qui un jour s’actualiserait par ici, comme un épisode sans doute inclusif de ce processus de sélection.Si vous ne croyez pas en la science-fiction, c’est, bien sûr, que vous n’avez jamais vécu en banlieue. Je veux dire la vraie banlieue. Je ne parle point-là du faubourg désuet situé aux limites du périphérique (frontière urbanistique et psychosociale qui a fait de Paris la caricature muséale d’elle-même), ni de la zone pavillonnaire pittoresque sur les hauteurs de Meudon, des petits ponts-au-dessus-de-la-Marne, ou même de la vieille école républicaine sentant bon les encriers et les livres d’histoire de la HP République, encore moins de la cité vachement multi-ethnique et hyper-cool de mon enfance, tous ces trucs de prestidigitateurs verbeux qui encombrent la littérature contemporaine. Non, je vous parle de la vraie banlieue, celle que personne ne voit, celle dont personne ne se souvient, celle qu’on traverse, celle des spectres, celle qu’on atteint avec une seule et mystérieuse petite clé : la clé de contact ».
LE LOUP DU PONT DE TOLBIAC
« La nuit qui tombe sur la ville est une forme humaine de l’obscurité primitive. Paris est une caverne, une vie souterraine, cryptique, en tout cas elle l’était à l’origine, et quelque chose sans doute a survécu de l’inframonde, en dépit des hautes tours de verre qui tend d’imiter platement, et sans la moindre grandeur ni impétuosité, la verticalité impériale des villes américaines. Il n’est rien dans cette cité qui ne se soit édifié sur un cadavre.Nous sommes ici au carrefour du temps pour une grande ville-lumière. Nous voici à l’aube de la dernière phase de sa destruction. Les anciennes halles aux vins de Bercy viennent d’être transformées en un immense complexe ultramoderne spectacle, à l’architecture de bunkers militaires, recouverts de gazon artificiel dont le vert hurle sous la lumière électrique. Des concerts de Prince, Johnny Hallyday compétitions de motocross, voire de planche à voiles sont tenus. En face, les vieux Moulins de Paris dressent leurs silos comme des cathédrales Art nouveau sous un ciel que la lune nimbe d’une lumière douce, fragile, et trouble. Mésas crayeuses vouées à l’érosion urbaine, à la destruction incorporée dans la vie même de la cité, elles tremblent sur elles-mêmes, dans une oscillation invisible du temps, de toute la fragilité d’un siècle qui va mourir.Un peu plus loin vers l’ouest, les anciens entrepôts frigorifiques de la SNCF, sorte d’improbable château fort industriel sorti de l’imagination délirante d’un ingénieur du rail, servent désormais
AAC058-7894
d’abri pour des compagnies de danse, des studios de répétition, des groupes de roi et des plasticiens subventionnés par la Ville de Paris, veille de sa hauteur médiévale, et improbable, sur un réseau de chemin de fer, un lot de hangars abandonnés aux illusions de la culture.La culture a peu à peu raison de la vie. Bientôt, selon les dires de presse, surgiront les premiers étages de la Très Grande Bibliothèque, molosse quadrilatéral en forme de living qui viendra s’élever sur le quartier de vieilles bicoques et de bistrots à prolos que je vois s’étendre encore jusqu’au métro Nationale, avec sa ligne aérienne traversant la Seine vers l’Institut »
INFLUENCES MUSICALES
-« Achtung baby » de U2-« Diamond dog » de David Bowie-Tangerine dream-« I am a Warlus » des Beatles-« Trans Europe Express » de Kraftwerk
AVIS PERSONNEL
C’est roman est assez fourni. Le style et les multiples digressions de l’auteur rendent la lecture compliquée. Le synthétiser en quelques pages est une gageure. En revanche, l’ambiance des lieux est formidablement transcrite, tout y est présent jusqu’aux sons et odeurs.
AAC058-7895
ANNEXE 05 - TRANSECTS
Le chateau Bellerive et la Soirie sur le quai JJ. Rousseau. Crédit photographique personnel, 2012
Venelle donnant sur la quai JJ. Rousseau. Crédit photographique personnel, 2011
AAC058-7896
Transect sur le quai des étroits – 16/12/2011 O. Poulet
Le travail se compose d'une première phase photographique, en plans parallèles sur environ 800m. , suivi d'un montage , puis d'un retour sur le terrain pour une analyse descriptive de détail durant laquelle chaque détails remarquable est annoté: nombre d'habitants d'un immeuble, plaques d'égouts afin d'avoir une idée du réseau hydrographique, la nature d'un quai, le parapet d'un pont, ...
Après une phase d'analyse à l'échelle urbaine, tant documentaire que sur le terrain, ce travail nous entraîne dans un changement d'échelle drastique et ré-interroge de fait, l'étape précédente.
POULET, Olivier, 2011 : Transect sur le quai des étroits, Travaux d'étude de cas, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon.
AAC058-7897
POULET, Olivier, 2011 : Workshop prototype bois cordé, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon.
AAC058-7909
ANNEXE 07 - ÉTUDE DE CAS D'UN ÉDIFICE
Joseph BACCONNIERCrédit photographique: Paul BACCONNIER
Crédit photographique: CHRETIEN Auriane, DESVIGNES Perrine, MESTER Anita, MOUCHET Philipe, POULET Olivier, étudiants ENSAL
AAC058-7916
Architecture religieuse des trente glorieuses, modernisme.L’église Saint-luc (1964-1966), une architecture à la charnière du mouvement moderne ? _ 26/05/2012 O.Poulet
BACCONNIER Joseph (1910-1990)Joseph Bacconnier était un architecte lyonnais né le 29 avril 1910. Lui-même fils de l’architecte Jean Bacconnier, il étudia aux Beaux-Arts de Lyon. Il obtint son diplôme le 19 février 1935. Par la suite, il intègre l’Institut d’Urbanisme de Paris jusqu’en juin 1937.Joseph Bacconnier suit donc un enseignement de l’architecture classique qu’il poursuit à l’atelier Tony Garnier où il travaille avant la seconde guerre mondiale. Il se forgera également une expérience chez Barnabé Augros à Macon. Après la guerre, Joseph Bacconnier vécu et travailla au 7 avenue Adolf Max dans le 5ème arrondissement de Lyon avec sa femme et ses quatre enfants. Il construit des milliers de logements dans la région lyonnaise . Il participa à la reconstruction du quartier de la presqu’île de Givors ainsi qu’à l’édification des trois tours en 1968. En tant qu’urbaniste, Joseph Bacconnier fut également chargé de la planification urbaine de Sainte- Foy-lès-Lyon.Il ne poursuivra pas ce travail d’urbaniste et se tourne rapidement vers la réponse à plusieurs commandes d’immeubles de logements dans l’agglomération lyonnaise. Durant sa carrière, il réalisera deux églises : Sainte Marie de La Guillotière en 1960 et Saint-Luc en 1962.Bacconnier appartient à la génération d’architectes pour qui le mouvement moderne intervient au milieu de leur
carrière. Il est fondamentalement issu d’un enseignement classique mais va assister au bouleversement de la pensée architecturale générée par l’émergence des techniques nouvelles de construction liées au béton. Si Joseph Bacconnier ne théorisera jamais sur le moderniste, il intégrera ces techniques nouvelles à son exercice professionnel en employant le béton et la préfabrication dans la construction des logements.C’était un homme décrit comme bon vivant et humoriste à ses heures. Mais il était surtout un travailleur acharné et pragmatique.
Introduction au contexte des trente glorieusesEn 1945, la fin de la seconde guerre mondiale amorce une période nouvelle pour la France. Elle se traduit par des changements économiques et sociaux majeurs, impulsés par une forte croissance économique et démographique.Parallèlement, l’exode rural entraîne un afflux de population dans toutes les villes de France et les accords d’Evian marquent la fin de la guerre d’Algérie et le rapatriement des pieds noirs ; c’est la naissance des grands ensembles, qui vont donner un nouveau paysage aux banlieues. Ces migrations géographiques ont un fort impact sur l’organisation des diocèses en ville dont la population va rapidement augmenter, avec pour conséquence une pénurie des lieux de cultes. Ainsi, entre 1900 et 1960, la population du diocèse de Lyon s’accroît de 400 000 habitants.A Lyon, pour répondre à cette évolution, l’évêque Monseigneur Dupuy va, en 1958, décider de la construction de 10 centres paroissiaux pour les 20 années à venir. Dans la foulée, pour organiser et conduire
POULET, Olivier, 2012 : Architecture des "trente glorieuses", Travaux d'étude de cas, DEM Matérialité, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon.
AAC058-7917
cette grande opération de construction, l’évêque Dupuy créé l’O.D.P.N., l’Office Diocésain des Paroisses Nouvelles.Cette période est marquée par un profond bouleversement de l’architecture sacrée. L'Église s’interroge sur la place de ces nouveaux lieux de cultes dans la cité et sur l’exercice de la pastorale. Le concile Vatican II et la réforme liturgique du début des années 60 vont apporter des réponses à ces interrogations entraînant des répercussions sur la disposition et l’aménagement des églises. Parallèlement, on va assister à l’introduction progressive de la pensée moderniste dans les églises. Ainsi, si les premières constructions sont assez classiques, peu à peu, l’architecture de ces lieux de cultes va évoluer, influencée par la pensée moderniste, au service d’une nouvelle expression de la foi.De nombreux architectes vont répondre aux commandes de ces nouveaux lieux de cultes et donc participer à cette évolution. Joseph Bacconnier, est l’un d’entre eux, en 1961, il va répondre à la commande de l'Église Saint-Luc sur la commune de Sainte-Foy lès-Lyon.A cette époque, l’église Saint-Luc apparaît comme une commande courante d’équipement cultuel, implanté au sein d’un nouveau quartier qui se construit dans la banlieue lyonnaise, intégrée à la grande opération urbaine qui fut planifiée à échelle nationale par le ministère de la construction.L’église Saint-Luc, située à la charnière de deux mouvements différents, est-elle le reflet de son architecte, Joseph Bacconnier, lui-même à la charnière de deux époques ?Jusqu’en 1960, le quartier Provinces-Chavril est en majorité composé de terrains agricoles ayant été, par le passé, occupé
par des cultures maraîchères. Ce quartier ne va pas échapper à l’urbanisation de masse qui survient pendant les Trente Glorieuses. Ainsi, en 1960, tous les terrains sont rachetés par la Société Immobilière lyonnaise « Les Bruyères » qui y élève des grands ensembles sur plus de 70 hectares. Une grande partie de la population destinée à vivre dans ces nouveaux immeubles vient de la campagne toute proche des Monts du Lyonnais ou bien de plus loin, dans l’objectif de trouver un travail en ville. Cette population est également issue d’anciens quartiers de Lyon en pleine mutation.Le Diocèse saisit rapidement la nécessité de créer une nouvelle paroisse rattachée à ce nouveau quartier. C’est ainsi que la paroisse Saint-Luc voit le jour en 1962 sous l’initiative de l’Archevêché. Le Père Jean Plaquet en devient le curé. Celui-ci témoigne de la nécessité de cette paroisse nouvelle :« Cette population transplantée cherche des points de rencontre. Elle a besoin de voisinage, on désire rencontrer des personnes pour d’autres raisons que professionnelles, et il semblerait que nos paroisses donnent une petite réponse à ce désir, à cette recherche. La paroisse permet de donner un caractère plus humain à un nouveau quartier»Très rapidement, la nécessité de construire un lieu de culte pour ce nouveau quartier s’exprime. De façon générale, l’église est incontestablement aux yeux des urbanistes comme aux yeux du diocèse l’un de ces équipements collectifs qui participe à donner une identité aux quartiers. L’émergence de ce quartier dans un paysage rural nécessite une réflexion de la part des urbanistes sur la construction de nouveaux repères spatiaux
AAC058-7918
qui participeraient à forger l’identité de ces nouveaux lieux.En juin 1962, le père Plaquet créé un Comité de construction (association loi 1901) composé de laïcs (au départ 10 membres) chargés de le seconder dans ce projet de construction. En décembre 1962, la SCI « Les Bruyères », promoteur de l’opération immobilière du quartier, fait don à l’Association diocésaine d’une parcelle de terrain de 3428m², dans le futur quartier Les Granges Bruyères.
joseph BACCONNIER et le projet Saint luc: un architecte et une église a la charnière de deux époquesA Sainte-Foy-Lès-Lyon, Bacconnier est choisi en 1963 par le Père Plaquet pour réaliser l’église Saint-Luc. A l’époque, l’architecte vient de terminer l’église Sainte-Marie La Guillotière, il n’est donc pas démuni d’expérience dans ce domaine-là, ce qui a certainement influencé le choix des laïcs.Par ailleurs, Joseph Bacconnier intègre la Commission technique rattaché à l’ODPN en 1960, un argument qui a certainement déterminé le choix de Joseph Bacconnier comme architecte.Ainsi, au sein de ce projet, celui-ci occupe une place particulière car il est, en tant qu’architecte, à la fois le maître d’oeuvre de l’église Saint-Luc et architecte conseil à la Commission technique du diocèse.Cette double position a probablement avantagé l’architecte pour obtenir cette commande mais elle a surtout participé à faciliter les échanges entre les différents acteurs de ce projet.Lors des réunions avec la Commission technique, l’accent est notamment mis sur la recherche de sobriété et modestie dans
les nouvelles constructions. « …Pas de recherche, pas de luxe. N’oubliez pas que beaucoup sont encore très mal logés. Nous devons veiller à ce qu’aucune dépense somptuaire ou superflue ne soit engagée. Nous devons nous borner à faire des choses simples, solides, pratiques, définitives…. La pauvreté sera un signe : les églises qui coûtent cher ne sont pas forcément les plus belles. De même qu’on ne demande plus à un curé d’être un notable, on ne demande plus à l’église d’être un monument ».La remise en cause de l’église-monument est un des tournants qui marque cette époque. La sobriété, qui se justifie à la fois par une volonté de rapprocher le peuple de Dieu mais également par le manque de moyens pour construire les églises va devenir une qualité de ces nouveaux lieux de culte. Les prêtres des grands ensembles sont conscients qu’une église imposante y serait non seulement anachronique, mais souvent scandaleuse. Ils refusent l’idée de l’église-monument « artistique » jusqu’à revendiquer que « quatre murs et un toit suffisent ». Ils préconisent la modestie dans le choix des dimensions et des matériaux, et attendent de la part des architectes une créativité nouvelle comme expression de cette modestie.Dans de nombreux projet, le budget va être l’un des points de désaccord majeur dans la relation entre les architectes et l’ODPN. Très souvent, le diocèse reproche aux architectes de se désintéresser de l’affaire et de ne pas respecter le budget.Un des rédacteurs de l’Art sacré, J. Capcir, écrivait «… Urbanistes et architectes ont tendance à voir dans l’église… un élément privilégié de leur composition d’ensemble,…l’oeuvre idéale dans laquelle pourra s’exprimer totalement leur besoin
AAC058-7919
de création… Disons le tout net, il n’est aucune raison pour demander aux chrétiens de payer aux architectes ces fantaisies coûteuses… et laides…"En effet, cette remise en cause de l’église monument n’est pas une chose évidente à accepter pour les architectes, dont la plus part voit en la construction d’une église, l’occasion de réaliser une oeuvre exceptionnelle, comme expression suprême de l’architecture.Toutefois, Joseph Bacconnier, du fait de sa position au sein du diocèse, est un architecte conscient de cette nécessité de modestie qu’il traduira tout au long du projet par une recherche d’économie de moyens.L'Église Saint-Luc est un bâtiment de plan rectangulaire, comprenant les annexes au rez-de-chaussée, à savoir trois salles de catéchisme, deux salles de réunions, des bureaux, un accueil, un dépôt mortuaire (aujourd’hui inutilisé) et une chaufferie. L’église se situe à l’étage, orientée Est-Ouest, elle est surmontée d’une tribune et possède une chapelle de semaine annexe, ainsi qu’une sacristie. Un narthex surélevé de quelques marches et protégé d’un auvent donne accès à l'Église côté Ouest. Les murs sont en béton, la charpente incurvée est composée de poutres métalliques recouvertes d’un revêtement étanche. A l’intérieur, le plafond ondulé est en lattes de frisettes de pin passées au xylophène, complété par un isolant en laine de verre.La chapelle de semaine est séparée de l’église par une cloison mobile qui permet d’agrandir cette dernière en cas de grande cérémonie. On remarque là un système pensé par l’architecte et emprunté au modernisme au service de la fonctionnalité
du lieu de culte.On voit là que le programme est nouveau, ainsi, la réflexion sur la place du lieu de culte dans la vie du quartier qui intervient dans les années 60 se perçoit dans les plans de conception de l’église Saint-Luc. La volonté de faire de l’église un lieu de rassemblement social entraîne la création d’annexes diverses participant à faire vivre ce lieu en dehors des instant de cérémonies.Lyon figure parmi les diocèses précurseurs en matière d’évolution liturgique. La réforme liturgique des années 60 exprime également cette volonté de rapprochement des fidèles dans la façon de célébrer le culte. La cérémonie du culte est repensée de façon à ce que les fidèles participent davantage . On retrouve nombreux de ces éléments dans la conception de Saint-Luc .Ainsi, l’autel est placé de telle sorte que le prêtre célèbre l’office, désormais en langue française, face aux fidèles. La position des bancs, en hémicycle autour du sanctuaire participe à rapprocher les fidèles du prêtre.Par ailleurs, la séparation entre la nef et le chœur s’efface complètement, seul un emmarchement la matérialise.L’intensité lumineuse focalisée sur le sanctuaire est renforcée : toute l’attention du fidèle est attirée vers l’autel, qui concentre le maximum de sources lumineuses. Cette source provient des parois latérales au Nord et au Sud, entièrement vitrées par lesquels la lumière pénètre en abondance. Ces verrières (186m²) accueillent des vitraux en résine de polyester, formant une fresque dessinée par le moine Choleska.Le baptistère est également un espace liturgique fortement marqué par l’évolution liturgique. Les instructions du diocèse de
AAC058-7920
1959 recommandent une « simple cuve, placée en principe dans un local extérieur, sinon dans un emplacement réservé au fond du lieu de culte » . Ici, le baptistère, se situe dans l’angle Sud, détaché de l’édifice, et logé dans un appendice circulaire en claire-voie. Celui-ci pointe un signal formant une flèche tripartite très effilée, dépouillé, squelettique, qui laisse apparaître les cloches.L’absence de piliers, autorisé par un système constructif moderne en béton, permet de libérer le plan de l’église. Ainsi, chaque fidèle peut voir le prêtre. De même, le toit ondulé en lamellé collé, le baptistère dépouillé sont des détails architecturaux qui relève du modernisme.Les techniques de construction nouvelles qui apparaissent à l’époque ont participé à la recherche d’économie de moyens. Ainsi, plusieurs éléments sont issus de la préfabrication, une nouvelle filière apparue avec le modernisme, comme les cadres des vitraux par exemple.Cette économie de moyens se perçoit également dans la provenance des cloches, puisque l’une d’entre elle a été l’objet d’un don du même donateur que le terrain. Elle provient d’une église d’Algérie .Le choix des vitraux est l’un des seuls points qui a entraîné un désaccord entre l’architecte Joseph Bacconnier et l’association de laïcs, comme en témoigne l’un d’entre eux «Les vitraux sont très importants et le choix fut très difficile à faire, surtout d’un point de vue financier. Pendant plusieurs mois, plusieurs devis ont été présentés, l’architecte était toujours présent à nos réunions et malgré quelques grincements, on s’achemine vers une solution : celle des vitraux en résine de polyester, présentée par la Sté Orle de Lyon
6 eme»L’architecte, qui n’avait aucune préconisation sur le thème du vitrail, avait le désir de travailler avec M. Paulin, artiste lyonnais qui réalise des laques. Il aurait souhaité que cet artiste réalise une verrière en dalle de verre éclatées. Toutefois, le Père Plaquet lui a imposé de travailler avec Guy Marcon qui réalisera des vitraux en résine polyester.D’après le témoignage de son fils, ce fut l’un des seuls et grand regret de l’architecte dans l’histoire de ce projet. Cela montre un certain engagement de la part de Joseph Bacconnier, soucieux de la qualité et de l’aspect de son édifice.Ce point de mésentente montre également une remise en cause de l’artisanat dans la présence de l’art des églises, justifiée d’une part, par la volonté du diocèse d’afficher une modestie dans les oeuvres d’art, et d’autre part par une volonté d’économie de moyens.Toutefois, si dans beaucoup de nouvelles églises, l’économie de moyens se perçoit jusque dans le mobilier, souvent acquis des années après la construction, l’ensemble du mobilier de Saint-Luc fut conçu en accord avec l’architecture : l’autel massif et l’ambon sont en calcaire brut et les confessionnaux sont encastrés dans les murs, appartenant véritablement à l’architecture.
L’église Saint-luc: un monument modeste ?L’église Saint-Luc est une église issue de la réforme liturgique, avec un programme nouveau adapté à un quartier nouveau. Joseph Bacconnier était soucieux de satisfaire au mieux le maître d’ouvrage, autant d’un point de vue financier que
AAC058-7921
liturgique. Avec l'Église Saint-Luc, il répond d’une juste façon à la commande du diocèse : un lieu de culte avec de nouvelles fonctionnalités, une économie de moyens dans la réalisation, mais sans compromettre une certaine créativité perçu comme la recherche d’une nouvelle expression de la foi.Si l'Église affiche inévitablement les traits principaux nous permettant, au regard de sa silhouette, de la qualifier d’église moderne, c’est-à-dire construite avec des techniques et matériaux modernes, l’attention portée à sa conception nous amène à conclure que finalement, sa conception répond a des critères fondamentalement traditionnels.Il s’agit d’un bâtiment signal qui se distingue du paysage environnement et qui est perçu directement comme étant une église, conservant en effet les critères de reconnaissance de l’église-monument, à savoir la tour cloché et les vitraux.Joseph Bacconnier, dans sa démarche conceptuelle habille finalement un concept traditionalistes d’une esthétique moderniste qu’il semble justifier par une recherche d’économie de moyens. De même que la volonté de modestie de la part du diocèse, exprimée plus haut par « quatre murs et un toit », n’est ici pas recherchée, bien au contraire, il s’avère que l’économie de moyens est plutôt bien traité.L'Église Saint-Luc peut être assimilée à l'Église de Perret à Raincy, construit en 1930. Ce bâtiment signal participa notamment à faire accepter à la communauté chrétienne l’emploi de matériaux et de techniques modernes dont le béton est le symbole suprême. Joseph Bacconnier réalise, 40 ans plus tard, la même chose avec Saint-Luc, alors qu’à la même époque, en 1966,
Sainte Bernadette de Nevers, qui voit le jour sous le compas de Claude Parent apparaît comme une réponse véritablement modernisme au concept de modestie. Ce blockhaus arbore une image sacrale avec une absence d’ouverture avec vitraux et une entrée par-dessous. La remise en cause de l’église monument est ici poussée à l’extrême puisque l’église devient un bunker, expression d’une architecture catastrophique, cataclysmique, qui rentre sous terre : c’est une église-manifeste.Saint-Luc s’avère donc être la réponse d’un architecte pragmatique, avec une analyse de la valeur et une réponse juste.Une des valeurs premières de l’église traditionnelle est celle de perdurer dans le temps comme monument de culte qui attire le respect de toutes les générations. Elle doit être un lieu où chaque croyant puisse s’y sentir bien quelque soit la génération à laquelle il appartient. L'Église doit être représentative de toute une population de croyants.Aujourd’hui, l'Église Saint-Luc semble remplir parfaitement son rôle de lieu de culte ouvert au rassemblement de tous. Cinquante ans après, les locaux de catéchisme et de réunions fonctionnent à plein régime, et 3 à 4 messes sont célébrées par week-end. On constate donc que la réponse apportée par Joseph Bacconnier est une réponse durable qui a fortement participé à forger l’identité du quartier des « Granges Bruyères ». Les paroissiens « aiment » leur église malgré ses signes de vieillissement et ses quelques dysfonctionnements liés à l’évolution des usages. Mieux encore, ils envisagent des possibilités de travaux pour apporter des réponses aux problèmes d’usages.Le fils de l’architecte, Paul Bacconnier
AAC058-7922
est déjà intervenu il y a quelques années pour rajouter une volée d’escaliers près de l’entrée. Ce dernier point montre donc que la communauté chrétienne possède une bonne relation avec la famille de l’architecte, point supplémentaire qui montre la juste posture de l’architecte Joseph Bacconnier.
Sources:LEBRUN Pierre,2011. Le Temps des Eglises mobiles Collection Archigraphy 344pPAROISSE SAINT-LUC , Si Saint-Luc m’était contéDIOCESE DE LYON, Construire une église, Archives diocésaine de LyonDEPARTEMENT DU RHONE Préinventaire des monuments et richesses historiques, Sainte-Foy-Lès-LyonCHALABI Maryannick, 22/07/2009, Les églises paroissiales construites dans la seconde moitié du XXe siècle et leur devenir : l’exemple de Lyon In Situ n°11http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=11&id_article=chalabi-1150
Crédits:L’ensemble des photographies ont été réalisée par CHRETIEN Auriane, DESVIGNES Perrine, MESTER Anita, MOUCHET Philipe, POULET Olivier, étudiants ENSAL
AAC058-7923
Photo Tom Bisig, courtesy of Durrer Linggi Architekten© Durrer Linggi Architekten . Pubblicata il 18 Gennaio 2007
Photo Tom Bisig, courtesy of Durrer Linggi Architekten© Durrer Linggi Architekten . Pubblicata il 18 Gennaio 2007
ANNEXE 08 - RÉFÉRENCES PRO-JETS
AAC058-7924
RÉFÉRENCE DE PRÉSENTATION
Réalisation urbaine et architecturale, communale, comprenant, une place, des logements, un équipement public, un lieu de séminaire et un hôtel restaurant
Bibliographie:Carnet de voyage d’étude, CAUE 74, 30 septembre, 1er et 2 octobre 2012
Photo Tom Bisig, courtesy of Durrer Linggi Architekten© Durrer Linggi Architekten . Pubblicata il 18 Gennaio 2007
http://europaconcorsi.com/projects/17789-Wiederaufbau-Gemeinde-Gondo
DURRER, Richard et LINGGI, Patrick 2003-2007 : Projet urbano-architectural, GONDO (Canton du Valais, Suisse)
AAC058-7925
www.philmod.my.tripper-tips.com, consultation le 09/02/2012www.uniquecolombia.com, consultation le 09/02/2012www.mundotayrona.com.co, consultation le 09/02/2012
www.philmod.my.tripper-tips.com, consultation le 09/02/2012www.uniquecolombia.com, consultation le 09/02/2012www.mundotayrona.com.co, consultation le 09/02/2012
AAC058-7926
RÉFÉRENCE DE PROJET
Citée précolombienne - Cuidad perdida
La «citée perdue» se situe au nord de la Colombie dans la Sierra Nevada à plus de 3000 m. d’altitude. Elle fût désertée par les Tayronas à l’arrivée des premiers colons venus piller leur or au 15 eme siècle. La végétation luxuriante des tropiques l’a ensuite entièrement recouverte. La citée a été redécouverte dans les années 70’ et fait l’objet, aujourd’hui, d’une inscription au patrimoine de l’UNESCO.Le climat tropical à cette altitude est extrêmement humide ; il pleut deux fois par jour.Des murets de pierre organisent des terrasses et permettent de ménager des surfaces planes dans le pente.Des escaliers relient les différents terrasses et assurent le drainage et la canalisation des eaux de pluie continuelles.Les terrasses accueillaient les huttes familiales , les hommes vivants séparés des femmes et des enfants. Les Tayronas allumaient des feux sur des terrasses spécifiques, pour se réchauffer après le travail. Bibliographie:
Trekking personnel en 1994
www.philmod.my.tripper-tips.com, consultation le 09/02/2012
www.uniquecolombia.com, consultation le 09/02/2012
www.mundotayrona.com.co, consultation le 09/02/2012
CITÉE PRÉCOLOMBIENNE - CUIDAD PERDIDA, Sierra Nevada de Santa Marta (Colombie)
AAC058-7927
Carnet de voyage d’étude, CAUE 74, 30 septembre, 1er et 2 octobre 2012
Carnet de voyage d’étude, CAUE 74, 30 septembre, 1er et 2 octobre 2012
AAC058-7928
RÉFÉRENCE DE PROJET
Pension brion et maison Annalisa
Bibliographie:Carnet de voyage d’étude, CAUE 74, 30 septembre, 1er et 2 octobre 2012
ZUMTHOR, Peter 2005 : Pension brion et maison Annalisa, LEIS (Canton des Grisons, Vals, Suisse)
AAC058-7929
http://www.utopies-realisees.com/fr/pages/5-sites/fiche-site/cite-etoiles,5.html
http://www.utopies-realisees.com/fr/pages/5-sites/fiche-site/cite-etoiles,5.html
AAC058-7930
RÉFÉRENCE DE PROJET
Les étoiles - Jean Renaudie (1925 -1981)
Face au constat que la politique des grands ensembles a conduit à un appauvrissement des grands idéaux du Mouvement Moderne, Jean Renaudie renouvelle le langage architectural de ses prédécesseurs,...En savoir plusEn plein triomphe de l’architecture moderne, le quantitatif l’emporte sur le qualitatif. En réfutant la géométrie élémentaire de ses prédécesseurs, Jean Renaudie conçoit la Cité des Étoiles.Avec ses 207 logements sociaux et en copropriété, ses commerces et ses équipements publics, ce quartier restitue la variété des villes traditionnelles grâce à une combinaison complexe de formes triangulaires qui en font sa singularité. Mais si l’expression se renouvelle, l’ambition de changer la ville et la vie reste intacte.
Bibliographie:http://www.utopies-realisees.com/fr/pages/5-sites/fiche-site/cite-etoiles,5.html
RENAUDIE, Jean 1976-1982 : Les étoiles, GIVORS (France)
AAC058-7931
RÉFÉRENCE DE PROJET
Row houses taglio
Bibliographie:Luigi Snozzi, Claude Lichtenstein, Basel ; Boston ; Berlin, ed. Birkhäuser, 1997
SNOZZI, Luigi 1963-65 : Row Houses Taglio, ORSELINA (Canton du Tessin, Suisse)
AAC058-7933
http://trianglemodernisthouses.com/schindler.htm, consulté le 09/02/2012
http://trianglemodernisthouses.com/schindler.htm, consulté le 09/02/2012
AAC058-7934
RÉFÉRENCE DE PROJET
WOLFE Summer houseRudolf M. Schindler (1887-1953)
Schindler was born to a middle class family in Vienna, Austria. He attended the Imperial and Royal High School from 1899 to 1906 then enrolled in the Wagnersschule of Vienna Polytechnic University, graduating in 1911 with a degree in architecture. Schindler worked for Hans and Theodore Mayer from 1911 to 1914. Encouraged by fellow Austrian architect Adolph Loos, Schindler moved to Chicago in 1914 to work for Ottenheimer Stern and Reichert. In 1916, he delivered 12 elaborate lectures at the Church School of Design in Chicago which became known as the Schindler «Program,» his central design philosophy. Schindler always wanted to work for Frank Lloyd Wright and in late 1918 Wright hired him. After obtaining the commission for the Imperial Hotel in Tokyo, a major project that involved being in Japan for several years, Schindler was promoted to run Wright’s American operations out of the Oak Park IL studio.In 1919, Schindler met and married Pauline Gibling (1893-1977) and in 1920 Wright sent Schindler to Los Angeles to work on the Aline Barnsdall House.Beyond his job for Wright, Schindler started his own independent practice in Los Angeles in 1922. Because of this issue and the two men’s massive egos, Schindler and Wright argued frequently and the two eventually separated as architects.Richard Neutra worked for Wright in 1924 at Taliesin East but left after a few months to work in California with Schindler. Neutra
shared space in Schindler’s house with their wives. Their firm was called Schindler and Neutra, then later AGIC (the Architectural Group for Industry and Commerce).Neutra split from Schindler when Neutra got a larger commission from one of Schindler’s best clients, Philip Lovell. They rarely interacted after that, and the Neutras moved out. When Neutra had a heart attack in 1953, he found himself in the same hospital room as Schindler who was dying of cancer. According to Neutra’s sons, Neutra and Schindler made their peace before Schindler died.Philip Johnson famously rejected Schindler’s inclusion in the 1932 exhibition at the Museum of Modern Art because he felt Schindler was outside the International Style. Schindler responded by rejecting the categorizing of his designs into any style. The Schindlers divorced in the 1930’s, however Pauline Schindler returned to the Kings Road house after a few years and stayed there until her death in 1977. They had one son, Mark.
Bibliographie:-http://trianglemodernisthouses.com/schindler.htm, consulté le 09/02/2012
SCHINDLER, Rudolf M. 1931 : WOLFE Summer House, SANTA CATALINA (Califor-nia, USA)
AAC058-7935
RÉFÉRENCE DE PROJET
Deux maisons a ponte de lima
Bibliographie:Francesco Zamora Mola , Eduardo Souto de Moura architecte, ed Loft Publications, 2009
SOUTO de MOURA, Zduardo 2001-2002 : Deux maisons à Ponte de Lima, PONTE DE LIMA (Portugal)
AAC058-7937
Photos: Francesco VENEZIA et Roberto COLLOVADessin: Francesco VENEZIA
Photos: Francesco VENEZIA et Roberto COLLOVA
AAC058-7938
RÉFÉRENCE DE PROJET
Bibliographie:Francesco VENEZIA, Introduction Alvara SIZA, Catalogos de Architectura contemporanea, édition Gustavo Gili
VENEZIA, Francesco 1973-76 : Plaza en Lauro, LAURO (Italie)
AAC058-7939
Photos: Francesco VENEZIA et Roberto COLLOVADessin: Francesco VENEZIA
Photos: Francesco VENEZIA et Roberto COLLOVA
AAC058-7940
RÉFÉRENCE DE PROJET
Bibliographie:SERAJI, Nasrine, 2007 : Logement, matière de nos villes - Chronique européenne 1900-2007, édition Picard
UTZON, Jorn 1956-58 : Kingo Houses, ELSENEUR (Danemark)
AAC058-7941
Photos:Kenneth FRAMPTON et José Paulo DOS SANTOS
Photos:Kenneth FRAMPTON et José Paulo DOS SANTOS
AAC058-7942
RÉFÉRENCE DE PROJET
Bibliographie:Dos SANTOS, José Paulo, Alvaro SIZA, Works & Projects 1954-1992, édition Gustavo Gili
SIZA, Alvaro 1986-93 : École d'Architecture, PORTO (Portugal)
AAC058-7943
Architectural Monographs 14 - Tadao Ando,London, Academy editions, New York, St. Martin’s press, 1990
Architectural Monographs 14 - Tadao Ando,London, Academy editions, New York, St. Martin’s press, 1990
AAC058-7944
RÉFÉRENCE A NE PAS SUIVRE
Rokko housing 1
Bibliographie:Architectural Monographs 14 - Tadao Ando,London, Academy editions, New York, St. Martin’s press, 1990
ANDO, Tadao, 1978-83: Rokko housing 1, ROKKO KOBE, Hyogo (Japan)
AAC058-7945
Architectural Monographs 14 - Tadao Ando,London, Academy editions, New York, St. Martin’s press, 1990
Architectural Monographs 14 - Tadao Ando,London, Academy editions, New York, St. Martin’s press, 1990
AAC058-7946
RÉFÉRENCE A NE PAS SUIVRE
Rokko housing 2
Bibliographie:Architectural Monographs 14 - Tadao Ando,London, Academy editions, New York, St. Martin’s press, 1990
ANDO, Tadao, 1985: Rokko housing 2, ROKKO KOBE, Hyogo (Japan)
AAC058-7947
EN SOUVENIR DE CALVINO
CASSIGOLI – Nous pourrions conclure notre précédente conversation par ces mots de notre ami Italo Calvino qui, en 1988, dans Leçons américaines, écrivait avec sagesse : « Nous entrons dans le nouveau millénaire sans espoir d’y trouver rien de plus que ce que nous serons capables d’y apporter. » Que pourrait apporter Renzo Piano dans ce nouveau millénaire, et que pourrait-il laisser au contraire derrière lui sans regret ?
PIANO – Je ne voudrais pas me montrer sous les traits du grand sage, mais au seuil de IIIe millénaire, l’idée maîtresse d’une interprétation moins rhétorique et moins symbolique de la « modernité » me semble un beau défi, étant donné que nous nous sommes fait avoir notre vie durant. Pendant toute notre existence, nous avons entendu parler de cette fameuse année 2000, qui allait nous offrir un monde complètement diffé¬rent. Eh bien, au moment d'y entrer, nous découvrons qu'elle n'est pas très différente du siècle qui s'achève, pas même sur le plan de cette technique qu'on fait passer pour la modernité. Mieux, c'est justement à cause de cette technique que nous nous sommes fait avoir, du mo
AAC058-7964
Extrait de PIANO, Renzo, 2009 : La Désobéis-sance de l'Architecte, traduit de l'italien par Oli-vier FAVIER, édition Diffusion Seuil, page 101.
ment où, sous prétexte de nous changer la vie, on nous a enlevé des choses qu'on ne croyait pas — ou qu'on disait ne pas croire — modernes alors qu'elles l'étaient peut-être. Malheureusement, nous n'avons pas avancé d'un pas dans une interprétation plus subtile de l'avenir. C'est comme ça ! Je ne sais comment le dire, mais je pense que nous avons tous été un peu crédules avec ces notions d'avenir, de croissance, de progrès, de modernité. Y avait-il une manière plus intelligente et plus sensible d'aborder ce grand thème qui dominait nos pensées en cette fin de millénaire ? Oui, probablement. Bien sûr, les aspects éthiques auraient dû pré¬valoir sur les enjeux mercantiles, commer¬ciaux, purement techniques. Et vu que tu m'as amené à parler de l'architecture dura¬ble, laisse-moi te dire qu'il y a aussi, très pro¬bablement, une littérature durable, une peinture durable, une musique durable, bref une culture « durable », qui permette de construire une morale allant de paire avec le progrès et la modernité. Il s'agit, simplement, de prendre conscience de ces admirables no¬tions de progrès et de croissance afin d'en éviter les pièges.
.
AAC058-7965