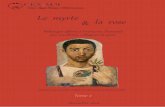35 Pratiques funéraires et tensions sociales dans le Rubané (Lbk)
Transcript of 35 Pratiques funéraires et tensions sociales dans le Rubané (Lbk)
63
eLBuRG R., 2010. Die verfüllung des bandkeramischen Brunnens von Altscherbitz aus taphonomischer Sicht – erste eindrücke. Referat Tagung Arbeits Gemeinschaft Neolithikum, Nürnberg, 27/05/10.
FRIeD M. H., 1975. The notion of tribe. Menlo Park, CA, Cummings Publishing, 136 p.
GeRo, J. M. & CoNKey M. W. (éd.), 1991. Engendering Archaeology – Women and Prehistory. oxford, Basil Blackwell, 418 p.
HoyeR W., 2010. Das bandkeramische Gräberfeld Niedermerz 3 und die Siedlungen im mittleren Merzbachtal – ein vergleich. In: CLAßeN e., DoPPLeR T. & RAMINGeR B. (éd.), Familie – Verwandtschaft – Sozialstrukturen: sozialarchäologische Forschungen zu neolithischen Befunden. Fokus Jungsteinzeit, 1. Kerpen-Loogh, Welt und erde: 43-51.
JeuNeSSe C., 1997. Pratiques funéraires au néolithique ancien – Sépultures et nécropoles des sociétés danubiennes (5500/4900 av. J.-C.). Paris, errance, Collection des Hesperides, 168 p.
LÉvI-STRAuSS C., 1958. Anthropologie structurale. Paris, Plon. (trad. en anglais: Structural anthropology. Garden City, Doubleday Anchor Books, 1967.)
LÉvI-STRAuSS C., 1975. La Voie des masques. Genève, Skira (coll. “Les Sentiers de la Création”), 2 vol.: 142 + 148 p. (trad. en allemand par D. Übers: Der Weg der Masken. Frankfurt am Main, Insel verlag, 1977. Édition revue, augmentée, suivie de trois excursions: Paris, Plon, 1979.)
MeuRKeNS L. & vAN WIJK I. M. (éd.), 2009. Wonen en begraven op de Caberg van het vroege neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen – Inventariserend Veld Onderzoek van een cultuurlandschap te Maastricht-Lanakerveld. Archol Rapport, 100. Leiden, Archeologisch onderzoek Leiden, 282 p.
MoDDeRMAN P. J. R., 1970. Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein. Analecta Praehistorica Leidensia, 3. 3 vol., Leiden: 218 p. et 232 pl. h.t.
NIeSzeRy N., 1995. Linearbandkeramische Gräberfelder in Bayern. Inter nationale Archäologie, 16. espelkamp, Marie Leidorf, 334 p., 117 fig., 84 pl.
PANKoWSKÁ A., 2008. Hodnocení shody odhadu pohlaví mezi dvêma batadeli na souboru lidských kosterních pozestatku z lokality Hulín 3 [evaluation of the degree of agreement in sex determinations by two observers of the collections of skeletons from the archaeological site “Hulín 3”]. Archeologické rozhledy, 60: 725-732.
PARKIN R. & SToNe L. (éd.), 2004. Kinship and family – An anthropological reader. oxford, Blackwell.
RICHTeR I., 1968-1969. Die bandkeramischen Gräber von Flomborn, Kreis Alzey, und vom Adlerberg bei Worms. Mainzer Zeitschrift, 63-64: 158-179.
tHiSSe-derouette r. et J. & THISSe J. Jr, 1952, Découverte d’un cimetière omalien à rite funéraire en deux temps (crémation et enfouissement des cendres) en Hesbaye liégoise à Hollogne-aux-Pierres. Bulletin de la Société préhistorique française, 49(3/4): 175-190.
vAN De veLDe P., 1995. Dust and ashes: the two Neolithic cemeteries of elsloo and Niedermerz compared. Analecta Praehistorica Leidensia, 25: 173-188.
vAN De veLDe P., 2008. on the neolithic pottery from the site. In: vAN De veLDe P. (éd.), Excavations at Geleen-Janskamperveld 1990/1991. Analecta Praehistorica Leidensia, 39. Leiden: 99-128.
vAN GeNNeP A., 1909. Les rites de passage: étude systématique... Paris, Librairie Critique Émile Nourry, Rééd. en 1981. (trad. en anglais par M. B. vizedom & G. L. Cafee: The Rites of Passage. London-Henley, Routledge & Kegan Paul, 1960, 1977).
WAHL J. & KÖNIG H. G., 1987. Anthropologisch-traumatologische untersuchungen der menschlichen Skelettreste aus dem bandkeramischen Massengrab bei Talheim, Kreis Heilbrunn. Fundberichte aus Baden-Württemberg, 12: 65-193.
WeINeR J., 2003. Profane Geräte oder Prunkstücke? Üeberlegungen zur zweckbestimmung übergrosser Dechselklingen. In: eCKeRT J., eISeNHAueR u. & zIMMeRMANN A. (éd.), Archäologische Perspektiven – Analysen und Interpretationen im Wandel (Festschrift Lüning). Rahden, verlag Marie Leidorf: 423-441.
c H r i S t i a n J e u n e S S e
pratiques funéraires et tensions sociaLes
dans Le rubané
Le Rubané, si riche en vestiges d’habitat, figure aussi parmi les cultures ayant livré le plus de sépultures. Plus de 3000 tombes sont actuellement répertoriées, et le corpus s’enrichit d’année en année. La majorité provient de grandes nécropoles, comme Wandersleben (311 tombes), Aiterhofen (227 tombes) ou Schwetzingen (202 tombes). Les pratiques funéraires sont, globalement, très standardisées, ce qui n’empêche évidemment pas une certaine variabilité. variabilité régionale, qui a conduit à la définition de traditions funéraires distinctes au sein de l’œkoumène rubané, mais aussi sociale, à l’échelle de la nécropole [voir van de velde, ce volume, p. 57-63], où les différences entre femmes et hommes d’une part, individus de statut différent d’autre part, sont clairement marqués à travers le choix des mobiliers funéraires.
des pratiques bien codifiéesLes nécropoles n’accueillent pas tous les morts. Il y a la cohorte, nombreuse mais inchiffrable, de ceux qui n’ont laissé aucune trace, mais aussi les morts enterrés dans l’habitat, par petits groupes dans le Bassin parisien et le Bassin des Carpates, dispersés ailleurs. Dans le deuxième cas, on est frappé par une proportion d’enfants nettement plus élevée que dans les cimetières. Même si les déséquilibres sont probablement liés en partie à des questions taphonomiques ou à l’état des recherches, certaines régions semblent, pour des raisons qui nous échappent encore, mieux pourvues que d’autres en nécropoles; c’est le cas, par exemple, de l’Alsace et de la Rhénanie-du-Nord – Westphalie.
Fig. 47 – La norme funéraire. Individu déposé sur le côté
gauche, en position fléchie, tête à l’est
(tombe rubanée ocrée, nécropole de Geispitzen,
Alsace).
catalogue 03_INT_20110929.indd 63 29/09/11 12:49
64 _ Des faits
La configuration la plus courante est celle d’un individu déposé sur le côté ou sur le dos, jambes repliées et rabattues sur le côté gauche, tête orientée dans un cadrant allant du sud-est au nord-est (fig. 47). Les exceptions sont cependant nombreuses: jambes rabattues sur le côté droit, orientation antipodique, position allongée avec les membres inférieurs en extension, incinération, pour ne citer que les plus courantes. Leur répartition et leur fréquence figurent parmi les critères de définition des traditions régionales. Le domaine qui montre la variabilité la plus élevée est cependant celui des mobiliers funéraires. L’importance des écarts entre les tombes se mesure au nombre d’objets (entre rien et plusieurs centaines), au nombre de catégories (céramique, outils, armes, parure...) et au niveau de rareté des objets représentés. Nous reviendrons plus loin sur leur signification sociale. Le marquage du genre est, n’en déplaise à quelques études récentes qui donnent une importance démesurée à des cas exceptionnels ou ambigus, clairement exprimé, et ceci, principalement, à travers une gamme d’objets (lame d’herminette, armature de flèche, v-spondyle...) qui sont l’apanage du sexe masculin (fig. 48).
Les traditions régionalesLa variabilité des gestes funéraires est difficile à interpréter à l’échelle d’une nécropole. Même en croisant les différentes approches, personne n’est jamais parvenu, par exemple, à saisir la logique qui sous-tend l’opposition entre orientation conventionnelle et orientation antipodique, ou encore les raisons pour lesquelles certains individus sont saupoudrés d’ocre. Les choses deviennent plus claires si l’on change de focale pour travailler à l’échelle du Rubané tout entier. on se met alors en situation de comprendre la signification géographique de certaines pratiques. Des configurations particulières se dessinent, qui forment autant de traditions régionales et, au-delà, autant de manières de se positionner par rapport à la norme telle que nous l’avons résumée ci-dessus.
Dans la plaine du Rhin supérieur, par exemple, deux traditions bien distinctes cohabitent. Le sud, comme le révèlent les nécropoles alsaciennes d’ensisheim et de Mulhouse-est, demeure, jusqu’au bout, plus proche des fondamentaux élaborés dans le berceau culturel oriental; les morts y sont presque tous orientés vers l’est, en position fléchie avec les jambes rabattues sur le côté gauche, souvent saupoudrés d’ocre et accompagnés de parures de coquillage. Le nord (Schwetzingen,
vendenheim, Souffelweyersheim) s’en détache, au contraire, assez largement. Les morts en positions antipodiques y forment, très tôt, une forte minorité; il sont rejoints, au Rubané récent, par les “allongés”, qui peuvent représenter jusqu’à près de la moitié des individus dans certaines nécropoles; le saupoudrage d’ocre est une pratique confidentielle, les colorants apparaissant le plus souvent sous la forme de petits blocs; la parure de coquillage enfin, y est peu fréquente et, en général, modeste, exploitant au moins autant les ressources locales que les espèces maritimes. Les clivages que dessine cette géographie des usages funéraires correspondent, globalement, avec les frontières séparant les styles céramiques [voir houbre, ce volume, p. 123-128].
des indices d’inégalitésLa question de la signification sociale des mobiliers funéraires a déjà fait couler beaucoup d’encre. S’appuyant sur quelques exemples de sociétés qui appliquent une idéologie funéraire “égalitaire”, certains sont allés jusqu’à avancer que le lien entre la composition des mobiliers et la réalité sociale était parfaitement arbitraire, et qu’il était donc vain d’espérer comprendre quelque chose de la société des vivants par l’étude de la société des défunts. Ce scepticisme extrême ne résiste pas à un examen approfondi prenant en compte les connaissances accumulées par les ethnologues et les historiens. on en retire une règle simple, qui s’applique à la très grande majorité des situations: si l’absence de variabilité est fondamentalement ambiguë, puisqu’on la trouve, pour simplifier, aussi bien dans des sociétés égalitaires que dans des sociétés marquées par de fortes inégalités, sa présence renvoie toujours à des clivages réels même si, naturellement, ces derniers ne s’inscrivent pas systématiquement sur une échelle verticale. un renversement complet de la hiérarchie sociale, avec des riches enterrés sans aucun bien et des pauvres accompagnés d’objets précieux, est une hypothèse parfaitement absurde.
Il convient donc de prendre au sérieux la variabilité que l’on observe entre les tombes rubanées. en l’absence d’architectures élaborées et de chambres funéraires, elle s’exprime principalement à travers la composition des mobiliers funéraires. on peut, schématiquement, distinguer trois niveaux de “richesse”: absence totale (niveau 1), assemblages de richesse “moyenne” (jusqu’à deux à trois catégories; ni armes, ni matières premières
catalogue 03_INT_20110929.indd 64 29/09/11 12:49
65
exotiques) (niveau 2), tombes “riches” (large éventail de catégories, armes, parures ou lames d’herminettes en matériaux exogènes, types rares) (niveau 3). Pour le niveau 3, on fera la différence entre les nécropoles où il ne concerne pratiquement que des tombes
masculines (par exemple Nitra, en Slovaquie), et celles où il comprend également des tombes de femmes et d’enfants (Aiterhofen, ensisheim). L’exemple de la tombe de Bajc (Slovaquie) illustre bien la notion de mobilier riche (fig. 49).
Fig. 48 – exemple de mobilier “masculin”.
La tombe 148 de vendenheim (Alsace). Cliché: François Schneikert,
INRAP.
catalogue 03_INT_20110929.indd 65 29/09/11 12:49
66 _ Des faits
elle comporte au moins une, voire deux armes (masse perforée et lame d’herminette), un bracelet en test de spondyle, matière exotique d’origine méditerranéenne, deux objets rares (tube en os décoré et bâtonnet en pierre polie) et, chiffre exceptionnel dans le Rubané, huit récipients en céramique.
Cette grille de lecture simplifiée permet de classer les nécropoles en fonction de leur degré de différenciation et d’esquisser une histoire et une géographie des inégalités au sein du monde rubané. Les écarts de richesse peuvent être bien marqués dès l’étape initiale, comme nous l’a révélé la publication de la nécropole de vedrovice (Moravie). Ils s’estompent ensuite durant les étapes ancienne et moyenne, avant d’atteindre leur maximum durant l’horizon récent/final. La nécropole de vedrovice a certes livré des mobiliers de niveau 3, mais ils sont presque systématiquement masculins et aucun ne provient d’une tombe d’enfant. outre l’existence d’assemblages très riches qui n’ont pas d’équivalent auparavant, les nécropoles du Rubané récent/final se distinguent par la présence récurrente de tombes d’enfants de niveau 3. à ensisheim et Aiterhofen, par exemple, une petite “élite”, formée d’une poignée de tombes et réunissant hommes, femmes et enfants, se détache très nettement du reste de la population. L’accès aux précieuses parures de coquillage constitue l’élément discriminant le plus important (fig. 50). La présence de tombes riches d’enfants – à partir de 3 à 4 ans –, dont le mobilier ne se distingue pas de celui des adultes (hommes ou femmes), soulève la question d’une éventuelle transmission des statuts, et donc d’une reproduction de cette petite élite par l’hérédité.
Ces indices de stratification remettent en cause l’égalitarisme présumé des sociétés du Néolithique ancien. en réalité, on ne voit guère ce qui, de ce point de vue, les distingue des cultures réputées plus inégalitaires du Chalcolithique moyen du Bassin des Carpates ou de la culture à céramique cordée, voire même des sociétés à “porteurs d’épée” du Bronze moyen centre-européen. on n’a pas de mal, en revanche, à pointer du doigt ce qui met le Rubané au-dessus, du point de vue du degré de différenciation, d’un certain nombre de grandes cultures plus récentes, par exemple le Michelsberg (Néolithique moyen). et cela d’autant plus que l’impression que l’on retire de l’étude des nécropoles sort renforcée de l’examen des habitats. Là, de grandes à très grandes maisons cohabitent avec des bâtisses plus modestes, s’en distinguant par une construction plus solide, des fonctions plus variées, des mobiliers plus riches et plus diversifiés. Personne n’ayant jamais pu sérieusement remettre en question leur statut commun de bâtiments à vocation domestique, rien n’empêche d’interpréter leurs différences en termes
Fig. 49 – exemple de mobilier masculin “riche”. Mobilier non céramique de la tombe de Bajc (Slovaquie, d’après Cheben, 2000).1. Collier de perles en pierre et en test de coquillage; 2. Pendentif en pierre polie; 3. Lame d’herminette; 4. Crache de cerf; 5. Bracelet en spondyle;6. Anneau décoré en os; 7. Masse perforée polie en pierre.
catalogue 03_INT_20110929.indd 66 29/09/11 12:49
67
sociaux et de “loger” les occupants des tombes les plus riches dans les maisons les plus longues. en réalité, le seul frein à une appréciation objective de la situation est le poids encore bien réel du vieux préjugé égalitariste inspiré des approches évolutionnistes de la fin du xIxe siècle.
La force des symbolesLes traits qui définissent les traditions régionales sont autant d’aménagements de la norme héritée de la phase formative du Rubané. en même temps qu’elles participent à la construction des identités régionales, ces modifications sont autant de remises en cause de cette norme. Ces comportements déviants ne sont cependant pas partagés par l’ensemble de la population. elles peuvent exprimer des clivages internes qui se manifestent à deux niveaux, comme nous allons tenter de l’expliquer à partir de l’exemple du rôle de la position allongée dans le Rubané récent de Basse-Alsace. à l’échelle de la nécropole, on remarque que certains individus conservent la position fléchie traditionnelle, alors que d’autres sont déposés en position allongée, membres inférieurs en extension. Précisons que rien ne permet d’affirmer que nous avons affaire à deux pratiques qui se suivent dans le temps, ou à des gestes funéraires liés à des différences de statut. L’opposition “replié” – “allongé” ne recoupe en rien les différences de richesse; elle reflète, plus probablement, l’existence d’une variabilité horizontale. à l’échelle régionale, on remarque que la même opposition se répète sur d’autres nécropoles, suggérant l’existence d’une sorte de sous-culture funéraire “dissidente” dont le signe de ralliement est cette manière de contester la pratique ancestrale du repliement des jambes.
on observe, également en Basse-Alsace, un phénomène comparable au niveau des décors céramiques. un style particulier, qui fait la part belle aux décors orthogonaux du type “décor en T”, se développe à côté du courant majoritaire. Il exprime l’identité d’un sous-ensemble – qui n’est pas obligatoirement le même que celui des partisans de la position allongée – qui ne trouve plus son compte dans la reproduction des règles traditionnelles de construction des décors. Ce rejet est loin d’être un simple épiphénomène puisqu’il est vraisemblablement à l’origine d’une scission de la communauté qui se traduira par le départ d’une partie au moins des membres de ce sous-groupe en direction du Bassin parisien (Jeunesse, 2008).
Les choix en matière de traitement des défunts expriment donc, en plus de tout un univers de croyances à tout jamais inaccessibles, les clivages qui traversent la société des vivants, clivages verticaux entre les strates sociales, horizontaux entre les genres ou entre ces sous-groupes que séparent leurs manières respectives d’interpréter la tradition. Les funérailles sont l’occasion d’exhiber, à travers les gestes funé raires et l’exposition des objets les plus précieux, l’écheveau des relations qui structurent la société. Si les ethnologues pouvaient voyager dans le temps, c’est sans doute dans ces moments où affleurent toutes les divisions latentes qu’ils trouveraient les meilleures clés de compréhension de la société rubanée. Nous avons distingué, plus haut, des cultures aux idéo-logies funéraires “égalitaristes” dont les tombes nient
Fig. 50 – Le spondyle, coquillage méditer-
ranéen, est synonyme de prestige. Perles tubulaires et plates de la nécropole de
Mulhouse-est (Alsace). La perle tubulaire
entière mesure environ 7 cm.
Cliché: Musée Historique de Mulhouse.
catalogue 03_INT_20110929.indd 67 29/09/11 12:49
68 _ Des faits
les divisions qui traversent la société des vivants. Avec le Rubané, nous avons assurément affaire à la position inverse, celle des sociétés qui n’hésitent pas à afficher leurs divisions, profitant au contraire de la circonstance solennelle que constituent les funérailles pour les mettre en scène. Si le rituel funéraire y sert, pour certains, à réaffirmer leur fidélité à la tradition, il est utilisé par d’autres pour signifier leur rejet de la norme et leur volonté de se constituer en porteurs d’une “contre-culture”. Aux tensions entre les strates sociales viennent donc s’ajouter des antagonismes “horizontaux”, les deux s’exprimant de manière très diverse selon les régions et selon les époques, donnant de la société rubanée une image extrêmement dynamique.
bibliogrAPhiE
CHeBeN I., 2000. Bajc – eine Siedlung der Zeliezovce-Gruppe. Entwicklungsende der Zeliezovce-Gruppe und Anfänge der Lengyel-Kultur. universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, 68. Bonn: 185 p., 137 pl.
JeuNeSSe C., 1997. Pratiques funéraires au Néolithique ancien. Sépultures et nécropoles danubiennes, 5500-4900 av. J.C. Paris, ed. errance, 168 pages.
JeuNeSSe C., 2002. La coquille et la dent. Parure de coquillage et évolution des systèmes symboliques dans le Néolithique danubien (5600-4500). In: GuILAINe J. (dir.), Matériaux, productions, circulations du Néolithique à l‘Age du Bronze. Paris, ed. errance: 49-64.
JeuNeSSe C., 2003. Les pratiques funéraires du Néolithique ancien danubien et l‘identité rubanée: découvertes récentes, nouvelles tendances de la recherche. In: CHAMBoN P. & LeCLeRC J. (dir.), Les pratiques funéraires néolithiques avant 3500 av. J.-C. en France et dans les régions limitrophes. Mémoire xxxIII de la Société Préhistorique Française: 19-32.
JeuNeSSe C., 2008. variations stylistiques et formation des groupes régionaux dans le Rubané occidental. L’exemple des décors orthogonaux. In: FALKeNSTeIN F., SCHADe-LINDIG S. & zeeB-LANz A. (dir.), Kumpf, Kalotte, Pfeilschaftglätter – Gedenkschrift für Annemarie Häusser und Helmut Spatz. Rahden, verlag Marie Leidorf: 129-151.
MoDDeRMAN P. J. R., 1970. Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein. Analecta Praehistorica Leidensia, 3. 3 vol., Leiden: 218 p., 232 pl.
NIeSzeRy N., 1995. Linearbandkeramische Gräberfelder in Bayern. Internationale Archäologie, 16. espelkamp, Marie Leidorf, 334 p., 117 fig., 84 pl.
oRSCHIeDT J., 1998. Bandkeramische Siedlungsbestattungen in Südwestdeutschland. Archäologische und anthropologische Befunde. Rahden: 139 p., 25 pl.
PAvuK J., 1972. Neolithisches Gräberfeld in Nitra. Slovenska Archeologia, 20(1): 5-106.
PoDBoRSKy v. (dir.), 2002. Dve pohrebiste neolitickeho lidu s linearni keramikou ve Vededrovicich na Morave (zwei Gräberfelder des neolithischen volkes mit Linearbandkeramik in vedrovice in Mähren). Brno, Masarik university, 343 p.
vAN De veLDe P., 1990. Bandkeramik social inequality – a case study. Germania, 68: 19-38.
sitEs sEPulCrAux du néolithiquE AnCiEn dE hEsbAyE
m i c H e l t o u S S a i n t e t i v a n J a d i n
Les sites funéraires du Rubané sont extrêmement rares en Belgique, en raison de la forte acidité des sols lœssiques de Hesbaye, qui détruit la plupart des ossements. Ainsi, en l’absence de corps clairement identifiables, certaines fosses ovalaires avec des vases intacts, comme la fosse 83008 de Darion – “Colia”, ne peuvent pas être formellement reconnues comme tombes alors qu’elles le sont probablement. Malgré ces mauvaises conditions de conservation, des sites funéraires ont été découverts à quelques reprises en Hesbaye (fig. 51), où sont d’ailleurs localisés la plupart des hameaux connus de cette culture, datée au radiocarbone de la fin du 6e et du début du 5e millénaires (Jadin, 2003).
Des tombes probablement à inhumation, maté -rialisées par la découverte de longues herminettes, et sûrement à incinération du Rubané ont été découvertes il y a une soixantaine d’années à Hollogne-aux-Pierres, sous la forme d’une vingtaine de “dépôts” (Thisse-Derouette et al., 1952; Tomballe et al., 1956). Deux d’entre eux, les nos 23 et 24, contenaient du charbon de bois et des débris d’os calcinés. Ils ont été interprétés comme traduisant un rite funéraire en deux temps: crémation de défunts, qui serait attestée par la structure n° 24, puis enfouissement des cendres avec un mobilier sélectionné, comme en témoignerait la structure n° 23. Le réexamen récent de ces deux dépôts confirme le caractère humain des débris osseux encore identifiables et la présence de charbons de bois. à Millen-Riemst, dans la partie limbourgeoise belge du bassin de la Meuse, une fosse ovale du Rubané a été considérée comme une possible tombe à inhumation sur base de minimes différences de couleur du remplissage qui refléteraient la silhouette d’un défunt (Lodewijckx et al., 1989). Il y aurait donc en Hesbaye, comme dans les autres “provinces” du Rubané, coexistence d’inhumations et de crémations.
Les principales comparaisons des nécropoles rubanées hesbignonnes sont à chercher vers l’est, en Meuse
catalogue 03_INT_20110929.indd 68 29/09/11 12:49