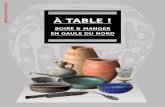J.-N. Castorio, Y. Maligorne, Les monuments funéraires précoces du sud de la Gaule mosellane
-
Upload
univ-brest -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of J.-N. Castorio, Y. Maligorne, Les monuments funéraires précoces du sud de la Gaule mosellane
REDDÉ (M.) et al. dir. — Aspects de la Romanisation dans l’Est de la Gaule. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2011, p. 791-802 (Bibracte ; 21).
Jean-noël CaSToRIo, Yvan MalIGoRne
Les monuments funéraires précoces dans le sud de la Gaule mosellane
Si les monumenta du Ier siècle exhumés sur le limes rhénan et dans la cité des Trévires ont tôt attiré l’attention des savants (Gabelmann 1972 ; 1973) et suscité des synthèses, traitant notamment des plus importants d’entre eux (Gabelmann 1977 ; Andrikopoulou-Strack 1986), on ne saurait en dire autant de ceux qui ont été mis au jour dans le sud de l’espace mosellan, en terres leuque et médiomatrique (ill. 1) : ils n’ont en effet été l’objet que de recherches ponctuelles (Freigang 1997 ; Burnand 2003). Ces monumenta constituent pourtant un corpus passion-nant, au sein duquel il est permis d’entrevoir, non seulement quelques-unes des influences qui ont joué un rôle décisif dans la formation de l’art pro-vincial du nord-est de la Gaule, mais également un certain nombre de processus qui peuvent alimenter les réflexions en cours sur la “romanisation”.
Cette contribution entend donner une vue d’ensemble des différentes formes de marquage de la sépulture attestées dans cette région au Ier siècle ; elle entend également signaler quelques décou-vertes récentes qui ont contribué à renouveler notre connaissance du paysage funéraire sud-mosellan.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, préci-sons qu’une étude consacrée aux monuments funéraires se heurte nécessairement à une dif-ficulté : le manque de repères chronologiques fiables (Castorio 2009). Les datations proposées dans ce texte sont donc à considérer avec toute la prudence nécessaire : si elles nous paraissent bien étayées, elles n’en demeurent pas moins tributaires de l’état actuel des connaissances, en matière de diffusion des modèles notamment.
LES TOMBEAUX MONUMENTAUX
Par tombeaux monumentaux, nous entendons, à la suite d’Y. Burnand, les monuments funéraires de « (…) très grandes dimensions, dont l’édifica-tion a nécessité la mise en œuvre de techniques architecturales » (Burnand 2003, p. 213). Deux types de tombeaux monumentaux sont attestés dans le sud de la Gaule mosellane durant le Ier siècle.
Les tombeaux circulaires à haut tambour retenant un cône de terre
Avant d’étudier ce type, il convient de noter que la frontière commune aux cités trévire et médiomatrique paraît avoir correspondu à la limite méridionale de l’aire de diffusion des tumuli durant l’époque romaine : en effet, alors que la cité des Trévires a livré d’assez nombreux vestiges de tertres funéraires datés du Ier au IIIe siècle (Ebel 1989 ; Wigg 1993), on n’en rencontre pas dans le sud de la Gaule mosellane. Le tumulus de Lauterbach (Sarre, RFA), érigé à la fin du Ier siècle ou durant la première moitié du IIe siècle (Kolling 1976), constitue la seule exception ; mais encore convient-il de préciser que, si l’on se trouve là en terre médiomatrique, la limite séparant ce peuple de son voisin septentrional n’est distante que de quelques kilomètres. Ajoutons que si les mentions de “tumulus d’époque romaine” sont assez fréquentes dans la bibliographie archéo-logique lorraine, elles se révèlent généralement erronées après examen, ces structures ayant en réalité été érigées à une époque antérieure.
792
Jean-noël CaSToRIo, Yvan MalIGoRne leS MonuMenTS funéRaIReS pRéCoCeS danS le Sud de la Gaule MoSellane
Le sud de la Gaule mosellane a en revanche livré les vestiges de plusieurs grands tombeaux circulaires appartenant à un type qui dérive du tumulus : dans ce cas, le tertre était retenu par un haut tambour de pierre.
La première occurrence régionale du type n’est documentée que par un bloc de frise retrouvé à Metz (Moselle) : ce rinceau d’acanthe sculpté sur un bloc de plan courbe (ill. 2, en haut à droite) présente des caractéristiques qui conduisent à lui assigner une datation augustéenne, sans doute antérieure au changement d’ère (Castorio, Maligorne 2007, p. 77). Quelques décennies plus tard, fut érigé à Nasium (Meuse) un tombeau de
très grandes dimensions, partiellement mis au jour et immédiatement détruit à l’occasion du creusement du canal de la Marne au Rhin en 1845. Les observations des fouilleurs et l’examen des membra disiecta conservés conduisent à lui restituer un diamètre de près de 30 m, ce qui le fait entrer dans la classe des monumenta de 100 pieds de diamètre, fréquents en Italie centrale (Schwarz 2002) et représentés en Gaule par la tombe dite de la Gironette, à Autun (Balty 2006). Le tombeau de Nasium était établi dans la vallée de l’Ornain, au pied de l’oppidum de Boviolles, dans une position charnière entre l’agglomération laténienne et la ville romaine. Il se signalait par une remarquable
1. Le sud de la Gaule mosellane durant le Haut-Empire (d’après Dondin, Raepsaet-Charlier 2001, XXII).
793
Jean-noël CaSToRIo, Yvan MalIGoRne leS MonuMenTS funéRaIReS pRéCoCeS danS le Sud de la Gaule MoSellane
animation plastique, puisque son tambour élevé en opus caementicium était revêtu d’une enveloppe en opus quadratum très probablement rythmée par un ordre complet, avec pilastres corinthiens – les cha-piteaux ne sont connus que par un dessin ancien –, architrave – c’est la seule composante de l’entable-ment qui ne soit pas documentée avec certitude –, frise de rinceau et corniche modillonnaire ornée. Le rapport dressé au moment de la découverte n’est pas très explicite, mais le monument semble avoir comporté un couloir permettant d’accéder à une chambre funéraire.
S’il met en œuvre des éléments se rattachant au vocabulaire protoaugustéen (gros caulicoles can-nelés de la frise, acanthe symétrique des modillons, typologie des oves), le décor architectonique intègre aussi des traits empruntés aux modèles médioaugustéens (syntaxe du registre inférieur de la corniche), qui se manifestent pour la première fois en Gaule sur la Maison Carrée de Nîmes dont les ornamenta ont été achevés vers le milieu de la première décennie de notre ère. Cela implique une datation tardoaugustéenne ou tibérienne de la tombe de Nasium, laquelle est confirmée par la découverte dans la maçonnerie d’un bronze de
Tibère relevant d’un type frappé à Lyon à partir de 10. Le décor architectonique dépend étroite-ment des modèles sud-galliques, mais la présence de perles et pirouettes en couronnement des modillons, caractéristique ignorée des corniches de Narbonnaise, permet d’en attribuer la réalisation à des lapidarii œuvrant dans un cadre régional ; ils sont assurément issus d’un atelier qui a contribué au décor des portes de Langres (Porte romaine et Longeporte), dont les corniches présentent une parenté remarquable avec celle de Nasium. Le tom-beau ou son enclos s’enrichissait aussi d’un décor figuré dont nous sont parvenus un grand masque de théâtre (h. 84 cm) et une sphinge assise tenant un crâne humain sous sa patte antérieure gauche (h. 66 cm). Ces sculptures rencontrent leurs plus proches parallèles en Narbonnaise.
En dépit de la perte de la dédicace du monu-ment, on peut affirmer que son commanditaire était un personnage de haut rang, sans doute l’un des primores de la ciuitas récemment constituée. Il a choisi de recourir pour son sépulcre à un type dont la monumentalité et la massivité expriment clairement la puissance du défunt ; il a pris soin de l’agrémenter d’un riche décor architectonique,
2. Blocs ayant appartenu à trois grands tombeaux circulaires. Musée de la Cour d’Or, Metz (© Musée de la Cour d’Or, Metz).
794
Jean-noël CaSToRIo, Yvan MalIGoRne leS MonuMenTS funéRaIReS pRéCoCeS danS le Sud de la Gaule MoSellane
développant un ordre corinthien complet et cano-nique qui témoigne d’une parfaite maîtrise du langage ornemental du principat naissant et assi-mile son tombeau à un véritable monument public. C’est dans la Rome et l’Italie centrale tardo-répu-blicaines et proto-impériales qu’il faut chercher les modèles de ce type de tumulus architecturé, modèles qui ont ensuite été adoptés en Gaule nar-bonnaise : le tombeau de Saillans (Voconces) d’un diamètre de 25 m est assurément plus précoce que celui de Nasium (Castorio, Maligorne 2007, p. 71-72) et celui de la nécropole de Vieilles-Fourches à Orange lui est à peu près contemporain (Mignon, Zugmeyer 2006, p. 307-320) ; le tombeau d’Autun pourrait constituer un jalon entre la Prouincia et la Moselle, mais il n’est pas daté.
Metz a livré les vestiges de deux autres tombes à tumulus et haut tambour (ill. 2). L’une est connue par des fragments de sa dédicace, dont la paléo-graphie a suggéré à Y. Burnand une datation au Ier siècle L’autre est documentée par des blocs de frise de rinceau ; pratiquement identiques aux rin-ceaux de pilastre du Monument n° 9 de Neumagen (Trévires), daté par B. Numrich du début de la période flavienne (Numrich 1997, p. 30-46, pl. 1.2, 1.4, 2.2, 2.4). Ces éléments nous fournissent une orientation chronologique en même temps qu’ils nous renseignent sur la circulation des modèles et des artisans dans l’espace rhénano-mosellan.
Signalons enfin deux tombeaux de même type à proximité de la frontière entre Médiomatriques et Trévires. Le premier est fort mal documenté : décou-vert à Montmédy (Meuse), à 500 m d’une grande uilla, il avait un diamètre de 8,45 m. Le second, mis au jour à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), à 400 m d’une uilla, était au moins partiellement érigé en opus quadratum : les fouilles ont dégagé l’ensemble du socle mouluré, d’un diamètre de 9,18 m, un bloc d’assise lisse et un bloc de corniche modillonnaire. Ces deux monuments ne sont pas datés, mais toutes les occurrences gauloises dont la datation est bien établie sont comprises entre les décennies précé-dant le changement d’ère et le troisième quart du Ier siècle.
On remarquera, pour en finir avec ce type, qu’aucun des exemplaires mosellans – et le constat peut être étendu à l’ensemble des exemplaires gaulois – ne surélève le tambour par un socle qua-drangulaire : le tambour, couronné le plus souvent par un entablement (Nasium, Longuyon, deux des monuments de Metz), constitue la seule structure architecturale en pierre, alors qu’en Italie, un socle
est apparu dès la période protoaugustéenne et a progressivement gagné en importance pour atteindre la même hauteur que le tambour ; le constat donne à penser qu’après son introduction dans l’espace gaulois, sans doute au début de l’époque augustéenne, le type s’est quelque peu figé, restant indifférent aux évolutions intervenues en Italie.
Les tombeaux à édicule sur podium
Associant un socle quadrangulaire, une cha-pelle prostyle ou une tholos couronnée d’un toit à double pente, conique ou en pyramidion – mais des enrichissements de ce schéma de base sont connus à Glanum, Orange, Aix-en-Provence et Faverolles –, ce type semble mal représenté dans la Gaule mosellane du Ier siècle.
En 2005, à Scarponne (Meurthe-et-Moselle), une fouille conduite par l’INRAP à la suite de la découverte fortuite de deux piles d’un pont du Ixe siècle remployant 850 blocs antiques a livré plusieurs éléments appartenant à une tombe rele-vant de cette catégorie. L’un est un fragment de pyramidion sur plan rectangulaire orné de feuilles imbriquées, comme on en connaît des dizaines en Gaule de l’Est. Deux blocs d’architrave-frise revêtent plus d’intérêt. L’architrave présente deux fasces lisses séparées par un astragale de perles et pirouettes et couronnées sur l’un des blocs par un rai-de-cœur en ciseau végétalisé. Sur un bloc, la frise est ornée d’un culot d’acanthe d’où s’échappent deux sections d’un rinceau à volutes-pédoncules ; sur l’autre, la frise porte un décor d’amas d’armes traité en relief méplat de médiocre facture (ill. 3) : on identifie, de gauche à droite, une cuirasse anatomique avec épaulettes, un casque-visage avec long pare-nuque recourbé, et deux cnémides croisées, sous lesquelles on aperçoit la bordure d’un bouclier allongé.
Les trois blocs autorisent à restituer une tombe constituée d’un podium, d’une chapelle prostyle et d’un pyramidion. Rinceau et frise d’armes coexis-taient au sein du même ordre ; le traitement plus soigné du premier, dont le talon de couronnement de l’architrave a seul reçu un décor, donne à penser qu’il ornait la façade du monument.
C’est du rinceau que l’on peut attendre les pré-cisions chronologiques les plus fiables. Les feuilles répondent toutes à un même type et trouvent des parallèles étroits dans le répertoire ornemental du temple de Mazeroie, à Nasium, durant le troisième
795
Jean-noël CaSToRIo, Yvan MalIGoRne leS MonuMenTS funéRaIReS pRéCoCeS danS le Sud de la Gaule MoSellane
quart du Ier s. apr. J.-C. (Maligorne à paraître) ; le fleuron situé à l’extrémité gauche est absolument identique à certains exemplaires de Nasium, apparaissant sur une frise du temple ou dans l’enroulement des volutes de chapiteaux com-posites et corinthisants du même édifice. Cette proposition chronologique n’est pas contredite par la structure du rinceau, claire et aérée, avec un fond bien visible et une tige principale dont la vocation structurante est encore nettement affir-mée : l’ensemble de ces caractères renvoie à la période julio-claudienne. Remarquons enfin que, si les rais-de-cœur végétalisés sont particulièrement fréquents à l’époque flavienne, ils apparaissent dès l’époque julio-claudienne : encore une fois le temple de Mazeroie à Nasium fournit un terme de comparaison utile, puisque le talon de base de la corniche du temple, tout comme le cymatium coronae, mettent en œuvre, aux côtés de rais-de-cœur non végétalisés de tradition augustéenne, des versions dentelées tout à fait comparables à celle de Scarponna.
La typologie des armes de la frise figurée requiert la plus grande attention. Le casque pourrait être confondu avec une tête coupée, mais cette hypothèse ne résiste pas à un examen attentif et les têtes coupées sont exceptionnelles dans le décor d’architecture (Polito 1998, p. 152). Quant à la cuirasse, elle relève incontestablement du type anatomique privé de pteryges (Polito 1998, type A1, p. 46), mais elle présente des épau-lettes, qui ne sont guère fréquentes sur ce type de cuirasses (voir cependant Polito 1998, fig. 144). Les quelques pièces d’équipement représentées sur ce bloc semblent désigner le titulaire du tombeau comme un officier de cavalerie de rang équestre (tribunus militum) : selon H. Devijver et F. Van Wonterghem, à l’époque tardo-républicaine et proto-impériale, la cuirasse anatomique serait un indicateur fiable (Devijver, Van Wonterghem 1990, p. 71) ; l’hypothèse est confortée par la présence du casque à visage, qui pourrait être un casque de parade d’officier de cavalerie.
3. Élément de frise d’armes mis au jour à Scarponna en Meurthe-et-Moselle (cliché J.-N. Castorio).
796
Jean-noël CaSToRIo, Yvan MalIGoRne leS MonuMenTS funéRaIReS pRéCoCeS danS le Sud de la Gaule MoSellane
Mentionnons pour être complet la dédicace d’un tombeau de grandes dimensions découverte à Monthureux-sur-Saône (Vosges), où elle était rem-ployée dans une sépulture mérovingienne, et qu’Y. Burnand propose de dater du début du Ier siècle (Burnand 1990, p. 129). CIL, XIII, 4711 : Sex (to) Iuent (o) Senouiri/ Dubnotali f (ilio)/ Iul (ia) Litumara Litauicci f (ilia)/ mater faciendum/ curauit.
Ce bloc imposant (H. 72 cm ; L. 167 cm ; prof. 27 cm) était à l’origine intégré à une structure en opus quadratum ; si l’on ne peut tout à fait écarter l’hypothèse d’un autel monumental, l’appartenance au podium d’une tombe à édicule apparaît comme la plus vraisemblable. Ce monumentum précoce, que l’on peut associer à une riche uilla dont les vestiges ont été identifiés à quelque 400 m de dis-tance, commémorait un indigène ayant accédé à la citoyenneté, sans doute à titre personnel.
L’HIÉRATISME DÉCORATIF
S’il convient de considérer avec une certaine prudence les reconstitutions des grandes évolu-tions stylistiques de la sculpture gallo-romaine parfois proposées (Castorio 2009), il n’en demeure pas moins que certains styles peuvent légitimement être regardés comme caractéristiques du Ier siècle Il faut dire que les structures de production de monumenta paraissent avoir alors été très sensible-ment différentes de celles du siècle suivant, durant lequel on assiste à une véritable efflorescence de la sculpture funéraire en pays de Moselle ; efflores-cence dont témoignent les importantes collections lapidaires des musées de Trèves, d’Arlon ou de Metz. Dès le début du IIe siècle, on voit en effet se multiplier, dans les centres urbains en particulier, les ateliers de sculpture spécialisés dans la produc-tion de pierres tombales sculptées (Rose 2007) ; ces officines, qui avaient à faire face à une demande croissante, développèrent rapidement des styles locaux, par essence difficilement datables. Durant le Ier siècle, la situation est apparemment très diffé-rente : la demande existe, mais paraît limitée aux catégories sociales les plus aisées. Ce marché a visi-blement été exploité par des ateliers peu nombreux et assez mobiles ; c’est du moins ce que laissent supposer les incontestables proximités stylistiques de certaines sculptures précoces, pourtant décou-vertes dans des sites éloignés les uns des autres. Ces œuvres ne sont certainement pas les productions d’un atelier unique, ainsi qu’on l’a parfois affirmé (Deyts 1984) ; elles témoignent plutôt de l’existence de véritables styles régionaux.
L’un de ces derniers, depuis longtemps identifié (Koethe 1937), a été qualifié d’ “hiératisme décora-tif” par J.-J. Hatt (Hatt 1957). Son expression la plus caractéristique se rencontre sur le Rhin, avec le monumentum à niches de Nickenich (Rhénanie-Palatinat, RFA) (Andrikopoulou-Strack 1986, p. 179, pl. 3-5) : les figures sont représentées en position strictement frontale ; les silhouettes, très étirées, sont raides, malgré le hanchement ; le plissé est figuré à l’aide de longues incisions ; les défuntes sont chargées de lourds bijoux, finement ouvrés. D’autres monuments funéraires rhénans présentent des caractères identiques, bien que moins outrés, comme le sépulcre du couple de Weisenau ou la stèle de Blussus (Boppert 1992, p. 48-60, no 1-2).
On rencontre des sculptures témoignant d’une même inspiration dans toute la Gaule mosellane, que ce soit chez les Trévires – à Arlon notamment (Andrikopoulou-Strack 1986, p. 180, pl. 9a ; p. 185, pl. 11a) –, les Médiomatriques ou les Leuques ; c’est la raison pour laquelle il n’est pas interdit de parler de style “rhénano-mosellan”. Si, en terre leuque, ce dernier n’apparaît que dans la grande statuaire religieuse (Castorio 2004), le chef-lieu des Médiomatriques, Diuodurum (Metz), a livré au moins un bloc comparable à ceux exhumés dans le rempart d’Arlon. Ce bloc (ill. 4) (Esp. V, 4365, récem-ment retrouvé au Musée de la Cour d’Or de Metz), appartenait à un grand tombeau, dont la forme ori-ginelle ne se laisse malheureusement plus deviner. Il conserve le torse d’une défunte, figurée grandeur nature et sculptée dans une niche ; on retrouve, dans le traitement, l’élongation de la silhouette, le caractère linéaire du plissé ou encore la surcharge de bijoux typiques du style rhénano-mosellan.
Quelles sont les sources de ce style qui s’est visiblement développé dans la région sous les règnes de Claude et de Néron ? En l’état actuel de la documentation, les meilleurs parallèles semblent devoir être cherchés dans la sculpture funéraire d’Italie du Nord (Pflug 1989, no 45, 66, 71, 199). Il est naturellement tentant de considérer qu’il est parvenu en Gaule mosellane par le Rhin ; il convient néanmoins de rester prudent à ce propos : le groupe de représentations divines mis au jour en pays leuque entretient de réelles paren-tés avec quelques sculptures plus méridionales, comme par exemple le “pilier” de Mavilly en Côte-d’Or (Deyts 1976, n° 284), tout en étant proche des tombeaux nord-mosellans et rhénans. Cela invite à penser que les processus et les voies de diffusion de ce style sont moins linéaires qu’il n’y paraît au premier abord.
797
Jean-noël CaSToRIo, Yvan MalIGoRne leS MonuMenTS funéRaIReS pRéCoCeS danS le Sud de la Gaule MoSellane
On ne dispose malheureusement pas d’informa-tions sur le commanditaire du tombeau de Metz, pas plus d’ailleurs que sur ceux des sépulcres figurés d’Arlon. On peut toutefois remarquer que les blocs sculptés dans ce style se rencontrent exclusivement en milieu urbain. On remarquera également que les blocs de Metz et d’Arlon appartenaient à d’assez grands tombeaux dont la composition était centrée sur l’effigie des défunts, sculptée dans une niche ; on a là une manière d’anticipation du développe-ment spectaculaire de la stèle à personnages qui caractérise le siècle suivant.
STÈLES ET “STÈLES-MAISONS”
Précisément : quand le modèle gréco-romain de la stèle monolithique sculptée de l’effigie funé-raire – modèle qui connaîtra un formidable succès aux IIe-IIIe siècles – apparaît-il dans la région ? Si
quelques documents démontrent que ce type de monumentum est introduit très précocement dans le nord de la Gaule mosellane, sans doute dès les pre-mières décennies de notre ère (Trier 1984, p. 232-234, 236-237), on ne saurait affirmer, du moins en l’état actuel de la documentation, qu’il en a été de même en terres leuque et médiomatrique. Il faut dire que l’épigraphie, parfois si précieuse pour dater un tom-beau, n’est que de peu de secours si l’on cherche à répondre à cette question : dans le sud mosellan, en particulier chez les Leuques, les stèles sculptées sont en effet souvent dépourvues d’épitaphes. Si quelques rares pierres tombales peuvent néanmoins être attribuées, grâce à l’examen épigraphique et onomastique, à une période précoce, elles sont aniconiques et ne paraissent pas antérieures au milieu du Ier siècle : une stèle découverte à Nasium et récemment publiée par Y. Burnand (Burnand 2008), en constitue un bon exemple, qu’il convient
4. Bloc d’un grand tombeau mis au jour à Metz. Musée de la Cour d’Or, Metz (cliché J.-N. Castorio).
798
Jean-noël CaSToRIo, Yvan MalIGoRne leS MonuMenTS funéRaIReS pRéCoCeS danS le Sud de la Gaule MoSellane
de rapprocher de deux exemplaires de conception comparable, vraisemblablement datés de l’époque julio-claudienne (Krier 1977-1978), provenant de l’oppidum trévire du Titelberg (G.-D. de Luxembourg).
Faute d’indications épigraphiques, il est assez fréquent que l’on invoque un certain nombre de traits stylistiques pour justifier la datation haute de sculptures funéraires mises au jour dans le sud de la Gaule mosellane ; parmi ces traits, citons l’hiéra-tisme ou la surcharge décorative qui dériveraient des conceptions artistiques ayant cours avant la Conquête. Qu’en penser ? Si l’on se garde de recon-naître dans de simples maladresses la persistance d’un langage plastique issu d’une tradition étran-gère à l’art gréco-romain – ce qui est loin d’être toujours le cas –, ces critères paraissent accep-tables : on peut ainsi songer à une datation précoce pour une stèle de Charmois-l’Orgueilleux (Vosges) (Esp. VI, 4795), sur laquelle cette persistance se tra-duit notamment dans le vocabulaire décoratif des parties hautes de la pierre sculptée. Il faut toutefois immédiatement ajouter que les documents de ce type sont très peu nombreux et qu’ils ne forment jamais une série homogène. Il convient également de noter qu’ils proviennent pour l’essentiel de zones périphériques du sud mosellan, rurales et visiblement isolées, où certains archaïsmes ont pu se maintenir longtemps après la conquête ; très rares sont en effet les sculptures comparables dans les grandes collections de la région provenant d’agglomérations antiques comme Solicia (Vosges) – dont le rempart a livré près d’une centaine de monumenta sculptés (Kahn 1992) – ou Diuodurum.
Si l’on ne dispose donc pas de traces bien assurées d’une introduction précoce de la stèle sculptée en pays leuque et médiomatrique, cela ne signifie nullement que la pratique consistant à indiquer la sépulture à l’aide d’une pierre tombale n’ait pas tôt pénétré dans la région. La fouille du site de La Croix-Guillaume à Saint-Quirin (Moselle) en a récemment apporté la preuve. La nécropole de ce hameau du piémont vosgien (Heckenbenner, Meyer 2004) situé en territoire médiomatrique a livré 80 structures funéraires – toutes ne sont pas des tombes – dont certaines étaient indiquées à l’aide de cette forme singulière de pierre tombale que constitue la “stèle-maison”. Rappelons que les monumenta de ce type (ill. 5), qui se concentrent presque exclusivement en terres leuque et médiomatrique (Linckenheld 1927 ; Mondy 1998), possèdent quatre caractéristiques : une épaisseur généralement plus importante que celle d’une simple stèle ; la présence d’éléments empruntés à
l’architecture ; l’existence d’une cavité creusée sous la pierre ; enfin, la présence, au bas de la façade, d’un conduit, prenant volontiers l’aspect d’une petite porte. Or ces monuments apparaissent à La Croix-Guillaume dès la première phase d’occupation du site, durant l’époque claudienne (Heckenbenner, Meyer 1994-2000).
C’est donc moins la pratique consistant à marquer la sépulture d’une pierre tombale qui est rare à haute époque, que celle consistant à orner le monumentum d’une image du défunt et/ou à y graver une épitaphe.
LES AUTRES FORMES DE MARQUAGE DE LA SÉPULTURE
Encore récemment, on ne disposait d’aucune indication sur les formes de marquage de la sépul-ture autres que la pierre tombale. Il n’y a pourtant aucun doute qu’elles jouaient un rôle tout à fait essentiel dans la structuration des paysages funé-raires : la fouille de la nécropole de Feulen (G.-D. de
5. Un exemple de “stèle-maison” découvert à Saint-Jean-d’Ormont (Vosges).
799
Jean-noël CaSToRIo, Yvan MalIGoRne leS MonuMenTS funéRaIReS pRéCoCeS danS le Sud de la Gaule MoSellane
Luxembourg) a ainsi démontré, il y a peu, l’impor-tance qu’avait la grande architecture funéraire de bois et de terre durant les premières décennies du Ier siècle dans l’ouest trévire (Schendzielorz 2006).
Grâce à quelques opérations archéologiques menées en Lorraine dans les dernières années, on en sait aujourd’hui davantage sur le paysage funé-raire précoce dans cette région. Si les données sont encore peu nombreuses, il est néanmoins permis d’émettre trois constats. Tout d’abord qu’il existait également, dans le sud mosellan, une grande archi-tecture funéraire de bois : tout récemment, à Flévy (Moselle), à quelques kilomètres au nord de Metz, une équipe de l’INRAP a ainsi mis au jour une riche sépulture d’époque augustéenne, protégée par une grande structure sur poteaux de bois “de type mau-solée” (Boulanger, Mondy 2009, p. 157) ; les résultats de cette fouille sont encore inédits, mais le rapport de l’exploration devrait être bientôt disponible. Ensuite que l’on utilisait assez fréquemment des structures de bois moins imposantes pour indiquer la tombe : de simples enclos sont ainsi signalés dans les nécropoles de Mondelange (Moselle) (Blouet 1994) et de Laneuvelotte (Meurthe-et-Moselle) (N. Meyer, communication personnelle).
Enfin et surtout les formes de marquage qui coexistaient dans une même nécropole pouvaient être d’une saisissante variété. À la Croix-Guillaume, où le paysage funéraire a été en quelque sorte fossilisé par le couvert végétal postérieur, on ren-contre ainsi, à côté des “stèles-maisons”, des cercles de pierres (ill. 6), taillées ou brutes, d’un diamètre compris entre un 1 m et 1,80 m. Au-dessus de l’une des sépultures, c’est un véritable dôme de pierre que l’on a bâti, dont la hauteur atteignait près d’un mètre. On signale également plusieurs enclos de pierre quadrangulaires. Il s’agit parfois d’aménage-ments plus grossiers : ici, on a placé trois blocs de grès, formant une sorte de U, autour de la tombe ; là, un simple amas de pierres brutes. L’une des tombes était recouverte d’une dalle percée en son centre d’un trou, dont on peut imaginer qu’il était destiné aux libations ; une autre était également couverte d’une dalle, creusée d’un conduit et d’un loculus. Parfois, semble-t-il, le caisson de pierre qui conte-nait les restes incinérés du défunt dépassait du sol, marquant ainsi l’emplacement de la sépulture. Enfin, l’usage du bois est également attesté par la découverte d’un trou de poteau dont l’emplace-ment jouxte celui d’une fosse.
6. Cercle de pierre mis au jour à Saint-Quirin (Moselle). Musée du Pays de Sarrebourg (cliché J.-N. Castorio).
800
Jean-noël CaSToRIo, Yvan MalIGoRne leS MonuMenTS funéRaIReS pRéCoCeS danS le Sud de la Gaule MoSellane
CONCLUSION
Que retenir de ce tour d’horizon des monumenta sud-mosellans attribuables au Ier siècle ? Tout d’abord, l’introduction précoce de la grande architecture funéraire gréco-romaine dans la région, qui a sans doute profondément renouvelé le paysage funéraire dès les premières décennies du Ier siècle Comme l’ont démontré les recherches sur ces grands tombeaux, les modèles qui les ont inspirés sont à chercher dans la péninsule italique ; si les voies par lesquelles ils sont parvenus en Gaule mosellane ne sont pas aisées à retracer, force est de constater que les travaux les plus récents sur certains de ces sépulcres colossaux, comme celui de Nasium, insistent sur l’existence de jalons menant de l’Italie du Nord au centre-est de la Gaule, en passant par la Prouincia.
Ces tombeaux monumentaux démontrent qu’à haute époque, l’expression de la puissance passe pour certains par l’adoption de formes de sépulcres importées, par l’utilisation de thématiques issues du répertoire gréco-romain et éventuellement par l’appel à des bâtisseurs et à des artistes venus du sud. En bref, ils témoignent de l’affirmation, par une partie de l’élite des cités sud-mosellanes, d’une romanité assumée. Cela dit, la perte des épitaphes nous prive d’informations précises sur les comman-ditaires de ces tombeaux.
On se gardera par ailleurs d’oublier que l’expression de la puissance n’a pas revêtu partout la même forme : le mausolée de Flévy, tout comme ceux mis au jour en terre trévire, démontrent l’im-portance de l’architecture funéraire de bois dans la région jusqu’à une date avancée du Ier siècle Si ces tombeaux ne commémorent vraisemblablement pas les membres les plus éminents des communau-tés civiques, ils n’en témoignent pas moins de la diversité des manifestations sépulcrales du pouvoir à l’échelle locale.
On retiendra ensuite le développement pré-coce, dès l’époque claudienne, d’un art proprement
régional de la sculpture funéraire, comme en témoigne le style rhénano-mosellan que l’on rencontre à Metz notamment. Il s’est visiblement épanoui sur des tombeaux de bonnes dimensions, qui ont la particularité d’avoir été centrés sur la représentation des défunts ; on voit là s’esquisser un langage qui sera appelé à connaître un grand succès par la suite. Pour qui œuvraient ces premiers ateliers régionaux connus ? Faute d’informations épigraphiques, cela est difficile à dire ; il faut toutefois noter que ces monuments proviennent d’agglomérations et que c’est l’effigie funéraire qui tient ici lieu de discours, plutôt que la référence à des types architecturaux romains ; effigie qui concentre d’ailleurs d’ostentatoires signes de réus-site sociale. Il est tentant, dès lors, de les mettre en relation avec l’émergence de catégories sociales profitant de l’essor des activités économiques dans les pôles urbains mosellans, alors en pleine crois-sance : d’ailleurs, la stèle de Blussus de Mayence, d’un style très proche comme on l’a vu, est celle d’un naute, qui a pris soin de faire figurer l’un de ses navires sur la face arrière du tombeau.
On retiendra également qu’en ce qui concerne les monumenta plus modestes, nos connaissances sont bien moins précises, faute de jalons chro-nologiques, mais que la pratique consistant à marquer la sépulture d’une pierre tombale s’est sans aucun doute répandue assez tôt, vers le milieu du Ier siècle ; il faudra toutefois attendre la fin du siècle, ou le début du suivant, avant que la pratique épigraphique se “démocratise” et que des structures spécialisées dans la production de monumenta sculptés se développent.
On se souviendra enfin qu’à haute époque, la principale caractéristique des paysages funéraires était certainement leur diversité. Si nos connais-sances demeurent encore très réduites à ce sujet, nul doute que les fouilles de nécropoles actuel-lement en cours nous permettront d’ici peu d’en mieux prendre la mesure.
v
801
Jean-noël CaSToRIo, Yvan MalIGoRne leS MonuMenTS funéRaIReS pRéCoCeS danS le Sud de la Gaule MoSellane
BIBLIOGRAPHIE
Andrikopoulou-Strack 1986 : ANDRIKOPOULOU-STRACK (J.-N.). — Grabbauten des 1. Jahrhunderts n. Chr. im Rheingebiet. Untersuchungen zur Chronologie und Typologie. Cologne ; Bonn : Rheinland-Verlag ; Habelt, 1986, 202 p., 10 fig., 44 pl. h.-t. (Beihefte der Bonner Jahrbücher ; Bd. 43).
Balty 2006 : BALTY (J.-Ch.). — Des tombeaux et des hommes : à propos de quelques mausolées circulaires du monde romain. In : *Moretti, Tardy 2006, p. 41-54.
Blouet 1994 : BLOUET (V.) et al. — La nécropole de Mondelange, “Schemerten” (Moselle). Metz : SRA Lorraine, 1994, 318 p. (rapport n° 1429).
Boppert 1992 : BOPPERT (W.). — Zivile Grabsteine aus Mainz und Umgebung. Mayence : Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 1992, 144 p. (CSIR Deutschland, Germania Superior ; II, 6).
Boulanger, Mondy 2009 : BOULANGER (K.), MONDY (M.). — En mémoire des ancêtres : les modes de signalisation des sépultures antiques en Lorraine. In : *Cat. Sarrebourg 2009, p. 141-162.
Burnand 1990 : BURNAND (Y.). — Histoire de la Lorraine. 1. Les temps anciens. 2. De César à Clovis. Nancy ; Metz : Presses Universitaires de Nancy : Éditions Serpenoise, 1990, 266 p.
Burnand 2003 : BURNAND (Y.). — Tombeaux monumentaux en pays leuque et médiomatrique ? In : NOELKE (P.) Hrsg. — Romanisation und Resistenz in Plastik, Architektur und Inschriften der Provinzen des Imperium Romanum. Neue Funde und Forschungen. Akten des VII. Internationalen Colloquiums über Probleme des Provinzialrömischen Kunstschafens, Köln, 2. bis 6. Mai 2001. Mayence : Philipp von Zabern, 2003, p. 213-229, 21 fig.
Burnand 2008 : BURNAND (Y.). — Une nouvelle inscription de Nasium (Naix-aux-Forges, Meuse) et le droit latin des Leuques. Latomus, 67, 2008, p. 940-948, 2 fig.
Castorio 2004 : CASTORIO (J.-N.). — La ’déesse-mère’ de Nasium et la sculpture gallo-romaine du ier siècle apr. J.-C. In : MOUROT (F.), DECHEZLEPRÊTRE (Th.) dir. — Nasium, ville des Leuques. Bar-le-Duc : Conservation départementale des Musées de la Meuse, 2004, p. 260-267, 7 fig. dans le texte.
Castorio 2009 : CASTORIO (J.-N.). — La sculpture d’époque romaine dans le sud de la Gaule mosellane : ‘ateliers’, styles, chronologie. In : GAGGADIS-ROBIN (V.), HERMARY (A.), REDDÉ (M.), SINTES (C.) dir. — Les ateliers de sculptures régionaux : technique, styles et iconographie. Actes du Xe colloque international sur l’art romain provincial, Arles et Aix-en-Provence, 21-23 mai 2007. Arles : Musée départemental Arles Antique ; Aix-en-Provence : Centre Camille Jullian, 2009, p. 565-573.
Castorio, Maligorne 2007 : CASTORIO (J.-N.), MALIGORNE (Y.). — Une tombe monumentale d’époque tibérienne à Nasium (cité des Leuques). Paris : De Boccard, 2007, 104 p. (Études lorraines d’Antiquité nationale ; 4).
Devijver, Van Wonterghem 1990 : DEViJVER (H.), VAN WONTERGHEM (F.). — The Funerary Monuments of Equestrian Officer. Ancient Society, 21, 1990, p. 59-98.
Deyts 1976 : DEYTS (S.). — Dijon. Sculptures antiques régionales. Musée archéologique. Paris : Éditions des Musées Nationaux, 1976 (Inventaire des collections publiques françaises ; 20).
Deyts 1984 : DEYTS (S.). — Un atelier de grande statuaire entre Langres et Mayence. Revue archéologique de l’Est et du Centre-Est, 35, 1984, p. 113-123, 11 fig.
Ebel 1989 : EBEL (W.). — Die römischen Grabhügel des ersten Jahrhunderts im Treverergebiet. Marburg : Hitzeroth, 1989, 192 p. (Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte ; 12).
Freigang 1997 : FREIGANG (Y.). — Die Grabmäler der gallo-römischen Kultur im Moselland. Studien zur Selbstdarstellung einer Gesellschaft. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 44, 1997, p. 277-440, pl. 17-46 h.t.
Gabelmann 1972 : GABELMANN (H.). — Die Typen der römischen Grabstelen am Rhein. Bonner Jahrbücher, 172, 1972, p. 65-140.
Gabelmann 1973 : GABELMANN (H.). — Römische Grabmonumente mit Reiterkampfszenen im Rheingebiet. Bonner Jahrbücher, 173, 1973, p. 132-200.
Gabelmann 1977 : GABELMANN (H.). — Römische Grabbauten in Italien und den Nordprovinzen. I : HÖCKMANN (U.), KRUG (A.) Hrsg. — Festschrift für Frank Brommer. Mayence : Philipp von Zabern, 1977, p. 101-117.
Hatt 1957 : HATT (J.-J.). — Esquisse d’une histoire de la sculpture régionale principalement dans le Nord-Est de la Gaule. Revue des Études Anciennes, 54, p. 75-107, 15 pl.
Heckenbenner, Meyer 1994-2000 : HECKENBENNER (D.), MEYER (N.). — Le site gallo-romain de la Croix Guillaume. Forêt domaniale de Saint-Quirin. Metz : SRA Lorraine, 1994-2000.
Heckenbenner, Meyer 2004 : HECKENBENNER (D.), MEYER (N.). — Les habitats et les parcellaires du piémont vosgien. In : *Flotté, Fuchs 2004, p. 177-179, fig. 74.
Kahn 1992 : KAHN (L. C.). — Gallo-roman sculpture from Soulosse, France. Diss. : Boston Univ., 1990, 498 p., LXXVI pl.
802
Jean-noël CaSToRIo, Yvan MalIGoRne leS MonuMenTS funéRaIReS pRéCoCeS danS le Sud de la Gaule MoSellane
Koethe 1937 : KOETHE (H.). — La sculpture romaine au pays des Trévires. Revue Archéologique, 2, p. 199-239, pl.
Kolling 1976 : KOLLING (A.). — Ein römerzeitlicher Grabhügel mit mehreren Steinkisten. Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im Saarland, 23, 1976, p. 59-65.
Krier 1977-1978 : KRIER (J.). — IVLIA POTHI FIL (ia) IVLLA. Ein epigraphischer Beitrag zur Geschichte des Titelbergs. Trierer Zeitschrift, 40-41, 1977-1978, p. 67-73, 1 fig.
Linckenheld 1927 : LINCKENHELD (É.). — Les stèles en forme de maison chez les Médiomatriques et en Gaule. Strasbourg : Les Belles-Lettres, 1927 (Publications de la Faculté des Lettres de l’université de Strasbourg ; 38).
Maligorne à paraître : MALIGORNE (Y.). — Les modèles sud-galliques et la première parure monumentale des villes de Gaule Belgique : l’exemple de Nasium. In : TARDY (D.) dir. — Le décor architectonique des Gaules. Actes des journées d’étude de Lyon. Lyon : université Lyon II-Lumière, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, à paraître.
Mignon, Zugmeyer 2006 : MiGNON (J.-M.), ZUGMEYER (S.). — Les mausolées de Fourches-Vieilles à Orange (Vaucluse). In : *Moretti, Tardy 2006, p. 289-320.
Mondy 1998 : MONDY (M.). — Les “stèles-maisons” dans les nécropoles gallo-romaines des Sommets vosgiens (secteur Sarrebourg/Saverne). Strasbourg : université des Sciences Humaines de Strasbourg, 1998, 2 vol. (Mémoire de maîtrise).
Numrich 1997 : NUMRiCH (B.). — Die Architektur des römischen Grabdenkmäler aus Neumagen. Beiträge zur Chronologie und Typologie. Trèves : Verlag des Rheinischen Landesmuseums Trier, 1997, 233 p. (Beiheft Trierer Zeitschrift ; 22).
Pflug 1989 : PFLUG (H.). — Römische Porträtstelen in Oberitalien. Untersuchungen zur Chronologie, Typologie und Ikonographie. Mayence : Philipp von Zabern, 1989, 320 p.
Polito 1998 : POLITO (E.). — Fulgentibus armis : introduzione allo studio dei fregi d’armi antichi. Rome : L’Erma di Bretschneider, 1998, 256 p. (Xenia antiqua. Monografie).
Rose 2007 : ROSE (H.). — Privatheit als öffentlicher Wert. Zur Bedeutung der Familie auf Grabmonumenten der Gallia Belgica. In : WALDE (E.), KAINRATH (B.) Hrsg. — Die Selbstdarstellung der römischen Gesellschaft in den Provinzen im Spiegel der Steindenkmäler. Akten des IX. Internationalen Kolloquiums über Probleme des Provinzialrömischen Kunstschaffens. Innsbruck : Innsbruck University Press, 2007, p. 207-224 (IKARUS ; 2).
Schendzielorz 2006 : SCHENDZIELORZ (S.). — Feulen. Ein spätezeitlich-frührömisches Gräberfeld in Luxemburg. Luxembourg : Musée National d’Histoire et d’Art, 2006, 481 p. (Dossiers d’archéologie ; 9).
Schwarz 2002 : SCHWARZ (M.). — Tumulat Italia tellus. Gestaltung, Chronologie und Bedeutung der römischen Rundgräber in Italien. Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2002, 278 p. (Internationale Archäologie ; 72).
Trier 1984 : Trier, Augustusstadt der Treverer, Stadt und Land in vor- und frührömischer Zeit. Mayence : Philipp von Zabern, 1984, 323 p.
Wigg 1993 : WIGG (A.). — Die Grabhügel des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. an Mittelrhein, Mosel und Saar. Trèves : Verlag des Rheinischen Landesmuseums Trier, 1993, 226 p. (Trierer Zeitschrift ; Beiheft 22).
v