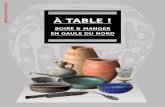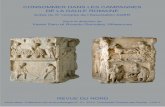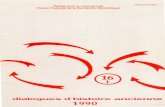"Les décors pariétaux des édifices collégiaux en Gaule"
-
Upload
univ-tlse2 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of "Les décors pariétaux des édifices collégiaux en Gaule"
115
Les décors pariétaux des édifices collégiaux en Gaule. Quelques éléments de réflexion.
Mots-clefs : décors pariétaux ; peinture murale ; collegia ; Gaule ; scholae ; corpora.
Keywords : parietal decorations; wall painting ; collegia ; Gaul ; scholae ; corpora.
Il paraîtra peut être prématuré d’envisager une synthèse sur les décors pariétaux dans les édifices collégiaux en Gaule, à l’heure où l’on s’interroge encore, dans bien des cas, sur l’identification de ces bâtiments pour lesquels on ne connaît pas de plan type et qui sont dès lors difficilement repérables dans le tissu urbain. Une seule certitude : la multiplicité des formules planimétriques adoptées pour les édifices des corporations faisait écho à la pluralité des activités qui y étaient exercées. Tantôt ouvert sur la cité, tantôt refermé sur lui-même, l’édifice collégial s’est imposé ces dernières décennies comme l’archétype de « l’espace mixte ou semi-public », une « structure intermédiaire » relevant tout à la fois de la sphère publique et de la sphère privée 1. Consciente des difficultés d’identification archéologique des collegia, j’ai choisi comme base de travail pour l’établissement de mon corpus l’article fondateur de P. Gros dans les CRAI (1997). Peu après, un article d’A. Bouet paru dans la Revue Archéologique permit de renforcer notre connaissance des collegia de Gaule romaine 2, et à travers sa réinterprétation archéologique d’un édifice aussi vaste et emblématique que la « domus des Bouquets » de Périgueux - confontré à d’autres ensembles architecturaux de Nîmes, Narbonne, Lyon, Avenches et Naintré -, a relancé archéologues et historiens sur la recherche des
traces archéologiques des édifices collégiaux. Ces synthèses eurent un effet particulièrement stimulant, contribuant de manière certaine à la relecture comme « siège de corporation » de bâtiments anciennement découverts, comme à l’identification de structures nouvellement fouillées. Depuis lors, se sont multipliées les propositions de réinterprétation de domus dont la planimétrie ne semblait pas correspondre à un usage spécifiquement domestique. Si certaines peuvent paraître peu justifiées, d’autres reposent sur des bases solides et ont été reprises et relayées ces dernières années par des spécialistes du phénomène associatif dans le monde romain 3. Ces travaux m’ont fourni une liste d’édifices dont on pouvait supposer avec beaucoup de vraisemblance qu’ils avaient servi de siège à une corporation.L’enjeu consiste à déterminer si les éléments de décors pariétaux mis au jour dans ces édifices peuvent aider à identifier leur caractère collégial. Mais une telle réflexion nécessitait des recherches préliminaires sur le décor des édifices collégiaux les mieux identifiés et conservés (dont la plupart se trouvent en Italie), afin d’envisager la question des programmes ornementaux et iconographiques dans un premier temps. Il s’agissait alors de s’intéresser non seulement aux peintures, mais à l’ensemble des supports décoratifs - mosaïque, décor architectural, marbre, statuaire - et d’observer les combinaisons et les éventuelles interactions entre les différents types de décors. Quelles observations peut-on faire sur les décors des lieux de réunion des collegia italiens, que l’on désigne souvent sous le terme de scholae 4 ?
Alexandra DARDENAY, Maître de Conférences, Université de Toulouse II-Le Mirail, Laboratoire TRACES (CNRS-UMR 5608)
1 J.-L. Ferrary dans Cébeillac-Gervasoni et Lamoine 2003, p. 737.2 Bouet 2001.3!"#$!%&%'()%*!)%+!,-./0%+!'%12.311,+!03''%!+.45%+!-%!03))45%!-#1+!)%!63)7'%!Collegia édité par M. Dondin-Payre et N. Tran (2012).4!87$!)97+#5%!-%!0%!2%$'%*!(#$:3.+!(%72!;2$%!%'()3<,!-#1+!71!+%1+!2$3(!5,1,$.=7%*!31!).$#!#6%0!($3/2!)%+!,0)#.$0.++%'%12+>!-%!?@!A3B#7&!C!A3B#7&!DEFF*!(#$2@!(@!GG!C!H!I1!0312%&2%!03)),5.#)*!13+!+37$0%+!+%'J)%12!-310!0316%$5%$!%2!-,+.51%$!(#$!)%!2%$'%!-%!schola 71!%+(#0%!-%!$,71.31!%2K37!-%!$%($,+%12#2.31!L!0#$#024$%!()7+!37!'3.1+!07)27%)*!376%$2!37!)%!()7+!+376%12!:%$',*!-%!-.'%1+.31+!2$4+!6#$.#J)%+*!#))#12!-971%!%&4-$%!37!-971%!2#J%$1#!L!-%!6#+2%+!(.40%+!031+2$7.2%+!%2!#',1#5,%+!L!0%2!%B%2@!M#1+!)%!0#+!-%!03))45%+*!0%!)30#)!(376#.2!0%$2#.1%'%12!;2$%!.12,5$,!L!71!%1+%'J)%!()7+!03'()%&%*!#6%0!037$!0%12$#)%*!(3$2.=7%+!%2!-,(%1-#10%+*!'#.+!31!(%72!(%1+%$!=7%!)%!2%$'%!-%!schola!+9#(().=7#.2!L!)#!+%7)%!+#))%!-%!$,71.31!N@!M#1+!)%+!JO2.'%12+!#007%.))#12!)%+!03))%5.#2.*!.)!%+2!(3++.J)%!=7%! )%! 2%$'%!-%!schola!#.2!-,+.51,!%++%12.%))%'%12! )#!+#))%!+%$6#12!-%! ).%7!-%!$,71.31*!%2!(%72P;2$%!(#+! :3$0,'%12! 2372!)9,-./0%!Q37!237+!)%+!2<(%+!-9,-./0%+R!+.!0%!19%+2*!,6%127%))%'%12*!+37+!71%!:3$'%!',231<'.=7%*!-#1+!0%$2#.1!0#+@
5 Rosso, Dardenay 2013.G Rosso 2013, p.70.7!S9%'($712%!)#!:3$'7)%!-%!?@!A3B#7&!DEFD*!(@!DEE!=7.!-.2!($,0.+,'%12!C!H!I1!T2#).%*!)#!'#U3$.2,!-%+!+.45%+!-%!03))45%+!%2!-9V757+2#)%+!+312*!#$0W.2%027$#)%'%12*!-971!+%7)!2%1#12!%2!1%!03'(3$2%12!%1!$45)%!5,1,$#)%!=7971%!5$#1-%!+#))%!N@!X3.$*!+7$!cette planimétrie, Bollmann 1998, p. 103.8!Y$#1!DEEG*!DDZPDD[@9!Y$#1!DEEG*!(@!DF\PDF]!%2!DDZPDD[!^!A3B#7&!DEFD*!(@!F[[PDEE^!_3++3!DEF`*!(@!aEPaF@10!Y$#1!DEFDJ*!(@!FZD! C!H! )%+!+,6.$+!#757+2#7&!-%!bc'%+! :3$'#.%12!71!corpus et pouvaient donc se présenter comme des corporati!N@11!A3B#7&!DEFD*!(@!DEF@12 Laird 2000.13! 87$! )9W.+23$.35$#(W.%! -%! )9,-./0%! %2! -%+! W<(32W4+%+! -9.12%$($,2#2.31! =7.! 312! ,2,! :3$'7),%+! +7$! +#! :3102.31! C!d#))#0%Pe#-$.))!DEFF*!(@!F`]PF\F@!f9.-%12./0#2.31!03''%!07$.%!-%!0%!JO2.'%12!%+2!132#''%12!0312%+2,%!(#$!S@Pg@!?#)2<*!+7$!)#!J#+%!-9#$57'%12+!%1!($%'.%$!).%7!2<(3)35.=7%+!Q?#)2<!F[[F*!(@!DEZPDFD@R@
116
Retrouve-t-on des constantes, des schémas décoratifs et iconographiques redondants ? Et s’agissant plus spécifiquement des décors pariétaux, existait-il des poncifs décoratifs pour les scholae ?Dans ma quête, je ne partais pas de rien, loin de là. J’avais, fort heureusement, pour soutenir ma réflexion des synthèses de référence sur les décors des édifices collégiaux italiens. Il s’agit de l’ouvrage de B. Bollmann, Römische Vereinshaüser (1998) ainsi que celui de W. Wohlmayr, Kaisersaal (2004) et plus récemment la synthèse sur « Les édifices collégiaux et leur programme figuratif » proposée par ma collègue Emmanuelle Rosso dans le volume Dialogue entre sphère publique et sphère privée dans l’espace de la cité romaine (2013), dont nous avons assuré la co-édition 5. Afin de rendre sensible mon cheminement, je présenterai dans un premier temps quelques éléments de synthèse sur les programmes ornementaux des scholae italiennes, puis les réflexions auxquelles j’ai pu aboutir concernant la question des décors peints dans les édifices collégiaux de la Gaule romaine. Ainsi que le rappelait E. Rosso, « les membres des corporations relevant des « élites non politiques » y trouvaient un espace distinct de la tombe où exprimer les valeurs du groupe et, partant, des opportunités d’accès à certaines formes de reconnaissance sociale. » 6.De fait, cette opportunité qui était offerte aux collegiati a nourri la formulation des programmes ornementaux et iconographiques de leurs lieux de réunion, dans le sens d’une mise en scène faisant écho aux monuments officiels. Attardons nous, un instant, sur des « sièges de collèges et d’Augustales 7 » bien documentés de Misène, Velia, Ostie et
Herculanum afin de résumer les principales composantes du programme ornemental des sièges de corporations.Méthodologiquement, l’analyse conjointe de sièges de corporations professionnelles et d’Augustales s’inscrit dans la prolongement d’études sur les collegia ayant démontré la validité d’une telle démarche 8. Celle-ci se justifie, entre autres, par le statut des Augustales qui ne rejoignaient un collegium Augustalis qu’à leur sortie de charge 9, à un moment de leur carrière, donc, où ils ne faisaient plus partie des magistrats de la cité, mais formaient une corporation regroupée autour de spécificités communes (ici, en l’occurrence, leur caractère d’ex-sevir Augustal), occupée par des activités similaires à celles d’autres collegia (funéraires, festives, cultuelles, honorifiques etc…), et protégées par des bienfaiteurs 10.Les similitudes typologiques, architecturales et planimétriques entre des lieux de réunions tels que les sièges de collèges professionnels, d’Augustales et les curies sont généralement constatées et suscitent à la fois confusions et réinterprétation de leur affectation 11. C’est ainsi qu’un édifice autrefois interprété comme un lieu de réunion d’anciens Augustales, à Ostie, a été attribué par Laird à un collège professionnel 12. Un autre exemple emblématique peut être celui des hésitations dans l’interprétation de l’édifice connu sous le nom de « sede degli Augustali » à Herculanum, dans lequel A. Wallace-Hadrill, suivant une ancienne proposition, préfère identifier le siège de la curie locale 13. Etant donné notre connaissance très fragmentée du décor de ces édifices, cela ne doit pas surprendre, les lieux de réunion des associations (quelles qu’elles soient) imitant l’apparat des édifices relevant
de la sphère publique 14 (comme les curies justement 15).
Le décor des scholae italiennes
L’édifice des Augustales de Misène nous retiendra tout d’abord 16. La salle absidée flanquée de deux pièces a pu être identifiée, grâce à l’abondance de son matériel épigraphique et statuaire, comme un lieu de culte associé au siège d’une corporation d’Augustales 17 (Fig.1). Pas ou peu d’enduits peints dans cet édifice dont les parois étaient ornées de luxueux placages de marbre. L’entrée du sanctuaire, dédié sans doute au culte impérial, était matérialisée par un fronton monumental orné, non pas de l’effigie du couple impérial, mais de celle de généreux bienfaiteurs de la corporation dont le « Zeitgesicht » évoque des contemporains d’Antonin et Faustine (Fig.2).
14!A3B#7&!DEFD*!(@!DFZ!C!H!)%!'31-%!-%+!03))45%+!%+2!71!'.0$303+'%!3h!+312!$%($3-7.2+!)%+!03'(3$2%'%12!W,$.2,+!-%!)971.6%$+!0.6.=7%!N@!I@!_3++3!(#$)%!-%!!H!)9,-./0%!03)),5.#)!03''%!'.$3.$!-%+!'317'%12+!3i0.%)+!-%!)#!0.2,!N!Q_3++3!DEF`*!(@!aFR@15!j!($3(3+!-%!)#!031:7+.31!%12$%!07$.%+!%2!scholae*!).$%!,5#)%'%12!)%+!$%'#$=7%+!-%!?@!A3B#7&!QA3B#7&!DEFFR!%1!(#$2.07).%$!(@!G`!L!($3(3+!-%+!scholae!+%$6#12!-%!+#))%!-%!$,71.31!%1!0312%&2%!0.6.)!C!H!Y372!03''%!)%+!+,1#2%7$+*!L!_3'%*!(376#.%12!+%!$,71.$!%1!-.B,$%12+!).%7&*!<!03'($.+!-#1+!0%22%!schola de la porticus Octaviae*!)%+!-,07$.31+!-%+!0.2,+!-9T2#).%!%2!-%+!($36.10%+!(376#.%12!,5#)%'%12!0W3.+.$!71%!schola!(37$!)%7$+!$,71.31+!N@!?@!A3B#7&!'%12.311%!()7+.%7$+!2,'3.51#5%+!+755,$#12!)9%'()3.*!+#1+!-372%!ponctuel, de lieux de réunion de collegia!(#$!)%+!-,07$.31+!-971%!0.2,!(37$!$,71.$!)#!07$.%@!g%2!7+#5%!1%!:#.2*!J.%1!%12%1-7*!=7%!$%1:3$0%$!)#!031:7+.31!(37$!)%+!3J+%$6#2%7$+!'3-%$1%+*!0%!=7.!(37$$#.2!;2$%!)%!0#+!L!e%$07)#17'!132#''%12@!FG!_3++3!DEF`@!A3B#7&!DEFD*!(@!DF]@!?3))'#11!F[[Z*!(@!`E\P`Ea*!`E[P`Fa*!`\]P`]\@!V-#'3!k7+0%223)#!DEEE!%2!k.1.%$3!DEEE@!17!f%027$%!-7!).%7!-%!$,71.31!%2!-7!).%7!-%!07)2%!C!63.$!%1!-%$1.%$!).%7!_3++3!DEF`*!(@!ZDPZZ@
117
Fig.1 : Misène. Reconstitution du templum Augusti. Dessin de Thora Fisker dans Fejfer 2008, p.80, fig.37.
Fig.2 : Misène. Détail du fronton du pronaos du templum Augusti : portraits des bienfaiteurs Cassia Victoria et son mari, L. Laecanius Primitivus (un Augustalis défunt).
118
Fig.3 : Vélia, collège des Médecins. Répartition des groupes statuaires mis au jour (statues d’empereurs ou de médecins). D’après Fabbri et Trotta 1989, fig. 68.
L’espace situé devant le sanctuaire devait être empli de statues si l’on en croit l’importance des découvertes de bases épigraphiées, de portraits et de statues en pied à cet emplacement. A côté des effigies impériales (portraits, statues cuirassées, statues équestres…) étaient érigées des statues des collegiati et de leurs épouses (cinq statues en toge et trois effigies féminines drapées). Les décors et les inscriptions ornant les bases de statues mises au jour dans cet espace témoignent de l’intérêt des membres du collège pour la garantie des valeurs associées à la personne de l’empereur, au premier rang desquelles la Fortune et l’Abondance. Quant à la cella du sanctuaire elle accueillait sans doute trois statues de culte, les représentations de Vespasien et Titus dressées de part et d’autre d’une troisième œuvre disparue 18. D’après les vestiges de décor pariétaux mis au jour, constitués très essentiellement de placages de marbre, il est probable que nul tableau, nulle frise figurée ne venait contrarier la lecture du programme statuaire.L’étude du programme statuaire de la schola
des médecins à Velia 19 révèle que la présence de cycles dynastiques impériaux dans les édifices collégiaux est loin d’être une spécificité des collèges d’Augustales : la plupart des scholae devait afficher de manière ostentatoire leur loyalisme envers la famille impériale 20. Là encore les représentations des membres de la famille impériale côtoient étroitement celles des collegiati comme l’attestent les vestiges de togati (sans doute des représentations de portraits de médecins en toge) et autres portraits de médecins mis au jour à l’intérieur de l’édifice (Fig.3).Le « sede degli augustali » d’Ostie – réinterprétée par Laird comme siège d’une corporation professionnelle 21 est un autre exemple éloquent du caractère privilégié des placages de marbre pour l’ornementation des murs des scholae (Fig.4). C’est ainsi que des plaques de marbre ont été appliquées sur les murs du portique ainsi que sur les parois de la salle absidée (AB) (Fig.5). Aucun enduit peint remarquable n’est signalé pour cet édifice, et en tout cas, ni tableau, ni scène figurée sur les murs. Là encore, la charge
18!l%U:%$!DEEZ*!(@!a[PZF@19 Rosso 2013, p. 77-82.20 Rosso 2013.21 Laird 2000, p. 72-80.
119
iconographique était concentrée sur le programme statuaire dont on connaît les vestiges mis au jour lors de la fouille du portique. On a ainsi découvert neuf statues, quelques-unes en toge représentant sans doute des corporati, ainsi que des effigies féminines drapées qui devaient figurer des épouses d’Augustales, ou de généreuses donatrices. Ces images sont une nouvelle attestation du rôle des sièges de corporation comme « lieux d’auto-représentation et de commémoration collégiale » 22.Je terminerai pour l’Italie par un regard sur un des très rares édifices collégiaux italiens présentant un décor d’enduits peints remarquables. Il s’agit du siège des Augustales d’Herculanum 23, et le caractère exceptionnel de son état de conservation permet des observations intéressantes sur le statut des décors peints dans ce type d’édifice.
22 Rosso 2013, p. 89.23! I103$%! =7%! V@! d#))#0%Pe#-$.))! Q03''%! +.51#),! ()7+! W#72R*! +7.6#12! 71%! %&,54+%! -,UL! #10.%11%*! $%($%1-! -#1+! 71%!(7J).0#2.31!$,0%12%!)9W<(32W4+%!+%)31!)#=7%))%!.)!+9#5.$#.2*!%1!:#.2*!-7!+.45%!-%!)#!07$.%!)30#)%!C!d#))#0%Pe#-$.))!DEFF*!(@!F`]PF\F@!g312$#!C!?#)2<!F[[F*!(@!DEZPDFD@!I-./0%!:37.)),!(#$!V@!k#.7$.!%1!F[GEPF[GF!%2!(7J).,!(#$!A@!A7#-#513!%1!F[Z`@!X3.$!,5#)%'%12!+7$!0%2!,-./0%!I2.%11%!F[[`!%2!b#UJU%$5!DEED*!(@!F]aPFG`@
Fig.4 : Ostie, édifice dit «sede degli Augustali», plan d’après Heres 1982, fig. 99
Fig.5 : Ostie, édifice dit « sede degli Augustali «, pièce B, détail des placages de marbre.
120
Fig.6 : Herculanum, édifice dit « sede degli Augustali », vue du « sacellum ». (Cl. A.Dardenay).
Fig.7 : Herculanum, édifice dit « sede degli Augustali », décor de la salle latérale. (Cl. A.Dardenay).
121
Le bâtiment consiste en une vaste salle ouvrant sur un sacellum accessible par deux marches et jouxté de deux pièces 24 (Fig.6). Les parois de la grande salle et des deux pièces latérales étaient ornées d’enduits peints d’une grande sobriété, un champ uni noir dans la moitié inférieure de la paroi surmonté d’un champ uni blanc (Fig.7). La substitution des enduits peints à des placages de marbre répond sans doute ici à des raisons économiques. Seul le sol avait reçu un revêtement plus luxueux d’opus sectile polychrome. Comme bien souvent dans ce type d’édifice, ainsi que l’ont illustré les exemples précédents, la grande salle devait être le lieu d’exhibition de nombreuses statues de corporati dont les fouilles n’ont toutefois livré aucun vestige. Ceci explique sans doute l’extrême sobriété du décor pariétal – de simples monochromes – dont on ne voulait pas que l’ornementation vienne perturber la mise
en scène des statues et détourner le spectateur de leur contemplation. Des choix décoratifs différents ont présidé à l’ornementation du sacellum, véritable point focal de l’édifice grâce à sa somptueuse décoration (Fig.8). La partie inférieure des parois était plaquée de marbre, preuve que le sanctuaire a été partiellement épargné par les mesures d’économie appliquées au reste de l’édifice. Sur les murs droit et gauche, au centre de compositions caractéristiques du IVe style pompéien, deux grands tableaux mis au jour dans cet espace sont les seuls attestés, jusqu’ici, dans un siège de collège italien 25. Ils mettent en scène Hercule, héros fondateur de la cité d’Herculanum et archétype des vertus impériales. Sur le tableau de droite sont synthétisés plusieurs épisodes du mythe d’Hercule, Achélous et Déjanire, jusqu’à sa mort empoisonné par la tunique trempée dans le sang de Nessos.
24!m1!$%'#$=7%!)#!+.'.).27-%!()#1.',2$.=7%!%12$%!0%2!,-./0%!%2!0%)7.!-%!X,).#!'%12.311,!($,0,-%''%12@25!I2!%103$%*!+9#5.2P.)!.0.!-7!-,03$!-7!sacellum!-7!03))45%!%2!131!-7!).%7!-%!$,71.31!($3($%'%12!-.2@
Fig.8 : Herculanum, édifice dit « sede degli Augustali », décor du « sacellum ». (Cl. A.Dardenay).
122
La déification d’Hercule est représentée à gauche, où il est reçu par Minerve, Zeus et Junon sur l’Olympe (Fig.9). Selon Fears, la représentation d’Hercule dans ces tableaux peut avoir été utilisée pour intensifier l’identification du héros avec l’empereur régnant, Titus, et son père déifié, Vespasien. Selon certains – mais cette proposition ne fait pas l’unanimité – il serait possible de voir un portrait de Titus dans le visage poupin d’Hercule du tableau de droite, alors que le visage âgé du héros dans le tableau de l’apothéose pourrait suggérer celui de Vespasien 26. Fears rappelle que, depuis Alexandre le Grand, Hercule est le prototype le plus compréhensible pour la déification des souverains dans le monde gréco-romain, celui grâce auquel l’humanité peut jouir de la paix et
de l’abondance 27.Regardons maintenant le mur du fond du sacellum (Fig.8). On est immédiatement frappé par l’absence de tableau sur cette paroi ornée du même type de scaenarum frontes que les autres et qui devait pourtant apparaître comme le point de convergence des regards à l’intérieur de l’édifice. Contre cette paroi était appuyée une base, qui, nous le savons grâce aux rapports de fouille, servait de support à un portrait impérial 28. Quel était l’empereur honoré ici et quel était le type statuaire employé, nous l’ignorons malheureusement, mais E. Moorman et U. Pappalardo estiment qu’il devait s’agir d’un buste colossal. Il est donc évident que, sur cette paroi, l’absence de tableau était justifiée par la présence d’une statue devant le mur, et
DG!l%#$+!F[[[!$#((%))%!=79!e%$07)%!%+2!)%!W,$3+!-312!)#!virtus!W3$+!-7!03''71!)%!031-7.2!L!#003'().$!-%+!%&()3.2+!-971!.''%1+%!J,1,/0%!(37$!)9W7'#1.2,@27!b32%$! )9.'(3$2#10%!-7! 2W4'%!-%! )9#J31-#10%!-#1+! )%! 2#J)%#7!-%!-$3.2%*! )#!03$1%!-9#J31-#10%!#<#12!,2,! :#J$.=7,%!(#$! )%+!b#n#-%+!L!(#$2.$!-%!)#!03$1%!-9V0W%)37+!J$.+,%!(#$!e%$07)%!(%1-#12!)%7$!03'J#2@28 Moormann 1983.
Fig.9 : Herculanum. Apothéose d’Hercule. Le héros avec Minerve et Junon. (Cl. A.Dardenay).
123
que la peinture ne faisait que de servir d’écrin au portrait impérial. On remarque, d’ailleurs, que la base est parfaitement centrée sous l’édicule central de la scaenae frons et qu’une couronne civique était figurée à l’aplomb de la tête de l’empereur. Cette organisation illustre bien le principe hiérarchique qui préside à la conception du décor d’une schola. Le décor pariétal doit se faire le plus discret possible pour ne pas nuire à la lecture du programme statuaire (et épigraphique). D’autre part les vestiges montrent que l’on préfère à la peinture – dans la mesure des moyens financiers – un luxueux mais sobre décor de placages de marbre.
Des formules planimétriques, architecturales et décoratives à la frontière des sphères « publique » et « privée »
Quelques mots pour conclure sur les scholae italiennes et introduire la suite de notre cheminement. Concernant les programmes statuaires, trois groupes d’œuvres prédominent. Les différentes synthèses réalisées sur le décor statuaire des scholae 29 et les travaux récents d’E. Rosso mettent en évidence que les éléments de décor liés au culte impérial et aux manifestations de loyalisme envers l’empereur surpassent quantitavement tous les autres ornamenta présents dans les édifices collégiaux (et pas seulement dans les locaux des Augustales). Viennent ensuite les effigies relevant de l’auto-représentation, portraits des collegiati et parfois des membres de leur famille et bien entendu des patrons et bienfaiteurs de la corporation. Enfin, un troisième groupe est à mentionner, beaucoup plus marginal mais malgré tout présent, celui de la statuaire idéale, dont la plupart des exemplaires devait être destinés à l’ornementation des jardins, thermes et autres espaces de loisir. S’agissant du décor pariétal, on observe une très nette prédilection pour les décors de marbre, la peinture n’étant attestée que de manière maginale, et n’apparaissant dès lors que comme un substitut à moindre coût aux placages de marbre. En ceci, la hiérarchie du décor pariétal est très similaire à
ce que l’on observe dans les bâtiments publics : on ne couvre les murs d’enduits peints que si l’on n’a pas les moyens de financer des placages de marbre. Mais là s’arrête, a priori, la comparaison avec l’ornementation pariétale des monuments publics. Au contraire de ce que l’on observe dans ces derniers, les murs des scholae n’ont généralement pas – pour autant que l’on puisse en juger – été utilisés comme supports à l’exhibition de copies d’opera nobilia. Ce qui n’est pas le cas des monuments publics qui - quand ils n’enfermaient pas de véritables musées – pouvaient voir leur murs recouverts de décors peints destinés à mettre en valeur des copies de tableaux célèbres (que l’on songe par exemple à « l’Augusteum » d’Herculanum 30).
Si les comparaisons formelles, du point de vue de l’ornementation, avec le décor d’édifices publics sont pertinentes - bien que les similitudes ne soient pas complètes - le lien qui rattache archéologiquement les scholae aux édifices domestiques est à envisager sous un angle différent. En effet, si les comparaisons fonctionnent souvent assez bien du point de vue planimétrique et architectural- donnant lieu d’ailleurs, à de fréquentes confusions d’interprétation – le type de décor mis en œuvre, apparaît, en revanche, tout à fait différent. Force est, en effet, de constater que les décors des scholae traduisaient un environnement artistique et figuratif, un « monde des images », bien différent de celui de la domus. Dès lors il est possible d’espérer qu’une juste évaluation du décor des collegia (pariétal et statuaire) pourrait, dans l’idéal, participer à leur identification, ou tout au moins lever certaines confusions. Une étude conjointe des décors architecturaux (peinture pariétale, pavements..) et statuaires est, en effet, une démarche indispensable, ceux-ci fonctionnant souvent en interaction ou, au moins, de manière complémentaire. Ceci étant dit, comme il apparaît que c’est tout autant l’absence de certains types d’images et de schémas décoratifs que la présence d’autres, ainsi que la prédilection pour certains matériaux qui sont éloquents, on mesure toute la difficulté d’une telle entreprise.
29!M312!)%+!2$#6#7&!$,0%12+!-9I@!_3++3!C!_3++3!DEF`*!(#$2@!(@!ZZ! C!H!f#!($,+%10%!-%!)#!k#.+31!.'(,$.#)%!-#1+!)%+!scholae est si '#++.6%!=79%))%!+7$(#++%!%1!($3(3$2.31!%2!%1!($,51#10%!)%+!(3$2$#.2+!-%+!collegiati!%7&P';'%+*!=7.!#$$.6%12!-310!%1!+%031-%!()#0%!-%+!-,-.0#0%+!-%!+2#27%+!)%+!()7+!:$,=7%''%12!#22%+2,%+!-#1+!0%+!JO2.'%12+!N@30!V10.%11%'%12!-.2!H!?#+.).=7%!N@!V))$355%1P?%-%)!V@!DEEZ*!(@!`\P\]@!Y3$%)).!DEE\@!b#UJU%$5!DEED@
124
Le décor des scholae en Gaule romaine
Tournons-nous maintenant vers la Gaule romaine, afin d’envisager un état de la question du décor des bâtiments identifiés comme sièges de collegia dans cette province. Ainsi que je le disais en introduction, le corpus des édifices susceptibles d’être interprétés comme sièges de corporation a été réalisé à partir des dernières synthèses disponibles. Il s’agissait donc, ici, de proposer un bilan des découvertes de décors pariétaux dans ces édifices, et de considérer si des constantes, des poncifs, pouvaient émerger de la documentation conservée.Afin d’illustrer mon propos, quatre exemples m’ont paru représentatifs, et dignes d’être retenus ici. La maison des dieux Océan à Saint-Romain-en-Gal est un des plus significatifs 31, en raison, notamment, de son plan qui, comme l’a montré P. Gros, frappe par la monumentalité de ses espaces de représentation et l’atrophie des pièces d’habitation et des espaces plus intimes, du type cubicula 32. Dans la quatrième phase de cet édifice, datée des années 170 ap. J.-C., le visiteur est accueilli dans un spectaculaire vestibule qui occupait à lui seul environ 130 m2 d’un ensemble couvrant, à cette époque, près de 3000 m2 (Fig.10). Ce vestibule qui occupe peu ou prou la place de l’atrium dans une domus traditionnelle était orné de la fameuse mosaïque de tesselles noires et blanches ornées aux écoinçons de masques du dieu Océan, probable allusion à l’élément aquatique qui favorisait la prospérité des affaires des négociants en vin (negotiatores vinarii) dont cet édifice aurait pu abriter le siège de la
corporation. Les découvertes d’enduits peints sur le site sont pour le moins sporadiques. Quelques ensembles concernent les précédents états de la maison, mais rares sont les peintures murales relevant de la quatrième phase d’occupation, celle qui nous intéresse ici. Quelques ensembles,
31 Gros 1997 et Desbat (dir.) 1994. Desbat et al.!%+2.'%12!=7%!)%+!($3($.,2#.$%+!-%!0%22%!H!-3'7+!N!%2!0%7&!-%+!%12$%(o2+!63.+.1+!+312!)%+!';'%+@!T)!(37$$#.2!+9#5.$!-%!1,530.#12+!%1!6.1!%2!31!+%!2$376%$#.2!.0.!#7!+.45%!-971%!-%!0%+!(7.++#12%+!03$(3$#2.31+!-%!negotiatores vinarii. 32!p7#12!#7&!%+(#0%+!-9W#J.2#2.31*!"@!A$3+!%+2.'%!=7%!)%7$!+7$:#0%!19%&04-%!(#+!FEa!'2! QA$3+!F[[a*!(@!D`GR@!I1!$%6#10W%*!)%+!(.40%+!-9#007%.)!Qvestibulum*!+#))%!0%12$#)%!%2!5$#1-%!+#))%!13$-!%+2R!3007(%12!($%+=7%!\EE!'2.
Fig.10 : Saint-Romain-en-Gal. Plan de la « Maison des Dieux Océan ». D’après Desbat (dir) 1994.
125
toutefois, proviennent des couches d’abandon et sont rattachés au décor de la maison des Dieux Océan. C’est ainsi que les murs du péristyle 27 étaient ornés de panneaux monochromes rouges à encadrement de bordures ajourées. En inter-panneau se trouvaient des candélabres grèles situés en avant d’entablements concaves. Ce type de composition apparaît dès le second tiers du Ier siècle ap. J.-C. Le lieu de découverte de ces enduits semble indiquer qu’ils furent peints pour orner le péristyle nord de la maison dans sa dernière phase de construction 33. Les vestiges du décor de la pièce 24 montrent, là encore, de larges panneaux monochromes rouges encadrés de bordures ajourées et séparés par des candélabres à deux brins croisés sur le même fond. Cette zone médiane repose sur un soubassement orné de touffes de feuillages, l’ensemble formant une composition picturale caractéristique de
la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C (Fig.11). D’autres petits ensembles relatifs à la dernière phase d’occupation ont été mis au jour, mais il s’agit de découvertes très sporadiques et qui, pas plus que les deux décors précédemment mentionnés, ne présentent de scènes ni même de motifs figurés. La rareté des enduits peints pourrait s’expliquer par la présence – difficile à quantifier- de placages de marbre pour orner les murs, ainsi que le suggèrent les responsables de la fouille pour le troisième état de l’édifice 34 .La maison des Nones de Mars à Limoges – une structure de près de 4000 m2 située à proximité immédiate du forum de la cité - nous offre un peu plus d’informations sur son programme décoratif 35. Cet édifice présente des caractéristiques planimétriques comparables à celles de la « maison des dieux Océan » de Saint-Romain-en-Gal, en particulier en ce qui
33!X%$+!GE!#(@!S@Pg!Q,2#2!`R@!g%22%!(#$2.%!-%!)#!'#.+31!19#!(#+!,2,!'3-./,%!-#1+!)9,2#2!\!Q(3+2,$.%7$!L!FaER@34 Desbat, Leblanc 1994, p.187.35 3735 m2!%%'%12*!0%!=7.!%1!:#.2!)#!()7+!5$#1-%!-%'%7$%!-,0376%$2%!L!f.'35%+@!87$!)%+!(%.127$%+!-%!0%2!,-./0%!C!?#$J%2!et al.!F[[]@!j!2.2$%!-%!03'(#$#.+31*!+37).51%!S@P"@!f37+2#7-*!)#!'#.+31!-7!l#71%!L!"3'(,.!1%!0376$%!H!=7%!N!D[aE!'2 (Barbet et al. F[[]*!(@!G]R@
Fig.11 : Saint-Romain-en-Gal. Restitution du décor 24, état 4. Zone inférieure à touffes de feuillages, panneaux à bordures ajourées et candélabres à deux brins croisés. D’après Desbat A. (dir.) 1994, pl.21.
126
concerne la faible superficie des espaces qui auraient pu être consacrés à la « vie de famille
» (Fig.12). Le bâtiment s’organisait selon un axe central le long duquel s’alignaient un vaste vestibule, un péristyle jardin agrémenté d’un bassin, un « triclinium cyzicène » et enfin un portique en U qui enserrait sur ses trois côtés un second jardin d’agrément attenant au triclinium 36. Deux ensembles d’enduits peints remarquables ont été mis au jour dans des pièces de réception de cet édifice. Le premier provient de la salle S4, de petites dimensions (34 m2), et fut mis au jour
dans un sous-sol condamné peu avant la fin du Ier siècle ap. J.-C. 37. La date d’exécution de ce décor
caractéristique du IIIe style pompéien doit se situer entre 35 et 45 ap. J.-C., date corroborée par le matériel découvert en association avec les fragments d’enduits. Bien que très sobre, cette paroi remarquable par sa prédelle noire ornée de canards et échassiers, était de belle facture. L’emploi d’un rouge vermillon fabriqué à l’aide de cinabre sur des panneaux entiers en de larges monochromes révèle la richesse du commanditaire, ce pigment rare étant extrêmement onéreux. Le second provient de la salle S19 de grande dimension (110 m2) et montre un décor plus simple avec une zone inférieure à fond noir et une zone médiane ornée de panneaux alternativement rouges ou noirs 38. Pas de tableaux, ni de scènes figurées, donc, dans ces salles de réceptions, mais de très belles parois monochromes agrémentées de frises décoratives ou de candélabres ornementaux. Le décor des murs du vestibule n’a pas survécu, on ne conserve donc de ce majestueux espace que la mosaïque de pavement blanche à croisettes noires,
ainsi que les aménagements hydrauliques des exèdres latérales qui, d’après l’analyse d’A. Malek, pourraient avoir été installés pour souligner la perspective axiale de la grande salle de réception39. De ce fameux « triclinium cyzicène » nous connaissons un peu mieux l’ornementation. Son sol était pavé d’une mosaïque dont les vestiges conservés témoignent de la finesse. Quant aux murs, la découverte d’un grand nombre de plaquettes
`G!f37+2#7-*!k#)%q!DEFF*!(@![\@!H!Triclinium!0<>.041%N!N!C!b3'!=7931!-311#.2!0W%>!)%+!A$%0+!L!71%!5$#1-%!+#))%!%&(3+,%!#7!13$-!%2!=7.!$,(31-#.2!#7!0,1#0)%!-%+!f#2.1+!Qf.22$,R@!37!r1!#72$%!-,03$!#!,2,!'.+!#7!U37$!-#1+!)#!+#))%!F[!C!?#$J%2!DEEZ*!(@Z\@38!f37+2#7-*!k#)%q!DEFF!(@![GP[a@39 Loustaud, Malek 2011, p. 94.
Fig.12 : Limoges. Plan de la «Maison des Nones de Mars». D’après Loustaud et Malek 2011, fig.1, p.94.
127
de marbre et de roches décoratives suggère qu’ils étaient couverts d’opus sectile. D’après le témoignage de J.-P. Loustaud, les éléments de décoration les plus riches – dont des fragments de moulures et corniches de marbre, ainsi que d’opus sectile par centaines – ont été retrouvés rassemblés en tas, dans le jardin, à proximité du triclinium 40. Ces vestiges provenaient sans doute du triclinium lui-même, mais peut-être aussi d’autres espaces de l’édifice.Sobriété iconographique des décors pariétaux, absence de tableaux ou de frises figurées
narratives, importance des revêtements de marbre sont des observations que l’on peut également formuler à propos d’un édifice mis au jour à Besançon, dit la « domus au Neptune » et dans lequel Ch. Gaston et Cl. Munier proposent de reconnaître un édifice collégial 41. L’édifice est construit dans le 3e tiers du IIe siècle, en une seule phase, après arasement de la domus antérieure. L’organisation interne s’articule autour d’un axe de symétrie nord-est/sud-ouest qui voit se succéder un vestibule, un péristyle, un oecus puis une galerie sur viridarium 42 (Fig.13).
41 Munier, Gaston, 2011, p. 183.42 Munier, Gaston, 2011, p. 172-173.
Fig.13 : Besançon. Plan de la «domus au Neptune». D’après Gaston et Munier 2011, fig.1 p. 173.
128
Les sols de chaque oecus et de la galerie sur jardin sont ornés de mosaïques, tandis qu’un terrazzo à opus signinum pave les sols des couloirs, des galeries du péristyle et de quelques autres pièces. Le plan de l’édifice révèle une impressionnante salle d’apparat ( le « grand oecus axial » ), d’une surface de près de 200 m2, dont quelques vestiges témoignent de la richesse du décor. L’élévation des murs de la salle n’est pas préservée et seuls quelques très rares fragments d’enduits peints en été retrouvés en relation avec cette pièce ; toutefois, la découverte sur le site de très nombreux fragments de placage de marbre pourrait indiquer qu’ils occupaient une place privilégiée dans le décor de ce grand oecus. Le sol de la pièce était orné d’une mosaïque dont le tableau central n’est pas sans rappeler la thématique de la mosaïque figurée éponyme du vestibule de la « maison des dieux Océan » de Saint-Romain-en-Gal, puisqu’il s’agit d’une représentation de Neptune, triomphant sur son char. A son sujet, J.-P. Darmon écrivait que par la présence de nombreux poissons et d’animaux marins et en l’absence des images des Saisons ou des Vents accompagnant généralement le Neptune cosmocratique, cette figuration évoquait davantage le rapport avec l’élément liquide que le rôle de puissance divine de Neptune 43 (Fig.14). Côté jardin, l’entrée de cet oecus était monumentalisée par un avant-corps surélevé à façade tétrastyle. Les responsables de la fouille y voient une reprise du thème du fastigium (fronton de monument public) qui, si l’on suit des observations d’A.Wallace-Hadrill, pourrait
renforcer le caractère public ou « semi-public » de la pièce 44. Le seul autre décor figuré de la maison – un médaillon orné d’une tête de Méduse - apparaît au centre du pavement mosaïqué d’une pièce de réception secondaire, sans doute un triclinium. Les écoinçons étaient également ornés de figures, dont les deux (sur 4) préservées représentent deux animaux marins (un ketos poursuivant un dauphin) et un caducée ailé. Il semble donc qu’ici encore, la symbolique protectrice de l’ensemble soit liée, comme avec Neptune, à l’élément liquide 45. Quelques éléments du décor pictural de cette pièce sont conservés, révélant, de nouveau, une composition d’une grande austérité caractérisée par une alternance de panneaux rouges et d’inter-panneaux noirs. Finalement on ne peut qu’être frappé par un programme ornemental dont la richesse – si l’on en croit la quantité de fragments de marbre mis au
43!k71.%$!DEEa*!63)@!D*!(@!DD]PD]G@44!d#))#0%!e#-$.))!F[[\*!(@!F[@!45!k71.%$!A#+231!DEFF*!(@!Fa]PFaG@
Fig.14 : Besançon, «domus au Neptune». Mosaïque représentant Neptune. D’après Gaston et Munier 2011,fig.4, p.176.
129
\G!Y3J.%!F[ZF^!?37%2!DEEF@
jour – n’avait d’égal que la grande sobriété iconographique. Comme le soulignent C. Munier et D. Gaston, le nombre, la dimension et la qualité des mosaïques contribuaient à conférer un grand luxe à ces espaces que leur originalité architecturale rendait déjà remarquables. Comme à la « maison des dieux Océan » ou à la « maison des Nones de Mars », l’importance des espaces de représentation ne rendait que plus perceptible l’atrophie des espaces de vie. C’est une des raisons pour lesquelles ils proposent de reconnaître dans cet édifice le siège d’une corporation, peut-être liée aux activités fluviales du naviculaire, ce qui expliquerait éventuellement que les deux seuls motifs figurés du décor évoquent l’élément liquide avec une connotation prophylactique.La « domus des Bouquets » de Périgueux dans laquelle nombre de chercheurs s’accordent à reconnaître un édifice collégial depuis les démonstrations de J.-L.Tobie et d’A.Bouet permet d’ajouter d’autres réflexions à notre
analyse sur le décor des ces édifices 46. A priori, pas ou peu de placages de marbre dans cet édifice dont les murs étaient majoritairement ornés d’enduits peints. Il est clair que le marbre était un matériau fort onéreux qui n’a pu être adopté que par les collèges dont les donateurs ont été suffisamment généreux pour financer un décor aussi luxueux. Pour les autres, il est évident que les enduits peints s’imposaient ; rappelons le cas du « collège des Augustales » d’Herculanum dont les placages de marbre pariétaux ont été réservés aux murs du sacellum. Mais l’étude de D. Tardy et E. Pénisson révèle que l’on a fait, à la domus des Bouquets, des choix ornementaux qui permettaient de faire illusion à cet égard. C’est ainsi que le décor du portique du péristyle s’inspire nettement d’un modèle architectural (Fig.15). Après remontage, les fragments d’enduits peints mis au jour dans l’angle nord-est et au sud du péristyle montrent un décor d’imitations d’architectures de marbre à veines vertes et
Fig.15 : Périgueux, «domus des Bouquets». Restitution du décor architectonique à imitations de marbre du péristyle. Imitation de plaques moulurées et pilastres corinthiens. D’après Tardy, Bujard et Pénisson 2011, fig.3, p.114.
130
roses sur toute la hauteur de la paroi. Au-dessus d’un soubassement de 70 cm à 1 m de haut, imitant un marbre blanc à veines vertes, se déploie une zone médiane ornée d’imitation de plaques moulurées rythmées par des pilastres cannelés à chapiteaux corinthiens. Cette composition est exceptionnelle, en particulier par la sobriété des teintes mises en œuvre, au regard de la prédilection généralement observée des commanditaires romains pour les opus sectile aux teintes vives. Rares sont également, dans ce type de décor, les pilastres cannelés et les plaques moulurées. On perçoit ici de manière très claire la volonté d’imiter un modèle architectural de la manière la plus réaliste possible. A cet égard, les auteurs de la publication du décor ont fait valoir la parenté entre cette composition pariétale, et le décor de la cella de la Tour de Vésone. Rappelons qu’A. Bouet a proposé de reconnaître dans cette domus intégrée dans l’insula de la « Tour de Vésone » le siège d’un collège de subaediani 47, dont les activités étaient donc liées au sanctuaire voisin. C’est ainsi que les fragments de placages de marbre mis au jour dans la cella de la Tour de Vésone montrent un décor d’architectures corinthiennes à pilastres cannelés réalisé à l’aide de marbre veiné rose ou vert, tout à fait semblable aux imitations ornant le péristyle de la « domus des Bouquet ». Pour les archéologues de Périgueux, nul doute que la similitude entre ces deux décors n’est pas fortuite, et que le projet d’imiter à la domus des Bouquets le décor de la cella du temple voisin
conforte l’interprétation de cet édifice en siège d’une association de subaediani. Un autre décor remarquable est à signaler dans cet édifice, puisqu’il s’agit du seul décor figuré gallo-romain présenté ici. Il s’agit d’un ensemble d’enduits peints découvert en remblai sous la salle 46 et dont on a longtemps pensé qu’il ornait le vaste vestibule de la maison (pas moins de 110 m2) mais dont on estime aujourd’hui qu’il devait appartenir aux murs du jardin. Cet imposant décor de munera - impressionnant par ses dimensions puisque les personnages, disposés sur plusieurs registres, ne mesuraient pas moins de 140 cm de hauteur - devait certainement avoir une valeur commémorative,
47!87.2%!L!+31!($3:31-!$%'#1.%'%12!-7!TTe!+.40)%@!f9,-./0%!+%$#!#J#1-311,!L!)#!/1!-7!TTTe!+.40)%!Q?37%2!DEEF*!(@!D\aR@
Fig.16 : Périgueux, « domus des Bouquets ». Détail du décor de munera. Relevé A. Lefèvre, dessin F. Ory. D’après Barbet 2008, fig.355.
131
si l’on en croit les inscriptions peintes qui y sont associées 48 (Fig.16). Les représentations de munera ne sont pas rares, mais ce qui est exceptionnel ici, ce sont les proportions ; on estime, en effet, que ces jeux de gladiateurs se développaient sur 4 à 5 m de hauteur, ce qui serait tout à fait inédit en contexte domestique. Le reste du décor peint de la maison témoigne de la même sobriété que celle mise en valeur dans les autres édifices collégiaux étudiés.Si, comme l’atteste le foisonnement de la représentation des corporati dans l’espace de la schola, le rôle commémoratif de l’édifice apparaît évident, il importe de placer les limites de la place de ces édifices comme « lieu de mémoire » de la corporation. La volonté d’auto-représentation imposait nécessairement l’exhibition du portrait des membres et des bienfaiteurs du collège, mais la volonté commémorative pouvait-elle s’étendre à l’évocation d’événements organisés à l’initiative du collège ? On est en droit de l’imaginer quand on est confrontés à des documents tels que les peintures de munera de la « domus des Bouquets », mais il faut se garder de généraliser. En effet, toutes les peintures de munera ne sont pas commémoratives, et toutes les peintures commémoratives ne doivent pas être rattachées à des édifices publics ou collégiaux. Comme j’ai eu l’occasion de le montrer ailleurs, certaines domus ont servi de cadre à de très beaux décors à caractère officiel, religieux ou commémoratif 49.
Pour conclure, ce qui caractérise le décor pariétal de ces scholae, ce n’est pas tant la présence de placages de marbre et d’opus sectile pariétaux, que l’on retrouve bien souvent dans les plus belles demeures de l’élite. A la lueur des vestiges conservés, ce qui nous apparaît comme tout à fait caractéristique, c’est l’effacement des images, ou plutôt l’absence de certains types d’images sur les parois. Ainsi que nombre d’études l’ont montré, le cadre domestique fournissait aux élites l’occasion d’utiliser le décor pour affirmer leur culture, ainsi que leurs valeurs sociales et personnelles 50. Dans les scholae, les images mythologiques et plus généralement toutes celles relevant de la sphère intellectuelle et culturelle sont souvent absentes, ou en tout cas marginales 51. Or, c’est celles-là même que les riches particuliers – soucieux de se conformer au type du mousicos aner - ne manquaient pas de multiplier dans leur demeure, aussi bien sur les murs que sur les sols, composant de véritables programmes iconographiques à la richesse et la subtilité telles qu’elles déroutent bien souvent les chercheurs qui se consacrent à leur exégèse 52. D’autre part, il semble que sur les murs des scholae, un décor sobre s’imposait, afin de laisser toute la place aux programmes statuaires destinés à mettre en valeur l’effigie des membres de la famille impériale et des corporati. Car à l’intérieur de l’édifice collégial – contrairement à ce que l’on observe en contexte domestique – ce n’est pas la « culture » des collegiati qu’il convenait afficher, mais leur loyalisme envers l’empereur et leur fidélité aux valeurs impériales.
48 Barbet et al. 1999, p. 18-19. Barbet 2008, p. 227-229. 49 Dardenay 2011.50!V.1+.!=7%!)%!$#((%))%!I@!k3$6.))%>!Qk3$6.))%>!DEEG*!(@!][FP][DR@51!j!)9%&0%(2.31*!-#1+!0%$2#.1+!0#+*!-%!+#))%+!-%!J#1=7%2+!Q-7!2<(%!triclinia!37!#72$%+R*!=7.!$%)46%12!-%!)#!+(W4$%!-%!)9otium et (%76%12!(3$2%$!-%+!-,03$+!'<2W3)35.=7%+!0#$#02,$.+2.=7%+!-%!0%!2<(%!-9%+(#0%+@!g.231+!)9%&%'()%!-%!)#!+#))%!+%'.P%12%$$,%!-7!JO2.'%12!-7!H!+.2%!-%+!VAl!N!L!bc'%+!=7.!(37$$#.2!$%)%6%$!-%!)#!+(W4$%!03)),5.#)%@!"37$!)#!$%)%027$%!-%!0%!+.2%*!63.$!.1:$#*!)9#$2.0)%!-%!M@!M#$-%!%2!k@!gW$.+23)!!^!!(37$!)%+!'3+#n=7%+!-7!+.2%!-%+!VAl!L!bc'%+*!0:!M#$'31!F[[E*!(#$2@!(@!a`Pa\@!V72$%!0#+!(#$2.07).%$!#7!+%.1!-%+!,-./0%+!03)),5.#7&*!0%)7.!-%+!sacella*!=7.!(%76%12!(3$2%$!!P!L!)9.'#5%!-%!0%!=7%!)931!3J+%$6%!-#1+!0%)7.!-%!)#!H!+%-%!-%5).!V757+2#).!N!-9e%$07)#17'!s!-%+!-,03$+!(%.12+!/57$,+!'#1.:%+2#12!)#!($,+%10%!-%+!-.6.1.2,+!W313$,+@!I1!A#7)%*!0%)#!(37$$#.2!;2$%!)%!0#+!-7!).%7!-%!07)2%!.-%12./,!-#1+!)9,-./0%!+#1+!-372%!03)),5.#)!-%!)#!$7%!?#7-.'312!L!V$$#+!Q0:!S#0=7%+!et al. 2008, p. 249-251). Dans ce probable local destiné à abriter les réunions des dendrophori, des peintures pariétales /57$#12!g<J4)%!%2!V22.+!3$1#.%12!71!).%7!-%!07)2%!Qibidem*!(@D\E*!/5@GR@@52! I@!k3$6.))%>!-311%!()7+.%7$+! %&%'()%+! %2! #1#)<+%!=7%)=7%+! 0#+!-#1+! +31! #$2.0)%! H!k.+%! %1! +041%!-%+! 0W3.&! 07)27$%)+! N!Qk3$6.))%>!DEEGR@!
132
Bibliographie
complesso degli Augustali », MDAIR, 107, 2000, p. 79-108..
Augusteum », dans M.P. Guidobaldi (dir.),
Ercolano, tre secoli di scoperte, Naples, 2008, p. 34-45.
Recherches d’architecture et d’urbanisme antiques sur les curies provinciales du monde romain, Bruxelles, 1991.
Décor et architecture en Gaule entre l’Antiquité et le haut Moyen Âge. Mosaïque, peinture, stuc, Actes du colloque international de Toulouse II-Le Mirail, 9-12 octobre 2008, Bordeaux, Ausonius, 2011.
et al. 1995 : A. Barbet, F. Monier, J.-P. Loustaud, « Les peintures murales de la maison des
Nones de Mars à Limoges », Aquitania, II, 1993 (1995), p. 63-111.
et al. 1999 : A. Barbet, J.-P. Bost, C. Girardy-Caillat, A. Lefèvre, B. Amadei, Fresques de gladiateurs à Périgueux, Exposition au Musée du Périgord du 14 mars au 13 septembre 1999, Périgueux,
1999.
La peinture murale en Gaule romaine, Paris, 2008.
Römische Vereinshäuser. Untersuchungen zu den Scholae der römischen Berufs-,Kut-und Augustalen-Kollegien in Italien, Mayence, 1998.
Subaediani », Revue Archéologique,
2001, 32, p. 227-278.
Les Élites et leurs facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romain, Rome, 2003.
thèmes iconographiques dans la peinture en Gaule romaine », dans Balmelle, Eristov, Monier
2011, p. 345-357
Archéologie à Nîmes, 1950-1990. Bilan de 40 années de recherches, Nîmes, Musée archéologique, 1990, p. 63-75.
La maison des dieux Océan à Saint-Romain-en-Gal (Rhône), Paris, 1994.
Le phénomène associatif dans l’Occident romain, Bordeaux, 2012.
cosidetto édifice des Augustales d’Herculanum », dans
L. Franchi Dell’Orto (éd.), Ercolano 1738-1988 : 250 anni di ricerca archeologica, Rome, p. 345-349.
L’insula II di Velia. Una scuola-collegio di età augustea,
Rome, 1989.
133
Herculanensium Augustalium aedes and the theology of ruler cult », dans
Classical archaeology towards the third millennium. Reflexions and perspectives. Proceedings of the XVth International Congress of Classical Archaeology, Amsterdam, July 12 - 17, 1998, Amsterdam, 1999, p. 166-169.
Roman Portraits in Context, Berlin, 2008.
domus au Neptune à Besançon : les sols au sein
d’un programme architectural ostentatoire », dans Balmelle, Eristov, Monier 2011, p. 171-183.
Occident », Revue des Études anciennes, 133/1, 2011, p. 47-67.
2012, p. 63-80.
associatif dans la Gaule romaine méridionale », Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1997, p. 213-241.
Herculanensium Augustalium Aedes », Cronache Ercolanesi, 13,
1983, p. 159-175.
et alii, « Vestiges de
repas et identification d’un siège de collège à Arras-Nemetacum » (Gaule Belgique), dans S. Lepetz,
W. Van Andringa (dir.), Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine. Rituels et pratiques alimentaires,
Montagnac, 2008, p. 237-252.
Paries, a proposal for a dating system of late-antique masonry structures in Rome and Ostia, Amsterdam, 1982.
Memoirs of the American Academy in Rome, 45, 2000, p. 41-84.
domus
de l’élite d’Augustoritum », dans Balmelle, Eristov, Monier 2011, p. 93-109.
Il sacello degli Augustali di Miseno, Naples, 2000.
Herculanensium Augustalium Aedes », Cronache Ercolanesi, 13, 1983, p. 175-177.
d’Occident dans leurs domus et villae en Occident (IIe et IVe siècles) », dans M.H. Quet (dir.), La « crise » de l’Empire romain, de Marc-Aurèle à Constantin, Paris, 2006, p. 591-634.
Basilica in
Herculaneum », dans Pompeian Brothels. Pompeii’s ancient history, mirrors and myseries, art and nature at Oplontisand the Herculaneum « Basilica », Portsmouth, 2002, p. 122-165
134
domus :
un langage ornemental commun ? L’exemple de Vesunna », dans Balmelle, Eristov, Monier 2011,
p. 111-124.
dans Périgueux, Le Périgord, Les anciennes industries de l’Aquitaine, Actes du XXXe Congrès d’Études régionales tenu à Périgueux les 22 et 23 avril 1978, Périgueux, 1981, p. 30-33.
basilica di Ercolano : une proposta di lettura », Eidola. International Journal of Art History, 1, 2004, p. 117-149.
Les membres des associations romaines. Le rang social des ‘collegiati’ en Italie et en Gaule sous le Haut-Empire, Collection de l’Ecole Française de Rome 367, Rome, 2006.
Herculaneum : in search
of the identities of the public buildings », Journal of Roman Archaeology, 24, 2011, p. 121-160.