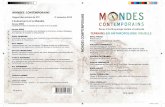Affinités, parentés et territoires en Gaule indépendante : fragments d'anthropologie
-
Upload
u-picardie -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Affinités, parentés et territoires en Gaule indépendante : fragments d'anthropologie
Publié avec le concours du ISSN 0755-7256
Centre National de la Recherche Scientifique
dialogues d'histoire ancienne
1990
Monsieur Serge Lewuillon
Affinités, parentés et territoires en Gaule indépendante :fragments d'anthropologieIn: Dialogues d'histoire ancienne. Vol. 16 N°1, 1990. pp. 283-358.
Citer ce document / Cite this document :
Lewuillon Serge. Affinités, parentés et territoires en Gaule indépendante : fragments d'anthropologie. In: Dialogues d'histoireancienne. Vol. 16 N°1, 1990. pp. 283-358.
doi : 10.3406/dha.1990.1471
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/dha_0755-7256_1990_num_16_1_1471
DIÍA 16,1 1990 283-357
AFFINITES, PARENTES ET TERRITOIRES EN GAULE INDÉPENDANTE :
FRAGMENTS D'ANTHROPOLOGIE.*
Serge LEWUILLON
Vae autem fratribus in populo barbaro. Vae et cognatis. [...] Solum uero alumnis et collectaneis, si quid habent uel amoris uel fidei, illud habent.
GIRALDUS CAMBRENSIS, Topographia Uibernica , III, 23.
I. LE CHAMP ANTHROPOLOGIQUE.
1. ÉTUDES INDO-EUROPÉENNES.
C'en est fini aujourd'hui de disputer de la notion de modèle en histoire car, pendant qu'on disputait, la pratique s'est imposée. Rendant au mot idéologie son sens presque ingénu de "systèmes
"Premiers fragments", en vérité ; deux autres études au moins compléteront celle-ci : l'une sur l'historiographie du droit, de la sociologie et de l'anthropologie ; la seconde sur l'évolution des formes de mariage et les transformations historiques de la parenté celtique; il faudrait une troisième étude sur les formes insulaires de la parenté.
284 Serge LEWUILLON
d'idées", G. Dumézil a démontré, il y a déjà beau temps, la nécessité de la lecture idéologique des mythes propres aux sociétés indoeuropéennes afin d'y retrouver d'antiques modes de pensée déjà révolus à l'époque où la légende était couchée par écrit. Offrant au mot structure d'investir largement le champ des sciences humaines, Cl. Lévi-Strauss a souligné le rôle du modèle dans l'ordonnancement des mythes et des attitudes, afin d'en décoder le langage celé *. Ces deux savants ne sont ni le commencement, ni la fin des recherches sur les sociétés antiques : il y eut avant eux des juristes, des archéologues, des sociologues et des historiens pour chaque étape de l'historiographie, comme il en existe après eux. Les Indo-Européens se concevaient avant Dumézil et le structuralisme de Lévi-Strauss s'estompe déjà 2. Demeure l'anthropologie historique. L. Gernet en avait affirmé , voici longtemps, l'usage pour la Grèce ^ ; elle a désormais conquis sa place en histoire romaine, aux côtés de toutes les autres méthodes ; et voici môme, à travers l'intérêt porté à la famille, le temps des premières synthèses 4. Mais si les romanistes
1. LEVI-STRAUSS (CL), Anthropologie structurale , Paris, 1958 (cf. notamment "l'analyse structurale en linguistique et en anthropologie", p. 43-69 ; "Linguistique et anthropologie", p. 83-97 ; "La structure des mythes", p. 235-265). Il ne m' échappe donc pas que la pensée lévi-straussienne plonge ses racines dans la linguistique, dont les théoriciens font figure de précurseurs en structuralisme. Dans la suite de cet exposé, je n'oppose donc pas anthropologie et linguistique, mais les études de la terminologie et celle sur les rapports sociaux, à l'intérieur de la parenté. Cf. JUCQUOIS (G.), " Termes de parenté en indo-européen et anthropologie structurale", Le Muséon , 82, 1969, p. 213-230.
2 LEVI-STRAUSS (Cl.), Le Regard éloigné , Paris, 1983, "Préface", p. 11- 13. DE HEUSCH (L.), "Situation et positions de l'anthropologie structurale" in Cl. Lévi-Strauss [éd. BELLOUR-CLEMENT]. Paris : 1979, p. 135-156.
3. Anthropologie de la Grèce antiaue , Paris, 1968 [pour le recueil], (Textes à l'appui ).
4 Cf. POUCET (J.), Les Origines de Rome. Tradition et histoire, Bruxelles, 1985 (Publ. des Fac. univ. Saint-Louis , 38) : analyse de toutes les écoles dans le cadre d'une histoire de l'historiographie romaine. Une place importante est réservée à G. Dumézil : on s'y reportera pour la philosophie de l'histoire de ce dernier, ainsi que pour sa bibliographie. Sur le monde antique en général - sauf la Gaule celtique,- cf. X Histoire de la famille. 1. Mondes lointains,
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 285
sont choyés par la relative abondance des sources, il n'en va pas de même pour les historiens des sociétés réputées sans écriture propre, dont les Celtes. Ceci s'explique par l'histoire même de leur "ethnographie", qu'on ne pourra qu'effleurer ici ^.
Les principes posés par les pères fondateurs de l'anthropologie de la parenté, au sens où nous entendons ces termes aujourd'hui, obéissaient à deux types de démarches : l'une proprement ethnographique, sorte d'inventaire méticuleux, avec une forte propension à la théorie ethnologique ; l'autre, plus encline à la taxonomie, à base de terminologie et de langage. On aura une idée de la première en lisant l'oeuvre de J. Frazer ^ et un aperçu de la seconde en étudiant L.-H. Morgan 7. L'oeuvre de Frazer a évidemment connu des fortunes diverses, qui l'ont surtout placée en faveur, à mon sens, auprès de l'école sociologique naissante dans le premier tiers de ce siècle. Quoiqu'on la redécouvre aujourd'hui, il faut reconnaître que le chemin qu'elle suivit n'était pas le plus propre à mener à l'apothéose historiographique.
Tout autre fut la destinée des idées de Morgan : distinguées par Engels , elles apportèrent sans délai leur pierre à l'édifice évolutionniste ^. Ses propres enjeux historiques, philosophiques et
mondes anciens . [dir. BURGUIERE (A.), KLAPISCH-ZUBER (C), SEGALEN (M.), ZONABEND (F.)]. Paris : 1986.
5. On réserve à d'autres travaux l'étude des conditions de la production d'histoire des sociétés celtiques de la Gaule dès l'aube du XIXe siècle jusque dans le courant du XXe.
6. The Golden Bough (à partir de l'édition de 1913-1915 (Le Rameau d'or , dans la trad. fr. de 1925-1937, Paris, 1984).
7. Ancient Society , 1877 (La Société archaïque , trad. JAOUICHE (H.), prés, et intr. [avec commentaires très abondants] de MAKARIUS (R.), Paris, 19852).
8. De l'origine de la famille, de la propriété et de l'Etat , lere éd. 1884 ; cf. la quatrième édition (1891) pour sa préface et ses ajouts, qui constituent une bonne recension des idées ethnologiques de la deuxième moitié du XIXe siècle : Engels y dit sa dette pour Bachofen (et auparavant, Maurer et Latham), Me Lennan et, bien entendu, Morgan, parmi d'autres, (cf. rééd. et trad, aux Ed. Sociales, Paris, 1975, qui donne des textes complémentaires parfois plus "souples" que L'Origine ... : "Sur l'histoire des anciens Germains", trad. BOTTIGELLI (E.), p. 193-249).
9. Cf. quelques remarques sur ce genre de processus in GODELIER (M.), "Anthropologie et économie. Une anthropologie économique
286 Serge LEWUILLON
politiques la dépassèrent rapidement et lui valurent, surtout après 1917, une réelle occultation de ses aspects sociologiques. Restait alors leur aspect terminologique, qui trouva son accomplissement dans les études linguistiques appliquées aux Indo-Européens ( déjà très en vogue à la fin du XIXe siècle) et même, bientôt, aux Proto- Indo-Européens. Les méthodes scientifiques furent rapidement éprouvées, mais elles comportaient tout de même un certain inconvénient : celui d'envisager les rapports sociaux d'abord par le biais de leurs dénominations. Si l'on veut - pour prendre un exemple simple - l'étude de la parenté fut d'abord celle des termes de parenté. Quoi qu'il en soit, cette démarche déboucha sur des travaux importants dont le moment le plus marquant est sans doute la parution du Vocabulaire des Institutions indo-européennes d'Emile Benvéniste (1969) ^. Cet ouvrage n'est certes pas le premier du genre, mais toute discussion sur certains noeuds de la théorie de la parenté , comme la notion de Yauunculus latin, par exemple, lui fait obligatoirement référence. Faut-il enfin préciser qu'il n'existe pas d'anthropologues de formation pour les sociétés anciennes comme il en existe pour les sociétés dites primitives et que tous ceux qui ont à s'occuper de ce département quelque peu marginal relèvent soit du droit, soit de la linguistique (sauf, bien entendu, pour le monde grec, où T'école française", depuis L. Gernet notamment, a coutume de se distinguer par des analyses dont la nature, les sources et la méthode, très culturelles, n'entretiennent avec nos préoccupations barbares que des rapports de complémentarité ...) ^ ? Leur domaine est exclusivement celui de la parenté, abordée surtout sous l'angle de la terminologie ^ ; on les a trouvé surtout dans les pays anglo-
est-elle possible ?", Un domaine contesté: l'anthropologie économique , Paris, 1974 [=1973], p. 285-345 ; id., "Préface", Sur les sociétés précapitalistes, Paris, 1973, p. 19-142.
10. BENVENISTE (E.), "Termes de parenté dans les langues i.-e.", L'Homme , 5, 1965, p. 5-16.
11. Sur les rapports de l'anthropologie culturelle du monde grec avec l'histoire de l'anthropologie au sens large, cf. VIDAL-NAQUET (P.), "Le cru, l'enfant grec et le cuit" in Le Chasseur noir. Paris : 1981, p. 177-207 : 181-196.
12. On aura un excellent aperçu de la bibliographie de cette spécialité pour le monde romain in FRANCIOSI (G.), Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia délia famiglia romana, I, Naples, 19782 (cet ouvrage présente une vue de la famille replacée dans l'évolution de l'ensemble de la société : ce vaste projet
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 287
saxons 13. Cette dernière remarque n'est pas gratuite : elle implique que, pour les "ethno-linguistes" anglophones, les modèles
condensé en un si petit volume, ainsi que l'attachement de son auteur à des idées qui peuvent apparaître obsolètes (par exemple sur la communauté antique) permettent de le rattacher, à certains égards, à l'école évolutionniste - mais cela ne saurait déboucher sur une condamnation globale du travail : ses idées sur le "mariage de groupe", notamment, comporte une grande part de vérité, quoi qu'on en ait dit). SZEREMENYI (O.), "Studies in the Kinship Terminology of the i.-e. languages, with special references to Indian, Iranian, Greek and Latin", Ada Iranica (Textes et Mémoires), 16, 1977 (Varia , 7), p. 1-240 (notamment, de notre point de vue, pour sa pertinente critique des thèses antérieures et spécialement du recours au système (Crow-)Omaha (p. 169-195); c.-r. très suggestif de ces deux ouvrages : MOREAU (Ph.), "La terminologie latine et indoeuropéenne de la parenté et d'alliance à Rome : question de méthode", R.E.L. , 1978, p. 41-53 ; id. , "Plutarque, Augustin, Lévi- Strauss : prohibition de l'inceste et mariage préférentiel dans la Rome primitive", R.B.P.H. , 56/1, 1978, p. 41-54 ; id. , "Quelques termes de parenté chez Tacite", Mélanges Wuilleumier , Paris, 1980, p. 239-250 ; la plupart des textes "canoniques" sont cités dans l'article fondamental - pour sa perspective historique - de THOMAS (Y.), "Mariages endogamiques à Rome. Patrimoine, pouvoir et parenté depuis l'époque archaïque", R.H.D.F. , 1980 (nlle sér., n° 3), p. 345-382; enfin, pour quelques critiques pertinentes aux précédents, et spécialement sur la manière de considérer l'enquête et le raisonnement anthropologiques, cf. HANARD (G.), "Inceste et société romaine républicaine. Un essai d'interprétation ethno- juridique du fragment du livre XX de l'histoire romaine de Tite-Live", R.B.P.H. , 64, 1986, p. 32-61. Par malheur, tout cela ne concerne les sociétés celtiques que très indirectement ... Il y a quelques mises au point à attendre de la publication des actes de la table ronde Parentés et stratégies dans l'antiquité romaine, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, du 2 au 5 octobre 1986. On trouvera une excellente présentation de l'état de la question dans BURGUIERE (A.), e.a. (dir.), Histoire de la famille .1. Mondes lointains, mondes anciens. Paris 1986 (mais qui ne traite pas des sociétés celtiques).
13. Cf. dans le c.r. de Moreau cité ci-dessous les références aux importants travaux d'Archie Bush, dont on verra surtout, d'un point de vue anthropologique "Parent's Cousin and Cousin's Child", A.]. Ph., 1972, p. 568-575 ; id. , "Latin Kinship Extensions. An Interpretation of the Data", Ethnology, 10, 4, 1971, p. 409-433; GALTON (H.), "The i.-e. Kinship Terminology", Zeitschrift fur Ethnologie , 82, 1957, p. 121-138 ; FRIEDRICH (P.), "Proto-i.-e.
288 Serge LEWUILLON
d'ethnologie théorique soient différents de ceux des chercheurs français. De fait, on remarquera l'extraordinaire présence de Radcliffe-Brown ou de Lowie dans leurs travaux, contrastant avec ce que l'on peut appeler, malgré quelques exceptions, le rejet quasi absolu des thèses de Lévi-Strauss ^. Ce dernier ayant enseigné aux Etats-Unis, et si l'on ne peut soupçonner les universitaires américains d'impéritie, il faut en conclure à une question de philosophie : on ne goûte sans doute pas - et il y a de bonnes raisons théoriques de ne pas en douter - ce structuralisme-là outre- Atlantique 15...
Pour compléter ce rapide tour d'horizon, disons que la position des anthropologues italiens paraît exactement inverse, ceux-ci appréciant tout particulièrement le concept d'attitudes (atteggiamenti) chez Lévi-Strauss 16. Quant au monde scientifique germanique, ce n'est pas en médire que de reconnaître sa relative discrétion actuelle dans le débat proprement anthropologique : il paie, en quelque sorte, le fait de s'y être intéressé précocement et d'avoir donné, par conséquent, les ouvrages fondamentaux se rattachant aux premières conceptions de l'anthropologie 17 : quelque
Kinship", Ethnology , 5, 1966, p. 1-36. Pour les articles sur des problèmes spécifiques de la parenté, cf. infra , n. 14, 45 ; p. 23-25.
14. L'ouvrage récent de MURRAY (A.), Germanie Kinship Structure. Studies in Law and Society in Antiquity and Early Middle Ages , Toronto, 1983 (Pontifical Institute of Mediaeval Studies) ne le mentionne même pas en bibliographie ! ... Sur les raisons de ce rejet, cf. TESTART (A.), in ENGELS, L'Origine ..., p. 14a. La distance n'est pourtant pas infranchissable entre Radcliffe-Brown et Lévi- Strauss ! Cf. RADCLIFFE-BROWN (A.R.), Structure et fonction dans la société primitive [articles en trad. fr. par Fr. et L. MARIN. Paris : 1968].
15. Sur l'incompatibilité entre deux formes irréductibles de structuralisme, la française et l'anglo-saxonne, cf. SAHLINS (M.), Au coeur des sociétés. Raison utilitaire et raison culturelle . Paris: 1980 (trad. s. FAIZANG [=1976, texte anglais] : "Le marxisme et les deux structuralismes", p. 13-76; VIDAL-NAQUET (P.), op. cit., p. 185.
16. Notamment BETTINI (M.), "Pater 'auunculus', auus nella cultura romana più arcaica", Athenaeum, 72, 1984, p. 468-491 ; autres références in FRANCIOSI (G.), loc. cit.
17. BACHOFEN (JJ-), Das Mutterrecht, Berlin, 1861; DELBRUECK (В.), Die indogermanische Verwandschaftsnamen ; ein Beitrag zur vergleichenden Alter tumskunde , Leipzig, 1889 ; MEITZEN (A.), Siedelung und Agrargeschichte der Westgermanen, Ostgermanen,
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 289
chose comme une ethnogénie, par exemple ... Depuis, leurs préoccupations se sont tournées avec bonheur vers le domaine de la linguistique indo-européenne ^.
Dans ce concert, la partie du celtisant n'est ni facile, ni prestigieuse. C'est que le poids du passé se fait impitoyablement ressentir : nous parlions à l'instant d'ethnogénie , et c'est encore chose honorable en regard des avatars "crâniologiques" de l'anthropologie française balbutiante. Mais passons là-dessus pour souligner une autre difficulté : la méconnaissance longtemps persistante du passé des Celtes, du moins tant que l'archéologie n'eut pas produit ses effets. Et pour quel résultat ? Pour les Germains, des bribes ; pour les Gaulois, des illusions ; pour les Celtes en général et les insulaires en particulier, des rêves. Sur ces pousses douteuses vint se greffer la mythologie politique du nationalisme belliqueux "fin de siècle". Le débat s'embourba décisivement : où étaient les Gaulois, où les Germains, où leurs frontières ? ... Il restait, comme en toute occasion où la confrontation gallo-germanique prend vilaine tournure et que le Rhin est aboli, la solution insulaire. Ainsi, les spécialistes de l'ethnologie juridique élirent pour nouveau champ d'études la littérature épique des Irlandais et des Gallois et leur ancien droit, en compilations médiévales : c'était l'époque de d'Arbois de Jubainville, de J. Loth, de S. Rcinach, de P. Collinct ou
Kelten, Finnen uni Slawen , Berlin, 1895 : cet ouvrage traite surtout de peuplement (occupation du sol) et des populations (I, iii, p. 174- 232) : la société celtique y est étudiée à partir des cas insulaires, la Gaule étant considérée comme moins "originale". L'auteur y voit une société patriarcale et clanique vivant dans un régime de communauté agraire. Peu de choses ont trait à l'anthropologie proprement dite : les systèmes de dévolution (gavelkind et tanistry ), dont la critique a été faite par d'Arbois de Jubainville; une brève notice sur la communauté des femmes et sur le matriarcat (p. 230- 231 et n. 1). Sur les formes spécifiques de l'anthropologie allemande pendant la seconde moitié du XIXe siècle et tout le début du XXe (on pense notamment à l'oeuvre de Rudolf Virchow), cf. POLIAKOV (L.), Le mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et du nationalisme. Bruxelles : 1987 [= 1971 l], p. 194-199, 219-227, 255 sq. et surtout 292- 330.
18. Voyez la bibliographie in FRIEDRICH (P.), op. cit. , p. 34-36 ; SZEREMENYI (O.), op. cit., p. 207-212 ; MURRAY (A.), op. cit. , p. 245-252.
290 Serge LEWUILLON
encore d'H. Hubert - pour ne parler ici que des celtistes français dont la priorité aurait dû demeurer, en principe, l'étude des Gaulois.
Ainsi, confrontés aux mêmes problèmes que les romanistes, les celtistes avaient ni les mêmes méthodes, ni les mêmes enjeux, ni, finalement, le même objet. En effet, il s'agissait pour eux d'imposer une méthodologie particulière consistant à faire admettre des extrapolations en chaîne : ce que l'on connaissait des Germains - qui avaient Tacite pour eux - pouvait se répéter, dans une mesure appréciable, des Gaulois ; ce que nous contaient les textes celtiques tardifs s'appliquait, jusqu'à un certain point, aux sociétés de la Gaule antique; ce qui s'exprimait, par la bouche des Latins, révélait approximativement la pensée d'un peuple muet.
Il ne faut voir aucune dérision à l'énoncé de ces problèmes : ils se posent encore aujourd'hui et la pratique ne doit pas être de les ignorer ou de renoncer, mais de déterminer les degrés de validité de ces extrapolations. L'enquête anthropologique sur les sociétés celtiques et sur leurs structures idéologiques, où régnent celles de la parenté, permet certes de faire progresser les connaissances objectives sur l'histoire des Gaulois, mais surtout de mettre en évidence de façon très précise les écarts et les rapports entre les Celtes continentaux et leurs cousins - terme de circonstance - insulaires.
2. L'ENQUÊTE.
On voit que ces problèmes préalables aboutissent à une véritable question préjudicielle: l'accès à la typologie sociale qu'exige l'enquête préconisée est-elle possible par la linguistique ? Il est clair dès le départ que ce qui fait l'essentiel de la méthode d'investigation de toutes les autres parties du monde indo-européen ne peut être appliqué aux Gaulois, dont nous n'avons pour ainsi dire pas recueilli le langage. Dès lors, point de terminologie de la parenté qui tienne, si ce n'est au prix d'une critique rigoureuse du vocabulaire romain "interprété". Pourtant, sans prétendre à un système aussi parfait que celui d'A. Bush pour la parenté latine, nous croyons à la possibilité de retrouver quelques traits suffisants pour esquisser un cadre cohérent - ou dont la cohérence, en tout cas, se reflète dans celle du vocabulaire latin. Le vocabulaire de César et de Tacite obéit à une logique dont ces auteurs ne se départissent jamais et leurs silences ou leurs hésitations en disent parfois plus long qu'un terme trop évident. Ainsi en va-t-il des couples
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 291
terminologiques qui précisent le sens d'une notion, que l'originalité de cette notion tienne à la société observée (fratres/consanguinei) ou qu'elle résulte de l'extinction du sens dans la société romaine elle- même (gentes /cognationes : la gens est vidée de son sens archaïque à l'époque de César et de Tacite). Les couples se font écho à travers le champ sémantique de la parenté et forment pour l'observateur une combinatoire plus vaste qu'on ne le croit de prime abord, avant de révéler leur nature linguistique intime et, finalement, leur fonction idéologique. Tout ceci fonctionne, pourvu qu'on ait le matériau. Or, nous possédons un important corpus d'occurrences parfois purement contingentes, mais parfois aussi inscrites dans quelque réflexion méthologique explicite. C'est le cas de Strabon et de ses sources, de certains passages du de bello Gallico et surtout de la Germanie , où la cognatio est assez bien repérée et définie : " ... mais les magistrats et les chefs de cantons attribuent pour une année aux clans et aux groupes de parents [gentibus cognationibusque] vivant ensemble une terre dont ils fixent à leur gré l'étendue et l'emplacement" ; "Parmi ceux-ci [l'un est Convictolitavis], l'autre est Cotos, issu d'une très vieille famille, jouissant d'ailleurs d'une très grande influence personnelle et ayant de nombreux parents [magnae cognationis]" ^ ; "Chez d'autres nations, introduites par
19. sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibuscjue hominum qui cum una coierunt ... (CESAR, B.G. , VI, 22, 2); horum esse [...] alterum Cotum, anticjuissima familia natum atcjue ipsum homine summae potentiae et magnae cognationis ... id., VII, 32,4 ; sauf indication contraire, malgré les risques et les inconvénients d'une traduction française, on se réfère à Г édition et à la traduction de L.-A. CONSTANS, (C.U.F. , 1967 [=1926] ). Le premier passage illustre bien la difficulté, car le texte est corrompu. Voici l'apparat critique de Constant: I I 2 qui Aldus : qui cum a quique p [de uariis emendationibus uide Meusel, Tab. coniect.. ] I I . A. MURRAY, op. cit. , choisit avec Meusel la leçon quiaue (cf. discussion p. 43 sq.). Dans ce cas, je proposerais de traduire " [les chefs attribuent une terre ] aux familles [restreintes] et à ceux des groupes éloignés qui les ont rejoints ...". Murray (comme BRUNNER, Deutsche Rechtsgeschichte , Leipzig, 1906-1928, I, p. 84, n. 10) voit une difficulté dans la juxtaposition de gentes et de cognationes . La solution de Brunner, quoiqu'hésitante pour le second terme, me paraît acceptable ; celle de Murray (qui a surtout à l'esprit une prévention tenace pour la notion de clan) me paraît difficilement tenable ; on verra plus loin le sens qu'il convient de
292 Serge LEWUILLON
des alliances de famille [cogna t ion e]avec des Suèves ou, ce qui arrive souvent, par l'esprit d'imitation ..."20.
Pour les Celtes et les Germains uniquement, on trouve chez César les termes suivants : auus "aïeul", IV, 12, 4 : "Pison, personnage de haute naissance, dont l'aïeul avait été roi dans sa cité ..."consobrinus, "cousin" ( du côté maternel ), VII, 76, 3 ;filia 21 ; filius : "... la principale différence qui les sépare des autres peuples, c'est que leurs enfants, avant qu'ils ne soient en âge de porter les armes, n'ont pas le droit de se présenter devant eux en public, et c'est pour eux chose déshonorante qu'un fils encore enfant prenne place dans un lieu public sous les yeux de son père" 22 ;frater, dont le sens est peut-être celui d'un titre assez officiel (quod fratres Haeduos appellatos diceret ; [...] fratres consanguineosque suos ... 23)^ mais aussi celui d'un terme classificatoire (fratres cum fratribus) 24 Ou tout simplement ordinaire, en apparence, du moins ^ ; f rat ris filius 26 ; gêner 27 ; mater 28 et surtout maires familiae 29 ; pater, avec le sens très fort, parfois, de chef de familia (pater familiae...; a patribus maioribusque ... 30) ou indiquant seulement la
donner à gens et à cognatio , en général et dans ce cas particulier (cf. p. 311-313 et n. 244 sq.).
20. in aliis gentibus seu cognatione aliqua Sueborum seu [...] imitatione ... : TAC, Germanie, 38, 2 . Sauf indication contraire, édition et traduction de J. PERRET (C.U.F., 1967 [=1949] ).
21. Piso Aquitanum, amplissima génère natus, cuius auus in ciuitate sua regnum obtinerat ; B.G., I, 3, 5 ; 9, 3 ; 26, 4 (où il est question à chaque fois de la fille unique d'Orgétorix); 53,4 (les deux filles d'Arioviste).
22. (ab reliquis differunt) quod suos liberos, nisi cum adoleuerunt, ut munus militiae sustinere possint, palam ad se adiré non patiuntur filiumque puerili aetate in publico in conspectu patris adsistere turpe ducunt : VI, 18, 3. Les autres occurrences indiquent souvent la filiation ; B.G., 1, 3, 4; VII, 4, 1 ; 31, 5; 65, 2 ; I, 26, 4 ; II, 13, 1 ; V, 4, 2 ; 27, 2; VI, 12,4.
23. B.G., 1, 44, 9 ; II, 3, 5 ; cf. infra. 24. V,14,4. 25. 1, 3, 5 ; 18, 1 ; 19, 2 ; 20, 1 ; 6 ; 37, 3 ; IV, 12, 5 ; V, 27, 2 ; 54, 2 ; VII, 32, 4 ; 33,
3; 37, 1 ; 38, 3 ; 40, 3 ; 43, 2 ; 64, 5 : certaines de ces occurrences sont peut-être aussi classificatoires.
26. V,27,2 27. V,56,3 28. 1,18,6-7. 29. 1, 50, 4 ; VII, 6, 3 ; 47, 5 ; 48, 3. 30. VI, 19, 3 ; 1, 13, 6 ; pour VI, 18, 3, cf. supra , s.v. filius.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 293
filiation 31 ; patruus, "oncle paternel" ^2 ; soror 33 ; uir, "mari" 34 ; uxor, "épouse" 3i^, parfois dans un contexte de polygamie ou de ce qu'on appellera provisoirement un "mariage de groupe" 36.
On rencontre naturellement des termes qui désignent la parenté de façon tantôt globale, tantôt particulière : gens, genus, propinqui, domus, ... etc : l'interprétation qu'il convient de leur donner fera l'objet d'un examen spécial ^7. Ces termes sont ceux que nous possédons pour la fin de l'Indépendance ou pour le début de la période gallo-romaine, mais des sources tardives du bas-empire nous laissent à penser que la terminologie de la parenté, du moins dans sa traduction latine, n'avait pas dû beaucoup évoluer 38.
A lire Ausone, en effet, il est permis de croire que les termes que César et Tacite nous livrent en interpretatio correspondent - à quelques exceptions près qui, du coup, se révèlent du plus haut intérêt - à des réalités identifiables et pour ainsi dire lisibles au premier degré. Toutefois, le traitement appliqué par les auteurs anciens aux phénomènes de la parenté a souvent varié. De ce point de vue, la comparaison entre César et Tacite révélera l'écart entre les occurrences spontanées et les gloses aux prétentions théoriques. Ne négligeons pas le langage de César qui, après tout, approche celui des notations d'un ethnologue de terrain et qui, dans un premier temps, se borne à recueillir et à enregistrer humblement les expressions indigènes. Et surtout, ayons l'attention éveillée par les hésitations ainsi que par les redondances : elles nous signalent un concept difficile à rendre dans la structure mentale de l'auteur et, par conséquent, dans la parenté romaine. Même Tacite, qui se pique pourtant de philosophie - et cela se sent aux rares emplois qu'il fait de termes particuliers, tout à sa préférence pour les expressions
31 . 1, 3, 4 ; 47, 4 ; V, 20, 1 ; VII, 4, 1 ; 4, 5. 32. VII, 4, 2. 33. 1,18, 7; 53, 4. 34. VI, 19,1. 35. 1, 18, 7 ; IV, 19, ; VI, 19, 1 ; 3 ; VII, 66, 7 ; 78, 3. 36. I, 53, 4 (les deux épouses d'Arioviste); V, 14, 4 (cf. supra, s.v. filius ). 37. Cf. infra. 38. AUSONE, Parentalia , qui nous parle de pater (1), mater (2),
auunculus (3), auus (4), auia (5), matertera (6), patruus (7), socer (8), uxor (9), paruulus filius (10), nepos (11), filius (11), soror (12, 16, 17), frater (13), gêner (14), maritus (18), affinis (15, 19), ami ta (26), consobrina (28), nurus (16), sororis filiae (17).
294 Serge LEWUILLON
générales - n'échappe pas à de tels lapsus, qui sont autant d'actes manques ...
Enfin, il faut remarquer que la terminologie latine n'est tout de même pas complètement étrangère à la terminologie celtique, du moins pour ce qui regarde l'étymologie et l'évolution linguistique : nous sommes en présence de deux parlers indo-européens dont bien des traits assurent l'apparentement. Bien plus, ces traits démontrent parfois que l'unité des structures de la parenté prolonge l'identité de la terminologie : c'est notamment le cas de l'évolution des groupes *aivos, *nepots et *derwo$ qui tend à prouver que cette homogénéité, à l'intérieur du territoire insulaire, s'est préservée jusqu'à la période britto-romaine (avec, par exemple, la persistance d'un modèle familial du type de la derbfine irlandaise) 39. Cette constatation redonne une vigueur et une signification particulièrement précieuses au témoignage de César sur les Bretons, si étrange qu'il puisse apparaître. Et par la même occasion, l'ensemble de ses observations du champ gaulois s'en trouve revigoré.
Mais l'enquête terminologique n'est assurément pas tout. Les études sur la parenté indo-européenne ont montré ces dernières années une influence décisive des grands théoriciens de l'anthropologie. On a vu que, pour l'Europe latine, les textes canoniques sont ceux qu'a publiés Cl. Lévi-Strauss (tout particulièrement, de notre point de vue, dans l'Anthropologie structurale et dans les Structures élémentaires de la parenté). Malgré leur puissance, ce serait une erreur de les considérer comme une vulgate ethnologique : la recherche et la démonstration se poursuivent à travers bien d'autres textes qui nous apportent un nouveau matériau comparatiste pour la lecture des mythes ou le déchiffrement des "attitudes" sociales 40. Mais les structures
39. CHARLES-EDWARDS (T.M.), "Some Celtic Kinship Terms", The Bulletin of the Board of Celtic Studies , 24, 2, 1971, p. 105-122 ; BACHELLERY 1er. du précédent], Etudes celtiques , 14, 1974, p. 685- 686.
40. Cf. la suite des Mythologiques et des Anthropologies structurales, jusqu'à des textes aussi importants que La Potière jalouse et Le Regard éloigné . En outre, Lévi-Strauss a été contredit sur quelques point de toute première importance, mais qui sont pour l'instant extérieurs - ou plutôt préalables - à notre sujet : l'origine de la prohibition de l'inceste. Pour L.-S., celle-ci consituerait "la démarche
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 295
élémentaires de la parenté sont un édifice complexe et ingénieux dont chaque partie est absolument nécessaire à la cohésion de l'ensemble : son sens général tient à la mise en lumière des conditions de l'échange (de biens, de services et de femmes) au sein des sociétés humaines. On ne saurait prétendre adhérer à ce modèle d'enquête et, dans le même temps, y sélectionner les exemples les plus propres à étayer une thèse partielle : "atome de parenté", "échange généralisé" ou "échange restreint", "actes prohibés" ou "gestes prescrits", "régimes harmoniques" ou " dysharmoniques", ... etc, sont autant de concepts et d'axes de recherche qui se combinent nécessairement au sein de la démarche ^1. L'exploration des systèmes de parenté est donc loin d'être close, tout spécialement pour l'anthropologue des mondes indo-européens 42.
Une analyse globale est rendue d'autant plus nécessaire que nous ne sommes pas placés, pour les sociétés celtiques, dans une situation aussi favorable que pour n'importe quel peuple primitif contemporain. Il semblerait qu'il n'y ait d'autres sources nouvelles que les apports de l'archéologie. Mais dans ces matières, où le dernier mot revient à l'idéologie (c'est-à-dire aux structures selon lesquelles les sociétés ont érigé la mémoire et la norme), les vestiges archéologiques ne parlent jamais d'eux-mêmes : ils prennent rang parmi tous les autres témoins historiques qu'il s'agit alors d'organiser sans privilèges. On fait alors la part de l'élémentaire et celle du contingent. A la première catégorie appartiennent les traits qui concernent :
- la prohibition et la prescription en matière de mariage ; - l'organisation de la parenté proprement dite ; - les formules fondamentales de l'échange dans la sphère de
l'économie (la réciprocité est d'une extrême importance dans les sociétés celtiques) ;
fondamentale grâce à laquelle, par laquelle, mais surtout en laquelle s'accomplit le passage de la nature à la culture". R. Makarius souligne justement que cette formule "ne fait que dire ce que nous savions déjà ; que la prohibition de l'inceste est inconnue dans la nature et se manifeste dans la culture" (op. cit., p. III xi-xii et n. 33). Mais qu'est-ce, historiquement, que ce passage de la nature à la culture, sinon une prémisse métaphysique ?
41. A cet égard, la lecture de HANARD (G.), "Inceste et société romaine ..." fait voir un progrès sensible.
42. P. 532-547.
296 Serge LEWUILLON
- la détermination des cellules territoriales qui, en relation avec les modules de parenté ou d'alliance, mettent en pratique les formules de l'échange.
De la seconde catégorie (que nous n'aurons pas la place d'exposer ici) relèvent les attitudes historiques qui, prétendant aménager les propositions sociales élémentaires, ont élaboré des stratégies nouvelles dans tous les départements des rapports sociaux 43 :
- développement des réseaux d'alliance ; - progrès des droits individuels (ainsi que son corollaire : le
recul de l'élément collectif - dit parfois communautaire, par abus de langage) ;
- diverses pratiques conservatoires du patrimoine.
Ces solutions sont évidemment de première importance puisqu'elles constituent en quelque sorte la signature des sociétés : les structures auxquelles on attache l'épi thète trop générale et un peu trompeuse d'anthropologiques n'étant, à ces sociétés précapitalistes, rien d'autre que ce que les instances économiques et sociales sont aux nôtres : "On ne peut se borner à déclarer simplement que l'économie est organiquement liée aux structures sociales et politiques des sociétés tribales. On ne peut la distinguer de ces structures. Elle est fondée justement sur, ou, pour reprendre l'expression de l'historien de l'économie, "enchâssée" dans les institutions généralisées, comme la famille et le lignage" 44.
Nous tenons ainsi à la fois la conception et le plan général de notre enquête sur l'anthropologie gauloise.
3. SOURCES.
L'objet de cet article est d'évaluer la conformité des structures anthropologiques gauloises (au sens large qu'on vient de définir) au modèle celtique général, en d'autres contrées et à d'autres époques : on tâchera de résoudre ce problème en retrouvant un archétype, sorte de structure originaire commune, si l'on veut . . .
43. C'est cette part historique qui fait le très vif intérêt de l'article de THOMAS (Y.), "Mariages endogamiques ..." loc. cit.
44. SAHLINS (M.), "L'économie tribale", Un domaine contesté : l'anthropologie économique , p. 237-264 [237] (="Tribal Economies", in Tribesmen , 1968).
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 297
D'une manière générale, si l'on excepte les textes celtiques insulaires, l'objet de cette enquête coïncide exactement à la documentation dont on dispose : la plupart des textes utilisables (c'est-à-dire ceux qui fournissent soit une masse de renseignements statistiquement significatifs, soit des réflexions explicitement ethnographiques) envisagent une époque à peu près homogène : La Tène au sens large (si l'on tient, un tant soit peu, pour l'historicité du récit livien de l'expédition de Ségovèse et Bellovèse) ou plutôt La Tène II et III (Cl à Dl) si l'on considère que les sources de Tite-Live et de Diodore datent des invasions gauloises en Italie (IVe et IIIe siècles a.C.) et de la traversée de la Gaule méridionale par Hannibal (IIIe siècle a.C); quant aux renseignements complémentaires de Posidonios et de Timagène, ils sont de la charnière des IIe et Ier siècles a.C. C'est aussi plus ou moins directement à ces sources que puisent César, puis Tacite, lorsqu'ils n'utilisent pas les renseignements de première main ou ceux provenant de leurs observations personnelles. Ainsi, on peut penser que l'intérêt des auteurs classiques ne peut que s'être renforcé à l'occasion des contacts noués entre Celtes de Gaule et Celtes d'Italie. Or, ces rapports s'affirment à partir du IIIe siècle a.C. ^ et s'intensifient avec la conquête de la Narbonnaise. Nous considérerons donc que notre documentation contient des traits certes valables pour La Tène II (Cl - C2), mais surtout pour La Tène III (Dl)46-
Les textes d'époque impériale n'étant que de médiocre qualité, quand ils ne sont pas tout simplement des compilations maladroites, nous ne les citerons que pour mémoire ou pour témoigner de la permanence de telle ou telle tradition, réellement ethnographique ou au moins historiographique. Il faudra faire une exception notable pour les Parentalia d'Ausone, petite mine de renseignements pour la
45. KRUTA (V.), "Les Celtes d'Italie", Les Celtes en Italie. Dossier Histoire et archéologie, n° 112 (janv. 1985), p. 8-19 : les migrations celtiques en Italie se placent surtout à la fin du IVe siècle (elles concernent alors le groupe des Sénons, laissant des traces en Gaule) et à la fin du premier tiers du IIIe siècle (ce sont cette fois les Boïens qui sont poussés par des groupes danubiens, moins homogènes, moins importants et moins structurés, toutefois, que ceux des vagues précédentes.
46. KRUTA (V.), Les Celtes , Paris, 1979 (=1976), p. 46 ; GUILAINE (J.), La Préhistoire , Paris, 1976, III, p. 21.
298 Serge LEWUILLON
parenté au bas-empire, déjà exploitée par certains historiens, d'ailleurs ^ •
On connaît les problèmes que posent les celtiques insulaires et leurs textes tardifs 4^. Afin de ne pas relancer le débat un peu vain sur l'extrapolation, on ne les utilisera que comme d'autres textes anachroniques (l'espace manquant pour tout examen circonstancié de chacun d'entre eux ), c'est-à-dire comme témoin de la permanence d'une tradition. Cependant, ici ou là, il faudra tout de même signaler les preuves de leur très haute antiquité, comme on Га déjà dit de leur aspect terminologique 4^.
Il reste enfin à examiner le statut particulier du témoignage du Tacite de la Germanie (un peu comparable à celui des ex-cursus germaniques de César) : dans quelle mesure peut-on l'utiliser pour l'étude de la parenté celtique ? Les travaux de Norden 50 ont ouvert un large débat dont Hachmann a donné récemment la synthèse 51 : si le Rhin ne représentait qu'une frontière artificielle postulée par César pour les besoins de sa cause, quelle serait la réalité ethnique des populations de ses rives, de YHelinium et même du Belgicum ? Sans vouloir faire preuve ici d'un évolutionnisme hors de propos, nous rappellerons quelques raisons qui nous poussent à croire que ce débat ne nous concerne que d'assez loin. En effet, quelle que soit la distance linguistique et culturelle entre les Celtes et les Germains, la pratique historique de la rive gauche du Rhin est celle d'une étroite
47. GUASTELLA (G.), "I Parentalia come testo antropologico : l'avunculato nel mondo celtico e nella famiglia di Ausonio", Materiále e Discussioni per l'analisi dei testi classici , 4, 1980, p. 97-124.
48. Cf. un résumé du débat in LE ROUX (Fr.), GUYONVARCH (Chr.), La civilisation celtique , Rennes, 1979, p. 39-48.
49. Cf. supra, p. 293, n. 37 et infra ; CAMPANILE (E.), "Fonti irlandesi per la storia del tardo impero romano", Athenaeum , 11, 1984, p. 61-66.
50. NORDEN (E.), Die germanische Urgeschichte in Tacitus Germania, Stuttgart, 19594.
51. HACHMANN (R.), KOSSACK (G.), KUHN (H.), Vôlker zwischen Germanen und Kelten , Neumunster, 1962 ; HACHMANN (R.), Les Germains , Genève, 1971.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 299
collaboration politique et même sociale entre Belges et Germains ^2. Ces peuples présentent de très nombreux traits communs et leur identité s'exprime tout particulièrement dans la pratique économique dont nous venons justement de dire qu'au sein de la "société tribale", elle empruntait presque exclusivement les voies et les formes de la parente. Pourtant, hâtons-nous de dire que ces peuples ont bien évolué différemment, y compris dans le domaine anthropologique, et que nous ne considérons nullement les populations germaniques comme les cadets d'un vaste groupe indifférencié et tout d'abord des Belges, comme ceux-ci le seraient à leur tour de tous les autres Celtes ... D'ailleurs, quelles que soient les ressemblances constatées, le meilleur gage de la distinction qu'il convient de maintenir entre les institutions sociales des Belges et celles des Germains sera encore les écarts explicitement signalés par les auteurs anciens eux-mêmes. On sera amené à en introduire d'autres, que ces auteurs n'avaient su repérer en leur temps. L'usage que nous ferons de ces textes germaniques sera donc celui d'un soutien critique à la documentation sur un peuple à la fois voisin des Celtes et original, dont il serait absurde de réfuter l'influence, exercée notamment grâce à son dynamisme guerrier et même commerçant, y compris envers Rome. Ignorer les structures sociales élémentaires des Germains pour l'étude des Gaulois, et surtout pour leurs groupes septentrionaux, serait d'aussi hasardeuse méthode que de négliger les Vénètes pour les problèmes de la Celtique italique.
52. LEVVUILLON (S.), "Histoire, société et lutte des classes en Gaule romaine : une féodalité à la fin de la république et au début de l'empire", A.N.R.W. , II, 4, 1975, p. 454-455 scj.
300 Serge LEWUILLON
IL PROHIBITION ET PRESCRIPTION.
1. FORMES DE POLYGAMIE RÉCIPROQUE.
Deux textes, l'un à propos de l'Hibernie et l'autre pour le nord de la Bretagne rapportent de curieuses coutumes : "Les hommes s'accouplent à la vue de tout le monde à n'importe quelle femme, même à leur mère et à leur soeur" (STRABON, IV, 5, 4 С 201, trad. Fr. LASSERRE). " Ils ont des femmes en commun et ils entretiennent l'ensemble de leur progéniture tout aussi communément" (DION CASSIUS, LXXVII, 12, 2).
Ces deux textes évoquent à coup sûr des formes de communautés familiales situées aux antipodes de la famille conjugale et de la monogamie. Ces informations constituent-elles un accident dans le cas de la première citation, et, de plus, une infraction à la prohibition de l'inceste pour la seconde ? L'analyse de ce cas montre qu'il n'en est rien et que cette forme de mariage par groupe se retrouve ailleurs en Bretagne, ainsi qu'en Gaule, à des degrés divers.
On sait désormais qu'en anthropologie, la prohibition n'est bien souvent qu'un des deux versants d'une règle sociale dont l'autre est la prescription. Ce raisonnement ne tient naturellement que dans le cas où la société envisagée pratique les formules de l'échange, restreint ou généralisé ̂ . Or, comme on le verra, l'échange à tous les degrés est une des règles fondamentales de la société gauloise de La Tène II et III au moins ^. Cependant, le fait de partir d'une théorie dont la validité est très largement reconnue aujourd'hui ne doit pas nous porter à produire ipso facto l'attirail complet des attitudes sociales de tous les groupements humains repérés, au prix, d'ailleurs, de sollicitations plus ou moins audacieuses. En effet, la société gauloise de l'Indépendance ne nous permet pas de nous faire une idée de ses interdits et de ses prescriptions en matière d'alliance ou de mariage. C'est sans doute que les conceptions des Celtes ne laissent pas de place à des prohibitions de ce genre (alors que par ailleurs, elles connaissent des formes de tabou). Ainsi, si l'inceste n'est pour ainsi dire pas "commis" - on pourrait tout aussi bien dire "codifié" -
53. Cette remarque générale est au coeur de l'étude de la prohibition de l'inceste : c'est la matière même des Structures élémentaires de la parenté.
54. Cf. infra.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 30Î
chez les Celtes ^, il ne paraît pas non plus faire l'objet, dans les mentalités collectives, de vives préoccupations liées à sa crainte, sa défense (ou son désir . . .) : il est, en quelque sorte, absent du récit.
De toute façon, nous sommes assez mal renseignes sur les formes archaïques du mariage indo-européen : certains ont cru déceler dans l'antiquité classique des formes de "mariage collectif" ou môme de "mariage par groupe" 56. Ils se sont fait contredire, malgré les textes allégués, sous prétexte que la thèse du mariage collectif devrait être largement conçue dans le cadre d'une "organisation dualiste" ^ , caractérisée par une division en "moitiés exogamiques" pratiquant cette forme de mariage ^ et par l'utilisation d'une "terminologie classificatoire" de la parenté, alors que tout cela ne se retrouverait pas à Rome. Ces moitiés exogamiques sont apparemment ressenties ou interprétées comme des classe matrimoniales, concept particulièrement délicat à manier et plus encore à reconnaître ^9. Mais à trop vouloir introduire la règle élémentaire là où elle est impossible à trouver, des chercheurs bien intentionnés ont ajouté beaucoup de confusion à la théorie de la parenté. Certes, la famille conjugale connaît aujourd'hui une réhabilitation - une de plus dans l'histoire de son long combat ! - dans l'histoire des sociétés
55. Une enquête systématique devra être conduite dans les textes celtiques insulaires. On y rencontre en effet de ces cas hyper- incestueux qui demandent à être analysés sérieusement avant de servir à appuyer telle ou telle hypothèse. Voyez, par exemple, dans le cycle d'Ulster , le cas de Lugaid-aux-Ceintures-Rouges , né des Trois Beaux d'Emain, frères - et époux successifs- de sa propre mère, avec laquelle lui-même aura des enfants (cf. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Cours de littéraure celtique , VII, p. 226 ; dans le môme cycle (Conception de Cûchulainn), Cûchulainn risque l'inceste avec sa soeur Dechtiré (ibidem , p. 29). On devra consulter DE MANDÁCH (A.), ROTH (E.-M.), "Le triangle Marc-Iseut- Tristan : un drame de double inceste", E.C., 23, 1986 (cf. infra ).
56. FRANCIOSI (G.), Clan gentilizio .... p. 201-238. 57. Pour la définition de ce terme, cf. LEVI-STRAUSS (CL),
Anthropologie structurale, p. 154-188: "Les organisations dualistes existent-elles ?" Idem, Structures élémentaires..., p. 80-97.
58. HANARD (G.), "Inceste et société romaine ...", p. 40-42 et n. 35-37. 59. LEVI-STRAUSS (CL), Structures ..., p. 475. Pour la reconnaissance de
l'organisation en moitiés, cf. THOMAS (Y.), "Mariages endogamiques ...", p. 358-359, n. 35 (à propos du schéma d'auunculus chez Benvéniste).
302 Serge LEWUILLON
archaïques ; certes, les concepts théoriques de classe matrimoniale , de terminologie classificatoire ou d'organisation dualiste doivent être reconnus et définis avec le plus grand soin, mais ce serait une profonde erreur de croire que les sociétés humaines s'organisent de façon si simpliste qu'un seul élément de leur structure en fournit infailliblement la clef et qu'un seul fil suffit à débrouiller l'écheveau. A ce compte, les principes d'alliance et de descendance des sociétés humaines seraient en nombre connu, alors que l'analyse concrète recourt, en réalité, de plus en plus souvent à l'ordinateur et au modèle mathématique ! Ainsi, reconnaître l'ensemble des traits sociaux ne suffit pas : il faut encore pouvoir les hiérarchiser et les ordonner au sein de ce qu'on pourrait appeler, par analogie avec une théorie économique, des "modes de reproduction" ... On aura l'occasion de répéter que la filiation, par exemple, n'est qu'un caractère secondaire de la parenté ; de même, la forme de la famille dépend de tellement de variables qu'elle se détache de la réalité sociale de la parenté. Cela est vrai aussi de cette forme de famille qui, si chère à nos mentalités et à nos traditions, s'en voit inconsciemment supposée par les historiens, qui éprouvent quelque répugnance - comparable à celle ressentie "instinctivement" vis-à- vis l'inceste - pour le mariage "par groupe" : pourtant, "la famille restreinte n'est pas l'élément de base de la société et elle n'en est pas non plus le produit" . . . ^0
Ainsi, il n'est pas suffisant de dresser des obstacles pseudothéoriques relevant de la parenté au mariage par groupe, puisque ce phénomène pourrait de toute façon se produire pour de nombreuses raisons historiques. C'est même exclusivement pour des raisons de cet ordre que cette forme de mariage - polyandrie, polygynie ou les deux à la fois - apparaît au sein de sociétés qui connaissaient préalablement la famille conjugale et la monogamie 61. Par conséquent, s'il ne s'agit d'un lieu commun de l'ethnographie gréco- romaine dû au regard porté par les auteurs classiques sur les barbaries (plutôt que le terme d'ethnographische Wander-
60. LEVI-STRAUSS (Cl.), Le Regard éloigné , p. 91 : nous choisissons volontairement cette citation là-même où un adversaire du mariage par groupe a récemment pris ses arguments ... (HANARD (G.), op. cit., p. 41-42 ; cf. ici, n. 89.
61. Idem., p. 67-71.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 303
motive 62, nous emploierons à l'avenir celui, plus simple, de topique), force est de constater que le mariage par groupe est plausible chez les Celtes. Le fait que ce thème soit minoritaire dans la littérature antique, ainsi que son absence de l'aire germanique, ruinent l'idée d'un topique.
Aux textes cités en tête de chapitre, il faut maintenant en ajouter ď autres :
"Leurs femmes sont en commun entre dix ou douze, particulièrement entre frères et entre pères et fils ; mais les enfants qui naissent de cette promiscuité sont réputés appartenir à celui qui a été le premier époux" (B.G. , V, 14, 4).
Ceci est explicite : les usages matrimoniaux présentent un indéniable caractère collectif inconnu à Rome 63. Faut-il y reconnaître le "mariage par groupe" proprement dit ? Dans la mesure où ce concept paraît largement mythique 64 - a-t-on pu l'observer à travers des cas qui n'étaient pas produits par une situation historique quasi fortuite ? - on s'exprimera avec prudence : parlons provisoirement d'une "forme polygame réciproque" (ou "mutuelle") où les membres d'un même groupe familial, à l'intérieur d'un degré déterminé par les termes uxores , fratres , parentes et liberi , pratiquent l'échange des partenaires. Il convient donc de
62. PERRET (J.), in TACITE, La Germanie , (C.U.F. ), p. 16-24. 63. FRANCIOSI (G.), op. cit., présente d'autres exemples dans
HERODOTE, I, 216, 1 (MUELLER 71): les Massagètes ; STRABON, V, 247, 265-9 ; VII, 9 ; XI, 8, 2 ; 8. 6-8 ; XV, 1, 6. HERODOTE, IV, 104 (MUELLER 213) : les Agathyrses (nord des Balkans); IV, 172, 2-3 (MUELLER 231), les Nasamoncs (Grande Syrte); IV, 180, 6 (MUELLER 233) : les Macles (?) ; III, 101, 1 (MUELLER 248-9) : les Indiens ; THEOPOMPE, fg. 222 (MUELLER 315) in ATHEN., XII, p. 517 d-e-f-; 518 a-b : les Etrusques ; ibidem , à propos de populations de Grande Grèce ; suivent (p. 210-218) des témoignages concernant les Romains. Cf. les critiques de MOREAU (Ph.), loc. cit. et HANARD (G.), loc. cit. Quant à TACITE, Germ. , 46, il est loin de parler explicitement du mariage collectif ; les conubia mixta font d'ailleurs clairement référence à des notions interethniques.
64. Pour Rome, cf. les remarques faites par MOREAU (Ph.), "La terminologie latine et i.-e. de la parenté ...", p. 50 sur les thèses de Franciosi.
304 Serge LEWUILLON
définir chacun de ces termes dans son acception gauloise pour reconnaître d'abord la forme de la famille et, ensuite seulement, apprécier les règlements matrimoniaux en vigueur.
La question est rendue difficile par le fait qu'on hésite encore sur la terminologie latine, et en particulier sur frater . Ce terme, si particulier en indo-européen est un des plus riches de sens, comme l'a démontré Benvéniste 65, car il ne concerne pas que la parenté naturelle. Mieux, le terme i.-e. *Bhrater ne désigne pas en premier lieu le frère consanguin : "il s'applique à ceux qui sont reliés par une parenté mystique et se considèrent comme les descendants d'un même père " (d'où le sens premier du grec фратлр "membre d'une phratrie", qui s'oppose à à8eX<poç "frère de sang", latin frater (germanusfà : ce terme est donc imprégné de signification classificatoire, même en latin, où il apparaît nécessaire de distinguer le frère consanguin (fils du même père qu'ego) du cousin germain patrilinéaire (fils du frère du père d'ego (donc le patruus) : frater patruelis). Par ailleurs, il est logique qu'une terminologie classificatoire range dans une même catégorie et sous le même appellatif les cousins agnatiques : c'est même là un cas de figure élémentaire de la parenté - sans jeu de mots. Si la terminologie de la parenté romaine n'est pas vraiment classificatoire - ou ne l'est plus à l'époque classique, ou encore l'est seulement devenue pour des raisons extrinsèques à la parenté ^ - elle
65. BENVENISTE (E.), Vocabulaire ..., I, 212-215 ; MOREAU (Ph.), op. cit., p. 43 et 46.
66. BENVENISTE (E.), op. cit. , I, I, p. 213. 67. Uxores habent déni duodenique inter se communes et maxime
fratres cum fratribus parentesque cum liberis ; sed si qui sunt ex his nati, eorum habentur liberi quo primům uirgo quaeque deducta est. (B.G., V, 14, 4) C'est peut-être à cause du manque de perspectives historiques que subsistent des désaccords sur ce point : par exemple entre Franciosi, partisan de la terminologie classificatoire et Moreau (loc. cit.) ou Hanard (op. cit., p. 40-46), qui en sont tous deux adversaires ; la peur de retomber dans un évolutionnisme primaire (complexe qui n'embarrasse pas Franciosi) semble tenailler beaucoup de ces historiens et, en quelque sorte, les freiner dans l'étude des "conditions historiques" de la parenté ... Je ne suis pas entièrement Hanard lorsqu'il envisage l'acquisition du caractère classificatoire comme "des extensions collatérales de sens [... qui] consistent à désigner des parents de la ligne paternelle jusque là réservés au degré correspondant de la ligne maternelle" (op. cit. , p. 43).
DIALOGUES D^HISTOIRE ANCIENNE 305
ne dispose pas d'autres termes pour désigner une situation étrangère qui, elle, le serait réellement. Les emplois que César fait du terme frater dans ses Commentaires apparaissent comme parfaitement banals. Bien sûr, il ne précise pas si les individus concernés sont germani, mais cette imprécision est la règle du langage courant ; nous n'avons aucun moyen de décider si Dumnorix et Diviciacos étaient des frères consanguins ou des cousins agnatiques. On pourra même objecter qu'il n'y a aucune raison de douter qu'ils fussent vraiment frères, car, s'ils avaient été fratres patrueles, pourquoi César se serait-il privé de le dire, alors qu'il n'hésite pas à spécifier que Vercingétorix et Vercassivellaunos sont conso-brini ^ ? (Mais on verra par la suite que cet argument est affaibli par les très évidents privilèges dont jouit la parenté par les femmes chez les Celtes en général.)
Pour en revenir à notre texte, considérons que nous nous trouvons dans un contexte particulier où il ne s'agit plus d'individus identifiables, mais d'exemples à valeur ethnographique. En outre, le terme frater prend en Gaule un sens spécial qui échappe à la parenté naturelle, lorsqu'on dit de deux peuples qu'ils sont unis par des liens de fraternité ^9 • mais comme si le mot était insuffisant, César le renforce de consanguinei ^ : n'est-ce pas là le substitut du terme germani qui nous faisait défaut, situé encore plus explicitement dans la parenté du sang, le nexum sanguinis cher aussi aux Germains ^ ?
Quoi qu'il en soit, le groupe des fratres paraît assez large pour comprendre une douzaine de femmes ; or, ce que nous connaissons des Celtes et des Germains à La Tène III ne nous permet pas d'envisager des familles nombreuses, du moins pour les classes sociales favorisées (mais ce sont justement celles-là qui sont concernées par les formes de mariage collectif ) : Galba n'a que deux fils '2 ;
68. E.G., VII, 76, 3. 69. B.G., 1, 11, 4 ; 33, 2 ; 44, 9 ; II, 3, 5 ; cf. JULLIAN (C), "A propos des pagi
gaulois avant la conquête romaine ", Notes gallo-romaines , R.E.A., 3, 1901, p. 77-97 et "Les parentes de peuples chez les Gaulois", id., . 142.
70. B.G. , II, 3, 5 ; I, 33, 2 ; necessarii et consanguinei , I, 11, 4 : cf. ici, p. 23- 25.
71. TAC. Germ., 20, 5 72. B.G., 11,13, 1
306 Serge LEWUILLON
Orgétorix a deux fils et une fille ^3 ; Indutiomar n'a qu'un fils ^ ainsi sans doute qu'Ambiorix et le frère de celui-ci ^ ; enfin, le roi norique Voccion n'a que deux filles ^. Par conséquent, il faut admettre au minimum que ces groupes connaissent la polygamie ou qu'ils incluent parmi les mâles un certain nombre de cousins, dénommés fratres. Les deux solutions ne sont pas incompatibles, mais quel que soit le choix, il ne laisse guère de place à l'inceste proprement dit. C'est à la même conclusion qu'aboutit l'examen des termes parentes et liberi, qui sont en positions réciproques. Comme on le verra, les parentes sont très précisément définis dans la parenté gauloise des Commentaires . Ce terme, toujours employé dans des contextes généraux et à portée ethnographique 78, est à prendre dans un sens très étroit: il détermine un groupe qui finit là où commence les propinqui, au troisième ou quatrième degré de parenté selon moi. Mais dans le cas de B.G. , V, 14, 4, outre que l'image - et peut-être n'est-elle que cela - s'imposait d'elle-même après celle des fratres, parentes constituait l'appellatif nécessaire et suffisant. De plus, l'emploi du terme propinqui pour désigner les oncles, obligatoirement présents, eût été impropre, car la sphère des propinqui dépasse précisément les collatéraux de la génération supérieure '^ . Ainsi, plutôt que l'inceste, et plutôt que toute périlleuse référence à une forme de famille précise, il me semble que ce témoignage évoque une authentique formule matrimoniale : le mariage oblique, évoqué ici à propos des formes celtiques de la relation avunculaire.
Les traits qui nous viennent d'être analysés ont laissé en Gaule des traces encore visibles à l'époque de la conquête, témoignant ainsi, jusqu'à un certain degré, de l'homogénéité sociologique du monde celtique : [...] sunt humanissimi qui Cantium incolunt [...] neque multum a Gallica differunt consuetudine 80. Même au début de
73. B.G., 1, 26, 4 ; 3,5 ; 9, 3 ; 26, 4. 74. B.G.,V,4,2. 75. B.C., V, 27, 2. 76. B.G., 1,53, 4. 77. Cf. infra , p. 311 sq. ; 326 sq. ; 346. 78. B.G. , V, 14, 4 ; VI, 14, 2 ; VII, 66, 7. 79. Cf. tableau III. 80. B.G.,V,14, 1.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 307
l'empire, Strabon se croyait tenu de le préciser pour les Germains 81 : " Ces derniers, en effet, leur ressemblent autant par leur nature que par leurs institutions politiques. Ils leur sont d'ailleurs apparentés par le sang et habitent un pays séparé du leur seulement par le Rhin et très semblable sous presque tous les rapports".
La polygamie n'était pas, ou plus, répandue en Gaule à l'époque des Commentaires. Cependant, dans un passage sur la famille gauloise, César emploie un pluriel significatif : "Toutes les fois que meurt un chef de famille de haute lignée [...] on met à la question les épouses ..." 82.
Ce pluriel n'est pas à mettre sur le même pied que ceux qu'on rencontre quelques lignes plus haut et qui sont commandés par uiri 83, Mais comme le dit A. Bayet, uxoribus est décisif: "il y a plusieurs femmes portant un titre que César traduit par le mot uxor" 84. Nous nous interrogerons ultérieurement sur le statut de ces femmes (concubinage, mariage annuel ou "polygamie successive") ^, mais ce qui compte pour l'instant, c'est que cette remarque porte sur des personnages de très haute naissance, alors que les autres emplois ďuxor, faits à propos d'individus plus ordinaires, ne trahissent pas cette forme de polygynie **6. II est possible qu'il représente un système matrimonial exceptionnel, en voie d'extinction en Gaule, pendant qu'il subsistait chez les Germains : Arioviste a deux épouses ^7 et Tacite ne dit-il pas : "Car, presque seuls entre les barbares, ils se contentent chacun d'une épouse, excepté quelques personnages qui, toute sensualité mise à part, sont, à cause de leur noblesse, sollicités à plusieurs unions" ^ ?
81. STRABON, IV, 4, 2 (C 196) (trad. Fr. LASSERRE). César dit évidemment le contraire (B.G., VI, 21, 1), mais on a déjà expliqué où était son intérêt à T'invention" des Germains.
82. B.G., VI, 19, 3 : [...] et cum pater familiae inlustriore loco natus decessit [...] de uxoribus in seruilem modum auaestionem habent.
83. Id., 19, 1-3. 84. BAYET (A.), La Morale des Gaulois , Paris, 1930, 1, 123. JULLIAN (C),
H.G., II, p. 408. 85. Les recherches de droit matrimonial seront développées dans une
prochaine étude. 86. Cf. n. 33. BAYET (A.), op. cit., p. 124. 87. B.G., 1,53, 4. 88. TAC, Germ., 18, 1. Monogamie : 19, 4-5.
308 Serge LEWUILLON
Quant à la communauté de la progéniture qui résulte immanquablement de cette forme de mariage, n'est-ce pas son souvenir qui se maintient dans une curieuse tradition, sans doute le trait pittoresque le plus persistant jamais mis au compte des Gaulois : l'épreuve faite aux nouveau-nés pour juger de leur légitimité (généralement en les immergeant dans le Rhin) 89. Sauf erreur, cette légende n'a pas reçu d'explication jusqu'à présent, non plus que cette remarque apparemment anodine de César à propos des femmes gauloises et de leurs communes liberi ^0, Rien ne s'oppose à ce que cette "commune progéniture" rejoigne le dossier étoffé de la famille communautaire ^ et polygame des Celtes.
Ainsi, le principe général des rapports entre les sexes à l'intérieur de la parenté celtique, dont il est pour ainsi dire le préalable, a commencé de se préciser : les habitants de la Gaule comme les insulaires respectent en tout premier lieu la règle élémentaire de la prohibition (à ce stade, j'évite volontairement de
89. PARADOXOGRAPHES VATICANUS, Admiranda , 17 (Germains); Scholies à DENYS le Périégète, Périégèse , 295-296 (fleuve celtique) ; Anthologie grecque (Anthologie palatine), Epigramme 125 (Celtes) ; ARISTOTE Politique , VII, 15, 2 (Celtes) ; VIRG. Aen. , IX, 603-604 (riverains du Rhin) ; GALIEN, 'YyiEiva, I, 10 (Germains) ; CLEMENT d'Alexandrie, Pédadogue , III, 3, 24 (Celtes) ; JULIEN, Discours "De la royauté" , 25, 81 d - 82 a (C.U.F.) ("fleuve gaulois" : le Rhin); LIBANIOS, l\poyu\ivào\iaTa, Narration 37 : Sur le Rhin (Celtes); GREGOIRE de Naziance, Poèmes moraux ; IV, Пара NixofJouXou прбс Tèv ттатфа (P.G., 37, col. 1515), 141-143 ; XXIX, Ката y\)\ivaix<bv(id., col. 900), 221 ; TZETZES, Chiliades, XXXV, 339 (Celtes).
90. B.G., VII, 36, 3. 91. On a déjà compris que la question des formes initiales du mariage et
de la famille constitue un des enjeux les plus formidables de l'anthropologie. En fait, le débat sur cette forme de famille, ou plus largement sur toute forme de famille, accompagne les progrès de l'évolutionnisme en sociologie. Très précocement, la définition d'une famille communautaire fut le reproche principal fait à Morgan. Déjà Engels en était conscient, lui qui ne manquait jamais de mettre en évidence un nouvel exemple de "mariage par groupe" : cf. Origine ..., p. 187-191 (=Neue Zeit, XIe ann. (1892-1893), t. I, n° 12, p. 373-375). Il est certes aisé de le révoquer d'un trait de plume, sous l'accusation d'évolutionnisme primaire, mais c'est là se placer soi- même au centre du vieux débat pour la famille monogamique et tous ses présupposés (cf. MAKARIUS (R.), op. cit. , III xxii- xlv).
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 309
spécifier une nouvelle fois "prohibition de l'inceste" pour ne pas enfermer la question à l'intérieur d'un débat qui la dépasserait : celui de l'origine de l'inceste) afin de mettre en oeuvre des formes de mariage et d'organisation de la descendance apparemment assez complexes. Mais ce système, réservé aux classes sociales supérieures, n'est plus dominant en Gaule à La Tène III, alors qu'il demeurera longtemps en vigueur dans les Celtiques insulaires (le témoignage de Dion Cassius date de la fin du IIe siècle p. C), se glissant même parmi les thèmes de la littérature épique "tardive" ^2. Enfin, on a constaté que ce système matrimonial s'accompagnait d'une terminologie de la parenté classificatoire, au moins de façon résiduelle jusqu'au Ier siècle de notre ère.
III. ORGANISATION PRATIQUE DE LA PARENTÉ.
1. EXOGAMIE ET ENDOGAMIE.
Les principes généraux ne suffisent pas à faire fonctionner la famille et la société : il faut leur donner un contenu, c'est-à-dire mettre en évidence les formules par lesquelles s'applique la volonté de codifier, à des fins sociales, les rapports entre les sexes. La question est délicate puisque les possibilités sont nombreuses pour y parvenir, mais que leur formulation est rarement explicite : la plupart des sociétés suivent des procédures éprouvées de longue date, mais d'autant plus tortueuses ; leur codification, élaborée a posteriori, se révèle largement artificielle ; de plus, elle n'est conservée qu'à travers des comportements sociaux ou des mythes plus ou moins historiques ^3 (souvent une hiérarchisation de l'occupation de l'espace), ce qui constitue, on l'a vu, un langage ou même une idéologie (au sens dumézilien). Le principe le plus souvent suivi consiste à déterminer les conjoints permis en pratique et à retrouver, à inventer le principe qui les relie : soit en définissant leurs rapports entre eux, soit en les rangeant à l'intérieur de classes ^4. Pas plus qu'il ne nous est donné, pour l'âge du fer ^, d'entrer dans les détails
92. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE (H.), La famille celtique , Paris, 1905, p. 50.
93. LEVI-STRAUSS (Cl.), "Les organisations dualistes ...", loc. cit. Idem, La Potière jalouse , Paris, 1985 ; id., Anthropologie structurale .
94. Idem , Les structures élémentaires ..., p. 47 sq. et passim . 95. Nous imaginons qu'il en va tout autrement pour la pleine période
gallo-romaine, où l'épigraphie étale sur les stèles funéraires divers
310 Serge LEWUILLON
des prescriptions matrimoniales (alors que nous savons qu'il en existe), il n'est possible de prouver l'existence de mariages préférentiels : si ce type de mariage est logique dans les sociétés primitives, il est rare que les textes en parlent explicitement. Même à Rome, l'existence de mariages prescriptifs, pourtant plausible, n'est pas encore irréfutablement démontrée 96.
Cependant, il est clair que la société gauloise de La Tène III (au moins) est foncièrement exogame. Il n'y a pas d'autres preuves à donner que l'extraordinaire multiplication des alliances matrimoniales, constituant un système qui ne doit rien au hasard ni à l'improvisation ^7. Il convient de s'accorder sur le sens des termes, car l'exogamie (et l'endogamie), ne sauraient s'entendre absolument : il faut encore préciser les limites qu'on assigne à la sphère du dedans et au monde du dehors . Il y a sur ce point une confusion pour ainsi dire historique, qui tient à la polémique des partisans de Me Lennan menée contre les thèses de Morgan : l'assimilation de la cité au "groupe primordial" (gens, clan, famille, tribu, selon les cas) et le refus d'admettre l'autonomie des structures de la parenté poussaient les premiers à voir dans les limites de la cité celles du cercle familial en deçà duquel toute pratique matrimoniale ne pouvait être qu'endogamique. On sait que Morgan connut très rapidement une éclipse durable, les thèses de ses contradicteurs demeurant largement dominantes au moins jusqu'à l'époque de Frazer 98. Faute de reconnaître le lieu exact de
types de stratégies familiales : BURNAND (Y.), "Stratégies matrimoniales des grands notables de la Gaule romaine" in table ronde Parentés et stratégies dans l'antiquité romaine .
96. MOREAU (Ph.), "Plutarque, Augustin, Lévi-Strauss : prohibition de l'inceste et mariage préférentiel dans la Rome primitive", surtout p. 53-54.
97. Cf. ici p. 353-358. 98. Sans avoir encore achevé les recherches sur les origines de la
pensée sociologique de Jullian, je pense pouvoir dire que celle-ci s'exprime assez peu dans l'Histoire de la Gaule : deux passages seulement sur la famille, pas d'allusion à Durkheim (que Jullian consultait parfois : "A propos des pagi ...", p. 97, n. 3). Deux types de sources : Fustel de Coulanges (uniquement La Cité antique ) et les juristes du XIXe siècle ; pour l'époque, cette information est déjà dépassée, pour son contenu comme pour sa fonction épistémologique. Il n'y a qu'une note à d'Arbois de Jubainville (à La
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 311
l'endogamie et de l'exogamie, on en arrivera à considérer que, pour un Gaulois, un mariage à l'intérieur de sa ciuitas est une preuve d'endogamie ^. En réalité, l'exogamie se pratiquant à une très large échelle, son principe est également valable pour les cellules les plus restreintes : qui peut le plus, peut le moins. Le fait de constater quelque mariage noué à l'intérieur d'une même ciuitas (Indutiomar donne sa fille à Cingétorix) ^0. n'est pas concluant. On voit trop bien, en effet, les avantages immédiats qu'Indutiomar pouvait retirer d'une alliance avec Cingétorix : celui-ci étant le chef du parti pro-romain des sénatoriaux 1^, il représentait pour Indutiomar un adversaire presque aussi extérieur que s'il n'eût point été de son peuple. Cette alliance interne suit donc un principe identique à toutes les autres et l'endogamie n'y est pour rien. On voit par ailleurs que la véritable famille d'Indutiomar (à l'intérieur de laquelle un mariage eût été qualifié à bon droit d'endogame) n'est pas dans la parenté de Cingétorix, mais située exactement à son opposé 102.
2. AGNATION ET COGNATION.
Faut-il prendre ces deux termes sous leur aspect le plus formel ou le plus concret ? On sait ce que les définitions peuvent avoir d'aléatoire, tel auteur penchant pour un emploi strict, tel autre tenant pour le laxisme terminologique : "son sens courant et général [est celui] de parenté par le sang en ligne paternelle et maternelle" ^3 Mais quelques textes d'importance permettent de ne pas opposer cognation et agnation selon la terminologie strictement ethnologique de parenté par les femmes et de parenté par les hommes : la référence essentielle est faite à la patria potestas (ceux
famille celtique ). Je reviendrai ailleurs sur la signification de ces choix et sur l'influence durable de Fustel de Coulanges.
99. JULLIAN (C), "La parenté de peuples chez les Gaulois", R.E.A. , 3, 1901, p. 142 : "l'exogamie des grandes maisons celtiques est un fait digne d'être noté, et qui a peut-être sa source dans d'antiques coutumes de clan"; et n. 5 : "l'exogamie n'est pas ou n'est plus la règle entre gens d'une même cité".
100. B.G.,V,56. 101. Id., V, 3, 1 ; 5; 4, 3 ; 4 ; 57, 2 ; VI, 8, 9. 102. Id., VI, 2, 1 ; sur l'analyse de ces faits, LEWUILLON (S.), op. cit.,
p. 468-470. 103. HANARD (G.), op. cit., p. 35.
312 Serge LEWUILLON
qui y sont soumis sont les adgnati, ceux qui ne le sont pas, les cognati) ou, mieux, à la parenté juridique laissée à la discrétion du paterfamilias , face aux rapports de parenté naturelle (quelle qu'en soit la ligne), tout à fait "indisponibles aux particuliers". C'est dans ce plan, a-t-on montré de façon assez convaincante, que se déterminent à Rome les prohibitions (et par conséquent les prescriptions) matrimoniales ^4
Mais la lecture de César n'est pas celle de Tite-Live : quoique tout entier livré aux démons de \ inter pretatio à toutes ses instances, le proconsul livre plus volontiers ses "clefs" terminologiques. En l'occurrence, la cognatio gauloise se présente comme infiniment plus concrète, c'est-à-dire moins juridique, que la notion livienne. La raison principale en est que César n'a pas à l'opposer, au terme d'un débat confus, à un autre plan de la parenté : l'agnation. Pour les ethnographes antiques, cognatio se connote à l'aide de deux couples terminologiques se référant au territoire ainsi qu'au groupe qui se l'approprie : gens ctager pour les Germains 105, potentia et familia chez les Gaulois : Horum esse [...] alterum Cotum, antiquissima familia natum atque ipsum hominem summae potentiae et magnae cognationis ... (cf. supra) ^6, ц est donc clair que pour César, dans le cadre de son enquête ethnographique, cognatio touche à tout ce qui fait concrètement le groupe parental (tant le territoire que la cellule, tant la force que donne une familia convenablement recrutée (voyez Orgétorix répondant à la convocation du "tribunal") que la toute-puissance procurée par les alliances extérieures (ce dernier sens est aussi souligné par Tacite chez les Germains) * ..., tandis que la parenté naturelle est bien définie par les termes précis de nexum sanguinis Ю8 Ainsi, on chercherait vainement une opposition terminologique, juridique ou sociologique entre agnation et cognation en Gaule comme en Germanie, tout simplement parce que les cellules familiales y connaissent une extension sans commune mesure avec la situation romaine et que d'autres réalités dépassent l'alternative traditionnelle : être ou ne pas être dans la patria potestas. Pour des raisons que je vais tenter de déterminer, le groupe de parenté
104. W., p. 37-38. 105. U.C., VI, 22, 2. 106. W., VII, 32, 4. 107. TAC, Germ., 38, 2. 108. W., 20,5.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 313
celtique soumis à l'influence d'un pater familias est extrêmement restreint et ses enjeux passent par la capacité d'un chef quelconque à élargir sa sphère de clientèle (au sens large: la familia) et ses alliances privées ou politiques à l'échelle des ciuitates (au sens large : Vadfinitas). Nous verrons aussi que, pour la parenté proprement dite, les cellules et les pouvoirs de leurs membres sont strictement morcelés, définis et délimités : il n'y a pas de place pour des notions aussi univoques que la cognation et l'agnation. Par définition, cette recherche des alliances privées et publiques crée des situations de déséquilibre (dont l'anisogamie est un trait constitutif) conduisant les femmes à revendiquer un sort nouveau en matière de gestion du patrimoine. L'étude de la condition de la femme fera donc voir que, s'il n'est pas impossible que l'organisation générale de la société celtique ait été, à haute époque, essentiellement agnatique, il serait illusoire d'y voir encore l'état social de La Tène III Ю9.
Ainsi, tant du point de vue de la parenté que de la transmission du patrimoine, la société celtique ne saurait être considérée comme étant à dominante agnatique : elle tend plutôt à l'indifférenciation, même si cette tendance n'était pas celle de ses origines.
3. LA FILIATION.
Si curieux que cela paraisse, il n'existe aucun renseignement précis sur la filiation dans la Gaule indépendante et les usages de la Gaule romanisée sont évidemment trop étrangers pour devoir aux Celtes autre chose que des détails secondaires ^®. Naturellement, on ne songerait même pas à évoquer ce point (le monde i.-e. ne connaissant pour ainsi dire que la filiation patrilinéaire) si la condition particulière faite aux femmes chez les Celtes ne réactivait ici ou là l'illusion d'un système matrilinéaire - voire matriarcal - supposé antérieur aux règles en vigueur à la fin de l'indépendance Ш : telle est la destinée extraordinaire des thèses de Bachofen qui, sur ce point, avaient même réussi à convaincre
109. L'étude du droit de la femme montre que la parenté est indifférenciée.
110. JULLIAN (C), Histoire de la Gaule , IV, p. 278-280. 111. Benvéniste lui-même y voit comme une explication de certaines
règles spéciales de la parenté, comme la relation avunculaire, p. ex.
314 Serge LEWUILLON
Morgan et les siens ... ^^. Mais, outre que l'exemple permanent d'une patrilinéarité presque sans exception se trouve dans les textes irlandais et gallois 113, il existe quelques présomptions de l'existence de ce système en Gaule : elles tiennent surtout à la transmission de la royauté. Quoiqu'il ait l'air de suggérer le contraire, César nous fait voir le rôle prédominant de ce type de transmission du pouvoir par les hommes (il connaît si bien ce mécanisme qu'il lui arrive de contribuer à le remettre en honneur) : c'est le cas de Casticos, fils de Catamantaloédis, chez les Séquanes 114 ; l'aïeul de l'Aquitain Pison avait été roi 115 ; chez les Carnutes, les ancêtres de Tasgétios avaient régné ^ ; de même, chez les Sénons, les ancêtres et le frère de Cavarinos ont exercé le pouvoir royal 117 . chez ies Trévires, beau-père et gendre se partagent la royauté et, à la mort du premier (Indutiomar), ce sont ses proches parents qui recueillent le pouvoir ^^ ; chez les Arvernes , Vercingétorix pourrait succéder à son père si son oncle paternel n'était avant lui *19 ; enfin, Valétiacos et Cotos veulent tous deux participer à la magistrature du vergobret ^0. Notons que les Gaulois
112. MORGAN (L.-H.), La Société archaïque , p. 401 sq. 113. On reparlera de ces exceptions à propos du droit successoral : en
Pays de Galles, une fille peut hériter à certaines conditions (d'ARBOIS DE JUBAINVILLE, La Famille celtique , p. 67-68) (cf. l'histoire de Peredur : la "Pucelle de Percdur" a hérité du royaume de son père (d'ARBOIS, Cours..., V, 2, p. 65) : c'est le cas de Cartimandua chez les Brigantes. En Irlande, la fille "épiclère" peut recueillir l'héritage afin de le transmettre : d'ARBOIS, Famille , p. 69- 72 ; 74 ; 77-81 ; le cycle d'Ulster (Naissance de Conchobar ) révèle le cas de la mère de Conchobar qui, outre son nom, lui transmet également le pouvoir (d'ARBOIS, Cours ..., V, p. 4-6).
114. B.C., 1,3, 4 115. Id., IV, 12,4. 116. Id., V, 25, 2 ; 10. Notez le pluriel ; on ne peut rien en tirer pour
appuyer l'idée d'une royauté "collégiale", bien que ce soit probablement le cas. Cf. ci-dessous n. 120.
117. B.G., V, 54, 2 : maiores également (cf. n. précédente). 118. B.G., V, 56, 3 ; VI, 2, ;8,8. 119. id., VII, 4, 1-2. 120. Id., VII, 32, 4. Rappelons que le vergobret est une magistrature
collégiale et non pas le nom porté par un magistrat unique (erreur fondée sur une correction abusive du texte de César, mais communément admise) : LEWUILLON (S.), op. cit., p. 547-550. La dernière découverte épigraphique n'ajoute rien au débat, tant sa
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 315
de Bretagne n'échappent pas à la règle : chez les Trinovantes, Mandubracios tient le pouvoir de son père 121.
On s'est interrogé plus haut sur la validité de la tradition de "l'épreuve en légitimité" 122. Sans y revenir, reconnaissons qu'elle implique au minimum le souci de la paternité. Argument banal, dira-t-on ; mais justement, il ne fait que souligner la banalité d'une situation qui, apparemment, n'avait aucune raison d'alerter les anciens. Elle ne doit d'ailleurs pas nous intriguer non plus, depuis que l'anthropologie a démontré l'inanité des "traces de matrilinéarité" que l'on reconnaissait autrefois au coeur des systèmes patrilinéaires à travers des institutions mal interprétées. (C'est ce que nous verrons à propos de la relation avunculaire.) Mais cette remarque a surtout une portée générale : quelles que soient les améliorations apportées à la condition féminine chez les Celtes et les Germains, elles ne peuvent être considérées que comme un produit de l'histoire ; par conséquent, elles n'affectent pas le principe fondamental du mode dominant de la patrilinéarité. La situation décrite par Tacite l'illustre de manière frappante. La femme de la Germanie joue en effet un rôle de toute première importance, étrangement comparable à celui de la femme dans les textes celtiques insulaires, fussent-ils juridiques, poétiques ou épiques : "Ainsi devra-t-elle vivre et enfanter : ce qu'elle reçoit, elle le rendra intact et pur à ses enfants, ses brus le recevront et cela passera, plus tard, à ses petits-fils"^.
lecture en est incertaine : ALLAIN (J., FLEURIOT (L.), CHAIX (L.), "Le vergobret des Bituriges à Argentomagus. Essai d'interprétation d'une fosse cultuelle", R.Á.E. , 32, 3-4, p. 11-32. Par contre, certaines inscriptions monétaires me paraissent confirmer la collégialité : cf. en résumé GRUEL (K.), La monnaie chez les Gaulois. Paris : 1989, p. 136-137
121. B.G.,V, 20,1. 122. Cf. supra n. 87. Par contre, si la remarque de Srabon sur la coutume
de dévorer le père après sa mort est intéressante (IV, 5, 4 С 201), elle est peut-être plus suspecte : d'autres peuples (Scythes et Ibères) sont censés pratiquer ce rite : est-ce dès lors un topique ?
123. TAC. Germ., 18, 5 : sic uiuendum, sic pariendum : accipere se auae liberis inuiolata ac digna reddat, auae nurus accipiant rursusaue ad nepotes referantur.
316 Serge LEWUILLON
Et pourtant, ceci n'enlève pas une once de pouvoir au paterfamilias , qui demeure le chef en toute occasion, à commencer lors de la célébration du culte privé qui fait la cohésion du foyer 124.
4. LA RÉSIDENCE.
La résidence des Gaulois est assurément patrilocale. Nous n'en avons à vrai dire aucune preuve formelle, mais les alliances interethniques nous montrent les femmes introduites dans la ciuitas du mari 125 . en vertu du même prédicat que pour l'exogamie, nous pouvons sans grand risque en inférer que l'adoption de la résidence patrilocale vaut également pour les cellules les plus étroites. En conséquence de quoi les systèmes celtiques peuvent être considérés comme harmoniques, c'est-à-dire pratiquant la même attitude vis- à-vis de la filiation et du choix de la résidence. Cette remarque ne serait que de pure théorie si elle ne nous avertissait d'avoir à trouver en Gaule une société toute disposée à réaliser les formules les plus complexes et les plus efficaces d'un échange généralisé 126. C'est effectivement le tableau économique et social que nous livrent les textes et l'archéologie.
IV. LA RÉCIPROCITÉ.
1. L'ÉCHANGE.
Alors que l'enquête sur la structure de la société celtique est rendue malaisée par l'absence de notations précises, notamment en matière de terminologie, la distanciation imposée aux auteurs classiques a tout de même produit quelques effets positifs : d'une manière très largement inconsciente, ils ont rapporté, souvent sur le mode pittoresque, des traits qui se distinguaient fondamentalement de la sociologie gréco-romaine. Mais dès lors que cette distinction n'opérait plus sur les circonstances, mais sur l'essence, le récit antique cessait d'être émaillé de ces remarques significatives qui, même si elles sont à décrypter, font la richesse d'un récit livien et de quelques autres. Il faut naturellement en éliminer les poncifs ; une
124. W., 10,2. 125. B.G., I, 18, 7 ; 53, 4 : ce dernier texte est le plus explicite. Arioviste a
deux épouses issues de cités différentes : la seconde était a fratre [missa].
126. LEVI-STRAUSS (Cl.), Structures ..., p. 266-335.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 317
fois ce travail accompli, il reste pour la Gaule la très forte impression d'une société qui envisage les rapports de tous types dans le cadre d'une réciprocité permanente, mais avec une telle constance qu'elle élève ce trait de caractère au rang d'une règle sociale. Selon les moments du processus, l'accomplissement de ces actes recevra les noms de don et de contre-don, de service et de contre-prestation. La théorie en est connue 127 et son champ d'application a déjà été largement exploré, et probablement surestimé 1^8 A cet égard, on n'a pas suffisamment souligné combien le comportement des Germains s'apparentait à celui des Gaulois :
"Aucune nation n'aime autant recevoir à table et pratiquer l'hospitalité [...] ils vont frapper à la maison la plus proche, sans être invités, il n'importe : ils sont reçus avec la même cordialité [...] Quand le visiteur s'en va, s'il demande quelque chose, l'usage est de lui accorder, et pour demander, en revanche, on a la même liberté. Ils
127. AUSS (M.), "Le don ", Année sociologique , ir'e sér., t. II ; id., "Sur un texte de Posidonius. Le suicide, contreprestation suprême", R.C., 42, 1925, p. 324-329. Les problèmes de fond de cet aspect de l'échange qu'est la réciprocité ne seront pas abordés pour l'instant. Il existe en effet une abondante littérature sociologique traitant des questions théoriques de la réciprocité ; les débats actuels portent sur l'approfondissement du concept (réciprocité positive - agent (intérieur) de cohésion sociale ? - et réciprocité négative - agent (extérieur) de désorganisation ? Cf. LACOURSE (J.), "Réciprocité positive et réciprocité négative : de Marcel Mauss à René Girard". Cahiers internationaux de Sociologie , 1987, vol. 83, p. 291-305 ; pour mémoire : RACINE (L.), "Les formes élémentaires de la réciprocité". L'Homme , 1986, vol. 26, n° 3, p. 97-118 ; DUPRE (M.C.), "Sous l'échange, l'inceste". Idem , 1981, vol. 21, n° 3, p. 27-37 ; MARTENS (F.), "A propos de l'oncle maternel, ou modestes propositions pour repenser le mariage des cousins croisés". Idem, 1975, vol. 15, n° 3-4, p. 155-175) ou sur sa critique radicale : cette dernière attitude peut contribuer à montrer que le don - contre-don, comme toute forme d'échange, n'est qu'un mécanisme qui contribue à la circulation, tandis que son extrême formalisme dissimule les véritables conditions de l'exploitation (TESTART (A.), Le communisme -primitif. I. Economie et idéologie . Paris : 1985, p. 240-242). Il y a, comme on dit, du grain à moudre ...
128. Depuis HUBERT (H.), "Le système des prestations totales dans les littératures celtiques", R.C., 42, 1925, p. 330-335 ; id., Les Celtes depuis l'époque de La Tène et la civilisation celtique, Paris, 1932, p. 209-213.
318 Serge LEWUILLON
aiment les présents, mais ne portent pas en compte ceux qu'ils ont donné, ni ne se sentent liés par ceux qu'ils ont reçus" ^9.
Voici, somme toute, la règle élémentaire ; elle est d'application tant dans les rapports privés qu'en public 130. Rien n'en est plus proche que les propos de Diodore sur l'hospitalité gauloise en retour de laquelle on exige, souvent de manière pressante, des renseignements généraux ^. A l'époque de César, ce système est toujours en vigueur, aux deux niveaux du public et du privé (notamment chez les Trévires) 132.
Ces alliances scellées par des dons et contre-dons sont d'un emploi général en Gaule aux heures de crise 133. Par ailleurs, ce système est également à la base du contrat qui lie un patron à ses clients, un chef à ses compagnons et, de manière générale, sans doute, tout homme à ceux qu'il tient dans sa dépendance 13^. Le dévouement des compagnons au chef prend ici tout son sens étymologique ; le chef leur octroie la vie sociale et les biens matériels, les compagnons lui doivent en retour le bien suprême : la vie ̂ 3^, cette vie qui demeure une "valeur d'échange" même lorsqu'elle est risquée dans les circonstances les plus étranges. En effet, les textes rapportent explicitement que la vie des Gaulois gage parfois des emprunts dont
129. TAC, Germ., 21, 2-4 : conuictibus et hospitis non alia gens effusius indulget [...] proximam domum non inuitate adeunt, nee interest : pari humanitate accipiuntur [...] abeunti, si quid poposcerit, concedere moris : et poscendi in uicem eadem facilitas . Gaudent muneribus, sed пес data imputant пес acceptis obligantur. ...
130. Id., 13, 5 ; 15, 3. 131. DIODORE, V, 28, 5. 132. Id., V, 55, A. 133. Id., V, 55, 1-3 ; VI, 2, 2 ; 31, 4 ; VII, 1, 5 ; 37, 6 ; 64, 8 ; 32, 2 (?). 134. Id., Ill, 22, 2-3 ; TAC. Germ., 13, 2-4 ; cf. DAUBIGNEY (A.),
"Reconnaissance des formes de la dépendance gauloise", D.H.A., 5, 1979, p. 145-189 ; id., "Formes de l'asservissement et statut de la dépendance préromaine dans l'aire gallo-germanique", D.H.A., 11, 1985, p. 417-447.
135. B.G., III, 22, 1-4 ; NICOLAS de Damase, apud ATHENEE, VI, 54, p. 249b ; TAC, Germ., 24, 1-5.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 319
on sait bien qu'ils ne pourront être remboursés en espèces 136. Cette pratique est également conservée par la légende qui veut que les Gaulois se prêtent des sommes remboursables dans l'au-delà ^1 \ \\ y a peut-être dans cette dernière tradition une confusion ou un amalgame entre les prêts gagés sur la vie et la propension des Gaulois à engager leur existence, à se dévouer, ainsi qu'avec la faveur dans laquelle ils tiennent le suicide : tout ceci relève manifestement de ce qu'on a appelé la "contreprestation suprême" 138# Enfin, pour épuiser les aspects du don, du contre-don et des prestations réciproques, évoquons encore certaines unions, ou stratégies matrimoniales, plutôt, dont les formes sont inconnues dans le monde gréco-romain : spécialement le mariage temporaire contracté en vue de la conclusion d'alliances, pour aboutir au règlement de conflits d'héritage ou pour toute autre raison tactique 139 On conçoit ainsi que certains processus sociaux, dont la pratique matrimoniale et les alliances, jouent un rôle essentiel dans l'accomplissement des cycles de réciprocité et de compensation. Or, on sait que ceux-ci tiennent à l'économie, notamment en palliant les insuffisances du marché et de la circulation monétaire naissante : la légende de Luern répandant son or suggère que ce phénomène doit être daté du début de La Tène III 140. Par conséquent, les cycles de réciprocité et les structures sociales qui les mettent en oeuvre, dont celles de la parenté, représentent avant tout des processus économiques. Il importerait de les examiner de plus près en reprenant l'analyse de tous les traits qui y touchent. Ceux-ci ont souvent un aspect pittoresque ; à la lumière de l'anthropologie celtique, ils n'en constituent pas moins le corpus de la compensation globale.
136. DESANTI (Th.), Les Gaulois à la fin de l'indépendance. Lecture sociologique de textes classiques (César et Tacite), Mém. maîtr., Dijon, 1986, p. 72-76.
137. VALERE MAXIME, II, 6, 10-11. 138. MAUSS (M.), "Sur un texte de Posidonios ...", loc. cit. ; HUBERT (H.),
"Le système des prestations totales ...", loc. cit. 139. Je reprendrai la question par la suite. Sur les mariages conclus pour
nouer des alliances politiques, cf. B.G., I, 3, 18. Pour l'étude des formes de mariages temporaires, cf. d'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Famille..., p. 153-155.
140. FEUVRIER-PREVOTAT (Cl.), "Echanges et société en Gaule indépendante : à propos d'un texte de Posidonios d'Apamée", Ktema , 3, 1978, p. 243-259.
320 Serge LEWUILLON
2. LA COMPENSATION GLOBALE.
J'indiquerai, sans chercher à les approfondir pour l'instant, quelques directions de recherche pour l'étude de ce mécanisme social chez les Gaulois. La volonté de régler les déséquilibres économiques et sociaux par l'intervention de la compensation se repère aux attitudes libérales qu'on vient d'évoquer. Le but immédiat de l'opération est déjà perceptible à la lecture des sources : il s'agit, pour l'individu demandeur, de provoquer chez son correspondant une situation débitrice dont celui-ci ne sortira qu'en restituant plus qu'il n'a reçu (le prêt étant censé avoir produit ses fruits : c'est, somme toute, un cas analogue à celui des biens paraphernaux celtiques). Donner plus, c'est promettre son service, sa liberté, sa vie, même. Si le prototype légendaire de cette prodigalité calculée est reflété par l'attitude extravagante de Luern ^^, le texte de César aussi est tout empli de ces formes d'acquisition de la puissance et du pouvoir : "C'était bien Dumnorix : l'homme était plein d'audace, sa libéralité l'avait mis en faveur auprès du peuple et il voulait un bouleversement politique [...] Cela lui avait permis d'amasser, tout en enrichissant sa maison, de quoi pourvoir abondamment à ses largesses "142
... turn lactea colla auro innectuntur ...
Des libéralités, qui sont signalées comme phénomènes des plus courants dans la société celtique et germanique 143, on glisse insensiblement aux offrandes. Dans la tradition des auteurs classiques, celles-ci permettent d'établir une liaison entre les dons privés et les contre-prestations générales où les dieux, "personnes morales", reçoivent les mêmes présents que les mortels. Le cas le plus typique en est "l'or de Toulouse", considéré comme celui du sanctuaire de Delphes augmenté d'offrandes privées (éx tôjv i8iu>v oťxcov) et constitué non pas d'objets façonnés, mais de lingots d'or et d'argent 144. Parmi ces offrandes, on trouve pourtant des torques et
141. POSIDONIOS, in JACOBY, II, A, p. 230, fg. n° 18 (= ATH., 246 c-d et IV, 152 d-f.).
142. B.G.,1, 18,3-4 (Eduens). 143. AC. Germ., 14, 4. 144. STRABON, IV, 1, 13 (С 188) ; DIODORE, V, 27, 3-4.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 321
des bracelets ^^ : la contradiction n'est peut-être qu'apparente si l'on admet que les anciens ont pu assimiler la forme particulière de certains lingots et des objets d'usage courant, comme des ancres de marine 146 ou, précisément, des bijoux. Quant aux torques, leur signification religieuse n'est plus à démontrer 147 : ce caractère aurait-il fini par cristalliser sur l'objet une valeur d'échange infiniment supérieure à sa valeur d'usage? On sait l'importance tenue par les attributs gaulois aux yeux des Romains 14^ ; ce caractère remarquable tenait-il à la fonction symbolique de l'objet ou à sa valeur intrinsèque ^ ? Aux deux à la fois, si l'on rapproche
145. STRABON, IV, 5 (C 197) SEGRE (M.), "Il sacco di Delfi e la leggenda dell' 'aurum Tolosanum ' ", Historia , 3, 1929, p. 592-648 ; on trouvera
de nombreuses références sur ce type de bijoux in DOTTIN (G.), Manuel pour servir à l'étude de l'antiquité celtique . Paris : 19152, p. 173-175; 179-192 ; notamment CARTAILHAC (E.), "L'or gaulois". Revue d'anthropologie , IV, p. 272-292.
146. Pseudo-ARISTOTE, de mirab. auscult., 85. 147. JOFFROY (R.), LEJEUNE (M.), "Un torque d'or découvert en 1965 à
Mailly-le-Camp (Aube)", Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot , 56.
148. Cf. le combat de Manlius Torquatus (LIV., VII, 10, 11) et les reproductions plastiques des Galates. Le torque est aussi oriental (cf. les portraits d'un galle et d'un cistophore in CUMONT (Fr.), Les Religions orientales dans le paganisme romain , Paris, 1963 [= 19061], pi. II ) et il est porté aux jeux troyens : VIRG., Aen., VIII, 556-559 (cf. GROS (P.), Aurea templa. Recherches sur l'architecture religieuse de Rome au temps d'Auguste , Rome, 1976 (BEFAR 231), p.13-14 ; (SUETONE, Aug., 43, 6). SASSATELLI (G.), "Les Gaulois de la frise de
Civitalba", Les Celtes en Italie (Dossier Histoire et Archéologie) n° 112 (janvier 1987), p. 56-62 (cf. biblio. p. 98). Sur l'origine orientale et la transmission des motifs décoratifs par les Grecs, CASTRO PEREZ (L.), "L'art des torques orientaux", Archéologia , 222 (mars 1987), p. 58-66 ; KRUTA (V.), "Or grec et or gaulois", idem , 220 (janvier 1987), p. 32-35.
149. En 358 a.C, les Romains retirent beaucoup d'or des dépouilles des Gaulois vaincus : sous quelle forme, sinon sous celle de bracelets et de torques, qu'on signale aussi à Télamon (POLYBE, II, 29, 8 ; 31, 5 : 225 a.C.) ? Remarquez également le butin saisi après la défaite de Bituitos, où les colliers et l'or de Toulouse sont clairement mis en relation (EUTROPE, Breviarum a.V.c, IV, 22-23). A propos de l'or de Toulouse, cf. DOMERGUE (C), "L'or des Volques Tectosages : mythe ou réalité ? " in L'art celtique en Gaule. Marseille-Paris- Bordeaux-Dijon : 1983, p. 84-85 (renvoyant à LABROUSSE (M.),
322 Serge LEWUILLON
l'offrande fabuleuse - peut-être dans tous les sens du mot - que les Gaulois firent à Auguste (en 16 a.C. ?) : un torque d'or de cent livres 150, }es torques d'or qui ornaient le Capitole à titre de dépouilles en 225 a.C. et les mystérieuses "dépouilles inamovibles" du temple insubre de Minerve ^1. Les torques, après avoir été les signes distinctifs de certains groupes celtiques, auraient-ils disparu en tant qu'ornements ^2 pour faire office de "lingots fonctionnels", décorant les temples et retrouvant pleinement leur valeur d'échange ? Au même titre que quelques autres pratiques signalées ci-dessus, ils participeraient ainsi des mécanismes économiques protomonétaires et contribueraient à faire fonctionner, à la fois comme symbole et comme support du don et du contre-don, les formes les plus complexes de l'échange. Même pour le début de l'empire, Tacite est là-dessus on ne peut plus explicite :
"Ils apprécient particulièrement les dons des nations voisines, envoyés par des particuliers mais aussi à titre officiel, chevaux d'élite, grandes armes, phalères et colliers ; aujourd'hui, nous leur avons appris à recevoir aussi de l'argent 153.
3. L'ENIVREMENT ET LES RICHESSES.
C'est un autre trait caractéristique des Gaulois, considérablement répandu dans l'historiographie antique, que leur tendance à boire immodérément. Si certains auteurs n'y voient qu'une clef de leurs problèmes comportementaux ^, d'autres témoignages
Toulouse antique . Paris : 1968, p. 129-136) ; ELUERE (C), L'or des Celtes . Paris-Fribourg : 1987, p. 164-166.
150. QUINTILIEN, De institutione oratoria , VI, 3, 79. Est-ce à l'occasion d'un des voyages d'Auguste en Gaule ? Pour de nombreuses raisons, le voyage de 16 a.C. apparaît comme le plus important quant à l'oeuvre politique et militaire réalisée par Auguste : LEWUILLON (S.), op. cit., p. 503-510. Sur ce type d'offrandes, cf. DOTTIN (G.), loc. cit.
151. POLYBE,II,31,5;32,6. 152. KRUTA (V.), "Le port d'anneaux de chevilles en Champagne et le
problème d'une immigration danubienne au IIIe siècle a.C", E.C., 22, 1985, p. 27-51.
153. TAC, Germ., 15, 3. 154. PLATON, Lois, I, 9, 637d (en relation avec le caractère guerrier) :
ARRIEN, Entretiens d'Epictète, II, 20, 17 ; (ARISTIDE QUINTILIEN,
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 323
permettent d'en dégager des tendances plus concrètes, historiques, économiques ou sociologiques :
- historiques en ce qui concerne la tradition de "l'Etrusque jaloux", dont l'expédition pour délivrer sa femme ravie par un Gaulois serait à l'origine de l'importation des vins italiens en Gaule 155 ;
- économiques et sociologiques lorsque l'idée d'ivresse accompagne celle d'une bombance dépassant toute mesure 156 : par ailleurs, comme les Celtes rejettent le luxe pour lui-même 157 _ peu importe que ceci soit une variante du topique classique à propos de la supériorité de l'état de nature sur celui de culture - cette consommation frénétique constitue bien un témoin du sens économique et social reconnu au banquet 158 - \e v\Uf \)\cn de consommation par excellence (mais aussi bien d'échange remarquable 15"), y joue un rôle primordial, joignant du même coup l'utile à l'insensé.
Signalons enfin deux formes dérivées de l'idée précédente : la notion d'hyper-consommation conduit immanquablement à celle de la destruction des biens d'usage ou d'échange, et même à celle des hommes :" Les funérailles sont, relativement au degré de civilisation des Gaulois, magnifiques et somptueuses ; tout ce qu'on pense que le mort chérissait est porté au bûcher, même les animaux, et, il n'y a pas longtemps encore, la règle d'une cérémonie funèbre
Sur la musique , II, 6); APPIEN, Guerres celtiques, 7 ; DIODORE, V, 26, 3. Pour les Germains, TAC, Germ., 23, 2.
155. LIV., V, 33, 2-3 ; DENYS, XIII, 10-11 (tradition parallèle) ; cf. PLINE, h.n., XII, 2, 5 ; PLUTARQUE, Camille, 15, 1-6. Sur l'origine italienne des vins en Gaule, cf. LAUBENHEIMER (F.), Le temps des amphores en Gaule. Vins, huiles et sauces. Paris 1990.
156. POSIDONIOS in JACOBY, H, A, n° 15 et 16, p. 229-230 (=ATH., IV, I51e-152d et 154a-c); DION de Pruse, Discours au conseil pour refuser l'archontat , 8 ; POLYBE, II, 19, 4.
157. CLEMENT d'Alexandrie, Le Pédagogue, III, 3, 24 ; B.G., II, 15, 4 ; IV, 2, 6 (et TAC. Germ., 23, 2 comme argument a contrario . Est-ce comparable à l'amende infligée aux jeunes gens trop gros ? EPHORE, fg. n° 131 (JACOBY, II, A, p. 81 = STRABON, IV, 4, 6 С 198).
158. FEUVRIER-PREVOTAT (Cl.), loc. cit.. 159. TCHERNIA (A.), "Italian Wine in Gaul at the End of the Republic",
Trade in the Ancient Economy , GARNSEY (P.), HOPKINS (K.) & WHITTAKER (C.R.) éd. Londres : 1983.
324 Serge LEWUILLON
complète voulait que les esclaves et les clients qui lui avaient été chers fussent brûlés avec lui" 1^0
Ce n'est pas le lieu de traiter de ces mécanismes dans le détail, car ils dépendent plutôt de la pratique du sacrifice au sens le plus large 161 et il est probable qu'ils rejoignent ainsi l'ensemble des rites agraires ^^. L'époque et la forme des sacrifices sont difficiles à déterminer ; comme beaucoup de renseignements rapportés par César, ceux-ci doivent être rattachés à une époque antérieure - comme il le reconnaît d'ailleurs lui-même : - rien ne s'oppose à ce que ce soit celle de Posidonios ou des sources de celui-ci. Il est probable enfin que les funérailles des Germains ne s'accompagnent pas du même genre de
160. B.G., VI, 19, 4. 161. Textes : SOPATROS [Comédies ], fg. n° 6 (Kaibel, p. 193) : Galates ou
Gaulois ? CICERON, de re publ., III, 9, 15 ; pro Fonteio , XIII, 29-31 ; SENEQUE, de beneficiis , VI, 1, 3 ; ANTONÍN DIOGENE, Ta ùnèp вбиХлУ йршта, 4 ; (LUCAIN, Pharsale , I, 445-462); PLINE h.n., Vil, 2, 19 ; DENYS, I, 38 (plus VII, 10) ; AUGUSTIN, de ciuitate Dei, VII, 19 ; PLUTARQUE, De la superstition, 13, 171 С ; POMPONIUS MELA, Chorographia , III, 2 (16-74) ; MINUCIUS FELIX, Octavius, VI, 1; TERTULLIEN, Apologétique , 9, 5 ; SOLIN, Curiosités , 21, 1 ; LACTANCE, Institutions divines, I, 21, 3. L'étude de ce point a donné lieu aux pires controverses, quelques auteurs pensant que le sacrifice, et spécialement le sacrifice humain, témoignait chez les Gaulois d'une extrême barbarie en désaccord avec l'état de la civilisation où on les croyait parvenus : JULLIAN, op. cit., IV, p. 66, n. 2 ; 173, n. 3-4. Pour un aperçu général du problème du sacrifice, et spécialement du sacrifice humain, cf. LE ROUX (Fr.), Introduction générale à l'étude de la tradition celtique , I, suppl. à Ogam , 19/112, 1967, p. 59-70.
162. DAUBIGNEY (A.), op. cit., p. 421 sq. Voyez cependant les problèmes archéologiques posés par les découvertes sacrificielles à proximité des milieux urbains : BRUNAUX (J.-L.), "Le sacrifié, le défunt et l'ancêtre. Pour une epistemologie des faits culturels de l'âge du Fer" in Actes du VIIIe colloque sur les âges du Fer. Aquitania , 1986, suppl. 1, p. 317-326 ; id., Les Gaulois. Sanctuaires et rites. Paris : 1986 ; idem , "Synthèse" in BRUNAUX (J-L.), MENIEL (P.), POPLIN (F.), Gournay
I. Les fouilles sur le sanctuaire et l'oppidum (1975-1984). R.A.P. , n° spécial, 1985, p. 167-180. Sur le sens structurel du sacrifice, cf.
LEWUILLON (S.), "Esus d'Aricie : rites du sang et culte des arbres en Gaule" [à paraître].
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 325
"sacrifice ultime" 1(>3 • on tient là une confirmation que les formes de la compensation n'ont pas atteint chez ces peuples la complexité - la perfection, dirais-je - qu'elles connaissent chez les Celtes.
Il ne faut sans doute pas négliger les autres formes de dévotion 164, dont les nombreux suicides de Gaulois, qui apparaissent souvent comme le recours ultime des vaincus. Cette attitude a gagné l'ensemble du domaine celtique et s'étend sur une époque très large : depuis la Galatie, dont on connaît les "Gaulois mourants", jusqu'à la Bretagne, où le suicide de Boudicca perpétue la tradition des chefs perdus 16^, depuis le IIIe siècle a.C. (voyez le suicide du roi Anéroeste et de toute sa famille après Télamon)^6 jusqu'à l'empire, en passant par la mort d'Orgétorix ^^ , de Catuvolcos 168, de Drappès 169 ou de Sacrovir 170, sans oublier le suicide collectif de certains Gaulois vaincus par Marius 171 ... Malgré les nuances que peut connaître l'application du principe, sa validité demeure : bien des cas apparemment marginaux de destruction et de dévotion démontrent que les sacrifices des biens ou des personnes ne sont pas que des pratiques rituelles l7^ ; il faut y
163. TAC. Germ., 27, 1-3. 164. ... depuis la tradition de "l'homme expiatoire" (PETRONE, fg. en
prose n° 1 [ERNOUT, C.U.F. ]; scholies à STACE (cf. DUVAL (P.-M.), La Gaule jusqu'au milieu du Ve siècle , n° 122 et 346J); SERVIUS ad. Aen., III, 57 ; JULLIAN H.G., I, p. 437, n. 4) jusqu'à la dévotion des joueurs de dés en Germanie dont on se débarrasse, s'ils viennent à être asservis, par le commerce (TAC. Germ., 24, 3-4).
165. TAC. Ann., XIV, 37, 6. 166. POLYBE, II, 31, 2. 167. B.G., 1,4, 4. 168. Id., VI, 31, 5. 169. Id., VII, 44, 2. 170. TAC. An., III, 46, 7 ; LEWUILLON (S.), op. cit., p. 515. 171. OROSE, adu. pagan., IV, 14, 5-6. JULLIAN (C), H.G., I, p. 133, n. 4
n'en fait pas de commentaire sociologique, mais précise qu'il s'agissait de Ligures
172. Sur les circonstances, les formes et l'extension des pratiques sacrificielles, cf. BRUNAUX (J.-L.), MENIEL(P.), RAPIN (A.), "Un sanctuaire gaulois à Gournay-sur-Aronde", Gallia , 38, 1980, p. 1-25 ; CADOUX (J.-L.), "L'ossuaire gaulois de Ribemont-sur-Ancre (Somme). Premières observations, premières questions", Gallia , 42, 1984, p. 53-78, surtout 75-78.
326 Serge LEWUILLON
voir aussi la réponse à quelques-uns des problèmes très concrets que pose la défaite au combat ou au grand jeu des dons, des prestations et de leur contrepartie : ils sont donc, en quelque sorte, la preuve et la loi du mécanisme de la compensation globale. Ce caractère, peut- être davantage celtique que germanique, démontre que les sociétés sur lesquelles nous nous penchons ont pour principe commun (ce qui fait remonter son existence au plus tard à partir du IIIe siècle a.C.) l'échange généralisé, dont les formes extrêmement diversifiées empruntent des voies extra-économiques. Les études anthropologiques récentes nous apprennent que les structures de la parenté peuvent y avoir une partie importante à jouer. Cette règle se vérifie en effet en Gaule.
V. PARENTÉ ET TERRITOIRE
1. LES CADRES TERRITORIAUX.
a. La société tribale.
L'articulation des notions qui viennent d'être mises en évidence exigerait que l'on brosse un tableau précis du contexte historique de la Gaule à la fin de l'âge du fer. Mais les résultats actuels de l'archéologie démontrent que les vues théoriques que nous pensons avoir de la société gauloise sont à remettre en cause ou, du moins, à rectifier continuellement, surtout en ce qui concerne le cadre territorial, l'habitat et la chronologie. Cette critique étant impensable dans les limites de cet article, on n'évoquera que les points significatifs qui caractérisent l'organisation économique des contrées contrôlées par les Gaulois. Même depuis les hautes périodes de l'indépendance, la Gaule est un pays d'économie rurale ; mais cela ne veut pas dire grand-chose : qu'aurait-elle pu être d'autres ? L'important est de déterminer les différenciations régionales et les décalages chronologiques. Or, la tradition historiographique, en général confirmée par l'archéologie, permet justement de distinguer des secteurs où l'élevage l'emporte sur l'agriculture proprement dite I73. Ces régions présentent forcément un profil social particulier, ce qui se perçoit, entre autre, à la présence d'un habitat
173. Les témoignages littéraires et archéologiques sont trop nombreux pour faire l'objet d'une note. On se référera provisoirement au bon inventaire de JULLIAN (C), H.G., II, p. 278-289 ; V, 195-203 ; cf. également ici, n. 177.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 327
caractéristique implanté dans des zones dont l'originalité écologique est également très marquée : ce que l'on appelle les fermes de l'âge durer174.
Ceci étant, sommes-nous fondés à évoquer des formes de société tribale à propos des Celtes de l'indépendance ? L'expression "formes de société tribale" n'engage pas loin et elle a trouvé, par le passé, de sérieux concurrents sur sa route à travers la littérature anthropologique et historique : mode de production néolithique, mode de production primitif et surtout, mode de production germanique, ... etc 175. Toutefois, puisque l'enquête ne porte pas sur l'ensemble des aspects de la formation gauloise, restons-en à cette caractérisation plutôt sociologique de "société tribale".
Si de nombreux témoignages antiques tendent à prouver que la Gaule de la fin de l'indépendance vivait essentiellement sur un mode ("mode de subsistance", au minimum) pastoral 176, ce trait se révèle commun à toutes les sociétés celtiques au moins depuis le haut moyen âge : il a laissé de profondes traces encore observables aujourd'hui dans les contrées d'origine celtique 177. Il en va de même des Germains et la comparaison de ceux-ci avec les Gaulois s'imposait déjà aux anciens 178 ; il existe d'ailleurs de cet état de fait de nombreuses preuves indirectes 17^. Celles-ci nous renseignent
174. AGACHE (R.), La Somme préromaine et romaine , Amiens, 1978, p. 120-168 (et 169-178 pour les fossés entourant les constructions sur substructions).
175. ANDERSON (P.), Les Passages de l'antiquité au féodalisme , Paris, 1977, p. 15, 231, 237; GODELIER (M.), 'Territoire et propriété dans quelques formes de sociétés capitalistes" , La Pensée , 198, 1978, p. 7- 50, p. 35. On rencontre aussi les termes de "mode de production génétique", "pastoral", "néolithique", ... etc.
176. STRABON, IV, 1, 2 (C178) ; JULLI AN (C), H.G., II, p. 278-283. 177. Cf. notamment FLATTRES (P.), Géographie rurale de quatre
contrées celtiques, Irlande, Galles Cornwall et Man , Rennes, 1957. 178. STRABON, VII, 2 (C 290) ; sur l'élevage en Germanie, cf. B.G., VI, 1,
8-9 ; 10, 2 ; 24, 1-4 ; TAC. Germ., 5, 1-2 ; 12, 2 ; 14, 4-5 ; 15, 1-2 ; 18, 2 ; 46, 5 ; PLINE, h.n., XVII, 4, 26 (sur les pâturages).
179. Notamment les nombreuses remarques où les auteurs anciens aiment à souligner la quasi-absence d'agriculture, concomitamment aux pratiques d'élevage intensif ; on appréciera évidemment la part des topiques dans ce genre de tableau, mais la cartographie de
328 Serge LEWUILLON
de manière particulièrement circonstanciée sur les activités de transformation à partir des productions animales, notamment dans les secteurs textile et alimentaire l^O Si ces témoignages se rapportent à la fin de l'indépendance et à la période gallo-romaine, il y a cependant de bonnes raisons de croire que ce genre de production remontait à une époque bien antérieure. A coup sûr, les Gaulois suivaient une alimentation carnée 181 : s'il n'est pas absolument certain que les énormes quartiers de viande qui tenaient la première place dans les banquets 182 provenaient de l'élevage, et non de la
l'agriculture gauloise comparée aux données de l'archéologie démontre qu'il n'y a pas dans ces propos que des lieux communs de l'ethnographie antique.
180. La Gaule se signalait également par ses peausseries : PLINE, h.n., IX, 6, 14. Les Vénètes du Morbihan devait en produire de longue date : B.G., III, 13, 6. Les sources les plus importantes témoignant de l'existence d'une industrie vestimentaire à base de produits animaux sont : STRABON, IV, 4, 3 (C 197) (généralités ; Corpus Tibullianum (BAEHRENS (E.), MOREL (W.), Fragmenta poetarum latinorum , 19272), fg. p. 134 : matelas cadurque ; PLINE, VIII, 73, 192 ; XIX, 2, 9 (idem , pour toute la Gaule); 74, 196 (étoffes à carreaux) ; 73, 191 (laine de l'Hérault et broderie gauloise) ; MARTIAL Epigrammes, I, 53, 5 (cape lingonne) ; 92, 8 (casaquin gaulois); IV, 19, 1-4 (couverture grossière séquane - ou de la Seine) ; XI, 21, 8 ; XIV, 159-160 (bourre leuconique et manteau gaulois) ; JUVENAL, Satires , VII, 221 (couverture cadurque) , VIII, 145 (cape saintongeaise); IX, 30(chape grossière, peut-être cadurque [scholiel) ; Hist. Aug., Les deux Galliens , VI, 6 (manteaux atrébates ) ; Claude II , XVII, 6 (manteau à capuchon) ; Probus , V, 5 (manteaux) ; Carus, Carinus et Numérien , XX, 6 (capes atrébates) ; SULPICE-SEVERE, Dialogues, I (II), 1, 8 (vêtement de Bigorre) ; JEROME, Chronique , 367 (production lainière de l'Artois) ; Contre Jovien , II, 21 (vêtements atrébates) ; OROSE, adu. pag., VII, 32, 18 (prospérité lainière des Atrébates). Pour l'industrie alimentaire, cf. STRABON, IV, 3, 2 (C 192) ; IV, 4, 3 (C 197) ; COLUMELLE, XII, 59, 3 ; PLINE, X, 22, 53 ; XI, 97, 140; MARTIAL, XII, 54 ; POLYBE et VARRON, apud ATHENEE, XIV, 657e-f.
181. C'est également une caractéristique des Germains : B.G., I, 4, 8-9 ; VI, 22, 1-4; 24, 1; 4.
182. POSIDONIUS, in ATHENEE, Deipn., IV, 151e ; 154b (JACOBY, F.G.H., II, A, fg. 15-16, p. 229-230); DIODORE, V, 28, 3-4 ; STRABON. IV, 4, 3 (C 197) ; FEUVRIER-PREVOTAT (Cl.), loc. cit.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 329
chasse 183, il faut tout de même ranger, parmi les preuves indirectes, les descriptions de paysage dont l'aménagement, comme les enclos ou le bocage, dénonce un important développement de l'élevage î**4 Naturellement, ces renseignements à eux seuls ne suffisent pas à établir la preuve d'un mode de vie réellement pastoral, d'autant plus que la Gaule était un pays agricole complet, où l'agriculture proprement dite tenait une place également considérable. Aussi, gardons-nous de rechercher une société univoque : la réalité, beaucoup plus complexe, s'exprime sous la forme de combinaisons de structures imbriquées qui ne s'agencent ni ne se reproduisent par hasard, mais dessinent une dominante dans leurs schémas économiques, surtout décelable dans le temps long. C'est dans de cette note constante qu'on trouve les raisons de voir dans la société gauloise une société dont les principes organisateurs sont tribaux et pastoraux - bien qu'ils ne soient pas que cela.
Pour cette étude, l'ethnologie comparée doit venir à notre secours. Les sociétés tribales sont surtout connues dans le monde des steppes de l'antiquité, mais elles y sont encore tout imprégnées de nomadisme. Or, les Gaulois de La Tène III ne sont plus guère nomades s'ils l'ont jamais été : tout au plus en ont-ils encore le souvenir, plus ou moins vif selon les cas (j'entends "nomades" au sens strict et classique : on ne peut, me semble-t-il user de ce terme pour nommer les "migrations périodiques" que pratiquent des groupes celtiques entiers - Danubiens, Belges - ou des tribus plus restreintes - Sénons à La Tène II et même, à La Tène III, les Helvètes, justement). Il faut pourtant distinguer entre les diverses composantes du nomadisme : s'il existe bien des rythmes longs qui entraînent les peuples dans des déplacements et des conquêtes à grande échelle, il existe aussi des
183. La chasse chez le Gaulois n'est plus l'activité prédatrice de base ; il existe des parcs à reconstituer le gibier : VARRON, res rusticae , III, 12, 2 ; JULLIAN, H. G., V, p. 202, n. et 4 ; II, p. 284-289 ; Cf. COLUMELLE, de re rustica , IX, "Préface" et 1 ; VARRON, III, 3, ; 8. Dans certains cas, la chasse n'était qu'une activité directement intégrée à l'élevage : on se procure de cette manière les porcs destinés à régénérer la race : STRABON, IV, 4, 3 (C 197).
184. Les parcs d'élevage sont mentionnés dans le textes antiques (cf. ci- dessus) et bien repérés par l'archéologie (AGACHE (R.), loc. cit. ); les haies nerviennes ont certainement une fonction agricole : B.G., II, 17, 4-5 ; 22, 1) ; les pâturages des Pictons : PAULIN, Carmina , X, 240- 249; 256-259 ; JULLIAN, H.G, II, p. 269-270.
330 Serge LEWUILLON
rythmes courts représentant une activité qui se rattache pour ainsi dire quotidiennement à l'économie pastorale 1**5 (ainsi des razzias, dont on lit de si nombreux exemples dans les textes celtiques). Mais il est d'autres critères plus significatifs : l'immense importance revêtue par le cheptel, notamment comme richesse mobilière de référence ; la contradiction entre différentes formes de propriété (privée pour les têtes de bétail, "commune" pour les pâturages) ; de profonds déséquilibres sociaux dus aux possibilités d'accumulation primitive (l'accroissement quantitatif du troupeau) ; l'émergence de groupes dirigeants issus des familles "aristocratiques" et guerrières, tenant fermement les commandes de la régulation économique (l'accès au saltus); et, naturellement, tout ce qui touche aux difficultés de la spécialisation du travail, de l'organisation du marché, à l'absence de structures urbaines, ... etc.
b. Modules territoriaux.
A de multiples égards, les formations économiques des sociétés celtiques à l'âge du fer correspondent à ce tableau brossé à larges traits. Mais c'est surtout pour des raisons d'articulation territoriale que la société gauloise mérite l'épithète de tribale ; elle est, en effet, morcelée en entités politiques auxquelles ont rattache, par interpretatio et de façon plus ou moins discutable, la notion de tribu : les ciuitates 186^ dont On connaît surtout l'aspect organisa tionnel augustéen, mais dont les Commentaires présentent déjà un modèle cohérent - dans les limites de la vision césarienne : il va de soi, faut-il le préciser, que l'analyse qui va suivre ne prétend à la signification que dans le cadre des champs lexicaux du territoire et de la parenté des textes de César et de Tacite. C'est pourquoi elle
185. La terminologie de ces sociétés est peu précise : "sociétés nomades", "tribales", "de la steppe", "pastorales", "pastorales nomades" ... etc. Cf. ANDERSON (P.), op. cit., p. 235-238 ; GODELIER, op. cit., p. 30 sq.
186. B.G., VI, 11, 2 ; le latin tribus n'exprime pas la notion celtique de "tribu" (teuta ; irl. tuath ), beaucoup plus sociale : BENVENISTE (E.), Vocabulaire ..., I, p. 336-37 ; sur ciuitas , idem , p. 308-309. Il existe des noms de dieux et des anthroponymes forgés sur ce radical : B.G., VII, 31, 5 ; 46, 5 ; EVANS (D.E.), Gaulish Personal Names ; a Study of Some Continental Formations , Oxford, 1967, p. 266-269 ; nombreux exemples in WHATMOUGH (J.), The Dialects of Ancient Gaul, Michigan, 1949-1951, passim.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 331
revêt sans doute encore des aspects provisoires en ce qui concerne la terminologie du territoire.
Pagus : on ne refera pas ici la discussion autour de ce que représente, face à la ciuitas, le pagus , dans lequel quelques-uns des meilleurs auteurs ont vu l'espace occupé primitivement sur le sol gaulois 187. Selon ce point de vue, très solidement étayé, les ciuitates dont les noms sont livrés par César constituent des regroupements de tribus intervenus entre les dernières vagues d"'invasions" celtiques et la fin de l'indépendance ï88. Ces regroupements étaient liés à la formation de ligues temporaires visant à l'hégémonie économique et politique de régions importantes. César lui-même fut encore le témoin de semblables événements lorsqu'il fut mêlé aux suites de l'affaire qui opposait Séquanes, Arvernes et Eduens 189. Quoi qu'il en soit, il nous importe surtout que ces pagi, qui font les ciuitates, soient composés eux-mêmes d'unités plus petites : "En Gaule, non seulement toutes les cités, tous les cantons et fractions de cantons, mais même, peut-on dire, toutes les familles sont divisées en partis rivaux" 190 un seui moj je \a phrase peut passer pour ordinaire : partibus. Les autres relèvent déjà d'un vocabulaire spécifique de la structure sociale. Domus, par exemple, éveille tout particulièrement l'attention de l'anthropologue : s'opposant à aedes, il n'admet aucune qualification matérielle et se réfère manifestement à une
187. JULLIAN H.G., I, p. 180, n. 1 ; II, p. 14-15 ; arrive à un total de 500 tribus pour toute la Gaule (il donne un chiffre différent in "A propos des pagi ...", loc. cit. ); GRENIER (A.), Les Gaulois , Paris, 1970 (= 19231), p. 146-148.
188. Ciuitas : B.G., VI, 11, 2, et de nombreuses occurrences au livre VII ; gens , II, 28, 1 ; populus, I, 3, 8 ; VI, 13, 6 ; natio , III, 10, 2 ; JULLIAN, op. cit., II, p. 19, n. 5 ; tribus : B.G., 1, 12, 4-5; 27, 4 ; 37, 3 ; 1, 1, 4 ; 22, 5 ; VI, 11, 2 ; 23, 5 ; VII, 64, 6. Le regroupement des tribus était déjà bien amorcé au cours de La Tène III : les Helvètes en sont là à l'époque de l'invasion des Cimbres : STRABON, IV, 3, 3 С 193 : aÛTôv xà ôuo фпХа Tpi&v 6vto)v ... cf. B.G., 1, 12, 4 (4 cantons).
189. LEWUILLON (S.), op. cit., p. 442-443 ; 483 ; sur les clients : B.G., I, 28, 5 ; II, 14, 6 ; les Rèmes tirent parti de la même situation : VI, 12, 7-9.
190. Sur la subdivision des pagi : VI, 11, 3 : in Gallia, non solum in ciuitatibus atque in omnibus pagis partïbusaue, sed paene etiam in singulis domibus factiones sunt .
332 Serge LEWUILLON
réalité gentilice ou, au minimum, "domestique" 191 : "maisonnée", "descendance", "lignée" ^2 ? Qe terme, intercalé entre la tribu et l'individu, devrait signifier "famille" ou "clan" (et même, éventuellement, "phratrie"). Il est remarquable, de plus, que César n'ait pas usé du mot gens à des fins ethnographiques : sans doute la situation qu'il avait sous les yeux, ou qu'on lui avait décrite ne correspondait-elle pas aux schémas familiaux romains, et rien de la structure de parenté gauloise ne méritait d'être comparé au patrilignage que symbolise la gens. Pour cette raison, l'appellatif vidé de toute sa précision est toujours (sauf au VI, 22, à propos des Germains - cf. infra et n. 245) synonyme de natio dans les Commentaires et dans la Germanie. Et pourtant, il est presque certain que la société gauloise était elle-même primitivement structurée en (patri)lignages, s'il faut se fier au nombre et à la force des références à l'hérédité paternelle, voire à celle de l'aïeul 193 • une telle situation pouvait difficilement découler, à son commencement tout au moins, d'une organisation poursuivant les règles de la filiation indifférenciée 194. La différenciation devrait donc se situer au niveau des lignages eux-mêmes qui, peut-être plus violemment qu'à Rome '"5^ furent soumis à des tiraillements
191. domus est indissociable de dominus : BENVENISTE (E.), op. cit., I, 294-307.
192. "Maisonnée", "descendance", "lignée", ces sens dominants sont biaises chez César, où domus signifie en général le lieu d'origine : B.G., 1, 5, 3 ; 6, 1 ; 12, 5 ; 18, 6 ; 20, 2 ; 28, 3 ; 29, 3 ; (30, 3 ?) 31, 14 ; 43, 9 ; 44, 2 ; 53, 4 ; 54, 1 ; II, 10, 4 ; 11, 1 ; 24, 4 ; 29, 1 ; IV, 21 , 6 ; V, 54, 2 ; VI, 8, 7 ; VII, 4 , 8 ; 4, 10 ; 5, 4 ; 39, 1; dans trois cas, le pluriel paraît lui donner le sens précis de "demeures" ou de "famille": I, 30 , 3 (Helvètes) ; VI, 11, 2 (la Gaule dans son ensemble) ; VI, 23, (Germains).
193. I, 3, 4 ; II, 13, 1 ; V, 4, 2 ; 25, 1 ; 54, 2 (maiores) ; 27, 2 ; 19, 3 (patriarcat) ; VII, 4, 1-2 ; 31, 5 ; 32, 4 ; 37, 1 ; 39, 1 (patrilinéarité).
194. Sur la terminologie, cf. PANOFF (M.), PERRIN (M.), Dictionnaire de l'ethnologie. Paris, 1973 ; AUGE (M) e.a., Les Domaines de la parenté. Filiation, alliance, résidence , Paris, 1975 (Dossiers africains); FOX (R.), Anthropologie de la parenté. Une analyse de la consanguinité et de l'alliance, Paris, 1972 [=1967] (et DREYFUS (S.), "Vocabulaire et concepts des études de parenté", p. 263-292).
195. Mais ceci est encore à démontrer; quelques indices vont dans ce sens, notamment le fait que la patrilinéarité connaisse des progrès plus rapides à Rome, comme le montre l'étude de l'aspect classificatoire de la parenté : BENVENISTE, op. cit., I, 230 ; 272-276 ; idem, 'Termes de parenté dans les langues i.-e", p. 10-15.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 333
d'origine stratégique, allant tantôt dans le sens d'une conglomeration, tantôt dans celui d'une fission. Quoi qu'il en soit, on verra que la tendance historique fut, à la longue, à l'indifférenciation.
Pars et regio : la première de ces divisions est située entre le lignage et la tribu. Il ne semble y avoir aucune difficulté à ce que ce terme représente le clan, au sens d'un groupe de lignages animé d'un puissant esprit de corps, lieu d'une solidarité active entre les membres qui se reconnaissent un ancêtre éponyme commun. Mais pars est un mot banal dont les connotations dépassent notablement la signification : il est sans doute préférable de lui réserver le sens général de "territoire", de division géographique (et administrative) inférieure au pagus 196. Cette interprétation est attestée I97 par l'appartenance du terme à des couples ou des séries terminologiques : ciuitas, pagus, domus 198, regiones 199 ; parfois, il est renforcé par sa propre répétition ^№ ■ regiones, par exemple, est un terme de géographie administrative, au même titre que ciuitas ou pagus 201. La description de la division politique de la Gaule permet de situer les partes entre les pagi et les domus. On proposera donc, plutôt que l'expression du clan (concept sociologique) à proprement parler, celle de son territoire (concept spatial).
Regio : si, chez César, le niveau de l'exploitation individuelle est désigné dans certains cas par ager (lorsque ce terme ne renvoie pas à la notion de territoire ou de campagnes comme forme
196. Au sens d'"assises territoriales" d'un groupe, tout comme la gens romaine (GAUDEMET (J.), Les Communautés familiales , Paris, 1963, p. 53-63).
197. Ces derniers sont les moins nombreux (48 occurrences) ; dans un sens relativement précis : B, 1, 1, 5 ; 13, 3 ; 15, 1 ; 34, 3 ; 40, 1 ; III, 20 , 1 ; V, 24, 7 ; 41, 6 ; VI, 5, 1; 1 1, 2 33, 1 ; 3 ; 35, 1 ; 43, 6 ; VII, 32, 5 ; VIII, 24, 1 ; 25,1.
198. B.G., V, 11, 2 : applicable à toute la Gaule ; V, 53, 4. 199. là., VI, 33, 1 ; 3 : ces deux emplois sont relies par regiones au § 2 ; VII,
43, 6 ; VIII, 24, 1 (regiones au § 2) : les Ménapiens, les Eburons et toute (?) la Gaule.
200. là., VII, 32, 5 (Eduens). 201. là., VI, 23, 5 : regiones atque pagi (Germains) ; VII, 32, 3 : agri
regionesque (en Gaule, et notamment chez les Carnutes); cf. III, 7, 1 : nationes ...et regiones (Illyricum) et IV, 4, 2 (Ménapiens).
334 Serge LEWUILLON
de paysage) ^02, la regio définit très logiquement, par rapport à ce terme, un territoire plus vaste que le simple domaine, mais plus petit que l'espace tribal. Il est difficile d'en déterminer la situation par rapport à pars, mais plusieurs éléments permettent de supposer qu'il représente une unité de dimensions inférieures. Son sens, tout d'abord : regio, spécialement au pluriel, prend un sens plus limitatif (qui le rapproche souvent de terminus) et désigne par conséquent un territoire mieux délimité que pars (dont l'emploi dans les Commentaires est toujours assez vague) ^03
Remarquons enfin qu'une tribu gauloise ne compte qu'un faible nombre de partes ^4 ; leur composition, en outre, n'est pas sociale : toutes les couches de la population peuvent y être réparties, comme tous les clans, tous les groupes de pression et toutes les clientèles. Pour ces raisons, on proposera de voir dans cette division particulière une catégorie sociologique- plutôt qu'une véritable cellule - susceptible de regrouper les clans : c'est-à-dire la "phratrie" 205.
202. là., VII, 3, 2 (pour la Gaule entière) ; I, 2, 3 ; 4, 3 ; 5, 4 ; 10, 1 ; 11 , 1 ; 16, 2 ; 28, 4; 31, 5 ; 40, 11 ; II, 4, 6 ; 5, 3 ; 7, 3 ; 9, 5 ; III, 9, 8 ; 29, 3 ; IV, 1, 7 ; 3, 1 ; 4, 2 ; 7, 4 ; 8, 2 ; 15, 5; 27, 7 ; 30, 3 ; 31, 2 ; 34, 3 ; V, 12, 2 ; 19, 1 ; 56, 5 ; VI, 3, 2 ; 10, 2 ; 12, 4 ; 22, 2 ; 23, 2 ; 24, 1 ; 30, 1 ; 31, 2 ; VII, 3 , 2 ; 4, 3 ; 13, 3 ; 20, 1 0 ; 54, 4 ; 56, 5 ; 77, 14 ; VIII, 2, 2 ; 7, 2; 24, 1 : sur les 47 occurrences, on compte moins d'une dizaine de connotations du territoire ; l'organisation spatiale est désignée en VI, 23, 5 (ager - regio- pagus ) et VII, 3, 2 (agros regionescjue). Beaucoup d'autres exemples dénotent le paysage agricole et s'inscrivent dans le schéma de la trilogie agraire (VII, 29, 3, p. ex.), dans celui des rapports ville- campagne (VIII, 24, 1, p. ex.) ou tout simplement dans celui d'un trait de civilisation ( cf. le discours de Critognatos, VII, 77, 14 : iura, leges, agros).
203. là., VIII, 24, 1 ; 2 : pour le nord de la Gaule (et même la Cisalpine) ; V, 24, 7 (Esuves).
204. là., VII, 32, 5 : traduction inexacte de Constans (op. cit., p. 233). 205. BENVENISTE (E.) Vocabulaire ..., II, p. 257-259 ; 316-317.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 335
TABLEAU I : PARENTÉ, SOCIÉTÉ SEGMENTAIRE ET TERRITOIRES : TERMINOLOGIE DES COMMENTAIRES.
PAGUS = tribu, au sens social ; FINES = les terres de la tribu ou de
FAMILIA :
DOMUS :
[CLAN]
[PHRATRIE]
CIU IT AS
[CIUITAS romaine]
tout autre groupe.
"famille étroite" (terme remontant à l'époque gauloise, toujours employé dans ce sens à l'époque de la conquête. Parfois équivalent à domus.
territoire : (ager ?) propriété : [possessio]
"lignage" ou "clan" (d'époque gauloise, il tend à disparaître à l'époque gallo- romaine.
territoire : ager propriété : possessio (tendance à l'appropriation privée).
division archaïque déjà en voie de disparition à la période gauloise.
Territoire : regio Propriété : appropriation privée ?
Division d'époque gauloise, toujours en vigueur à l'époque de la conquête.
territoire : pars. "peuplade" (fédération de pagi )
"cité" . Cette entité tend à effacer toutes les subdivisions d'époque gauloise, territoire : la ciuitas est son propre
territoire (FINES ). propriété : privée, du type ager romain.
Le tableau de l'articulation de la parenté avec le territoire à la veille de la conquête est un préliminaire historique à une synthèse des résultats procurés par l'archéologie à notre connaissance du milieu rural et de l'habitat. Il conviendrait
336 Serge LEWUILLON
cependant d'approfondir encore les recherches comparées sur les conditions juridiques et sociales de l'occupation du sol aux "époques archaïques". En effet, les conclusions qui ont été exposées ci-dessus s'accommodent mal d'une vision anévolutive de la propriété de la terre : puisqu'on admet très largement, semble-t-il, que Rome 206 a connu à l'époque archaïque de la royauté des formes d'exploitation collective du sol ^07^ ц ne devrait subsister aucun obstacle de principe à ce qu'il en ait été de même pour la Gaule. Mais à théoriser trop tôt, on risque de rechuter, même involontairement, dans les pièges de l'évolutionnisme. C'est donc avec cette mise en garde à l'esprit qu'il faudrait retoucher le tableau économique et social de la Gaule à la fin de l'indépendance ^.
206. RICHARD (J.-Cl.), Les Origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien , Rome, 1978 (BEFAR 232), p. 175-194; TORELLI (M.), "Rome et l'Etrurie archaïque", Terre et paysans dépendants dans les sociétés antiques (actes du colloque international de Besançon, 2-3 mai 1974), Paris, 1979, p. 251-311; CAPOGROSSI COLOGNESI (L.), "Le régime de la terre à l'époque républicaine", ibidem , p. 313-368 ; idem , "Le comunità rurali nell'Italia romana", Les communautés rurales (actes du congrès de Varsovie, 1975), p. 411-430.
207. Il faudrait éviter l'expression "appropriation communautaire", contradictoire ou, du moins, anachronique ; on peut admettre celle d'"occupation collective". Il importe, dans tous les cas, d'éviter de postuler, à partir des formes des usages, celles d'une communauté sociale, voire d'un "communisme primitif".
208. J'ai tenté d'indiquer quelques directions de recherche sur ce domaine dans "Histoire, société ..." (A.N.R.W., II, 4). Cet article constitue avant tout une analyse du comportement des deux partis gaulois au moment de la conquête, ainsi que du choix de leurs alliances avec les Romains et les Germains, selon l'intérêt économique et politique que ces rapprochements leur procuraient. J'ai eu tort, cependant, de faire intervenir en conclusion, des concepts exprimés dans une terminologie relevant d'abord de l'histoire médiévale et de schématiser les processus de transition de la formation économique et sociale gauloise : ce qui se veut une analyse théorique pourrait passer ainsi pour un exposé un peu rigide des différentes étapes historiques, celles-ci donnant l'impression de se succéder dans un ordre nécessaire. Ce phénomène apodictique est typique de l'évolutionnisme, où le temps se comprime et l'histoire se désincarné. Il est clair que je récuse cet évolutionnisme larvé et que je considère les transitions d'une façon infiniment plus nuancée. Il n'en reste pas moins que les
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 337
II serait utile d'apporter quelques éléments préalables à cette étude-là, particulièrement en matière de périodisation : jusques à quand pouvons-nous faire remonter les limites de validité du modèle déduit de l'époque de la conquête et même de la période gallo- romaine précoce ? Les événements de 60 à 50 a.C. (et même au delà) témoignent d'un profond bouleversement économique qui plonge la Gaule dans une sorte de guerre civile 20^ : deux conceptions globales s'affrontent et César n'hésite pas à désigner ceux qui n'ont pas sa faveur (les partisans de l'aristocratie traditionnelle) et qui tentent de renverser l'ordre nouveau des "sénatoriaux" de fauteurs de révolution 210 Qe schéma me paraît tenir au moins pour la génération qui précède la conquête, si j'en juge par le cas de Vercingétorix 21 1. Ц serait même logique de le faire remonter jusqu' à l'époque de Bituit, en évitant cependant d'y voir un mal endémique qui aurait frappé les Celtes depuis l'époque de leurs invasions. En effet, bien des raisons font croire que l'influence romaine fut déterminante dans les modifications de la formation économique et sociale en Gaule comme en Italie, en présentant aux Celtes des modèles de développement étrangers à leur société et incompatibles avec le maintien de leur authenticité. Nous possédons une illustration archéologique éclatante de ce phénomène dans les transformations successives des aedifida de l'âge du fer : ceux-ci évoluent depuis la forme d'enclos irréguliers vers des structures élaborées et rigoureuses où s'ébauche une régulation de l'espace. Au terme de leur évolution, ils aboutissent à un bel ordonnancement, autour d'une cour qui préfigure celle des grandes villae , de leurs dépendances et de leurs habitations dont certaines, déjà construites sur fondations, s'inscrivent très exactement dans le réseau des fossés
discours de César et de Tacite, pour ne citer que ceux-là, s'agencent selon des structures qu'il importe de mettre en évidence, par priorité sur les recherches "en historicité". La confrontation des modèles théoriques avec les apports archéologiques devraient permettre d'éviter progressivement les malentendus et les confusions, notamment sur les rapports entre l'élevage et l'agriculture proprement dite.
209. B.G., 1, 31, 3-7 ; VI, 1 1, 2-5 ; 1 2, 1 . 210. B.G., sur les sénatoriaux, cf. les références in LEWUILLON (S.), op.
cit., p. 542-543. 211. B.G., VII, 4,2.
338 Serge LEWUILLON
"néolithiques" ^12 : on ne saurait trouver plus belle illustration d'une transition entre deux systèmes d'exploitation agricole. Dans d'autres régions, la transformation économique est tout aussi sensible au sein d'un espace traditionnellement dominé par les oppida 213.
Toutefois, il n'est pas exclu que plusieurs mutations se soient auparavant produites à plusieurs reprises. L'archéologie confirme ce que certaines sources laissaient pressentir : que les sociétés celtiques étaient relativement fragiles et que des disettes ou des accidents démographiques pouvaient être à l'origine de leurs "mouvements" ^14 Ces possibilités sont à retenir pour la période qui va du Ve siècle a.C. au début du IVe et même au Ier tiers du IIIe siècle a.C. : la première période corrrespond aux déplacements des Gaulois vers l'Italie (les Sénons, notamment), tandis que la seconde est celle des Boïens, entre autres. En outre, Tite-Live et Polybe témoignent que les Celtes d'Italie ne sont pas encore fixés au IIe
212. AGACHE (R.), op. cit., p. 169-178 ; GADAGNIN (R.), "L'aedificium du Bois Bouchard. Etude d'une exploitation agricole gauloise découverte au Mesnil-Aubry (Val-d'Oise)", Les Celtes dans le nord du bassin parisien (VIe-Ier siècles a.C). Actes du colloque de Senlis, Revue archéologique de Picardie , 1983, 1, p. 195-209 ; BARBIEUX (J.), "L'habitat ouvert d'Hornaing (Nord). L.T. finale - gallo-romain précoce", Les Celtes en Belgique et dans le nord de la France. Les fortifications de l'âge du fer. Actes du VIe colloque de l'A.F.E.A.F., Bavay-Mons, Revue du Nord , n° spécial, h. -s., 1984, p. 59-62 ; GOGUEY (R.), "Les sites de l'âge du fer dans les vallées des Tilles et de l'Ouche d'après la photographie aérienne", Les âges du fer dans la vallée de la Saône (VHe-Ier siècles a.C). Paléométallurgie du bronze à l'âge du fer . VIIe colloque de l'A.F.E.A.F., Rully, 12-15 mai 1983, Paris, 1985, p. 1-24 : cf. p. 12-13 (les Maillys, la Terre du Varin).
213. FICHES (J.-L.), "Processus d'urbanisation indigène dans la région de Nîmes (VIIe-Ier siècles av. J.-Chr.)", D.ll.A. , 5, 1979, p. 35-57 ; id., «Les Transformations de l'habitat autour de Nîmes au haut-empire", Villes et campagnes dans l'empire romain. Actes du colloque d'Aix- en-Provence , 16-17 mai 1980, Aix-en-Provence, 1982, p. 111-121 ; id. , "L'archéologie et les transformations des rapports sociaux en Gaule. Protohistoire et antiquité", Actes de la table ronde de Besançon , mai 1982, Paris, 1984, p. 219-232.
214. TROGUE-POMPEE, apud JUSTIN, Epitome ..., 24, 1 (pour le Ve s. a.C.) ; APPIEN, Guerres celtiques , 2, 1 (pour le début du IVe s. a.C); de uiris illustribus , 235 (pour la seconde moitié du IVe s. a.C.) ; JUVENAL, Sat., VIII, 234.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 339
siècle a.C. ^15. Cette séquence quasi ininterrompue permet de croire que les auteurs anciens ont pu avoir à leur disposition des renseignements qui ne devaient pas tout à la fable et qu'un "ethnographe" comme Posidonios se situait à la charnière idéale entre une tradition relativement fiable et une documentation personnelle ^16.
Vue de la sorte, l'histoire celtique est celle d'une longue série de perturbations, d'une instabilité permanente où la propriété privée du sol dut se réaliser assez tardivement. Outre ces conditions favorables à l'occupation et l'usage collectifs du sol, le droit celtique a conservé des traits qui font voir dans la collectivité un principe général de grande valeur chez ces peuples : la propriété collective des meubles et immeubles est bien inscrite en droit ^17, dans le cadre du groupe familial plus ou moins étendu selon les cas. On ne peut évidemment s'empêcher de songer à certaines conditions du droit romain archaïque où, à défaut d'agnat proche, l'héritage fait retour au groupe gentilice 218. Le système celtique paraît cependant peu enclin à conserver l'état d'indivision permanente, dont la définition même l'inscrit dans la conception de la communauté familiale : elle porte le nom de "lit commun", par ailleurs rattaché sémantiquement à la "famille" ^19 La consultation du groupe familial est la règle dans toutes les questions qui, à plus ou moins longue échéance, risquent de mettre en cause la transmission du patrimoine ; le droit de l'adoption est, à cet égard, extrêmement significatif 2^0 Mais le droit celtique diffère encore du droit romain par sa définition de la famille : celle-ci n'est pas considérée comme un groupe d'individus où le principe des degrés de parenté (gradus ) détermine la notion de proximité ; ce sont plutôt des groupes aux contours strictement délimités qui s'imbriquent ou s'étagent au sein de la famille la plus large ; chacun d'entre eux possède un nom et un degré de proximité
215. PEYRE (Chr.), La Cisalpine gauloise du IIIe au Ier siècle a.C. , Paris, 1979, p. 40-59 ; KRUTA (V.), loc. cit.
216. TIERNEY (J.J.), "The Celtic Ethnography of Posidonios", Proceedings of the Royal Irish Academy, 60, C, n° 5, I960, p. 189-252.
217. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, La Famille celtique , p. 41. 218. XII Tables , 5, 4-5. 219. A propos des cohéritiers qui sont tenanciers d'une propriété
indivise : ils labourent en commun, ils ont leur maison en commun et un "lit commun" ; d'ARBOIS, op. cit., p. 49 sq.
220. D'ARBOIS, op. cit., p. 83-84.
340 Serge LEWUILLON
uniques qui définissent la situation de ses membres au cours de la procédure d'adoption et d'héritage ou en toute matière impliquant la responsabilité 2^1 . On voit que le principe familial est déjà en lui-même - je dirais : par essence - collectif. Remarquons enfin que si les filles n'héritent pas au stade le plus ancien de ce droit, des dispositions nouvelles s'y inscrivent peu à peu, qui octroient à la femme n'ayant plus de frère (et ayant épousé, en principe, un "étranger") 222 la possibilité de recueillir temporairement l'héritage afin de le transmettre à ses fils, puis à ses petits-fils, avant qu'il ne fasse retour aux agnats de son père 223 : il me paraît probable que c'est par ce biais que la dévolution collective se transforma progressivement en dévolution particulière.
On admettra que ce système ne peut s'expliquer que compte tenu du rôle joué par l'agnat principal disparu, autrement dit le frère de la fille héritière, ou encore le frère de la mère des héritiers : l'oncle maternel. Le rôle de Yauunculus apparaît ici nécessaire à l'élargissement du contexte successoral, provoquant au cours de ce processus une apparente réévaluation de la position féminine dans la parenté. Ces caractéristiques paraissent tout à fait valables pour l'aire germano-celtique vers la fin de l'âge du fer au moins, tant par la définition des groupes de parenté que par le mécanisme de transmission du patrimoine :
"Cependant, pour héritiers et successeurs, chacun a ses propres enfants et il n'y a pas de testaments. A défaut d'enfants, la possession revient, d'abord, aux frères, aux oncles paternels, aux oncles maternels" ^24.
221. IZARD (M.), "La terminologie de parenté bretonne", L'Homme , 5, 1965, p. 88-100.
222. ... qui n'a donc pas de patrimoine indigène susceptible d'"avaler" celui du père et de l'épouse. Ceci n'est pas sans évoquer les questions du mariage forcé et du gendre étranger. D'ARBOIS, op. cit., p. 69-81.
223. On pourrait apeler ce système "épiclérat celtique" ; c'est à rapprocher des règnes de femmes en Bretagne (TACITE, Annales , XIV, 31).
224. TAC. Germ., 20, 6 : heredes tamen successoresque sui cuique liberi, et nullum testamentům ; si liberi non šunt, proximus gradus in possessione fratres, patrui, auunculi.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 341
II est difficile de juger de l'importance de l'ordre des mots dans cette phrase : y a-t-il, au delà du privilège de masculinité, un ordre de succession appelant, en l'absence d'héritiers en ligne directe, d'abord les frères, puis l'oncle paternel et ensuite seulement l'oncle maternel 225 ? L'essentiel pour notre propos est que la présence de Yauunculus parmi les héritiers n'est pas considérée comme allant de soi malgré le rôle déterminant qu'il joue par ailleurs 226 dans le domaine de la parenté proprement dite. Cela confirme au passage que la relation avunculaire et les systèmes de filiation sont des phénomènes totalement indépendants 227 et que c'est perdre son temps que d'y chercher une preuve de la bilinéarité ("indifférenciation"). La seule conclusion qu'on puisse en tirer est qu'il existe des procédures de transmission du patrimoine qui, en cas de force majeure, admettent le côté des femmes à l'héritage 228 ■ cette innovation passe obligatoirement par un approfondissement historique de la relation avunculaire qui investit de plus en plus l'espace économique et social de la parenté.
225. Sur ces questions, on peut encore recourir à GRIMM (J.), Deutsche Rechtsaltertù'mer , Leipzig 18994 (18281), qui évoque beaucoup de textes germaniques du haut moyen âge. Pour le point de vue historiographique et la comparaison avec ces textes : MURRAY (A.), Germanie Kinship Structure , Toronto, 1983, quoique cet ouvrage pêche par son information anthropologique partiale ; sur le texte de Tacite et la question des héritages : p. 57-65.
226. TAC. Germ., 20, 5. 227. Ci. infra. 228. TAC, Germ., 18, 2 ; 5 (cf. ici, n. 121) : le prix du mariage est payé par le
mari à la femme, mais celle-ci ne fait que recueillir les présents pour les transmettre aux enfants de son fils ; cette transmission se fait par la femme de son fils. Ce système n'a peut-être pas été correctement interprété par Tacite, qui y voit en outre l'occasion d'une sentence édifiante. Il témoigne néanmoins de la combinaison de plusieurs modes de transmission, dont certains sont investis par les femmes, même si c'est de façon modeste. Pour d'autres procédures, cf. TAC, Germ., 32, 4, à comparer avec le système de tanistry .
342 Serge LEWUILLON
2. PARENTÉS
. . . coniunctio hominum serpit sensim foras, cognationibus primům, turn affinitatibus, deinde amicitiis ...
CICERON, de finibus bonorum et malorum, V, 65.
Avant de confirmer l'existence et le contenu de la relation avunculaire chez les Celtes, procédons à l'examen des groupes qui organisent leur parenté en essayant de préciser quelques-unes de leurs limites.
Propinquitas : ce terme vaut surtout par sa présence au sein du couple terminologique où il est connote par propinqui (propin- quitatibus adfinitatibusque coniuncti ^29 . ^ propos des Rèmes et des Belges), qui répond à l'emploi des mêmes appellatifs dans le domaine privé (à propos des alliances entre Orgétorix et les Bituriges) 230. Mais deux autres couples permettent d'approcher la sphère de Yadfinitas et de la propinquitas : propinqui Ф consanguinei et consobrinus = propinquus . On sait par ailleurs que le terme peut être employé réciproquement.
TABLEAU II : ADFINITAS ET PROPINQUITAS DANS LES COMMENTAIRES.
II, 4, 4 Gaulois et Germains propinquitas * adfinitas
1, 44, 2 Germains "parents" et "proches" d'Arioviste
VI, 14, 2 Gaulois "parents" et "proches"(+ fosterage?) sens général et réciproque propinqui Ф consanguinei
229. 230.
VI, 19, 3
VII, 77, 8
B.G., II, 4, 4. Id., 1, 18, 7-8.
Gaulois
Gaulois
V, 57, 2
VI, 2, 1
VI, 8, 8 VII, 38, 3
VII, 39, 3 VII, 83, 6
Trévires
Trévires
Trévires Arvernes
Arvcrnes Arvernes
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 343
1, 18, 7-8 Eduens "parents" et "proches" de
Dumnorix V, 4, 2 Trévires "enfants" et
"proches"; limite à la propincjuitas. "proches" de
Cingétorix "proches" d'Indutiomar idem "frères" et "proches" de Litaviccos idem propinquus = consobrinus
Ainsi, comme il ressort du tableau II, cette catégorie de parents ne peut se confondre avec les fratres, ni avec les parentes , qui sont toujours désignés spécialement ; par contre, elle peut commencer au moins au 4e degré (consobrinus) - il est possible que le 3e degré soit concerné également, comme c'est le cas pour la parenté irlandaise 23* - tandis qu'au delà d'un certain degré commence la sphère des consanguinei . Cette parenté prend exactement le même sens chez les Germains, s'opposant à la famille immédiate (les parentes 232, la domus 233 ou la familia 234). Enfin, le groupe des propinqui constitue le tribunal familial ordinaire, notamment pour les cas d'adultère simple 235 ou pour celui qu'on soupçonne compliqué de meurtre 236.
Adfinitas : le terme est plus rare, mais on le place ici parce qu'il connote parfois le précédent : il désigne le bénéfice "stratégique" retiré d'un mariage d'affaire réalisé de cité à cité 23^.
231. D'ARBOIS, Famille ... , p. 19 : les oncles sont dans la derbfine . 232. TAC; Germ., 13, 1 : ... uel pater uel propinqui ... ; 21, 1 : [inimidtia] seu
patris seu propinqui . 233. B.G.,V,44,2. 234. TAC. Germ.,7, 3. 235. Id., 19,1. 236. B.G., VI, 19, 3. 237. Id., 1, 18, 8 ; II, 4, 4.
344 Serge LEWUILLON
Mais il est évident que pour nouer ce genre d'alliance, il faut avoir des parents à marier : quanto plus propinquorum, quanto maior adfinium numerus 238, c'est une remarque de bon sens. Encore faut-il mettre à profit les occasions propices à la négociation et à la conclusion des alliances : ce sont les banquets qui en fournissent l'opportunité, affirmant par là, une fois encore, leur fonction quasi institutionnelle 239. On peut penser que si la parenté des propinqui est une donnée sur laquelle il est difficile d'agir, Yadfinitas en est, en quelque sorte, l'indispensable réalisation politique.
Consanguinei : cet appellatif n'est pas employé isolément dans les Commentaires : il connote soit necessarii , soit fratres (employé dans ce cas comme un véritable titre et non comme une catégorie de la parenté privée), soit enfin par propinqui ; étant réciproque, il s'emploie toujours au pluriel. Il précise de toute évidence que la relation formelle et politique qui est avancée se double d'un lien de parenté plus réel et plus intime, un véritable lien du sang (nexum sanguinis) 24°. On le comprend bien de necessarii, qui désigne en l'occurrence des liens de clientèles entre les Eduens et ce qui constitue peut-être un de leurs pagi, les Ambarres 241. Cela s'accorde également avec le terme fratres employé pour les parentés de peuples : d'une part, on sait que le mot serait volontiers classificatoire chez les Gaulois et qu'une précision est souhaitable 242 : mais d'autre part, le fait que consanguinei connote un terme classificatoire permet de conclure que cette précision vise à choisir un sens précis parmi les fratres possibles et à déterminer ainsi un nouveau degré de parenté. Si le nexum sanguinis ne se mesure pas à la proximité immédiate dans la parenté 243, les consanguinei peuvent y occuper une situation relativement éloignée. Dans la mesure où les degrés les plus proches ont déjà leur appellation, on peut formuler l'hypothèse que les consanguinei se situent au delà du 4e degré : comme des cousins issus de germains, par exemple.
238. TAC. Germ., 20, 7. 239. Id., 22,3. 240. Cf. ici, п. 69. 241. В. G., 1, 11, 4 ; JULLIAN (C), "Les parentés de peuples ...", p. 87, n. 3. 242. Cf. ici, n. 63 à 69. 243. N.69.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 345
Cognatio ( et gens ) : on a déjà dit de gens que les Latins ne l'employaient pas volontiers pour décrire une situation de parenté ^44. La majorité des occurrences chez César et Tacite veulent signifier le peuple, la nation 245 Tjn seul passage, compliqué par la corruption du texte, pose quelques problèmes d'interprétation : sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum qui [cum] una coierunt... (a) ou quique una coierunt (p). Pourtant, la solution ne passe pas par la restitution - d'ailleurs impossible - du texte ; les génies et les cognationes sont des éléments irréductibles et rien ne sert d'en ajouter un troisième ("tribes, cognationes and those who have joined together") s'il n'éclaire pas les deux premiers ^46. En fait, nulle raison ne pousse à croire que cette occurrence germanique de gens doive se distinguer des autres qui, pour la plupart, concernent aussi les Germains. A cette notion assez vague de "tribu" s'oppose cognatio, qui n'est donc ni gens, ni familia et qui paraît aussi s'opposer à la potentia que procure une clientèle nombreuse ^47 . Ц est donc logique d'en faire un terme générique qui dénomme des parents précisés par ailleurs : non pas les parentes ni les liberi, non plus que les fratres , qui répondent évidemment à la définition â'adgnati (c'est la définition de la famille des Bretons dans B.G., V, 14, 4), mais les propinqui et les consanguinei ; c'est toute cette parenté qui s'étend depuis les cousins ou peut-être même les oncles et qui finit là où commence l'alliance : à Yadfinitas .
Familia : gardons-nous de faire de ce mot un emploi trop latin, exclusivement social dans la sphère de la dépendance. Il signifie certes les groupes d'alliés et amis, ainsi que les clientes et les oboerati ^48, ou mieux encore, la maison comme patrimoine 249 ; mais de nombreuses fois, le mot fait référence sans ambiguïté au
244. Cf. supra , p. 291-292. 245. B.G., II, 28, 1 ; IV, 1, 3 ; V, 54, 5 ; VI, 17, 2 ; 22, 2 ; 25, 3 ; 32, 1 ; VIII, 24, 1. 246. Id., VI, 22, 2 ; MURRAY (A.), op. cit., p. 43-45: cet auteur ne traduit
d'ailleurs pas cognationes : son parti-pris est que les Germains ne connaissaient pas la filiation unilinéaire (agnatique) et que, par conséquent, la catégorie de clan entendue dans ce sens n'est pas opératoire pour l'étude de leur parenté. Sans critiquer le fond de cette pensée, je trouve que Murray a tort de ne pas analyser la cognatio in B.G. , VII, 32, 4.
247. B.G., VII, 32, 4-5. 248. Id., I, 4, 2 (Orgétorix) ; VI, 30, 3 : comités familiaresque . 249. Id., 1,18,4.
346 Serge LEWUILLON
groupe de parenté : "Cotos, issu d'une très vieille famille, jouissait d'ailleurs d'une très grande influence personnelle et ayant de nombreux parents ... 250 [il apprit que] le frère avait proclamé le frère, alors que les lois interdisaient que deux membres d'une même famille fussent, l'un du vivant de l'autre, non seulement nommés magistrats, mais même admis au sénat ... 251 [certains jeunes gens] à la tête desquels était Litaviccos et ses frères, issus d'une très grande famille..." 252.
Le fait que ce groupe de parenté soit assez proche d'ego pour y admettre ses frères porte à le distinguer radicalement de la catégorie précédente, cognatio : il faut donc y ranger les agnats. C'est aussi le sens de la description des formations guerrières germaniques laissée par Tacite, où ce n'est "ni le hasard, ni un fortuit assemblage qui constitue l'escadron ou le coin, mais les familles et les parentés" (familiae et propinquitates ) :
...et in proximo pignora 253 . . .
TABLEAU III : CATÉGORIES ET DEGRÉS DE PARENTÉ.
parentes [gens]
adgnati + ou familia (sens gaulois)
AGNATS ego + f rat res propinqui (3e ou 4e degrés)
250. Id., VII, 32, 4 : [... Cotum , ] antiquissima familia natum atque ipsum hominetn summae potentiae et magnae cognationis ...
251. Id., VII, 33, 3 : [...] fratrem a fratre renuntiatum, cum leges duo ex una familia uiuo utroque non solum magistratus creari uetarent ...
252. Id., VII, 37, 1: [...] quorum erat princeps Litauiccus atque eius fratres, amplissima familia nati adulescentes ...
253. TAC, Germ., 7, 3 : il y a chez ce dernier un terme pour nommer la cellule familiale comme groupe encore plus restreint : domus (Germ., 13, 1-2 ; 20, 1 ; 5 ; 21, 3 ). Cf. SALLE (R.P.), "Familia , domus and the Roman Conception of the Family", Phoenix, 38, 1984, p. 336- 355, où la domus est le lieu des cognats.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 347
COGNATIO + consanguinei (5e degré et suivants)
familia (sens latin) +
ADF1NITAS adfines [hors parenté] +
clientes
3. LA RELATION AVUNCULAIRE
De même qu'on a examiné les conditions pratiques des relations de parenté, il eût été nécessaire, à ce stade de l'étude, d'analyser celles de l'échange entre les groupes de parenté : ceci suppose une étude d'historiographie critique du mariage et du "droit nuptial", qui prend justement place parmi les plus anciennes recherches en histoire du droit. Mais les recherches préliminaires indispensables à la compréhension des formes celtiques de la dot et du douaire, par exemple, nous conduiraient hors des limites de cet article : elles seront poursuivies ailleurs. Cependant, il me paraît impossible de ne rien dire dès à présent d'un phénomène bien connu qui touche de près à la conclusion des mariages et sur lequel il court bien des approximations : la relation avunculaire. Il est inconcevable d'étudier ce chapitre de la parenté sans faire référence aux théories forcément actuelles du mariage dans les sociétés les plus diverses. J'ai déjà dit les raisons de mon adhésion vigilante aux thèses de Lévi-Strauss : on se reportera donc à celles-ci pour se convaincre de quelques principes fondamentaux désormais indiscutables, dont les plus importants, pour notre chapitre, sont :
- que la nature de la filiation n'est qu'un principe secondaire des systèmes de parenté ;
- qu'il est nécessaire de distinguer le principe de matrilatéralité (choix du "côté des parents" où l'on prend son conjoint) de celui de matrilinéarité (question de filiation) ;
- que les formes historiques de la relation avunculaire mettent en jeu de préférence au côté du père la matrilatéralité, système plus
348 Serge LEWUILLON
sophistiqué, mais aussi plus fagile, conduisant aux formes les plus souples de l'échange généralisé ^54.
II faut surtout souligner - ce qui n'a pas été assez dit à l'intention des historiens - que la relation avunculaire est un mécanisme complexe qui se développe selon deux axes principaux 255 : l'avunculat proprement dit, en tant que système d'attitudes qui lient l'oncle maternel et le fils de la soeur, et le privilège matrimonial, qui met en scène l'oncle et la fille de la soeur. Or, il se fait que ce phénomène est surtout spectaculaire par un de se modes dérivés : les attitudes ; c'est cet aspect qui, dans l'historiographie de l'Occident classique et médiéval, a toujours partagé la faveur des chercheurs avec les questions de terminologie et de lexicographie 256. Par ailleurs, pour des motifs qui tiennent à la forte présence des femmes dans cette forme d'échange (la soeur et sa fille) et pour des raisons qui, historiquement, découlent des précédentes (le développement des revendications féminines), on a souvent imaginé que la relation avunculaire représentait un reliquat du matriarcat : cette illusion dure depuis le Mutterrecht de Bachofen au moins et reçoit périodiquement la caution de voix autorisées en matière linguistique ou juridique : le Vocabulaire... de Benvéniste avait réactivé le propos et je ne sache pas qu'il ait été là-dessus démenti explicitement, quand la critique a porté si pertinemment sur d'autres points ^57 Et ceci d'autant moins pour les sociétés celtiques que la personnalité de la femme y est très forte et que le mariage, extrêmement valorisé ^58f donne lieu à des
254. LEVI-STRAUSS (Cl.), Structures élémentaires de la parenté , p. 154 sa.; 355-356 ; 425 sa.; 467 sa.; 520-527 ; 543 sa. et passim .
255. Idem , p. 494-504. 256. Voyez les références citées dans les notes 1, 11, 14, 45, auxquelles on
ajoutera BEEKES (R.S.P.), "Uncle and Nephew", J.I.E.S. , 1976, p. 43- 63 ; BREMMER (J.), "Avunculate and Fosterage", idem , p. 65-78 ; HANARD (G.), Inceste ..., p. 45, n. 55.
257. BENVENISTE (E.), Vocabulaire ..., I, p. 209-234, repris par THOMAS, (Y.), "Mariages endogamiques ...", p. 358-359, n. 35 ; par HANARD (G.) op. cit., p. 46 sa.
258. B.G., I, 3, 5 ; 9, 3 ; 18, 7-8 ; VI, 19, 1 ; TAC, Germ., 18, 2 ; 19, 1-6 ; 20, 4 ; Jullian et Bayet ont naturellement mis en scène de façon particulièrement avantageuse les comportements conjugaux des Gaulois, supposés d'une qualité morale au-dessus de tout soupçon : BAYET (A.), La Morale des Gaulois , I, p. 167-173.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 349
développements apparemment féministes du droit matrimonial et successoral ^.
Sans être aussi explicite que Tacite, César nous permet quelques conclusions sur la relation avunculaire. Il est évident, par exemple, que la relation entre le père et le fils présente, d'une manière générale, un fort caractère d'évitement (angl. avoidance) 260 ; nous savons que Vercingétorix et son oncle paternel (patruus) sont en mauvais termes 261 ; on voit aussi un chef gaulois, Ambiorix, donner en otage le fils de son frère (ce qui ne veut pas dire qu'il n'eût point de soeur, puisque celle-ci aurait pu être mariée très normalement dans d'autres cités). Chez les Germains, l'exaltation de Vauunculus est très remarquable : "le fils d'une soeur ne trouve pas moins d'égards auprès de son oncle que chez son père. Certains pensent que cette parenté du sang est plus sainte et plus étroite et, pour prendre des otages 262, l'exigent de préférence" 263.
On constate à cette occasion le danger des raisonnements particuliers sur lesquels se fonde trop souvent l'examen des attitudes : les Germains font une grande confiance aux échanges d'otages où sont impliqués neveux et oncles maternels, alors qu'un Eburon place dans cette situation délicate le fils de son frère ; mais est-ce en vertu d'une règle proprement gauloise ou plutôt pour épargner les fils de ses soeurs (toujours à supposer qu'il en eût) ? On
259. ...sur lesquels je reviendrai spécialement ; cf. CZARNOWSKI (S.), "Les biens féminins en droit celtique". Compte rendu des Journées d'histoire du droit . Paris, 6-8 juin 1929. RHDFE , 4e série, 1929, p. 649- 651. L'interprétation du "pécule" constitue une empoignade farouche et récurrente en histoire du droit romain ... Mais il n'y a pas que le monde celtique à dégager précocement un "espace féminin" - ou encore "tonalité féminine" - de la propriété : cf. les références in GUICHARD (P.), "De l'antiquité au moyen âge : famille large et famille étroite". Cahiers d'histoire , 1979, vol. 24, n° 4, p. 45-60 : 58-60.
260. B.G., VI, 18, 3. 261. Id., VII, 4, 2. 262. /i.,V,27,2. 263. TAC, Germ., 20, 5 ; J. PERRET, op. cit. , p. 83, n. 1 se demande s'il ne
s'agit pas de "vestiges du matriarcat" ... Sur l'histoire de ce préjugé tenace, cf. LOWIE (R.), "The Matrilineal Complex", Univ. Calif. Publ. in Amer. Arch, and Ethn. , 16, 2, 1919.
350 Serge LEWUÏLLON
porte volontiers plus de crédits aux permanences historiques dont témoignent les Parentalia. Dans une de ses saynètes, Ausone avoue que l'évocation de son oncle maternel l'a placé face à un cruel dilemme : fallait-il lui donner la place qu'ordonne son rang dans la parenté ou lui rendre celle qu'exigeait un amour filial 264 ? Certains ont pris beaucoup de peine à démontrer que le phénomène était anormal dans une structure gallo-romaine, mais qu'il ne devait cependant rien au hasard puisqu'il se répétait sur plusieurs générations. Si les parallèles d'époque tardive sont nombreux 265, les textes antiques sont rares : on cite les neveux d'Ambigat 266 et quelques exemples d'époque impériale (Civilis entouré de ses neveux) 267. Tout cela paraît un peu court pour démontrer la prégnance de la relation avunculaire en Gaule.
Par contre, ce qui est peut-être plus opératoire dans les sociétés celtiques, c'est la mise en éducation des enfants pendant des périodes généralement assez longues. Sous réserve d'inventaire des textes insulaires, ce mécanisme social paraît plus fréquent et plus cohérent en Irlande ou au Pays de Galles que l'avunculat proprement dit 2i)8 (toujours pour la raison que celui-ci est repéré exclusivement à partir des systèmes d'attitudes). On lui donne le nom de fosterage et on a cru le repérer jusqu'au coeur de certaines attitudes monastiques des
264. AUSONE, Parentalia , III. Cf. sur ce texte GUASTELLA (G.), "Ausonio come testo antropologico. . . ", loc. cit.
265. Références in GUASTELLA (G.), op. cit., p. 117-121; BREMMER (J.), op. cit., p. 70-71; Cûchulainn reçoit l'essentiel de sa filiation moins de son père que de son oncle maternel, Conchobar. D'ailleurs, c'est à ce dernier qu'il ressemble ; c'est surtout Conchobar qui s'occupe de la mise en nourrice de son neveu (Conception de Cûchulainn, d'ARBOIS, Cours ..., V, p. 29-32. En Pays de Galles, on voit l'initiation de Peredur conduite par ses oncles maternels (Mabinogion, éd. et trad. LOTH (J.), ibidem , III, p. 57-59). Je trouve ailleurs une relation avunculaire double (avec le frère de la mère d'une part et avec le frère de la mère de la mère d'autre part ) : Math devrait épouser la fille de sa soeur, mais Aranrot est déjà enceinte : l'enfant illégitime sera tué par un de ses oncles maternels, tandis que l'enfant légitime qui naît ensuite entretiendra des rapports très positifs avec un autre oncle maternel (ibidem , p. 134-136 ; 150).
266. LIV., V, 33-35. 267. TAC, Hist, IV, 33, 1 ; V, 20, 1 ; Ann., XII, 29-30. 268. GWYNN (E.J.), "Fosterage", loc. cit. , p. 107-109.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 351
Celtes insulaires ^69 (Je me réserve de reprendre ultérieurement l'analyse du problème pittoresque que pose la découverte d'un témoignage épigraphique de la filiation de Tristan et de la situation délicate dans laquelle on le met ainsi : au centre d'un double inceste, mais aussi, ce qui n'a pas frappé les commentateurs, au coeur d'un "imbroglio nourricier") 270 Qr, on a montré avec justesse que la famille maternelle constituait la cellule d'accueil par excellence pour l'enfant placé et il n'en fallut pas plus pour provoquer l'identification de l'avunculat et du fosterage. Mais à mon sens, cela ne fait que renforcer l'amalgame initial qui oblitère l'utilité sociale de la relation avunculaire. On postule de surcroît que l'avunculat est une "préférence" pour la famille de la mère et que Vauunculus s'identifie au "père nourricier" (foster-father) 271, lui- même parfois interprété, selon une théorie de Radcliffe-Brown, en "mère masculine" (mal e-m other) 272.
Bref, le constat que je voudrais établir est que les témoignages d'un réel privilège matrimonial font jusqu'à présent défaut dans le monde celtique 27^ Un tel privilège a-t-il pu avoir cours à l'époque gauloise ? Il est possible que certaines pratiques matrimoniales aient débouché sur des mariages "obliques", ou interprétés de la
269. KERLOUEGAN (Fr.), "Essai sur la nourriture et la mise en éducation dans les pays celtiques d'après les témoignages des textes hagiographiques latins", E.C., 1968-1969, p. 101-146.
270. Les auteurs de cette découverte ont cru retrouver le nom de Tristan sur une stèle des parages de Tintagel : d)RVSTANVS HIC IACIT / CVNAWORI FILIVS. Une démonstration assez convaincante révèle que ce Conomorus n'est autre que Marc (ceci est à mettre en relation avec la Triade n° 73 : "Tristan, fils (ou héritier, successeur) de Marc". D'autres recoupements rendent crédible l'hypothèse selon laquelle Tristan serait le fils naturel de Marc, issu de relations (déjà) incestueuses que celui-ci aurait eues avec sa soeur (DE MANDÁCH (A.), ROTH (E.-M.), "Le triangle Marc-Iseut-Tristan : un drame de double inceste". Etudes celtiques , 1986, vol. 23, p. 193-213). En quittant le Léonois pour la cour de Marc, Tristan se prépare à opérer, en quelque sorte, un double inceste, mais aussi un "double fosterage".
271. HUBERT (H.), Les Celtes et la civilisation ..., p. 243-244. 272. RADCLIFFE-BROWN (A.R.), Structure et fonction ..., p. 83-102 [=
South African Journal of Science , 21, [1924], p. 542-555]. 273. Il faudra scruter, dans cet esprit, les textes celtiques tardifs au cours
d'un examen exhaustif qui fait jusqu'à présent défaut.
352 Serge LEWUILLON
sorte, par suite de l'existence d'une famille communautaire 274^ ou une fille peut épouser ses "pères" (classificatoires) 275. Mais dans la Gaule de La Tène III, cette pratique a disparu et il n'en reste, sinon que le souvenir, du moins que comme un regret. C'est ainsi, en effet, que peut être regardé l'avunculat : dès le moment qu'il a cessé de fonctionner comme processus d'alliance (le privilège matrimonial) propre à réaliser les conditions de l'échange, il n'en reste plus que les systèmes d'attitudes. Mais d'autres mécanismes sociaux se substituent à lui: l'oncle n'est plus l'époux potentiel de sa nièce, mais seulement le foster-father de ses neveux et nièces. Se trouve-t-on pour autant en présence du fosterage pur et simple ? Il est difficile de comparer une situation sur laquelle les textes celtiques nous livrent un grand luxe de détail et les maigres allusions des Commentaires. Le fosterage n'est cependant pas absent de Gaule, comme l'a montré un texte déjà cité ^76#
II est certes plausible que ce texte fasse allusion à la prise en charge de l'éducation du fils par quelqu'un d'autre que le père. Faute de savoir prouver que c'est le côté de la mère qui y pourvoit, nous savons tout au moins que les druides peuvent prendre soin, à la demande des familles, de la très longue éducation des jeunes gens (et des jeunes filles) ^ : "Attirés par de si grands avantages, beaucoup viennent spontanément suivre leurs leçons, beaucoup leurs sont envoyés par les familles" (la traduction est assez faible) ^78 Ce propinqui(s) nous intéresse prodigieusement : se pourrait-il que les parents au 3e degré (cf. le tableau III), et par conséquent les oncles, se chargent de placer neveux et nièces auprès des druides? S'il en était ainsi, cela confirmerait que le fosterage est bien l'expression historique de ce que j'ai appelé le "regret avunculaire".
Deux systèmes différents sont ainsi esquissés, traçant une séparation entre Germains et Gaulois : les premiers connaissent (faut-il dire : encore ?) l'avunculat classique, tandis que les seconds
274. Cf. supra, p. 300-308. 275. B.G.,V, 14, 4. 276. Id., VI, 18, 3. 277. B.G., VI, 14, 2-4. 278. Id., VI, 14, 2 : Tantis excitati praemiis et sua sponte multi
disciplinám conueniunt et a parentibus propinauisaue mittuntur .
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 353
en sont (déjà ?) 279 au fosterage. Néanmoins, ne nions pas qu'à la fin de l'indépendance, ces traces sont ténues : la société gauloise n'est- elle d'ailleurs pas occupée à mettre au point de nouvelles stratégies propres à intensifier les processus de l'échange en élargissant la sphère des alliés : Yadfinitas ?
VI. CONCLUSION : STRATÉGIES HISTORIQUES ET ALLIANCES.
Il ne faut pas voir dans l'attrait extrême que jouent pour les Gaulois les nombreuses formules d'alliances un tardif bricolage historique ni le produit de leur incorrigible inconséquence. En réalité, leur société bigarrée franchit, vers la fin de l'âge du fer, une étape décisive à laquelle quelques autres peuples n'ont pas échappé : "la triple articulation du territoire, de la parenté et de l'alliance", c'est-à-dire une situation où les clans voisins par la parenté et par l'espace se mettent à se marier entre eux et à s'allier, a joué à Rome un rôle de tout premier plan 280. C'est, somme toute, le premier moyen de parer aux inconvénients d'une exogamie parfois lourde à porter. S'agissant des Gaulois, je pense que cette pratique remonte loin, car on y voit, à la lecture de Tite-Live ou de Polybe, comme une des conditions de la cohésion des bandes celtiques en perpétuelles migrations : rien n'a plus d'importance, au cours d'une expédition, que la manifestation des parentés de tous ordres :
" [...] à nouveau, un mouvement des Gaulois transalpins, leur faisant craindre d'avoir à soutenir une rude guerre, ils détournèrent de chez eux la poussée des envahisseurs en leur offrant de l'argent et en invoquant leur parenté, ils les lancèrent sur les Romains et prirent part à l'expédition " 281.
Pour cela, tous les moyens sont bons et les gages divers, argent ou otages, dûment échangés 282. Les Germains, comme on sait,
279. Des points d'interrogation pour éviter, autant que faire se peut, le piège d'un évolutionnisme primaire ...
280. THOMAS (Y.), op. cit., p. 379-380. 281. POLYBE, II, 19, 1 (trad. P. Pédech, C.U.F. , 1970). 282. Id., II, 21, 3 (alliance avec les Transalpins); 4, 6 : cette situation
présente la plus grande analogie avec ce que j'ai appelé la "lutte fondamentale pour la nature du pouvoir in "Histoire, société...", p. 544-545 ; II, 22, 3 (les gages donnés aux Gésates) ; 23, 1-2 ; 34, 2 ; les
354 Serge LEWUILLON
n'échappent pas à ce comportement : la conclusion d'alliances privées représente d'ailleurs l'occasion idéale de mettre en pratique l'opération du don et des contre-prestations 283. Enfin les Romains eux-mêmes savent tirer parti de ces prédispositions barbares en établissant de fructueuses relations commerciales et politiques avec tous leurs voisins septentrionaux, fussent-ils Celtes, Vénètes ou Germains ... Il n'y a donc rien d'étonnant à constater l'apogée de cette situation au moment ou va débuter l'enteprise de César en Gaule, dans une société où Vadfinitas demeure le principe politique primordial confondant en permanence droit privé et droit public, ainsi que fides et amicitia . Le système a peut-être connu sa formalisation très matérielle dans ces diplômes si particuliers, les mains de bronze, dont on a ingénieusement cru retrouver la trace jusque chez Cicéron et Tacite 284.
L'autre forme d'alliance est le mariage, peut-être même dans ses formes celtiques originales qu'il conserve dans les textes juridiques irlandais : faut-il les mettre sur le compte de hasards funestes, ces remariages pressés de la mère de Dumnorix 285 f ou sur celui d'une institution assimilable au "mariage annuel" ? Mais la distance est nulle entre les alliances par traités et celles par mariages : en effet, les deux moyens impliquent la parenté dans le politique avec une comparable efficacité, comme le démontre ce jeu cruel où la spéculation sur le lien du sang est le gage de toute entreprise 286 La délimitation du groupe des otages ne doit rien au hasard ; c'est la familia qui en fournit le cadre 287^ majs c'est l'ensemble du territoire de la tribu qui est mis à contribution : à plusieurs reprises, des Gaulois forcés de précipiter les leurs dans la
Vénètes concluent des traités avec les Romains : II, 18, 1-3. POL YEN, Strategemata , VII, 50, a signalé le rôle des femmes dans les affaires publiques, les combats et les négociations diplomatiques ... Sur les Celtes en Italie et les principaux textes, cf. PEYRE (Chr.), loc. cit.
283. TAC, Germ., 13, 5 ; 15, ; 20, 5 ; 7 ; 21, 1-3 ; 38, 2. 284. PIGANIOL (A.), "Fides et mains de bronze. Densae dexterae , CIC,
ad. Att., VII, 1", Droits de l'antiquité et sociologie juridique {Mélanges H. Lévy-Bruhl ), Paris, 1959, p. 471-473 ; TAC. Hist, II, 8, 3.
285. JULLIAN (H.), "Les parentés de peuples chez les Gaulois", p. 142, n. 4 : elle aurait été mariée à trois reprises au moins.
286. TAC, Germ., 20,5. 287. B.G., 1, 31, 7-8 ; II, 2, 5 ; (IV, 27, 5-6); V, 4, 2 ; 27, 2.
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 355
gueule du loup implorent qu'on leur laisse un délai pour rameuter tout ce beau monde 288. Enfin, le système gaulois rencontre auprès des Romains un succès si franc qu'il pousse ces derniers à passer de la garantie qualitative (les fils des principes) 289 à l'exploitation quantitative ; on est frappé du nombre croissant d'otages qui s'échangent au cours des événements de la conquête 290. Que ce sojt César qui porte le système à son paroxysme ne change rien à l'affaire : cela témoigne tout simplement de la réussite d'un système que les Gaulois eux-mêmes avaient mis au point, pour la plus grande efficacité de leurs sujétions mutuelles.
TABLEAU IV : LES ALLIANCES EN GAULE,
a. alliances publiques consenties librement.
1,9,3 Helvètes, Séquanes, Eduens. 1, 18, 5 ; 8 Eduens, Bituriges, Helvètes et alia . II, 4, 4 Rèmes et Belges (surtout les Bellovaques). III, 8, 4 Vénètes et voisins, puis tous les peuples de
la côte, jusqu'aux Morins et Ménapiens. IV, 6, 3 Belges et Germains. V, 53, 4 toute la Gaule. V, 55, 1 ; 5 Trévires, Gaulois et Germains. VI, 2, 1-3 Trévires, Germains ; tous les peuples
belges ; Eburons ; Sénons et Carnutes. VII, 1, 4 toute la Gaule VII, 4, 5-6; 29, 6 Arvernes et la plupart des autres peuples
gaulois, dont César donne les noms. 30, 4; 31,1
VII, 43, 4 ; Idem , avec les Eduens en plus. VII, 75, 2-5 Toute la Gaule, sauf les Bellovaques.
55, 4; 63, 3-4 VII, 5, 2 Bituriges, Eduens. VII, 64, 7 Arvernes, Allobroges. VIII, 3, 3 Bituriges et voisins. VIII, 7, 5 ; Atrébates et Germains
288. Id., (IV, 27, 5-6 : chez les Bretons); VII, 12, 4 : chez les Bituriges. 289. Id., 1, 31, 7-8 ; VII, 12, 4 ; V, 4, 1-2 ; 5, 3-4 ; 27, 2. 290. (Chez les Bellovaques, les Morins, les Trévires, les Eburons, les
Sénons, les Bituriges, les Carnutes et même, à la veille de l'expédition de Bretagne, des otages de toutes les cités : II, 15, 1: 600 ; (IV, 22, 2 : "un nombre élevé"); V, 4, 1-2 : 200 ; VI, 4, 5 : 100 et VII, 11, 2 : 600 ; V, 5, 3-4 (quelques principes de toutes les cités).
356 Serge LEWUILLON
10, 4; 21, 2 VIII, 45, 1
ainsi que 7
III, 17, 3 V, 2, 4 V, 27, 6 VI, 6, 4 VI, 9, 1 VII, 71, 2 VIII, 23, 3
b. alliances forcées
1, 31, 7-9 II, 1, 3 HI, 23, 2 V, 39, 1 VI, 2, 1-3
VII, 2, 1-3 VII, 7, 1
с. hors de Gaule.
1, 53, 4 IV, 16, 2
Trévires et Germains.
cas probables :
Unelles, Lexoviens, Aulerques Eburovices. Trévires et Germains. Belges entre eux, dont les Eburons. Ménapiens, Eburons. Trévires, Germains (Eburons ?) toute la Gaule Bellovaques et alliés
, garanties par des otages.
Eduens, Séquanes. Belges. Aquitains, Ibères. les Nerviens et leur pagi . Trévires, Germains et peuples belges, dont les Eburons. toute la Gaule. Arvernes de la Gaule centrale.
Germanie, Norique. Sicambres, Usipètes, Tencthères.
d. Alliances dans la parenté.
(avec les précisions de vocabulaire lorsque celui-ci permet de distinguer entre les alliances publiques et privées ; lorsque ces alliances sont conclues par un chef de tribu ou de lignage important, la mention est précédée d'un astérisque.)
1, 3, 5-8 I,18,5;8
II, 4, 4
V,55,l;5
VII, 31, 1
Helvètes,Séquanes,Eduens. Eduens, Bituriges, Helvètes, Séquanes et alia . Rèmes, Belges (dont les Bellovaques) : propinquitates * adfinitas. Trévires, Germains et autres Gaulois : nuntii Ф legationes. * toute la Gaule
DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE 357
VII, 63, 1 ; 3-4
VII, 64, 7 VII, 75, 5
VIII, 3, 3 (V, 53, 4 (VI, 2, 2
(V,55,l;5
* Eduens et autres Gaulois : gratia Ф auctoritas. Arvernes, Allobroges. * Atrébates, Bellovaques hospitia priuata societas. * Bituriges et voisins. contact entre les partes .) Eburons, Trévires, Nervies, Aduatiques, Ménapiens, Germains : foedere et societate .) * Trévires : amicitiam publiée priuatimque
peter e .)
Ainsi s'achève cet examen préalable de la parenté en Gaule indépendante, bien qu'il nous manque encore une étude du droit, surtout matrimonial et successoral. Mais les principes sont déjà en place : une société patriarcale, exogame et harmonique ; un stade archaïque de communauté familiale, avec des tendances à la polygamie réciproque et à la responsabilité collective ; une forme originaire de terminologie classificatoire ; une famille structurée où les degrés comptent moins que ses instances hiérarchisées (ses "classes concentriques") ^91 • et encore, ses espaces territoriaux strictement définis et dénotés ; et enfin, le souvenir lointain de ses mariages obliques et leur perpétuation dans le "regret avunculaire". Le tout au service de la règle socio-économique fondamentale : la compensation globale, ou l'expression celtique de l'échange généralisé.
J'ai parlé - faisant montre par là, je le crains, d'un certain idéalisme ethnologique - de formes originaires, archaïques, primitives, de "souvenir" et de "regret"... C'est qu'il est certain que la société gauloise a profondément évolué depuis le début du deuxième âge du fer, mais que les étapes de sa longue mutation sont indiscernables : on ne peut que les supposer. Comme la plupart des peuples en butte aux crises de l'histoire, les Gaulois feront montre d'une remarquable faculté d'adaptation de leurs structures sociales, mais avec un caractère profondément original : plutôt que de choisir la stratégie de l'endogamie fonctionnelle comme solution de repli et de préservation des patrimoines, les Celtes ont développé un droit où se conserve, jusqu'à un certain point, l'élément communautaire et collectif. Ce recoin antique, dissimulé au coeur du continent de
291. IZARD (M.), op. cit., p. 90.














































































![[Ed]. Où en est l’histoire du temps présent ? Notions, problèmes et territoires, Dijon, Université de Bourgogne, 1998.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633562d302a8c1a4ec01bf3f/ed-ou-en-est-lhistoire-du-temps-present-notions-problemes-et-territoires.jpg)