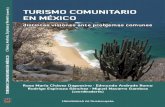APORTES BOTÁNICOS DE SALTA -Ser. Flora FLORA DEL VALLE DE LERMA
Les territoires d'exploitations des sites pré-tarasques du sud du Lerma, Mémoire de M1,...
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Les territoires d'exploitations des sites pré-tarasques du sud du Lerma, Mémoire de M1,...
0
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne UFR 03 Histoire de l’Art et Archéologie
Mémoire de Master 1
Archéologie des Amériques
Antoine DORISON
Co-dirigé par Mme Brigitte Faugère et M. Grégory Pereira
Année universitaire 2011-2012
LES TERRITOIRES D’EXPLOITATION AGRICOLE DES SITES PRÉ-TARASQUES
AU SUD DU LERMA, RÉGION DE ZACAPU, MICHOACÁN, MEXIQUE
(700-1500 apr. J.-C.)
1
TTTTABLE DES MATIÈRES
REMERCIEMENTS………………………………………………………………………………………………………………4
INTRODUCTION…………………………………………………………………………………………………………………5
PREMIÈRE PARTIE – LE VERSANT MÉRIDIONAL DU LERMA ET LE MONDE
MÉSOAMÉRICAIN : ESSAI DE RÉTROSPECTIVE D’UN ESPACE ATTACHÉ À LA RECHERCHE
FRANÇAISE………………………………………………………………………………………………………………………..7
CHAPITRE 1 – ANTÉCÉDENTS DE LA RECHERCHE DANS LA RÉGION DE ZACAPU………………….8
A. Archéologie au Michoacán…………………………………………………………………………………..8
B. Le projet Michoacán (1983-1987)………………………………………………………………………11
C. Les projets Zacapú, Michoacán, Etapa III (1993-1996) et Uacúsecha (2006- )…….14
D. La zone « Vertiente Lerma »……………………………………………………………………………..15
E. «Site catchment analysis »………………………………………………………………………………..17
CHAPITRE 2 – L’ENVIRONNEMENT AU SUD DU LERMA…………………………………………………….20
A. Situation générale……………………………………………………………………………………………..20
B. Volcanisme et géomorphologie………………………………………………………………………….21
C. Climat………………………………………………………………………………………………………………..23
D. Hydrographie…………………………………………………………………………………………………….25
E. Pédologie…………………………………………………………………………………………………………..25
F. Végétation…………………………………………………………………………………………………………29
CHAPITRE 3 – PÉRIODISATION ET ÉVOLUTION CULTURELLE……………………………………………..34
A. Présentation générale……………………………………………………………………………………….34
B. Dynamiques culturelles dans la région de Zacapu……………………………………………..37
C. Évolutions culturelles au sud du Lerma……………………………………………………………..38
• Phase Lupe (700-800/850 apr. J.-C.)
• Phase La joya (800/850-900/950 apr. J.-C.)
• Phase Palacio (900/950-1200 apr. J.-C.)
• Phase Milpillas (1200-1500 apr. J.-C.)
2
DEUXIÈME PARTIE – LA VIE DES CHAMPS AU SUD DU LERMA ENTRE LES VIIIème ET XVème
SIÈCLES : ÉBAUCHE D’ANALYSE DES TERRITOIRES D’EXPLOITATION AGRICOLES……………….47
CHAPITRE 4 – LE LIEU DE VIE DE L’AGRICULTEUR : LES SITES DU CORPUS…………………………48
A. Typologie des sites…………………………………………………………………………………………..48
• Hameaux
• Villages
• Centres
• Autres
B. Précisions sur la sélection de l’échantillon de sites…………………………………………..50
• Cimetières
• Zones de taille
• Grottes et abris-sous-roches
• Indéterminés
C. Présentation des sites………………………………………………………………………………………53
CHAPITRE 5 – PRATIQUES AGRICOLES AU SUD DU LERMA ET POTENTIALITÉ DES SOLS…….56
A. Que sait-on des pratiques agricoles dans la région ?............................................56
B. La population et les travaux des champs……………………………………………………………59
C. Quelles terres étaient cultivées ?...........................................................................60
1. Notions de pédologie élémentaires………………………………………………………..61
• Couleur
• Texture
• Structure
• Acidité
2. Connaissance des sols traditionnelle………………………………………………………63
D. Le potentiel agricole des sols au sud du Lerma…………………………………………………..64
• Dernière précision sur les vertisols
CHAPITRE 6 – APPLICATION INFORMATIQUE : SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
68
A. Méthodologie de création des couches shapefile………………………………………………68
1. Couches de points pour les sites…………………………………………………………….68
2. Modèle numérique de terrain………………………………………………………………..70
3. Couches de polygones pour les aires………………………………………………………71
B. Type de sols et potentialités agricoles………………………………………………………………..71
C. Catchment analysis : les sites du sud du Lerma et leurs territoires d’exploitation
76 1. Territoires d’exploitation globaux et potentiels agricoles……………………….76
2. Les sites et les territoires d’exploitation individuels………………………………..79
3
3. Questions de chronologie……………………………………………………………………….81
D. Le facteur végétation…………………………………………………………………………………………83
TROISIÈME PARTIE – SUBSISTANCE AGRICOLE : SYNTHÈSE ET TENTATIVES
D’INTERPRÉTATION…………………………………………………………………………………………………………85
CHAPITRE 7 – LES POPULATIONS PRÉ-TARASQUES ET LEUR ENVIRONNEMENT………………..86
A. Les populations pré-tarasques du sud du Lerma et leur environnement……………86
1. Des travaux et des jours : agriculture traditionnelle au sud du Lerma…….86
2. Terrasses et fonds de vallées………………………………………………………………….87
3. Les villages et leurs territoires d’exploitation………………………………………….88
4. Une société d’agriculteurs………………………………………………………………………89
B. Vers une meilleure connaissance de la société des communautés préhispaniques :
limites et perspectives……………………………………………………………………………………….90
1. Questions de pédologie………………………………………………………………………….90
2. Questions de végétation…………………………………………………………………………91
3. Questions de topographie………………………………………………………………………92
4. Questions de relations humaines……………………………………………………………93
CONCLUSION…………………………………………………………………………………………………………………..94
TABLE DES FIGURES…………………………………………………………………………………………………………95
BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………………………………………………….97
ANNEXES……………………………………………………………………………………………………………………….102
4
RRRREMERCIEMENTS
J’ai le plaisir d’écrire ici quelques lignes pour témoigner de toute la gratitude que
j’éprouve envers les personnes qui ont contribuées à la conception de ce mémoire.
Je tiens avant tout à remercier Mme Brigitte Faugère, professeure des universités à
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et M. Grégory Pereira, docteur en archéologie précolombienne,
tous deux membres permanents du laboratoire d’archéologie des Amériques, pour avoir
accepté de diriger le présent travail. Je souhaite leur exprimer ici ma reconnaissance la plus
sincère pour leur soutien, leur confiance, leur aide et leurs conseils avisés en qualité de
spécialistes de ma région d’étude.
Je voudrais ensuite remercier les membres et personnes associées au laboratoire
d’archéologie des Amériques qui ont toujours trouvé du temps pour répondre à mes
interrogations. Ma gratitude va plus particulièrement à Mme Michelle Elliott, docteur en
archéologie, pour ses conseils sur les questions environnementales que je connais mal. Elle
va aussi à Mlle Chloé Andrieu, docteur en archéologie, qui par son implication hebdomadaire
pendant ses cours et par e-mail, a grandement contribué au bon déroulement de cette
année. À M. Dominique Michelet, directeur de recherche au CNRS, qui a eu l’amabilité de
m’accorder une entrevue pour clarifier des thèmes qu’il maîtrise parfaitement. Enfin, à Mlle
Marion Forest, doctorante sur la région de Zacapu, qui m’a notamment procuré des données
de premiers ordres pour mon travail.
Je tiens à remercier MM. Chris Fischer et Steve Leisz, professeurs d’archéologie et
d’anthropologie à l’université d’état du Colorado, que j’ai eu la chance de rencontrer à
l’occasion du workshop sur l’Occident du Mexique à Nanterre et avec qui j’ai entretenu des
conversations instructives par e-mail.
Je remercie ici Romuald Housse, qui a toujours été d’un soutien sans faille et un ami
fidèle sans qui cette année aurait été bien plus morne. Mes pensées vont aussi à Celeste
Massol et Victoria Otero, avec et grâce à qui j’ai pu braver les longues heures de
bibliothèque. Ma gratitude aussi à quelques étudiants de M2, devenus des amis et qui furent
d’un soutien redevable. Je pense surtout à Rémi Mereuze, pour son ingéniosité
informatique, et Céline Lamb, pour ses conseils estimables à la fin de mes recherches.
Je témoigne finalement de ma gratitude à mes parents qui m’ont toujours soutenu
dans ma progression en archéologie.
5
IIIINTRODUCTION
À près de 2000 mètres d’altitude, au sein des contreforts septentrionaux de la
Meseta Tarasca, Zacapu est aujourd’hui une ville importante du nord du Michoacán au
Mexique. Ses alentours, à l’instar d’une bonne partie de l’État, constituent encore l’habitat
de l’ethnie purépecha. Ces hommes et femmes sont les descendants directs des irréductibles
Tarasques qui tinrent tête aux Aztèques avant l’arrivée des Espagnols. Le mythe fondateur
des Tarasques est consigné dans un texte colonial daté de 1540, la Relacíon de […]
Michoacán1. Son auteur probable, le fray Jerónimo de Alcalá fut mandé par le vice-roi de
Nouvelle Espagne, Antonio de Mendoza et lui fut confiée la mission de récolter toutes les
informations qu’il pouvait sur le peuple tarasque, sujet de la Couronne d’Espagne depuis
1522. Malgré la perte de la première partie du manuscrit, le texte abonde de
renseignements sur l’histoire légendaire et les coutumes de cette communauté. Le mythe
veut qu’un groupe de guerriers nomades, les uacusécha, soit arrivé des plaines du nord pour
coloniser le bassin de Pátzcuaro et ainsi créer le royaume Tarasque. Sur leur route, alors
guidés par leur premier chef, Hire Ticatame, ils firent escale dans les environs de Zacapu-
Tacanendam2 où il est dit qu’ils s’arrêtèrent un temps.
Au-delà du mythe, le lieu légendaire où s’installa Hire Ticatame a depuis longtemps
été identifié comme la ville actuelle de Zacapu. Dans les malpaís qui bordent l’agglomération
au nord, on peut observer les vestiges d’architecture typiquement tarasque. Plus au nord,
les villageois ont retrouvé d’autres structures éparses qui jonchaient leurs champs. N’y
prêtant guère attention, ils récupérèrent pierres et objets pour leur besoins personnels,
jusqu’à ce que la communauté scientifique s’intéresse à la question.
Aujourd’hui, après plus d’un siècle d’études, dont les trente dernières années
constituent le plus gros du travail à la lumière des investigations françaises, ce ne sont plus
des structures éparses qui parsèment le paysage montagnard, mais bel et bien les vestiges
de centaines de villages où ont un jour vécu des communautés préhispaniques complexes.
L’étude de la région a permis d’agrandir considérablement le champ des connaissances sur
ces sociétés tarasques et pré-tarasques. En 2006, sous l’impulsion de Grégory Pereira, une
équipe de spécialistes, épaulée de fouilleurs locaux, s’attèle à poursuivre les investigations
dans une zone qui, nous allons le voir, est imprégnée par l’archéologie française. C’est dans
le cadre de ce programme de recherche renaissant que s’inscrit l’étude que nous allons
présenter.
1 Relación de las cerimonias y rictos y población y gobernación de los indios de la provincia de Mechuacan hecha
al Ilustrísimo señor don Antonio de Mendoza, virrey y gobernador desta Nueva España por Su Majestad 2 Relación de las ceremonias y ritos y población y goberno de los indios de la provincia de Michoacán. Édition
française : LE CLEZIO, 1984 (abrévié RM, 1984 par la suite) : 60
6
Nous nous sommes familiarisés avec la littérature, désormais assez abondante, sur la
région. Notre objectif premier était d’étudier l’organisation spatiale de cette zone
géographique. Au fil des lectures et d’entretiens avec Grégory Pereira et Brigitte Faugère,
tous deux spécialistes des environs de Zacapu, nous nous sommes petit à petit orientés vers
une analyse spatiale centrée sur l’agriculture. L’idée d’observer l’environnement comme un
vivier naturel nous a très vite motivés. Nous nous sommes donc documentés sur les
questions de subsistance et d’acquisition des ressources. Souhaitant, par ailleurs, profiter de
la technologie des systèmes d’information géographique, nous avons cherché à concilier ces
expectations.
Pour ce faire, nous avons décidé de nous intéresser à un thème piquant en
archéologie comme en géographie : l’importance du facteur environnemental dans
l’implantation des sites. D’aucun, tel que Franz Boas, ont répugné l’idée même de
déterminisme géographique. Nous tenterons ici de ne pas tomber dedans. Toutefois, nous
serons moins catégoriques, en ce sens que nous pensons l’homme et l’environnement
intimement liés. L’un influant sur l’autre et réciproquement, tentant tant bien que mal de
maintenir un équilibre. Nous nous sommes donc posé la question suivante qui servira de fil
conducteur à notre réflexion. L'exploitation du potentiel agricole de leur environnement par
les groupes pré-tarasques du sud du Lerma aux époques classique et post-classique,
influent-elle sur l’organisation spatiale des sites archéologiques ?
Notre choix s’est alors arrêté sur l’idée d’une « site catchment analysis » – ou analyse
des territoires d’exploitation de sites archéologiques. Nous souhaitons, dans un premier
temps, définir des niveaux de compatibilité avec la mise en culture du maïs pour chacun des
espaces géographiques qui entourent les sites. Dans un second temps, nous voulons
matérialiser les territoires d’exploitation de ceux-ci. Ainsi, par recoupement, obtenir une
idée des possibilités offertes aux hommes du sud du Lerma et savoir si elles ont pu avoir un
poids dans les décisions concernant l’établissement de leurs villages.
Nous commencerons par faire un point sur les connaissances acquises sur Zacapu et
sa région à l’époque préhispanique. Après quoi, nous présenterons la méthodologie utilisée
pour réaliser notre étude. Finalement, nous nous essaierons à une synthèse sur l’agriculture
dans la région et son influence pour l’organisation spatiale des établissements. Agencement
de l’espace que nous tenterons de mettre en exergue en proposant des hypothèses sur la
perception que les hommes du sud du rio Lerma ont pu en avoir.
7
PREMIÈRE PARTIE – LE VERSANT MÉRIDIONAL DU LERMA ET LE MONDE
MÉSOAMÉRICAIN : ESSAI DE RÉTROSPECTIVE D’UN ESPACE ATTACHÉ À LA RECHERCHE
FRANÇAISE
8
- CHAPITRE 1 -
AAAANTÉCÉDENTS DE LA RECHERCHE DANS LA RÉGION DE ZACAPU
A. Archéologie au Michoacán
À l’été 1522, Cristóbal de Olid est envoyé par Cortés au Michoacán afin d’y établir
une colonie espagnole3. Tangáxoan II, cazonci4 depuis quelques années, avait à plusieurs
reprises fait part aux conquistadores de sa prévenance envers eux et de son désir d’entamer
des relations pacifiques. C’est donc sans embûche que l’Espagne devient maîtresse de la
région qu’elle dépouillera de ses ressources. La tragique histoire de la conquête du
Michoacán restera dans l’ombre de celle de l’Empire aztèque, dont le dernier tlatoani5,
Cuauthemoc, résista jusqu’au dernier souffle de son peuple. Parallèlement, peu d’écrits
relatent l’épisode qui, en quelques décennies, fait pratiquement table rase de l’histoire
Tarasque. Étant une civilisation sans système d’écriture, sa mémoire ne subsistera que
péniblement à travers le temps. Par extension, l’histoire des groupes qui ont précédés les
Tarasques et ont contribué à la formation de leur royaume est encore plus floue.
Néanmoins, certains indices permettent de reconstituer ce passé. D’abord, une poignée de
textes de l’époque de la Conquête ou plus tardifs. On retiendra par exemple la troisième
lettre de Cortés ou les travaux du franciscain Jerónimo de Mendieta qui écrit à la fin du
XVIème siècle6. Parmi ces sources écrites, la plus importante reste la Relacíon de […]
Michoacán7. Écrite autour de 1540 par le Fray Jerónimo de Alcalá – bien que subsiste une
incertitude sur l’auteur –, elle compile les informations qu’il a récupérées auprès des
« anciens » de l’élite Tarasque à la demande du vice-roi de Nouvelle Espagne, Antonio de
Mendoza. Elle relate l’histoire de l’arrivée des uacusécha – guerriers nomades, ancêtres
mythiques des Tarasques – dans la région de Pátzcuaro, ainsi que de nombreuses coutumes
3 WARREN J.B., 1985 : 42
4 Souverain tarasque.
5 Souverain aztèque.
6 WARREN J.B., ibid. : 24
7 RM, 1984
9
purépecha8, comme les rites qui accompagnaient la mort du cazonci. C’est par conséquent
un écrit fondamental. Malheureusement, ces documents ne fournissent que des
informations partielles et sont pour la plupart déformés par la subjectivité de leurs auteurs.
C’est donc naturellement vers l’archéologie que les scientifiques se sont tournés pour
tenter de reconstituer l’histoire préhispanique du Michoacán. Pourtant, les recherches sont
très récentes comparées à celles qui ont été réalisées sur les autres grandes civilisations
comme les Aztèques ou les Mayas. Peut-être est-ce du au manque de sources écrites, au
caractère moins prestigieux des sites archéologiques ou encore au côté honteux de la
Conquête éclair dans la région, puisque Tangaxoan II est encore aujourd’hui considéré
comme un lâche par les Purépecha9. Quoi qu’il en soit, ce n’est que pendant les années 1930
et 1940 que les réels travaux archéologiques se mettent en place. C’est en effet à cette
époque que l’on commence à définir la région que l’on appelle Occident du Mexique, dans
laquelle est comprise une partie de l’état de Michoacán. Plusieurs archéologues pionniers
commencent alors des études sur tout l’ouest mexicain en privilégiant néanmoins les
vestiges de la civilisation tarasque, mieux connus. Ce sont par exemple les travaux de
Wigberto Jiménez Moreno qui publie une « Historia antigua de la zona tarasca » en 1948
dans la quatrième réunion de la table ronde sur les problèmes anthropologiques du Mexique
et de la Centramérique10. On peut aussi citer les recherches d’Eduardo Noguera à Zamora et
Pátzcuaro ou ses fouilles à El Opeño11, devenues célèbres pour l’état de conservation des
structures. C’est donc à cette époque que sont réalisées les premières grandes avancées sur
l’Occident du Mexique qui sort alors de sa situation de « marge de la Mésoamérique » pour
en devenir partie intégrante. L’hypothèse originelle était un développement tardif sous
l’influence des Toltèques au postclassique, ou de Teotihuacan au classique12. Avec ces
nouvelles découvertes, l’Occident du Mexique devient une zone bien plus importante qui n’a
pas seulement a été influencée par les civilisations du haut plateau central, mais a aussi su
diffuser certaines de ses particularités vers l’est ou même le nord. À ce titre on compte par
8 Nom indigène des Tarasques. Cette communauté existe toujours aujourd’hui au Michoacán.
9 WARREN J.B., ibid. : 237
10 JIMÉNEZ MORENO W., 1948 dans MICHELET D., 1992 : 12-17
11 NOGUERA E., 1931 et 1942 dans MICHELET D., ibid.
12 ARNAULD C. et al., 1993 : 13
10
exemple les traits de la céramique Chupicuaro que l’on retrouve à Cuicuilco au préclassique
ou au nord dans la culture Hohokam, bien connue des auteurs nord-américains13.
La région de Zacapú, qui nous intéresse plus spécialement, est connue depuis
longtemps des scientifiques. La ville fut le premier lieu où s’installèrent les uacúsecha guidés
par leur chef, Hire Ticatame, d’après la Relation de Michoacán. Les sites visibles de la région
ont donc constitué des sujets de réflexion dès le début du XXème siècle. Le site de San
Antonio Carupo, l’un de ceux qui présentent les structures les plus impressionnantes au sud
du rio Lerma, est cité par Carl Lumholtz en 1904, qui l’inclus parmi les « monuments
anciens » que l’on peut observer dans les environs de Zacapú14. Outre des observations, la
collecte et le dessin de quelques objets, Lumholtz réalisa des fouilles dans le site. Elles ne
durèrent cependant que cinq jours. Dans les années 1930 et 1940, dans la lignée des travaux
mentionnés plus haut, c’est Alfonso Caso qui identifiera plusieurs des sites de la région15. Il
effectua ses recherches en parallèle d’Eduardo Noguera16. Les deux œuvrèrent sous l’égide
du musée national qui organisait alors ses collections Tarasques. Plus connu pour ses fouilles
à Monte Albán, Caso sera parmi les premiers à faire réaliser à la communauté scientifique
l’importance de la région pour l’archéologie de la civilisation tarasque. Pourtant, la zone
reste inexplorée pendant de nombreuses années après les travaux de l’archéologue
mexicain. Ce n’est qu’en 1973 que Marie Kimball Freddolino entreprend de nouvelles
recherches dans le cadre de sa thèse de doctorat à l’université de Yale17. Elle met en
évidence le caractère pré-tarasque des vestiges archéologiques. Parallèlement, au sud-est de
Zacapú, le bassin de Pátzcuaro est abondamment étudié par des chercheurs nord-
américains. La fin des années 1930 voit la publication des recherches de Acosta et de Rubín
de la Borbolla18. Plus tard, en 1946, la IVème Table Ronde de la Société Mexicaine
d’Anthropologie est spécialement dédiée à l’Occident. On notera ensuite les nombreux
travaux d’Helen Pollard, souvent en partenariat avec Shirley Gorenstein entre 1970 et
198019. Les auteurs se concentrent alors, entre autres, sur l’urbanisme de l’ancienne capitale
de Tzintzuntzan. En 1993, Helen Pollard publie Tariacuri’s Legacy (l’héritage de Tariacuri,
13
CAROT P., 2001 14
FAUGÈRE B., 1991 : 48 15
CASO A., 1930 dans MICHELET D., ibid. 16
NOGUERA E., 1931 et 1948 dans MICHELET D., ibid. 17
FREDDOLINO M.K., 1973 dans MICHELET D., ibid. 18
ACOSTA J., 1939 et RUBIN DE LA BORBOLLA D., 1939 dans MICHELET D., ibid. 19
POLLARD H.P., 1980, 1982, 1993
11
fondateur légendaire du royaume Tarasque, qui s’établit à Pátzcuaro autour de 1250 selon la
Relation). Cet ouvrage fait le point des connaissances sur la civilisation Tarasque.
Les investigations menées dans les décennies 1970 et 1980 font réaliser à la
communauté scientifique que l’histoire contée par la Relation de Michoacán revêt peut-être
un caractère plus historique que ce que l’on croyait jusqu’alors. L’arrivée des uacúsechas
depuis le nord via la région de Zacapú avant leur installation dans le bassin de Pátzcuaro
devient une question déterminante dans la compréhension des mouvements de populations
qui aboutirent à la mise en place de l’État tarasque.
B. Le projet Michoacán (1983-1987)
C’est entre autres dans cette optique qu’est entrepris le projet Michoacán par le
Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaine (CEMCA) au début des années 1980.
L’objectif principal est l’identification de « toutes les manifestations préhispaniques
notables »20 dans la région. Cette investigation ambitieuse fournira la majorité des
informations sur les sites archéologiques qui jonchent les environs de l’actuelle Zacapu
jusqu’au rio Lerma. Menée de 1983 à 1986, El proyecto Michoacán couvre une aire
géographique de près de 1000 km², s’étendant des contreforts de la Meseta (ou Sierra
Tarasca) au sud au rio Lerma au nord.
Près de 400 sites archéologiques sont identifiés, allant de la simple concentration
d’artefacts en surface à de véritables centres urbains munis des bâtiments traditionnels de la
vie civique et rituelle mésoaméricaine. Chaque site est indexé pour des raisons pratiques
(faciliter le dialogue scientifique ou éviter de toujours avoir à répéter le nom usuel, parfois
très long). Un numéro est donc affecté à chaque site et est précédé du code MICH (pour
Michoacán). Par exemple, El Palacio de San Antonio Carupo est codé MICH. 103.
Trois zones sont définies sur la base des caractéristiques architecturales et du
matériel retrouvé, ainsi que la nature de l’environnement direct des sites (cf. chapitre 2)21.
La « Zona Sierra » au sud comprend principalement les sites postclassiques du malpaís de
20
MICHELET D., ibid. : 17 21
MICHELET D., ibid. : 17-18
12
Zacapu dont l’agencement se rapproche fortement de ce que l’on retrouve à l’époque
tarasque dans le bassin de Pátzcuaro22. Au nord-est de Zacapú, la « Zona Lago » regroupe les
sites de l’ancienne ciénéga, drainée au début du XXème siècle. Les sites s’établissent
essentiellement sur les lomas, de petites éminences qui émergeaient du lac à l’époque
préhispanique et constituaient alors autant de lieux d’une grande importance idéologique.
Ils présentent en effet souvent les évidences de pratiques funéraires23. Enfin, plus au nord, la
« zona Vertiente Lerma » présente des sites pour la plupart pré-tarasques, des grottes et
abris-sous-roches qui ont pu être les refuges des sédentaires mais aussi de nomades, ainsi
que de nombreux ateliers et mines d’obsidienne tarasques issue des cerros Zináparo et
Prieto24.
Fig.1 – carte générale des zones (issu de MICHELET D., 1992)
22 MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON, 2005 : 139-143 23
ARNAULD M.-C., P. CAROT & M.-F. FAUVET-BERTHELOT, 1993 24
FAUGÈRE B., 1996 et DARRAS V., 1999
13
À la lumière de la première campagne de 1983, six axes de recherche sont définis :
(1) L’étude de l’habitat dans la ciénega.
(2) Celle de l’organisation des établissements dans la zone « Vertiente Lerma ».
(3) La réalisation d’une investigation dans les alentours du Zináparo et du Prieto,
riches en obsidienne.
(4) La mise en place d’un programme d’exploration du malpaís de Zacapu où l’on
trouve une très forte concentration de sites tardifs.
(5) L’étude poussée du complexe funéraire de Las Milpillas (MICH. 95).
(6) Enfin, la reconstitution de la séquence céramique afin de replacer
chronologiquement les sites de la région.
Beaucoup des chercheurs français, directement associés ou non au laboratoire
d’archéologie préhispanique, ont travaillé dans la région de Zacapu. Que ce soit dans le
cadre du projet Michoacán ou dans sa continuation. On peut par exemple citer Dominique
Michelet, Alain Demant et Jean-Noel Labat qui publièrent El Proyecto Michoacán en 199225
où l’on retrouve une étude archéologique et environnementale de la région. Au même titre,
Arqueología de las Lomas en la cuenca lacustre de Zacapu par Marie-Charlotte Arnauld,
Patricia Carot et Marie-France Fauvet-Berthelot, fait le point sur les connaissances dans la
« Zona Lago ». On peut mentionner les travaux de Véronique Darras sur l’obsidienne du
Zináparo-Prieto ou ceux de Gérald Migeon dans le malpais de Zacapú. Enfin, ceux de Brigitte
Faugère sur « Vertiente Lerma » qui nous intéressent plus particulièrement26.
Bien que nous nous y attardions plus en détail dans le chapitre suivant, il est
important que nous insistions ici sur les travaux réalisés par Jean-Noël Labat. Il réalise sa
thèse de botanique sur la végétation du Michoacán, soutenue en 198827. Pendant la
préparation de celle-ci, il intégrera l’équipe du projet Michoacán pour lequel il effectuera
25
MICHELET D., 1992, DEMANT A., 1992 et LABAT J.-N., 1992 26
FAUGÈRE B., 1990, 1991, 1996, 2006, 2007 et 2009 27
LABAT J.-N., 1988
14
une étude de la végétation et de la pédologie de la région de Zacapu28. C’est en partie sur la
base de ses travaux que nous avons constitué notre analyse.
C. Les projets Zacapu, Michoacán, Etapa III (1993-1996) et Uacúsecha (2006- )
L’année 1987 clôt la première étape du programme qui aura duré cinq ans. À sa suite,
plusieurs publications présenteront les résultats. Parmi elles, El Proyecto Michoacán (1992),
Arqueología de las Lomas en la Cuenca lacustre de Zacapu (1993), ou les thèses de Brigitte
Faugère (1989), Gérald Migeon (1990), Véronique Darras (1991) et Patricia Carot (1993).
À partir de 1993, un nouveau projet est mis en place : Zacapu, Michoacán, Etapa III. Il
se concentre sur le malpaís au nord-ouest de Zacapu, afin d’étudier les vestiges tarasques
tardifs qui recouvrent les quelques 80 km² de coulées de lave du « mauvais pays ». Ce sont
trois grands sites qui sont choisi pour l’investigation : MICH. 23, 31 et 38. Ne pouvant
accorder autant de temps à ceux-ci qu’à MICH. 95 dix ans plus tôt, ce sont principalement
des enregistrements rigoureux d’un maximum de structures dans un quadrillage prédéfini
qui sont privilégiés29. Le temps manquait et réaliser un plan exhaustif avec le relevé
graphique de chaque structure comme cela avait été fait pour MICH. 95, n’était pas
envisageable. De ces travaux découlent deux informations principales. La première concerne
l’estimation de la population, qui a alors été légèrement revue à la baisse. La seconde est la
mise en évidence d’un indéniable changement dans l’organisation spatiale, très
probablement lié à des modifications d’ordre sociopolitique. Cette dynamique est reflétée
par l’établissement de ces grands sites. Pourtant, les indices qui pourraient permettre
l’identification d’une élite dirigeante sont minces.
Parallèlement et à la suite du projet Zacapú, de nouvelles publications paraissent. Ce
sont par exemple les Cuadernos de Estudios Michoacános édités par le CEMCA : Entre
Zacapu y Rio Lerma (1996) où Brigitte Faugère reprend les données de sa thèse, ou
Tecnologías prehispánicas de la obsidiana (1999) où Véronique Darras fait de même. Notons
aussi Génesis, culturas y espacios en Michoacán dont les sept chapitres, rédigés par les
protagonistes des deux projets, font à l’époque le point des connaissances sur les thèmes
28
LABAT J.-N., 1992 29
MICHELET D., 1998
15
principaux abordés pendant les quinze années passées. Le début des années 2000 constitue
toutefois un certain ralentissement dans les travaux sur la région.
C’est en 2006 que Zacapú et ses environs retrouvent une nouvelle jeunesse avec la
mise en place du projet Uacúsecha par Grégory Pereira. Ce-dernier avait déjà pris part au
dernier programme, notamment dans le cadre de sa thèse30 dont la problématique s’appuie
sur les fouilles de Potrero de Guadalupe. En qualité de spécialiste en anthropologie
physique, Grégory Pereira a pu fournir, grâce à ces fouilles, de nombreuses informations sur
les pratiques funéraires des populations pré-tarasques de la région. Le nom du projet –
Uacúsecha – n’est pas trompeur puisqu’un des objectifs principaux est d’éclaircir l’obscure
question des mouvements de populations qui ont conduit à l’implantation des Tarasques
dans le malpaís hostile et, par extension, ont probablement constitué un premier moteur à
l’émergence de l’État éponyme. Nombre de doctorants et de jeunes chercheurs ont intégré
et continuent d’intégrer ce nouveau programme de recherche. On pourra citer Elsa Jadot ou
Marion Forest31.
D. La zone « Vertiente Lerma »
C’est sur la zone « Vertiente Lerma » qu’a été réalisée l’étude que nous allons
présenter ici. Aussi est-ce sur la base des travaux de Brigitte Faugère, mentionnés plus haut,
que repose une grande partie de notre étude. Il convient donc de les présenter. En 1990,
l’auteur soutient sa thèse de doctorat à l’université de Paris 1 : Entre nomades et sédentaires
: archéologie du versant méridional du Lerma au Michoacán. Elle constitue la source
principale des connaissances sur cette zone en présentant à la fois les sites, leurs
descriptions, le matériel issu des fouilles de certains d’entre eux, l’étude de l’art pariétal
abondant dans la région ainsi qu’une synthèse générale sur l’évolution culturelle de la
période archaïque au XVIème siècle. Ce travail est l’aboutissement du second axe de
recherche qui avait été mis en place en 1984 au sein du projet Michoacán. Il se fonde à
l’origine sur l’étude de 62 sites de natures diverses présentant des états de conservation
variés. Certains possèdent encore des structures en élévation sur une hauteur notable.
30
PEREIRA G., 1999 31
FOREST M., 2011
16
D’autres, au contraire, ont vu le temps détruire et araser leurs constructions, au point
parfois de ne plus présenter que les vestiges de fondations. À partir de ce corpus, Brigitte
Faugère a pu replacer la plupart dans un cadre chronologique – sur lequel nous reviendrons
plus tard – qui correspond approximativement à l’époque classique et au début du
préclassique pour la majorité. Dans une certaine mesure, elle a pu reconstituer les grandes
lignes de l’économie et même toucher à l’idéologie, au travers notamment des nombreuses
gravures et peintures rupestres découvertes. Elle a aussi posé les bases de l’évolution
culturelle de la région en mettant en évidence des regroupements de sites en fonction des
époques. Cette démarche a été réalisée via l’établissement d’une classification
morphologico-fonctionnelle des sites. Là encore, nous y reviendrons.
Les travaux de Brigitte Faugère ne se résument pas seulement à cette thèse.
Notamment parce qu’elle a débouchée sur une publication où de nombreuses informations
ont été ajoutées. Entre Zacapu y Río Lerma : culturas en una zona fronteriza parait en 1996.
Reprenant les grandes lignes qu’elle avait mises en évidence dans sa thèse, l’auteur effectue
cependant un réel travail de remodelage. C’est avant tout le corpus des sites qui est très
largement étendu. De 62, on passe à 101 sites présentés. En 1997, Brigitte Faugère publie un
ouvrage qui fait le point sur les découvertes concernant les peintures et gravures rupestres
que l’on trouve dans la région. Parallèlement à ces deux synthèses principales, plusieurs
articles et contributions à des ouvrages collectifs viennent compléter ces travaux. Parmi
ceux-ci, notons le chapitre publié au sein de Las sociedades complejas del occidente de
México en el mundo mesoamericano32 qui touche plus particulièrement à notre étude. C’est
en effet dans ce chapitre qu’est présentée une première approche des potentiels agricoles
liés aux sites, ainsi qu’un travail de cartographie pour les mettre en exergue. L’auteur
travaille alors sur un corpus de 102 sites (ajout de MICH. 106), qu’elle replace dans une
typologie morphologico-fonctionnelle simplifiée (« hameaux », « villages », « centres » et
« autres »). Nous y reviendrons lors de la présentation des sites dans le chapitre 4. Elle
réalise plusieurs analyses statistiques simples à l’aide de cartes pour définir les liens entre les
sites en fonction des phases chronologiques. L’étude des distances entre sites et celle de
leur intégration dans l’environnement via des données sur la pédologie, le climat, la
végétation, l’utilisation des sols et l’hydrologie ont été effectuées. Elles ont mis en évidence
32
FAUGÈRE B., 2009
17
des regroupements de sites qui varient au cours de la séquence chronologique (nous y
reviendrons dans le chapitre 3). Comme l’auteur le précise, l’étude s’est limitée à la
comparaison manuelle des cartes fournies par l’INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geographía), bien que cela puisse être entrepris à l’aide d’un système d’information
géographique (SIG).
Au vu des limites inhérentes à une étude manuelle telle qu’elle a été présentée ci-
dessus, l’objectif principal de notre travail est d’intégrer les sites et les données
environnementales dans un SIG. On veut par la suite être capable d’apprécier l’évolution
culturelle de la région au travers de l’étude de différentes variables que ce type de logiciel
peut gérer. Cependant, la maîtrise d’un SIG demande un certain temps et beaucoup
d’expérience. Aussi nous limiterons-nous à une analyse relativement simple correspondant
autant à la découverte de l’environnement archéologique que nous commençons à
appréhender, qu’à la prise en main de l’outil informatique. Nous souhaitons mettre en place
une nouvelle approche de l’organisation spatiale de la zone Vertiente Lerma. Notre postulat
de départ est que les sites archéologiques se regroupent, d’une manière ou d’une autre, en
fonction des potentiels agricoles de la région. Nous allons pour cela réaliser une « site
catchment analysis ». Les détails de ce travail seront présentés dans les parties II et
III. Néanmoins, dans une optique de clarification de notre propos, il nous a semblé important
de revenir sur la notion même de « catchment analysis », ainsi que sur ses origines et son
application en archéologie.
E. «Site catchment analysis »
Depuis ces dernières années, l’informatique ouvre des horizons nouveaux à la
recherche archéologique grâce à des outils qui évolue à la vitesse des nouvelles
technologies. Parmi ceux-ci, l’un des plus répandu, de part sa polyvalence, est sans doute le
système d’information géographique. Il permet la réalisation de cartographies dynamiques
où peuvent être conçues de nombreuses analyses spatiales et statistiques. L’un des objectifs
de notre étude, comme on l’a déjà évoqué, est d’appliquer ce nouvel outil à la région
Vertiente Lerma afin de mieux comprendre l’organisation spatiale de ses sites. Dans cette
optique, nous allons mettre en place une analyse dit de « catchment » (captage), francisée
18
en « territoire d’exploitation ». Avant d’aller plus loin, nous nous devons donc de revenir sur
cette notion et son origine.
La première mention et, par extension, la première réalisation de «site catchment
analysis » se trouve dans un article de Vita-Finzi et Higgs de 197033 où ils présentent une
étude sur l’économie préhistorique de la région du Mont Carmel en Palestine. Les auteurs
empruntent le terme à la géomorphologie où il signifie « bassin versant ». À l’instar de ce-
dernier qui canalise les cours d’eau grâce à ses pentes, le territoire d’exploitation d’un site
archéologique est la zone de laquelle il tire ses ressources. À l’époque, les outils qui
permettent la mise en place d’une telle analyse sont alors relativement limités, mais la
théorie est posée. L’idée générale est de définir cet espace qui entoure le site en
introduisant plusieurs facteurs déterminants, tant économiques, qu’énergétiques,
sociologiques, topographiques ou simplement logiques. On obtient alors un espace
géographiquement délimité dans lequel les hommes peuvent trouver des ressources
primordiales. La réflexion est faite pour des systèmes de société où l’autosuffisance
représente une grande partie de l’économie. Ainsi, en règle générale, ce type d’étude
concerne les denrées à proximité du site et pour lesquelles l’investissement fourni par les
habitants pour s’y rendre est régulier (quotidien, hebdomadaire, voire mensuel). Ce sont par
exemple les territoires de chasses, les zones d’approvisionnement en eau, ou les champs
cultivés. L’aire qui entoure le site se limite alors à quelques kilomètres. Cependant, certains
auteurs vont parfois plus loin et tente d’appliquer ce type de réflexion à une échelle
beaucoup plus petite. Par exemple, Kent Flannery réalise une analyse des territoires
d’exploitation dans les vallées d’Oaxaca et Tehuacan dans les années 197034. À San José, les
territoires d’exploitation qu’il définit vont du kilomètre (pour l’obtention de ressources dans
la rivière voisine) à plusieurs centaines (pour l’acquisition de matériaux exotiques). Cette
réflexion est intelligente au niveau social puisque, en effet, il est important de réfléchir à
tous les types de produits. Néanmoins, tout regrouper dans une même méthode d’approche
ne nous parait pas judicieux. Il semble compliqué d’avoir une approche théorique viable
quand on travaille sur un cercle dont le rayon est aussi grand.
33
VITA-FINZY C. & E.S. HIGGS, 1970 34
FLANNERY K., 1976 : 91-130
19
Depuis les travaux pionniers de Vita-Finzi et Higgs, beaucoup d’archéologues
américanistes (Flannery ; Blanton ; Coe ; Rossman…35), ou non36, ont réalisé des analyses des
territoires d’exploitation en faisant varier les facteurs et les problématiques. Notre objectif
ici est avant tout de mettre en place une méthodologie de travail. C’est pourquoi l’étude que
nous allons réalisée ne fera intervenir que peu de facteurs.
C’est ainsi dans la lignée d’une riche histoire des recherches dans la région que nous
entamons notre étude. Cependant, c’est surtout la partie méridionale qui a concentré les
investigations depuis près de vingt ans. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, il
nous faut revenir sur deux points fondamentaux pour bien comprendre le contexte de
l’analyse. Nous voulons bien entendu parler de l’environnement et de la chronologie.
35
FLANNERY K., ibid. 36
COSTE N., J. GUILAINE & J.-C. REVEL, 1988
20
- CHAPITRE 2 -
CCCCADRE GÉOGRAPHIQUE
Avant de commencer notre présentation du cadre géographique, nous souhaitons
préciser que nous avons réalisé une carte à l’aide du SIG qui regroupe les informations
générales (cf. annexes, carte 1). Ainsi, le lecteur pourra s’y reporter au cours de ce chapitre.
A. Situation générale
La région étudiée se situe autour de la ville actuelle de Zacapu au nord-ouest de l’état
de Michoacán dans l’Occident du Mexique. L’agglomération moderne, première escale des
Uacúsecha vers le bassin de Pátzcuaro à la charnière entre le XIIème et le XIIIème siècle selon la
Relation de […] Michoacán, se situe à environ 300 kilomètres à l’ouest de l’ancienne
Tenochtitlan. À une trentaine de kilomètres au sud-est reposent les ruines de Tzintzuntzan,
capitale de l’empire Tarasque à l’arrivée des Espagnols. Mais c’est au nord de la ville que l’on
trouve les vestiges des édifices construits par les civilisations pré-tarasques qui habitèrent
les vallées au sud du rio Lerma à l’époque classique et au début du postclassique (entre 600
et 1200 apr. J.-C.).
La zone étudiée par le projet Michoacán à partir du début des années 1980 se situe
entre 19°45’ et 20°10’ de latitude nord et entre 101°40’ et 102°05’ de longitude ouest. Ce
sont environ 1000 km² qui ont fait l’objet d’une investigation. La zone Vertiente Lerma,
quant à elle, est réduite entre 19°55’ et 20°10’ de latitude nord pour les mêmes
coordonnées de longitude. Elle représente très grossièrement 450 km² prospectés. Elle est
limitée au sud par les contreforts de la Meseta, ou Sierra Tarasca, matérialisée par le cerro El
Agostadero qui culmine à un peu plus de 2500 mètre d’altitude, ouvrant sur les montagnes
qui atteignent 2800 et 3000 mètres au sud ouest de Zacapu. Au nord c’est le début de la
dépression créée par le rio Lerma qui matérialise la frontière. À l’est, la vallée du rio Angulo
constitue la limite de la zone. Enfin, la vallée qui va de la ville de Los Fresnos à Penjamillo
forme l’extrémité ouest, où il faut noter le complexe montagneux du Zinaparo-Prieto, dont
21
l’obsidienne native sera d’une grande importance à l’époque tarasque37. La région entière
est jonchée de cônes volcaniques qui en font un terrain relativement accidenté, perché
entre 2100 et 1700 mètres d’altitude du sud vers le nord et entrecoupé de vallées fertiles.
Aussi est-il important de revenir sur le volcanisme omniprésent qui a façonné
l’environnement et constitue par conséquent un facteur déterminant pour la perception que
les hommes préhispaniques en ont eu et l’utilisation qu’ils en ont fait.
Fig. 2 – Situation générale de l’étude.
B. Volcanisme et géomorphologie
Le Mexique central est coupé sur presque toute sa largeur par l’Axe Néovolcanique
Transmexicain (ANT). Il s’étend approximativement le long d’une ligne imaginaire que l’on
peut tracer entre la ville de Tepic (Nayarit) et celle de Veracruz (Veracruz). Il correspond à la
zone de subduction où la plaque tectonique des îles Cocos plonge sous la plaque nord-
37
DARRAS V., 1999
22
américaine. L’ANT a été divisé en quatre parties distinctes38. On rencontre ainsi d’ouest en
est, la fosse tectonique Tepic-Chapala orientée NW-SE, puis celle de Colima N-S, la zone du
Michoacán et finalement la partie orientale qui s’arrête au Pico de Orizaba, à la limite entre
les états de Puebla et Veracruz. La région étudiée se situe bien entendu dans la zone
Michoacán, la plus riche en volcans quaternaires, c’est-à-dire, relativement récents à
l’échelle des temps géologiques. La zone Vertiente Lerma présente une majorité de
stratovolcans, formés par des éruptions successives ou uniques. Ils sont qualifiés dans ce
dernier cas de cônes monogéniques. Ainsi, l’environnement est composé d’une succession
de monts distribués le long d’une pente légère mais constante du sud vers le nord. Le fond
des vallées se trouve entre 1700 et 2000 mètres. La partie méridionale présente donc les
plus hauts monts avec des altitudes tournant autour de 2500 mètres. En remontant dans la
partie septentrionale, les massifs montagneux se font plus épars et leurs altitudes plus
réduites – autour de 2000 mètres – alors que l’on atteint les bords du rio Lerma. Entre les
montagnes, plusieurs vallées s’étalent. En leur sein, un réseau hydrographique complexe
s’est lentement mis en place. C’est souvent les versants des monts (cerros en espagnols) qui
ont constitués des espaces privilégiés pour l’édification des établissements à l’époque qui
nous intéresse.
La région est grossièrement divisée en trois vallées successives d’est en ouest. Elles
sont toutes trois orientées S-N. Au nord de celles-ci, on retrouve la large vallée du rio Lerma,
qui est, elle, orientée E-W.
- La vallée du rio Angulo est la plus orientale des trois mentionnées plus haut. Elle
s’étend sur environ 15 kilomètres depuis le cerro El Brinco Del Diablo au sud jusqu’à la ville
actuelle d’Agua Caliente au nord. Elle est large d’environ 6 kilomètres et est aujourd’hui
particulièrement riche en zones cultivées en raison des terres fertiles qui bordent la rivière.
Toutefois, ces alluvions s’avèrent relativement lourdes et sont donc difficilement
exploitables sans l’utilisation de techniques agricoles modernes. Des conditions à prendre en
compte dans la mesure où les populations précolombiennes n’avaient à disposition que la
force humaine pour les travaux des champs.
38
DEMANT A., 1992
23
- La seconde vallée, centrale, va approximativement de Bellavista à Epejan. Elle est
limitée au sud par le cerro El Fresno et au nord par le goulet formé par les cerros Blanco à
l’est et Prieto39 à l’ouest. Pour une longueur d’une douzaine de kilomètres, sa largeur est
assez variable dans la mesure où elle est bien plus accidentée que celle du rio Angulo. Les
petites élévations, comme le cerro La Cruz, en font une vallée sinueuse et souvent étroite.
Aussi est-elle aujourd’hui moins mise en culture que ses voisines.
- La troisième vallée s’étend du lac de Los Fresnos au sud à la ville de Penjamillo au
nord. Alors qu’elle commence étroite au sud, elle s’évase de plus en plus à mesure qu’on la
remonte vers le nord. Elle est aujourd’hui abondamment cultivée, surtout dans sa partie
septentrionale.
- La vallée du rio Lerma est de nos jours la plus intensément mise en valeur pour ses
terres fertiles. Néanmoins, comme nous l’avons fait remarquer pour le rio Angulo, les sols
alluvionnaires lourds ne sont pas forcément ceux privilégiés par les sociétés préhispaniques.
Nous en prendrons compte dans notre analyse. De plus, cette zone n’a été sujette qu’à peu
de prospections systématiques et ne constitue donc pas un échantillon assez viable.
C. Climat
La région répond aux caractéristiques d’un climat tropical avec cependant deux
variations principales liées à la différence d’altitude entre nord et sud40. La partie
septentrionale connait majoritairement un climat de type tropical montagnard assez chaud.
L’isohypse des 2300 mètres d’altitude définit grossièrement la limite entre ce dernier type
de climat et celui que l’on retrouve au-dessus de cette altitude, à savoir un climat tropical
montagnard assez froid. Ainsi, le complexe montagneux sud initié par le cerro El Metate et
celui de l’ouest avec le Zinaparo et le Prieto connaissent un climat plus froid que les vallées.
La résultante dans les deux cas est la persistance d’une saison sèche plus longue. En effet,
comme pour tout climat tropical, l’année est ici divisée en deux saisons. La saison sèche
dure environ sept mois, de novembre à mai. Par conséquent, la saison humide s’étale sur
39
Il faut faire attention à ne pas confondre le cerro Blanco évoqué ici et celui que l’on trouve à l’est du rio Angulo. De même pour le cerro Prieto qui possède un homonyme dans le complexe Zinaparo-Prieto. 40
LABAT J.-N., 1992 : 75-78
24
cinq mois, de juin à octobre. Toutefois, ces données sont valables pour la région du projet
Michoacán dans son entièreté et la durée de la saison sèche est donc à rallonger un peu
pour la zone Vertiente Lerma à la lumière des conditions particulières mentionnées ci-
dessus.
La variation d’altitude a donc une influence importante sur la température moyenne.
En dessous de 1800 mètres, dans la partie septentrionale de la région, la température
moyenne annuelle est d’environ 20,5°C. On compte 1 à 4 jours de gel entre décembre et
février avec des minimales à 3°C au dessous de 0°C. Dans la partie méridionale, plus élevée,
la température moyenne annuelle est un tantinet plus faible avec environ 15°C au dessus de
2000. On dénombre alors 20 à 60 jours de gel d’octobre à mars. Le baromètre peut
descendre jusqu’à -5/-7°C.
En l’absence de diagramme ombrothermique spécifique à la zone Vertiente Lerma,
nous nous appuierons sur les données disponibles pour la ville actuelle de Zacapu. On
compte en moyenne 811 millimètres de précipitations par an. Les mois les plus secs sont
février et mars avec moins de 10 millimètres de précipitations. À l’inverse, les mois les plus
humides sont juillet et août, pendant lesquels tombent près de 200 millimètres.
Fig. 3 – diagramme ombrothermique de la ville de Zacapu (d’arpès LABAT J.-N., 1992)
En conséquence de ce climat, la région est relativement sèche dès que l’on s’éloigne
des lits de rivières. En admettant que le climat soit resté assez similaire depuis l’époque
préhispanique, l’accès aux ressources en eau devait alors être déterminant pour le choix des
installations. Il est donc important que nous revenions sur l’hydrographie.
25
D. Hydrographie
Nous l’avons déjà mentionné, le réseau hydrographique actuel est très complexe.
Avec une largeur d’une vingtaine de mètres de moyenne, le rio Lerma qui coure au nord est
la plus grosse rivière de la région. Il marque la limite naturelle entre l’état de Michoacán et
celui de Guanajuato. Les trois vallées S-N mentionnées plus haut sont traversées par trois
affluents du Lerma. Le rio Angulo à l’est, le San Miguel Epejan au centre et le Río Grande à
l’ouest. Ceux-ci sont eux-mêmes approvisionnés par de très nombreux petits cours d’eau qui
s’écoulent des montagnes environnantes. La plupart sont cependant temporaires mais
constituent quoi qu’il en soit des ressources en eau non-négligeable à la saison humide.
Certains espaces enfin ont été drainés, à l’instar de ce qui a été fait au début du XIXème siècle
dans l’ancienne ciénéga de Zacapu. C’est le cas pour une partie de la vallée du rio Angulo de
part sa forte anthropisation pour l’exploitation des terres. Les alentours du cerro El Colorado
ont aussi fait l’objet d’un remaniement drastique. Cependant, cela ne concerne que
l’extrême nord de la région que nous étudions et seuls quelques sites en grotte côtoient cet
espace.
Parallèlement aux cours d’eau, la zone est parsemée de lacs. Pourtant, là encore,
beaucoup ne sont que temporaires et/ou ont été remaniés par des interventions humaines,
comme la construction de barrages par exemple. Pour ce qui est de l’époque préhispanique,
aucun indice d’irrigation n’a pu être mis en évidence41.
E. Pédologie
Dans la mesure où nous allons tenter de définir des zones présentant différents
potentiels de mise en culture dans la suite de notre exposé, il est important de nous arrêter
sur la pédologie de la région. Les facteurs édaphologiques sont en effet fondamentaux pour
le développement de la végétation. Nous reviendrons brièvement pour cela sur les travaux
réalisés par Jean-Noël Labat pendant le premier projet Michoacán42 et les cartes de l’INEGI.
Nous avons aussi eu recours à des sources plus générales comme l’Introduction à la science
du sol43 de Philippe Duchaufour ou les encyclopédies en ligne Universalis et Britannica44.
41
FAUGÈRE B., 1996 42
LABAT J.-N., 1992 43
DUCHAUFOUR P., 2001 44
Confère « Références internet »
26
Enfin, il faut préciser qu’en pédologie, de nombreuses classifications pour les sols sont
utilisées. Elles sont sans cesse revues et les spécialistes ne s’accordent pas encore sur une
seule classification qui aurait valeur universelle. N’étant pas assez expérimenté dans le
domaine, nous avons préféré rester en accord avec les travaux de Labat qui suivent la
classification proposée par Philippe Duchaufour. Il a parallèlement donné les équivalences
de types de sol dans la classification nord-américaine de la FAO (Food and Agriculture
Organization), ce que nous avons aussi fait ici. Aussi, sans nous y aventurer outre mesure,
nous avons recoupé les informations de la FAO à l’aide des sites susmentionnés. Et ce,
notamment pour les données concernant l’agriculture qui nous intéressent et que Labat n’a
pas tellement mis en avant. Pour la suite du travail, nous dénommerons les types de sols en
suivant la terminologie de la FAO pour la simple et bonne raison qu’elle est celle usité au
Mexique.
Trois groupes de sols ont été définis par Jean-Noël Labat pour la zone Vertiente
Lerma.
- 1. Les sols peu évolués avec des profils peu différenciés. Ils correspondent à la
première étape de pédogénese, directement au dessus de la roche mère et sont ici
représentés par les lithosols et les andosols.
Lithosols (Lithosols FAO). Constitués d’un complexe organo-minéral, ces sols
très superficiels (25 cm) reposent directement sur la roche volcanique et
résultent d’un fort degré de dégradation du aux pentes dans les zones
montagneuses. Ils sont par conséquent peu propices à la croissance des
végétaux qui se limitent à des herbes et des buissons. Néanmoins la faune
peut s’y avérer nombreuse. Ils sont présents dans toute la région et sont
souvent associés à d’autres types de sol.
Andosols (Andosols FAO). Ces sols jeunes se sont formés à la faveur de la
dispersion de cendres volcaniques. Ils présentent un fort taux de verres
volcaniques et de matériaux colloïdaux45. Leur porosité leur permet une
bonne hydratation. Ils sont donc particulièrement fertiles et faciles à
travailler. Cependant, alors qu’ils sont très nombreux dans la zone Sierra, on
45
Éléments microscopique dispersés dans un solide, un liquide ou un gaz.
27
ne les retrouve qu’au sud de la zone Vertiente Lerma, autour des cerros El
Agostadero et Brinco del Diablo notamment.
- 2. Les sols à maturation humique. L’humification est le processus de transformation
de la matière organique en humus sous l’influence de micro-organismes. Ainsi, les
sols dits humiques présentent une forte concentration en carbone organique qui leur
confère une couleur foncée.
Sols isohumiques brunifiés tropicaux (Phaeozems FAO). Ce sont des sols très
riches en matière organique. Ici souvent en contact avec des vertisols et des
sols vertiques, on les retrouve dans les zones les mieux drainées.
Vertisols (Vertisols FAO). On rencontre les vertisols dans les zones où le
drainage est mauvais. La maturation et la polymérisation46 de la matière
organique y sont favorisées. Ce sont par conséquent des sols très riches en
argiles. Extrêmement durs pendant la saison sèche, extrêmement lourds (car
gorgés d’eau) pendant la saison humide, ils demandent beaucoup d’effort
pour être mis en culture, surtout en l’absence d’un outillage adéquat.
Pourtant, ils sont les plus représentés dans notre zone d’étude puisqu’ils en
occupent 70%.
Sols vertiques. Ces sols sont de deux types dans la région. Les sols
fersiallitiques vertiques (Luvisols vertiques FAO) et les sols brunifiés eutrophes
tropicaux vertiques (Vertisols chromiques FAO). Ils sont assez similaires aux
vertisols. Les premiers sont des sols intermédiaires dans leur transformation
en vertisols à proprement parler. Les seconds sont très proches des vertisols,
mais s’avèrent moins riches en argiles de part leur situation dans des zones
mieux drainées que ces-derniers.
- 3. Les sols fersiallitiques. Ils sont caractérisés par un taux élevé d’oxydes de fer qui
leur donne des colorations particulières tirant vers le rouge. Deux types sont
observables dans la région.
46
Réaction chimique qui pousse les molécules constitués de peu d’atomes (monomères) à s’assembler pour former des molécules bien plus complexes et lourdes (polymères).
28
Brunisols eutrophes tropicaux (Cambisols FAO). Ce type de sols ne se retrouve
qu’aux limites méridionales de notre zone d’étude. À savoir, au sud-ouest du
cerro El Fresno et au sud-ouest du complexe montagneux du cerro El
Agostadero. Il est tout de même important de les noter car, bien que peu de
sites en soit proches (MICH. 74 et 75 par exemple), ce sont des sols fertiles.
Sols rouges fersiallitiques tropicaux (Luvisols chromique FAO). À l’instar des
brunisols eutrophes tropicaux, ces sols se retrouvent au sud de la zone autour
des mêmes complexes montagneux. Peu nombreux mais plus proches des
sites archéologiques, il faut noter leur bonne fertilité. Néanmoins, ce sont des
sols profonds dont l’exploitation par les populations préhispaniques n’est pas
forcément aisée.
Fig.4 – Pédologie de la région de Zacapu (d’après LABAT J.-N., 1992)
29
Nous reviendrons dans notre deuxième partie sur ces différents types de sols
auxquels nous tenterons d’attribuer différents degrés de potentialité agricole. Toutefois, afin
de ne pas limiter nos définitions aux facteurs édaphologiques et climatiques que nous
venons de présenter, nous nous appuierons aussi sur les données disponibles concernant la
végétation et l’exploitation de la terre actuelles. Aussi allons-nous désormais les présenter.
F. Végétation
Nous nous appuierons là encore sur les travaux de Jean-Noël Labat qui a réalisé sa
thèse sur la végétation au nord-ouest du Michoacán47. Les résultats de ses recherches sont
aussi disponibles dans El Proyecto Michoacán48. Avant toute chose, l’auteur présente une
carte de la végétation potentielle de la région (dont nous fournissons une reproduction
vectorisée par SIG, carte 2). Il a combiné les informations pédologiques et climatiques pour
aboutir à cette représentation purement théorique qui nous sera utiles pour nous donner
une idée de l’environnement avant toute activité humaine. On pourrait penser que
l’agriculture traditionnelle préhispanique a eu une moindre importance dans la modification
du milieu que celle réalisée à partir du XVIème siècle à l’aide de l’outillage et des techniques
rapportées par les Espagnols. Ce n’est probablement pas le cas. En effet, O’Hara, Alayne
Street-Perrott et Burt49 ont montré dans leur étude du lac de Pátzcuaro que l’influence des
pratiques agricoles anciennes sur l’environnement s’est avérée bien plus importante que
l’on ne le pensait encore naguère. C’est pourquoi nous prenons aussi en considération
l’utilisation actuelle des différentes niches écologiques à l’aide des cartes de l’INEGI.
Végétation potentielle
À la suite de son étude de la pédologie et du climat de la région du projet, Jean-Noël
Labat a réalisé une carte de la végétation qui aurait du couvrir la région sans l’intervention
de l’Homme. L’auteur a simplifié afin de ne pas la surcharger. Il a choisi de ne représenter
que les espèces dominantes en mettant de côté celles qui sont trop sporadiques ou dont la
représentation dans la région est proportionnellement minime. Il a donc réduit son
47
LABAT J.-N., 1988 48
LABAT J.-N., 1992 49
O'HARA, S.L., F.A. STREET-PERROTT & T.P. BURT, 1993
30
échantillon à sept types de végétation. Cependant, nous n’en présenterons ici que cinq
puisque deux d’entre eux – la forêt d’oyamel et la végétation des coulées de lave récentes –
ne sont pas observables dans la zone Vertiente Lerma.
- Forêt tropicale caducifoliée50. Ce type de végétation est potentiellement le
plus répandu de la région avec une couverture de 1175 km² (cf. fig.5 ci-
dessous). Pourtant, l’anthropisation du milieu l’a presque fait complètement
disparaître. Seul persiste un minuscule noyau au sud-ouest du Zináparo (non
représenté sur la carte de part l’exceptionnalité de l’échantillon). Le reste de
l’espace normalement couvert par ce type de végétation est aujourd’hui
principalement occupé par des pâturages et buissons sur lesquels nous
reviendrons après. La forêt tropicale caducifoliée du Michoacán correspond à
une forêt basse avec une canopée ne dépassant pas les 8 à 10 mètres. Sous
cette première strate, on en distingue une seconde composée d’arbustes de 1
à 2 mètres. Enfin, on retrouve une strate d’herbacées pouvant atteindre 60
centimètres.
- Forêt de pin. Comme son nom l’indique, ce type de végétation est caractérisé
par la prédominance d’une ou plusieurs espèces de pins. La canopée atteint
en moyenne 15 à 25 mètres. On observe souvent une deuxième strate, plus
basse, plafonnant entre 8 et 12 mètres, constituée d’espèces latifoliées51
caducifoliées ou semi-sempervirentes52. Une troisième strate d’arbuste
atteint 2 à 3 mètres. La strate d’herbacées ne dépasse pas le mètre de haut.
- Forêt de chêne. On y retrouve une prédominance d’une ou, plus
généralement, plusieurs espèces de chênes. La canopée atteint 10 à 15
mètres pour la strate supérieure. La strate arbustive fait 2 à 3 mètres et celle
d’herbacées moins d’un mètre.
- Végétation aquatique. C’est bien entendu la végétation que l’on retrouve
aux abords des cours et des plans d’eau. Ces zones sont difficilement
50
Qualifie les arbres à feuilles caduques. Par extension, défini une forêt présentant des espèces de ce type. 51
Qui a des feuilles larges. 52
Une espèce sempervirente ne perd pas ses feuilles à la mauvaise saison. Une espèce semi-sempervirente perd ses feuilles pour une période de temps très courtes alors que les nouvelles feuilles poussent déjà.
31
exploitables sans avoir recours à des opérations de drainage importantes. Les
recherches antécédentes n’ayant pu identifier aucun aménagement
préhispanique de ce type, nous ne prendrons pas compte de ces espaces dans
la suite de notre étude. Nous nous limiterons simplement à leur mention.
- Forêt d’épineux. Ce dernier type est hypothétique. En effet, quelques
individus isolés laissent penser que la forêt d’épineux a pu constituer la
végétation originelle des grandes vallées comme celle du rio Lerma à
l’extrême nord de la région étudiée. Cependant, ces zones ont été
extrêmement modifiées par l’Homme. D’énormes travaux d’irrigation,
postérieurs à l’époque préhispanique ont transformé le paysage en une
mosaïque de champs cultivés, qui n’a donc plus rien à voir avec le milieu
ancien. Ces données sont par conséquent très épineuses et difficiles à
exploiter.
Type de végétation
Superficie potentielle en km²
% Superficie actuelle en km²
%
Forêt d’oyamel 2 0,09 2 0,09
Forêt de pin 344 15,09 219 9,61
Forêt de chêne 581 25,48 191 8,38
Forêt tropicale caducifoliée 1175 51,54 1 0,04
Végétation sur coulées de lave 16 0,70 16 0,70
Végétation aquatique (et plans d’eau)
81 3,55 17 0,75
Forêt d’épineux 81 3,55 0 0
Mosaïque de buissons et pâturages 0 0 793 34,78
Agriculture pluviale 0 0 774 33,95
Agriculture irrigée 0 0 267 11,71
Total 2280 100 2280 100 Fig.5 – Superficies potentielle et actuelle des types de végétation (d’après LABAT J.-N., 1992)
Histoire d’anthropisation et utilisation actuelle des sols
La végétation présentée ci-dessus est théorique. Aussi, lorsque que l’on passe à
l’observation directe sur le terrain, la réalité est toute autre. Dès les premières occupations
humaines, l’environnement a été modifié en profondeur. Nous verrons dans le chapitre
suivant que la colonisation de la région par des groupes de cultivateurs sédentaires
32
commence probablement dès le VIIème siècle de notre ère. C’est donc vraisemblablement à
cette époque que sont réalisées les premières démarches d’appropriation du milieu. Que ce
soit pour construire leurs habitations, façonner leurs outils, ou plus simplement pour mettre
en culture certains espaces, les hommes préhispaniques ont coupé les arbres dont ils avaient
besoin ou qui entravaient leur expansion agricole. Ils ont construit des terrasses sur les
pentes des monts pour y installer maisons et champs et ont ainsi commencé le remodelage
de leur environnement. Cette dynamique, initiée il y a plus de 1300 ans, est toujours
d’actualité et s’est même amplifiée avec l’introduction des animaux de trait après la
Conquête, et plus encore avec la mécanisation du travail au cours des deux derniers siècles.
En l’absence d’une reconstitution de l’environnement à l’époque préhispanique, il
nous a paru judicieux de nous intéresser un tant soit peu à l’usage des sols à l’époque
actuelle. En effet, le paysage présent peut garder des traces du paysage passé. Pour ce faire,
nous nous appuierons sur trois sources principales. D’abord, la suite du travail de Jean-Noel
Labat qui, en identifiant la végétation de la région, a bien entendu proposé une étude du
milieu actuel. Parallèlement, nous prendrons en compte les recherches d’Olivier Gougeon
sur le paysage du nord du Michoacán53. Enfin nous utiliserons aussi les cartes réalisées par
l’INEGI entre 1981 et 199654, ainsi que le logiciel Google Earth qui nous permettra de vérifier
et comparer les zones cultivées, forêts et pâturages sauvages.
Sur les cinq espaces écologiques mentionnés pour la végétation potentielle, certains
ont complètement disparu et d’autres ont considérablement régressé à la faveur de deux
nouveaux types de paysages. Les champs cultivés et une mosaïque de buissons et de
pâturages sauvages. Comme on l’a déjà évoqué, la forêt tropicale caducifoliée qui devait
couvrir la majorité de la région avant l’arrivée de l’Homme est aujourd’hui pratiquement
inexistante. Des 1175 km² (plus de 50 % de l’environnement) qu’elle a du occuper, il ne reste
qu’environ 1 km² (moins de 1 %) au sud-ouest du Zináparo. À l’instar des autres types de
végétation théoriques, elle a été progressivement supplantée par les zones agricoles qui ont
nécessitées des démarches de déforestation. À leur suite, les champs nouvellement ouverts
ont été exploités par les générations successives depuis l’époque préhispanique jusqu’à nos
jours. Cependant, les espaces choisis n’ont sans aucun doute pas été les mêmes selon les
53
GOUGEON O., 1991 : 53-101 54
Confère INEGI dans « références internet »
33
moyens que l’agriculteur avait à disposition. Ses bras, ses bœufs, ou un tracteur bien huilé.
Quoi qu’il en soit, après la déforestation et l’abandon des champs, les chances de
régénération de la végétation originelle sont extrêmement minces et c’est bien souvent un
nouvel écosystème qui se met en place. Aujourd’hui, la végétation est divisée en huit
espaces distincts (cf. carte 3).
Les données concernant la végétation sont difficilement exploitables. L’une est
théorique. L’autre trop récente et anthropisée pour correspondre à l’environnement ancien.
Nous essaierons tout de même d’en tirer quelques conclusions dans notre étude. Nous
manquerons cependant de connaissances pour obtenir des résultats pertinents.
34
- CHAPITRE 3 -
PPPPÉRIODISATION, CHRONOLOGIE ET ÉVOLUTIONS CULTURELLES
A. Présentation générale
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, le projet Michoacán commence une
investigation dans la région de Zacapu sur des connaissances très minces. Afin de pouvoir
comparer cette zone avec le reste de l’occident et, a fortiori, le reste de la Mésoamérique, il
était fondamental d’établir une chronologie et de mettre en place une périodisation. Sauf
quelques exceptions, comme le travail d’Isabel Kelly pour Autlan de 194555, la plupart des
périodisations pour l’occident du Mexique ont été constituées entre les années 1970 et
1980. Par exemple, Beatriz Braniff élabore celle du Guanajuato en 197256, revue en 1989 par
Carlos Castañeda et al.57 En 1972 toujours, Helen Pollard en présente une pour le Michoacán
central (région de Patzcuáro)58, retravaillée en 1982 par Román Piña Chan et Kuniaki Oi59,
puis par Linda Manzanilla en 198460.
Pour la région de Zacapu, c’est l’équipe du CEMCA qui conçoit la chronologie à partir
du matériel collecté et excavé, complété d’une vingtaine de datation 14C. Quatre phases
principales sont alors définies61. Ce sont Loma Alta, Lupe, Palacio et Milpillas. La première
phase est divisée en trois étapes successives et la seconde en deux. Deux interphases, reflet
de périodes de transition culturelle, ont été définies. Jaracuaro, entre Loma Alta et Lupe et
La Joya entre Lupe et Palacio. Nous les présentons ci-après:
55
KELLY I., 1945 56
BRANNIF B., 1972 57
CASTAÑEDA C . et al., 1989 58
POLLARD H.P. 1972 59
PIÑA CHAN R. & K. OI, 1982 60
MANZANILLA L., 1984 61
MICHELET D., 1992
35
100 av. J.-C. – 100 apr. J.-C.
Loma Alta 1
100 apr. J.-C. - 350 apr. J.-C.
Loma Alta 2
350 apr. J.-C. - 450 apr. J.-C.
Loma Alta 3
450 apr. J.-C. – 500 apr. J.-C.
Jaracuaro
500 apr. J.-C. - 800 apr. J.-C.
Lupe Temprano/Reciente
800 apr. J.-C. - 850 apr. J.-C.
La Joya
850 apr. J.-C. - 1200 apr. J.-C.
Palacio
1200 apr. J.-C. – 1500 apr. J.-C. Milpillas
Fig.6 – Séquence chronologique de la région de Zacapu (d’après MICHELET D., 1992)
Il faut néanmoins préciser l’existence de vestiges datés de période archaïque qui
remontent à plus de 2500 av. J.-C.. Cette phase, mal cernée au vu du peu de données, a été
appelée Los Portales, en référence à l’un des sites les plus important de la période, l’abri-
sous-roche Cueva de Los Portales (MICH. 389).
Replacée dans une chronologie plus générale de la Mésoamérique, Loma Alta puis
Jaracuaro correspondent au préclassique et au début du classique. Soit à la fin de la phase
Chupicuaro62 dans la région du bajio au nord-est. Parallèlement, c’est aussi la mise en place
et le début de l’expansion de Teotihuacan dans le bassin de Mexico (de la phase Patlachique
au début de Xolalpan)63. Lupe équivaut au classique récent et est donc contemporaine des
derniers instants du déclin après l’effondrement de la « cité des dieux » dans le haut plateau
central (Phases Xolalpan et Metepec)64. C’est aussi à cette époque que le mode de société
62
TALADOIRE E. & B. FAUGÈRE-KALFON, 1995 63
TALADOIRE E. & B. FAUGÈRE-KALFON, ibid. 64
COWGILL G.L., 2008 : 85 dans SANDERS W.T. et al., 2008
36
mésoaméricain connait un mouvement d’expansion vers le nord et ce jusqu’au IXème siècle65.
Les sites de La Quemada et Chalchihuites dans la Zacatecas atteignent alors leurs apogées66.
L’éloignement parait conséquent, mais mérite d’être mentionné dans la mesure où ces
cultures procèdent sans doute d’un même mouvement architectural que celui que l’on
retrouve à San Antonio Carupo (MICH. 103) dès le IXème siècle de notre ère67. Lupe Reciente,
La Joya et le début de Palacio, fin du classique et début du postclassique, sont
contemporains de l’émergence des nombreuses cités qui fleurissent dans le bassin de
Mexico après la chute de Teotihuacan (Cacaxtla, Cholula…)68. On notera particulièrement la
création de Tula et l’apparition avec elle de la civilisation toltèque dans la mesure où elle a
été considérée comme moteur du développement de l’occident. La réalité est probablement
tout autre puisque les traits toltèques sont probablement nordiques, issu de styles qui se
sont développés en Zacatecas69. En effet, à cette même période, la frontière nord de la
Mésoamérique, dont on a mentionné la montée au classique, commence à régresser pour se
fixer aux bordures des états Tarasque et Aztèque qui émergent entre le XIVème et le XVème
siècle. Avec cette redescente, les populations du nord rapportent avec elles plusieurs siècles
d’évolutions stylistiques développées dans des états qui redeviennent les territoires des
nomades, les Chichimèques des Aztèques70. La phase Milpillas correspond donc finalement à
la consolidation du postclassique dans le reste du monde mésoaméricain. Si l’on suit la
mythologie, les Mexica quittent alors Aztlan pour le bassin de Mexico et y fonde l’Empire
aztèque71. Au même moment, quelques centaines de kilomètres à l’ouest, les uacúsecha
investissent le bassin de Pátzcuaro après une escale à Zacapu. Ils y créeront le royaume
Tarasque72. Au-delà des mythes, peut-être voit-on ici le reflet déformé du déplacement de la
frontière nord évoqué plus haut.
65
BRANIFF B., 2000 : 159-190 dans MANZANILLA L. & L. LÓPEZ LUJÁN, 2000 66
ELLIOTT M., 2005 67
FAUGÈRE B., 1991 : 55-58 68
TALADOIRE E. & B. FAUGÈRE-KALFON, ibid. : 63 69
HERS M.A., 1989 dans TALADOIRE E. & B. FAUGÈRE-KALFON, ibid. 70
BRANIFF B., 1989 71
DURANT-FOREST J. de, 2008 : 39-43 72
MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON, 2005
37
B. Dynamiques culturelles dans la région de Zacapu
La région de Zacapu semble présenter un exemple concret de la fluctuation de la
frontière de la Mésoamérique73. En effet, la chronologie des occupations, l’architecture, et
les styles céramiques, confortent la thèse d’un mouvement progressif des populations du
nord vers le sud74. Alors que les sites de la zone méridionale de l’aire géographique étudié
par le CEMCA datent du postclassique dans leur majorité, ceux de Vertiente Lerma sont plus
largement datés du classique.
Le malpaís de Zacapu, situé au nord-ouest de la ville actuelle, est particulièrement
riche en vestiges de structures préhispaniques. Pourtant, les malpaís, dont l’étymologie
espagnole n’est pas trompeuse (mal = mauvais ; país = pays), ne sont guère propices à
l’installation humaine. Constitués d’anciennes coulées de laves, ils sont très peu adaptés à la
mise en place d’une agriculture efficace. C’est cependant là que décident de s’implanter les
populations tarasques du postclassique peu après 1250 apr. J.-C.(phase Milpillas), qui
n’hésitent pas à déplacer d’impressionnantes quantité de terre pour nivelé l’espace et le
rendre apte à la construction. On y retrouve les plus gros sites comme El Infiernillo, qui
couvre 140 hectares et présente 1150 structures d’habitation et 22 temples-pyramides, ou El
malpaís Prieto, qui s’étend sur 50 hectares avec presque 1000 fondations de maisons et 14
temples-pyramides75. À la même époque (phase Tariacuri), à une trentaine de kilomètres au
sud-est, le bassin de Pátzcuaro connait une certaine effervescence avec la mise en place
successive des grands centres tarasques d’Ihuatzio, Pátzcuaro, Urichu, Erongarícuaro et
Tzintzuntzan76. Ce bouillonnement culturel reflète l’émergence de l’État tarasque qui sera
plus tard centralisé autour de sa dernière capitale, Tzintzuntzan.
À la fondation relativement brutale des sites du malpaís de Zacapu, correspond
probablement un phénomène de colonisation à la suite d’un mouvement de population. La
contemporanéité entre la disparition d’une grande partie des sites de la région Vertiente
Lerma et le peuplement de ceux du malpaís, laisse penser que les occupants des premiers
sont les fondateurs des seconds77. On aurait ainsi déplacement des populations depuis le
73
FAUGÈRE B., 1996 : 133-140 74
MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON, 2005 75
MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON, 2005 76
POLLARD H.P., 2003 77
MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON, 2005
38
versant du Lerma vers le malpaís en l’espace de quelques décennies. Cette hypothèse
semble être vérifiée par la continuité typologique des artefacts et de l’architecture.
Cependant, ces styles, tant mobilier, qu’immobilier, peuvent aussi être observés plus au
nord comme dans le Cerro Barajas78. Région qui, parmi d’autres, est elle aussi dépeuplée à la
fin du classique. Il est donc possible que les colons du malpaís viennent de régions plus
septentrionales, au nord du Lerma. De plus, on observe certaines innovations dans les sites
postclassiques de la zone Sierra que l’on ne retrouvait pas dans les établissements plus
anciens. Ce sont par exemple les plans des soubassements pyramidaux, rectangulaire à
l’épiclassique, qui deviennent plus généralement carrés, au postclassique.
On constate aussi une recrudescence des sites à vocation défensive. El malpaís Prieto
présente par exemple de hautes terrasses dont la fonction n’est probablement pas
purement esthétique79. De même l’installation volontaire des sites dans le malpaís répond
surement à un besoin de protection. L’avantage stratégique est évident de part la situation
surélevé permettant une bonne vision sur la vallée septentrionale et la difficulté du terrain
constitué de champs de pierres volcaniques et de végétation sèche. Ce type d’implantation
des sites répond à une logique qui été qualifié de « stratégie à bas-coût pour la dissuasion et
la défense »80. Un état de stress que l’on ressent déjà dans les occupations épiclassiques de
la zone Vertiente Lerma. On notera particulièrement Las Lajas (MICH. 400), daté de la phase
Palacio, entouré d’un mur de protection dont l’épaisseur peut aller jusqu’à trois mètres par
endroits81. On voit peut-être ici de façon concrète le reflet de la mise en place de la frontière
entre le monde sédentaire tarasque et celui, nomade, de ceux que les Aztèques appelleront
les Chichimèques (les « chiens sales »).
C. Évolutions culturelles au sud du Lerma
Après une occupation sporadique de sites en grotte (Cueva de Los Portales) à
l’époque archaïque, le versant sud du Lerma est dépeuplé pendant environ deux
millénaires82. Ce n’est qu’à la phase Lupe que l’on observe une nouvelle vague de
peuplement autour de 600 apr. J.-C.. L’occupation est ensuite continue jusqu’au
78 PEREIRA G., D. MICHELET & G. MIGEON, 2007 79
MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON, 2005 80
ELLIOTT M., 2005 81
FAUGÈRE B., 1996 : 60-61 82
FAUGÈRE B., 2006
39
postclassique mais répond successivement à des modifications dans son organisation que
nous allons détailler ici83. C’est dans le cadre de ce second peuplement des phases Lupe, La
Joya, Palacio et Milpillas que s’inscrit notre étude. En effet, nous nous intéresserons à la
continuité culturelle de cette période en mettant de côté la phase Los Portales pendant
laquelle les occupations sont ponctuelles. De plus, on ne peut parler d’homogénéité
culturelle quand un hiatus de deux millénaires sépare les deux époques.
La présentation de l’évolution de l’organisation spatiale des sites est ici faite en
suivant substantiellement la dernière description en date réalisée en 2009 par Brigitte
Faugère84. La typologie des établissements est donc celle que l’on a évoquée dans le premier
chapitre. Soit « hameaux », « villages », « centres » et « autres ». Pour chaque phase (Lupe,
La Joya et Palacio), des regroupements de sites ont été définis par l’auteur. Ils se basent sur
les distances mesurées entre les sites et leurs situations dans l’environnement. Nous devons
enfin préciser que les 102 sites n’ont pas tous pu être datés, faute de données. 25 n’ont pu
être replacés dans une phase, soit environ 1/4 du corpus. Parmi eux, on compte 7 grottes et
abris-sous-roche (MICH. 110, 149bis, 366, 390, 391, 395, 405), 9 hameaux (MICH. 45, 114,
134, 330, 342, 343, 362, 364, 365), 2 villages (MICH. 47, 129), 3 zones de taille (MICH. 99,
130, 361), 1 cimetière (MICH. 37) et 3 sites dont la nature n’a pu être identifiée (MICH. 341,
359, 396). Il est donc important de ne pas perdre de vue ces problèmes.
Phase Lupe (700-800/850 apr. J.-C.) (cf. carte 4)
L’occupation commence donc à la phase Lupe reciente, soit autour de 700 apr. J.-C..
Le peuplement rapide débouche sur 28 sites archéologiques connus, lesquels semblent
regroupés en quatre entités plus ou moins indépendantes.
- Versant sud du Cerro El Metate. Ce premier groupe au sud de la région d’étude est
composé de cinq sites. Les deux centres MICH. 50 et 51, le village MICH. 136 et les
hameaux MICH. 138 et 368. À ces établissements, proches les uns des autres, ont été
ajoutés le hameau MICH. 135, plus à l’est, et MICH. 103 qui présente une phase
d’occupation Lupe. Ce-dernier est défini comme centre pour les phases postérieures,
83
FAUGÈRE B., 1996 : 125-140 84
FAUGÈRE B., 2009
40
mais ne peut être qualifié comme tel à la phase Lupe en raison de l’incertitude
concernant son importance à cette phase.
- Versant sud du Cerro Prieto. Un peu plus au nord, sur les pentes du Cerro Prieto,
quatres sites composent ce second groupe. Les villages MICH. 111 et 113 et les
hameaux MICH. 109 et 401. Un cinquième établissement, le village MICH. 115, fait
possiblement partie de la même entité.
- Vallée de Los Frenos-Penjamillo. Les villages MICH. 104, 147 et 148, ainsi que le
hameau MICH. 146, composent ce troisième groupe. Un deuxième hameau, celui de
MICH. 145, se trouve de l’autre côté de la vallée à l’est. Néanmoins, il n’est pas
clairement associé aux quatre autres.
- Vallée du rio Angulo. Enfin, dans la vallée du rio Angulo, à l’est de la zone d’étude,
deux sites constituent le quatrième et dernier groupe. C’est le village MICH. 78 et le
hameau MICH. 80.
-Vallée du Lerma. À ces quatre groupes, on peut ajouter les sites MICH. 398, 402 et
40385, situés plus au nord dans la vallée du Lerma. Il n’ont pas été intégrés dans une
entité pour la simple et bonne raison que l’échantillon des sites dans cette partie de
la région n’est pas assez conséquent.
Tous ces groupes sont interprétés comme des « entités économiques et sociales
autonomes »86. Chacun possédant son propre territoire de chasse, dans les forêts de pins et
de chênes environnantes, et d’activité agricole, sur les pentes des monts de la région comme
le montrent les réseaux de terrasses. L’environnement semble alors être le facteur
fondamental lié à l’implantation. Néanmoins, certaines vallées sont presque inoccupées,
comme celle entre le Cerro Prieto et le Cerro Blanco ou celle du rio Angulo avec seulement
deux établissements. L’hypothèse d’un pouvoir décisionnel au sein de chaque groupe
influençant les populations à s’installer dans des endroits précis a donc été émise. Toutefois,
il est archéologiquement très difficile d’identifier de telles entités. Des indices résident dans
les structures civico-cérémonielles qui ont été découvertes à MICH. 50 et 51 par exemple.
85
L’article mentionne MICH. 398, 401 et 402. Néanmoins, MICH. 401 se trouve plus au sud, sur le versant sud du Cerro Prieto, et ne fait donc pas partie de la vallée du Lerma. Nous avons donc corrigé ce qui doit être une faute de frappe par MICH. 403, lequel répond à la description concernant la situation géographique des sites. 86
FAUGÈRE b., 2009 : 193
41
Il faut enfin préciser que parmi les 28 sites, seulement 22 ont été intégrés dans les
entités susmentionnées. Trois sont des grottes et abris-sous-roche (MICH. 149, 360 et 389)
dont le rattachement à un groupe de sites est assez difficile de part le caractère
essentiellement temporaire de l’occupation de ces espaces au Classique. L’étude de la Cueva
de Los Portales (MICH. 389) a en effet permis de mettre en évidence que les traces laissées
par les populations des phases Lupe, La Joya et Palacio, sont relativement rares. Elles
correspondent probablement à des occupations en périodes de chasse ou pour la pratique
de rituels. Parmi le reste des six sites non pris en compte, MICH. 141 est un hameau mais
sont rattachement à la phase Lupe n’est pas sûr. MICH. 75 est probablement un hameau
aussi mais, à l’instar de sa nature, sa périodisation Lupe est incertaine. Enfin, MICH. 388 date
bien de cette époque mais n’a pas pu être intégré dans la typologie et reste donc hors des
groupes constitués ci-dessus.
La phase suivante, La Joya, voient la réorganisation spatiale de la région à la faveur
d’une croissance démographique reflétée par la multiplication du nombre de sites. Ce
nouvel agencement sera perpétué pendant la phase Palacio où il se consolidera. Malgré
cette continuité culturelle, il faut préciser que la périodisation céramique sépare ces deux
phases.
Phase La Joya (800/850-900/950) (cf. carte 5)
On dénombre alors 37 sites connus. Les vallées auparavant vides sont occupées. Le
peuplement se répand dans toute la région. Quatre entités ont clairement été identifiées
mais 13 sites (MICH. 74, 111, 112, 115, 143, 146, 149, 360, 363, 388, 389, 398 et 402) n’ont
pas encore été rattachés à des groupes. Nous allons d’abord présenter les entités identifiées.
Puis nous reviendrons sur les 13 sites susmentionnés.
- Vallée du rio Angulo. La vallée qui, rappelons-le, ne contenait que deux sites lors de
la phase Lupe, est alors peuplée par huit sites, auxquels s’ajoutent peut-être deux autres
non-datés. On dénombre quatre hameaux, MICH. 79, 331, 333 et 336 (peut-être cinq avec
MICH. 337), et quatre villages, MICH. 78, 81, 82 et 332 (MICH. 338 constitue peut-être un
cinquième).
42
- Versant ouest du Cerro El Metate. Alors que le versant méridional regroupe les
occupations à la phase précédente, les sites s’organisent alors le long du versant occidental.
Il est constitué de quatre villages, MICH. 139 en position défensive, MICH. 142 agrémenté
d’un espace civico-cérémoniel important, ainsi que MICH. 140 et 399. Cependant, une
incertitude persiste pour les deux derniers.
- Vallée de Bellavista-Epejan. Cette vallée, peu peuplée pendant Lupe (exception faite
de MICH. 136), voit l’émergence de trois villages, MICH. 108, 137 et 385, et deux hameaux,
MICH. 106 et 107. Le groupe est donc composé de six sites.
- Cerro El Agostadero. On trouve ici le centre monumental de San Antonio Carupo
(MICH. 103), qui prend alors toute son ampleur. Plus à l’est, MICH. 48 constitue un second
centre et à l’ouest enfin, le village de MICH. 102 fait probablement son apparition pendant la
phase La Joya.
À la lumière de ces informations, on constate un remodelage complet de la région.
L’auteur émet l’hypothèse qu’elle traverse alors une période de stress dans la mesure où la
tendance à la monumentalité se fait plus forte. À l’est les sites s’organisent autour de l’accès
à l’eau que procure le rio Angulo. Au sud-ouest, les établissements se réorganisent avec
l’émergence de San Antonio Carupo. Des sites défensifs, comme MICH. 139 sur la cime du
Cerro El Metate, font leur apparition.
Cependant, treize autres sites contemporains doivent être mentionnés. Les
regroupements qui suivent sont purement arbitraires et ont été constitués, non pas via
l’identification de liens entre les sites, mais dans un souci de clarté dans notre présentation.
- Versant sud du Cerro El Fresno. Seul, le probable hameau de MICH. 74 semble un
peu excentré. Peut-être est-il à rapprocher des sites de la zona sierra plus au sud.
- Vallée de Los Fresnos-Penjamillo. À l’ouest de la région Vertiente Lerma, deux sites
ont été identifiés aux abords du lac Los Fresnos. Au nord-ouest du lac, on trouve le hameau
isolé MICH. 146. Au sud-est, la grotte de MICH. 143. Dans la large vallée qui s’étale au nord
du lac jusqu’à Penjamillo, cinq sites sont connus pour la phase La Joya. On dénombre trois
grottes, MICH. 149, 360 et 389 (Cueva de Los Portales), un hameau isolé au nord-est de la
ville actuelle de Penjamillo, MICH. 398, et MICH. 388, dont la nature reste inconnue.
43
- Corridor Cerro El Metate-Cerro Prieto. Sur le versant nord du Cerro El Metate, on
rencontre les deux villages de MICH. 115 et MICH. 363. À l’est de ces-derniers, on trouve le
village MICH. 111 sur les hauteurs du Cerro Prieto et le hameau MICH. 112 en bas du versant
sud du même mont.
- Vallée du Lerma. Alors que MICH. 403 semble abandonné, le hameau de MICH. 402
est toujours occupé. Parallèlement, c’est l’émergence du centre de MICH. 150 avec ses
constructions monumentales.
Phase Palacio (900/950-1200 apr. J.-C.) (cf. carte 6)
Comme on l’a déjà évoqué, la phase Palacio correspond à une période de
consolidation du remodelage qui s’opère en phase La Joya. On dénombre 40 sites datés de
cette époque.
- Vallée du rio Angulo. Des dix sites qui peuplaient cette vallée pendant La Joya, seuls
trois continuent d’être occupés en phase Palacio : les villages de MICH. 78 et 332 et le
hameau MICH. 79. À ces trois-là viennent s’ajouter trois nouveaux sites. Les hameaux MICH.
77 et 334, respectivement voisins de MICH. 78 et MICH. 79. Enfin, le village de MICH. 339 fait
son apparition au sud sur le versant septentrionale du Cerro El Brinco del Diablo.
- Versant ouest du Cerro El Metate. Cette zone, occupée par quatre sites auparavant
est alors dépeuplée.
- Vallée de Bellavista-Epejan. À l’instar de ce que l’on observe dans la vallée du rio
Angulo, quatre des six sites qui peuplaient la vallée de Bellavista-Epejan pendant La Joya ne
sont plus occupés. Seuls les villages de MICH. 136 et 137 se maintiennent. Le hameau MICH.
368 est réoccupé et quatre nouveaux sites sont créés. Au sud de la zone, un village et un
hameau, respectivement MICH. 46 et MICH. 367. Au nord, deux villages, MICH. 160 et MICH.
400, premier site réellement fortifié de la région, puisqu’il présente un mur d’enceinte
englobant pratiquement toutes ses structures.
44
- Cerros El Agostadero, de Enmedio et El Cuije. Aux trois sites qui occupaient déjà la
région pendant La Joya (MICH. 48, 102 et 103) viennent s’ajouter trois nouveaux sites
proches des sommets. Ce sont les trois hameaux MICH. 131, 132 et 133.
- Vallée de Los Fresnos-Penjamillo. Alors que la vallée est relativement peu peuplée
pendant la phase La Joya, Palacio voit l’émergence de nouveaux sites. Les quatre grottes
(MICH. 143, 149, 360 et 389) sont toujours occupées et cinq autres viennent compléter la
liste (MICH. 358, 392, 393, 394, et 406). Les hameaux de MICH. 146 et 398 continuent eux-
aussi d’être habités et deux nouveaux apparaissent (MICH. 144 et 397). Les villages de MICH.
147 et 148, occupés en phase Lupe mais pas en phase La Joya, sont habités de nouveau et on
observe la création d’un troisième, MICH. 357. Le village de MICH. 363 est probablement à
rattaché à cette vallée. Enfin, MICH. 388 est toujours occupé à la phase Palacio, sans pour
autant que sa nature n’ait pu être identifiée. Brigitte Faugère identifie une entité constituée
des sites MICH. 144, 146, 147, 148 et 357.
- Vallée du rio Lerma. Sans pouvoir parler de groupe de sites au vu du faible
échantillon, le hameau de MICH. 402 continue d’être habité et celui de MICH. 403 est
réoccupé après avoir été délaissé pendant la phase La Joya. Enfin, notons que l’auteur a
proposé de lier le hameau MICH. 398 (ici inclus dans la vallée de Los Fresnos-Penjamillo) à
ces deux sites.
- Cerro Prieto. MICH. 112 n’est plus occupé et seul subsiste alors le village MICH. 111
sur les hauteurs du Cerro Prieto.
C’est là que s’arrête l’analyse de la répartition spatiale des sites de la région Vertiente
Lerma proposé par Brigitte Faugère en 2009. Pour présenter la dernière phase
chronologique (Milpillas), nous nous appuierons donc sur des données plus anciennes issues
de la thèse du même auteur87, ainsi que sa publication de 199688.
87
FAUGÈRE B., 1990 88
FAUGÈRE B., 1996
45
Phase Milpillas (1200-1500 apr. J.-C.) (cf. carte 7)
Cette ultime période d’occupation de la région correspond sans doute à une phase
d’abandon probablement liée à des mouvements de population. Il a été proposé que les
groupes humains qui habitaient Vertiente Lerma se déplacent alors plus au sud dans le
malpaís de Zacapu, alors florissant89. Seulement 20 sites sont connus. La plupart des
occupations de la phase Palacio sont abandonnées au profit de quelques créations
nouvelles. Il se peut que la région serve alors de relais pour l’accès à l’obsidienne des
gisements du Cerro Zinaparo au nord-ouest90, matière première d’une grande importance
pour la société Tarasque qui émerge alors. L’étude de la Cueva de Los Portales a montré
qu’après une occupation d’époque Tarasque à des fins probablement rituelles caractérisées
par des vestiges de pipes, les grottes de la région sont réutilisées par des groupes de
chasseurs-cueilleurs. En effet, de petites pointes de flèches typiques des périodes récentes
laissent supposer l’occupation par des groupes Chichimèques et Guamares. Le sud de la zone
Vertiente Lerma correspond donc peut-être à l’expression de la mise en place de la frontière
nord du royaume Tarasque.
- Vallée du rio Angulo. Des nombreux sites qui peuplaient cette vallée, il ne subsiste
guère que le hameau MICH. 77. À celui-ci s’ajoutent deux hameaux qui apparaissent alors,
MICH. 335 et 340.
- Vallée de Bellavista-Epejan. Cette vallée est elle-aussi désertée. MICH. 400, village
fortifié, reste en place, peut-être dans le contexte de stress lié à la consolidation de la
frontière. Parallèlement, le village de MICH. 385 est réoccupé, après avoir été apparemment
abandonné pendant la phase Palacio.
- Cerros El Agostadero, de Enmedio et El Cuije. Alors que MICH. 48, 102 et 133 ne
sont plus occupés, MICH. 103 et les deux hameaux MICH. 131 et 132 continuent de l’être. À
l’ouest, le village MICH. 101 fait son apparition, ainsi que MICH. 100, une zone de taille
couplée d’un cimetière. À l’est, le centre de MICH. 49 est mis en place.
-Vallée de Los Fresnos-Penjamillo. Là encore le mot d’ordre est désertion. Les abords
du lac de Los Fresnos ne sont plus occupés que par le hameau MICH. 145, lequel n’avait pas
89
MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON, 2005 90
DARRAS V., 1999
46
été habité depuis la phase Lupe. Au nord, les hameaux et villages sont laissés à l’abandon.
Seules quelques grottes présentent encore des niveaux d’occupation. Ce sont MICH. 149,
358, 360, 389, 392 et 393.
-Cerro Prieto. MICH. 113, village daté de Lupe, est réoccupé, alors que MICH. 111
n’est plus habité.
-Vallée du rio Lerma. Les sites de cette vallée sont eux aussi abandonnés.
-Cerro El Fresno. Enfin, sur le versant oriental du Cerro El Fresno, on rencontre le
hameau MICH. 76 qui présente aussi un cimetière. Il est peut-être à rapprocher des sites
plus au sud.
C’est donc sur une séquence chronologique de près d’un millénaire que nous allons
travailler. Arrivées probablement depuis le nord, de nouvelles populations d’agriculteurs
sédentaires colonisent le versant sud du Lerma au début du VIIIème siècle de notre ère.
Plusieurs générations s’y succèdent sans changer fondamentalement la place de leurs
établissements, mais évoluant plutôt au sein des quelques vallées dans lesquelles elles
s’intègrent parfaitement. Les quatre siècles suivants (IX-XIIème siècles) reflètent sans doute
une période de forte croissance démographique. Pourtant, au tournant du XIIIème siècle apr.
J.-C., la région se vide de ses habitants qui continuent alors probablement leur descente vers
le sud initiée sept siècles plus tôt. Sont-ils appelés au sud par l’émergence du royaume
Tarasque ? Font-ils partie des fondateurs de cet État ? Sont-ils acculés au nord par les
Chichimèques nomades ? Quels que soient les motifs qui les ont poussés à s’installer dans la
région comme à la quitter, ces communautés paysannes ont nécessairement du choisir,
préparer et entretenir des terres agricoles pour leur subsistance pendant ces huit siècles
d’occupation. Quelles terres ont été choisies ? Y’a-t-il seulement eu choix ? Pour tenter de
répondre à ces questions, nous allons maintenant expliquer la méthodologie que nous avons
suivie pour tenter d’identifier ces espaces privilégiés et ainsi d’apporter un soupçon
d’informations nouvelles sur la vie de ces hommes du Nouveau Monde.
47
DEUXIÈME PARTIE – LA VIE DES CHAMPS AU SUD DU LERMA ENTRE LES VIIIème ET XVème
SIÈCLES : ÉBAUCHE D’ANALYSE DES TERRITOIRES D’EXPLOITATION AGRICOLES
48
- CHAPITRE 4 -
CCCCHOIX ET PRÉSENTATION DU CORPUS
Quand les hommes préhispaniques ont pour la première fois foulé du pied les terres
du sud du Lerma, ils ont très vite du commencer l’édification de leurs villages. C’est depuis
ceux-ci qu’ont alors été rythmées leurs vies d’agriculteurs. Nous suivrons leur exemple et
partirons donc des villages pour aller aux champs. En des termes moins poétiques, nous
allons ici présenter le corpus des sites archéologiques qui servira de fondation à notre étude.
A. Typologie des sites
Avant de présenter l’échantillon que nous avons sélectionné, il convient de revenir
sur quelques points qui ont orientés notre choix. Tout d’abord, il a fallut opter pour une
typologie. Après des essais infructueux, les informations glanées dans la bibliographie se
sont avérées insuffisantes pour réviser efficacement les typologies préexistantes. Aussi
avons-nous préféré garder tel quel celle proposée par Brigitte Faugère. Dans sa thèse,
l’auteur définissait sept catégories, réduites à quatre dans son article de 200991. Nous avons
choisi de suivre cette seconde interprétation dans une optique de simplification et en raison
de la trop grande incertitude qui plane parfois sur l’identification de sites détériorés.
Arrêtons-nous ici sur chacun des types.
Hameaux. Ce sont les groupes comprenant relativement peu de structures (entre
deux et douze fondations d’habitations). Elles sont de plan rectangulaire ou subcarré et
mesurent entre 8 et 15 m de long. Elles s’organisent en petits groupes de quelques maisons
agencées autour d’une place. Ces groupes, n’excédant pas 2500m², correspondent
probablement aux habitats de familles étendues mais ne présentent pas de constructions
91
FAUGÈRE B., 2009
49
communautaires. Ils se répartissent dans des réseaux de terrasses et il n’est pas rare de
retrouver des pétroglyphes à proximité. Ceux-ci reflètent des activités à caractère
symbolique, expressions probables de rituels domestiques92.
Villages. Plus complexes que les hameaux, ils possèdent généralement plus de
structures (de 10 à 20 en moyenne pour un maximum de 48). Cependant, leur différence
fondamentale avec les hameaux est la présence d’un centre civico-cérémoniel clairement
défini pouvant faire 3 ha. Celui-ci peut contenir une ou plusieurs structures
communautaires. On y observe assez régulièrement des monticules interprétés comme des
oratoires. Il n’est pas rare que les villages présentent un ou plusieurs terrains de jeu de balle.
En dehors de ces caractéristiques, les structures s’organisent globalement comme dans les
hameaux. Toutefois, on note parfois un agencement particulier. Notons le cas exceptionnel
de MICH. 400 dont la majorité des structures sont regroupées dans une enceinte.
Centres. Ils sont caractérisés par la présence d’un centre civico-cérémoniel bien
développé, doté d’au moins trois structures communautaires et agrémenté d’un ou deux
terrains de jeu de balle. Le centre civico-cérémoniel fait entre 1,5 et 6 ha selon les cas.
Autour, on retrouve des groupes satellites constitués d’habitations mais pouvant aussi être
pourvus de structures monumentales, voire de jeux de balle mineurs. Les sites de ce type
peuvent atteindre entre 15 et 33 ha. Ils s’organisent en suivant deux sortes de plan. Le
premier voit ses structures agencées autour d’une place qui est parfois aménagée le long de
la pente ou surcreusée (patio hundido). Le second présente des constructions alignées le
long d’un axe.
Autres. Cette dernière catégorie, particulière, regroupe plusieurs types de sites. Les
grottes et abris-sous-roches, les cimetières, les zones de tailles et les sites dont la nature n’a
pas pu être déterminée, à cause d’une érosion avancée ou de destructions trop importantes
(agriculture moderne, réutilisation des blocs…). Nous reviendrons plus amplement sur
chaque type juste après, puisqu’ils n’entrent pas dans notre corpus.
De ces quatre types, seuls les trois premiers seront pris en compte. Voyons pourquoi.
92
FAUGÈRE B., 2009 : 187-188
50
B. Précisions sur la sélection de l’échantillon de sites
Le corpus complet des sites archéologiques de la zone Vertiente Lerma est
aujourd’hui de 104 sites. En plus des 102 sites mentionnés dans le chapitre 3, deux grottes
ont été ajoutées (MICH. 408 et 409). Pourtant, nous ne pouvons pas utiliser tout le corpus
pour deux raisons que nous allons expliquer ici.
La première raison réside dans le problème des datations. Comme nous l’avons
évoqué plus haut, tous les sites n’ont pas pu être rattachés à une phase chronologique pour
des raisons sur lesquelles nous nous sommes déjà étendus. Par conséquent, ces sites seront
mis à part pour éviter de fausser l’étude. Nous avons néanmoins conscience que le retrait du
corpus d’une partie des sites est aussi facteur d’erreur, mais nous ne pouvons être beaucoup
plus précis pour le moment. Ainsi, les 25 sites non-datés présentés dans le chapitre
précédent ont été retirés de l’échantillon étudié (MICH. 37, 45, 47, 99, 110, 114, 129, 130,
134, 149bis, 330, 341, 342, 343, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 390, 391, 395, 396 et 405). À
ces 25, doivent être ajoutés MICH. 408 et 409.
La deuxième raison est plus liée à l’objectif que nous nous sommes fixé. Nous
souhaitons identifier des zones de potentiels agricoles dans la région Vertiente Lerma. Mises
en corrélation avec la disposition des sites aux différentes phases, nous cherchons à savoir si
elles ont une inférence sur l’organisation spatiale des villages préhispaniques. Comme nous
l’avons présenté plus haut, les travaux réalisés par Brigitte Faugère ont permis d’attribuer à
la plupart des sites une catégorie morphologico-fonctionnelle. Nous garderons ici cette
typologie. Ainsi, dans la mesure où nous nous intéressons à l’agriculture, nous exclurons du
corpus une partie des sites. Expliquons-nous. Les sites qualifiés « autres » correspondent à
quatre types bien particuliers qui, en toute logique, ne peuvent que difficilement être
associé aux activités agricoles. Ce sont les cimetières, les zones de taille, les grottes et abris-
sous-roches et les sites dont la nature n’a pas pu être déterminée.
Cimetières. Ils sont qualifiés ainsi à cause du nombre de sépultures qui y a été
observé. Celles-ci sont regroupées et relativement éloignées des zones d’habitat. On peut
donc raisonnablement penser que les cimetières n’ont pas un caractère central dans la vie
des champs. Ainsi, MICH. 37 a été retiré du corpus.
51
Zones de taille. On en connait quatre pour la zone Vertiente Lerma. Elles sont
matérialisées sur le terrain par un amas important de déchets de débitage. Seule celle de
MICH. 100 a pu être datée phase Milpillas grâce à la présence d’un cimetière associé. Les
trois autres, MICH. 99, 130 et 361, restent non-datées. On peut néanmoins supposer qu’elles
sont relativement tardives à la lumière des travaux réalisés par Véronique Darras dans les
alentours du Zinaparo-Prieto. Elle a montré que c’est avec l’émergence du royaume
Tarasque que se développe l’exploitation de l’obsidienne de la région93. MICH. 99, 100, 130
et 361 sont donc hors du corpus.
Grottes et abris-sous-roches. On en connait 18. L’interprétation la plus courante est
que ces espaces ne sont occupés que temporairement. Ils ont pu être des refuges en période
de chasse, des lieux privilégiés pour les rituels ou pour d’autres activités difficilement
identifiables. Quoi qu’il en soit, il est peu probable qu’ils soient liés à l’agriculture. Aussi
avons-nous préféré les mettre de côté pour notre étude. Ce sont donc MICH. 110, 143, 149,
149bis, 358, 360, 366, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 405, 406, 408 et 409.
Indéterminés. Enfin, quatre sites n’ont pas pu être intégrés dans la typologie. Il est
donc impossible de les rapprocher des activités agricoles. Ce sont MICH. 341, 359, 388 et
396.
Ces quelques précisions faites, l’échantillon a été réduit à 66 sites. Ils correspondent
aux 33 hameaux, 27 villages et 6 centres pour lesquels une datation a pu être donnée. Dans
un souci d’exhaustivité et parce qu’il est fort probable qu’ils entrent dans le cadre d’études
postérieures, nous avons tout de même réalisé une carte SIG présentant les sites exclus du
corpus (cf. carte 8).
Le tableau suivant consigne les informations exposées ci-dessus.
93
DARRAS V., 1999
52
Type de site Datation et statut
Hameaux Villages Centres Autres Tx
Grottes Zones de taille
Cimetières Indéterminés
Datés et pris en compte
74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 79 ; 80 ; 106 ; 107 ; 109 ; 112 ; 131 ; 132 ; 133 ; 135 ; 138 ; 141 ; 144 ; 145 ; 146 ; 331 ; 333 ; 334 ; 335 ; 336 ; 337 ; 340 ; 367 ; 368 ; 397 ; 398 ; 401 ; 402 ; 403
46 ; 78 ; 81 ; 82 ; 101 ; 102 ; 104 ; 108 ; 111 ; 113 ; 115 ; 136 ; 137 ; 139 ; 140 ; 142 ; 147 ; 148 ; 160 ; 332 ; 338 ; 339 ; 357 ; 363 ; 385 ; 399 ; 400
48 ; 49 ; 50 ; 51 ; 103 ; 150
Total 33 27 6 66
Datés mais exclus
143 ; 149 ; 358 ; 360 ; 389 ; 392 ; 393 ; 394 ; 406
100 388
Total 9 1 1 11
Non-datés
45 ; 114 ; 134 ; 330 ; 342 ; 343 ; 362 ; 364 ; 365
47 ; 129 110 ; 149bis ; 366 ; 390 ; 391 ; 395 ; 405 ; 408 ; 409
99 ; 130 ; 361
37 341 ; 359 ; 396
Total 9 2 9 3 1 3 27
Totaux 42 29 6 27 104
Fig 7. – Bilan sur le choix du corpus
53
C. Présentation des sites
Nous allons ici donner une brève description de chaque site. Nous ne préciserons que
peu d’informations concernant l’agencement de chacun sur le terrain. Pour obtenir plus de
précision sur ce point, le lecteur devra se reporter aux travaux antérieurs de Brigitte
Faugère94. Nous nous contenterons de donner les informations suivantes95 :
- Numéro
- Nom usuel
- Municipalité et localité où l’on trouve le site
- Coordonnées géographiques. Elles ont été récupérées en degrés, minutes, secondes
(DMS) dans les publications, mais ont ici été traduites en degrés décimaux (DD) pour
nous permettre de les intégrer au SIG. Notons que la plupart d’entre-elles doit
différer de quelques mètres, voire centaines de mètres, de la position réelle du site
de part l’imprécision des moyens disponibles (boussoles, altimètres et cartes
topographiques) lors des premiers relevés dans les années 1980. En effet, nous avons
pu consulter les rapports de terrain réalisés par Laure Déodat pendant la campagne
201196. L’un des objectifs était l’évaluation de la validité des coordonnées
géographiques attribuées pendant le projet Michoacán I sur un échantillon de vingt
sites. Pour Vertiente Lerma, seuls MICH. 101, 103, 148 et 358 ont été repositionnés à
l’aide d’un GPS. MICH. 148 avec une erreur de 300m NNW est le mieux positionné
des quatre. La marge est d’environ 1 km SW pour 103, le plus mal placé (mais aussi
l’un des plus étendu de la région).
- Altitude. Nous avons préféré garder celles données dans les publications.
Néanmoins, nous nous devons de préciser qu’en raison des incertitudes mentionnées
au-dessus, il est fort probable que l’altitude que l’on pourra lire sur le SIG diffère
quelque peu de celle présentée ici.
94
FAUGÈRE : 1990 et FAUGÈRE : 1996 95
Dans un souci pratique, nous avons réunis les informations dont nous avions besoin dans une base de données Filemaker excessivement simple. Une seule table rassemble toutes les rubriques. Les résultats des requêtes que nous avons réalisées ont ensuite été consignés dans des tableaux Excel. 96
DÉODAT L., non-publié
54
- Situation géographique. Une précision intéressante donnée par Brigitte Faugère
dans ses publications. Toutefois, nous n’avons pas pu en tenir compte dans le SIG.
Nous la rappelons ici car nous estimons qu’il est important de garder la mention de la
situation géographique faite par quelqu’un qui est allé sur le terrain. La réalité et une
carte sont bien différentes.
- Type.
- Composition. Cette rubrique sert à donner une idée de l’organisation du site. Les
compositions ont été définies à partir des descriptions qui accompagnaient les sites
dans les publications97. Nous précisons ainsi s’il s’agit d’une structure isolée, d’un
groupe de structures, de plusieurs etc.
Compositions Totaux
Structures isolées
Groupe(s) de structures
Groupe principal et structures dispersées
Groupe principal et groupe(s) secondaire(s)
Indéterminé (destructions, autre modèle d’organisation…)
En nombre de sites
2 39 4 12 9
En pourcentage du corpus
3,03 % 59,09 % 6,06 % 18,18 % 13,64 %
- Superficie. Définir la superficie d’un site archéologique n’est pas chose aisée. Nous
nous sommes limités aux approximations données dans El Proyecto Michoacán.
- Périodisation. Elle est simplifiée à la mention « OUI » pour la ou les phases
chronologiques concernées. C’est là une ruse que nous avons utilisée pour garder
une trace de ces informations dans les tables attributaires des fichiers du SIG, dans la
mesure où nous ne sommes pas encore capable de lié efficacement le SIG et une
base de données.
Les 66 sites du corpus sont consignés sur fiches dans l’annexe.
97
FAUGÈRE : 1990 et FAUGÈRE : 1996
55
Type de site Phase
Hameaux Villages Centres Totaux (sur le nombre de sites connus pour chaque phase)
Lupe
75 ; 80 ; 109 ; 135 ; 138 ; 141 ; 145 ; 146 ; 368 ; 398 ; 401 ; 402 ; 403
78 ; 104 ; 111 ; 113 ; 115 ; 136 ; 147 ; 148
50 ; 51 ; 103
Total Lupe 13 8 3 24 (sur 28 sites Lupe)
La Joya
74 ; 79 ; 106 ; 107 ; 112 ; 146 ; 331 ; 333 ; 336 ; 337 ; 398 ; 402
78 ; 81 ; 82 ; 102 ; 108 ; 111 ; 115 ; 136 ; 137 ; 139 ; 140 ; 142 ; 332 ; 338 ; 363 ; 385 ; 399
48 ; 103 ; 150
Total La Joya 12 17 3 32 (sur 37 sites La Joya)
Palacio
77 ; 79 ; 131 ; 132 ; 133 ; 144 ; 146 ; 334 ; 367 ; 368 ; 397 ; 398 ; 402 ; 403
46 ; 78 ; 102 ; 111 ; 136 ; 137 ; 147 ; 148 ; 160 ; 332 ; 339 ; 357 ; 363 ; 400
48 ; 103
Total Palacio 14 14 2 30 (sur 40 sites Palacio)
Milpillas
76 ; 77 ; 131 ; 132 ; 145 ; 335 ; 340
101 ; 113 ; 385 ; 400 49 ; 103
Total Milpillas 7 4 2 13 (sur 20 sites Milpillas)
Fig.8 – Bilan des sites du corpus phase par phase
66 sites constituent l’échantillon final sur lequel nous avons travaillé. Partant de leurs
maisons, groupées dans des hameaux, des villages ou des centres, les hommes ont
régulièrement attrapé leurs outils de travail en direction des champs cultivés. Suivons-les.
56
- CHAPITRE 5 -
PPPPRATIQUES AGRICOLES AU SUD DU LERMA ET POTENTIALITÉ DES SOLS
Notre objectif est de connaître les conditions d’accessibilité des zones qui peuvent,
en théorie, être cultivées. Nous serons alors en mesure de savoir si ce facteur est
déterminant pour l’organisation spatiale des sites. Néanmoins, avant de définir ces espaces,
il faut nous pencher sur la question de l’agriculture elle-même. Il nous a semblé nécessaire
de faire un point des connaissances sur le sujet afin d’établir une hypothèse qui servira de
base à notre étude.
A. Que sait-on des pratiques agricoles dans la région ?
Peu de choses. À la lumière des travaux de Brigitte Faugère, il est certain que
l’agriculture a été pratiquée. Les terrasses en attestent. Au même titre, l’outillage de
mouture retrouvé, qui laisse penser qu’au moins le maïs et les piments ont été cultivés et
consommés. Outre les réseaux de terrasses à flancs de montagnes, Brigitte Faugère a émis
l’hypothèse de la mise en culture des fonds de bassins versant où les terres sont riches et
profondes. Selon elle, la répartition des sites sur les versants résulterait peut-être d’un désir
des habitants de laisser libres les meilleures terres. On ne peut en effet réduire l’absence de
site dans les fonds de vallées aux destructions liées à l’agriculture moderne98. Nous verrons
plus bas que cette question reste discutable. On sait finalement qu’aucun système
d’irrigation n’a pu être identifié.
En raison du manque d’informations concernant le type d’agrosystème utilisé par les
occupants de notre région, nous devrons nous baser sur les données qui ont pu être
récoltées dans d’autres parties de la Mésoamérique. Ainsi, en complément des résultats des
investigations des projets français successifs, nous prendrons en compte les recherches
effectuées dans le bassin de Pátzcuaro, puisqu’il fut le centre névralgique du royaume
98
FAUGÈRE B., 1996 : 130-131
57
Tarasque99. Nous utiliserons aussi les informations issues des travaux de Sanders, Parsons et
Santley dans le bassin de Mexico100. Nous partirons donc du postulat que les techniques
agricoles sont relativement similaires à celle que l’on retrouve plus tard chez les Tarasques
et dans beaucoup de populations mésoaméricaines. À savoir, un semis direct à l’aide d’un
bâton à fouir et l’entretien des champs avec un outillage néolithique101. De même, nous
devrons considérer que le maïs constituait alors la principale espèce cultivée à l’instar de ce
que l’on observe dans le bassin de Pátzcuaro102. Assertion confortée par l’observation des
cultures actuelles où le maïs tient une place prépondérante103. Nous ne perdons pas de vu
que d’autres espèces ont très certainement été cultivées – comme le haricot ou la courge –
mais nous simplifierons ici en restreignant notre étude au maïs seul.
Savoir, ensuite, quel fut ou furent le ou les types de mise en culture employés est très
difficile. Nous nous appuierons pour cela sur les travaux réalisés par Javier Caballero104 au
début des années 1980 dans le cadre d’un projet multidisciplinaire conduit par la Dirección
General de Culturas Populares SEP. Il a mis en relation l’utilisation des ressources faite par
les Purépecha actuels dans le bassin de Pátzcuaro avec les documents ethnohistoriques, tels
que la Relation de Michoacán105. Il a montré que deux types d’agriculture sont aujourd’hui
dominants. L’agriculture irriguée aux abords du lac (que nous mettrons de côté dans notre
région sans indice de tels systèmes) et l’agriculture saisonnière sur les versants. Son étude
des textes ethnohistoriques lui a permis de dire que ces deux types, utilisés dans les mêmes
espaces écologiques, semblent correspondre à ceux pratiqués par les Purépecha
préhispaniques106. De même, Jorge Romero fait la même observation pour l’agriculture
actuelle dans la Meseta Purépecha107, où l’on pratique le système temporal de humedad
residual108. Dans la limite de nos connaissances et des données, nous avons donc décidé
d’admettre que l’agriculture pluviale saisonnière était aussi celle que pratiquaient les
hommes du versant sud du Lerma entre le VIème et le XIIIème siècle.
99
FISHER C.T., 2005 ; POLLARD H.P., 1993 100
SANDERS W.T., J.R. PARSONS & R.S. SANTLEY, 1979 101
SANDERS W.T., J.R. PARSONS & R.S. SANTLEY, ibid. : 231 102
POLLARD H.P. & S. GORENSTEIN, 1980 103
GOUGEON O., 1991 : 72-75 104
Directeur du jardin botanique de l’UNAM 105
CABALLERO J., 1982 106
CABALLERO J., 1982 : 35-37 107 ROMERO J., 1995 : 71 cité par AYALA-ORTIZ D.A. & R. GARCÍA-BARRIOS, 2009 108
Agriculture pluviale saisonnière
58
Dans leur étude du bassin de Mexico, Sanders, Parsons et Santley ont défini les
étapes successives des travaux agricoles tels qu’ils étaient pratiqués dans les années 1950109.
Ils précisent que ces tâches différaient alors peu de celles effectuées juste après la Conquête
et l’introduction de la charrue. Ils mettent ensuite l’accent sur le fait qu’elles devaient aussi
être relativement similaires avant la Conquête. La différence majeure étant, selon eux,
l’effort requis pour leur réalisation sans les techniques modernes. Nous pensons donc que
cette suite de tâches est raisonnablement applicable à notre région. Rappelons-les ici.
Barbecho : labour profond après la récolte
d’automne
Novembre-Décembre
Rastrillo : nivellement du champ avec le soc de
charrue
Immédiatement après Barbecho
Cruzada : labour superficiel perpendiculairement au
Barbecho
Janvier-Février
Rastrillo
Immédiatement après Cruzada
Zurcada : labour du champ pour le semis
Mars-Mai
Siembra : semis à la main
Mars-Mai
Primer Labor : sarclage110
à la charrue
Quand la récolte fait 10 cm
Segundar : sarclage à la charrue
Quand la récolte fait 30 à 50 cm
Aterrada : buttage111
à la main
Fin de l’été
Cosecha : moisson
Septembre-Novembre
Fig. 9 – Travaux agricoles en 1950 (d’après SANDERS W.T., J.R. PARSONS & R.S. SANTLEY, 1979 : 237)
Bien entendu, à l’époque préhispanique, tout était réalisé à la main et les étapes
devaient être légèrement différentes. Cependant, cette séquence est probablement valide
dans ses grandes lignes. Le sud du Lerma connait toutefois des conditions climatiques
différentes du bassin de Mexico. L’altitude moyenne est un peu plus basse – environ 1900m
dans notre région contre environ 2400 dans le bassin de Mexico – et l’hygrométrie, un peu
109
SANDERS W.T., J.R. PARSONS & R.S. SANTLEY, 1979 : 237 110
Retrait des mauvaises herbes 111
Constitution de butte de terre au pieds des plants pour favoriser le développement des racines
59
plus élevée – environ 800mm contre 450-650mm112. Cependant, les saisons sèche et humide
s’étalent approximativement sur les mêmes mois et, a fortiori, la temporalité des tâches
agricoles est semblable. Au vu du climat au sud du Lerma et des informations que nous
avons, voici la séquence, hypothétique et simplifiée, que nous proposons.
Labour profond après la récolte d’automne
Novembre-Décembre
Nivellement du champ
Immédiatement après
Opérations d’entretien (labours…) ?
Décembre-Mars
Labour avant semis
Mars-Mai
Semis
Mars-Mai
Entretien de la récolte (sarclage et buttage)
Mai-Octobre
Moisson
Octobre-Novembre
Fig.10 – Séquence des travaux agricoles hypothétique dans la zone Vertiente Lerma
B. La population et les travaux des champs
Malgré les lacunes concernant l’agriculture, nous avons une assez bonne idée de
l’organisation spatiale élémentaire des établissements. Toutes périodes confondues, plus de
90 % du corpus est constitué de hameaux et de villages à vocation agricole. Mis à part les
centres à l’agencement complexe, la tendance globale est aux petits groupes de maisons,
intégrés dans un réseau étendu de terrasses. Comme nous l’avons vu au chapitre précédent,
ces groupes reflètent probablement les zones d’habitat de familles étendues, où chacun
prend très certainement part aux activités quotidiennes rythmées par la vie des champs. Un
point à ne pas perdre de vue pour comprendre comment est perçu l’environnement par les
communautés préhispaniques qui nous intéressent. Enfin, nous connaissons cet
environnement. Ou du moins, ce qu’il en reste et ce à quoi il a pu ressembler en théorie.
Nous devrons là encore assumer que le milieu actuel est, dans les grandes lignes,
relativement similaire à celui qu’ont connu les sociétés pré-tarasques.
112
SANDERS W.T., J.R. PARSONS & R.S. SANTLEY, 1979
60
Résumons le scénario hypothétique que nous allons suivre. À l’époque
préhispanique, le versant sud du Lerma est habité par des communautés de paysans. Établis
dans des hameaux, des villages, ou plus rarement des centres, leurs activités quotidiennes
s’organisent au sein de petits groupes d’habitations où vivent des familles étendues. Ils
construisent des terrasses pour palier au pendage des flancs des montagnes qui les
entourent et y plantent principalement du maïs. Ils travaillent leurs terres avec des outils de
bois et de pierre. On sème entre mars et mai, au début de la saison des pluies, pour obtenir
une récolte moissonnée quand commence la saison sèche, autour de novembre. La majeure
partie de la récolte relève alors de la subsistance dans une société à tendance
autosuffisante113. Les travaux des champs et leur entretien constituent donc des activités
régulières, pratiquées par la majorité de la population.
En toute logique, l’accès à ces champs se doit de ne pas être ni trop long, ni trop
compliqué. C’est pourquoi nous émettons l’hypothèse que la répartition des espaces cultivés
peut avoir une importance sur l’implantation des habitations. Pour vérifier cette hypothèse,
la première étape est d’essayer de savoir quels étaient ces espaces cultivés.
C. Quelles terres étaient cultivées ?
À ce stade, nos recherches sont restreintes à la bibliographie. Néanmoins, il n’est pas
impossible de s’appuyer sur celle-ci pour obtenir de nouvelles données. Afin de définir des
zones de potentiel agricole, nous avons naturellement cherché à savoir quels sont les
facteurs qui font qu’une terre est bonne ou mauvaise pour l’agriculture. Pour ce faire, nous
nous sommes penchés sur la pédologie qui, avec l’ensoleillement et l’apport en eau,
constitue l’un des éléments déterminants dans le bon développement des plantes.
Toutefois, les pré-tarasques n’étaient pas des pédologues. Leur connaissance de
l’environnement n’en est pas moins bonne, mais leurs critères sont empiriques. C’est
pourquoi, nous nous sommes aussi intéressés aux approches des archéologues et des
ethnologues qui peuvent nous aider à comprendre les choix des communautés étudiées.
113
FAUGÈRE B., 2009 : 204-205
61
1. Notions de pédologie élémentaire
Aujourd’hui, le pédologue a recours à quatre critères fondamentaux pour identifier
un sol. Ce sont la couleur, la texture, la structure et la mesure de l’acidité. Les trois premiers
critères sont facilement identifiables sans avoir appel à des techniques très évoluées. La
mesure de l’acidité est, quant à elle, moins évidente. Les descriptions qui suivent sont tirées
du cours d’introduction à la pédologie de Sophie Bonin114, qui elle-même reprend les travaux
de Philippe Duchaufour115.
Couleur. Pour le pédologue, la couleur est un bon indicateur de la composition. Le
noir trahit la présence de matière organique. Le bleu-vert correspond à la présence de fer
réduit (Fe2+) du à une situation d’asphyxie. C’est le cas dans les sols à hydromorphie
permanente. Le rouge indique une forte concentration en fer oxydé (Fe3+). Nous pourrions
continuer cette description car il existe de nombreuses nuances en fonction des minéraux
que contient le sol, mais là n’est pas notre propos.
Texture. Ce deuxième critère correspond à la malléabilité du sol sec ou humide. Un
test simple consiste à former un boudin avec le sol, puis à le courber pour faire un anneau.
L’intégrité du modelage dépend de la granulométrie. Une terre argileuse et dense sera
facilement modifiable. Il sera impossible de faire quoi que ce soit d’une terre sableuse.
Finalement, un sol limoneux se craquellera dès qu’on essaiera de modifier la forme
d’origine. Le tableau suivant répertorie les différentes granulométries.
Catégorie Taille
Argiles < 2µm
Limons 2 µm < x < 0,05 mm
Sables 0,05 mm < x < 2 mm
Graviers < 2 cm
Cailloux < 7,5 cm
Pierres < 25 cm
Blocs > 25 cm Fig.11 – Granulométries (d’après BONIN S., 2006)
Pour ce qui est de l’adéquation avec l’agriculture, la texture donne de nombreuses
informations. Un sol argileux est collant et lourd. Il sera difficile à travailler car gorgé en eau
et asphyxiant. Sa mise en culture demandera beaucoup d’investissements, notamment pour
114
BONIN S., 2006 115
DUCHAUFOUR P., 2000
62
le drainage. De même, un sol limoneux aura tendance à retenir l’eau de pluie, se tasser et à
devenir asphyxiant. À l’inverse, un sol sableux est perméable à l’eau et à l’air. Cependant,
les racines s’y accrochent mal et il est particulièrement sujet au dessèchement et à l’érosion.
Le sol idéal sera donc celui qui alliera harmonieusement les trois types et présentera assez
de matière organique. On exprime la texture d’un sol à l’aide d’un schéma en triangle
(fig.12).
Fig. 12 – Triangle des textures (d’après FAO116
)
Structure. Ce troisième critère concerne la compacité du sol et l’agglomération des
éléments qui le compose. Le test consiste ici en l’enfoncement d’un couteau pour connaître
la compacité et au bris d’une motte pour observer les blocs obtenus. On note trois
catégories de structure : massive (gros blocs), fragmentaire (grumeaux) et particulaire. La
seconde constitue un équilibre pour ce qui est de la circulation de l’eau. La structure est due
116
Confère références internet
63
à l’effet de retrait (alternance entre périodes humides et sèches) et à l’effet de granulation
(activité biologique).
Acidité. Ce quatrième et dernier critère requiert un équipement spécifique pour
tester le pH du sol. Nous verrons néanmoins que l’acidité peut être estimée autrement.
Quand le pH est faible, il reflète la pauvreté du sol en minéraux biogènes117. Neutre ou
élevé, il trahit le contraire.
2. Connaissance des sols traditionnelle
Ces techniques relativement simples et utilisées aujourd’hui par les géologues ne
sont qu’une première étape avant les études physico-chimiques. Toutefois, cette première
approche s’accorde avec les moyens que les paysans ont à disposition. Il n’est donc pas
étonnant que ce même type d’observations soit pratiqué par les agriculteurs traditionnels du
monde entier. Gérald Marten et Patma Vityakon ont écrit un chapitre dans un ouvrage
collectif qui donne quelques exemples ethnographiques des savoirs de différentes
communautés de paysans dans plusieurs pays118. Le nombre de catégories de sols et la
justesse de leurs observations sont souvent impressionnants. Les critères d’identification
sont par ailleurs similaires aux critères élémentaires des pédologues.
Ce sont donc la couleur, la texture et la structure qui sont très souvent les marqueurs
déterminants choisi par les agriculteurs. L’humidité du sol est aussi un facteur récurrent. Par
exemple, les communautés soundanaises de l’île de Java caractérisent les sols en fonction de
quatre critères : la couleur, la texture (et présence de pierres et de sable), l’humidité et la
structure (compacité)119. Ils nomment ainsi les sols (Tanah) en fonction de variantes de
chaque critère qui correspondent à un niveau de fertilité. Un tanah beureum (sol rouge) est
donc considéré comme peu fertile, à l’inverse d’un tanah hideung (sol noir). Sans être
instruits des processus d’humification qui entrainent la coloration noire, ils savent donc que
cette couleur est généralement bonne pour l’agriculture. La classification soundanaise est
relativement simple avec ses douze types de sol. La typologie peut s’avérée beaucoup plus
117
Constitué à partir du vivant. 118
MARTEN G.G. & P. VITYAKON, 1986 119
CHRISTANTY L. & J. ISAKANDAR, cités par MARTEN G.G. & VITYAKON P., 1986 : 200
64
complexe. C’est le cas chez les Q’eqchi’ du Guatemala qui possèdent, par exemple, pas
moins de vingt-quatre dénominations différentes pour les sols, variant selon la couleur, la
texture, le drainage et la présence de racines120.
Toujours est-il que l’ingéniosité des agriculteurs du monde ne se limite pas aux
critères qui recoupent ceux utilisés par les pédologues. L’acidité, qui, comme nous l’avons
vu, nécessite pour les pédologues le recours à des instruments spécialisés, n’est pas pour
autant délaissée par les paysans traditionnels. En Malaisie, l’acidité du sol peut être estimée
au goût, doux, neutre ou amer. Parallèlement, les malaysiens font aussi appel à leur
connaissance de la végétation. Ainsi, certains arbres trahissent un sol acide. La végétation
constitue un indicateur de premier ordre. Plus que simplement pour avoir une idée de
l’acidité, les plantes permettent souvent le choix d’un site propice à l’agriculture. Revenons
pour l’exemple chez les Q’eqchi’. D’après les travaux de Carter121, onze espèces permettent
d’identifier un espace adéquat pour l’implantation d’une milpa à la saison humide et cinq à
la saison sèche.
On peut raisonnablement penser que le même type de savoir était détenu par les
populations préhispaniques. Nous nous appuierons donc sur ces informations pour définir
différents niveaux de fertilité pour les sols que l’on retrouve dans la région Vertiente Lerma.
D. Le potentiel agricole des sols au sud du Lerma
Nous reprendrons ici chacun des types de sols présentés dans le chapitre 2, auxquels
nous attribuerons un niveau de compatibilité pour l’agriculture (Bonne, Moyenne, Plutôt
mauvaise et Improbable) à la lumière des informations préalablement mentionnées. La
culture prise en compte est celle du maïs. Aussi est-il nécessaire de donner quelques
dernières précisions sur les besoins de cette plante. Nous tirons ces informations des travaux
de Christopher Beekman et William Baden122.
120
CARTER W.E., 1969, cité par MARTEN G.G. & VITYAKON P., 1986 : 205-206 121
CARTER W.E., 1969, cité par MARTEN G.G. & VITYAKON P., 1986 : 207 122
BADEN W.W. & C.S. BEEKMAN, 2011
65
Le maïs est une plante relativement polyvalente qui, au Mexique, peut et est cultivée
à peu près partout, même dans des zones inappropriées123. En théorie, le sol doit néanmoins
répondre à quelques exigences. Il doit être bien drainés et fertile. Sa teneur en argile doit
être comprise entre 10 et 30% et son pH entre 5 et 7-8 (neutre ou légèrement basique). Le
maïs tolère assez mal une salinité trop élevée124. On l’aura compris, ces critères restent
théoriques et peuvent être outrepassés. Rappelons donc les facteurs qui permettent de dire
qu’un sol est bon ou mauvais pour la mise en culture.
Critères Compatibilité théorique avec la mise en culture du maïs
Couleur (idéal : présence de matière organique)
Noire/sombre Bonne
Moyennement rouge Moyenne
Très rouge Mauvaise
Claire Moyenne à bonne
Texture (idéal : compromis entre les trois catégories)
Argileuse Plutôt mauvaise (Bonne si beaucoup d’investissements)
Limoneuse Moyenne (Bonne avec drainage efficace)
Sableuse Plutôt mauvaise
Structure (idéal : compromis entre légèreté et fertilité)
Massive Plutôt mauvaise
Fragmentaire Bonne
Particulaire Plutôt mauvaise
Acidité (idéal : entre 5 et 7-8)
Faible Mauvaise (si < 5), Moyenne (si > 5)
Moyenne Bonne (7-8)
Élevée Mauvaise (> 8)
Fig.13 – Tableau récapitulatif de la compatibilité théorique avec la mise en culture du maïs en fonction des
critères déterminants
123
SANDERS W.T., J.R. PARSONS & R.S. SANTLEY, 1979 : 233 124
BADEN W.W. & C.S. BEEKMAN, 2011
66
À partir de ces critères, nous allons proposer ces niveaux de compatibilité pour les
sols de notre région. Malheureusement, nous ne possédons pas toutes les informations pour
compléter tous les critères pour chaque type de sol.
Type de sol Critères déterminants Compatibilité théorique avec la mise en culture du maïs (outillage préhispanique)
1. Les sols peu évolués avec des profils peu différenciés.
LITHOSOLS - couleur : ? - texture : tendance sableuse - structure : particulaire - acidité : élevée
Improbable
ANDOSOLS - couleur : noir - texture : tendance limoneuse - structure : fragmentaire - acidité : ?
Bonne
2. Les sols à maturation humique.
PHAEOZEMS - couleur : brun - texture : limoneuse-sableuse - structure : fragmentaire - acidité : ?
Bonne
VERTISOLS - couleur : sombre - texture : argileuse - structure : massive - acidité : ?
Plutôt mauvaise (demande un investissement énorme)
SOLS VERTIQUES - couleur : brun - texture : argileuse-tendance limoneuse - structure : massive-tendance fragmentaire - acidité : ?
Moyenne à bonne
3. Les sols fersiallitiques.
CAMBISOLS - couleur : brun - texture : limoneuse-tendance sableuse - structure : fragmentaire à particulaire - acidité : ?
Bonne
LUVISOLS CHROMIQUES - couleur : brun-rouge - texture : limoneuse - structure : fragmentaire - acidité : ?
Moyenne à bonne
Fig. 14 – Compatibilités théoriques des sols de la zone Vertiente Lerma avec l’agriculture du maïs
67
Dernière précision sur les vertisols.
Rappelons que les sols de la région sont en majorité des vertisols, qui représentent
près de 70% (cf. chapitre 2), même s’ils sont souvent associés à d’autres types. Au total, les
terres composées en majorité de vertisols couvrent près de 85% de la zone Vertiente
Lerma125. Il nous parait donc judicieux de nous attarder un peu plus dessus.
Les vertisols sont, par essence, extrêmement riche en argiles (entre 50 et 70 %126). Ce
sont par conséquent des sols très lourds. Très secs et craquelés à la saison sèche, très
meubles et visqueux à la saison des pluies. Ainsi, bien que l’on ne retrouve pas de site dans
les fonds de vallée où ils sont nombreux, il n’est pas évident que ces terres aient été
favorisées par les populations préhispaniques dépourvues d’animaux de traits comme
d’instruments de labour127. Afin d’appuyer cette acception, nous avons consulté différents
travaux récents sur les vertisols. L’un d’eux, effectué en Bulgarie a plus particulièrement
retenu notre attention. Les pédologues Maria Borissova et Dafina Nikolova ont réalisé une
étude sur les vertisols des environs de Sofia. Elles ont constitué des parcelles
d’échantillonnage où elles ont mis en culture du maïs en suivant cinq techniques différentes,
et ce sur plusieurs années. Leur objectif était de connaitre les meilleures conditions
d’absorption de l’eau en fonction des différentes techniques pour obtenir la meilleure
productivité. Les quatre premières pratiques agricoles faisaient varier la profondeur du
labour, mais la dernière consistait en un semis direct qui pourrait se rapprocher des
pratiques préhispaniques. Au final, le semis direct entraine une réduction de la perméabilité
des vertisols à l’eau et à l’air et par conséquent, fatigue les sols qui perdent alors en
fertilité128. Les facteurs climatiques sont certes bien différents dans notre région, mais il n’en
reste pas moins intéressant de noter ces informations à caractère général.
Contre toute attente, les communautés du sud du Lerma n’ont pas choisi les terres
les plus évidentes pour implanter leurs réseaux de terrasses et leur agriculture. C’est à l’aide
du SIG que nous allons maintenant voir cela de plus près.
125
Calculé sur le SIG à partir de la carte de répartition des sols de l’INEGI 126
ÖSZOY G. & E. AKSOY, 2007 : 5 127
SANDERS W.T., J.R. PARSONS & R.S. SANTLEY, ibid. : 228 128
BORISSOVA M., & D. NIKOLOVA, 2008 : 4
68
- CHAPITRE 6 -
AAAAPPLICATION INFORMATIQUE : SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
A. Méthodologie de création des couches shapefile
Avant toute chose, donnons quelques précision sur les outils et le vocabulaire des
SIG, que nous allons utiliser. Le shapefile (.shp) est un format de fichier vectorisé129 propre
aux SIG qui permet d’afficher une couche130 sur un géodésique131 ou dans un système de
projection132. On parle de systèmes de coordonnées référencées (SCR) – coordonnées
géographiques sur un géodésique ou coordonnées projetées sur un plan. Nous utiliserons ici
les systèmes universels. À savoir WGS84, pour ce qui est du géodésique, et UTM133, pour la
projection. Notre aire géographique d’étude se situe dans la projection WGS84/UTM zone
14N. La première étape de notre étude a donc été de choisir ces SCR qui sont fondamentaux
pour pouvoir afficher les cartes et nuages de points en fonction de coordonnées
géographiques. L’idée étant de pouvoir superposer les couches, ce qui nécessite une
homogénéité parfaite des SCR. Nous avons principalement utilisé le logiciel libre Quantum
GIS version 1.7 (Qgis).
1. Couches de points pour les sites
Nous n’avons pas eu le temps de nous familiariser suffisamment avec les possibilités
de lier le SIG avec une base de données. Nous avons donc préféré procéder en deux temps
en créant d’abord une table Excel, que nous importions ensuite dans le SIG au format .csv.
Les tables Excel se présentent de façon très simple. Elles reprennent les rubriques
que nous avions définies dans la base de données : numéro, nom usuel, municipalité,
129
La vectorisation s’émancipe des pixels et permet de déformer une image à volonté sans perdre en précision. Le fichier vecteur est ainsi opposé au fichier raster (pixellisé). 130
Plan composé d’informations codées qui visuellement se présentent sous la forme de points, de traits ou de polygones. 131
Représentation théorique du globe terrestre sous la forme d’une sphère étirée. Bien qu’il existe de très nombreux modèles, l’un d’eux, WGS84 (World Geodesic System, établit en 1984), est aujourd’hui universel. 132
Représentation plane d’une partie du globe terrestre. Dépend des coordonnées géographiques de la zone. 133
Universal Transverse Mercator.
69
localité, coordonnées géographiques, altitude, situation géographique, type, composition,
superficie et périodisation (cf. Chapitre 4). La table attributaire134 reprend les mêmes
rubriques que le fichier Excel originel. Qgis reconnait automatiquement les rubriques qui
correspondent aux coordonnées géographiques (si on lui dit) et crée donc une couche où
chaque point correspond à un site. Conformément aux coordonnées d’origine en DMS, les
coordonnées en DD traduites doivent être importées dans le système WGS84. Le fichier est
ensuite enregistrer au format .shp pour être émancipé du tableur Excel d’origine. On crée
enfin une copie de ce .shp en précisant le SCR pour être en mesure d’ouvrir le fichier dans la
projection WGS84/UTM zone14N. Sans cet ajustement, aucune analyse spatiale n’est
possible avec le mètre comme unité de carte135. Cette démarche a été appliquée à toutes les
couches que nous avons réalisées. Aussi ne la répèterons nous pas par la suite.
Pour des raisons pratiques, nous avons choisi de créer un fichier de points «site »
pour chaque phase. Nous avons donc quatre fichiers. Nous nous sommes inspirés de la
symbologie de Sanders, Parsons et Santley136 pour différencier les sites entre eux en fonction
de la typologie détaillée au chapitre 4. Voici la typologie employée.
Typologie
Symbologie
Hameau
Village
Centre
Grotte ou abri-sous-roche Cimetière Zone de taille Indéterminé
Fig. 15 – Symbologie des sites
134
Table intrinsèque au fichier qui regroupe toutes les informations qui le concerne. 135
Qgis ne prend en compte que les degrés décimaux comme unités de carte sur le géodésique WGS84. Ce qui rend la plus simple des mesures extrêmement complexe. 136
SANDERS W.T., J.R. PARSONS & R.S. SANTLEY, 1979 : 52-60
70
2. Modèle numérique de terrain
Un modèle numérique de terrain (MNT) est un fichier qui permet de donner une
représentation graphique de la topographie. Nous avons pu récupérer un ASTER GDEM137. Il
se présente sous la forme d’un fichier raster. Les pixels possèdent des coordonnées
géographiques (x et y) qui permettent l’affichage du MNT sur le géodésique WGS84 et des
coordonnées renseignant l’altitude (z). Ainsi, il est possible d’attribuer une couleur à tous les
pixels dont les altitudes sont comprises dans un intervalle défini. Au final, nous sommes en
mesure de créer des plages de couleur successives qui, en suivant un panel logique,
permettent de donner une représentation de la topographie.
Nous avons choisi d’utiliser un dégradé de couleurs pour rendre compte de l’altitude.
Les tons verts matérialisent les parties basses, les jaunes, l’intermédiaire, et les rouges les
parties hautes. Chaque plage de couleur correspond à une élévation de vingt mètres.
Fig. 16 – exemple de symbologie pour les MNT
137 Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) Global Digital Elevation Model
(GDEM), développé conjointement par le Japon et les États-Unis. Sa résolution spatiale est de 15m. Communication personnelle de Marion Forest, doctorante en archéologie préhispanique à Paris 1.
71
3. Couches de polygones pour les aires
Plusieurs de nos couches représentent des aires géographiques où sont distribués
des caractères particuliers de façon relativement homogène. Le traitement informatique de
ce type d’informations est fait à partir de couches de polygones. Certaines ont été
directement récupérées sur le site de l’INEGI qui met à disposition de nombreux fichier .shp
en WGS84. Ils sont facilement convertibles en UTM. Nous avons toutefois eu à les remanier
quelque peu. D’autres couches de polygones ont du être créées dans deux cas que nous
allons brièvement expliquer.
Le premier cas répondait au besoin de pouvoir travailler sur des cartes issues de
publications. Par exemple, la carte pédologique de Jean-Noël Labat138. Pour ce faire, nous les
avons scannées et géoréférencées. C'est-à-dire que nous avons superposé les cartes
numérisées sur des couches vectorisées en nous appuyant sur des repères géographiques
précis (coudes de rivières, plans d’eau…)139. À partir de ces images, nous avons utilisé l’outil
de création de polygones de Qgis et ainsi redessiner les cartes pour les traduire en .shp. Le
second cas correspondait à la création de nouvelles aires géographiques présentant un
caractère intéressant. Nous sommes alors directement passés par l’outil de création de
polygones.
B. Type de sols et potentialités agricoles
Nous tenons à préciser avant la présentation, que l’INEGI a réalisé des cartes
d’utilisations potentielles des sols en fonction de différents facteurs (pédologie, climat,
hydrologie…) entre 1968 et 1979. Ces cartes auraient pu être d’un grand intérêt, mais il ne
nous a pas été possible de les obtenir. Elles n’ont pas été numérisées.
La situation serait trop simple si chacune des terres étudiées correspondait à un seul
sol. Ce n’est pas le cas. Dans son étude présentée dans El Proyecto Michoacán140, Jean-Noël
Labat réalise sa carte pédologique de la région en constituant des entités géographiques les
plus homogènes possible. Elles regroupent généralement deux types de sols, voire trois,
138
LABAT J.-N., 1992 : 79 139
On parle de géoréférencement. 140
LABAT J.-N., 1992 : 73-111
72
rarement un seul. Nous devrons donc adapter les niveaux de compatibilité agricole que nous
avons définis dans le chapitre 5 pour chacun des cas.
Les dix-huit sols – ou associations de sols – identifiées pour la région sont
répertoriées dans le tableau ci-dessous (fig. 17). Nous ne pourrons malheureusement pas
être extrêmement précis pour ce qui est de la définition des compatibilités agricoles. En
effet, nous ne savons pas dans quelles proportions les sols sont associés. Toutefois, le
lecteur constatera par lui-même que l’on note certaines redondances dans les associations
(ex : « lithosols/vertisols » et « vertisols/lithosols »). Aucune explication n’est donnée dans la
publication, mais nous ne pensons pas que cela soit anodin et les récurrences sont trop
nombreuses pour ne pas avoir de signification. Nous pensons donc que le premier sol
mentionné représente une part plus importante que le second. Pour rester en accord avec
cette acception, nous avons donc attribué une pondération différentielle en suivant la
logique suivante. Très simplement, le premier sol a été considéré comme deux fois plus
représenté que le second. La compatibilité agricole du premier vaut donc deux fois plus que
celle du second. Ainsi, pour reprendre l’exemple susmentionné, dans le cas « compatibilité
lithosols/vertisols », nous avons considérer les lithosols deux fois plus représentés
(pondération de 2) que les vertisols (pondération de 1). L’inverse pour le cas
« vertisols/lithosols ». Pour que les calculs ne soient pas biaisés, nous avons attribué une
pondération de 3 au sol quand il est le seul à être représenté dans l’aire géographique. Enfin,
pour l’unique cas où l’on a trois types de sol – « Vertisols/Vertisols chromiques/Luvisols
vertiques » –, les deuxième et troisième types de sols sont relativement similaires (sols
vertiques). Aussi avons-nous décidé de les regrouper et de leur attribuer une pondération de
1 pour faciliter la réalisation du tableau.
Nous sommes ensuite partis du postulat que les compatibilités « moyennes » et
« bonnes » étaient mises en culture. Les deux autres non, ou moins sûrement. Nous avons
donc fait la somme des colonnes deux à deux : « bonne » + « moyenne » (Σ 1) et « plutôt
mauvaise » + « Improbable » (Σ2). Les colonnes des totaux ont alors été converties en
pourcentages sur un graphique (fig. 18), dans lequel quatre catégories de compatibilité –
« bonne », « moyenne », « plutôt mauvaise » et « improbable » – sont aisément
identifiables.
73
Sol ou association de sols
Pondérations des compatibilités agricoles en fonction du type de sol
Bonne Moyenne
Σ 1 Plutôt mauvaise
Improbable Σ2
Andosols
3
0
3
0
0
0
Andosols/Lithosols
2
0
2
0
1
1
Lithosols/Cambisols
1
0
1
0
2
2
Lithosols/Vertisols
0
0
0
1
2
3
Luvisols chromiques/Cambisols
2
1
3
0
0
0
Luvisols chromiques/Luvisols vertiques
1,5
1,5
3
0
0
0
Phaeozems/Lithosols
2
0
2
0
1
1
Phaeozems/Vertisols
2
0
2
1
0
1
Phaeozems/Vertisols chromiques
2,5
0,5
3
0
0
0
Vertisols
0
0
0
3
0
3
Vertisols/Lithosols
0
0
0
2
1
3
Vertisols/Luvisols vertiques
0,5
0,5
1
2
0
2
Vertisols/Phaeozems
1
0
1
2
0
2
Vertisols/Vertisols chromiques
0,5
0,5
1
2
0
2
Vertisols/Vertisols chromiques/Luvisols vertiques
0,5 0,5 1 2 0 2
Vertisols chromiques/Luvisols chromiques
1,5
1,5
3
0
0
0
Vertisols chromiques/Luvisols vertiques
1,5
1,5
3
0
0
0
Vertisols chromiques/Vertisols
1
1
2
1
0
1
Fig.17 – Pondérations des compatibilités théoriques des sols de la zone Vertiente Lerma
Fig. 18– Graphe des
À la lumière, de ce graphique simple, ordonné pour mettre en valeur les quatre
catégories, nous avons pu attribuer une compatibilité théorique à chacun des espaces
définis par Jean-Noël Labat. Ces résultats sont c
Qgis, les compatibilités ont ensuite été attachées au(x) type(s) de sol(s) correspondant
la carte que nous avions numérisée au préalable. Ainsi, nous avons obtenu une carte de
notre zone d’étude où sont représentés les espaces propices à l’agriculture du maïs et les
aires impropres ou mal adaptées à la culture de la céréale
avons appelé cette couche « compatibilité agricole
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Graphe des pourcentages de compatibilités agricoles
À la lumière, de ce graphique simple, ordonné pour mettre en valeur les quatre
catégories, nous avons pu attribuer une compatibilité théorique à chacun des espaces
Noël Labat. Ces résultats sont consignés dans la figure 19, page suivante. Sur
Qgis, les compatibilités ont ensuite été attachées au(x) type(s) de sol(s) correspondant
la carte que nous avions numérisée au préalable. Ainsi, nous avons obtenu une carte de
représentés les espaces propices à l’agriculture du maïs et les
aires impropres ou mal adaptées à la culture de la céréale (carte 9 dans l’annexe)
compatibilité agricole ».
74
À la lumière, de ce graphique simple, ordonné pour mettre en valeur les quatre
catégories, nous avons pu attribuer une compatibilité théorique à chacun des espaces
, page suivante. Sur
Qgis, les compatibilités ont ensuite été attachées au(x) type(s) de sol(s) correspondant(s) sur
la carte que nous avions numérisée au préalable. Ainsi, nous avons obtenu une carte de
représentés les espaces propices à l’agriculture du maïs et les
(carte 9 dans l’annexe). Nous
Σ 2
Σ 1
75
Sol ou association de sols
Compatibilité théorique avec la mise en culture du maïs (outillage préhispanique)
Andosols
Bonne
Andosols/Lithosols
Moyenne
Lithosols/Cambisols
Plutôt mauvaise
Lithosols/Vertisols
Improbable
Luvisols chromiques/Cambisols
Bonne
Luvisols chromiques/Luvisols vertiques
Bonne
Phaeozems/Lithosols
Moyenne
Phaeozems/Vertisols
Moyenne
Phaeozems/Vertisols chromiques
Bonne
Vertisols
Improbable
Vertisols/Lithosols
Improbable
Vertisols/Luvisols vertiques
Plutôt mauvaise
Vertisols/Phaeozems
Plutôt mauvaise
Vertisols/Vertisols chromiques
Plutôt mauvaise
Vertisols/Vertisols chromiques/Luvisols vertiques
Plutôt mauvaise
Vertisols chromiques/Luvisols chromiques
Bonne
Vertisols chromiques/Luvisols vertiques
Bonne
Vertisols chromiques/Vertisols
Moyenne
Fig. 19 – Compatibilité théorique avec la mise en culture du maïs des sols de la zone Vertiente Lerma
76
C. Catchment analysis : les sites du sud du Lerma et leurs territoires d’exploitation
Comme nous l’avons évoqué dans le premier chapitre, les territoires d’exploitation
correspondent à des espaces au sein desquels les sites peuvent obtenir une ou plusieurs
denrées spécifiques. Nous avons souhaité établir de tels espaces pour donner une idée des
distances entre le centre de chaque site et les terres qu’il est susceptible de cultiver. Nous
avons au préalable défini les potentiels agricoles des terres de la zone d’étude. Restait à
savoir jusqu’où les habitants peuvent aller pour obtenir des terres arables. La réponse s’est
présentée à nous à la lecture de certains travaux de « catchment analysis ». L’agriculteur
traditionnel ne parcourra pas une distance énorme pour se rendre à son champ. Surtout s’il
doit le faire régulièrement. La distance maximale moyenne généralement admise est de 5
kilomètres à pied141. Passé cette limite, la dépense énergétique n’est plus rentable dans le
cadre de l’agriculture. Cette distance est considérée comme parcourue au moins deux fois
dans une même journée (aller et retour). Nous ne perdons pas de vue que notre région est
montagneuse et que la majorité des sites de notre corpus est située sur les versants ou les
sommets. Les 5 kilomètres sont donc peut-être à revoir à la baisse puisque l’effort produit
sur terrain plat n’est pas le même que sur terrain accidenté. Les auteurs pondèrent
généralement les territoires d’exploitation. 1km de rayon vaudra plus que 2km, car plus
rapidement accessible, etc. Cependant, nous ne sommes pas encore en mesure de prendre
en compte l’importance de la topographie ou d’autres facteurs qui influe sur la durée du
trajet.
1. Territoires d’exploitation globaux et potentiels agricoles
Nous nous sommes dans un premier temps contenté de créer des zones de
tampons142 régulières autour de chaque site, sans prendre en compte le facteur
topographie. En accord avec l’acception courante, nous avons défini la largeur maximale des
tampons à 5000 mètres. De cette manière, nous avons obtenu des cercles de rayon r =
5000m autour de chaque site et ce pour chaque phase chronologique. Nous souhaitions voir
quels étaient alors les types de terres recoupés par nos tampons. Deux types de fichiers
tampons ont été créés pour chaque analyse. Le premier matérialise les cercles autour de
141
VITA-FINZY C. & E.S. HIGGS, 1970 cités dans FLANNERY K., 1976 : 91-92 142
Dans un SIG, un tampon ou buffer est une aire d’une largeur choisie constitué autour d’un point, d’une ligne ou d’un polygone.
77
chaque site. Cette couche a été nommée « Phase_buffer5000 ». Sur des échantillons allant
de 13 à 32 établissements proches dans l’espace, les recoupements des tampons sont trop
nombreux pour que le fichier soit facilement interprétable. C’est pourquoi nous avons créé
un second fichier qui présente une union de tous les cercles de façon à former un polygone
(couche « Phase_buffer5000_union »). À partir de ce second fichier, via l’outil d’intersection,
il nous a été possible de concevoir une couche dont la surface était celle du polygone créé,
avec les mêmes rubriques que la couche « compatibilité agricole ». Nous avons alors utilisé
la calculatrice du logiciel pour connaître les surfaces couvertes par chaque niveau de
compatibilité agricole. Elles ont été traduites en pourcentages. Le tableau et les graphes
suivants consignent les résultats de ces analyses.
Les cartes 10 à 13 en annexes sont des représentations graphiques de ces analyses.
Surfaces des terres arables théoriques
(%) Phase chronologique
Bonne Moyenne Plutôt mauvaise Improbable
Lupe
11,60 3,30 82,87 2,22
La Joya
13,97 8,86 75,27 1,91
Palacio
12,62 10,91 74,64 1,84
Milpillas
18,83 14,98 66,19 0
Fig. 20 – Pourcentages de terres arables à proximité des sites en fonction des phases d’occupation
Fig 21. – pourcentages des terres arables théoriques par phase
À la lecture des figures
improbable sont négligeables. Elles ne sont par ailleurs représentées qu’à l’extrême nord de
la zone d’étude. Il est évident que ces espaces n’ont pas été sélectionnés par
préhispaniques.
L’écrasante majorité des terres à proximité des sites présentent un potentiel agricole
plutôt mauvais. Il est néanmoins notable que la tendance générale est à la réduction de
cette majorité au cours du temps. Des 83% de la
pendant La Joya et Palacio qui présentent des proportions relativement similaires pour tous
les niveaux de potentialité agricole. Ces deux phases voient en effet l’augmentation des
pourcentages en « bonnes
explications.
12%3%
83%
2%
Pourcentages des terres arables théoriques, phase Lupe
Bonne Moyenne
Plutôt mauvaise Improbable
12%
11%
75%
2%
Pourcentages des terres arables théoriques, phase Palacio
Bonne Moyenne
Plutôt mauvaise Improbable
pourcentages des terres arables théoriques par phase
la lecture des figures 20 et 21, on observe que les terres où la culture du maïs est
improbable sont négligeables. Elles ne sont par ailleurs représentées qu’à l’extrême nord de
la zone d’étude. Il est évident que ces espaces n’ont pas été sélectionnés par
L’écrasante majorité des terres à proximité des sites présentent un potentiel agricole
plutôt mauvais. Il est néanmoins notable que la tendance générale est à la réduction de
cette majorité au cours du temps. Des 83% de la phase Lupe, on passe ensuite à 75%
pendant La Joya et Palacio qui présentent des proportions relativement similaires pour tous
les niveaux de potentialité agricole. Ces deux phases voient en effet l’augmentation des
» et « moyennes » terres. On peut imaginer plusieurs
3%
Pourcentages des terres arables théoriques, phase Lupe
Moyenne
Improbable
14%
75%
2%
Pourcentages des terres arables théoriques, phase La Joya
Bonne Moyenne
Plutôt mauvaise Improbable
11%
Pourcentages des terres arables théoriques, phase Palacio
Moyenne
Improbable
19%
66%
0%
Pourcentages des terres arables théoriques, phase Milpillas
Bonne Moyenne
Plutôt mauvaise Improbable
78
, on observe que les terres où la culture du maïs est
improbable sont négligeables. Elles ne sont par ailleurs représentées qu’à l’extrême nord de
la zone d’étude. Il est évident que ces espaces n’ont pas été sélectionnés par les populations
L’écrasante majorité des terres à proximité des sites présentent un potentiel agricole
plutôt mauvais. Il est néanmoins notable que la tendance générale est à la réduction de
phase Lupe, on passe ensuite à 75%
pendant La Joya et Palacio qui présentent des proportions relativement similaires pour tous
les niveaux de potentialité agricole. Ces deux phases voient en effet l’augmentation des
» terres. On peut imaginer plusieurs
9%
Pourcentages des terres arables théoriques, phase La Joya
Moyenne
Improbable
19%
15%
Pourcentages des terres arables théoriques, phase Milpillas
Moyenne
Improbable
79
- Cela peut être l’expression d’une recherche de terres favorables en parallèle avec
l’expansion démographique dénotée par l’augmentation du nombre de sites.
- Cela peut aussi refléter le fait qu’il n’y a pas de choix des terres et simplement
que les nouveaux établissements recoupent par hasard des zones où le potentiel
agricole est meilleur.
Toutefois, à la phase Milpillas, où le nombre de sites diminue considérablement, la
seconde hypothèse n’est plus valide. Sauf si, par hasard encore, le déplacement vers le sud
amène les établissements vers de meilleures terres. Pour tenter de clarifier les choses, il
nous fallait nous intéresser aux sites au cas par cas.
2. Les sites et les territoires d’exploitation individuels
Nous n’avons avec les graphes ci-dessus qu’une idée des potentiels agricoles dans
leur globalité. Nous voulions néanmoins savoir quels étaient les sites qui avaient accès aux
meilleures terres ou si, dans l’ensemble, on cherchait à avoir un accès à ces espaces. Pour ce
faire, il nous a suffit de superposer notre couche « Phase_buffer5000 » pour savoir quel site
possède un territoire d’exploitation théorique lui permettant d’avoir accès à telle ou telle
terre cultivable. Au cas par cas, nous avons donc pu réaliser le tableau suivant (fig. 22).
80
Phase chronologique
Sites ayant accès à des terres où la potentialité agricole est…
« bonne » « moyenne » « plutôt mauvaise » « improbable »
Lupe
50 ; 51 ; 75 ; 78 ; 80 ; 103 ; 104 ; 135 ; 136 ; 141 ; 368
75 ; 78 ; 80 ; 402 ; 403
Tous 398
Total Lupe 11/24 5/24 24/24 1/24
Pourcentage 45,83% 20,83% 100,00% 4,17%
La Joya
48 ; 74 ; 78 ; 79 ; 81 ; 82 ; 102 ; 103 ; 136 ; 137 ; 139 ; 140 ; 142 ; 331 ; 332 ; 333 ; 336 ; 337 ; 338 ; 399
74 ; 78 ; 79 ; 81 ; 150 ; 331 ; 332 ; 333 ; 336 ; 337 ; 338 ; 402
Tous sauf 337 et 338 398
Total La Joya 20/32 12/32 30/32 1/32
Pourcentage 62,50% 37,50% 93,75% 3,13%
Palacio
46 ; 48 ; 78 ; 79 ; 102 ; 103 ; 131 ; 132 ; 133 ; 136 ; 137 ; 144 ; 332 ; 334 ; 339 ; 367 ; 368
77 ; 78 ; 79 ; 332 ; 334 ; 339 ; 402
Tous 357 ; 397 ; 398
Total Palacio 17/30 7/30 30/30 3/30
Pourcentage 56,67% 23,33% 100,00% 10,00%
Milpillas
49 ; 76 ; 101 ; 103 ; 131 ; 132 ; 335 ; 340
76 ; 335 ; 340 Tous sauf 335 et 340 Aucun
Total Milpillas 8/13 3/13 11/13 0/13
Pourcentage 61,54% 23,08% 84,62% 0,00% Fig. 22– Les sites et les terres arables de leurs territoires d’exploitation.
Tous les sites ont accès à des terres à potentialité plutôt mauvaise. Pourtant,
exception faite de la phase Lupe où 46% des sites ont accès à de « bonnes » terres, c’est
ensuite près de 60% des établissements qui ont cet accès à ces espaces. Ajoutons-y les terres
« moyennes ». On ne comptera qu’une fois les sites ayant accès aux deux types de terres en
même temps.
81
Phase chronologique Sites ayant accès à de « bonnes » ou « moyennes » terres
Lupe
13/24 soit 54,17%
La Joya
22/32 soit 68,75%
Palacio 19/30 soit 63,33%
Milpillas
8/13 soit 61,54%
Fig. 23 – Proportions des sites avec accès à de « bonnes » ou « moyennes » terres
On a donc, toutes périodes confondues, plus de 50% des sites qui ont accès à des
terres arables aux potentiels moyen et bon. Nous ne pensons pas que cela soit anodin.
Notons, qui plus est, que, mis à part MICH. 150, tous les centres de la région font partie des
sites qui ont accès aux meilleurs terres (MICH. 48, 49, 50, 51 et 103).
Pour aller plus loin, il nous fallait savoir où étaient implantés les nouveaux
établissements entre chaque phase pour voir si l’on choisissait alors des zones aux terres de
qualité.
3. Questions de chronologie
Pendant la phase Lupe initiale, il est notable que les trois centres MICH. 50, 51 et 103
soient situé à proximité des « bonnes » terres du cerro Agostadero. Quelques sites ont accès
à des terres de qualité aussi, près du cerro El Fresno (MICH. 75 et 135 notamment) ou dans
la vallée du Rio Angulo (MICH. 78 et 80). Les autres sites sont plus généralement à proximité
de terres moins favorables.
Entre Lupe et La Joya, de nombreux établissements sont créés. Seuls 8 sites datés de
la phase Lupe continuent d’être occupés. Ainsi, La Joya voit la création de 24 sites. Ceux de la
vallée de Bellavista-Epejan ont globalement accès à des terres « plutôt mauvaises ». D’autres
gravitent autour de MICH. 103 et ont, dans un certaine mesure, accès aux « bonnes » terres
du cerro El Agostadero (MICH. 139, 140, 142 et 399), voire sont installés directement sur ces
espaces (MICH. 48 et 102). Finalement, les plus notables sont les nouveaux établissements
de la vallée du Rio Angulo, car, des 9 sites qui y sont créés, tous sont à proximité de terres
particulièrement adaptées à l’agriculture (MICH. 79, 81, 82, 331, 332, 333, 336, 337 et 338).
Notons finalement le cas particulier de MICH. 74, implanté en plein milieu des andosols
fertiles du cerro El Fresno.
82
Au début du Xème siècle, alors que s’amorce la transition entre La Joya et Palacio, le
nombre de sites dans la vallée du Rio Angulo diminue. Les trois nouveaux établissements
restent cependant à proximité des terres « bonnes » et « moyennes » de cette région (MICH.
77, 334 et 339). Plus à l’ouest, dans la vallée de Bellavista-Epejan, les deux sites qui
subsistent, MICH. 136 et 137, continue d’avoir un accès, restreint mais effectif, à des terres
de qualité. 5 établissements sont créés, dont une réoccupation (MICH. 368). Sur les quatre
autres, MICH. 160 et 400 sont implantés dans des espaces sans intérêt agricole particulier. À
l’inverse, MICH. 46 et 367, au sud, sont à proximité des « bonnes » terres des cerros El
Agostadero et El Fresno. La tendance générale semble être à la descente vers le sud qui
présente des terres de meilleure qualité, mais aussi où est installé le centre MICH. 48 qui
peut s’avérer être un attrait. Dans le complexe montagneux du cerro El Agostadero, un peu
plus au sud-ouest, MICH. 48, 102 et 103 perdurent. Parallèlement, MICH. 131, 132 et 133,
nouvellement établis, le sont dans des espaces particulièrement propices à la mise en
culture. La vallée de Los Fresnos-Penjamillo voit l’apparition de quatre nouveaux sites
(MICH. 144, 147, 357 et 397). MICH. 148 est réoccupé. Excepté MICH. 144 au sud, aucun de
ces sites n’a accès à des terres de qualité. Ces installations sont donc difficilement
interprétables en termes de potentialité agricole. Cependant, notons tout de même que
l’occupation de cette région est bien moindre pendant la phase La Joya.
Enfin, pour la phase Milpillas, le choix des terres nous parait relativement évident. En
effet, des 13 sites alors occupés, on compte 8 sites déjà présents auparavant. Parmi eux, 5
étaient occupés phase Palacio et 3 sont des réoccupations de sites Lupe ou La Joya. Restent
donc 5 nouveaux établissements purement Milpillas (MICH. 49, 76, 101, 335 et 340). Il suffit
d’un coup d’œil à la figure 22 pour s’apercevoir qu’ils ont tous accès à des terres à
potentialité « bonne ». Plus encore, deux d’entre eux, MICH. 335 et 340, n’ont même pas de
terres « plutôt mauvaise » dans leurs territoires d’exploitation.
Sans pouvoir nous avancer de façon formelle, il semblerait donc que le potentiel
agricole des terres qui entourent les hommes préhispaniques ne soit pas complètement
laissé de côté. Nous pensons qu’il a au contraire pu avoir un certain poids dans les décisions
qui ont menées à l’installation des villages.
83
D. Le facteur végétation
L’importance de la végétation pour l’implantation des sites est un facteur difficile à
interpréter. Nous n’avons pas pu le prendre en compte de façon efficace. En effet, nous
n’avons à disposition que deux types d’information. Dans un premier temps, la végétation
actuelle. Dans un second, la végétation théorique avant anthropisation de Jean-Noël Labat
(cf. Chapitre 2). Ce n’est pas avec ces données que nous nous lancerons dans une tentative
de reconstitution de l’environnement ancien. Même théorique. Nous avons néanmoins
essayé d’en tirer des informations. Pour ce faire, nous avons numérisé la carte de végétation
théorique et récupéré celle de l’utilisation des sols et de la végétation actuelle143 sur le site
de l’INEGI au format .shp. Les couches de sites phase par phase y ont été superposées afin
de savoir dans quel environnement étaient implantés les établissements préhispaniques
(cartes 2 et 3). Tout au long de la séquence chronologique, centres, villages et hameaux
restent globalement dans les mêmes espaces. Les quatre vallées que nous avons décrites au
chapitre 2. Dans cette mesure, les écosystèmes où les populations préhispaniques ont
évoluées n’ont pas du changer drastiquement pendant les dix siècles d’occupation. Nous
venons cependant de mettre le doigt sur une donnée fondamentale : dix siècles
d’occupation. Il est impossible que l’installation d’agriculteurs pendant un tel laps de temps
n’ait pas eu de conséquences énormes sur l’environnement. Ne serait-ce qu’en mentionnant
l’indubitable déforestation qui a été pratiquée.
Ainsi, même si les sites sont tous situés dans des zones de forêt tropicale caducifoliée
et de chênes selon la végétation théorique, il nous parait présomptueux d’en tirer des
conclusions sur les espaces agricoles. En effet, ce type de végétation, relativement clairsemé,
ne devait pas constituer d’entrave majeure à l’expansion des agriculteurs. De même, quand
on observe la carte d’utilisation actuelle des sols et de végétation, on s’aperçoit que la
majorité des sites du corpus sont situés dans des espaces aujourd’hui mis en culture.
Agriculture qui, le plus souvent, est saisonnière et ne nécessite donc pas de démarches
importantes d’irrigation.
143
Uso del suelo y vegetacion
84
Sans reconstitution fiable de la végétation ancienne et du fait de notre indéniable
manque de connaissances sur les dynamiques qui président à l’évolution de celle-ci, nous
avons préféré nous limiter à ces quelques observations élémentaires.
Notre utilisation du SIG s’est limitée à la définition de potentiels agricoles et des
territoires d’exploitation des sites. Ce n’est certes qu’une première approche qui pose les
bases d’une méthodologie, mais nous pouvons néanmoins tirer quelques conclusions des
analyses réalisées. Ce ne sont que des ébauches d’hypothèses au vu des nombreuses limites
de l’étude. Il est maintenant temps de faire une synthèse de ce que nous avons pu
apprendre.
86
- CHAPITRE 7 -
SSSSYNTHÈSE, LIMITES ET PERSPECTIVES
Après six chapitres à mettre en place, présenter et donner les résultats de notre
étude, il est temps de faire le bilan des apports et des manques. Nous espérons que les
premiers sont là. Nous sommes sûrs que les seconds le sont.
A. Les populations pré-tarasques du sud du Lerma et leur environnement
Combien de temps leur a-t-il fallut pour édifier les vingt-quatre premiers villages ?
Quel fut le premier mis en place ? Qui décida que l’on devait arrêter de chercher et
construire une nouvelle vie ici ? Autant de questions auxquelles on ne pourra très
certainement jamais donner de réponses. Toujours est-il qu’à l’aube du VIIIème siècle de
notre ère, le sud du Lerma, encore inviolé par les travaux des champs, est colonisé par une
ou plusieurs communautés d’agriculteurs sédentaires. Peut-être sont-ils les héritiers de
civilisations nordiques venues reconquérir leurs territoires d’antan, comme plus tard le laisse
penser certains traits architecturaux144. Et peut-être sont-ils les ancêtres des tarasques qui
s’installeront dans le malpaís de Zacapu145. Les recherches entreprises dans la région par les
équipes françaises depuis maintenant près de 30 ans et, a fortiori, celles pratiquées dans
tout l’Occident du Mexique, ont commencé à éclaircir quelque peu ces interrogations. C’est
avec la prétention de participer à cette tâche que nous avons entamé l’esquisse d’une étude
sur l’agriculture de ces pré-tarasques en relation avec l’organisation spatiale de leur habitat.
1. Des travaux et des jours : agriculture traditionnelle au sud du Lerma
Pendant près de huit siècles, les hommes préhispaniques vont remanier le milieu
montagnard qui les entoure, le façonner pour en faire leur jardin. Il est indéniable que des
démarches de déforestation ont été entreprises. Si l’on admet que le paysage ressemblait
144
FAUGÈRE B., 1991 : 55-58 145
MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON, 2005
87
alors à celui théorisé par Jean-Noël Labat, la tâche n’a pas du être des plus minces. Une fois
les chênes, pins et arbres tropicaux délogés des espaces choisis, les agriculteurs ont préparé
leurs terres à la culture traditionnelle du maïs et d’autres cultigènes. Ils ont probablement
choisi de cultiver leurs champs au rythme du régime pluvial, comme le font aujourd’hui leurs
lointains descendants146. Hypothétiquement, les hommes, équipés seulement d’un outillage
de bois et de pierres, réalisaient donc un labour, autour de mars, au début de la saison des
pluies. C’est alors qu’ils semaient les graines avec des bâtons fouisseurs. La récolte étaient
ensuite régulièrement entretenue jusqu’à la période de la moisson. On a certainement
pratiqué le sarclage et le buttage, comme la protection des champs contre la faune locale.
Aux alentours d’octobre, alors que la pluie s’apprêtait à s’arrêter pour les mois à venir, on
moissonnait. Les champs étaient ensuite sûrement labourés à nouveau, puis nivelés. Peut-
être entretenait-on par la suite les terres agricoles pendant la saison sèche, en attendant le
prochain semis. Nous ne pouvons pas pour le moment savoir quelle était la fréquence de ces
activités. Pendant certaines périodes, on devait se rendre quotidiennement aux champs.
Pendant d’autres, peut-être ne s’y rendait-on qu’une fois par semaine, voire moins.
Toutefois, au vu de la topographie et sachant que la plupart des villages était située en
hauteur, on devait pouvoir garder un œil sur son champs, comme sur ceux des voisins, assez
facilement.
2. Terrasses et fonds de vallées
L’hypothèse de la pratique d’une agriculture pluviale traditionnelle est renforcée par
l’absence de trace de systèmes d’irrigation retrouvée. Il n’est cependant pas exclu que des
travaux de drainage aient été pratiqués, sans pour autant laisser de vestiges visibles. C’est en
effet au moins les pentes des montagnes qui étaient cultivées. Les réseaux de terrasses en
attestent. Aussi semble-t-il aisé qu’elles aient pu être creusées d’une ou plusieurs tranchées
pour laisser le surplus d’eau s’écouler. Tranchées qui auraient aujourd’hui entièrement
disparues. Dans les vallées, travailler les lourds vertisols, bien que fertiles, devaient
constituer une épreuve de taille. Nous n’excluons pas l’hypothèse qu’ils aient pu être mis en
culture, d’autant qu’il reste étrange de n’avoir presque aucun sites en bas de versants. Mais,
à la lumière des données que nous avons récoltées sur la pédologie régionale, il semblerait
que les terres les plus abordables pour les communautés préhispaniques soient réparties sur
146 ROMERO J., 1995 : 71 cité par AYALA-ORTIZ D.A. & R. GARCÍA-BARRIOS, 2009
88
les flancs de montagnes. Une autre hypothèse est envisageable. On sait par ailleurs147 que
les malpaís au nord-ouest de Zacapu ont été remblayés par de la terre importée pour nivelé
le terrain et édifier les structures. Il est donc possible que quelques siècles plus tôt, les
hommes du versant Lerma aient pu utiliser les mêmes techniques pour remblayer leurs
terrasses. Peut-être que la terre qu’ils utilisaient provenait des fonds de vallée. Ces mêmes
vertisols, durs à travailler in situ, devenaient alors bien plus intéressants. Nous n’avons
malheureusement aucun moyen de vérifier cette hypothèse pour le moment. De même,
nous ne pouvons pas connaître la chronologie de l’édification des terrasses par les
communautés concernées. En ont-ils édifié dès le départ ? Résultent-elles d’un
agrandissement des réseaux sur le long terme ? Cette expansion pourrait-elle être le reflet
de l’épuisement d’autres terres et ainsi de la recherche de nouveaux espaces ? Ne pouvant
pas répondre à ces questions, c’est par la théorie que nous sommes passés.
3. Les villages et leurs territoires d’exploitation
Nous ne connaissons pas l’étendue exacte des réseaux de terrasses. Nous ne savons
pas pour sûr si les fonds de vallées étaient cultivés. Nous savons cependant où sont les sites.
Du haut des versants, les hommes vivaient en familles étendues dans des groupes de
maisons rassemblés en villages de différentes dimensions. Ils allaient régulièrement
travailler leurs champs. La plupart des terres qui les entouraient étaient difficilement
cultivables. Pourtant, qu’ils les aient ou non cultivées quand même, ou qu’ils aient
transporté la terre pour créer artificiellement des zones exploitables, il est notable que, dans
un rayon de cinq kilomètres, la moitié, voire plus, des sites ait accès à des terres plus
facilement utilisables. Et ce, quelle que soit la période. De plus, les sites les plus importants,
qui potentiellement regroupent le plus de personnes, sont tous particulièrement bien placés
en regard de ces terres de qualité. Peut-être que les terres moins bonnes suffisaient à
l’entretien de la population de petits groupes de villages vivant en autarcie, mais devenaient
limitées dès lors que les bouches à nourrir étaient plus nombreuses. Peut-être que
l’existence, dans les grands sites, d’une frange de la communauté détachée du monde
agricole nécessitait un investissement plus grand de la part des paysans. Au vu de
l’architecture cérémonielle que l’on observe dans certains sites, comme la structure à
147
MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON, 2005
89
colonnes de San Antonio Carupo (MICH. 103)148, il est assez raisonnable d’imaginer la
présence de personnes attachés au maintien du monde idéologique. Tant physiquement, par
l’entretien des structures bâties, que spirituellement, par la pratique des rituels dans des
sociétés préhispaniques si imprégnées de surnaturel.
Au cours du temps, on note une certaine tendance des sites à se rapprocher des
zones les mieux dotées en bonnes terres arables. On l’observe assez distinctement au
travers du peuplement massif de la vallée du rio Angulo pendant la phase La Joya, ou avec
l’établissement de nouveaux sites sur les versants fertiles du cerro El Agostadero en phase
Palacio. Cependant, en parallèle, la vallée de Los Fresnos-Penjamillo, fortement peuplée
pendant la phase Palacio, est dépourvue de terres réellement intéressantes. Qui plus est, le
rapprochement de certains sites des terres de qualité n’est peut-être pas seulement du à
l’attrait des sols eux-mêmes. En effet, pendant la phase Palacio, l’installation de sites au sud
de la région est peut-être mue, dans une certaine mesure, par l’existence des centres tels
que Las Iglesias de Copitiro (MICH. 48) ou San Antonio Carupo (MICH. 103). Toutefois,
pendant la phase Milpillas, la recherche de bonnes terres semble avoir un poids non-
négligeable en ce qui concerne la création de nouveaux sites.
Enfin, précisons que notre interprétation se fonde sur des rayons de 5km. Aussi,
certains sites n’ont accès aux terres de qualité qu’au prix d’environ une heure de marche
pour leurs habitants. Est-ce alors rentable ?
4. Une société d’agriculteurs
Notre analyse reste très générale et ne fait que creuser un peu plus la surface d’une
organisation spatiale encore difficile à cerner. Proposer des interprétations concernant
l’organisation de la société est donc encore risqué. Cependant, nous souhaitons tout de
même évoquer ici quelques hypothèses, soulevées par les quelques résultats obtenus.
Nous avons déjà évoqué la possibilité de l’existence de personnes n’entrant pas dans
la sphère des tâches agricoles, ce qui expliquerait le besoin des centres de se positionner à
proximité de terres particulièrement rentables. Peut-être des prêtres, des artisans
spécialisés ou une élite. Mais rien n’est moins sûr. Il nous semble en revanche raisonnable
148
FAUGÈRE B., 1991 : 55
90
de penser que des dynamiques d’entre-aide ou de partage existent entre les sites. En effet,
certains sites n’ont qu’un accès limité aux sols de qualité. Si, et seulement si, ces espaces
sont nécessaire à leur survie, il est envisageable que les terres qui s’y trouvent aient été
partagées. Dans le même registre, prenons les sites de la vallée de Los Fresnos-Penjamillo.
Sans accès aux zones facilement exploitables, on peut penser qu’une entre-aide a pu être
mise en place entre les habitants des sites proches pour cultiver efficacement des terres
difficile à travailler.
L’ébauche de cette « catchment analysis » nous a apporté des résultats bien plus
stimulants que nous ne l’espérions. Toutefois, sa simplicité a un caractère ambigu. Elle
constitue d’abord la première limite puisqu’elle mérite d’être approfondie. Mais
parallèlement, c’est par là qu’elle ouvre vers de nombreuses perspectives.
B. Vers une meilleure connaissance de la société des communautés
préhispaniques du versant Lerma : limites et perspectives
1. Questions de pédologie
La définition des potentiels agricoles que nous donnons reste extrêmement
sommaire. Nous n’avons pas la prétention de nous considérer géologue. Loin de là. Il serait
donc nécessaire d’approfondir cette approche avec plus de rigueur scientifique. Notamment
en ayant accès à des identifications plus précises de la nature des sols où l’on trouverait les
taux d’acidité, par exemple, ou les teneur en éléments chimiques qui peuvent avoir un
impact sur la croissance du maïs. Il serait aussi important de s’intéresser aux dynamiques qui
entrent en jeu dans la formation des sols. Nous ne savons pas s’il est possible d’avoir une
idée de la composition des sols à l’époque préhispanique et notre étude s’est donc basée sur
des données actuelles. Le processus d’humification peut s’avéré très rapide et, selon la
91
nature de la roche-mère sur laquelle l’humus repose, le complexe organo-minéral peut
évoluer très vite. Assez vite pour qu’un sol préhispanique soit différent du sol actuel. Qui
plus est, les hommes du passé ont, comme nous l’avons évoqué, modifier drastiquement
leur environnement. Dès les premières phases de l’anthropisation, et même si les moyens
sont traditionnels, l’écosystème est changé149. Nous sommes bien loin du mythe de
l’agriculteur traditionnel qui ne fait qu’un avec son environnement. Les machines et
fertiliseurs modernes ont probablement une influence considérable, mais il n’est pas évident
que les techniques préhispaniques n’est pas eu un impact, même moindre, qui reste
considérablement important.
2. Questions de végétation
La première carte de végétation utilisée est théorique. La seconde, actuelle. Là
encore, les limites sont évidentes. À quoi ressemblait réellement le paysage dans lequel ont
évolué les premiers habitants de la région ? La question reste en suspend. Nous n’avons, de
plus, fait que quelques observations concernant cette végétation. Les informations qu’elle
renferme pourraient être exploitées de façon bien plus importante. Nous ne sommes, par
exemple, pas en mesure de savoir quel investissement est nécessaire pour mettre en culture
une forêt. Combien d’hommes cela demande-t-il ? Combien de temps ? Quels en sont les
conséquences pour le milieu ? Cela aura-t-il une tendance à produire plus de matière
organique en surface à la faveur du pourrissement du bois ? Ou la mort des racines rendra-t-
elle les sols fragiles et sujets à l’érosion ? Et si fertilité il y a, pour combien de temps ? De très
nombreuses questions qu’il serait intéressant d’approfondir.
Dans la même veine, il serait souhaitable de connaître les apports nutritifs du maïs.
Apports qui pourraient être mis en relation avec la fertilité des sols et ainsi indiqué les
ressources théoriques que renferme un lopin de terre. Nous pourrions alors savoir si le
milieu au sud du Lerma suffisait à nourrir sa population, si les terres devaient être partagées
ou si d’autres pratiques, comme la chasse, étaient nécessaires.
149 O'HARA, S.L., F.A. STREET-PERROTT & T.P. BURT, 1993
92
Enfin, il serait intéressant de prendre en compte les autres cultigènes qui ont pu être
plantés et consommés par les communautés préhispaniques. La courge et le haricot sont,
par exemple, deux concurrents de choix.
3. Questions de topographie
Encore un point qui mériterait une étude approfondie. Balbutiant avec le SIG, nous
n’avons malheureusement pas pu faire entrer le facteur topographie qui, dans ce milieu
relativement vallonné, peut avoir une importance majeure. D’abord pour la mise en culture.
Pourquoi préférer un système de terrasses ? Est-il le seul utilisé ? Peut-être en tire-t-on des
avantages particuliers. Faciliter le drainage ? Assurer un apport en eau régulier mais éviter
l’hydromorphie ? Garantir la fertilité de la terre en l’important, plutôt qu’en l’utilisant in
situ ?
La topographie a probablement un poids non-négligeable dans la question des
déplacements. Nos modestes territoires agricoles de 5 kilomètres résisteront-il à la
confrontation avec les facteurs géomorphologiques ? Quel agriculteur prendrait plusieurs
heures pour rejoindre son champ ? Les compatibilités agricoles que nous avons définies
sont-elles assez justes et assez déterminantes pour poussé les hommes à rechercher ces
espaces particuliers ? Les considèrent-t-ils seulement comme particuliers ? Comme nous
l’avons vu, certains indices laissent penser que oui. Mais notre ébauche de « catchment
analysis » ne reste qu’une ébauche. Elle se doit d’être perfectionnée dans l’avenir.
Enfin, les montagnes, malgré la fatigue qu’entraîne leur escalade, constituent des
points stratégiques naturels. Nous pourrions parler du simple avantage en temps de conflit.
Mais, en restant simplement dans le registre de l’agriculture, la hauteur permet d’accroître
le champ de vision. Nous souhaitons dans le futur pouvoir faire intervenir ce facteur qui
nous parait primordial. Maîtriser la visibilité de son territoire, c’est déjà avoir un coup
d’avance sur les évènements. Quand les agriculteurs préhispaniques sortaient de leurs
maisons, pouvaient-il jeter un coup d’œil à leur champ ? Probablement que
oui. Pareillement, ils voyaient très certainement leurs voisins, plus loin dans la vallée, avoir la
même attitude qu’eux. Quelle était alors la nature de leurs relations, ne serait-ce que dans le
cadre de l’agriculture ? Ennemis ? Concurrents pour l’accès aux terres ? Ou plutôt amis ?
Soutiens fidèles en cas de mauvaises récoltes ? À nouveau des questions dont nous brûlons
93
de connaitre un embryon de réponse puisque si proche de la vie quotidienne. Réaliser une
étude sur l’intervisibilité entre sites est possible à l’aide d’un SIG. Nous ne manquerons pas
d’apprendre à mettre en place ce type d’étude plein de promesses.
4. Questions de relations humaines
Nous avons déjà évoqué ce point dans les paragraphes précédents. Savoir combien
d’hommes sont requis pour abattre une forêt ou savoir quelles relations sont possibles entre
des voisins. Nous avons mentionné le fait que l’estimation du rendement des terres de la
région pourrait être intéressante. Celui-ci serait-il alors suffisant pour nourrir la population ?
L’agriculture est donc intimement liée à la subsistance. Laquelle est inséparable de la
démographie. Ainsi, au-delà des rapports qu’on pu entretenir les hommes, il pourrait être
particulièrement stimulant pour la recherche de pouvoir donner une estimation de la
population aux différentes périodes. Mis en relation avec les potentiels agricoles de la
région, cette estimation pourrait nous éclairer sur le mode de vie des populations
préhispaniques. Vivait-elle dans une relative abondance ? Ou ont-t-elles connu des périodes
de crises ?
Pour ne pas nous égarer (et dans une certaine mesure pour des raisons d’amour-
propre), nous arrêterons ici la liste des limites de notre étude et celle des perspectives qui
s’offre à nous. Nous retiendrons simplement que, les premières, comme les secondes, sont
très nombreuses.
94
CCCCONCLUSION
Hire Ticatame et les Uacusécha restent pour nous une fiction. Une création des
Tarasques pour légitimer leur position et mettre en valeur la grandeur de leur peuple.
Pourtant, derrière le mythe, il est certain que se cache une réalité complexe. L’archéologie
de l’Ouest Mexicain, des Tarasques et de leurs prédécesseurs permet d’éclaircir petit à petit
ces points qui demeurent obscures. Au-delà du groupe de féroces guerriers partis à la
conquête d’un nouvel espace pour fonder un royaume, l’étude de la région de Zacapu a
permis de mettre en évidence l’existence de sociétés organisées. Bien plus que ce que nous
en dit la Relation de Michoacán, ce sont des communautés parfaitement organisées qui
possède une maîtrise certaine de leur territoire. Elles sont très certainement gouvernées par
une forme de pouvoir (oligarchie ?) qui peut décider la population à entreprendre des
travaux conséquents, notamment pour des opérations de terrassement.
Dans la région Vertiente Lerma pendant le classique récent et le début du
postclassique, des sociétés de ce type prennent possession de l’espace et y évoluent
pendant plusieurs siècles. Nous avons revu quelles étaient les hypothèses qui ont été
proposées pour interpréter l’organisation de l’environnement. En ce qui concerne
l’agriculture, nous avons pu montrer que ce milieu, bien que riche, n’est pas forcément des
plus simple à exploiter pour les populations préhispaniques. Les terres sont en général assez
dures à travailler. Pourtant, cela n’a pas empêché les hommes d’y vivre et d’y prospérer.
Nous avons pu mettre le doigt sur le fait que les meilleures terres étaient parfois
recherchées. Ainsi, la subsistance via l’agriculture a très certainement eut un certain impact
dans les décisions prises par les pré-tarasques quant à l’installation de leurs villages. C’est là
le point que nous voulions mettre en exergue. Toutefois, il est évident que d’autres facteurs
entre en jeu. Politiques, peut-être, ou idéologiques. Il semblerait que l’on recherche parfois
à se rapprocher des centres, soit parce qu’ils concentrent hypothétiquement le pouvoir, soit
parce qu’ils rassemblent peut-être certains éléments liés à l’idéologie qui revêtent une
grande importance. Dans d’autres cas, la réponse est sûrement ailleurs, quand la présence
d’un centre ne suffit plus à constituer une motivation assez conséquente.
Ce travail, indéniablement limité, n’en est pas moins stimulant. Nous avons
conscience qu’il présente de nombreuses limites, dans la méthodologie comme dans son
application. Pourtant, nous avons été les premiers surpris d’avoir autant de matière à
réflexion. Aussi, même si énormément de points sont à revoir et beaucoup d’autres à
ajouter, l’efficience du système d’information géographique est incontestable. Il permet une
vision d’ensemble pertinente et ouvre la voie à un panel considérable de possibilités et
d’interprétations. Nous espérons pouvoir par la suite en tirer toujours plus.
95
TTTTABLE DES FIGURES
CHAPITRE 1
Fig.1 - carte générale des zones (issu de MICHELET D., 1992)………………………………………………12
CHAPITRE 2
Fig.2 - Situation générale de l’étude…………………………………………………………………………………….21
Fig.3 - diagramme ombrothermique de la ville de Zacapu (d’arpès LABAT J.-N., 1992)………..24
Fig.4 - Pédologie de la région de Zacapu (d’après LABAT J.-N., 1992)…………………………………..28
Fig.5 - Superficies potentielle et actuelle des types de végétation (d’après LABAT J.-N., 1992)
31
CHAPITRE 3
Fig.6 - Séquence chronologique de la région de Zacapu (d’après MICHELET D., 1992)…………35
CHAPITRE 4
Fig.7 - Bilan sur le choix du corpus……………………………………………………………………………………….52
Fig.8 - Bilan des sites du corpus phase par phase…………………………………………………………………55
CHAPITRE 5
Fig.9 - Travaux agricoles en 1950 (d’après SANDERS W.T., J.R. PARSONS & R.S. SANTLEY,
1979 : 237)………………………………………………………………………………………………………………………….58
Fig. 10 - Séquence des travaux agricoles hypothétique dans la zone Vertiente Lerma…………59
Fig. 11 - Granulométries (d’après BONIN S., 2006)………………………………………………………………61
Fig.12 - Triangle des textures (d’après
FAO150
)………………………………………………………………………62
Fig.13 - Tableau récapitulatif de la compatibilité théorique avec la mise en culture du maïs en
fonction des critères déterminants………………………………………………………………………………………65
Fig.14 - Compatibilités théoriques des sols de la zone Vertiente Lerma avec l’agriculture du
maïs……………………………………………………………………………………………………………………………………66
150
Confère références internet
96
CHAPITRE 6
Fig.15 - Symbologie des sites………………………………………………………………………………………………69
Fig.16 - exemple de symbologie pour les MNT…………………………………………………………………….70
Fig.17 - Pondérations des compatibilités théoriques des sols de la zone Vertiente Lerma…….73
Fig.18 - Graphe des pourcentages de compatibilités agricoles…………………………………………….74
Fig.19 - Compatibilité théorique avec la mise en culture du maïs des sols de la zone Vertiente
Lerma………………………………………………………………………………………………………………………………….75
Fig.20 - Pourcentages de terres arables à proximité des sites en fonction des phases
d’occupation……………………………………………………………………………………………………………………….77
.
Fig.21 - pourcentages des terres arables théoriques par phase…………………………………………..78
Fig.22 - Les sites et les terres arables de leurs territoires d’exploitation………………………………80
Fig.23 - Proportions des sites avec accès à de « bonnes » ou « moyennes » terres……………….81
97
BBBBIBLIOGRAPHIE
ARNAULD M.-C. & B. FAUGÈRE 1998 – Evolución de la ocupación en el Centro-norte de Michoacán y la emergencia del Estado Tarasco. en DARRAS V. (coord.) Génesis, culturas y
espacios en Michoacán. CEMCA ,Mexico.
ARNAULD M.-C., P. CAROT & M.-F. FAUVET-BERTHELOT 1993 - Arqueología de las Lomas en la
cuenca lacustre de Zacapu, Michoacán, México. CEMCA ,Mexico.
ARNAULD M.-C. & P. PETREQUIN 1994 - 8000 años de la Cuenca de Zacapu : evolución de los
paisajes y primeros desmontes. CEMCA ,Mexico.
AYALA-ORTIZ D. A. & GARCÍA-BARRIOS R. 2009 - Contribuciones metodológicas para valorar la multifuncionalidad de la agricultura campesina en la Meseta Purépecha. Economía, Sociedad
y Territorio, vol. 9, N° 31 : 759-801. El Colegio Mexiquense, México.
BADEN W.W. & C.S. BEEKMAN 2011 - The Cultivation of Maize and its Regional Impact : Soil Exhaustion in the La Venta Corridor, Jalisco. en WILLIAMS E. & P. C. WEIGAND (eds.), Patrones de asentamiento y actividades de subsistencia en el Occidente de México,
reconocimiento a la Dra. Helen P. Pollard. Colegio de Michoacán, Zamora.
BONIN S. 2006 - Connaissance des sols : introduction à la pédologie. Ressources pédagogiques
Université Joseph Fourier - Grenoble 1 - Institut de géographie alpine, Grenoble.
BORISSOVA M., & D. NIKOLOVA 2008 - Assеssment of the Water Parameters of Vertisol Under Different Agricultural Practices. In (Actes du colloque) BALWOIS 2008 International Scientific
Conference on Water, Climate and Environment. Ohrid.
BRANIFF B. 1972 – Secuencias arqueologicas en Guanajuato y la cuenca de Mexico : intento de correlacion. Teotihuacán. XI Mesa Redonda : 237-323. Sociedad Mexicana de Antropología, México.
1989 – Oscilación de la frontera norte mesoamericana : un nuevo ensayo. Arqueológía
(Segunda epoca) 1 : 99-114
2000 – La frontera septentrional de Mesoamérica. en MANZANILLA L. & L. LÓPEZ LUJÁN, Historia Antigua de México. Volumen I : El México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes
y el horizonte Preclásico. INAH, México.
CABALLERO J. 1982 - Notas sobre el uso de los recursos naturales entre los antiguos purepecha. Biotica, vol. 7, n°1 : 31-42.
CAROT P. 2001 - Le site de Loma Alta, Lac de Zacapu, Michoacan, Mexique. Archaeopress, Oxford.
CARTER W.E. 1969 - New lands and old traditions. Kekchi cultivators in the Guatemalan lowlands.
Latin American Monographs. University of Florida Press, Gainesville.
98
CASTAÑEDA C. et al. 1989 – Poblamiento prehispanico en el centro norte de la frontera
mesoamericana. Antropología 28 : 34-43. INAH, Mexico.
COSTE N., J. GUILAINE & J.-C. REVEL 1988 - Archéologie et pédologie : essai de reconnaissance des
territoires d'exploitation autour des sites néolithiques. Bulletin de la Société préhistorique
française, vol. 85 : 390-411.
DARRAS V. 1998 – La obsidiana en la Relación de Michoacán y en la realidad arqueológica : del símbolo al uso y del uso de un símbolo. en DARRAS V. (coord.) Génesis, culturas y espacios en
Michoacán. CEMCA ,Mexico.
1999 - Tecnologías prehispánicas de la obsidiana : los centros de producción de la región de
Zináparo-Prieto, Michoacán, México. CEMCA ,Mexico.
DEMANT A. 1992 - Marco Geológico regional de la laguna de Zacapu, Michoacán, México. en
MICHELET D. (coord.) El Proyecto Michoacán 1983-1987 : medio ambiente e introducción a los trabajos arqueológicos. Cuadernos de estudios michoacanos 4 : 53-72. CEMCA, Mexico.
DÉODAT L. non-publié - Notes de terrains. Campagne Uacusécha 2011.
DUCHAUFOUR P. 20006 - Introduction à la science du sol : sol, végétation, environnement. Dunod, Paris.
DURANT-FOREST J. de 2008 – Les Aztèques. Les Belles Lettres, Paris
ELLIOTT M. 2005 – Evaluating Evidence for Warfare and Environmental Stress in Settlement Pattern Data from the Malpaso Valley, Zacatecas, Mexico. Journal of Anthropological
Archaeology 24 : 297-315.
FAUGÈRE B. 1990 - « Entre nomades et sédentaires : archéologie du versant méridional du Lerma au Michoacan, Mexique ». Thèse de doctorat, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Paris.
1991 - San Antonio Carupo (centro-norte de Michoacán, México) : nuevas evidencias de ciertas transformaciones en el inicio del Postclásico. Journal de la Société des Américanistes, vol. 77 : 45-61. Paris
1996 - Entre Zacapu y Río Lerma : culturas en una zona fronteriza. CEMCA ,Mexico.
2006 - Cueva de los Portales : un sitio arcaico del norte de Michoacán, México. CEMCA/INAH, Mexico.
2007 (coord.) - Dinámicas culturales entre el Occidente, el Centro-Norte y la cuenca de
México, del Preclásico al Epiclásico. CEMCA ,Mexico/El Colegio de Michoacan, Zamora.*
2009 – Sociedad y poder en el centro-norte de Mesoamerica (700-1200 D.C.). El caso del norte de Michoacán en WILLIAMS E. Las sociedades complejas del occidente de México en el
mundo mesoamericano : homenaje al Dr. Phil C. Weigand, El Colegio de Michoacan, Zamora.
FISHER C. T. 2005 - Abandoning the Garden: Demographic and Landscape Change in the Lake Pátzcuaro Basin, Mexico. American Anthropologist, vol. 107 : 87-95.
FLANNERY K. 1976 – The Early Mesoamerican Village. Academic Press, New York.
99
FOREST M. 2011 – Les centres publics des sites urbains du malpais de Zacapu, Michoacán, Mexique : exemples d’espaces hiérarchisés et/ou hiérarchisant ? 4ème
journée doctorale
d’archéologie de Paris 1 : « Les marqueurs de pouvoir ».
FOSTER M. S. & S. GORENSTEIN 2000 (coord.) - Greater Mesoamerica : the archaeology of West
and Northwest Mexico. University of Utah Press, Salt Lake City.
GORENSTEIN S. & H. P. POLLARD 1980 - Agrarian Potential, Population, and the Tarascan State.
Science, New Series, vol. 209, n°4453 : 274-277.
GOUGEON O. 1991 - El noroeste de Michoacán : un paisaje en busca de identidad. en Paisajes
rurales en el norte de Michoacán. Cuadernos de estudios michoacanos 3 : 53-101. CEMCA,
Mexico.
KELLY I. 1945 – The Archaeology of the Autlán-Tuxcacuesco Area of Jalisco : the Autlán Zone.
Ibero-Americana 26. University of California Press, Berkeley/Los Angeles
LABAT J.-N. 1988 - Végétation du nord-ouest du Michoacán (Mexique) : écologie, composition
floristique et structure des groupements végétaux. Thèse de doctorat. Université de Paris VI,
Paris.
1992 - Fitogeografía de la región de Zacapu. en MICHELET D. (coord.) El Proyecto Michoacán
1983-1987 : medio ambiente e introducción a los trabajos arqueológicos. Cuadernos de
estudios michoacanos 4 CEMCA, Mexico.
MANZANILLA L. 1984 – Loma de Santa María I, Morelia, Michoacán.Un sitio del periodo clásico
mesoamericano. Tesis. ENAH, Mexico.
MARTEN G.G. & P. VITYAKON 1986 – Soil Management in Traditional Agriculture. In MARTEN G.G.
(coord.), Traditional Agriculture in Southeast Asia : A Human Ecology Perspective : 199-223.
Westview Press, Boulder.
MICHELET D. 1989 - Enquêtes sur l’Amérique moyenne : mélanges offerts à Guy Stresser-Péan. CEMCA/INAH, Mexico.
1992 - El centro-norte de Michoacán : caractericas generales de su estudio arqueologico regional. en MICHELET D. (coord.) El Proyecto Michoacán 1983-1987 : medio ambiente e introducción a los trabajos arqueológicos. Cuadernos de estudios michoacanos 4 : 9-52 CEMCA, Mexico.
1998 – Topografía y prospección sistemática de los grandes asentamiento del malpaís de Zacapu : claves para un acercamiento a las realidades sociopolíticas. en DARRAS V. (coord.) Génesis, culturas y espacios en Michoacán. CEMCA ,Mexico.
MICHELET D., G. PEREIRA & G. MIGEON 2005 - La llegada de los uacúsechas a la región de Zacapu, Michoacán : datos arqueológicos y discusión. en MANZANILLA L. (ed.) Reacaomodos
demográficos del Clásico al Posclásico en el centro de México. UNAM-Instituto de investigaciones antropológicas, México.
100
MIGEON G. 1984 - « L’habitat postclassique dans la région de Zacapú, Michoacán : répartition et typologie des sites, première approche » dans Trace 6 : 38-52. CEMCA ,Mexico.
1991 - « Archéologie en pays Tarasque : structure de l’habitat et ethnopréhistoire des habitations tarasques de la région de Zacapu (Michoacan, Mexique) au postclassique récent ». Thèse de doctorat, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Paris.
O'HARA S. L., F. A. STREET-PERROTT & T. P. BURT 1993 - Accelerated Soil Erosion around a Mexican Highland Lake Caused by Prehispanic Agriculture. Nature, 362 : 48-51.
ÖSZOY G. & E. AKSOY 2007 - Characterization, Classification and Agricultural Usage of Vertisols Developed on Neogen Aged Calcareous Marl Parent Materials. Journal of Biological,
Ecological and Environmental Science, vol. 1 : 5-10
PEREIRA G. 1999 - Potrero de Guadalupe: anthropologie funéraire d’une communauté pré-tarasque du nord du Michoacan, Mexique. B.A.R. International Series 816, Oxford.
PEREIRA G., D. MICHELET & G. MIGEON 2007 - Cerro Barajas, Guanajuato. Arqueología Mexicana 87 : 77-82.
PIÑA CHAN R. & K. OI 1982 – Exploraciones arqueológicas in Tingambato, Michoacán. INAH, México.
POLLARD H. P. 1972 – Prehispanic Urbanism at Tzintzuntzan, Michoacan. Ph. D. Dissertation. Department of Anthropology, Columbia University.
1980 - Central Places and Cities. A Consideration of the Protohistoric Tarascan State. Society
for American Archaeology, vol. 45, n°4 (oct. 1980) : 677-696
1982 - Ecological variation and economic exchange in the Tarascan state. American
Ethnologist, vol. 9 : 250-268. Blackwell.
1993 - Taríacuri’s legacy : the prehispanic Tarascan state. University of Oklahoma Press, Norman.
2003 - Central places and cities in the core of the Tarascan State. In W. T. SANDERS, A.G. MASTACHE
& R.H. COBEAN (eds.) Urbanism in Mesoamerica, bilingual edition : 345-390. INAH/Pennsylvania
University Press, México.
Relación de las cerimonias y rictos y población y gobernación de los indios de la provincia de
Mechuacan hecha al Ilustrísimo señor don Antonio de Mendoza, virrey y gobernador desta
Nueva España por Su Majestad 1984 - (Traduction et présentation de J.M.G. LE CLEZIO). NRF Tradition, Gallimard, Paris.
ROMERO-PEÑALOZA J. 1995 - Configuración agrícola regional y zonas agrícolas. en PULIDO S., P. ROMERO y V. NUÑEZ (eds.), La producción agropecuaria y forestal de la región Sierra
Purépecha, Michoacán : 69-82. Universidad Autónoma, Chapingo.
ROPER D. C. 1979 - The Method and Theory of Site Catchment Analysis : A Review. Advances in
Archaeological Method and Theory, vol. 2 : 119-140.
101
SANDERS W. T., MASTACHE A. G. & Á. GARCIA COOK 2008 - Urbanism in Mesoamerica Urbanismo
en mesoamérica. 2. INAH, Mexico/The Pennsylvania State University, Philadelpie. SANDERS W. T., J. R. PARSONS & R. S. SANTLEY 1979 - The basin of Mexico. ecological processes in
the evolution of a civilization. Academic Press, New York/San Fransisco.
SMITH M. E. 2011 - “ Empirical Urban Theory for Archaeologists”. in Journal of Archaeological
Method and Theory. Vol. 18, N°3 (sept. 2011) : 167-192. Springer. VITA-FINZY C. & E. S. HIGGS 1970 - Prehistoric Economy in the Mount Carmel Area of Palestine :
Site Catchment Analysis. Proceedings of the Prehistoric Society, XXXVI, 1-37 WARREN J.B. 1985 - The conquest of Michoacán. The Spanish domination of the Tarascan
kingdom in Western Mexico. 1521-1530. University of Oklahoma Press, Norman. REFERENCES INTERNET
Site de l’INEGI <http://www.inegi.org.mx/> Site de la FAO <http://www.fao.org/index_fr.htm> Britannica <http://www.britannica.com/> Universalis <http://www.universalis.fr/>