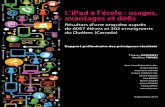« Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et...
Transcript of « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et...
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents
scientifiques depuis 1998.
Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : [email protected]
Jean-Philippe WarrenBulletin d'histoire politique, vol. 22, n° 2, 2014, p. 7-21.
Pour citer ce document, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/1021985ar
DOI: 10.7202/1021985ar
Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir.
Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI http://www.erudit.org/apropos/utilisation.html
Document téléchargé le 21 février 2015 09:43
« Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défispratiques »
Association québécoise d’histoire politique 7
Éditorial
Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu :précisions conceptuelles et défis pratiques
Jean-Philippe WarrenUniversité Concordia
La légitimité et la place de l’histoire politique ne cessent de faire l’objet de débats au Québec. Certains y découvrent un inexcusable rétrécissement du regard historien sur des objets élitistes (le fameux récit des « grands hommes »), d’autres un détournement plus ou moins subtil vers des thé-matiques nationalistes, des accusations qui, disons-le d’emblée, n’ont pas toujours été dénuées de fondement. Récemment, deux étudiants de l’UQAM et de McGill ont pu ainsi s’en prendre à un éditorial du Bulletin d’histoire politique signé par Michel Sarra-Bournet parce que ce dernier leur semblait promouvoir une vision traditionaliste de la pratique historienne, fermée aux méthodes et sensibilités propres à l’histoire culturelle et l’his-toire sociale1. Tout en leur étant réceptifs, nous croyons de telles critiques mal inspirées. Elles prennent sources dans une série d’équivoques idéolo-giques et de flottements théoriques qui permettent aux uns de laisser pla-ner de commodes sous-entendus et aux autres, de jouer sur les mots. Il est d’ailleurs fort à parier que ces débats gagneront en ampleur au cours des prochains mois suite à la publication par le ministère de l’Éducation d’un document de consultation qui propose de discuter des bienfaits d’un « renforcement de l’enseignement de l’histoire nationale au primaire et au secondaire2 ». En nous invitant à réfléchir à la possibilité d’une réconcilia-tion de l’histoire politique et de l’histoire sociale en les articulant « dans une trame nationale plus suivie », le document interroge à nouveaux frais l’épineuse question des normes articulant les finalités de l’histoire et les desseins de la mémoire. Dans la foulée du dépôt de ce document, et en anticipation des débats qui vont suivre, une mise au point nous paraît bienvenue : elle permettra, du moins nous l’espérons, de mettre un peu
BHP 22-2 368 pages.indd 7 13-12-17 13:26
8 Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2
d’ordre dans les approches et les prémisses associées à l’histoire politique, et d’ainsi mieux baliser ce que chacun peut en attendre, en plein respect des différentes pratiques de la communauté des chercheurs. L’histoire politique bien entendue n’a aucune prétention hégémonique. Elle ne re-tranche rien aux autres perspectives, comme nous souhaitons le démon-trer dans la suite de ce texte, elle ne fait que s’ajouter à une compréhension générale, multidimensionnelle, du passé.
Précisions conceptuelles
Commençons par une précision élémentaire. L’histoire politique, l’histoire sociale et l’histoire culturelle sont souvent mises en compétition alors qu’elles ne recoupent pas les mêmes réalités. Prise dans son sens commun, l’histoire sociale désigne une insistance sur les déterminations infrastruc-turelles (démographie, économie) au détriment des articulations des re-présentations, des idées et des idéologies. Mise notamment en vogue par les tenants de l’École des Annales de la première vague, elle se rapproche d’une perspective de recherche qui place les facteurs socio-économiques au cœur de l’analyse. L’histoire culturelle s’intéresse pour sa part à la di-mension symbolique de la vie humaine. Il existe une culture scientifique, comme il y a une culture populaire, une culture religieuse et tutti quanti. On peut mener une étude de la culture des grands bourgeois montréalais au xixe siècle, tout autant qu’une culture des quartiers populaires de Qué-bec dans l’entre-deux-guerres. Enfin, l’histoire politique se concentre sur un champ plus ou moins autonomisé de la société dont l’État est le centre, mais point l’aboutissement. Vue ainsi, on devine qu’une histoire sociale de l’État est tout aussi envisageable qu’une histoire culturelle des rites parle-mentaires. Pour cette raison, il est assez étrange d’entendre que le déve-loppement de l’histoire politique compromet, en soi, la réalisation d’his-toires sociales ou d’histoires culturelles quand, en fait, ce développement ne nuit (d’un point de vue quantitatif, considérant la rareté des ressources universitaires) qu’à la prise en compte des autres champs. On peut se plaindre, certes, que l’on fait trop d’histoire politique et pas assez d’his-toire de la haute couture, mais point, par exemple, que l’on délaisse en soi l’histoire des femmes, les mouvements féministes ou les suffragettes qui font partie en propre, comme on s’en doute, du champ politique.
Pour mieux penser les problèmes soulevés par l’étude du champ poli-tique et clarifier l’utilisation de ce concept, un retour aux travaux de Pierre Bourdieu s’impose. Loïc Wacquant a bien exposé la triple relation de Bour-dieu au politique3. En premier lieu, il est possible de revenir sur ses divers engagements, qui vont de la guerre d’Algérie à la mondialisation néolibé-rale. En deuxième lieu, l’on peut exposer ses diverses analyses des institu-tions politiques (partis, syndicats, parlements, sondages, États). Enfin, en
BHP 22-2 368 pages.indd 8 13-12-17 13:26
Association québécoise d’histoire politique 9
dernier lieu, on peut s’intéresser au rôle politique qu’il assigne aux prati-ciens des sciences sociales et aux intellectuels dans le combat pour la véri-té et la justice. Le champ politique (comme arène, comme objet et comme menace à l’autonomie de la science) est au cœur de ces trois dimensions de sa vie et de son œuvre. Toutefois, délaissant le Bourdieu militant et le Bourdieu épistémologue, nous insisterons ici sur le deuxième aspect de sa pensée, celui qui concerne son approche du monde social. Nous croyons que plusieurs leçons peuvent en être tirées.
La lecture de l’œuvre de Bourdieu permet déjà de lever une confusion courante entre politique et pouvoir. Influencés par Michel Foucault, de nombreux chercheurs ont adopté l’idée (féconde, il est vrai) selon laquelle le pouvoir moderne ne peut être saisi comme l’exercice d’une contrainte institutionnelle sur des sujets qui lui seraient extérieurs. Ils conçoivent au contraire le pouvoir comme une réalité directement intégrée dans le corps des individus à travers des disciplines et des morales qui échappent à la conscience et à la volonté. En d’autres termes, le pouvoir n’opère pas sur les individus, il opère en eux, par les techniques de ce que Foucault nomme le biopouvoir. Les individus se retrouvent pris dans les rets de relations sociales complexes (familiales, économiques, religieuses, etc.) qui struc-turent intimement leurs personnalités et qui servent à contrôler les popu-lations humaines. La connaissance elle-même devient, dans ce schème interprétatif, un instrument de domination de la société disciplinaire. La prison, l’hôpital, l’asile, l’école, l’usine, l’État sont, pour Foucault, des lieux exemplaires de quelque chose qui les dépasse, ces institutions nou-velles ayant permis l’expérimentation de techniques ayant fini par enva-hir toutes les facettes de la société. Poussée à bout, cette logique impla-cable rend impossible la localisation des sources du pouvoir, qui sont à la fois partout et nulle part.
Tout comme Foucault, Bourdieu croit que la société structure puis-samment l’individu. Cependant, il préfère concevoir cette relation à tra-vers la notion d’habitus, laquelle nous semble, d’un point de vue historien, beaucoup plus utile et fructueuse. L’habitus consiste en effet pour Bour-dieu en l’ensemble des dispositions, acquises dans un processus de socia-lisation, qui définit la trajectoire de l’individu dans l’espace social. Ces schèmes de perception et d’évaluation des pratiques orientent les actions des sujets dans le monde social et leur indiquent leur horizon d’attentes. Or, et c’est ce qui nous intéresse ici, l’habitus est en lien étroit avec le champ dans lequel il circule, puisque c’est la rencontre entre un champ et un habitus qui définit les pratiques. C’est ainsi que les contextes dans les-quels se déroule l’action des sujets modifient leurs valeurs et leurs pra-tiques ; ils les normalisent et les objectivent en les replaçant dans des en-sembles différenciés qui permettent codages et repérages. Il va sans dire que tout cela se modifie dans le temps, les époques générant des habitus
BHP 22-2 368 pages.indd 9 13-12-17 13:26
10 Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2
spécifiques. L’habitus de l’écrivain a beau avoir, en Occident, des origines lointaines, il est trompeur de parler de lui en termes généraux. Il faut sa-voir au contraire distinguer les traits qui le caractérisent pour chaque mi-lieu et chaque moment historique.
La conclusion de tout ceci, c’est qu’il n’existe pas, pour Bourdieu, de pouvoir avec un grand « P », mais autant de pouvoirs, voire de types de pouvoirs, qu’il y a de champs. Dans l’anthropologie bourdieusienne, la notion de champ est circonscrite historiquement, un champ pouvant ap-paraître, gagner ou perdre son autonomie relative, prendre telle ou telle forme passagère. Une fois constitué, il existe pourtant des éléments consti-tutifs de tout champ : le champ est un microcosme de la société globale ; il possède des règles du jeu et des enjeux spécifiques, lesquels assurent son autonomie relative ; il structure la position des acteurs qui y participent ; il représente un espace de lutte entre les acteurs qui visent à s’approprier le maximum de capital légitime (que ce soit l’argent, le prestige, la recon-naissance affective, etc.), avec pour résultat la production de dominés et de dominants et, donc, de rapports de force qui préexistent à l’entrée des acteurs dans le champ ; les stratégies de conservation et de subversion sont tour à tour utilisées en fonction des habitus et de la structure des capi-taux accumulés (économique, social, culturel, symbolique)4. Ce qui se dé-gage de cette énumération, c’est, tout d’abord, à quel point un champ est le résultat de luttes entre les différents acteurs : celles entre ceux qui s’en-tendent sur les limites et potentialités du champ et cherchent à contenir l’intrusion de nouveaux compétiteurs, et celles entre les acteurs qui y sont reconnus. Il y a toujours deux types d’affrontements, l’un pour la détermination des règles du jeu et des enjeux, et l’autre pour l’acquisition du capital propre au champ.
Le champ politique n’échappe pas à cette logique5. « La raison et la raison d’être d’une institution (ou d’une mesure administrative) et de ses effets sociaux n’est pas dans la “volonté” d’un individu ou d’un groupe mais dans le champ de forces antagonistes ou complémentaires où, en fonction des intérêts associés aux différentes positions et habitus de leurs occupants, s’engendrent les “volontés” et où se définissent et se redéfi-nissent sans cesse, dans et par la lutte, la réalité des institutions et de leurs effets sociaux, prévus et imprévus6. » Balayé par des luttes intenses, le champ politique est un véritable champ de bataille, Bourdieu ayant d’ail-leurs recours à un vocabulaire économique affranchi de toute moralité intrinsèque pour en caractériser la dynamique (marché, consommateurs, capital, stratégie, investissement, rentabilité). Les intérêts de ceux qui s’y mobilisent étant pluriels, les affrontements sont constants afin d’établir la suprématie des intérêts et celle des acteurs qui entrent en compétition pour le monopole des ressources politiques. Bien que les différents capi-taux puissent dans des conjonctures particulières se convertir les uns dans
BHP 22-2 368 pages.indd 10 13-12-17 13:26
Association québécoise d’histoire politique 11
les autres (pensons à un ancien astronaute devenu député fédéral, ou à un chef d’entreprise prospère devenu chef de parti), le capital politique se distingue du capital scientifique ou même économique non seulement par la logique propre au champ politique mais aussi par le fait que, pour Bour-dieu, l’État détient un « pouvoir sur les autres espèces de capital ». Le capi-tal politique peut intégrer différents capitaux qui sont mobilisés et instru-mentalisés par l’État, dont le capital financier, le capital militaire, le capital culturel et le capital juridique (à travers le droit de prélever des impôts, de promulguer des lois, d’user de la contrainte physique, d’organiser le sys-tème scolaire, de nommer les juges). Bourdieu se sent donc autorisé de parler dans ce cas précis d’un méta-capital7.
Tout champ étant structuré en une série de positions (l’idée étant jus-tement, pour un acteur du champ politique, de « prendre position »), Bour-dieu refuse de voir l’État comme une personne collective qui autorise ceci ou interdit cela. Il lui importe au contraire de comprendre l’enchevêtre-ment des forces qui se posent et s’opposent dans un espace de luttes réelles en s’attardant au « corps de professionnels de la représentation (à tous les sens du terme), producteurs culturels et idéologiques, hommes politiques, représentants syndicaux8 » qui tentent de plier les décisions prises dans le champ politique dans le sens de leurs intérêts, et ce, tout en clamant des idéaux pour la plupart du temps désincarnés (bien commun, justice, éga-lité, liberté, solidarité). Car, les injonctions du champ politique ne sont valables que dans la mesure où les hommes et les femmes auxquelles elles s’appliquent n’en voient pas l’arbitraire et reconnaissent la logique qui structure le champ dans lequel ils souhaitent être reconnus, fût-ce comme révolutionnaires. « Ceux qui réussissent, en politique […], peuvent appa-raître rétrospectivement comme des stratèges inspirés alors que ce qui était objectivement un placement rationnel a pu être vécu comme un pari risqué, voire une folie. L’illusio qu’exige et produit l’appartenance à un champ exclut le cynisme et les agents ne possèdent pratiquement jamais la maîtrise explicite des mécanismes dont la maîtrise pratique est la condi-tion de leur réussite9. » Cette illusio revient à dire que, dans la perspective proposée par Bourdieu, l’on ne peut gagner au jeu politique que lorsque l’on est pris par le jeu, mieux encore, que lorsque l’on est pris au jeu. C’est cette institutionnalisation de la croyance que le chercheur a pour tâche de mettre au jour.
L’autonomie du champ politique au Québec
L’un des enjeux cruciaux du champ politique est celui de son degré d’au-tonomie, c’est-à-dire de sa capacité à assoir ses principes d’inclusion et d’exclusion. Or, la particularité du champ politique est qu’il peut moins aisément que d’autres se fermer entièrement sur lui-même, la définition
BHP 22-2 368 pages.indd 11 13-12-17 13:26
12 Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2
de ses limites étant soumises à des luttes permanentes, dont les cam-pagnes électorales ne sont qu’une des multiples variantes. « Cela donne sans doute une sorte de flou à la définition du champ [politique], avoue Bourdieu, mais ce flou est dans la réalité10 ». On mesure mieux, dès lors, le défi que représente la délimitation de ce que recouvre le politique dans le corps social, même si la césure est de mieux en mieux marquée, dans les démocraties contemporaines, entre les professionnels de la poli-tique et la société civile. Quoique Bourdieu ne l’a jamais exprimé ainsi, il serait tentant d’illustrer le degré de fermeture du champ politique par une série de cercles concentriques, avec un premier cercle défini par l’État (à commencer par les ministères et les institutions étatiques) et les responsables politiques (en particulier ceux qui forment le gouverne-ment), un second, par les partis politiques (qui stabilisent les croyances politiques et canalisent des luttes autrement anarchiques), et un dernier par les mouvements sociaux et les groupes de pression. Plus l’on s’éloi-gnerait du noyau dur du champ politique, plus l’autonomie de ce champ serait vague ou fragile.
À l’évidence, l’enjeu de l’autonomie du champ politique (comme de tout champ) varie considérablement selon les époques et les traditions nationales, lesquelles permettent de révéler autant de logiques de fonc-tionnement du monde politique. Dans le cas du Québec francophone (l’adjectif étant sous-entendu dans le reste du texte), une telle observation est essentielle, dans la mesure où la délimitation du champ politique, et donc la reconnaissance de son autonomie, y est éminemment contestable. La plupart des historiens québécois découpent le champ politique à partir des frontières provinciales, alors que, pourtant, ce dernier s’inscrit dans d’autres espaces politiques, dont l’État fédéral canadien. Ce n’est rien en-core : on assume d’ordinaire que l’on peut faire l’histoire politique de la communauté canadienne-française dans l’entre-deux-guerres, du Mani-toba à la Nouvelle-Angleterre, alors que celle-ci ne possède même pas d’institutions gouvernementales propres. C’est que l’on ramène dans le champ politique les débats idéologiques des penseurs de la « nation », élargissant l’acceptation de ce qui est d’habitude rassemblé par cette no-tion dans la tradition bourdieusienne. Il n’est pas certain d’ailleurs que Bourdieu aurait accepté d’emblée une telle élasticité du concept, vu que les exemples qui lui servent à illustrer sa représentation du champ poli-tique ne s’éloignent guère de la compétition des élites pour le pouvoir d’État (défini, dans la continuité de la tradition wébérienne, comme le détenteur du monopole de 1’usage légitime de la violence physique et symbolique sur un territoire donné) et de sa gouvernance entendue de manière stricte11. Dans un tel schème, la lutte pour le pouvoir politique est tenue par la volonté d’occuper une place privilégiée au sein des appareils d’État.
BHP 22-2 368 pages.indd 12 13-12-17 13:26
Association québécoise d’histoire politique 13
Les historiens québécois ont mis du temps à investir les études sur l’État. Si les politiques publiques et les appareils étatiques ont fait davan-tage l’objet de monographies (quand l’analyse n’était pas laissée aux poli-tologues, aux sociologues et aux journalistes), l’histoire militaire est long-temps demeurée, quant à elle, un parent pauvre de l’historiographie, tout comme celle qui étudie les modalités d’accès (suffrage, lobbying, diplo-matie) et d’exercice du pouvoir politique (partis, personnel, fonction pu-blique). Avant que, dans les années 1980, s’impose l’histoire sociale, ce sont les recherches sur les représentations qui ont été les plus communes, ce dont témoigne le vaste chantier sur les idéologies supervisé par Fer-nand Dumont et son équipe. Confronté à un État provincial dérisoire, à un État fédéral jugé hostile et à des programmes gouvernementaux plutôt rudimentaires, il semblait plus intéressant pour les historiens de braquer leur regard sur les intellectuels, les mouvements sociaux, les journaux et les revues où se déroulaient des conflits symboliques qui avaient au moins, pour les chercheurs, l’intérêt de faire vivre le champ politique avec quelque richesse et profondeur, non seulement par ce qu’on pouvait les rattacher (sans avoir à les comparer) aux vastes courants d’idées (socialisme, ultra-montanisme, coopératisme, thomisme) qui traversaient le reste des socié-tés occidentales, mais aussi parce qu’on pouvait y voir s’élaborer, ne se-rait-ce que dans l’imaginaire, le fait national. Pour les historiens québécois, le champ politique n’était pas seulement le lieu de production de la loi ou l’organe de la puissance publique légitime ; il était le lieu constitutif (quoique discursif) de la nation. En faisait partie tout ce qui touchait à l’émergence de la référence collective de la nation canadienne-française, puis québécoise – ce qui permet de comprendre pourquoi personne ne songeait à contester que le livre de Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, constituât une œuvre éminemment politique, et ce, bien que les débats parlementaires occupent dans ses pages une portion pour le moins congrue. Nous pensons que cet élément n’est pas pour rien dans la diffé-rence qui existe entre la majorité des historiens québécois et les historiens français proches de Bourdieu au sujet de leur conception respective de l’idéologie. Pour Bourdieu, l’idéologie est immanquablement une repré-sentation déformée des rapports sociaux, représentation élaborée au profit d’une classe qui y trouve la légitimité de sa production et reproduction. Tandis que pour les disciples (assumés ou non) de Dumont, l’idéologie est une définition de la situation en vue de l’action, avec pour résultat que, pour ce dernier, le nationalisme n’est pas un mensonge, mais une simple configuration des possibles12.
On peut dire, dans un premier temps, que si la coïncidence entre his-toire politique, histoire nationale et histoire nationaliste fut aussi forte dans l’historiographie québécoise, c’est que le champ politique s’est consti-tué à partir du xixe siècle autour de l’idéal national. Pendant longtemps,
BHP 22-2 368 pages.indd 13 13-12-17 13:26
14 Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2
le sujet du champ politique fut ainsi la nation canadienne-française, puis québécoise ; c’est en elle que devaient censément se réaliser l’affirmation et la fraternité des personnes. Il n’y a rien là de particulier ou d’unique à l’échelle de l’Occident. Néanmoins, il nous semble que les historiens poli-tiques du Québec ont repris, souvent sans trop réfléchir, les catégories d’entendement du politique de l’époque qu’ils étudiaient parce que c’était ces catégories qui s’imposaient d’elles-mêmes dans les discours et les re-présentations. Il en est pour leur reprocher d’avoir ce faisant restreint un peu trop rapidement leurs interprétations à la nation francophone d’héri-tage canadien-français, confondant allégrement histoire politique et his-toire nationale13. Il nous suffit de noter que les seuls travaux d’envergure consacrés à des premiers ministres fédéraux écrits par des historiens qué-bécois ont pris pour objet des politiciens élus dans la province, ce qui ne laisse pas d’être troublant pour qui reconnaît qu’il n’y a pas de raison de croire que les politiques du gouvernement de Wilfrid Laurier aient eu, parce qu’il était né à Saint-Lin-de-Lachenaie, plus d’impact sur les Québé-cois que celles de celui de John A. Macdonald, qui a grandi à Kingston. Cette situation se reflète aussi dans le peu d’attention que l’historiogra-phie a accordé à la tradition loyaliste canadienne-française, tradition intel-lectuelle et politique, importante s’il en est une, qui doit sa place margi-nale dans les travaux savants non pas seulement à sa faible postérité intellectuelle mais aussi, pensons-nous, à la réputation antinationaliste de ses thuriféraires14. Il y a bel et bien un a priori national, voire nationaliste, dans l’historiographie dessinée par les historiens politiques.
Cet a priori découle d’abord du fait que les historiens québécois du politique, ne pouvant chercher le politique là où les bourdieusiens le loca-lisaient en propre, c’est-à-dire dans l’État, ont été amenés par défaut à in-vestir le domaine des idéologies nationales. De fait, le champ politique canadien-français ne pouvant s’instituer d’abord dans les ressorts et les mécanismes propre à l’institution étatique, c’est principalement dans l’es-pace culturel, idéologique et institutionnel infra-étatique de l’Église catho-lique que les Canadiens français ont cru pouvoir, de 1840 à 1960, réaliser leurs ambitions nationales15. Quelque chose de ce paradigme est demeu-rée même après l’éclatement de la Révolution tranquille, alors que les nou-velles générations d’historiens épousaient en masse l’idée transhistorique de la nation québécoise (de Samuel de Champlain à René Lévesque) et refoulaient hors de la mémoire commune, entre autres, les minorités fran-çaises du reste du Canada16. Les chercheurs ont continué à faire de la na-tion culturelle (et non pas de l’État) le centre du champ politique cana-dien-français et québécois, en la posant et l’imposant comme sujet politique, que ce soit en tant que « peuple fondateur », « communauté de destin », « parcours collectif » ou « trame historique ». Par exemple, Jacques Beau-chemin, l’un des auteurs du document de consultation cité plus haut, écri-
BHP 22-2 368 pages.indd 14 13-12-17 13:26
Association québécoise d’histoire politique 15
vait en 2005 que l’aptitude à s’assumer comme entité nationale pouvait être qualifié de politique parce qu’elle « touche la capacité de la commu-nauté d’histoire franco-québécoise à assumer la subjectivité que porte sa conscience historique et à se représenter comme sujet politique de plein droit17 ». Ne tient-on pas ici un autre des principaux enjeux d’une traduc-tion conceptuelle du champ politique en contexte québécois, Bourdieu n’ayant jamais eu, à la différence des penseurs québécois, à poser la réalité (historiquement admise par un peu tout le monde en France) de la nation française ?
Il s’en est suivi que l’étude des discours nationalistes a pris beaucoup de place dans les travaux d’histoire politique québécois. Un glissement a ainsi pu s’exercer de l’histoire politique vers l’histoire nationale, puis vers l’histoire nationaliste. Nous trouvons confirmation de cette équivoque dans le fait que la publication d’une recherche sur la carrière journalis-tique d’Olivar Asselin était en général accueillie comme une contribution à l’histoire politique, alors que l’analyse des conditions d’incarcération dans les prisons au xixe siècle était classée comme ressortissant de l’his-toire sociale ; ou encore, que la biographie du père Georges-Henri Lé-vesque était admise dans le cercle de l’histoire politique, tandis qu’une thèse de doctorat sur la mobilisation des noirs à Montréal dans les années 1968 était, pour sa part, rangée par d’aucuns dans le rayon des études sur les communautés culturelles. Reconduisant cet amalgame de l’histoire politique et de l’histoire nationale, le rapport Bédard-D’Arcy et celui de Charles-Philippe Courtois18 iront encore plus loin en prétendant que la montée de la démocratie libérale, en tant que phénomène général de la modernité, n’entretient qu’un rapport accidentel à la communauté de mé-moire des Québécois et occupe pour cette raison – on ne peut plus parado-xalement – une position périphérique dans l’histoire politique, quelques épisodes exceptés19.
Une histoire qui ne serait pas celle des vainqueurs
L’histoire nationale a réussi naguère à égaler l’histoire politique parce que, dans le discours commun, elle se présentait comme le récit des tribula-tions du peuple, du « vrai monde », de « nous autres ». Bien entendu, au-jourd’hui, l’artifice de la prétention nationale à recouvrir le champ poli-tique n’aveugle plus personne. Nous avons la tâche facile de dégager les rouages intéressés de cette fiction. Les bourgeois qui proclamaient la né-cessité de construire un chemin de fer au nom de l’unité nationale s’en mettaient plein les poches, et les éducateurs qui affirmaient former l’élite de la nation s’assuraient par la même occasion un rang privilégié. Certains leaders catholiques qui plastronnaient pour la patrie en profitaient pour confirmer la marginalisation des Juifs et l’infériorité des femmes. Nous
BHP 22-2 368 pages.indd 15 13-12-17 13:26
16 Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2
n’avons pas à souligner à nouveaux frais comment la construction de la nation comme sujet politique a servi à sélectionner les dignes représen-tants du champ politique par ceux qui, appartenant d’ores et déjà à la classe dominante, se constituaient juges et parties.
Nous touchons ici à une autre difficulté, non plus définitionnelle, mais proprement politique, voire épistémique, pour qui souhaite utiliser dans ses recherches les concepts bourdieusiens. D’un côté, par souci démocra-tique, le champ politique contemporain a proclamé être ouvert aux ci-toyens de toutes conditions et fournir un modèle d’universalité civique. De l’autre côté, il a, dans les faits, rassemblé un groupe assez homogène, lequel excluait un ensemble de catégories sociales (les pauvres, les femmes, les minorités) qui étaient mis « hors-jeu », c’est-à-dire qui tombaient « hors champ »20. L’accusation d’élitisme lancée à ceux qui choisissent d’étudier le champ politique n’est donc pas sans valeur. Bien sûr, cette accusation ne change pas quand on décide d’étudier d’autres champs, et d’abord le champ scientifique (où la présence de pauvres, de femmes et de minorités est encore plus réduite), mais comme le champ des sciences est fondé sur le critère d’objectivité, et non pas sur celui de représentation démocra-tique, la contradiction performative y est moins sensible21. Faire l’histoire de la physique de 1850 à 1950 sans citer une seule femme ne soulève pas les passions, tandis que faire l’histoire des idées politiques québécoises pour la même période à travers la parole des seuls élus provinciaux (tous des hommes) semblerait réactionnaire.
Reste la possibilité d’écrire une histoire politique en creux : pour Bour-dieu, la domination d’une classe n’est pas la conséquence d’un processus « naturel », mais au contraire le produit d’une domination « naturalisée ». Il y a là par conséquent un chantier possible pour qui ne veut pas se contenter d’objectiver dans un récit historique le fait des multiples exclu-sions consommées par et dans le champ politique. Telle était d’ailleurs le sens de la mise en garde qu’avait formulée Bourdieu aux historiens, à qui il reprochait une réflexivité souvent défaillante, lui qui avait été toujours soucieux de dégager les conditions concrètes susceptibles de déterminer les approches ou les objets investis par la science historique22. Aussi, au lieu de se concentrer sur les victoires des classes dominantes, un historien du politique s’inspirant des travaux des bourdieusiens pourra étudier les mécanismes mis en place pour évincer du champ politique les groupes dominés et dégager les stratégies de résistance qu’ils ont pu déployer (ha-bilement au centre, ou violemment en marge). Autrement dit, il pourra dessiner le champ politique comme le lieu où se structure l’arbitraire de l’ordre global et se déploie tout un ensemble de mécanismes indépendants et convergents qui imposent des principes de vision et de division du monde social, et qui peuvent (et doivent) pour cette raison être remis en cause. Allan Greer a écrit un texte particulièrement stimulant sur la fabri-
BHP 22-2 368 pages.indd 16 13-12-17 13:26
Association québécoise d’histoire politique 17
cation d’un idéal républicain par les Patriotes de la première moitié du xixe siècle, idéal qui conduisit à l’exclusion des femmes des campagnes électorales. Ce genre de travaux confirme que, sauf à utiliser la violence armée, « il n’est pas de domination qui puisse se maintenir sans se faire reconnaître en faisant méconnaître l’arbitraire qui est à son fondement23 ». La violence la plus efficace et la plus économique est toujours celle qui se fait oublier comme violence et parvient à embrigader les acteurs, bour-reaux comme victimes, dans une participation mutuelle au maintien d’un rapport de force inégal. L’histoire qui prend comme objet cette violence à partir de ses effets sur les exclus du régime dominant contribue directe-ment à l’avancement des connaissances sur le champ politique.
Si on choisit de suivre cette voie, on s’aperçoit à nouveau que c’est moins l’étroitesse du champ politique qui pose problème que son élargis-sement virtuellement illimité. D’un côté, très peu d’activités sociales, au Québec, ne sont pas balisées, sinon régies par une loi quelconque aux xixe et xxe siècles. Le programme scolaire du système d’éducation, les subven-tions aux institutions artistiques, la réglementation des médias, les lois régissant la liberté d’expression, les soins de santé, les normes du travail, la fixation des taux d’intérêt, les obligations du mariage, tout cela et plus tombe sous la coupe de l’État, et l’historien qui s’intéresse à l’œuvre des gouttes de lait, à la chasse, aux collèges classiques, aux ultramontains finit presque immanquablement par rencontrer sur son chemin des représen-tants ou des normes du gouvernement. D’un autre côté, l’établissement des frontières du champ politique se complique quand on considère que l’on peut aussi faire l’histoire des résistances du politique : en parlant de l’œuvre des gouttes de lait ou des collèges classiques, on peut se deman-der pourquoi l’État n’était pas davantage présent dans l’organisation de la santé publique ou l’éducation provinciale avant les années 1960. Il y a toute une histoire de l’indifférence politique par rapport à certains enjeux devenus incontournables avec le temps qui mérite d’être contée et qui res-sort, en négatif (comme on le dit dans le langage de la photographie), d’une histoire politique.
Face à ces défis, chacun plaidera pour un tracé de la frontière du champ politique qui correspond à ses présupposés et ses attentes. Dans le présent article, nous n’entendons pas, pour notre part, nous mêler à ce travail d’arpentage. Qu’il nous suffise d’affirmer que nous sommes d’ac-cord avec l’attitude générale des directeurs du Bulletin d’histoire politique qui ont su démontrer, numéro après numéro, une heureuse ouverture aux initiatives les plus variées. Religion, femme, sport, classes sociales, jeu-nesse, éducation, cinéma, autant de thématiques qui ont été le prétexte à des analyses du champ politique entendu dans son sens le plus large. Dans un éditorial de la revue paru en 2012, les auteurs rappelaient à quel point l’étude du champ politique non seulement devait se faire dans le
BHP 22-2 368 pages.indd 17 13-12-17 13:26
18 Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2
respect de celles des autres champs, mais ne devait pas servir à nourrir des querelles de méthodes, puisque les recherches sur le champ poli-tique n’invitent par elles-mêmes aucune approche a priori 24. En d’autres termes, et nous n’insisterons jamais assez sur ce point, l’histoire poli-tique n’est que l’histoire du champ politique à partir des approches et des méthodes, et en fonction des dimensions qui sont privilégiées par chaque chercheur. L’impressionnante bibliographie de Bourdieu nous aide, encore une fois, à saisir cette polyphonie du champ politique, pour qui veut bien l’entendre.
Conclusion
La référence à un cadre d’analyse issu du cadre sociétal et étatique français pour étudier le champ politique d’une autre société ne peut, nous semble-t-il, faire l’économie d’une réflexion approfondie sur les effets symbo-liques d’un tel transfert conceptuel. Pierre Bourdieu, conscient du lieu à partir duquel il a articulé son paradigme sociologique, écrivait que « le sens et la fonction d’une œuvre étrangère sont déterminées au moins au-tant par le champ d’accueil que par le champ d’origine25 ». Ainsi, s’il est une chose que l’on peut retenir des précédentes remarques, c’est que la référence au concept bourdieusien de champ politique doit prendre en considération ses modalités singulières de réception et d’application dans le Canada français / Canada / Québec d’hier ou d’aujourd’hui. Bourdieu lui-même n’aurait eu aucun mal à souscrire à cet impératif, lui qui défen-dait le principe d’une science réflexive, c’est-à-dire d’une science qui, ayant pour ambition de lutter contre toute domination symbolique, ne pouvait, sous peine de trahir ses propres fondements, cloisonner les di-mensions de la pensée.
Disons-le, contrairement à la France, il est clair que le champ politique est seulement en théorie un domaine d’études parmi d’autres au Québec. En pratique, il a occupé une place enviable, parce que, ne pouvant autant qu’ailleurs se centrer sur l’État, il s’est approprié les discours nationalistes québécois et s’est érigé en gardien de la mémoire nationale. Plusieurs de ceux qui, comme Jocelyn Létourneau, critiquent cette dérive ne font d’ail-leurs que la reproduire à l’envers, ainsi que l’avait remarqué Marc Ange-not qui voyait son collègue de l’Université Laval reprendre d’une manière détournée le mandat romantique mais héroïque de l’historien au service de la nation26. Tout en étant conscient de ce qui nous sépare du cas fran-çais, Pierre Bourdieu nous aide à dégager les défis de cette conceptualisa-tion piégée du champ politique sans pour autant en nier le caractère natio-nal et nationaliste, en faisant comme s’il n’y avait là que fumisterie et intolérance, car les prétentions nationales et nationalistes ont fait partie intégrante du jeu et des enjeux du champ politique au Québec. De fait, une
BHP 22-2 368 pages.indd 18 13-12-17 13:26
Association québécoise d’histoire politique 19
histoire du champ politique de la communauté canadienne-française qui évacuerait complètement de telles prétentions ferait littéralement dispa-raître celle-ci de la carte et se retrouverait sans objet, tant il est vrai que le champ politique, longtemps, n’a guère existé ailleurs que dans les dis-cours et les pratiques para-politiques (soutenues notamment par le cler-gé). Or, on le sait, cette structuration nationale du champ politique a conti-nué bien après 1960 et les discours de Jean Lesage sur l’État du Québec27. N’est-ce pas déjà assez dire comment le champ politique québécois, repo-sant sur une clôture en apparence si manifeste mais en réalité si probléma-tique, a pu nourrir au fil des ans de nombreuses polémiques ?
Notes et références 1. Isabel Harvey et Guillaume Bouchard Labonté, « L’histoire politique n’est pas
une victime », Le Devoir, 25 octobre 2013. 2. Document de consultation. Pour un renforcement de l’enseignement de l’histoire na-
tionale au primaire et au secondaire, Ministère de l’éducation, du loisir et du sports, novembre 2013, www.mels.gouv.qc.ca.
3. Loïc Wacquant, « Pointers on Pierre Bourdieu and democratic politics », dans Loïc Wacquant (dir.), Pierre Bourdieu and Democratic Politics, Cambridge, Polity, 2005, p. 10-28. Le fait que le présent texte soit un éditorial explique que les références ont été réduites au minimum.
4. Bernard Lahire, « Champ, hors-champ, contrechamp », dans Le travail sociolo-gique de Pierre Bourdieu, Paris, La Découverte, 2001, p. 24-26.
5. Pierre Bourdieu, « Le champ politique », dans Propos sur le champ politique, (avec une introduction de Philippe Fritsch), Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2000 ; Philip S. Gorski (dir.), Bourdieu and Historical Analysis, Durham et Londres, Duke University Press, 2013.
6. Pierre Bourdieu , « Le mort saisit le vif. Les relations entre l’histoire réifiée et l’histoire incorporée », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 32-33, juin 1980, p. 6.
7. Pierre Bourdieu , « La représentation politique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 36-37, février/mars 1981, p. 3-24.
8. Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, Presses Universitaires de Lyon, 2000, p. 97.
9. Pierre Bourdieu, « Le mort saisit le vif », p. 6. 10. Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, p. 73. 11. Pierre Bourdieu, Sur l’État : Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Seuil, 2012. 12. L’épistémologie dumontienne pose la vérité comme une activité de la pensée
d’abord informée par l’expérience vécue du sujet connaissant ; elle n’est attei-gnable qu’à partir d’une subjectivité de l’appartenance et exprime « la situa-tion et [l]es enracinements de ceux qui s’y vouent et de ceux à qui elle est desti-née » (Fernand Dumont, Récit d’une émigration. Mémoires, Montréal, Boréal, 1997, p. 172). C’est d’ailleurs pourquoi Dumont, en tant que chercheur et intel-lectuel vivant au Québec, estimait n’avoir pas le choix d’être nationaliste. Lire l’intéressante analyse bourdieusienne de Récit d’une émigration par Yves
BHP 22-2 368 pages.indd 19 13-12-17 13:26
20 Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2
Gingras, « Pour une biographie sociologique », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 54, n° 1, été 2000, p. 123-131.
13. Un livre particulièrement éclairant sur cette question demeure Robert Comeau et Bernard Dionne (dir.), À propos de l’histoire nationale, Montréal, Septen-trion, 1998.
14. Les chercheurs intéressés par l’histoire de la doctrine loyaliste canadienne-française s’étonneront de constater que le dernier ouvrage de référence com-plet paru sur le sujet demeure celui du jésuite Jacques Monet, The Last Cannon Shot : A Study of French Canadian Nationalism… en 1969. Il faut néanmoins sa-luer l’attention que lui ont plus récemment accordée Yvan Lamonde dans son Histoire sociale des idées au Québec, de même que l’historien Damien-Claude Bélanger dans ses récents travaux sur Thomas Chapais.
15. Jean-Philippe Warren, « L’invention du Canada français : le rôle de l’Église catholique », dans Martin Pâquet et Stéphane Savard (dir.), Balises et références : Acadies, francophonies, Québec, PUQ, 2007, p. 21-56.
16. Michel Bock, Quand la nation débordait les frontières : les minorités françaises dans la pensée de Lionel Groulx, Montréal, Hurtubise HMH, 2004, p. 31. Ce glissement analytique rend d’ailleurs contestable la thèse voulant que la mar-ginalisation de l’histoire nationale (entendue au sens politique et non pas ethnico-culturel) au Québec s’expliquerait par la montée en importance de l’histoire sociale dans les milieux universitaires, cette dernière ayant délimité son champ d’analyse à l’espace québécois et contribué significativement à la consolidation de celui-ci dans l’imaginaire collectif.
17. Jacques Beauchemin, « Contre l’impuissance politique : s’assumer comme sujet de l’histoire », Argument, vol. 7, no 2, 2005, p.84-92.
18. Éric Bédard et Myriam D’Arcy, Enseignement et recherche universitaire au Québec : L’histoire nationale négligée, Étude commandée par la Fondation Lionel-Groulx, septembre 2011. Charles-Philippe Courtois, Le Nouveau cours d’histoire du Québec au secondaire : l’école québécoise au service du multiculturalisme canadien ?, Montréal, Institut de recherche sur le Québec, 2009. On lit dans ce dernier document que la vie démocratique ne peut se concevoir en dehors d’une nation québécoise entendue comme transhistorique et extérieure au Canada, aux immigrants et aux Anglais, communauté qui serait la « communauté politique réelle ».
19. Dont l’inévitable épisode des Rébellions, bien entendu, replacé dans le contexte d’un Printemps des peuples « républicain ». Sur la question des rapports entre communauté politique et communauté nationale, lire Martin Petitclerc, « L’actualité en débat : le rapport Bédard et notre communauté politique », Histoire engagée, revue en ligne, 10 décembre 2011, http://histoire engagee.ca/lactualite-en-debat-le-rapport-bedard-et-notre-communaute- politique/.
20. Bernard Lahire, « Champ, hors-champ, contrechamp ». 21. Yves Gingras, « Le champ scientifique », dans Frédéric Lebaron et Gérard
Mauger (dir.), Lectures de Bourdieu, Paris, Ellipses, 2012, p.279-294. 22. Olivier Christin, « La discipline historique et Bourdieu », dans Hans-Peter
Müller et Yves Sintomer (dir.), Pierre Bourdieu, théorie et pratique. Perspectives franco-allemandes, Paris, La Découverte, 2006, p. 146-154.
BHP 22-2 368 pages.indd 20 13-12-17 13:26
23. Pierre Bourdieu, « Le patronat », Actes de la recherche en sciences sociales, 20-21, 1978, p. 76.
24. Ivan Carel, Martin Pâquet, Stéphane Savard et Jean-Philippe Warren, « Édito-rial : Les principes du Bulletin d’histoire politique », Bulletin d’histoire politique, vol. 20, n° 3, printemps 2012, p. 57-64.
25. Pierre Bourdieu, « Les conditions sociales de la circulation internationale des idées », Actes de la recherche en science sociales, vol. 145, n° 145, 2002, p. 5.
26. Marc Angenot, « Questions à Jocelyn Létourneau : quel avenir ? », Spirale, n° 180, 2001, p. 14-15.
27. Est-il besoin de rappeler que Fernand Dumont, tout souverainiste fut-il, ne croyait pas à l’existence d’une nation québécoise ? « On parle couramment de nation québécoise. Ce qui est une erreur, sinon une mystification. […] L’histoire a façonné une nation française en Amérique ; par quelle décision subite pense-t-on la changer en une nation québécoise ? » (Raisons communes, Montréal, Boréal, 1995, p. 63-64).
BHP 22-2 368 pages.indd 21 13-12-17 13:26
![Page 1: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: « Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042323/6334521da1ced1126c0a445a/html5/thumbnails/16.jpg)