Gestion intelligente d'entrepôts de données énergétiques : quels défis ?
Les défis de l'adoption domestique en Bolivie
Transcript of Les défis de l'adoption domestique en Bolivie
Article_________________________________________________________________________
Les défis de l’adoption domestique en Bolivie Anne-Marie Piché
Professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal
Abstract (100 mots)
Le nombre d’enfants abandonnés ou privés de soins familiaux a augmenté de manière préoccupante en Bolivie au cours des dernières années. Cette étude de cas documente les enjeux de la réalisation d’adoptions domestique dans ce pays. Alors que le gouvernement a mis en place de nouvelles régulations qui empêchent l’adoption de ces enfants à l’international, des organismes de la communauté de Cochabamba tentent de développer une culture de l’adoption domestique. Ils ont développé une expertise dans le développement des enfants, identifient et soutiennent les familles boliviennes qui les accueillent. Toutefois, leur travail est entravé par le manque de collaboration et de sensibilisation des institutions étatiques et juridiques, qui elles seules détiennent le pouvoir décisionnel en matière d’adoption.
Keywords
Domestic adoption, child adoption, developing countries, Bolivia, child protection,
abandoned children, child development, Hague Convention, adoption culture
Corresponding author :
Anne-Marie Piché, School of Social Work, Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec) H3C 3P8, C.P. 8888, succursale Centre-Ville, Canada.
Email : [email protected]
1
Introduction
Le problème central de l’adoption est de concilier, d’une part, le droit des enfants privés de
famille d’avoir un milieu familial sain et stable- ce qui inclut la possibilité d’une adoption,
et, d’autre part, celui d’être maintenus dans leur famille, leur communauté et leur pays
d’origine (HCCH, 1993). Ce problème soulève des questions nouvelles, sur la gouvernance
et la régularisation des conditions de l’adoption internationale (Lammerant and Hofstetter,
2007; Fonseca, 2012) ; aussi sur les possibilités de réalisation d’adoptions domestiques au
sein des pays d’origine des enfants.
Dans les pays en développement, ce sont majoritairement les ONG de la communauté et les
communautés religieuses qui s’occupent de recueillir les enfants abandonnés ou « privés de
soins parentaux» (UNICEF, 2009).
Hors, la majorité de ces enfants ne trouvent pas de famille dans laquelle ils peuvent se
développer ; la logique de placement institutionnel étant encore la tendance dominante au
sein des pays pauvres, particulièrement lorsque la protection de l’enfance y est absente ou
peu organisée. Ce type de placement a pourtant été maintes fois dénoncé pour ses effets
déplorables sur le développement socioaffectif, physique et neurocognitif des enfants,
2
surtout lorsqu’il dépasse la première année de vie (Bowlby, 1951; Spitz, 1945; Zeanah,
2000; Smyke et coll., 2002; Rutter and coll., 2007; Maclean, 2003).
La nécessité de développer une prise en charge alternative, de trouver des familles stables
et engagées auprès de ces enfants n’est donc plus à démontrer. L’adoption est en soi
considérée comme une intervention efficace et valable lors de l’absence d’autres solutions
dans la communauté.
Toutefois, la situation actuelle est telle que la plupart des enfants resteront en institution
jusqu’à l’âge adulte ou vivront dans la rue ; par manque de ressources, de connaissances
des institutions sur le développement de l’enfant mais surtout, par manque de volonté
politique (Fuentes et coll., 2012; Salazar La Torre et coll., 2011). La majorité des enfants
abandonnés en Bolivie resteront en institution jusqu’à leur âge adulte, ou vivent dans la rue.
Des ONG d’aide à l’enfance tentent de pallier aux lacunes ou à l’absence d’intervention
étatique pour s’occuper des enfants abandonnés. Ces organismes, à but non-lucratif
fonctionnent avec peu de moyens, et doivent tenir compte dans leurs interventions de
contextes sociaux complexes, qui sont de plus en plus caractérisés par l’augmentation des
problèmes sociaux qui ont des impacts majeurs au sein des familles et qui provoquent la
plupart de ces abandons (violence, alcoolisme ou toxicomanie des parents, isolement dû
aux mouvements de migration urbaine, déresponsabilisation parentale, etc.).
3
La prise en charge locale des enfants sans soutien familial: le cas de la
Bolivie
La Bolivie s’est engagée en 1989 dans une démarche de coopération internationale en
adhérant à la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en
matière d’adoption internationale (HCCH, 1993). Cette convention vise à défendre les
droits des enfants sans soutien familial et implique que les pays membres mettent
rapidement en oeuvre des interventions qui se fondent sur le principe d’intérêt supérieur de
chaque enfant.
Les principes qui y sont défendus visent, entre autres, à assurer les conditions de
développement optimales aux enfants fragilisés par l’absence de famille, à encouragent les
initiatives de soutien local aux familles afin de prévenir l’abandon et favorisent l’adoption
domestique avant l’adoption étrangère afin de préserver les liens de l’enfant avec son
milieu et sa culture.
Bien qu’elle ait ratifié la Convention, la Bolivie n’est pas devenue « État membre » car elle
n’a pas autorisé la présence d’organismes d’adoption internationale d’autres pays sur son
territoire. Ainsi les ententes d’adoption internationale entre la Bolivie et les pays d’accueil
occidentaux ont expiré les unes après les autres au cours des années 2000. En conséquence,
4
toute adoption étrangère est rendue presque impossible puisqu’elle exige de devenir
résident du pays et d’y séjourner pendant 2 ans avec l’enfant.
Les foyers et orphelinats sont ainsi les principaux milieux de vie ouverts aux enfants
boliviens sans soutien familial. Les organismes peinent à concrétiser des placements
d’enfants en familles d’accueil et adoptives, seulement une centaine trouvent une famille
pour les accueillir à Cochabamba chaque année (CARITAS). Ce qui est bien peu,
comparativement au nombre d’enfants vivant actuellement en institution dans cette région :
environ 3,600 y seraient placés et n’ont aucun projet d’adoption, selon des organismes
locaux (Infante, 2015); près de 10% sont à risque de perdre leurs soins parentaux et à
l’échelle nationale, environ 6000 enfants sont privés de famille (Salazar La Torre et coll.,
2011).
Malgré une réforme judiciaire récente (Código del Niño, 2012) concernant le traitement des
enfants abandonnés, certains efforts d’amélioration technique et de coordination des
institutions gouvernementales impliquées (UNICEF, 2014), tous les acteurs consultés
dénoncent la lenteur des progrès pour réellement arriver à assurer à tout enfant le « droit à
vivre dans une famille ». Outre ces obstacles structurels à la réalisation de placements
familiaux, un travail important de sensibilisation culturelle resterait à faire dans les
communautés afin de transformer l’image négative qui est encore associée à la parentalité
5
par adoption, notamment en Bolivie. Ce contexte culturel défavorable à l’adoption vient
s’ajouter à la forte pression mise sur ces milieux pour trouver des familles aux enfants.
Les solutions de placement au niveau local doit survenir dans un délai raisonnable et les
enfants visés ne peuvent pas attendre la disparition des problèmes structurels, politiques qui
les maintiennent dans la pauvreté et l’exclusion pour trouver une famille (SSI/ISS, 2012) ;
lorsque ces politiques devraient assurer leur développement (Van Ijzendoorn and Juffer,
2006). De l’autre côté, l’adoption internationale « à tout prix » n’est pas toujours
recommandable ; ayant été questionnée par plusieurs auteurs au cours des dernières années
comme fausse solution à des problèmes structurels au sein des pays pauvres (Rotabi and
Gibbons, 2009; McCreery Bunkers et coll., 2009; Roby and Ife, 2009). Nous devons alors
nous intéresser, plus que jamais, aux efforts mis en place au sein des communautés pour
protéger et assurer le développement des enfants qui ont perdu leur soutien familicoll.
Ces efforts sont pour la plus grande partie assumés par des organismes de la société civile
et les communautés religieuses en Bolivie ; toutefois ces derniers n’arrivent qu’à répondre
aux besoins de 23% des enfants de moins de 5 ans qui sont vulnérables face à la perte du
soutien familial; et seulement 9.4% de ceux qui sont à risque le plus élevé (La Torre
Salazar et coll., 2011).
6
(Salazar La Torre et al., 2011).
Cochabamba et les problèmes modernes des familles en Bolivie
La Bolivie est le pays le plus pauvre d’Amérique du Sud, les femmes, les enfants et les
autochtones en région rurale étant les populations les plus vulnérables parmi les 10.1
millions d’habitants (Canada, 2014). La mortalité infantile des enfants boliviens en bas de 5
ans s’établissait à 41 décès pour mille naissances en 2012; le plus haut taux en Amérique du
Sud et le 60e dans le monde (UNICEF, 2014A). Le pays a entrepris une réforme sociale en
2008 touchant à divers aspects de la qualité de vie des enfants et des jeunes : santé,
éducation, et protection sociale. Par contre, les observateurs dénotent l’augmentation de la
présence de graves problèmes sociaux reliés à la pauvreté et aux iniquités sociales :
violence domestique, abus sexuels, alcoolisme, abandons et homicides d’enfants
(CARITAS); ces politiques sont critiquées par plusieurs ONG locaux comme étant
théoriques, non appliquées dans les communautés (La Torre Salazar et al., 2011).
Troisième centre urbain de la Bolivie, Cochabamba vit une croissance trop rapide, reliée
aux migrations de citoyens des régions rurales qui ne fournissent plus de travail (autrefois
dans l’exploitation minière et la culture de coca). Les mères abandonneraient fréquemment
leurs enfants en recherche de travail dans les pays voisins (CARITAS); laissant ces derniers
en institution, souvent surpeuplées. La loi bolivienne ne condamne pas l’abandon d’enfants
7
(La Torre Salazar et al., 2011) et interdit l’avortement à moins de viol ou de maladie grave
de la mère. Les orphelinats publics ou foyers d’accueil privés n’offrent pas les opportunités
développementales d’un milieu familial (soins, liens significatifs avec des adultes,
éducation) et ne sont pas dotés de ressources suffisantes pour assurer la nutrition de base,
l’encadrement ni le soutien psychologique aux enfants qui ont développé des
problématiques. Le financement des foyers d’enfants boliviens par le gouvernement (0,80$
US par enfant par jour; (La Torre Salazar et al, 2011) est nettement insuffisant pour assurer
les besoins de base des enfant. Selon l’organisme CARITAS, jusqu’à 100 enfants de moins
de 7 ans sont placés chaque année dans une famille d’accueil temporaire en attente d’un
placement adoptif permanent (dans la région de Cochabamba). La réintégration de ces
enfants dans leur famille ou milieu d’origine n’est pas souvent possible par la lourdeur des
problématiques de la famille, leur non-désir de garder l’enfant, ou est négligée comme
étape préalable à un placement. Plusieurs organismes du pays dénoncent vivement
l’inaction du gouvernement dans l’amélioration de la situation des droits de l’enfant au
pays : en 2010, 74% des enfants boliviens entre 0 et 10 ans étaient affectés par la pauvreté ;
63% étaient à risque pour leur protection et leur développement en milieu familial (53%
à Cochabamba) ; 10.98% étaient à risque très élevé d’abandon (La Torre Salazar et al,
2011). Ceux dont la famille n’a pas pu être soutenue à temps se sont retrouvés en situation
8
d’abandon : selon le recensement national (rapporté par l’enquête nationale de (Salazar La
Torre et al., 2011), 20,000 enfants se retrouvaient en orphelinat en 2010 ; une augmentation
depuis 2001 alors que leur nombre atteignait 9,200. Ceci ne tient pas compte des enfants
qui vivent dans la rue (ninos en situacion de calle) qui eux, sont estimés à 6,000 dans
l’ensemble du pays (UNICEF, 2014b).
Méthodologie
Objectifs de l’étude
Cette étude a voulu comprendre la manière dont les organismes d’aide à l’enfance de la
région de Cochabamba agissent, tant dans la réalisation de placements adoptifs locaux que
dans la promotion des droits de l’enfant privés de soutien familial . Les objectifs
spécifiques que nous avons identifiés pour cette étude étaient de :1) comprendre les réalités
spécifiques et les activités d’organismes d’aide à l’enfance de la localité de Cochabamba;
2) repérer les principaux enjeux qui les mobilisent actuellement et leur signification dans
l’exercice de leur mission et 3) identifier les stratégies employées par ces organismes pour
se positionner dans le « champ » de l’adoption (Ouellette, 2005; Bourdieu, 1980) par
rapport aux autres acteurs du milieu.
9
Méthodologie Cette étude était guidée par un devis de nature qualitative et exploratoire. La
démarche méthodologique qui a été privilégiée est l’étude de cas. Cette méthodologie
permet d’examiner des phénomènes spécifiques vécus par des individus, des groupes ou
des communautés en tenant compte du contexte (Yin, 2013; Creswell, 2013), en observant
sur le terrain les réalités telles que vécues et perçues par les participants. Le cas à l’étude est
l’adoption domestique dans la communauté de Cochabamba, étant donné qu’elle compte un
grand nombre d’enfants abandonnés ou privés de soutien familial (la 2e ville au pays en ce
sens ; (Salazar La Torre et coll., 2011). Nous étions également intéressés par la présence
significative d’organismes impliqués dans le soutien à ces enfants et qui font la promotion
de leurs droits.
Méthodes et participants
Afin de mieux comprendre les réalités de l’adoption domestique et le travail des
organismes, nous avons utilisé un ensemble de méthodes soit 1) l’entrevue semi-structurée
individuelle avec des employés et directions d’organismes d’aide à l’enfance de la région;
2) l’analyse de documentation (journaux locaux, sites internet d’organismes) sur les réalités
des enfants et des familles vulnérables en Bolivie ; 3) l’observation d’une rencontre
associative d’organismes d’aide à l’enfance régionaux; et 4) nous avons également visité
deux orphelinats de la région, afin de donner un contexte à nos observations. Les
10
participants ont été recrutés dans un premier temps par établissement de contact via
personnes de confiance agissant dans la communauté de Cochabamba (méthode de « gate-
keeper » ; (Creswell, 2013). Une fois le contact accepté, nous avons fait parvenir une lettre
d’information aux participants intéressés par courriel. Nous avons obtenu le consentement
écrit de chaque participant sur place.
Au total, nous avons rencontré 9 participants; 7 ont accepté que nous utilisions leurs
témoignages aux fins de l’étude. Nous avons en plus observé une rencontre de l’association
ASHONA1, qui regroupe les organismes d’aide à l’enfance et la presque totalité des 60
foyers de la région de Cochabamba, discuté avec sa directrice, et visité deux orphelinats
pour enfants (plus jeunes et plus âgés). 3 autres organismes locaux ont accepté de participer
à l’étude, mais n’ont pas pu être rejoints pour obtenir leur témoignage.
Stratégie analytique
Notre démarche d’analyse du matériel de recherche a été inspirée de la théorisation
enracinée (Grounded theory ; (Charmaz, 2014; Strauss and Corbin, 2008). L’objectif est de
faire émerger des concepts construits à même le discours des participants, en élaborant
autour des éléments contextuels (localisation sociale, historique, politique) dans lesquels ils
évoluent. Suite à l’enregistrement et à la traduction des entrevues réalisées en espagnol, les
1 Asociacion de hogares centros y asilos
11
transcriptions ont été codées par les chercheurs en faisant ressortir les grandes catégories de
données, d’abord descriptives puis analytiques. La rédaction de mémos thématiques a
assisté à l’approfondissement des analyses et à la sélection de thématiques dominantes ; de
même que la tenue d’un journal de bord. Les étapes de codification propres à la théorisation
enracinée (initiale, axiale, transversale) (Strauss et Corbin, 2008) ont été utilisées et
impliquaient l’organisation et la réorganisation des éléments de discours recueillis en les
constituant en catégories par démarche itérative. Les questions initiales de l’entrevue semi-
dirigée concernaient: 1) la perception des rôles exercés par l’acteur-organisme avec ses
avantages et ses contraintes actuelles; 2) les enjeux de pratique et de collaboration
rencontrés dans l’accompagnement des enfants et des adoptants dans un processus de
placement, d’adoption, ou de réintégration familiale ; 3) les stratégies déployées par une
partie des acteurs pour se positionner dans le « champ » de l’adoption domestique et les
intérêts qu’ils tentent de faire valoir.
Étant donné le nombre plus important de participants en provenance d’ONGs, les analyses
reflèteront principalement leur point de vue ; principalement de deux organismes qui jouent
un rôle central dans les placements d’accueil et les adoptions dans la région : Infante
(Promocion integral de la mujer y la infancia), et le chapitre local d’une association de
familles adoptives Boliviennes (Familias Adoptivas). Dans le cadre d’une étude qui voulait
12
avant tout cibler le travail des organismes communautaires, nous n’avons pas ciblé les
représentants des institutions domestiques gouvernementales, ni les familles pour cette
étude, bien qu’il aurait été intéressant d’obtenir leurs témoignages. Nous avons cependant
sollicité le témoignage des représentants gouvernementaux de l’institution en charge de la
protection et du placement des enfants, la SEDEGES (Departamental de Gestion Social),
mais n’avons pas obtenu de réponse de leur part.
Résultats
Nos analyses indiquent que, malgré le très grand nombre d’enfants en besoin de placement
stable dans la région de Cochabamba, très peu parviennent à trouver une famille en raison
de facteurs complexes d’ordre institutionnel, légal, politique et socioculturels. Ces facteurs
sont relatifs aux lacunes de coordination des services d’aide à l’enfance entre la SEDEGES
(représentant de l’État), et les organismes aptes à trouver des familles adoptives; au manque
de sensibilisation et de formation professionnelle des officiels quant aux besoins des
enfants privés de famille; au changement constant de politiques domestiques en la matière;
et au manque de familles domestiques désireuses d’adopter un enfant, en lien avec une
culture négative de l’adoption en Bolivie.
13
Les positions et enjeux vécus par les acteurs qui se préoccupent de la protection des enfants
vulnérables peuvent être analysés avec le concept de « champ » social (Bourdieu, 1980).
Un champ est défini comme un espace où des intérêts sont exprimés par des acteurs d’une
société donnée et pour un domaine d’action ciblé, et ce autour d’un enjeu central commun :
dans ce cas-ci, il s’agit de l’enfant abandonné ou privé de famille. À Cochabamba, les
acteurs publics que nous avons rencontrés agissent tous autour du même enjeu central : la
prise en charge de ces enfants vulnérabilisés. Nous avons remarqué dans le discours des
participants concernant les institutions gouvernementales boliviennes que les acteurs de
l’adoption priorisent et identifient les problématiques sociales à des niveaux très différents,
et ne conçoivent pas la prise à charge des enfants de la même façon.
I. Une difficile mobilisation autour des droits de l’enfant privé de famille
Les principaux acteurs autour du placement dans la région (Infante et le SEDEGES2) sont
des compléments « obligés » dans le déroulement de tout placement adoptif : Infante est un
ONG de la société civile qui trouve et prépare des familles pour accueillir les enfants; mais
seul le gouvernement a l’autorité de compléter leur évaluation et de concrétiser l’adoption
sur le plan juridique. Malgré leur collaboration, ils divergent depuis plusieurs années et de
manière importante sur la priorisation de l’adoption comme solution (la famille comme
2 Servicio Departamental de Gestion Social
14
meilleur milieu pour l’enfant), dans l’importance accordée à la rapidité des démarches
administratives et juridiques entourant le placement, et sur l’interprétation de la loi qui
l’encadre en Bolivie. Cette situation affecte leur coopération, et limite le nombre de
placements adoptifs qui peuvent être menés à bien dans la région (à peine 30 par année
selon Infante).
Du point de vue d’Infante, la prise en charge doit se faire d’abord et avant tout dans une
perspective de droit de l’enfant (CRC, 1989) : le droit à vivre en famille, et le droit à
l’identité qui est relié à la fois à la transparence quant aux origines familiales de l’enfant
(droit de savoir qu’il est adopté); qu’au droit de détenir une identité légale, un statut. Cette
perspective est fondée dans une connaissance et une reconnaissance des besoins
fondamentaux du développement de chaque enfant, par exemple le besoin de stabilité et de
continuité dans un milieu familial qui assurera non seulement la sécurité et l’éducation des
enfants déstabilisés; mais aussi un véritable attachement avec un adulte. Cette façon de voir
les choses se rattache au discours humaniste et socio-psychologique (Healy, 2014) des
intervenants, qui se sont professionnalisés en tant que travailleurs sociaux, psychologues et
avocats. Leur posture démontre également une sensibilité aux impacts du placement en
milieu institutionnel surtout à long terme, ce qui les mobilise dans la recherche de familles
d’adoption permanentes, ou du moins de familles d’accueil à moyen terme le temps de
15
trouver une situation stable aux enfants recueillis par les Defensorias, : l’instance
municipale qui reçoit initialement la plupart des enfants et adolescents en situation
d’abandon.3
Ces intervenants critiquent la perpétuation depuis des années du réflexe du placement
institutionnel des enfants par le gouvernement bolivien; que ce soit en foyer, en orphelinat
public ou privé. Ces placements surviendraient automatiquement après le recueil des
enfants par les autorités, sans examen approfondi de la situation de l’enfant et sans
participation de l’État à un véritable effort concerté, qui pourrait permettre une
réintégration familiale à l’aide des professionnels, un placement d’accueil ou en famille
adoptive.
Malgré les efforts de promotion de l’adoption par les ONG dans la communauté, il reste
aussi très ardu de dénicher des familles :
Nous tentons cependant d’aller vers le moindre mal. Nous savons que l’institutionnalisation nuit à
l’enfant. Il entre dans un système où il devient un numéro, où il va occuper un espace. Il ne va pas
pouvoir se réaliser comme personne parce que les foyers ici ne se questionnent que depuis peu sur le
problème des enfants qui restent jusqu’à 18 ans. Qu’arrive-t-il par la suite? Lamentablement, à 18 ans, ils
se retrouvent dans la rue sans référent familial. (Infante)
3 Defensoria de la Ninez y Adolescencia
16
Cette recherche de continuité identitaire et affective pour les enfants est menée entièrement
par le Programme d’évaluation et réintégration familiale d’Infante4; autrement aucun
service gouvernemental n’offre cette assistance aux familles en difficulté. Un troisième
programme de l’organisme, les familles d’accueil temporaires5, vise à assurer une sécurité
aux enfants en attente d’une solution d’adoption ou à plus long-terme :
La loi parle de familles d'accueil mais comme gardiennes. Ce qui signifie que dans le cas par exemple
d’un enfant dont les parents sont partis en Espagne, beaucoup ont émigré là-bas, l’oncle sera en charge de
l’enfant. Il aura la garde pour qu’il en prenne soin. Il devient le gardien jusqu’au retour des parents. Il y a
aussi le cas où des enfants abandonnés sont gardés par ces personnes. C’est à ça que se réfèrent les
familles d'accueil de la loi. Elle ne parle pas du modèle de familles d'accueil temporaire sans fins
d’adoption. (Infante)
Alors que le blâme pour l’abandon ou la maltraitance des enfants porte souvent sur les
parents, les familles et leur mode de vie dans la société bolivienne, selon quelques discours
entendus lors de notre séjour; les organismes rencontrés relèvent plutôt le manque d’appui
aux familles les plus vulnérables comme source dominante de la problématique.
L’adoption n’est pas la solution. Des fois on nous accuse en nous disant que nous voulons que tous les
enfants soient adoptés mais ce n’est pas le cas. Tous ne doivent pas être adoptés. Tous les enfants doivent
avoir une famille et la première devrait être la famille d’origine ou biologique. Des enfants sortent de leur
4 Atencion a la infancia5 Familias sustitutas transitorias
17
famille en raison de la maltraitance, de questions économiques, parce qu’on n’arrive pas à contrôler leur
éducation etc. etc.; ils aboutissent dans les foyers. Le gouvernement doit travailler à la réinsertion.
Collaborer avec les foyers pour parvenir à une réinsertion professionnelle. Ce n’est pas juste dire à la
maman : « c’est votre enfant, vous devez l’élever, vous en occuper.» Il doit s’agir d’un processus
professionnel. Dans ce cadre, il faut travailler avec les parents, l’église, les ONG, la famille, pour trouver
des appuis. (Familias Adoptivas)
La réponse des ONG arrive souvent tard, une fois que l’enfant vit déjà dans la rue après
avoir fui un milieu familial violent, ou que sa mère l’ait abandonné par manque de solutions
alternatives. Les intervenants croient que le gouvernement devrait assumer son rôle de
protection sociale dans la prévention des abandons; ce qui n’est pas le cas actuellement par
absence d’application des politiques sociales et de services publics de soutien aux familles.
2. Créer une culture de l’adoption domestique: une longue
conscientisation
L’augmentation alarmante des abandons d’enfants en Bolivie (La Torre Salazar et al.,
2011) serait issue d’une trop lente conscientisation de la société bolivienne par rapport au
développement humain et aux droits des enfants, par rapport à d’autres enjeux priorisés par
les gouvernements qui se sont succédés à travers les années.
18
Ce qui me frustre parfois c’est le manque d’appui de l’État. Parce que si le gouvernement faisait, pas juste
les lois parce que les lois existent, mais s’il travaillait plus la prévention, l’éducation, les valeurs et
plusieurs autres choses. Les familles seraient moins violentes, on recevrait plus d’appui mais ça manque
encore. Le ou les gouvernements, celui-ci ou un autre, n’appuient pas la santé ou l’éducation. Ils
n’appuient pas beaucoup la partie sociale. (Familias Adoptivas)
Ainsi, ce sont de petits organismes locaux, à but non lucratif qui fonctionnent sans appui ni
reconnaissance de la part des gouvernements, qui soutiennent les enfants et les familles.
Leur survie est précaire puisque le fonctionnement de la plupart dépend de dons privés et
d’une assistance toujours à renouveler de la part des ONG internationaux, ou des
communautés religieuses.
Ces dans ce contexte que des alliances se sont formées par rapprochement d’organismes de
la communauté (le regroupement de foyers et d’organismes ASHONA; entre Infante et
l’association de familles adoptives domestiques Familias Adoptivas; notamment) afin
d’influencer le développement d’une culture de l’adoption et du droit des enfants. Cette
association leur permet aussi de se positionner de manière plus influente par rapport au
SEDEGES. Les organismes tentent de faire reconnaître les enjeux reliés au développement
des enfants (affectif, cognitif, physique, identitaire), et les besoins qu’ils observent dans
leur pratique quotidienne. Ensemble ils revendiquent le droit à une famille pour tous les
enfants, leur protection mais aussi une collaboration plus efficace avec un système
19
gouvernemental au personnel très changeant, politisé, peu sensibilisé aux besoins
spécifiques des enfants en situation d’abandon ou à l’impact du temps administratif pour
rendre les décisions d’adoption sur ces derniers. En possession d’un capital de
connaissances professionnelles sur l’enfance et les familles, ces organismes ne détiennent
cependant aucun pouvoir décisionnel; ce qui les a appelé à développer des alliances
stratégiques et des collaborations avec les institutions domestiques:
On tente de rechercher des alliances stratégiques avec des institutions. Nous avons des enfants qui nous
arrivent avec de graves problèmes de santé. Nous avons des alliances avec des institutions dont nous savons
qu’elles vont pourvoir prendre en charge tout l’aspect médical. Un enfant avec des problèmes de santé, c’est
bien plus compliqué de lui trouver un espace (…). Ce que nous recherchons, ce sont des alliances qui nous
permettent une coordination plus directe avec des institutions pouvant recevoir les enfants, où il y a des
familles d'accueil temporaires par exemple. (Infante)Un thème central recueilli dans tous les
témoignages est la difficulté à créer une culture positive de l’adoption en Bolivie. Plusieurs
aspects relatifs à la culture, aux représentations sociales de l’enfant, et de la famille
empêcheraient les boliviens de se proposer comme postulants à l’adoption, et ce malgré les
encouragements offerts (possibilité d’adopter un enfant sans frais, ouverture aux
célibataires, campagnes de sensibilisation, etc.). L’idéologie de « l’amour créé par les liens
du sang » (Herman, 2008), ou de « l’enfant naturel » est encore très présente partout au
20
pays et encourage la croyance qu’un parent ne peut pas aimer un enfant qui ne vient pas de
lui.
Les gens n’arrivent pas à croire que tu peux aimer un enfant que tu n’as pas porté parce qu’ici « l’amour
vient par le sang (« el amor entra por la sangre »). (Familias Adoptivas)
Selon Infante, ce thème de l’adoption est à promouvoir; il faut travailler à défaire l’aspect
négatif qui est encore associé à l’adoption d’un enfant non-apparenté, notamment dans
l’entourage familial des couples. Défaire l’idéalisation de l’enfant naturel et valoriser les
projets familiaux adoptifs comme « une manière différente de construire sa famille » est
selon l’organisme une étape préalable importante au développement de l’adoption
domestique, qui s’ajoute aux défis du maintien des ressources en place et leur collaboration.
Culture de la fertilité, préjugés en lien avec l’adoption
Culturellement, la question de la fertilité est très présente dans notre communauté. Toute la cosmovision
andine, la nôtre, est souvent associée à la productivité et la fertilité. Bien des gens qui viennent nous voir
des campagnes ont honte ou ressentent de la tristesse parce qu’ils ne peuvent pas avoir d’enfants. Ce
qu’ils associent au fait qu’ils ne seront pas un couple productif, leurs animaux ou récoltent ne seront pas
abondants. Il y a beaucoup de peurs que nous les aidons à maitriser et à penser que les choses sont
différentes. Et pourquoi? Parce que les personnes qui vivent ces peurs préfèrent dire que c’est un enfant
naturel et pas adopté. (Infante).
21
Le principal préjugé véhiculé envers l’adoption vise la présumée moindre qualité du lien
parent-enfant ou encore son caractère jugé moins « vrai » que le lien naturel. L’autre source
de résistance des adoptants se retrouve dans l’adoption d’enfants grands, nombreux; alors
que l’idéal reste l’imitation de la relation familiale avec un nouveau-né, sans démarcation
d’âge qui serait trop visible au sein de leur communauté. Les fonctionnaires du
gouvernement manquent de formation et de sensibilisation à la question :
Nous avons rencontré quelques « techniciens », parfois des travailleurs sociaux, qui font bien leur travail.
Mais dans les SEDEGES et à la cour, il y a des « techniciens » qui ne sont pas sensibilisés à l’adoption et
qui ne vont pas vous appuyer très bien dans le processus d’adoption. (Familias Adoptivas)
Certains intervenants du SEDEGES qui sont en pouvoir de recommander une procédure
d’adoption ne tiennent pas compte des recommandations des professionnels qui vont en
faveur de ce type de placement pour un enfant donné. Les enfants se retrouveraient ainsi
rapidement transférés en institution de manière permanente, sans même qu’une réflexion
plus approfondie sur leur meilleur intérêt quant au choix de leur milieu de vie n’ait eu lieu
dans les instances.
L’association Familias Adoptivas, formée en 2003, regroupe 80 familles Boliviennes qui
ont adopté des enfants dans leur localité. Ils coordonnent des activités avec AIBI-Amigos de
los niños et Infantem, et sont membres d’un réseau national (Red por mi derecho a tener
22
una familia); tout comme Infante le fait dans ses ateliers post-adoption, ils organisent des
activités et conférences afin de démystifier l’adoption et offrir du soutien aux familles :
Ce que nous recherchons dans ces rencontres c’est sensibiliser la société et les autorités au thème de
l’adoption. Nous voulons aussi partager avec les enfants adoptés, partager des témoignages…Nous
voulons que l’adoption soit un peu plus visible, un peu plus « normale.» (Familias Adoptivas)
La stratégie de diffusion « aux parents par des parents » cet organisme permet de mieux
rejoindre la population et d’accroître petit à petit les candidatures à l’adoption domestique.
Culture de la violence et adoptions utilitaires
Les intervenants rencontrés font souvent référence à la violence familiale, comme source de
fuite des jeunes de leur milieu; tout comme la littérature qui documente cette réalité très
présente partout au pays. Alimentée par une forte consommation d’alcool de parents qui
fuient leur réalité précaire ou compensent leur frustration de ne pas trouver d’emploi, la
violence intrafamiliale se manifeste en abus physiques, psychologiques, sexuels, homicides,
suicides. Plusieurs enfants de la rue s’y sont retrouvés parce qu’ils préfèrent apprendre à
être indépendants plutôt que de retourner dans leur milieu familial (La Torre Salazar et al.,
2011). Le placement en foyer n’arrive pas à défaire le cycle de la violence et de la
dépendance, lorsque l’enfant atteint ses 18 ans il doit aussi quitter :
23
Ils les « jettent ». Alors l’adolescent qui a grandi dans un foyer, sans vraiment recevoir d’aide, se retrouve
dans la rue et il ne sait pas quoi faire. C’est un âge très critique où les jeunes ont besoin d’être encadrés.
Lorsqu’ils ne trouvent pas de soutien, ils se retrouvent seuls dans la rue et ils peuvent commencer à
consommer, ils vont devenir des adolescents de la rue (en situación de calle) et le cycle recommence.
Une adolescente tombe enceinte, l’enfant se retrouve dans un foyer, c’est un cycle. C’est pour cela que
nous pensons que les foyers ne sont pas la solution. (Familias Adoptivas)
Les organismes font aussi référence à une violence systémique, par laquelle l’entourage, les
municipalités, et même les institutions gouvernementales ne portent pas attention au droit
de l’enfant de grandir en contexte sécuritaire et émotionnellement soutenant; ignorent leurs
besoins développementaux. La culture du travail des enfants est présente de longue date en
Bolivie, et est acceptée de manière générale comme moyen naturel de soutenir les familles
les plus pauvres. 57% des enfants boliviens travaillent, selon le rapport de ALDEAS SOS
SOS (La Torre Salazar et al., 2011). Pour certains, la motivation d’adopter un enfant
localement a souvent été teintée de motifs utilitaires, c’est-à-dire lorsque les adultes le
considèrent comme force de travail additionnelle et ne lui reconnaissent pas un statut
égal aux autres enfants:
C’était ça la vision de l’adoption. « J’adopte un enfant, je l’aide, je l’adopte » mais je le fais travailler et il
n’a pas les mêmes droits que les enfants biologiques. C’était un peu la façon de voir l’adoption ici.
(Familias Adoptivas)
24
Les évaluations des postulants à l’adoption tentent ainsi repérer ce type de motifs. À ce
sujet, des orphelinats sont parfois en défaveur de l’adoption domestique; par rapport aux
opportunités bien plus grandes fournies par l’adoption internationale. D’autres intervenants
favorisent l’adoption domestique mais estiment que dans le contexte actuel, ils n’arrivent
pas à répondre aux besoins :
S’il n’y en avait que 100, sans l’adoption internationale, juste 100, on pourrait se débrouiller. Mais selon
les données d’UNICEF en 2007, il y a 15.000 (…) enfants en situation d’abandon. Alors, on ne peut pas
se permettre le luxe de dire « non, il ne faut pas qu’ils partent à l’étranger», dans un pays différent de
notre culture »…oubliant que cet enfant a besoin d’une famille.» (Familias Adoptivas)
Les adoptants internationaux seraient aussi plus ouverts que les boliviens à l’adoption
d’enfants grands, et avec des besoins spéciaux; adoptions qui sont difficiles à assumer sur
le plan financier et social pour les citoyens du pays, puisque l’État ne fournit pas d’aide en
matière de santé.
Discussion : coordonner et redistribuer la responsabilité de la protection
de l’enfance
Le portrait de situation des enfants et familles vulnérables de Cochabamba, dont nous avons
pris connaissance par cette étude, évoque la prédominance des efforts des ONG qui se sont
mobilisés et regroupés, en l’absence de structures d’aide adéquates et de mobilisation au
25
niveau gouvernemental quant à la problématique des enfants abandonnés. Si ces
organismes de la communauté tentent d’intervenir, ou de prévenir à la racine les abandons
et la maltraitance, ils ne bénéficient d’aucune reconnaissance (ni matérielle; ni symbolique)
du gouvernement Bolivien et doivent concentrer une grande partie de leurs efforts dans la
recherche de financement, dans l’assurance de la survie de leur mission auprès des enfants.
La Loi reconnait les familles temporaires comme instances d’accueil. Par contre, il y a une contradiction.
C’est SEDEGES qui nous reconnaît comme partie intégrante mais, maintenant, il ne souhaite pas
renouveler notre licence qui vient à terme bientôt. Et ils continuent à nous envoyer des enfants. Ça nous
rend un peu confus. Si on ne nous reconnaît pas, on ne devrait pas faire appel à nous, n’est-ce pas? C’est
justement là que se trouve le problème. Il y a beaucoup de changements. Trop. Il peut y avoir 3 directeurs
en 1 an. Ça change avec beaucoup de facilité. (Infante)
Le soutien intensif, de qualité et en proximité des familles est reconnu par tous les
intervenants rencontrés comme la principale source de résolution du problème de l’enfance
abandonnée et vulnérable - une solution à long-terme. L’intervention se doit d’être répartie
sur trois niveaux d’action : d’abord par apport de soutien aux mères avant que l’enfant ne se
retrouve en situation d’abandon; puis dans un travail de réinsertion familiale guidé par des
évaluations et un soutien professionnel intensif après le signalement de difficultés
familiales graves; puis dans coordination efficace dans l’organisation des adoptions entre
l’État et les organismes. À ce sujet, certains organismes collectiviseront la problématique
26
(davantage doit être fait pour soutenir les familles en général, il n’y a pas de « mauvaises
familles » en tant que telles mais bien des personnes vulnérables mal entourées); alors que
d’autres se centreront sur un discours de « famille à problème », violente, consommatrice,
abusive, incompétente, avec qui il ne sert à rien de mettre en œuvre des interventions. Le
placement adoptif le plus rapide possible devient la solution de première qualité à envisager
pour ces acteurs.
Les intervenants dénoncent les délais et processus inutilement lents qui font perdurer les
carences et le vide identitaire des enfants abandonnés. La définition de la situation légale
des enfants trouvés représente à elle seule un enjeu différent, et majeur; comme plusieurs
enfants n’ont jamais eu de certificat de naissance ou l’ont perdu en fuguant ou en étant
abandonnés, il devient difficile de faire reconnaître officiellement leur abandon de fait
auprès des instances; pourtant la seule porte ouverte à une adoption :
Selon la Loi, [le processus] devrait se compléter à l’intérieur de trois mois. Après cela, l’enfant est déclaré
sans filiation, signifiant « sans parents ». Mais, sur le plan bureaucratique, le processus peut dépasser un
an. La moyenne est d’un an et demi. C’est pourquoi lorsqu’un enfant arrive en foyer d’accueil, il/elle n’est
pas adopté avant l’âge de deux ans ou après. Ils justifient cela en blâmant la documentation, pour déclarer
que l’enfant n’a pas de filiation, mais ça n’a pas de logique; si on suivait la Loi, le processus durerait trois
mois. (Infante)
27
Selon ALDEAS SOS, les enfants abandonnés de plus de 10 ans n’ont aucune possibilité
d’adoption familiale au sens de la Loi bolivienne (La Torre Salazar et al., 2011); aucune
intervention étatique n’est prévue pour venir en aide aux enfants qui vivent dans la rue
après avoir fui leur milieu familial.Les décisions ultimes de placement des enfants relèvent
uniquement de l’État et des juges (Defensorías), et prennent beaucoup de temps à être
rendues, plusieurs démarches administratives sont inutilement longues et causent du tort
aux enfants en attente dans un milieu institutionnel qui ne suffit pas à répondre à leurs
besoins fondamentaux. Aussi, les juges qui sont nommés pour prendre des décisions
concernant les enfants ne sont pas souvent formés ou spécialisés en la matière :
Une fois, ils ont demandé à un juge d’être en charge de l’enfance alors que son expérience préalable était
en agriculture. Les juges ne se coordonnent pas, même pas entre eux, pour désigner des enfants pour
l’adoption. Ce sont ces incohérences…Travailler avec des enfants requiert de l’expérience. C’est
compliqué. (Familias Adoptivas)
Suite à un autre changement de direction, l’évaluation psychosociale en vue des adoptions
ou d’une réinsertion familiale est réalisée par la SEDEGES. Par contre, c’est Infante qui
s’occupe de gérer tout le processus d’enquête psychosociale avec les familles d’origine;
d’examiner en profondeur les enjeux et la situation légale de chaque enfants. D’après leurs
intervenants, la gestion de ces aspects par le gouvernement est très déficiente,
28
administrative et générique; ne tient pas compte des besoins particuliers des enfants. Ils
sont satisfaits de leur travail lorsqu’ils arrivent à sensibiliser l’institution :
Pour moi, c’est pouvoir travailler avec les enfants pour pouvoir récupérer et leur restituer leur place. Ce
sont des enfants qui, quand ils nous arrivent en situation d’abandon, sont « annulés ». La carence
affective est très forte et pour cela, l’autre partie la plus exigeante c’est de pouvoir, en équipe, analyser ce
qui est le mieux pour l’enfant. Et nous donner ce pouvoir de donner notre opinion sur un enfant devant un
juge. (Infante)
Aucune équipe n’est dédiée spécifiquement à l’adoption au SEDEGES; les fonctionnaires
seraient surtout des généralistes qui s’occupent de toutes les problématiques sociales
simultanément. Les postes seraient aussi largement politisés, ce qui nuit ultimement aux
dossiers des enfants et aux collaborations avec le milieu :
Le gouvernement est politisé. Ce sont des postes politiques. Les gens sont désignés. Des fois, la personne
n’a pas les capacités pour occuper le poste mais on lui doit quelque chose politiquement et elle prend
possession du poste. C’est triste mais c’est la réalité. C’est un point très négatif pour tout le travail que
nous réalisons. (Infante)
Cette organisation de la protection de l’enfance entrainerait de fréquents changements de
direction et de protocoles quant aux décisions d’adoption; qui affectent la collaboration.
Les relations de travail sont constamment à refaire avec de nouveaux partenaires. Les
organismes rencontrés nous ont parlé d’un travail de longue haleine, dans lequel les
29
institutions qui sont en mesure de concrétiser les adoptions qu’ils proposent sur une base
régulière, compliquent et limitent la portée de leur travail auprès des enfants.
Ce n’est pas tout mais je pense que l’État devrait jouer un plus grand rôle, une participation plus active et
voir que le simple changement d’un fonctionnaire peut occasionner la rupture un cas. Il faut
recommencer de nouveau (…) (Infante)
Pour un organisme qui travaille dans le domaine de l’enfance, les changements constants de directeur
affectent complètement la façon de fonctionner. Alors que certains signent des accords et permettent de
progresser, un nouveau directeur ne sera pas d’accord ou quelque chose d’autre va arriver et là, quoi?
(Familias Adoptivas)
Ainsi les facteurs qui permettraient une amélioration de la situation des enfants privés de
famille en Bolivie sont complexes, reliés à des changement sociaux rapides qui amènent de
nouvelles problématiques, et nécessitent un effort systémique accru pour que s’accroisse la
coopération entre les ONG et le gouvernement. Pour les intervenants, la solution passe
avant tout par la responsabilisation de l’État dans son rôle de soutien aux familles
vulnérables, la professionnalisation et l’organisation de la protection de l’enfance qu’elle
doit assumer, l’accélération de la définition de la situation légale des enfants pour leur
donner une chance d’être adopté. Au plan plus global, la communauté doit s’ouvrir au
caractère positif de l’accueil d’un enfant non-apparenté et créer une culture de l’adoption
positive au sein du pays.
30
FundingCe projet de recherche a été rendu possible avec le programme d’appui aux nouveaux professeurs PANP-FRQSC de l’Université du Québec à Montréal mais n’a reçu aucune subvention spécifique d’agences dans le domaine public, commercial ou sans but lucratif.
Remerciements
Nous remercions tous les organismes qui ont généreusement participé à cette étude ainsi que les personnes qui nous ont ouvert leurs portes : Mmes Johanne de Champlain et Sr Murielle Dubé. Nous remercions également M. Alain Droga pour son travail d’assistance à la recherche.
AuteureAnne-Marie Piché est professeure permanente à l’École de travail social de l’Université du
Québec à Montréal, Québec, Canada.
Références
Bourdieu P (1980) Questions de sociologie. Paris: Éditions de Minuit.
31
Bowlby J (1951) Maternal care and mental health. Bulletin of the World Health Organization 3: 355–533.
Canada Gov’t (2014) Foreign Affairs, Trade and Development Canada – Bolivia. Available at: http://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/bolivia-bolivie.aspx?lang=eng (accessed 26-03-2015).
CARITAS Bolivie: des familles d’accueil prennent en charge des enfants abandonnés. Available at: https://www.caritas.ch/fr/nos-actions/dans-le-monde/enfants/bolivie-des-familles-daccueil-prennent-en-charge-des-enfants-abandonnes/.
Charmaz K (2014) Constructing Grounded Theory. Sage Publications.
Código de la Niña (2012) Código de la Niña, Niño y Adolescente.
Corbin JM and Strauss AL (2008) Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, Los Angeles, CA: Sage Publications.
CRC (1989) Convention on the rights of the child. Available at: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx (accessed 26-03-2015).
Creswell JW (2013) Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. SAGE Publications.
Fonseca C (2012) Transnational negotiations of the mechanisms of governance: regularizing child adoption. Vibrant 6(1): 8–34.
Fuentes F, Boéchat H and Northcott F (2012) Investigating the grey zones of intercountry adoption. In: International reference centre for the rights of children deprived of their family (ed). Geneva: International social service/Service social international, 120.
HCCH (1993) Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption (Hague Adoption Convention). Available at: http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=45 (accessed 26-03-2015).
Healy K (2014) Social Work theories in context: creating frameworks for practice. Palgrave MacMillan.
Herman E (2008) Kinship by design: a history of adoption in the modern United States. Chicago: University of Chicago Press.
32
Infante (2015) Infante promoción integral de la mujer y la infancia. Available at: http://infante.com.bo.
Lammerant I and Hofstetter M (2007) Adoption: à quel prix? Pour une responsabilité éthique des pays d’accueil dans l’adoption international. Lausanne, Suisse: Terre des Hommes–aide à l’enfance, 46.
Maclean K (2003) The impact of institutionalization on child development. Development and Psychopathology 15: 853–884.
McCreery Bunkers K, Groza V and Lauer DP (2009) International adoption and child protection in Guatemala. International Social Work 52(5): 649-660.
Ouellette FR (2005) Le champ de l’adoption, ses acteurs et, ses enjeux. Revue de Droit Université de Sherbrooke 35(2).
Roby JL and Ife J (2009) Human rights, politics and intercountry adoption. International Social Work 52(5): 661–671.
Rotabi KS and Gibbons JL (2009) Editorial. International Social Work 52(5): 571–574.
Rutter M et al. (2007) Early adolescent outcomes for institutionally deprived and non-deprived adoptees. In: Disinhibited attachment. Journal of child psychology and psychiatry 48(1): 17–30.
Salazar La Torre CS, Escalante EC, Abularach KV, et al. (2011) Análisis de la situación actual de los niños y niñas privados del cuidado de sus padres y en riesgo de perderlo. Report, Aldeas Infantiles SOS Bolivia, 245.
Smyke AT, Dumitrescu A and Zeanah CH (2002) Attachment Disturbances in Young Children. In: The Continuum of Caretaking Casualty. Journal of American Academic Child and adolescent Psychiatry 41(8): 972–982.
Spitz R (1945) Hospitalism: An inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood. Psychoanalytic Study of the Child 1: 53–74.
SSI/ISS (2012) Bulletin mensuel. SSI/CIR Centre international de référence pour les droits de l’enfant privé de famille (ed) Edition spéciale. Les adoptions d’enfants dits besoins spéciaux : nécessités, expériences et limites: Centre international de référence pour les droits de l’enfant privé de famille SSI/CIR.
UNICEF (2009) L’UNICEF: en absence d’un environnement protecteur, la vie est difficile pour les enfants. Available at:
33
http://www.unicef.ca/fr/press-release/l’unicef-en-l’absence-d’un-environnement-protecteur-la-vie-est-difficile-pour-les-enfa (accessed 26-03-2015).
UNICEF (2014a) La situation des enfants dans le monde 2014 en chiffres: chaque enfant compte-dévoiler les disparités, promouvoir les droits de l’enfant. Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), New York, 110 p. Available at: http://www.unicef.ca/sites/default/files/imce_uploads/UTILITY%20NAV/MEDIA%20CENTER/PUBLICATIONS/FRENCH/sowc_2014_fr.pdf (accessed 26-03-2015).
UNICEF (2014b) UNICEF annual report 2013 — Bolivia. Available at: http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Bolivia_COAR_2013.pdf (accessed 26-03-2015).
Yin RK (2013) Validity and generalization in future case study evaluations. Evaluation 19(3): 321–332.
Zeanah CH (2000) Disturbances of attachment in young children adopted from institutions. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 21: 230–236.
34






































![« Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334521da1ced1126c0a445a/-penser-lhistoire-politique-au-quebec-avec-pierre-bourdieu-precisions-conceptuelles.jpg)

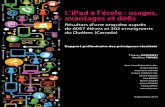

![LES SEPT DÉFIS DE LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE [The seven challenges in the fight against social exclusion]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321c3c8807dc363600a205a/les-sept-defis-de-la-lutte-contre-lexclusion-sociale-the-seven-challenges-in.jpg)










