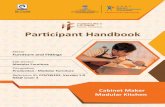« Mahomet expulsé d’Espagne par Isidore de Séville. Sur la postérité moderne d’un épisode...
-
Upload
ephe-sorbonne -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of « Mahomet expulsé d’Espagne par Isidore de Séville. Sur la postérité moderne d’un épisode...
MahoMet exPulsé d’esPagne PaR isidoRe de séVille. suR la PostéRité ModeRne d’un éPisode hagiogRaPhique
ReJeté PaR les bollandistes
Patrick HenrietÉcole Pratique des Hautes Études
Section des Sciences Historiques et Philologiques
La légende selon laquelle Mahomet serait venu prêcher en Es-pagne avant de repartir très vite en direction de l’Afrique afin de ne pas être capturé par Isidore de Séville est attestée, pour la pre-mière fois, dans une Vita sancti Isidori qui peut être datée de la fin du xiie ou du tout début du xiiie siècle.1 Bien connue au Moyen Âge, présente jusque dans les bréviaires, elle a fait l’objet de différentes versions que j’ai présentées ailleurs.2 L’objet de ce travail est donc de reprendre le dossier pour l’époque moderne, jusqu’au moment où cette histoire fut définitivement discréditée par Faustino Aréva-lo dans son édition des oeuvres complètes d’Isidore patronnée par le cardinal Lorenzana (1797). Pour ce faire, après avoir brièvement résumé les faits tels qu’ils apparaissent sous leur forme la plus complète, dans la Vita sancti Isidori, nous passerons en revue les principales chroniques ou recueils hagiographiques, d’origine pé-ninsulaire mais aussi ultra-pyrénéenne, qui la mentionnent. Il ne s’agit pas ici de prétendre à l’exhaustivité, plusieurs mentions de cette légende nous ayant assurément échappé. Néanmoins, les té-moignages réunis dans cette étude devraient permettre de dresser
1 Vita sancti Isidori (BHL 4486), Avril I, reproduite dans F. Arévalo (1797, 57-63); version incomplète dans PL 82, col. 19-56. Sur la Vita sancti Isidori, J. Fontaine (2001); P. Henriet (2002 et 2003); J.C. Martín (2005).
2 P. Henriet (2012).
Vitae Mahometi: reescritura e invención en la literatura cristiana de controversia.Simposio internacional, Universitat Autònoma de Barcelona (España), 19-20 de marzo, 2013
256 Vitae Mahometi
une première histoire de ce motif d’origine hagiographique, deve-nu sujet de controverse à partir de la fin du xvie siècle.
Selon la Vita sancti Isidori autrefois attribuée à tort à Lucas de Tuy, les événements prennent place alors qu’Isidore, de retour d’un voyage à Rome, s’approche de Séville. Le saint prélat apprend si-multanément l’apparition de Mahomet, prophète corrupteur, et celle d’un énorme serpent qui dévaste les alentours de sa ville. Il ordonne alors qu’on lui amène Mahomet, en l’enchaînant si néces-saire. Sur ce, le Diable apparaît au prophète de l’islam déguisé en ange de lumière et lui conseille de se retirer. Suit une longue dis-cussion entre Mahomet et celui qu’il croit être un ange. Ce dernier, le Diable donc, informe son interlocuteur qu’il n’est pas de taille à lutter contre Isidore et qu’il doit en conséquence gagner l’Afrique, ce que celui-ci fait immédiatement. Satan prend cependant soin de préciser que «les iniquités des habitants de l’Hispania ne sont pas encore terminées». En Afrique, Mahomet opère de nombreuses conversions. Quant à Isidore, il repousse par ses paroles le dragon qui semait la terreur.
On ne reviendra pas ici sur le sens de cette histoire. Conten-tons-nous de rappeler qu’il s’agissait alors d’exalter la figure d’Isi-dore à une époque qui, après la translation de ses restes à León en 1063, était celle de la composition d’un dossier hagiographique fourni.3 Le saint apparaissait ici lié au destin de la Péninsule dans son ensemble: sa simple présence éloignait les hérésies (personni-fiées sous la forme d’un dragon) et tout particulièrement celle de Mahomet. On comprenait aussi, implicitement, que les musulmans n’avaient pu s’emparer de la Péninsule qu’après la mort du «doc-teur des Espagnes». Cette étonnante histoire, dont on verra un peu plus loin que les bollandistes choisirent en 1675 de ne pas la pu-blier, fit l’objet d’une première traduction au castillan vers le milieu du xve siècle, en même temps que le reste de la Vita sancti Isidori, par l’ «Arcipreste de Talavera», auteur bien connu du Corbacho. Cette traduction ne connut qu’une diffusion restreinte et ne fut
3 Les différentes pièces hagiographiques du dossier isidorien entre xie et xiiie siècle sont recensées dans une optique plutôt historique par P. Henriet (2002) et dans une optique plutôt philologique par J.C. Martín (2005).
MahoMet expulsé d’espagne par IsIdore de sévIlle 257
imprimée, pour la première et dernière fois, qu’en 1952.4 Cepen-dant, dès 1525, le bénédictin Juan de Robles avait publié à Sala-manque une traduction du Liber miraculorum beatissimi Ysidori de Lucas de Tuy complétée par d’autres textes supposément écrits en latin et tirés des archives de Saint-Isidore. Venaient ensuite sept chapitres tirés de la Vita sancti Isidori et traduits au castillan. Parmi eux l’épisode de la venue de Mahomet en Espagne.5 Dès 1525 donc, une version intégrale de cet épisode était disponible sous une forme imprimée.
Dans la plupart des cas, cependant, ceux qui y firent allusion ne dépendaient pas de Juan de Robles mais de versions écourtées et simplifiées, tout particulièrement pour ce qui touchait à la longue et complexe discussion entre Mahomet et Satan déguisé en ange de lumière. Sous une formé abrégée, l’histoire de la venue de Mahomet avait été rapportée au Moyen Âge dans le Chronicon mundi de Lucas de Tuy, dans les légendiers de Rodrigue de Cerra-to, de Bernard de Brihuega et de Juan Gil de Zamora, dans les bréviaires et surtout dans l’Estoria de España d’Alphonse X.6 Elle était donc bien connue et fournit à partir du xve siècle des argu-ments aux apologistes de la religion chrétienne dans leur opposi-tion à l’islam. En voici deux exemples, l’un du milieu du xve siècle et l’autre résolument moderne.
En 1458-1459, le franciscain de Salamanque Alfonso de Spina écrivit le Fortalitium fidei, une oeuvre polémique très diffusée par la suite grâce à l’imprimerie.7 S’en prenant successivement aux hérétiques, aux juifs, aux musulmans et aux démons, l’auteur men-tionne deux fois la venue de Mahomet. Dans le chapitre consacré à l’expulsion des juifs d’Espagne, il note qu’« à cette époque [ = celle du roi Sisebut], Mahomet s’enfuit honteusement d’Hispania
4 Arcipreste de Talavera [ed. de J. Madoz y Moleres (1952) (traduction de la Vita sancti Isidori, pp. 67-161; chapitre relatif à la venue de Mahomet en Espagne: pp. 99-103).
5 Juan de Robles (1525), rééd. avec quelques commentaires par J. Pérez Llamazares (1992). 6 Toutes références dans P. Henriet (2002)7 Sur Alfonso de Spina, A. Echevarría (1999), ainsi que la thèse encore inédite de Raúl
Platas, Edición crítica y comentario del Fortalitium Fidei de Alfonso de Espina. Je remercie Raúl Platas pour avoir attiré mon attention, sur la présence de cet épisode en deux endroits du Fortalitium fidei alors que je n’en avais d’abord repéré qu’un.
258 Vitae Mahometi
pour gagner l’Afrique ».8 Il gomme donc le rôle d’Isidore, qui ne l’intéresse pas ici, mais retient ce qui peut servir son discours apo-logétique. Alfonso revient plus longuement sur cette question dans le chapitre consacré à Mahomet, donnant alors une version des faits très influente par la suite. Le faux prophète vient désormais sous le règne de « Richardus », comprenons Reccared II, le fils de Sisebut (621). Il admet la virginité de Marie mais pas la divinité du Christ. Les conversions opérées, après sa fuite d’Espagne, en Afrique et en Arabie, permettent de conquérir la Perse.9 Le reste est conforme aux récits antérieurs et la véracité de l’ensemble n’est jamais remise en cause.
Un siècle et demi plus tard, chez un autre frère mendiant polé-miste, le ton est bien différent et les certitudes sont moins fermes. En 1618, en effet, un fervent défenseur de l’expulsion des mo-risques (1609), le dominicain valencien Jaime Bleda, publie une Chronique des Maures d’Espagne dont on a pu dire qu’elle était « l’al-pha et l’oméga de l’historiographie apologétique relative à l’expul-sion des morisques ».10 Tout un chapitre du premier livre est consa-cré à Mahomet et à la question de savoir s’il a pu venir en Espagne. Les avis, comme on le verra bientôt, étaient alors partagés, aussi Bleda prend-il soin de donner quelques arguments inédits en fa-veur de la venue de Mahomet: retenons en particulier cette préci-sion selon laquelle les musulmans de Cordoue étaient persuadés de la venue du Prophète dans leur ville, raison pour laquelle ils lui
8 Hujus tempore [ = à l’époque de Sisebut] nefandus Mahometh ab Hispania fugatur in Afri-cam, Alfonso de Espina (Nuremberg, 1494), livre III, 9, fol. 169v.
9 (...) transiuitque dissimulatus in Hyspaniam anno ultimo regis Richardi et venit in ciuitate Cordubensi et predicauit ibidem suam malam doctrinam, dicendo quod Ihesus Christus fuit natus de virgine opere Spiritus sancti sed tamen quod non erat Deus. Quod cum audiuit beatus pater Ysido-rus archiepiscopus Hispalensis qui tunc veniebat de curia romana, statim misit homines suos ad predictam ciuitatem ut eum vinculatum sibi adducerent. Sed dyabolus apparuit sibi et dixit quod recederet ab illo loco et statim exiuit et fugiens nauigio transiuit in Affricam in qua et in Arabia decepit innumeras gentes, qui omnes ei adherentes Persarum regnum infestare ceperunt, ibidem, livre IV, II, 2, fol. 188.
10 Ainsi que l’expliquent B. Vincent et R. Benítez Sánchez-Blanco dans leur « estudio introductorio », J. Bleda (2001, 24), réédition de la première édition (Valence, 1618).
MahoMet expulsé d’espagne par IsIdore de sévIlle 259
avaient dédié la grande mosquée.11 Bleda reste cependant relative-ment prudent et conclut que cette venue « semble vraisemblable ».12
La nouvelle d’un séjour de Mahomet en Espagne avait franchi les Pyrénées dès le xve siècle et se retrouvait ici et là dans l’histo-riographie européenne. Déjà le chartreux allemand Werner de Ro-velinck (m. 1502) y avait donné crédit dans son Fasciculus tempo-rum, un abrégé d’histoire universelle qui, après sa publication en 1474, était devenu une référence européenne pendant tout le xvie siècle et avait connu de très nombreuses éditions.13 Dans une chro-nique publiée à Cologne en 1577, l’humaniste belge Johannes Va-saeus, qui avait vécu en Espagne et au Portugal, disait s’inspirer d’Alfonso de Spina mais aussi du bréviaire d’Évora, une oeuvre publiée à Lisbonne en 1548 par l’humaniste Andrés Resende.14 Vasaeus donnait également l’histoire comme vraie.15 Vingt ans plus tard, en 1597, les frères de Bry, fils de ce Théodore de Bry célèbre pour ses descriptions de l’Amérique, publiaient un ouvrage consa-cré aux « Faits de Mahomet, prince des sarrasins ». Ils y rappor-taient l’épisode qui nous intéresse en suivant de près Alfonso de Spina, jusque dans le nom du roi Reccared II, « Richardus », et ne mettaient pas plus en doute que ne l’avait fait Alfonso la véracité de l’épisode.16 Depuis la fin du xvie siècle, cependant, divers au-teurs n’hésitaient plus à manifester au moins un certain scepti-cisme. Ainsi en 1608, dans son Histoire générale de l’Espagne, le protestant suisse Théodore Turquet de Mayerne qualifiait l’épisode
11 Il conviendrait donc de rechercher dans les textes musulmans médiévaux mais aussi dans la littérature mudejar les traces de la croyance en la venue de Mahomet en Espagne. Cette recherche excède les objectifs du présent travail et les compétences de son auteur.
12 Ibidem, livre I, cap. 16, pp. 47-48.13 W. Rolenwich (j’ai consulté l’édition de Venise, 1484), fol. 41v : Ipse ( = Isidorus) etiam
Machometum qui in Hispaniam venit capi iussit sed admonitus a diabolo fugit.14 Sur le bréviaire d’Évora, B. de Gaiffier (1942, 131-139), qui met en valeur les tendances
falsificatrices de Resende. 15 J. Vaseus (Cologne, 1577, 399, anno 605): Hoc anno Mahometem pseudoprophetam, Cordu-
bae haereseos suae virus diffundere in Hispanos conatum produnt. Quae res quum S. Isidoro, qui id temporis Roma, quo ad concilium a summo pontifice vocatus fuerat, rediebat, innotuisset, atque ad capiendum illum misisset, ille, sive a daemone, sive ab alio quopiam admonitus, fuga sibi consulens, in Africam rediit. Ex Fortalitio fidei et Breviario Eborensi.
16 Jean-Théodore et Jean-Israël De Bry (Francfort 1597, 11-12). Je dois la connaissance de cette oeuvre à mon collègue Fernando González Muńoz (Universidade da Coruña), que je remercie vivement.
260 Vitae Mahometi
de « suspect ». Il n’en émettait pas moins l’hypothèse que « Mahu-met aagé pour lors d’environ vingt cinq ans, servant un marchand riche d’Arabie, la vesve duquel il espousa apres, se soit peu trouver en Espagne, pour les negoces de son maistre, et là ait donné quelque cognoissance du venin qu’il cuisoit en son cœur ».17
Ce n’est cependant pas de l’extérieur mais bien de l’intérieur de l’Espagne, et chez des historiens de tout premier plan, que vint la remise en cause de la légende. Ambrosio de Morales, chroniqueur officiel de la couronne de Castille depuis 1563, s’exprima sans am-bigüité en 1574 non seulement sur la venue de Mahomet mais aussi sur un autre histoire, elle aussi d’origine hagiographique,18 qui voulait que deux lampes confectionnées par Isidore ne s’étei-gnissent jamais : « il ne convient pas de perdre du temps à contre-dire ce genre de choses, car elles ne peuvent avoir ne serait-ce qu’une ombre de vérité ».19 Le jésuite Juan de Mariana, qui publia en 1592 ses volumineuses et très influentes Historiae de rebus His-paniae (rapidement traduites du latin à l’espagnol et au français), rejetait aussi totalement la fuite de Mahomet devant Isidore (pro vano repudiamus) et écrivit quelle ne concordait ni avec la chrono-logie ni avec les histoires «extérieures» (comprenons non espa-gnoles).20 En 1605, enfin, Francisco de Padilla se prononçait égale-ment contre l’authenticité de cet épisode dans une Histoire ecclésiastique de l’Espagne écrite en castillan.21
Mahomet avait-il oui ou non foulé le sol de la Péninsule ? En Espagne, malgré Morales et Mariana, la question n’était toujours pas tranchée au xviie siècle. De façon assez curieuse mais finale-ment très révélatrice de la naïveté qu’il y aurait à accorder a priori aux historiens un degré de crédibilité supérieur à celui des hagio-graphes, certaines chroniques continuèrent à entretenir le flou. On
17 L.Turquet de Mayerne (1608), livre V, cap. XVII, 182.18 Épisode présent dans Vita sancti Isidori, AASS, avril, I, col. 351 A.19 A. De Morales (ed. de 1791), cap. XII, 23, § 18, 134 (« y todo lo de haber querido pren-
der a Mahoma que vino a España, y otras cosas déstas, no hay que gastar tiempo en contradecirlas, pues no pueden tener ni aun sombra ninguna de verdad »).
20 J. De Mariana (Tolède, 1592) t. I, lib. VI, cap. 3, 244.21 F. De Padilla (Malaga, 1605), t. II, ff. 218-218v (« y lo de la venida de Mahoma a ella
tengo por falso »).
MahoMet expulsé d’espagne par IsIdore de sévIlle 261
vit en effet fleurir à partir de la fin du xvie siècle, sous l’impulsion d’un impénitent jésuite faussaire nommé Román de la Higuera, une série de chroniques dues à sa plume mais supposément écrites par Lucius Flavius Dexter (auteur cité par saint Jérôme mais dont l’œuvre ne nous est pas parvenue), par Maxime évêque de Sara-gosse (viie siècle), par Liutprand de Crémone (xe siècle) ou encore par Julián Pérez, un archiprêtre imaginaire qui aurait été, après la reconquête de Tolède (1085), le secrétaire particulier de l’arche-vêque Bernard de la Sauvetat (m. 1128).22 Or dans la supposée chronique de Maxime (continuation de celle de Lucius Flavius Dexter), il était affirmé à l’année 606: « Mahomet, homme impie et scandaleux, rôde en Espagne ».23 La fausse chronique de Liutprand affirmait quant à elle dès le troisième paragraphe que Mahomet était venu à Cordoue, Séville et Tolède et qu’il avait été repoussé par « Aurasius, archevêque de Tolède ».24 Comble du raffinement dans la forgerie, Román de la Higuera, qui était lui-même tolédan et dont on peut penser qu’il était ici mu par un patriotisme local, remplaçait Isidore par cet Aurasius effectivement attesté comme métropolitain de Tolède au début du viie siècle. Le même épisode était encore mentionné, plus brièvement, un peu plus loin. Román de la Higuera pouvait même donner force à son propos en citant
22 Sur ce phénomène des fausses chroniques, outre le libre de Nicolas Antonio cité en note 32, on se reportera encore avec profit à l’ouvrage classique de J. Godoy y Alcántara (Madrid, 1868, dernière réédition: Granada, 1999). Voir aussi G. Cirot (1904, 226-260), T.D. Kendrick (1960, 116-127), et divers travaux de A. Mestre Sanchís, par exemple (1996 et 2003). Sous l’angle hagiologique, P. Henriet (2002b, note 28). J.L. Quantin (1998, 451-480), écrit p. 455 que « les falsos cronicones, au moins hors d’Espagne, ne firent guère de dupes que volontaires ».
23 Fragmentum chronici, sive Omnimodae Flavii Lucii Dextri... cum chronico Marci Maximi et additionibus sancti Braulionis et etiam Helecae, episcoporum Caesaraugustanorum... per ... Petrum a Mendoza... in lucem editum et vivificatum... labore P. Fr. Joannis Calderon, Saragosse, 1619: Machumetus homo impius et flagitiosus, grassatur per Hispanias, p. 98 (année 644 de l’ère his-panique, soit 606). Dans une édition parue à Séville en 1627, Flavi Luci Dextri V.C. Omnimo-dae Historiae (…), Rodrigo Caro (m. 1647) commente tous les paragraphes de Dexter et de ses continuateurs et rejette la possibilité de la venue de Mahomet: voir fol. 215v.
24 Pseudo Liutprand dans l’édition de Román de la Higuera et Lorenzo Ramírez de Prado, Luitprandi Opera, Anvers, 1640, p. 297 (aera 645, anno 607) : Mahumetus virus erroris sui fundens per Hispanias, Cordubae, Hispali, Toleti coepit seminare : ab Aurasio Toletano archie-piscopo Toleto pellitur : catholicique doctores verbo scriptoque nefarium errorem persequuntur. Autre allusion à la venue de Mahomet p. 301 (§ 21) : Mahumetus pseudopropheta Cordubae praedicat. On notera que cette édition hispanique (mais publiée à Anvers) du Pseudo Liutprand donne d’abord, dans le même volume, les oeuvres authentiques de Liutprand de Crémone.
262 Vitae Mahometi
la Chronique d’Ildephonse de Tolède, c’est-à-dire, en réalité, un passage du Chronicon mundi de Lucas de Tuy placé sous l’autorité du prestigieux archevêque de Tolède mais rédigé, selon toute pro-babilité, par Lucas lui-même.25 Et peu importait si ce dernier met-tait bien en scène, comme on pouvait d’ailleurs s’y attendre, Isidore et non Aurasius !26 Ces forgeries étaient par ailleurs accompagnées de copieuses notes par leurs savants éditeurs, ainsi Rodrigo Caro, Tamayo de Vargas ou encore Ramírez de Prado.27
Alors que les chroniques espagnoles prenaient des directions diamétralement opposées (Morales et Mariana contre les faux chro-niqueurs), les auteurs de recueils hagiographiques faisaient para-doxalement preuve d’une grande prudence. Déjà le jésuite Ribade-neyra, auteur à partir de 1599 d’un célèbre Flos sanctorum en castillan, avait préféré ignorer purement et simplement l’épisode de la venue de Mahomet alors qu’il mentionnait pourtant le retour du saint depuis Rome ainsi que les pluies et les miracles qui l’avaient accompagné.28 Ribadeneyra connaissait donc la Vita sanc-ti Isidori, mais il avait choisi de passer sous silence la légende qui nous occupe ici: un signe, assurément, qu’elle le gênait. L’attitude de Juan de Tamayo y Salazar, qui publia à Lyon entre 1651 et 1659 une gigantesque Anamnesis sive commemoratio omnium sanctorum hispanorum, surprend davantage. Lui-même faussaire invétéré, grand lecteur des « falsos cronicones », Tamayo consacre un para-graphe à la question de savoir si Mahomet est bien venu en Es-
25 Sur la probable autorité de Lucas pour cette chronique d’un pseudo Ildephonse déjà suspecte au xvie siècle, voir P. Linehan (1993, 363, 376-377), ainsi qu’E. Falque dans son in-troduction au Chronicon mundi (2003, XLIX-LV).
26 Le commentaire de Jérôme de la Higuera se trouve sur la même page 297 : De adven-tu Mahumeti in Hispaniam etiam Iulianus, Lucas Tudensis, et recentiores. Quamvis neget Morales, nam in Chronico confirmat sanctus Ildephonsus archiepiscopus toletanus, quem affirmat per vim expulisse sanctum pontificem Aurasium. Non declarat, quinam auctores verbo scriptoque nefarios errores huius pseudoprophetae refutaverint, sed cum venerit in Hispaniam, valde verisimile est His-panos fuisse. Commentaire plus bref pour le § 21 : De adventu Mahumeti in civitatem Cordu-bensem, praeter hunc auctorem Ildephonsus in chronico, et Lucas Tudensis. On notera également le long commentaire de Lorenzo Ramírez de Prado aux pages 589-590, dans une série d’omissa in notis ad chronicon Luitprandi. Ces notes ont été reproduites en bas de la chronique du Pseudo Liutprand dans PL 136, col. 973-975.
27 Voir infra, annexe, aux années 1635 et 1640. Également Rodrigo Caro à l’année 1627. 28 P. de Ribadeneira, Primera parte del Flos sanctorum o Libro de las vidas de los santos (1624,
278-280).
MahoMet expulsé d’espagne par IsIdore de sévIlle 263
pagne (An Mahumetes in Hispanias devenerit). Or après avoir cité, comme bien d’autres, les principaux auteurs qui ont traité ce pro-blème, il conclut sans trancher : « laissons cela, jusqu’à ce que nous puissions accéder à de meilleures preuves ».29 Les critiques de Morales et de Mariana avaient sans doute fait leur chemin. Ne les entendaient cependant que ceux qui voulaient bien les entendre, comme on peut s’en rendre compte en examinant les publications de 1675. Cette anné-là, le bénédictin Gregorio de Argaiz, dans le quatrième tome de sa «Solitude honorée par saint Benoît», une histoire du monachisme bénédictin péninsulaire qui accordait un grand crédit aux faux chroniqueurs, signalait l’entée en Espagne, pour l’année 606, de «Mahomet fils de perdition». S’appuyant à la fois sur les faux chroniqueurs, sur Lucas de Tuy et sur l’Estoria de Espańa, Argaiz renvoyait à Tamayo de Vargas sans mettre en doute un seul instant la véracité de l’événement.30
Or en cette même année 1675, le bollandiste Henschenius (Hens-kens) donnait dans les Acta sanctorum la première édition de la Vita sancti Isidori. Le texte lui en avait été communiqué par Nicolas Antonio (m. 1684), alors chanoine de la cathédrale de Séville, grand érudit, bibliophile et auteur de la Bibliotheca Hispana Vetus (1672), un ouvrage alors sans équivalent en Espagne.31 Antonio ne nour-rissait par ailleurs aucune illusion sur les « fausses chroniques », qu’il appelait « historias fabulosas ».32 Une note d’Henschenius à son édition de la Vita sancti Isidori nous apprend que c’est son cor-respondant espagnol qui l’avait averti du caractère fantaisiste de l’épisode relatif à Mahomet. C’est encore lui, selon toute probabi-lité, qui avait donné au savant bollandiste diverses références dont celles de Tamayo, Padilla et Mariana, ainsi que, du côté des parti-sans de l’autenticité, celles de Lucas de Tuy et des faux chroni-
29 J. de Tamayo y Salazar (Lyon, 1652, t. II, 483-501) (Isidore), ici p. 493: Hinc ab illa dis-cedimus, quousque maiora veritatis monumenta capiamus. Sur Tamayo, je me permets de ren-voyer à P. Henriet (2002b).
30 G. de Argaiz (1675, 36).31 Nicolas Antonio (1617-1684) est l’auteur de deux œuvres posthumes très importantes :
la Bibliotheca hispana vetus, Rome, 1672 (rééd. de l’édition de 1788 : Madrid, 1996) et la Biblio- theca hispana nova, Rome, 1692 (rééd. de l’édition de 1788 : Madrid, 1996), qui répertorient et commentent les auteurs hispaniques d’Auguste à 1500 puis à partir de 1500.
32 Cf. son œuvre également publiée à titre posthume par Gregorio Mayàns i Siscàr (1742) comme Censura de historias fabulosas, Valence (rééd. Madrid, 1999).
264 Vitae Mahometi
queurs. Henschenius n’excluait certes pas la venue précoce en Espagne d’un prédicateur musulman, et il posait même la question: « Pourquoi (...) quelque prédicateur de la dépravation mahométane ne serait-il pas passé d’Afrique en Espagne à l’époque d’Isidore et, promptement découvert, n’aurait-il pas été poussé à prendre la décision de fuir ? ».33 Cependant, suivant en cela l’opinion d’Anto-nio, il rejetait absolument la possibilité que Mahomet fût venu jusqu’à Cordoue. Soucieux, en bon bollandiste, de produire un texte hagiographique crédible, il décida de ne pas faire figurer cet épisode dans son édition. Celui-ci resta donc inédit jusqu’à sa ré-cente publication par José Carlos Martín (2005).34 Ainsi après Henschenius, en Espagne comme hors d’Espagne, la plupart des érudits savaient à quoi s’en tenir. En 1752, dans le neuvième tome de sa fameuse España Sagrada, consacré à la Bétique et à Séville, Flórez, pourtant pas toujours irréprochable en matière de critique historique, même selon les critères de son temps, renvoyait à Mo-rales en se lamentant de voir circuler à propos des saints des « choses indignes d’eux ». Refusant de s’abaisser à les contredire, il ne mentionnait même pas l’épisode de la venue de Mahomet, clairement catalogué parmi les histoires « indignes d’être réfutées ».35
La messe était dite. En 1797, dans son édition des oeuvres com-plètes d’Isidore, Faustino Arévalo put donc logiquement écrire après avoir présenté le dossier : « il faut conclure qu’il est impos-sible de défendre d’aucune façon, par quelque raison probable que ce soit, que Mahomet soit venu en Espagne et qu’il ait été pour-chassé et mis en fuite par Isidore ».36
Dans le contexte hispanique et plus spécifiquement léonais des xiie-xiiie siècles, l’histoire de la venue de Mahomet en Espagne permit d’exalter la figure du doctor Hispaniarum en même temps
33 Quidni tamen Mahometicae pravitatis seminator aliquis, tempore Isidori ex Africa in Hispa-niam trajecerit, matureque detectus, coactus sit sibi fuga consulere ?, AASS, Apr. 1 (Anvers, 1675, 340 C-D, note e).
34 J.C. Martín, (2005, 227-228). L’auteur prépare une nouvelle édition de la Vita sancti Isidori.
35 E. Flórez (1752, t. IX, n.º 27-28, 204). Sur les méthodes de Flórez, P. Henriet (2001).36 (…) concludendum omnino est nulla probabili ratione defendi posse quod Mahometus in
Hispaniam venerit, et ab Isidoro pulsus fugatusque fuerit, texte reprís dans PL 81, col. 137 D. (Isidoriana, I, 25).
MahoMet expulsé d’espagne par IsIdore de sévIlle 265
que la centralité de la collégiale qui abritait ses reliques. Elle con-forta sa dimension « nationale », si l’on veut bien excuser cet ana-chronisme, et contribua à faire du métropolitain de Séville le suc-cesseur de saint Jacques et le rempart de l’orthodoxie chrétienne contre l’islam et son fondateur. Au Moyen Âge, ce morceau d’hagiographie connut une assez belle carrière dans les limites de la Péninsule, son autenticité ne posant alors aucun problème. Les critiques se développèrent à partir de la fin du xvie siècle chez des historiens comme Morales et Mariana, les meilleurs de leur temps. Cependant, alors qu’on eût pu s’attendre à ce qu’en face d’une historiographie critique et exclusive, l’hagiographie se montrât to-lérante envers une histoire certes abracadabrante mais en définiti-ve pas plus que beaucoup d’autres, les choses en allèrent tout au-trement. D’une part, tout un courant historiographique, celui qui produisait les « falsos cronicones » ou qui leur accordait un certain crédit, refusa d’entendre Morales et Mariana; d’autre part les bo-llandistes et même, ce qui est plus surprenant, les grands hagio-graphes compilateurs du xviie siècle hispanique, tels que Tamayo ou Ribadeneyra, rejetèrent l’épisode de la venue de Mahomet ou le traitèrent avec les plus grandes précautions. Il y a là un bel exemple du rôle que l’hagiographie put jouer dans la construction de l’érudition moderne, hors même de l’excellence bollandiste. Il resterait à comprendre pourquoi cette histoire posa alors tant de problèmes alors que d’autres, non moins extravagantes, étaient acceptées sans débat. Ce pourrait être l’objet d’une autre étude, sur les critères du vraisemblable mais aussi sur les enjeux du récit hagiographico-historique dans le catholicisme des xviie et xviiie siècles.
266 Vitae Mahometi
annexe
mahomet en esPagne textes modernes dans l’ordre chronologique
O : favorable ou plutôt favorable à la véracité de l’épisode
NSP : refuse de se prononcer mais pense que la venue de Mahomet en Espagne est possible.
N : conteste la véracité de l’épisode.
1464-1476 – Alfonso de Espina
O
Huius tempore [ = à l’époque de Sisebut] nephandus Machometh ab Hispania fugatus in Africam transfretauit (...).
[Alfonso de Espina, Fortalitium fidei, Nuremberg, 1494, livre III, 9, fol. 169v]
(...) et incepit esse dives et potens secundum ambicionem sui desiderii transiuitque dissimulatus in Hyspaniam anno ultimo regis Richardi et venit in ciuitate Cordubensi et predicauit ibidem suam malam doctrinam, dicendo quod Ihesus Christus fuit natus de virgine opere Spiritus sancti sed tamen quod non erat Deus. Quod cum audiuit beatus pater Ysidorus archiepiscopus Hispalensis qui tunc veniebat de curia romana, statim misit homines suos ad predictam ciuitatem ut eum vinculatum sibi ad-ducerent. Sed dyabolus apparuit sibi et dixit quod recederet ab illo loco et statim exiuit et fugiens nauigio transiuit in Affricam in qua et in Arabia decepit innumeras gentes, qui omnes ei adherentes Persarum regnum infestare ceperunt.
[Alfonso de Espina, Fortalitium fidei, Nuremberg, 1494, livre IV, II, 2, fol. 188]
MahoMet expulsé d’espagne par IsIdore de sévIlle 267
1474 – Werner Rolewinch
O
Isidorus Ispalensis episcopus inter doctores notabilissimus multa scripsit reliquit gravia sententiis et auctoritate. Hic vir studiosissimus ultra 70 sectas hereticorum enumerat que contra ecclesiam dei successu temporis surrexerunt et damnati sunt a sanctis patribus vicissim usque ad tempora hec […] Ipse etiam Machometum qui in Hispaniam venit capi iussit sed admonitus a diabolo fugit.
[Werner Rolewinch, Fasciculus temporum, 1480 (1ère éd. 1474), fol. 41v]
1525 – Juan de Robles
O
Traduction de certains chapitres de la Vita sancti Isidori, dont celui qui relate la venue de Mahomet en Espagne, à la suite du Liber miraculorum sancti Isidori de Lucas de Tuy.
[Juan de Robles, Libro de los miraglos de Sant Isidro arzobispo de Sevillia, Salamanque, 1525, cap. 75, fol. 121v-123v; rééd. avec com-mentaires par J. Pérez Llamazares, Milagros de San Isidoro, León, 1947, app. 2, cap. 5, p. 152-155; nouvelle édition avec introduction d’A. Vińayo González, Milagros de San Isidoro, León, 1992, cap. 9, pp. 133-135]
1548 – Bréviaire d’Évora
O
Illius adventum audiens Machometus, qui tunc spurcitiae suae semi-na per Hispaniam iaciebat, in Africam fugit, praesentiam eius expectare non ausus.
[Andrés Resende, Breviarium Eborense, Lisbonne, 1548, In natali sancti Isidori, lect. 7, col. 1105]
268 Vitae Mahometi
1574 – Ambrosio de Morales
N
Las otras cosas en aquella historia de las dos candelas que san Isidoro por gran secreto de naturaleza tenia hechas, para que ar-diendo siempre, nunca se consumiesen, y todo lo de haber querido prender a Mahoma que vino a España, y otras cosas déstas, no hay que gastar tiempo en contradecirlas, pues no pueden tener ni aun sombra ninguna de verdad (…) Dolorosa cosa es ver escritas de la santos, cosas indignas de quien ellos fueron. Mas tiene un bien este pesar, que anima á deshacer aquellas ficciones, mostrando como no tienen fundamento. Sino que hay algunas tan manifiestamente falsas, que no tienen necesidad de quien las contradiga. Y éstas son dellas.
[Coronica general de España que continuaba Ambrosio de Morales, VI, Madrid, 1791, cap. XII, 23, § 18, p. 134]
1577 – Johannes Vasaeus
O
Hoc anno Mahometem pseudoprophetam, Cordubae haereseos suae virus diffundere in Hispanos conatum produnt. Quae res quum S. Isidoro, qui id temporis Roma, quo ad concilium a summo pontifice vocatus fuerat, rediebat, innotuisset, atque ad capiendum illum misisset, ille, sive a daemone, sive ab alio quopiam admonitus, fuga sibi consulens, in Afri-cam rediit. Ex Fortalitio fidei et Breviario Eborensi.
[Johannes Vasaeus, Rerum Hispaniae memorabilium annales, Co-logne, 1577, p. 399 (anno 605)]
1592 – Juan De Mariana
N
Nam Mahometem novae superstitionis specie victoriis Asiam et Afri-cam cum lustrasset, traiecisse in Hispaniam, atque Isidori auctoritate
MahoMet expulsé d’espagne par IsIdore de sévIlle 269
metuque Corduba fugatum, pro vano repudiamus: neque cum ratione temporum conuueniens, neque externis historiis consentaneum; tametsi nonnulli ex nostris scriptoribus id affirmare non dubitarunt, pudenda homines securitate.
[Juan de Mariana, Historiae de rebus Hispaniae, I, Tolède, 1592, lib. VI, cap. 3, p. 244]
1597 - Jean-Théodore et Jean-Israël De Bry
O
Postea in Hispaniam contendebat, anno ultimo regis Richardi, ac Cordubae, quae est primaria illius regni civitas, suum impium et blasphe-mum dogma passim spargebat, videlicet Christum salvatorem nostrum, e castissima quidem virgine, per spiritum Dei natum, sed tamen ipsum minime verum esse Deum. Haec atrox blasphemia, cum ad aures archie-piscopi Hispaniae Isidori esset perlata, e vestigio populum universum concitabat, ut Mahometem in vincula coniicerent, et ad se adducerent. Verum Diabolus Mahometi apparebat, et hortabatur eum, ut sibi caveret et isthinc discederet. Continuo igitur fugam capessebat, et navem ingres-sus, in Africam traiiciebat, ubi infinitam hominum multitudinem seduxit, perinde uti idem, non ita pridem in Arabia ab incolis facile obtinuerat.
[Jean-Théodore et Jean-Israël de Bry, Acta Mechemeti I. Saraceno-rum Principis, natales, vitam, victorias, imperium et mortem ejus omi-nosa complectentia, s.l. (Francfort), 1597, pp. 11-12]
1605 – Francisco De Padilla
N
Comunmente se dize, que antes que San Isidro muriesse profe-tizo la destruición de España, y que a ella vino Mahoma en tiempo deste santo, y que de miedo del se boluio a Berueria: pero desto no hallo autor autentico, a lo menos San Ilefonso ni San Braulio sus discípulos no lo dizen, y assi lo de la profecía de la destruycion de España tengo por incierto y lo de la venida de Mahoma a ella ten-go por falso.
270 Vitae Mahometi
[Francisco de Padilla, Historia ecclesiastica de España, II, Malaga, 1605, fol. 218-218v]
Román de la Higuera (m. 1611)
O
- (1619)
Machumetus homo impius et flagitiosus, grassatur per Hispanias.
[Fragmentum chronici, sive Omnimodae Flavii Lucii Dextri... cum chronico Marci Maximi et additionibus sancti Braulionis et etiam Hele-cae, episcoporum Caesaraugustanorum... per ... Petrum a Mendoza... in lucem editum et vivificatum... labore P. Fr. Joannis Calderon, Sara-gosse, 1619, p. 98 (année 644 de l’ère hispanique, soit 606)]
- (1635)
Mahumetus qui virus erroris sui fundens per Hispaniam, Cordubae, Hispali, Toleti coepit seminare : ab Aurasio Toleti archiepiscopo toletano pulsus, catholicique doctores verbo et scripto nefarium errorem perse-quuntur.
[…]
[Luitprandi sive Eutrandi (…) Chronicon, Tamayo de Vargas éd., Mantoue, 1635, p. 10 (année 607) et p. 13 (année 615)]
- (1640)
De adventu Mahumeti in Hispaniam etiam Iulianus, Lucas Tudensis, et recentiores. Quamvis neget Morales, nam in Chronico confirmat sanc-tus Ildephonsus archiepiscopus toletanus, quem affirmat per vim expu-lisse sanctum pontificem Aurasium. Non declarat, quinam auctores verbo scriptoque nefarios errores huius pseudoprophetae refutaverint, sed cum venerit in Hispaniam, valde verisimile est Hispanos fuisse.
[Luitprandi (…) opera, éd. L. Ramírez de Prado, Anvers, 1640, p. 297]
MahoMet expulsé d’espagne par IsIdore de sévIlle 271
De adventu Mahumeti in civitatem Cordubensem, praeter hunc auc-torem Ildephonsus in chronico, et Lucas Tudensis
[Ibidem, p. 301]
1608 – Loys Turquet de Mayerne
NSP
On lit que régnant de roy Victeric, l’an 605 Mahumet vint en Espagne, prescher la doctrine à Cordouë, et qu’estant descouvert ainsi qu’on le voulait saisir, il disparut et s’enfuit si secrettement, qu’on ne sceut qu’il devint, mais nous sçavons que Mahumet proceda à la publication de sa doctrine, par moyens plus violents que celà, ayant corrompu par argent et par babil les arabes pillars, les armes desquels il employa à estendre ses erreurs parmi les autres peuples, sous l’empire d’Heraclius: toutefois il n’est pas imposible que Mahumet aagé pour lors d’environ vingt cinq ans, servant un marchand riche d’Arabie, la vesve duquel il espousa apres, se soit peu trouver en Espagne, pour les negoces de son maistre, et là ait donné quelque cognoissance du venin qu’il cuisoit en son cœur.
[en marge : « Narration de Mahumet suspecte »]
[Loys Turquet de Mayerne, Histoire générale d’Espagne comprise en XXX livres, I, Paris, 1608, livre V, cap. XVII, p. 182]
1618 – Jaime Bleda
NSP
La Coronica general de España del rey don Alonso el Sabio, Fasciculus temporum, y Fortalicium fidei, folio 219, dizen que Maho-ma, vino a España. Y Vaseo refiere, que lo mismo hallo en el Bre-viario de Eurora [sic], y que en Cordoua quiso enseñar sus errores: mas que siendo dello auisado S. Isidoro, procuro, de prendelle, y el, o porque el diablo su familiar le auiso, o algun mal hombre, se fue huyendo. Ambrosio de Morales dize, que tiene esto por cosa
272 Vitae Mahometi
tan manifiestamente falsa, que no tiene necesidad, que ninguno la contradiga. Tambien Juan Mariana lo tiene por patraña, y dize, que no conuienen los tiempos, ni quadra con las historias externas, y maltrata a estos autores, que lo afirman. En lo que toca al tiempo, en que repara este autor, no tiene razón […] No se encaminan estas razones, a querer yo provar, que es cosa cierta, que aquel enemigo de Dios estuuo en España, solo pretiendo mostrar, que no es cosa increyble, ni tan grande desuario, como pensaron Morales, y Ma-riana, antes parece verosímil.
[Jaime Bleda, Corónica de los moros de España, Valence, 1618, pp. 47-48]
1627 Rodrigo Caro
NSP
[Rappelle que l’épisode est rapporté par la Chronique d’Al-phonse X, Alfonso de Espina, Bleda; Mariana et Padilla refusent son historicité].
Nec tamen antiquis scriptoribus omnino contra ire ausim. Venisse saltim credam eius Pseudoprophetae mystas aliquos, ut animos Hispano-rum tentarent, aut saltim dolis aliquos falaciisque pellicentes, in eam vesaniam inducerent.
[Flavi Luci Dextri V.C. omnimodae historiae (…), éd. R. Caro, Sé-ville, 1627, fol. 215v]
1635 – Tamayo de Vargas
NSP
Cite Lucas de Tuy (Chronicon), la Chronique d’Alphonse X, le Fasciculus temporum de Rolewinch, Alfonso de la Espina, le bré-viaire d’Evora, Vasaeus, Bleda, Morales, Mariana et Padilla.
[…] Itaque an id factum, nunc nec plane affirmem, nec plane negem; potuisse fieri semper asseverabo.
MahoMet expulsé d’espagne par IsIdore de sévIlle 273
[Notae in Luitprandi Chronicon, dans Luitprandi sive Eutrandi (…) Chronicon, Tamayo de Vargas éd., Mantoue, 1635, pp. 28-29 (ajoute p. 36 le texte de la Chronique d’Alphonse X)]
1640 – Ramírez de Prado
NSP/O
De Mahumeti aduentu in Hispaniam, et eius conatu spargendae in-fesctisimae sectae Hispali, Cordubae et Toleti, testantur multi [ sont cités à peu près tous les auteurs à avoir abordé la question).
A propos de Rodrigo Caro : quod Maximus et alii affirmant, ipse negat; et quod ipsemet autumat, nemo est, quem ego viderim, qui scribat.
[Luitprandi (…) opera, éd. L. Ramírez de Prado, Anvers, 1640, pp. 589-590]
1652 – Juan de Tamayo y Salazar
NSP
Hinc ab illa discedimus, quousque maiora veritatis monumenta ca-piamus
[Juan de Tamayo y Salazar, Anamnesis sive commemoratio sancto-rum hispanorum (…), II, Lyon, 1652, p. 493]
1675 – Gregorio de Argaiz
O
El año de seiscientos y seis entro en España el hijo de la perdi-ción Mahoma, son autores M. Máximo, Liberato y Hauberto, quien siguieron Lucas Tudense, la Historia General y otros muchos, que alega D. Tomas Tamayo de Vargas (…).
[Gregorio de Argaiz, La soledad laureada por San Benito…, IV, Madrid, 1675, p. 36]
274 Vitae Mahometi
Vers 1675 – Nicolas Antonio
N
Henschenius écrit (cf. entrée suivante): quae falsa et ad scititia censet Nicolaus Antonius
1675 – Henschenius
N
Sequebantur nonnulla inserta de Mahometis praedicatione in Hispa-nia, et quomodo a diabolo monitus sit recedere in Africam, propter adven-tum sancti Isidori, quae falsa et ad scititia censet Nicolaus Antonius. Disputat de iis Tamajus, qui opinionem vanam et sine apice veritatis adstructam clamitat cum Morales, Padilla, Mariana et aliis. Quare nos ea ex hac Vita eliminamus, maxime quia compendium hic relatorum legi potest apud Lucam Tudensem, lib. 3 Chronici sub Sisebuto rege et aera 674; ítem apud Maximum, in Chronico ad annum 606 ; Luitprandum, ad annum 607, et similes auctores nuper excogitatos, quasi ex inde His-paniae accederet aliqua gloria. Quidni tamen Mahometicae pravitatis seminator aliquis, tempore Isidori ex Africa in Hispaniam trajecerit, matureque detectus, coactus sit sibi fuga consulere ?
[AASS, Apr. 1, p. 340 C-D, note e]
1752 – Flórez
N
(...) con razon escribio Morales, lib. 12. cap. 21 fol. 128, «no hay para que gastar tiempos en contradecirlas, pues no pueden tener ni aun sombra ninguna de verdad. Dolorosa cosa es ver escritas de los santos cosas indignas de quien ellos fueron. Mas tiene un bien este pesar, que anima á deshacer aquellas ficciones, mostrando como no tienen fundamento. Sino que hay algunas tan manifiesta-mente falsas que no tienen necesidad de quien las contradiga».
Algunas de estas cosas entresaca y expresa el mencionado Morales; yo lo omito, por cuanto me contento con poner en el apéndice VI
MahoMet expulsé d’espagne par IsIdore de sévIlle 275
la Vida del santo, escrita por el Cerratense, autor del siglo trece, pero posterior al Tudense, de quien se valió en esta parte, y tene-mos prometido ir publicando la obra de aquel autor en lo que mira á los santos de España, por no haberse dado á luz hasta hoy. Allí pues se ven las más de las cosas que aquí callamos, pues no las juzgamos dignas de refutarlas, contentándonos con haber referido las dos especies de la niñez del santo, puestas en el núm. 4 y 6, pues aunque no hallamos otro texto más antiguo, tampoco le tene-mos en contra, y por tanto las expresamos.
[Enrique Flórez, España sagrada, IX, Madrid, 1752, n.º 27-28, p. 204]
1797 Faustino Arévalo
N
(…) concludendum omnino est nulla probabili ratione defendi posse quod Mahometus in Hispaniam venerit, et ab Isidoro pulsus fugatusque fuerit.
[Faustino Arévalo et Francisco de Lorenzana, Sancti Isidori His-palensis episcopi Opera omnia, I, Rome, 1797, p. 166, et de là PL 81, col. 137 D]