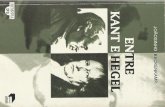Philosophie moderne : Kant 8
Transcript of Philosophie moderne : Kant 8
L'antinomie de la raison pure
La dialectique de la raison pure consiste en trois types de sophismes :Les paralogismes concernent l'idée de l'âme.Les antinomies concernent l'idée du monde.L'idéal de la raison pure concerne l'idée de Dieu.
L'antinomie de la raison pure
L'expression « antinomie » :Etymologie : de « anti » (contre) et « nomos » (loi)En philosophie, une antinomie est une contradiction dont les énoncés qui se contredisent sont également prouvés (ce qui implique normalement que les prémisses de ces preuves ne sont pas consistantes)Kant caractérise l'antinomie comme un « conflit des lois » (418)
L'antinomie de la raison pure
Tout comme les paralogismes de la psychologie rationnelle, les antinomies sont le résultat d'une application illégitime des catégories de l'entendement pur, à savoir une application qui est détachée de la sensibilité.De plus, comme dans le cas des paralogismes, les antinomies sont dues à la tendance de la raison à toujours chercher l'inconditionné dans une série de conditions.
L'antinomie de la raison pure
Par contraste au paralogismes, le raisonnement qui engendre les antinomies est un raisonnement hypothétique et non catégoriques (notez la forme catégoriques des paralogismes)
L'antinomie de la raison pure
« [C]est seulement de l'entendement que peuvent provenir des concepts purs et transcendantaux, [que] la raison n'engendre proprement aucun concept, mais [qu']en tout état de cause elle se borne à affranchir le concept de l'entendement des limites inévitables d'une expérience possible et cherche donc à l'étendre au-delà des limites de l'empirique, même si c'est pourtant en maintenant une liaison avec celui-ci. » (418)
L'antinomie de la raison pure
« Cela s'accomplit à travers la manière dont, pour une condition donnée, elle exige une absolue totalité du coté des conditions (auxquelles l'entendement soumet tous les phénomènes de l'unité synthétique) et fait ainsi de la catégorie une Idée transcendantale pour conférer une complétude absolue à la synthèse empirique en poursuivant celle-ci jusqu'à l'inconditionné (lequel n'est jamais atteint dans l'expérience, mais seulement dans l'Idée). » (418-9)
Le concept du monde
Kant définit le monde comme « la totalité des phénomènes », donc il s'agit évidemment du monde phénoménal qui se présente à nos sens sous forme spatio-temporelle et non pas du monde en soi.
L'application des catégories au monde
L'application des catégories à la totalité des phénomènes (une application transcendantale parce que nous ne pouvons jamais percevoir la totalité des phénomènes possibles) engendre quatre Idées cosmologiques :
L'application des catégories au monde
1. L'absolue complétude de la composition de la totalité donnée de tous les phénomènes
2. L'absolue complétude 3. L'absolue complétudede la division d'une totalité de la genèse d'undonnée dans le phénomène phénomène en général
4. L'absolue complétudede la dépendance de l'existencede ce qu'il y a de changement dans le phénomène
L'application des catégories au monde
La tentative d'appliquer les catégories de l'entendement à la totalité des phénomènes (dans l'intérêt de la complétude, idéal qui nous est imposé par la raison pure) engendre quatre conflits d’idées transcendantales.Chaque conflit consiste en une thèse et une antithèse qui sont toutes deux prouvables a priori.
Le premier conflit
La thèse : « Le monde a un commencement dans le temps et il est aussi, relativement à l'espace, contenu dans certaines limites » (430)
L'antithèse : « Le monde n'a ni commencement ni limites spatiales, mais il est infini aussi bien relativement à l'espace que par rapport au temps » (431)
L'argument pour la 1ère thèse
Concernant le temps :S'il n'y avait pas de commencement dans le temps une série infinie d'états se serait passée jusqu'à chaque moment. Une série infinie ne peut pas pas être produite par la synthèse [par l'intuition ?].Donc le monde doit avoir un commencement dans le temps.
L'argument pour la 1ère thèse
Concernant l'espace :Un monde infini dans l'espace exige, à chaque moment, une synthèse successive infinie [par l'intuition]Une synthèse infinie est impossible.Donc le monde ne peut pas être infini dans l'espace.
L'argument pour la 1ère antithèse
Concernant le temps :Si le monde avait un commencement dans le temps, il doit exister un temps précédent qui est vide (où il n'y avait rien).Nulle naissance n'est possible dans un temps vide.(Il existe des choses).Donc le monde ne peut pas avoir un commencement dans le temps.
L'argument pour la 1ère antithèse
Concernant l'espace :Si l'espace était infini, tout objet devrait avoir un rapport à l'espace [par exemple, une distance à la limite]Mais il n'y a pas de tel rapport dans nos intuitions.Alors le monde ne peut pas avoir une limite.
Le deuxième conflit
La thèse : « Toute substance composée, dans le monde, est constituée de parties simples, et il n'existe partout rien que le simple ou ce qui en est composé. » (436)L'antithèse : « Aucune chose composée, dans le monde, n'est constituée de parties simples, et il n'existe nulle part rien qui soit simple dans ce monde. » (437)
L'argument pour la 2ème thèse
(la thèse « atomiste »)Si les substances composées n'étaient pas constituées de parties simples, aucune substance ne nous serait donnée, ni une substance composée (parce qu'il n'y avait pas de constitution) ni de substance simple (parce qu'il n'y a pas de parties simples).
L'argument pour la 2ème antithèse
(la divisibilité infinie de la matière)Concernant la composition :La composition de toute substance n'est possible que dans l'espace. L'espace n'est pas simple, donc le simple devrait occuper un espace. Donc le simple devrait contenir une diversité d'éléments qui occupent différentes parties de cet espace, ce qui est contradictoire.
L'argument pour la 2ème antithèse
(la divisibilité infinie de la matière)Concernant la simplicité : l'existence de l'absolument simple ne peut pas être démontrée dans l'expérience
Le troisième conflit
La thèse : « La causalité qui s'exerce d'après les lois de la nature n'est pas la seule d'où puissent être dérivés les phénomènes du monde considérés dans leur totalité. Il est encore nécessaire d'admettre en vue de leur explication une causalité par liberté. » (442)
Le troisième conflit
L'antithèse (le déterminisme causal) : « Il n'y a pas de liberté, mais tout dans le monde arrive uniquement d'après les lois de la nature. » (443)
L'argument pour la 3ème thèse
S'il n'y avait pas d'autre causalité que celle qui s'exerce d'après les lois de la nature toute cause devrait être précédée par une autre cause d'après une règle, et cette autre cause aussi devrait avoir une cause précédente etc. ad infinitum. Donc aucun événement ne serait déterminé par les lois de nature. Contradiction !
Le quatrième conflit
La thèse : « Au monde appartient quelque chose qui, comme sa partie ou comme sa cause, est un être absolument nécessaire." (448)L'antithèse : « Il n'existe nulle part aucun être qui soit absolument nécessaire ni dans le monde ni hors du monde, comme en constituant la cause. »
L'argument pour la 4ème thèse
Le monde manifeste une série de changements. Tout changement doit avoir une cause, c'est-à-dire quelque chose qui détermine son existence de façon nécessaire. Donc il doit y avoir un commencement qui existe de façon nécessaire.
L'argument pour la 4ème antithèse
Si le monde ou une partie du monde était un être nécessaire, alors il y devrait y avoir dans la série des changements dans le monde un commencement sans cause qui est nécessaire, ce qui contredit la loi de la causalité. Si le monde avait une cause en dehors de lui, cette causalité devrait appartenir au temps. Donc elle ne serait pas hors du monde. Contradiction !
Question
Pour chacun des quatre conflits, est-ce que la thèse et l'antithèse :1) Peuvent être vraies les deux ?2) Peuvent être fausses les deux ?
Question
Les deux premiers conflits : Les thèses de l'infinitude / finitude du monde et de la divisibilité infinie de la matière évidemment ne peuvent être vraies toutes les deux. Mais peuvent-elles être fausses toutes les deux ?Pourquoi est-ce pertinent ?
Question
Les deux premiers conflits : Les thèses de l'infinitude / finitude du monde et de la divisibilité infinie de évidemment ne peuvent être vraies toutes les deux. Mais peuvent-elles être fausses toutes les deux ? Oui !
Question
Le monde n’est ni fini ni infini ; et il n’est ni infiniment divisible ni composé de parties simples parce qu’il n’existe pas comme une chose en soi et nous n’est pas donné comme totalitéPourquoi est-ce pertinent ?Parce que toutes les preuves des thèses ainsi que des antithèse sont apagogiques.
La preuve apagogique
La preuve apagogique d'une proposition P procède en supposant non-P et en démontrant ensuite que cette supposition implique une contradiction. Parce qu'une contradiction est toujours fausse la supposition non-P doit l’êtreaussi. Mais si non-P est fausse alors par la loi du tiers exclu P est vrai.
La preuve apagogique
Mais selon Kant, dans le cas des preuves disponibles pour les thèses et les antithèses dans le cas des deux premières antinomies la thèse et l'antithèse ne s'opposent pas de cette manière. Les deux sont fausses donc la loi du tiers exclu n'est pas applicable.
Question
Qu'en est-il du troisième et du quatrième conflit ?3) La liberté vs le déterminisme causal4) L'existence vs l'inexistence d'un être nécessaireEst-ce que la thèse et l'antithèse peuvent être vraies toutes les deux ?
Question
Qu'en est-il du troisième et du quatrième conflit ?3) La liberté vs le déterminisme causal4) L'existence vs l'inexistence d'un être nécessaireEst-ce que la thèse et l'antithèse peuvent être vraies toutes les deux ?Kant : Oui !
La liberté
Selon Kant, la loi de la causalité ne concerne que les phénomènes. La liberté n'existe pas dans les phénomènes mais elle pourrait exister dans le monde nouménal. Donc ici le conflit entre la thèse et l'antithèse n'est qu’apparent. La même solution est aussi applicable au quatrième conflit.
L'idéal de la raison pure
La dialectique de la raison pure consiste en trois types de fautes :Les paralogismes concernent l'idée de l'âme et la psychologie rationnelle (=a priori).L'antinomie concerne l'idée du monde et la cosmologie rationnelle.L'idéal de la raison pure concerne l'idée de Dieu et la théologie rationnelle.
L'idéal de complétude
L'idéal de complétude est un principe régulateur de la raison. Elle s'oriente toujours vers le savoir et les concepts complets. Le concept complet d'une chose détermine cette chose vis-à-vis de tout prédicat possible.
Les concepts complets
Pour chaque prédicat possible et pour toute chose : Ou bien le prédicat convient à cette chose ou bien il ne lui convient pas. Donc ou bien P ou bien non-P convient à la chose.Le concept complet d'une chose est l'ensemble de tous les prédicats P possibles avec une détermination de quels prédicats (P ou non-P) conviennent à la chose
Les concepts complets
Un concept complet n'est jamais pensable pour nous ; il s'agit d'une idée régulatrice. Idée régulatrice (regulative Idee) : une idée qui oriente nos recherches vers un but, mais ce but ne sera jamais atteint.
L'idée de l'ens realissimum
Selon Kant la connaissance complète d'une chose quelconque exige le concept complet de toute la réalité ou l'ens realissimum. Etant donné ce concept, le concept de toute autre chose est déterminable par des syllogismes disjonctifs :A ou BNon-AAlors B
L'idée de l'ens realissimum
« La détermination logique d'un concept par la raison repose uniquement sur un raisonnement disjonctif dans lequel la majeure contient une division logique (la division de la sphère d'un concept universel), la mineure limite cette sphère à une partie et la conclusion détermine le concept de cette partie. » (521)
L'idée de l'ens realissimum
« Donc, la majeure transcendantale de la détermination complète de toutes choses n'est rien d'autre que la représentation de l'ensemble global de toute réalité, non pas seulement un concept qui comprenne sous lui tous les prédicats selon leur contenu transcendantal, mais qui les comprenne en lui :
L'idée de l'ens realissimum
… et la détermination intégrale de chaque chose repose sur la limitation de ce tout constitué par la réalité, dans la mesure où une dimension de cette réalité est attribuée à la chose, tandis que le reste en est exclu. » (521)
L'idée de l'ens realissimum
Pour illustration, imaginons on monde simple dans lequel il n’y a que trois objects.L’objet 1 a les propriétés A et BL’objet 2 a les propriétés C et DL’objet 3 a les propriétés E et FLa prémisse disjonctive majeure :Tout objet est A et B ou C et D ou E et F.
L'idée de l'ens realissimum
La détermination complète de l’objet 3 :Tout objet est A et B ou C et D ou E et F.L’objet 3 n’est pas A et BL’objet 3 n’est pas C et DDonc l’objet 3 est E et F.
L'idée de l'ens realissimum
Or, nous pouvons étendre cette procédure à la réalité entière. Nous arrivons ainsi à l'idée d'une conception complète de la réalité ou d'un être (individuel) complètement déterminé par une prémisse majeure maximale. Cet être est l'ens realissimum. Il n'existe pas selon Kant ; la raison le postule en hypostasiant l'idée d'un concept complet (tout comme elle a hypostasié l'âme et le monde à partir d'idées transcendantales).
L'idée de l'ens realissimum
Note sur le verbe « hypostasier » (hypostasieren) :Probablement après le mot grec hupóstasis, « se placer dessous »Le verbe est apparemment un néologisme de la part de Kant qui est toujours utilisé en philosophie.Il désigne l’attribution (injustifiée) de réalité ou l’association (injustifiée) d’une substance à une idée abstraite.
L'idée de l'ens realissimum
L’essence de la dialectique transcendale :- La psychologie rationnelle hypostase le concept du
sujet pensant en formant le concept d’âme- La cosmologie rationnelle hypostase le concept de la
totalité des phénomènes en formant le concept du monde
- La théologie rationnelle hypostase l’idée de l’ensrealissimum en formant le concept de Dieu
Les postulats de la raison pratique
Parenthèse :Kant critique ici les raisons théoriques pour le postulat de l’âme immortelle et de Dieu. Dans le Canon de la CRP, il argumentera qu’il y a aussi des raisons pratiques pour ces deux postulats, à savoir des raisons liées à l’accomplissement du summum bonum. Or, le rôle de ces postulats dans la théorie éthique de Kant est difficile à comprendre (il est même possible que Kant les a abandonnés dans son éthique).
L'idée de l'ens realissimum
« Toute la diversité des choses est seulement une manière tout aussi diverse de limiter le concept de la suprême réalité, qui est leur substratum commun, de même que toutes les figures ne sont possibles que comme des manières diverses de limiter l'espace infini.» (522)Ainsi l'idée d'un être suprême ou Dieu (comme l'idée de l'âme et du monde) est le résultat d'un raisonnement dialectique selon Kant.
L'idée de l'ens realissimum
Mais quelle est la différence entre les concepts du monde et de Dieu ?Seul l’ens realissimum- Existe nécessairement- Explique l’existence de toute autre chose
L'idée de l'ens realissimum
« S'il existe quelque chose, de quoi qu'il puisse s'agir, il faut accorder aussi quelque chose qui existe nécessairement. Car le contingent n'existe que sous la condition d'autre chose qui constitue sa cause, et à partir de celle-ci le raisonnement continue de s'appliquer avec la même validité jusqu'à une cause qui n'existe plus de façon contingente et qui par conséquent existe sans condition et avec nécessité. Tel est l'argument sur lequel la raison fonde sa progression vers l'être originaire. » (525)
L'idée de l'ens realissimum
« Or, ce dont le concept contient en soi la solution de tous les pourquoi, une raison d'être qui n'est en défaut dans aucun domaine et d'aucun point de vue, qui apporte une condition suffisante en tout registre, semble constituer par là même être qui correspond à l'absolue nécessité, puisque, par la manière dont il possède en lui-même toutes les conditions pour tout le possible. » (526)
L'idée de l'ens realissimum
« Le concept d'un être doté de la suprême réalité serait donc celui qui, parmi tous les concepts de choses possibles, correspondrait le mieux au concept d'un être inconditionnellement nécessaire. » (526)
L'idée de l'ens realissimum
Donc le concept de Dieu selon Kant est le concept avec le potentiel explicatif maximal par rapport à toute réalité.
L'idée de l'ens realissimumLe concept de Dieu correspond à la tendance de la raison à toujours chercher l'inconditionné dans une série de conditions, soit l'explication la plus complète qui est disponible (une idée régulatrice). Mais est-ce qu'il y a une entité (Dieu) qui correspond à ce concept ?Kant : Non, on ne peut pas hypostasier ce concept. Mais bien que le concept n'ait pas d'objet, le concept est pourtant important comme idée régulatrice (et aussi comme fondement de la moralité)
Les preuves de l'existence de Dieu
Selon Kant il y a exactement trois voies pour prouver l'existence de Dieu :(1) Inférer l'existence d'une cause située en dehors du monde à partir de notre expérience déterminée du monde sensible : la preuve physico-théologique
Les preuves de l'existence de Dieu
Selon Kant il y a exactement trois voies pour prouver l'existence de Dieu :(2) Inférer l'existence d'une cause située en dehors du monde à partir d'une expérience indéterminée : la preuve cosmologique
Les preuves de l'existence de Dieu
Selon Kant il y a exactement trois voies pour prouver l'existence de Dieu :(3) Faire abstraction de toute expérience et inférer a priori l'existence d'une cause suprême : la preuve ontologique
L'impossibilité d'une preuve ontologique
La preuve ontologique :Prémisse : Le concept de l'ens realissimum est le concept d'un être auquel tous les prédicats réels conviennent.Prémisse : L'existence est un prédicat réel.Conclusion : alors l'ens realissimum (=Dieu) existe.
L'impossibilité d'une preuve ontologique
En critiquant cet argument, Kant prend une approche différente par rapport à la première et à la deuxième partie de la dialectique.Dans la critique des paralogismes et de l'antinomie, Kant a identifié des erreurs formelles (le sophisme figurae dictionis / une application illégitime de la preuve apagogique).Dans le cas présent, il semble tout simplement rejeter une des prémisses de l'argument.
L'impossibilité d'une preuve ontologique
Donc ici Kant ne critique pas la validité de l'argument mais la vérité d'une prémisse, à savoir celle-ci :L'existence est un prédicat réel.Mais qu'est-ce qu'il entend par un « prédicat réel » ?
Les prédicats réels
Kant contraste les prédicats réels ou déterminations avec des prédicats logiques : « Tout ce que l'on veut peut servir de prédicat logique, et même le sujet peut être prédiqué de lui-même ; car la logique fait abstraction de tout contenu. Mais la détermination est un prédicat qui s'ajoute au concept du sujet et l'accroît. »(533)
Les prédicats réels
Or, l'existence n'accroît pas le contenu d'une chose. En pensant une chose comme existante je n'ajoute rien au contenu de cette pensée. Par exemple, en pensant les licornes comme existantes je n'ajoute rien au concept de licorne, je pense juste leur présence dans le monde réel.
Les prédicats réels
Donc l'existence, bien qu'elle puisse figurer logiquement comme prédicat, n'est pas un prédicat réel. Ainsi, la preuve ontologique échoue en raison de fausseté d'une prémisse (et pas pour des raisons formelles, par contraste aux arguments dialectiques des paralogismes et de l'antinomie !)
Une objection anticipée
La caractérisation des prédicats réels donnée par Kant suggère une objection :On pourrait considérer le jugement « L'ensrealissimum existe » comme un jugement analytique. Dans ce cas, il serait absolument normal que le prédicat n'accroisse pas le concept du sujet (tout comme le prédicat d'extension n'ajoute rien au concept de corps dans le jugement « tous les corps sont étendus »).
Une objection anticipée
Kant a anticipé cette objection, car il présente l'argument suivant :« Si l'on vous accorde cela [penser l'existence comme appartenant au concept d'une chose M.W.] vous avez en apparence gagné la partie, mais en fait vous n'avez rien dit ; car vous avez commis une simple tautologie. »
L'impossibilité d'une preuve cosmologique
« S'il existe quelque chose, de quoi qu'il puisse s'agir, il faut accorder aussi que quelque chose existe nécessairement. Car le contingent n'existe que sous la condition d'autre chose qui constitue sa cause, et à partir de celle-ci le raisonnement continue de s'appliquer avec la même validité jusqu'à une cause qui n'existe plus de façon contingente et qui par conséquent existe sans condition et avec nécessité. Tel est l'argument sur lequel la raison fonde sa progression vers l'être originaire. » (525)
L'impossibilité d'une preuve cosmologique
La preuve cosmologique :Prémisse : Si quelque chose existe, alors un être absolument nécessaire doit aussi exister.Prémisse : J'existeConclusion : Alors un être absolument nécessaire doit aussi exister.
L'impossibilité d'une preuve cosmologique
Kant semble accepter cette preuve comme solide (voir le 4ème conflit dans l'antinomie), mais selon lui elle ne prouve que l'existence d'un être nécessaire et non pas de l'ensrealissimum ou Dieu. Si on veut prouver que l'être nécessaire est identique à Dieu il faut recourir à la preuve ontologique, mais celle-ci n'est pas solide.
L'impossibilité d'une preuve physico-théologique
La preuve physico-théologique :« 1. Dans le monde se découvrent partout des signes transparents d'une mise en ordre conforme à une intention déterminée, opérée avec une grande sagesse et constituant un tout aussi indescriptible dans la diversité de son contenu qu'il peut être illimité quant à la grandeur de son étendue. » (549)
L'impossibilité d'une preuve physico-théologique
« 2. Cette mise en ordre finalisée est totalement étrangère aux choses du monde, et elle ne leur est attachée que de façon contingente – autrement dit : la nature de cette diversité des choses n'aurait pas pu d'elle-même, par des moyens convergents de tant de sortes, s'accorder à des intentions finales, si ces moyens n'avaient été choisis tout exprès pour cela et disposés à cette fin par un principe organisateur doué de raison prenant pour fondement des Idées et intervenant d'après elles. »
L'impossibilité d'une preuve physico-théologique
« 3. Il existe donc une (ou plusieurs) cause sublime et sage qui doit être la cause du monde, non pas simplement par fécondité, comme une nature toute puissante agissant de manière aveugle, mais par liberté, comme une intelligence. »
L'impossibilité d'une preuve physico-théologique
La preuve physico-théologique est différente de la preuve cosmologique selon Kant en partant de la prémisse d'une expérience déterminée du monde (le monde comme manifestant de la beauté, de l'ordre, de la sagesse et de la finalité). Par contraste, la preuve cosmologique a pour prémisse un jugement empirique indéterminé (lequel ?).
L'impossibilité d'une preuve physico-théologique
L'objection de Kant contre cet argument :« L'Idée transcendantale d'un être originaire qui soit nécessaire et totalement suffisant est si démesurément grande, elle dépasse de si haut tout ce qui est empirique et se trouve toujours conditionné, que d'une part on ne peut jamais dégager de l'expérience assez de matière pour remplir un tel concept, et que d'autre part on tâtonne toujours au milieu du conditionné en ne cessant de chercher en vain l'inconditionné » (547)
L'impossibilité d'une preuve physico-théologique
Donc peut-être que cet argument prouve l'existence d'une cause intelligente mais il ne prouve pas celle de l'ens realissimum, d'un être de réalité suprême.
L'impossibilité d'une preuve de l'existence de Dieu
Le diagnostic de Kant à la fin semble être le suivant :- La preuve ontologique est formellement valide
mais non-solide (il y a une prémisse fausse).- Les preuves cosmologiques et physico-
théologiques ne sont pas formellement valides en tant que preuves de l’existence de l'ens realissmum