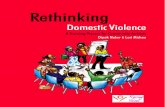Violence politique et vérité
Transcript of Violence politique et vérité
265
VIOLENCE POLITIQUE ET VÉRITÉ
Qu’est-ce que la violence politique ? Quel est son sens, sa raison d’être ? Peut-on l’expliquer ? La définir ? La distinguer d ’autres types de violence ? Les
violences criminelles ou familiales, par exemple ? Pourquoi la violence politique est-elle si souvent et si aisément poussée vers l’extrémisme, vers la terreur, les mutilations, les massacres, les « crimes abominables » ? Certes toutes les formes de violence, un vol, un kidnapping ou rançonnement sont susceptibles de ce genre de dérapages, mais dans le cas des violences politiques ces « dérapages » constituent presque la règle, sinon la norme du moins un aspect inévitable et régulier des affrontements politiques violents. Pourquoi en va-t-il ainsi ? Pourquoi la violence politique évolue-t-elle si facilement vers les génocides, le nettoyage ethnique, les massacres à grande échelle ?
Une dimension fondamentale de la violence politique est sa légitimité. Si dans un moment d’emportement, de délire, ou par pure méchanceté, un toxicomane torture le vieillard à qui il vient de dérober de quoi satisfaire ses besoins en drogue, puis lui fracasse le crane, tous considèrent qu’une telle violence est mal, qu’elle est injustifiée, illégitime, sans raison.
Mais il n’en va pas de même dans le cas de la violence politique, ici il y aura toujours quelqu’un pour trouver que les mêmes actes, ou presque, sont en un sens, d’une certaine manière, jusqu’à un certain point, justifiés, ou sinon qu’ils sont du moins compréhensibles et en partie excusables. Par « quelqu’un » je veux dire des gens autres que ceux qui ont commis les actes de violence. Les trois voyous qui assomment un sans abri à coup de
Hommages Monique.indd 265 14-01-24 14:10
266
Paul Dumouchel
barres de fer puis l’arrosent d’essence et y mettent le feu trouvent peut-être cela amusant, mais ce sont les seuls. Dès qu’il s’agit de violence politique au contraire, les auteurs de la violence ne sont jamais les seuls à approuver la violence qu’ils commettent. Il y a toujours d’autres personnes qui s’y rallient. Il y a toujours quelqu’un pour penser, dire ou arguer que cette violence est justifiée, bonne, qu’elle a un sens et que, sans nécessairement approuver, on comprend. La violence politique se distingue de la violence criminelle en ce que elle jouit toujours d’une certaine légitimité, une légitimité certes partielle et limitée, mais néanmoins réelle. Pourquoi en va-t-il ainsi ? Pourquoi la violence politique n’est-elle pas unanimement condamnée au même titre que la violence criminelle ?
La réponse habituelle consiste à dire que les individus ont des croyances politiques différentes et à chercher dans les opinions et la propagande politique les causes de ce ralliement à l’action politique violente. Je pense qu’il faut au contraire invertir cette démarche. Plutôt que de partir des croyances politiques pour comprendre l’adhésion à la violence, il faut partir de l’adhésion à certains actes de violence comme un geste politique fondamental, qui conditionne les opinions politiques plutôt qu’il n’est motivé par elles. C’est l’adhésion spontanée, l ’accord, l ’assentiment donné par certains aux actes de violences commis par d’autres qui fonde leur dimension politique.
On peut donc définir comme politique toute violence qui devient légitime du seul fait qu’elle ait eu lieu. En d’autres mots, est politique toute violence dans laquelle se reconnaissent spontanément d’autres que ceux qui l’ont perpétrée. La violence politique, par opposition à la violence criminelle s’offre comme légitime et elle est légitimée du simple fait qu’elle ait été commise. Sa légitimité ne dépend ni de qui a commis la violence, ni de qui en ont été les victimes, mais du fait qu’une fois commise d’autres
Hommages Monique.indd 266 14-01-24 14:10
267
violence politique et vérité
s’y sont reconnus. Cette reconnaissance peut se limiter à ne pas condamner la violence, elle peut aussi consister à encourager et à aider d’une façon ou d’une autre les auteurs de la violence ou aller jusqu’à s’engager dans leur rang. La violence politique est une violence contagieuse. C’est une violence exemplaire au double sens du mot. Elle constitue un modèle à imiter et elle se donne comme une « bonne » violence. Il n’y a donc pas entre la violence politique et la violence criminelle de différence essentielle ou de nature, la seule différence qu’il y a entre ces deux formes de violence tient au regard des autres, au regard de ceux qui n’ont pas commis eux-mêmes la violence et qui n’en ont pas été les victimes. Ces autres, au moment où la violence est commise constituent des « tiers » dans la mesure où ils ne sont ni ceux qui attaquent ni ceux qui sont attaqués, mais leur accord (ou leur désaccord) les range immédiatement dans un parti ou l’autre, celui de l’ordre existant ou de sa contestation.
Une violence politique est une violence qui réussi à se donner comme modèle, ce qu’elle fait en désignant des « ennemis », c’est-à-dire des autres contre qui l’usage de la violence est légitime. Du même coup elle rassemble les « amis », c’est-à-dire ceux qui se reconnaissent dans la violence perpétrée, qui la trouve justifiée, compréhensible. Au début d’un conflit politique violent ceux qui ne sont ni « amis » ni « ennemis » sont très souvent les plus nombreux, mais la dynamique de la violence va durcir cette ligne de partage. L’augmentation de la violence pousse chacun dans un camp ou l’autre et chaque camp use de la violence en son sein pour éliminer les tièdes et les « pacifistes », pour forcer la main aux indécis, et justifie par la violence des « ennemis » celle qu’il exerce contre les siens.
À première vue on pourrait penser qu’une telle « définition » de la violence politique exclue ce qui semble en être l’exemple par excellence : la violence de l’état. Ici la légitimité de la violence
Hommages Monique.indd 267 14-01-24 14:10
268
Paul Dumouchel
semble dépendre toute entière de qui a commis la violence. Dans ce cas, ce n’est pas, semble-t-il, la violence elle-même qui se légitime, mais au contraire l’autorité qui l’ordonne qui rend la violence légitime ou non. La légitimité de la violence dépend de qui en est l’auteur, par exemple des membres des forces de l’ordre ou de l’armée, plutôt que de simples particuliers dépourvus d’autorité. La légitimité de cet acte de violence dépend aussi dans ce cas des circonstances dans laquelle il a été commis. Il ne suffit pas que la violence ait été commises par des personnes autorisées, mais aussi dans des circonstances appropriées, la brutalité policière est un crime plutôt qu’une violence légitime.
Les choses cependant ne sont pas tout à fait aussi claires qu’il ne semble à première vue. En temps normal, il n’y a pas de violence de l’État. La force coercitive de l’État n’est pas conçue comme une forme de violence politique, ni même comme une forme de violence. Tant que les circonstances restent normales, si un agent de l’État agit à l’intérieur de son mandat, son acte quel qu’il soit n’est pas considéré comme une violence, et s’il en sort, sa violence est criminelle. Ni dans un cas, ni dans l’autre il n’y a ici, à proprement parler, de « violence politique » car, ainsi que l’a bien compris Carl Schmitt1, ni dans un cas ni dans l’autre il n’y a d’affrontement entre groupes, mais seulement l’opposition entre un individu isolé et l’ensemble du groupe auquel il appartient.
Pourquoi l’usage de la force coercitive par l’État ne constitue-t-il pas une forme de violence, ou du moins n’est-il pas en temps normal conçu comme tel ? C’est parce qu’il y a ici, pourrait-on dire, excès de légitimité. Plus exactement, c’est parce que la légitimité de la violence est unanime qu’elle n’apparaît plus comme violence. Cette unanimité c’est le fait que chacun se reconnaisse dans la violence de l’État, la trouve bien fondée,
1. Carl Schmitt, La notion de politique (trd. M-L. Steinhauser), Paris, Calman-Lévy, 1963.
Hommages Monique.indd 268 14-01-24 14:10
269
violence politique et vérité
la juge utile et nécessaire. Ce n’est pas seulement une question d’opinion – et les opinions à cet égard sont souvent changeantes – cette unanimité est surtout inscrite dans nos institutions. Ainsi la cour lorsqu’elle rend justice, espère et s’attend à ce que le criminel fasse preuve de remords et reconnaisse de ce fait le bien fondé de la punition qui le frappe. C’est-à-dire qu’il consente à la violence qu’il subit. Tant que cette unanimité perdure, la force coercitive de l’État n’est pas perçue comme une forme de violence et dès que l’usage de la force par l’État commence à être vu comme violence ou répression, c’est que l’unanimité de sa légitimité commence à s’effondrer.
La violence politique constitue un moyen terme entre l’unanimité et l’absence totale de légitimité. Un moyen terme révélateur qui met en évidence le mécanisme d’autolégitimation de la violence par la violence. Autolégitimation, car la violence devient légitime lorsque d’autres se reconnaissent en elle, reprennent à leur compte la violence commise par d’autres, et cela vaut tout autant pour la violence politique que pour la force coercitive de l’État. Entre l’une et l’autre du point de vue de la légitimité la seule différence est l’unanimité des suffrages que récolte la « force » étatique.
La violence politique est une violence qui se légitime elle-même, du simple fait qu’elle ait eu lieu. Cela n’est pas le cas de toute violence. La violence criminelle échoue à se légitimer, son apparition la déclare pour ce qu’elle est : meurtre, crime, violence et voie de fait. La question qui se pose est alors de savoir pourquoi dans certaines circonstances la violence réussit à se légitimer elle-même tandis que dans d’autres elle échoue ? De prime abord on peut penser que cela dépend du choix des victimes, des cibles de la violence. Une « bonne victime » pour ainsi dire est telle qu’elle sera perçue par plusieurs comme une cible acceptable de l’action violente. Un individu qui pour des raisons quelconques
Hommages Monique.indd 269 14-01-24 14:10
270
Paul Dumouchel
est l’objet de haine, de ressentiment ou de méfiance commune est une « bonne victime » en ce sens. Un tel individu est aussi une « bonne victime » au sens où étant pour ainsi dire « l’ennemi de tous » il n’y aura personne pour le défendre ou chercher à venger le mal qu’il aura subit. Cela cependant ne suffit pas. Un tel individu peut faire l’objet d’une violence collective, mais afin que cette violence devienne une violence politique encore faut-il que d’autres que ceux qui ont commis l’acte se reconnaissent en lui et trouvent la violence justifiée. Faute de quoi nous avons affaire à un crime collectif, mais pas à un acte de violence politique.
Il existe un film dont je ne me souviens pas très bien, mais dont la mémoire imparfaite que j’en ai va me permettre de mieux préciser ce qui est en jeu ici. Selon ce que je me souviens c’est un film hollandais qui s’intitule le huissier. Or ce huissier était un homme extrêmement désagréable qui terrorisait tous les habitants du village où il sévissait et qui profitait de sa fonction pour extorquer aux uns et autres divers avantages auxquels il n’avait aucun droit. Un jour le huissier sera collectivement assassiné par les ouvriers de sa propre exploitation agricole. Les autres habitants du village qui n’ont pas pris part au meurtre, face à cet événement regarderont ailleurs pour ainsi dire et feront comme si rien ne s’était produit. C’est-à-dire qu’ils prennent jusqu’à un certain point cette violence à leur compte.
Dans le film chacun pense que le huissier l’a bien cherché et que c’est bien fait pour lui. Par contre, pour les spectateurs du film ce crime collectif devient un geste politique dans la mesure où le huissier est décrit comme un représentant du capitalisme urbain qui exploite les ouvriers agricoles. Alors que dans le film le huissier est tué en raison de ses caractéristiques individuelles insupportables, pour nous son meurtre apparaît comme un épisode de la lutte des classes. D’individu exécrable qu’il est dans le film, il devient pour nous spectateurs, le représentant
Hommages Monique.indd 270 14-01-24 14:10
271
violence politique et vérité
d’une catégorie sociale. Lorsque nous interprétons ainsi le film politiquement, l’accord que nous donnons à la violence dont le huissier est la victime, bien qu’il soit de la même nature, est néanmoins différent de celui qui est implicite dans le silence des autres paysans suite à l’incident meurtrier, car ce qui est dès lors justifié ce n’est plus la violence contre une personne particulière contre, mais contre un représentant d’une catégorie et donc en un sens contre tout membre de cette catégorie quel qu’il soit.
Une « bonne victime » doit donc appartenir à une catégorie reconnue. Certes la victime, comme dans le cas du huissier, très souvent est ciblée en fonction de certaines des ses caractéristiques individuelles, mais elle ne peut être victime d’un crime politique et attirer sur elle le ressentiment commun qu’en tant que membre d’une catégorie. L’appartenance à une catégorie d’individus qui mobilise l’animosité ou la crainte peut faciliter le devenir politique d’un acte de violence, mais elle n’est ni nécessaire, ni fondamentale, car la violence elle-même peut suffire pour marquer la catégorie comme cible licite d’actes de violence, cela dépend essentiellement de la réponse que l’acte de violence élicite.
On peut reconnaître ici deux cas de figure distincts. Premièrement, l’inaction des pouvoirs en place. Si des actes criminels répétés contre les membres d ’une communauté particulière sont passés sous silence, si les plaintes des victimes se heurtent à un mur d’indifférence de la part des autorités, cette passivité et cette indifférence de la part des autorités désigne la communauté en question comme une cible licite d’actes de violence. Selon René Girard toute société recèle à tout moment une quantité importante de frustrations et de ressentiments qui sont prêt à se satisfaire de victimes de rechanges, faute de ne pouvoir s’exercer contre ceux qui en sont la cause1. En conséquence, il n’est pas besoin de raison particulière pour
1. René Girard, La Violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972.
Hommages Monique.indd 271 14-01-24 14:10
272
Paul Dumouchel
accepter comme victimes licites une catégorie particulière de personnes outre que celle-ci ait été désignée comme tel. C’est pourquoi la question de qui sont les victimes a beaucoup moins d’importance qu’on en pense généralement lorsqu’il s’agit de comprendre quel est le mécanisme en cause. Préjugés, indifférence bureaucratique ou corruption feront tout aussi bien l’affaire (et parfois marcheront de concert) pour enclencher la dynamique de la violence.
Dans ce premier cas de figure c’est le refus d’agir pour sanctionner la violence commise qui la légitime et l’encourage, qui l ’offre aux autres comme succédané de leur propre violence. Génocide, nettoyage ethnique, massacres et vexations administratives en tous genres exercées contre les membres d’un groupe « minoritaire »1 sont les formes communes que prend ce genre de violence politique. Ce sont essentiellement des violences politiques où l’État est impliqué dont il est généralement l’acteur principal.
Le second cas de figure est celui de la réponse excessive à des attentats contre les représentants du pouvoir en place, ou contre des membres de l’élite politique ou sociale. Ici aussi la portée politique de la violence originale dépend de la réaction qu’elle suscite. Très souvent c’est la réaction excessive (ferme diront ses avocats) du pouvoir qui, par une répression indiscriminée, transforme en « ennemis » de larges catégories sociales qui ne sont que vaguement liées aux auteurs de l’attentat. Cette répression vient rétroactivement légitimer à leurs yeux une violence qu’à l’origine les membres de cette communauté condamnaient. Dans
1. Le mot « minoritaire » est écrit entre guillemets car un tel groupe ne constitue pas nécessairement une minorité numérique, mais essentiellement une minorité politique. Ainsi, comme le sont par exemple les Hutus au Burundi, le groupe « minoritaire » victime de violence politique peut très bien constituer la majorité numérique.
Hommages Monique.indd 272 14-01-24 14:10
273
violence politique et vérité
de pareils cas, c’est la violence de la réaction qui crée les « autres » qui vont dorénavant reconnaître comme légitime la violence qui « répond » à celle qu’ils subissent. Les autorités pourraient-on dire sont tombées dans le piège des terroristes, il vaudrait mieux dire qu’elles sont tombées dans le piège de la violence, chaque violence justifiant, légitimant une riposte violente plus extrême. Il y a dans de tels conflits politiques une dynamique où la violence de chacun légitime celle de l’autre, où très clairement la violence se légitime elle-même, mais néanmoins échoue constamment à créer une unanimité.
L’État moderne est défini comme le détenteur du monopole de la violence légitime, ou si l’on préfère comme le détenteur du monopole de l’usage légitime de la force, et la violence politique, comme il a été dit précédemment constitue toujours soit une tentative pour briser ce monopole, soit un effort pour le refonder. Dans ce second cas c’est généralement l’État lui-même qui est l’auteur de la violence politique qu’il utilise de la même manière que les terroristes comme un moyen de redessiner la ligne de partage entre les « amis » et les « ennemis ». Cependant, être le détenteur du monopole de la violence légitime ce n’est pas seulement être l’institution qui détient la force suprême, celle qui peut faire taire la violence de quiconque d’autre, c’est aussi et surtout être une institution qui réussit à donner sa propre violence comme succédané de la violence de tous.
Les deux choses sont en fait inséparables. Il n’y a pas de régime politique stable qui repose sur la seule terreur. Il faut toujours que la majorité des individus « accepte » jusqu’à un certain point la violence de l’État afin que celle-ci devienne légitime. L’unanimité de l’accord ou si on préfère du transfert de la violence de chacun vers la violence de l’État métamorphose sa violence en force coercitive légitime. La violence politique au contraire est violence parce que sa légitimité reste toujours partielle, mais
Hommages Monique.indd 273 14-01-24 14:10
274
Paul Dumouchel
cette violence est néanmoins politique plutôt que simplement criminelle parce qu’elle jouit d’une partielle légitimité.
Les États moderne s’efforcent de faire coïncider la ligne de partage « amis » « ennemis » avec les frontières de l’État. C’est ce partage et cette coïncidence que la violence politique remet en cause. Elle fait passer entre ceux qui sont (ou qui auraient dû être) des « amis » la ligne de partage et les divise en « amis » et « ennemis ». Cela est d’autant plus facile, d’autant plus susceptible de réussir dans les situations où cette division était déjà partiellement inscrite dans les institutions, comme c’est généralement le cas dans les situations coloniales. Du même coup la violence abolit la coïncidence qu’il y avait auparavant entre les frontières de l’État et la division « amis » « ennemis ». La violence politique « réussit » pour ainsi dire, lorsque la nouvelle division « amis » « ennemis » qu’elle propose prend corps, tout particulièrement si ce nouveau partage obtient une expression spatiale, territoriale. Il n’est donc pas étonnant que la violence politique donne si souvent lieu à des mouvements de populations. La fabrique des réfugiés n’est généralement ni un simple accident, ni seulement une conséquence indirecte des combats seulement.
Un des objectifs fondamentaux de la violence est précisément de faire partir les uns, de retenir et d’encadrer les autres. C’est là l ’évolution normale des guerres civiles, des guerres coloniales, d’indépendance et de libération que de forger un nouveau territoire dont une caractéristique essentielle est une homogénéité de la population. Il faut dire « une homogénéité » et non pas « l’homogénéité » car une population homogène selon une certaine dimension – par exemple, la langue, la religion, ou l’origine ethnique – est simultanément radicalement hétérogène selon d’autres dimensions par exemple, le revenu, le niveau d’éducation ou l’accès à la propriété foncière. La violence élève
Hommages Monique.indd 274 14-01-24 14:10
275
violence politique et vérité
une de ses différences au rang de critère de l’appartenance aux « amis » ou aux « ennemis ».
Statis Kalyvas dans son étude sur la violence durant les guerres civiles s’est penché sur la question de la distribution spatiale des massacres et des violences extrêmes1. Ce qui l’intéressait était de savoir pourquoi, disons en sept ou dix ans de guerre civile, quatre ou cinq massacres ont lieu dans le même village, alors que d’autres villages qui ne représentent ni plus ni moins de valeur stratégique ou politique seront complètement épargnés. Ils traverseront l’ensemble du conflit sans jamais faire l’expérience de ce genre d’incidents. La réponse qu’il propose vient en deux moments. À l’échelle géographique de l’ensemble du territoire touché par le conflit, les massacres ont lieu dans les régions contestées, c’est-à-dire là où aucun des partis n’arrive à établir durablement sa suprématie. Mais cette réponse reste partielle, car au niveau local la question se pose de savoir pourquoi dans une localité trois massacres ont eu lieu en deux ans alors que dans la localité voisine que rien ne distingue ni par la taille, l’importance stratégique ou la facilité d’accès, il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais de massacre ou de violence extrême ?
La seule variable pertinente mise en évidence par sa recherche est la qualité des relations sociales au sein des diverses localités. Plus précisément les villages où des massacres ont lieu sont des villages divisés par des conflits entre personnes, entre familles ou groupes. À l’opposé les villages sans histoires, les villages unis où les relations sociales sont dans l’ensemble harmonieuses échappent aux massacres et aux tueries massives. L’hypothèse qu’il propose, et que semble confirmer les enquêtes de Robert
1. S. Kavylas, The Logic of Violence in Civil Wars, Cambridge University Press, 2009.
Hommages Monique.indd 275 14-01-24 14:10
276
Paul Dumouchel
Gellately et Sheila Fitzpatrick sur la délation politique, est que les agents, les acteurs individuels et sociaux utilisent, exploitent la violence politique à leur propre avantage afin de résoudre leurs conflits privés1.
Selon Gellately, les archives de la Gestapo, partout où elles ont survécut à la débâcle de la fin de la Seconde Guerre, révèlent que plus de 50% des délations politiques étaient classées comme délations « malicieuses »2. C’est-à-dire, que la Gestapo, qu’on ne peut pas soupçonner de prêter excessivement attention à l ’innocence des prévenus, considérait plus de la moitié des délations pour « crime politique » étaient sans fondement politique réel et que leur motif était en fait privé : remplacer une procédure de divorce longue et coûteuse, se débarrasser d’un compétiteur, se venger d’un rival, obtenir un appartement plus spacieux, etc. Les individus prenaient avantage de la violence politique afin de résoudre leurs conflits personnels d’une façon qui leur soit favorable. Or comme le fait remarquer Gellately, dès le début de la guerre au plus tard, personne ne pouvait ignorer qu’un interrogatoire de la Gestapo n’avait rien d’une partie de plaisir.
Par rapport au niveau d’animosité qu’en temps de paix nous jugeons normal au sein de pareils conflits ordinaires entre voisins, rivaux ou membres d’une même famille, les conséquences d’une telle entrevue pouvaient être radicalement disproportionnées. En temps normal nous n’assassinons pas nos compétiteurs, nous n’emprisonnons pas nos voisins pour nous emparer de leur appartement, nous ne faisons pas torturer par des tiers nos rivaux amoureux ou le propriétaire d’une entreprise commerciale
1. S. Fitzpatrick & Gellately R.(eds), Accusatory Practices Denunciation in Modern European History 1789-1989, Chicago University Press, 1997.
2. R. Gellately, Backing Hitler Consent and Coercion in Nazi Germany, Oxford University Press, 2001.
Hommages Monique.indd 276 14-01-24 14:10
277
violence politique et vérité
rivale. D’autres enquêtes montrent que l’exploitation privée de la violence politique est un phénomène fréquent et récurrent, qui n’a pas seulement eu lieu dans l’Allemagne Nazi, mais aussi en URSS, en Allemagne de l’Est ou même pendant la révolution Française1.
La violence politique, en raison de sa légitimité partielle, mais néanmoins réelle, se donne et se conçoit elle-même comme différente de la violence criminelle. Cependant parce qu’elle constitue un défi au monopole étatique de la violence légitime, lequel incarne la distinction reçue entre violence légitime et illégitime, entre la « bonne » et la « mauvaise » violence, la violence politique brouille inévitablement cette distinction. Elle affole la différence entre violence légitime et violence criminelle, plus elle se répand et plus la distinction s’estompe. C’est de cet effacement dont témoignent les phénomènes mis en évidence par Kavylas et Gellately.
Les acteurs individuels exploitent à leur propre avantage la violence politique, même s’ils en seront peut-être demain les prochaines victimes. Cette collusion et confusion entre intérêts privés et violence politique simultanément légitime la violence politique – les agents rendent « acceptables » les pratiques violentes dont ils font usage – et détruit la distinction entre violence légitime et violence illégitime – car en légitimant leur propre violence privée, criminelle, les agents subvertissent le mécanisme de transfert qui est au fondement de la légitimité politique, laquelle repose sur la capacité de la violence de certains à se donner comme succédané de la violence
1. Voir en particulier S. Fitzpatrick & R. Gellately (eds) Accusatory Practices Denunciation in Modern European History 1789-1989 et aussi V. Joshi, Gender and Power in the Third Reich Female Denouncers and the Gestapo 1933-45, Palgrave Macmillan, 2003.
Hommages Monique.indd 277 14-01-24 14:10
278
Paul Dumouchel
des autres1. Les vengeances privées et les conflits mesquins viennent alors alimenter la violence au nom des grandes causes. Progressivement les acteurs politiques eux-mêmes perdent la capacité de distinguer entre la violence politique, qui s’offre comme succédané de la violence de plusieurs, et leur violence personnelle. Au sein des débats internes à leur mouvement ils font de moins en moins la différence entre les conflits personnels et les désaccord politiques et dans les uns et les autres sont prêts à recourir à une violence qu’ils habillent inévitablement de l’oriflamme politique.
Cette exploitation privée de la violence politique nous conduit à la question du rapport entre la violence, le mensonge et la vérité. Les individus qui font de fausses dénonciations politiques ou affirment que telle famille avec qui ils sont en conflits depuis toujours cache des rebelles ou qu’elle informe la police au sujet des insurgés mentent dans le sens le plus ordinaire du terme. Ils ne disent pas la vérité, et dissimulent leurs objectifs et leurs motivations. Ils trompent à la fois les violents dont ils viennent embaucher les services, et leurs victimes, à l’égard desquelles ils affichent parfois la plus parfaite amitié. Ils mentent aussi aux autres habitants du village aux yeux de qui ils doivent cacher leurs actions et leurs raisons, et enfin à tous les autres, aux tierces parties, aux journalistes et observateurs en tous genres qui viendront par la suite chercher à comprendre et à éclairer ce qui s’est passé. Par opposition à la violence politique pour laquelle la publicité est essentielle puisqu’elle trouve sa légitimité à ce que d’autres, par force ou par enthousiasme, se rallient à elle, la dissimulation de l’exploitation privée de la violence politique est nécessaire de peur que la « vérité » ne viennent déchirer le voile de légitimité dont elle se couvre.
1. Paul Dumouchel, Le sacrifice inutile. Essai sur la violence politique, Paris, Flammarion, 2011.
Hommages Monique.indd 278 14-01-24 14:10
279
violence politique et vérité
Révéler la vérité de pareils incidents, c’est du même coup révéler le « mensonge » de la violence politique, ou du moins commencer à miner la confiance que nous lui portons spontanément. Il y a un mythe de la violence politique. Ce mythe c’est qu’il existe une « bonne violence » politique, par opposition à une « mauvaise violence » politique. Or cette « bonne violence » ce n’est rien d’autre que la violence que nous approuvons, que nous sommes prêts à faire nôtre. Sa légitimité repose sur le transfert de la violence de ceux qui se reconnaissent en elle. C’est pourquoi la violence n’a jamais d’autre légitimité qu’elle-même, seule la violence légitime la violence.
Nous confions à des spécialistes, militaires, rebelles, terroristes ou représentant des forces de l’ordre le soin d’exercer notre violence. En cela nous ressemblons beaucoup à ceux qui exploitent à leur propre avantage privé la violence des conflits politiques. La seule différence qui existe entre ces deux cas de figures est la distance et l’anonymat du transfert. Dans le cas de l’exploitation privé, si l’on charge d’autres d’exécuter à notre place notre propre violence, les victimes sont désignées pour des raisons personnelles et privées auxquels ceux qui sont extérieurs au conflit ne peuvent se rallier.
En conséquence, la dissimulation s’impose. Les victimes sont nécessairement des proches et le transfert de la violence ne peut rassembler que peu de personnes. Dans le cas de la violence politique les victimes sont anonymes et le transfert distant dans la mesure où les victimes sont censée appartenir à une catégorie définies à laquelle n’appartiennent pas ceux dont il s’agit de récolter le support. Le « mensonge » de la violence politique c’est l’illusion qu’il y a là une différence essentielle, comme si la distance et l’anonymat des victimes changeait quoi que ce soit à la violence, dont la légitimité ne vient finalement que de l’accord des autres qui sont prêts eux aussi à se reconnaître en
Hommages Monique.indd 279 14-01-24 14:10
280
Paul Dumouchel
elle. Reconnaissance mimétique où chacun fait de l’accord des autres la raison de son accord.
Le mensonge de la violence politique tient aussi à son caractère performatif. La violence politique cherche à déplacer la ligne de séparation entre les « amis » et les « ennemis » et dépendant en partie de la réaction qu’elle suscite elle y arrive parfois très bien. Ce « succès » transforme rétroactivement une hypothèse en une réalité. La ligne de démarcation est bel et bien déplacée. Ceux qui étaient tous « amis » se sont dorénavant séparés en « amis » et « ennemis ». La violence a rendu réelle la division censée à l’origine justifiée la violence. Le mensonge de la violence vient de sa dimension performative qui, paradoxalement, enferme progressivement les agents dans une situation qu’à la fois ils n’ont pas voulu et qu’ils ne peuvent pas ne pas vouloir! Ils ne l’ont pas voulu, car pour la plupart ils aimeraient échapper à cette violence qui est maintenant à leur porte, et ils ne peuvent pas ne pas la vouloir, car la situation qu’ils déplorent est maintenant devenue trop réelle et les efforts qu’ils font pour s’y adapter ne font que l’asseoir plus solidement. La violence prive les agents de la possibilité de choisir. Les victimes, mais aussi les autres qui sont appelés à se reconnaître dans la violence ne sont pas invités à participer au propos que la violence politique tient sur le monde. Ils y figurent uniquement sous la forme d’objets qu’il s’agit de manipuler, jamais comme personnes, c’est-à-dire comme interlocuteurs égaux.
Il y a dans cette dimension performative de la violence une parenté conceptuelle certaine avec le mensonge qui lui aussi refuse à l’autre d’être un interlocuteur égal, et au contraire le manipule, le réduit au statut d’objet. De plus de même que la violence le mensonge a une dimension performative essentielle. Lui aussi vise à transformer le monde. Soit de façon très locale, en manipulant le comportement de l’autre grâce à la fausse
Hommages Monique.indd 280 14-01-24 14:10
281
violence politique et vérité
information qu’on lui transmet. Soit de façon plus globale. En niant systématiquement l’existence d’une situation ou d’un état de fait le mensonge, en haussant les enchères, force l’autre, soit à un désaccord qui semble injustifié, soit à faire « comme si » il ne s’était rien passé et à faire en sorte que ce qui fut n’ait jamais été. Tout comme la violence le mensonge change le réel en niant l’égal statut moral de l’autre.
PAUL DUMOUCHELRitsumeikan University
Hommages Monique.indd 281 14-01-24 14:10