Histoire politique en France (with Philippe Olivera)
Transcript of Histoire politique en France (with Philippe Olivera)
398 Historiographies, Concepts et débats
privilégiée d'accéder aux représentations de soi et dumonde des hommes vivant en société, dans l'espace etdans le temps.
FLORENCE DESCAMPS
Référen c es b ibli o graphi q ue s
Cahiers de I'IHTP, < Questions à l'histoire orale n, n' 4, 1987. -DescaÀ4ps F., L'archiviste, I'historien et Ie magnétophone' De Ia
constitution de Ia source orale à son exploitation, Pais,CHEFF, 2001. - Drscatrps F,, Les sources orales, Parts, Bréal,2006. - Jourano P., Ces voix qui nous viennent du passé, Pans,Hachette, 1983. - LnltoINB H. et CALLU A., Guide du patrimoinesonore et audiovisuel français, Paris, Belin, 2005. - Scuuar-psp.D,, Histoire orale ou archh,vs orales, Pais, ARSS, 1980' -VolpnaN D. (dir.), n La bouche de vérité ? La recherche histo-rique cr les sources orales ,, Cahiers de I'IHTP n" 2l' 1992'
CorréIats.'histoire du temps présent (I);le témoin et l'histo-rien (III).
Histoire poîitique en France
Éclairer ce qu'est l'histoire politique suppose de le-ver les hypothèques liées à son adjectif, L'opérationpeut prendre au moins trois directions, selon que celui-cidésigne plutôt un point de vue idéologique, un champd'investigation ou une méthode. Toutes trois renvoientà un même fil directeur: la question de l'autonomie dupolitique. Pour la clarté de l'exposé, elles seront iciexaminées successivement bien que, comme on pourale constater chemin faisant, il ne soit pas toujours aiséde les distinguer en pratique.
(1) L'histoire peut être dite politique parce que sonauteur soumet son travail à des soubassements n idéo-logiques o (même s'il est loin de toujours les revendi-quer). On parle alors d'une histoire ( conservatrice >,( marxiste r, u de droite u ou n de gauche o... dont ilfaut immédiatement souligner qu'elle peut fort bien nepas nécessairement traiter d'objets aisément cataloguéscomme u politiques >. L'histoire politique est ici celled'un point de vue qui ne présage ni des objets qu'elleprivilégie ni des tours de main et outils qu'elle mobi-lise. En ce sens précis, on pourrait à bon droit objecterque l'adoption d'un point de r,ue politiquement informén'a pas à figurer dans la présentation d'une pratiquesavante. L'évoquer reste pourtant décisif si l'on veutcomprendre ce qui s'est joué autour de la formule n his-toire politique > et l'importance des débats, pas si éloi-
400 Historiographies. Concepts et débats
gnés, que cette catégorie a cristallisés dans l'histoirede la discipline.
(2) De façon plus commune, l'histoire politique peutêtre ainsi qualifiée simplement parce que les objetsdont elle se saisit sont jugés relever du domaine de /aou dar politique. Dans ce cas, l'histoire politique est celled'un terrain d'enquête dont la difficulté consiste dansun travail de repérage et de délimitation, sans préju-ger, là encore, de manières de faire qui lui seraientpropres. On constatera ici que, si le fait de définir cettehistoire comme celle s'intéressant aux phénomènespolitiques semble de prime abord plus naturel, le dé-coupage d'un domaine politique bien circonscrit n'a enfait rien d'évident, si tant est qu'il puisse aboutir.
(3) Enfin l'hisioire peut être politique au sens où elles'appuierait sur une épistémologie spécifique. En cesens, l'histoire politique est une méthode qui privilégieune échelle d'observation (celle du sujet ( autonomede sa volonté >) et un type particulier de compréhen-sion des phénomènes sociaux (la recherche des rai-sons données à l'action), sans s'attacher nécessaire-ment à l'analyse d'objets censément politiques.
(1) Dire de I'historiographie française du xx" sièclequ'elle est politiquement informée a tout du truisme.Chacun a ici en tête les longues controverses, dont lesbraises restent aujourd'hui encore rougeoyantes, aux-quelles le terrain révolutionnaire a donné lieu. Dès lafin du xx'siècle, l'histoire de 1789 est, dans le mêmemouvement, un espace décisif de professionnalisationdisciplinaire et un lieu de combat politique : AlphonseAulard accède en 1891 à Ia toute nouvelle chaire d'his-toire de la Révolution en Sorbonne en raison de sonengagement républicain (et pour promouvoir la supé-riorité du régime) ; mais c'est sur le terrain de la mé-thode critique qu'il attaqLle l'histoire conservatrice deTaine, prônant contre le seul recours à la mémoire et
à la littérature une histoire objective parce que fondéesur des matériaux o de premièie main > et sur le refusd'usages purement u illuitratifs n d"s u..hir"s. Ses suc-cesseurs Mathiez, Lefebvre et Soboul < gauchiront >plus encore l'histoire de 17g9 tout en fondËnt sa légiti_mité sur des critères d,objectivité voulus toujours flusscientifiques (multiplications.,de monographies de pre_mière main, constructions d,hypothèsÀ d" reche.èhe,recours à la contextualisation). La thèse de GeorgesLefebwe (débutée en 1.904, soutenue en 1924), en cequ'elle systématise l'idée que les actions a", irrai,nia,-r,doivent être expliquées par des causes proiondes dontus n ont pas la maîtrise sinon la conscience (en l,occur_rence des facteurs économiques), représente une formed'introduction ou de tradu&ion e" frirtoir" des postu_lats philosophico-politiques quant à l,existence d,un dé_terminisme historique et au rôle des forces collectivesdans l'evolution des sociétés. Ce faisant, elle inaugureun tournant historiographique décisif : I'infrastructureéconomiqrre représente désormais la clé de compréhen_sion, des-changements politiques et sociaux. principeexplicatif que les historiens hés au courant labroussièn9t^ 1"" Annales systématisent dans Ies années 1950_1960 par le recours à la mise en série et à la quantifi_cation. Toujours fortement liés à la gauche intellec_tuelle, ce sont aussi eux qui rompront,"en réinscrivantles causes _explicatives de la Révjution aunr.,r., ,"*p,Iong, avec le caractère événementiel de l,histoire d.e l7g9(l'idée que c'est dans le moment lui_même qu,on trou_vera
.ses causes) auquel autant Lefebwe que Soboulrestaient attachés. Enfin, à rebours de ce rir<rr.vementde < sinistrisme o de l'histoire revolutionnàire, Fran_Spis lurel a appelé à (re)penser l,événemenr conrrelnrstorre labroussienne en remettant à l,honneur lestravaux Iongtemps délaissés sinon décriés comme< réactionnaires o de Tocqueville ou, plus encore, del'antirépublicain Augustin Cochin.
Histoire politique en France 401
402 Historiographies. Concepts et débats
Cette trop brève évocation de l'historiographie révo-lutionnaire permet d'abord de rappeler que la politisa-tion de l'histoire est d'autant plus marquée que son ob-jet reste enjeu de mémoire ou travaillé par des usagespolitiques. En ce sens, l'histoire de la Révolution n'estévidemment pas la seule à être politisée (pour autantquil existe d'ailleurs des histoires qui ne le soient aucu-nement). Il suffit ici de penser aux travaux récents surl'histoire coloniale, sur celle du n fascisme français u oudes violences de guerre pour s'en convaincre. Dès 1954d'ailleurs, à I'occasion d'une nouvelle formule de la Re-vue d'histoire modeme et contemporaine, Charles-Hip-polyte Pouthas attaquait les volontés hégémoniquesprêtées aux Annales tout en réaffirmant l'esprit de sarer,ue, soulignant le fait qu'elle n se défie en particulierdes transpositions de conceptions actuelles dans le passé,des anticipations qui exigent des gens ce qui n'était paspensable à leur époque, : critique banale des dapgersde I'anachronisme certes, mais aussi remise en caused'une histoire jugée instrumentalisée et qui, pour cettemême raison, cherchait (les classes sociales existent-elles ?) à vérifier la présence historique de catégoriespolitiquement débattues plus que scientifiquementconstituées. Ici comme ailleurs, l'historien o politi-que > c'est toujours l'autre,
Le cas de l'historiographie révolutionnaire permet parailleurs de revenir sur l'idée, trop bien reçue aujourd'huiet un peu paresseuse, qu'il n'existe d'histoire vraiment< scientifique ) que ( dépolitisée n. En l'occurrence,c'est bien dans un domaine caractérisé par la force desenjeux politiques (la Révolution française) que la mo-bilisation d'une philosophie sociale précise (les com-portements sociaux ont des déter"rninants irréductiblesà la somme des volontés individuelles) a conduit à re-nouveler en profondeur le questionnement et les mé-thodes historiennes (bornes chronologiques excédant
Histoire politique en France 403
celles de l'événement à expliquer, constr-uction d'indi-cateurs sériels fondés sur des données socio-économi-ques, etc.), précisément contre une histoire qualifiéede o politique >. Ainsi, c'est encore dans le cadre d,uncompte rendu portant sur une série d'ouwages consa-crés à I'histoire diplomatique de l'Europe, et parce queles tenants de cette démarche persistaient à oublier n Iaconstante pression de l'économique sur le politique ,,que Lucien Febvre mobilise pour la qualifier l'expres-sion n histoire événementielle r. Fernand Braudel, dansson célèbre article sur u La longue durée , commemoyen d'accès aux strates enfouies d'explication desphénomènes historiques (paru dans Annales ESC en1958), la reprend à son compte en évoquant < chezcertains d'entre nous, historiens, une méfiance vive àl'égard d'une histoire traditionnelle, dite événemen-tielle, l'étiquette se confondant avec celle d'histoire po-litique >. Et même s'il ajoute immédiatement qu'il y alà n quelque inexactitude D, puisque < l'histoire politi-que n'est pas forcément événementielle, ni condamnéeà l'être o, l'image est fixée sous les traits du lieu com-mun, dessinant les formes d'une historiographie.jamaislibérée de son positivisme des origines : une ( histoire-récit > composée à partir de o correspondances d'am-bassadeurs ou de débats parlementaires ) et qui chro-niquerait la succession des faits les plus monumen-taux sans véritablement les expliquer.
(2) L'attaque s'est depuis diffusée jusqu'à être reven-diquée, sous la forme d'un classique retournement dustigmate, par ceux qui se sont efforcés de promouvoirl'histoire politique, comme courant sinon école, autourd'un objet posé comrne ( autonome r. René Rémond.dans lintroduction à l'ouwage éponyme qu'il dirige(Pour une histoire politique,1988), l'écrit tout à fait ex-plicitement : o É,vénementielle, subjectiviste, psychologi-sante, idéaliste, l'histoire politique assemblait ainsi tous
404 Historiographies. Concepts et d.ébats
Ies défauts du genre d,histoire dont une génération as_pirait à clore Ie règne et à précipiter la dàchéance. pre_nez trait pour trait le contre_pied de ce portrait cruelet vous aurez l'essentiel du programme que s,assigneune histoire régénérée. " Le groupe des historiens quiportent ce renouveau a su se forger une solide colonnevertébrale institutionnelle (la chaÀière paris l0 / Fonda_tion nationale des sciences politiques / Institut d,his_toire du temps présent) et édito;iale. Il est aussi àl'initiative de nouvelles re\,ues (Vingtième siècle, fond.éeen 1,984, Histoire@politique. politiquà, culture, société, re-lue électronique éditée depuis 2007 par le Centre d,his_toire de Sciences po). Surtout, il s,eit efforcé de pour_suiwe continûment le programme dessiné en affiimantde façon conjointe l'autonomie et la profondeur histo_rique des phénomènes politiques.
- Commençons par la question de l,approfondissement
chronologique, la plus facile à présËnter. Car, bienqu'elle ait-été longtemps une histoire contemporaine,voire une histoire du seul xx" siècle ou du o temps pré_sent > (et de fait sans doute parce qu,elle etaii telle),Ies promoteurs de l'histoire politique se sont récem_ment efforcés de lui donner la noblesse de la longue du_rée. Dès 1998, le manuel-manifeste qui prolonge pourune histoire politique, intitulé cette fois Lre,
"t métho-
dys de.l'histoire politique, fait appel à des spécialistesqes penodes antique ou modenre pour traiter de la.t:
"ulTf" du politique o. À sa suite, le projet éditorialdes éditions du Seuil d'une Histoire d.e îa irance potiti-que franchit encore une étape : à l,instar de ses cousi_nes rurale, urbaine ou religieuse, il existerait désormaisunc < France politique " (également publiée dans lacollection n L'Univers historique r, .".i expliquant enpartie cela) dont l'histoire est aussi longue que possi-ble puisqu'elle se décline, là encore sur"le modèle deses cousines, en quatre volumes chronologiques du
Histoire politique en France 405
Moyen Âge (481-1514) à l'époque la plus contempo-raine (1914 < à nos jours o), en passant par n la monar-chie n (1515-1792) et la o naissance de la démocratie >(1789-1914). L'opération n'a rien d'évident, ce que ledirecteur du premier volume reconnaît et assumé plei-nement dans son prologue: à la question soulevée enouverture, < Une "Histoire de la France politique,, auMoyen Âge est-elle un pari tenable si ltn velt voirdans cette formulation plus que Ia préhistoire, la ge-nèse souterraine d'un objet, d'un champ de recherchequi trouve tous ses développements, toute sa légitimitéaux époques moderne et plus encore contempo_raine ? u, il répond fermement que o si l'histoire politi-que est celle de l'État et des luttes menées pour le diri-ger, prétendre écrire une histoire de la France politiquependant le millénaire médiéval est une utopie. Mais sil'histoire politique est celle du pouvoir, et que de l,his-toire du pouvoir on glisse à celle de la puissance, elleprend tout son sens o. Cela posé, le placement des qua_tre ouvrages sous une bannière commune, celle de la< France politique >, impose une idée de continuité elle-même productrice de contradictions très fortes pourune histoire politique contemporaine dont le héros,forcément < national ), reste un citoyen icléalementmû par sa u République intérieure o (Claude Nicolet) :
un tel < personnage >, même non républicain, n,existepas sous lAncien Régime (pour autant qu'on puisse lecroiser fréquemment aujourd'hui) ; or l'histoire politi-que semble ne pas pouvoir s'en passer parce que les ex-plications qu'elle propose dépendent, cômme on va levoir, de la pleine autonomie de n sss ) sujets.
Dans sa volonté d'affirmation d'un champ de recher-che, l'histoire politique s'est d'abord con-centrée surl'étude d'objets qui relèvent directement et principale-ment du domaine : histoire de la vie politique (des par-tis, des gauches et des droites, des transactions et déli-
406 Historiographies. Concepts et débats
bérations au sein du monde politique, des leaders et dupersonnel de ce même monde _ n,hésitant pas, parfois,à mettre en ceuvre des analyses proropog.àphiques oustatistiques), histoire de l,État (administrationf pohti_ques publiques), histoire de l,opinion (élections, son_dages, médias), histoires des relations internationaleset des conflits. L'idée consiste à refuser d,expliquer lepolitique par autre chose que lui-même (le iocial,l'économique) : désormais, il èst point de congruence ;mieux, il impulse et réglemente les autres champs so-ciaux..D'où, depuis, une tendance nette à I'expansionvers d'autres domaines (tous ?) que le politique irriguesinon dirige sous la forme de représentâtions du mondeou de cultures dont les engagements individuels oucollectifs (voir l'importance conférée à la notion de sé_nération) sont nécessairement porteurs. Le remplale_ment de l'adjectif ( politique > pâr < culturel , danscertains ouvrages manifestes ou articles programmati_ques, ou l'ajout de racines cuhurelles a l,oblei politique(y compris chez certains des contributeurs d,e pàurune histoire politique), apparaît symptomatique de cetélargissement (notamment sensible avec li publica_tion, en 1992, del'Histoire des droites en France diriséepar Jean-François Sirinelli). L,histoire politique est àe-sormais celle d'un domaine qui possède son propremoteur explicatif, présent dans les têtes: la culture.On perçoit ici combien le repérage des frontières dupolitique n'a rien d'évident, et qu,il n,est pas certainque l'existence d'un domaine politique puisse aisémentconstituer le plus petit dénominateur commun des tra-vaux d'histoire politique.
(3) Sans doute ce mouvement culturaliste ou n iden_titaire > doit-il beaucoup aux convergences initiéesavec les travaux des historiens, principalement dix-neuviémistes, qui ont impulsé, dès les années 1960 eten lien avec Ia re\\e Le Mouvement social, une histoire
Histoire politique en France 407
sociale des sociabilités et politisations populaires, ouplutôt une histoire des politisations à travers des for-mes particulières de sociabilité et d'action (réunions,assemblées, associations, fêtes et s5.nnboles, grèves, syrrdi-calisation, luttes et mouvements sociaux, violences etrévoltes). À ce courant désormais ancien se sont égale-ment ajoutées d'autres manières de traiter des modali-tés de la politisation des populations et de l'État au fild'un long xx" siècle. On pense ici à l'histoire intellec-tueile ou conceptuelle du politique que met en æuvre,à la suite de F. Furet, le travaii de Pien'e Rosanvallon(il se propose de décrire, à parlir d'une analyse essen-tiellement discursive, l'émergence et les transforma-tions des figures de la démocratie représentative). Ouencore à la socio-histoire (ou sociologie historique) dupolitique qui tente de saisir les caractéristiques desprocessus d'étatisation des sociétés modernes à partirdu moment où le cadre national s'y impose en prati-que. Or on peut remarquer que, même sur le terrainbien identifié des formes de la politisation depuis laRévolution, les convergences restent faibles ou récen-tes : présentes dans le troisième volume del'Histoire dela France politique, les références aux travaux socio-historiques ou à l'ceuwe de P. Rosanvallon n'apparais-saient pas ou peu dans Ates et méthodes de l'histoirepolitique.
Le fait que les travaux de sociologie historique dYvesDéloye et Olivier Ihl ou ceux de P. Rosanvallon soientrelativement peu mobilisés par l'histoire politique laplus implantée tient évidemment en partie à des luttesinternes au champ scientifique, mais leur discrétionne saurait s'y résumer, Plus fondamentalement, ellerenvoie à l'existence de différences effectives dans lerapport de chaque programme à l'activité de rechercheet à l'écriture scientifique. À l'évidence, les n nouveauxentrants ) mettent en æuvre, dans leurs analvses du
408 Historiographies. Concepts et débats
matériau historique, un rapport plus intime et plussoutenu à Ia conceptualisation, en lien avec la philo-sophie ou l'histoire des idées pour l'histoire n intellec-tuelle > du politique, avec la sociologie et la sciencepolitique pour la < sociologie historique,. Ces diver-gences s'incarnent également, on l'a vu, dans un rap-port différent à la chronologie. Dans l'ensemble, les te-nants de l'approche socio-historique comme ceux quipeuvent se réclamer de u l'histoire conceptuelle du po-litique > s'en tiennent fermement à un programme vi-sant l'analyse des transfor-rnations des rapporls depouvoir induites par le cadre national et la citoyen-neté. En cela leurs histoires restent strictemenr conrem-poraines, quitte à mordre sur les terres modernistespour traiter la < question des origines > : les travaux desociologie historique sur l'étatisation, les sciences ca-mérales, les identifications de papier ou l'histoire dusuffrage présupposent ainsi logiquement l'existence del'État-nation comme cadre de pensée ; de même, l'ana-lyse des conditions d'émergence et de réalisation duprincipe d'autonomie de la volonté citoyenne cher àP. Rosanvallon présuppose au moins que le processusd'individualisation des sociétés, sinon l'idée de citoyen-neté, soient parfaitement constitués. En revanche, l'en-régimentement récent de lAncien Régime dans unprogramme d'histoire politique initié par des histo-riens du contemporain manifeste une volonté englo-bante plus marquée. Pourtant, en ce qu'elle supposed'adapter des analyses souvent liées au cadre de l'É,tat-nation et à une pensée moderne du sujet à des pério-des où ni l'un ni l'autre n'existaient encore sous leurforme actuelle, cet élargissement n'a rien d'évidentcomme en témoigne, récemment encore, le volume queB. M. Bedos-Rezak et D. Iogna-Prat ont consacré à laquestion de L'individu au Moyen Àge. Individuation etindividualisation avant la modemité (Aubier, 2005).
Histoire politique en France 409
Est-ce à dire qu'il n'est point de dénominateur com-mun enfie ces manières de faire de l'histoire politique ?
Par-delà les différences qui viennent d'être mention-nées (et dont la liste pourrait sans doute être élargie),on peut tenter de répondre par la négative en souli-gnant qu'elles possèdent, de façon certes plus ou moinsmarquée, un point de convergence ou d'accord décisifqui tient précisément à la place qu'elles reconnaissentaux choix, motifs et autres délibérations intimes dans
l'explication des engagements individuels. Ainsi, au-
delà du caractère spécifique, on I'a vu, de la prétentionà faire une ( histoire politique n des périodes antérieu-res à la Révolution, la justification qu'en donne Jean-
François Sirinelli, par exemple, rejoint la philosophiesociale de l'histoire politique contemporaine lorsqu'ilévoque la nécessité de privilégier un ( sujet pensant etagissant > comme acteur principal de toute histoire poli-tique. Postulat qui, sans évidemment être propre à ladiscipline, est d'autant plus délicat à manier sur ce ter-rain des idéaux qu'il favorise ou facilite un glissement
fréquent de la description d'un principe normatif général
reconstitué par juxtaposition de textes (admettons levolontarisme civique décrit par les penseurs républi-cains) à son existence, supposée nécessaire au bon fonc-tionnement du régime, dans les têtes des citoyens pourlesquels ses différents promoteurs I'ont couché sur lepapier ou exposé dans leurs discours. Parce que l'his-torien du politique se donne pour pe$onnages des su-jets ( autonomes de leur volonté >, les systèmes de re-présentation (les cultures politiques) qu'il reconstitueen tissant entre eux des extraits des libelles, placards,
ouvrages et autres rapports retrouvés dans les archivespeuvent aisément être glissés, sous formes de n bonnesraisons o, dans les esprits des individus-citoyens qu'ilcroise parfois en chemin. S'il est de ceux qui s'intéres-sent un peu aux pratiquants ordinaires, son travail
410 Historiographies. Concepts et débat s
consiste alors, plus que dans d'autres domaines puisquela politique est (aujourd'hui ?) affaire de choix et d'en-gagements en conscience, à faire le chemin inverse ensondant les âmes de quelques témoins, volontaires ounon, pour y retrouver les traces de ces représentationsagissantes, L'ambivalence de la notion de n modèle ré-publicain > développée autour de Serge Berstein etOdile Rudelle est une bonne illustration du processusdès lors qu'elle oscille entre la volonté de reconstitutiond'un < texte général D propre à un moment historique etla mise en avant d'une norme politique dont on ne saitjamais si la diffusion partagée est d'une part nécessaireà sa légitirnité, d'autre part seulement postulée ou enpartie attestée empiriquement. Dans le même sens,nombre de travaux sur la politisation des campagnes(cf. les débats régulièrement relancés depuis la parutionde Peasants into Frenchmen d'Eugen Weber en 1983) nese défont que difficilement de l'idée que l'aboutissementnécessaire de l'histoire reste une citoyenneté semblableà celle que ses théoriciens ont dessinée et que l'appren-tissage des pratiques électorales consiste pour l'essentieldans la mise en place d'un modèle délibératif aussiidéal que peu vérifié empiriquement.
Sous l'espèce de ce paradigme du ( citoyen éclairé etcompétent >, norme démocratique qui est à la fois unmodèle jamais atteint mais toujours espéré et un objetd'analyse agissant comme moteur effectif des compor-tements observés, l'histoire politique, dans ses diffé-rentes composantes, existe pleinement et foftement,On pourrait ici aisément objecter que cette conclusionne vaut guère pour ce qui concerne en particulier l'his-toire politique des dictatures, qui privilégie l'étude des< institutions n à celle des n acteurs >. Il n'est pourtantpas sûr qu'il y ait là contradiction: car si l'on croisepeu ou moins de sujets pensants dans ces travaux, celatient sans doute en partie au poids de l'enrégimente-
Histoire politique en France 4tl
ment supposé des esprits dans ces régimes. En ce sens,
le contre-argument vient encore rappeler la prégnancede l'horizon pluraliste (présent ou à venir) dans les tra-vaux d'histoire politique portant tant sur des régimeslibéraux ou en voie de l'être que, sous la forme d'unmanque, sur des régimes autoritaires.
NICOLAS MARIOT, PHILIPPE OLIVERA
Référenc e s b iblio graphiq ues
BERSTEIN S., Mtrza P. (dir.), Axes et méthodes de I'histoirepolitique, Paris, PUF, o Politique d'aujourd'hui D, 1998. - BBns-rsrNS., WrNocr M.et CoNrar'tINr Ph. (dir.), Histoire.de IaFrance politique, Pais, Seuil. Vol. l, 2002, I* Moyen Age. kroi, l'Éflise, Ies grands, Ie peuple, 481-1514 (par Philippe Con-tamine Olivier Guyotjeannin et Régine Le Jan). Vol. 2,2000'I-a monarchie entre Renaissance et Révolution, 1515-1792 (parLaurent Bourquin, Joël Cornette, Hervé Drévillon, PhilippeHamon et Pierre Serna). Vol. 3, 2003, L'invention de la démo-cratie, 1789-1914 (par Serge Berstein, Raymond Huard, Jean-Clément Martin, ^Nicolal Roussellier ét Michel Winock),Vol.4,2004, La République recommencée, de 1914 à nos iours(par S. Berstein, Olivier Wieviorka, M. Winock). - DÉlovB Y',Sociologie historique du politique, Paris, La Découverte, < Re-pères,, 2007. - NornIBr G., Introduction à Ia socio-histoire,Paris, La Découverte, < Repères r, 2006. - RÉltoNo R. (dir.),Pour une histoire politique, Paris, Seuil, 1988' - RoseNver--rou P., Ze sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel enFrance, Paris Gallimard, 1992. - RosaNveuoNP', k peuple
introuvable. Histoire de la représentation démocratique enFrance, Paris, Gallimard, 1998. - RosaNvatrovP., I'a démo'cratie inachevée. Histoire de Ia souveraineté du peuple enFrance, Paris, Gallimard, 2000. - SrzuNertt J.-F. (dir.), Histoiredes droites en France, Paris, Gallimard, 1992, 3 vol. (vol. I :
u Politique ",vol,2: n Cultures r, vol.3: u Sensibilités u).
CoréIats.' fascisme français (III) ; histoire-bataille (I) ; lepolitique en Grèce ancienne (III); Révolution française: his-toriographie au xIX" siècle (III).








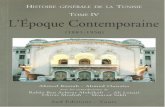







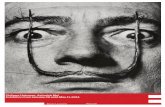



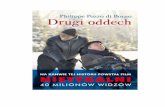


![« L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63206f14067e4ea67a0f4d34/-lere-auguste-ebauche-dune-histoire-politique-de-la-thessalie-sous-auguste.jpg)




