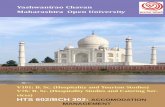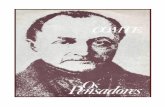La démocratie difficile à l'ère des masses. Lettres d'Hubert Lagardelle à Robert Michels (1903-1936)
« L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132...
-
Upload
universite-lyon2 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132...
BCH132
2008
1 Études
ÉC O L E FR A N Ç A I S ED 'AT H È N E S
B U L L E T I N D E C O R R E S P O N D A N C E H E L L É N I Q U E
BCH1 3 22008
B U L L E T I ND E C O R R E S P O N D A N C E
H E L L É N I Q U E
É C O L E F R A N Ç A I S E D ’ A T H È N E S
BCH1 3 22008
B U L L E T I ND E C O R R E S P O N D A N C E
H E L L É N I Q U E
1 Études
É C O L E F R A N Ç A I S E D ’ A T H È N E S
É C O L E F R A N Ç A I S E D ’ A T H È N E S
Comité de rédaction : Dominique MULLIEZ, directeur Catherine AUBERT, adjointe aux publications
COMITÉ DE LECTURE
Le comité de lecture de l’École française d’Athènes est composé de trois membres de droit et de sept membres désignés par le conseil scientifique sur proposition du directeur. Sa composition actuelle est la suivante (conseil scientifique de l’École française d’Athènes du 27 novembre 2007) :
Membresde droit
- le directeur de l’École française d’Athènes : Dominique MULLIEZ
- le directeur des études : Arthur MULLER - le responsable des études sur la Grèce et les Balkans aux époques moderne et contemporaine :
Maria COUROUCLI
Membresdésignés
Sont membres désignés des personnalités scientifiques françaises ou étrangères (mais francophones), reconnues et de dimension internationale. Le choix en est fait de manière à assurer la meilleure représentation possible des champs disciplinaires concernés. Leur mandat coïncide avec la durée d’un contrat quadriennal.
- Olivier DESLONDES, Professeur des Universités, université Lyon 2-Lumière- Emanuele GRECO, Directeur de l’École italienne d’Athènes- Jean GUILAINE, Professeur au Collège de France- Miltiade B. HATZOPOULOS, Directeur de recherche, Directeur du Centre de recherche sur
l’Antiquité gréco-romaine (Fondation nationale de la recherche [EIE] - Athènes)- Catherine MORGAN, Directrice de l’École britannique d’Athènes- Jean-Pierre SODINI, Professeur émérite de l’université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne- Georges TOLIAS, Directeur de recherche en histoire contemporaine, Institut de recherche néo-
hellénique (Fondation nationale de la recherche [EIE] - Athènes)Le comité de lecture fait appel en tant que de besoin à des experts extérieurs.
Révision des textes : EFA, Béatrice DetournayTraductions en grec : Pavlos KarvonisTraductions en anglais : Michael WeddeRéalisation en PAO : EFA, Guillaume FuchsImpression et reliure : n.v. PEETERS s.a.
© École française d’Athènes, 20106, rue Didotou GR - 10680 Athènes www.efa.gr
Dépositaire : De Boccard Édition-Diffusion 11, rue de Médicis F - 75006 Paris www. deboccard.com
ISBN 978-2-86958-227-9 ISSN 0007-4217Reproduction et traduction, même partielles, interdites sans l’autorisation de l’éditeur pour tous pays, y compris les États-Unis.
B U L L E T I ND E C O R R E S P O N D A N C E
H E L L É N I Q U E
132.1 2008
AVIS AUX LECTEURS
Partageant une longue tradition, l’École française d’Athènes et la British School at Athens diffusent auprès de la communauté scientifique le résultat de l’activité archéologique conduite en Grèce et dans certaines régions du monde hellénique. Depuis 1920, l’École française d’Athènes consacre une partie du Bulletin de Correspondance hellénique à la chronique des travaux archéologiques réalisés en Grèce, à Chypre et, selon un rythme bisannuel, dans le Bosphore Cimmérien. De son côté, la British School at Athens compile un bilan annuel similaire, Archaeology in Greece, publié en association avec la Society for the Promotion of Hellenic Studies comme partie constitutive des Archaeological Reports depuis 1955.Chacune des deux institutions avait un double défi à relever : faire face à une documentation croissante, d’une part ; utiliser des outils plus performants pour mieux faire circuler l’information scientifique et en permettre une meilleure utilisation, d’autre part. - L’École britannique a accepté sans hésitation le projet d’un programme commun que lui a proposé l’École française d’Athènes et les deux institutions ont décidé d’unir leurs efforts, pour proposer depuis la fin de l’année 2009 une Chronique des fouilles en ligne consultable sur http://chronique.efa.gr.Outre les articles relatifs à des opérations de terrain ou relevant de l’archéométrie, le second fascicule du BCH ne comprendra donc plus désormais que les « Rapports sur les travaux de l’École française d’Athènes » proposés par les responsables de missions ou de programmes.
AVIS AUX AUTEURS
Depuis la parution du BCH 130 (2006), les tirages à part sont fournis aux auteurs sous format électronique et sont uniquement destinés à une utilisation privée. L’École française d’Athènes conserve le copyright sur les articles, qui ne peuvent donc être mis en accès libre sur quelque base de données ou par quelque portail que ce soit. - L’ensemble de la livraison sera disponible sur le portail Persée trois ans après sa parution (www.persee.fr).
SOMMAIRE DE LA LIVRAISON
Topographie et architecture
Emmanuelle BENCHIMOL, Brigitte SAGNIER
Un trésor archaïque du sanctuaire d’Apollon à Délos (Trésor 5) : étude architecturale ................................................................................................................................................................................................................................................... 1-113
Jean-Charles MORETTI, Myriam FINCKER
Un autel de Dionysos à Délos ..............................................................................................................................................................................................................115-152
Pavlos KARVONIS
Les installations commerciales dans la ville de Délos à l’époque hellénistique .....................................153-219
Jean-François BOMMELAER
Delphica 1, À nouveau les comptes de Delphes et la reconstitution du temple d’Apollon au IVe siècle av. J.-C. .................................................................................................................................................................221-255
Amélie PERRIER
La moisson et les pigeons. Note sur l’assise sommitale du pilier de Prusias à Delphes ...............................................................................................................................................................................................................................................257-270
Épigraphie
Mathilde DOUTHE, Nicolas KYRIAKIDIS
Les archontes du nom de Kléophanès à Delphes : note de chronologie et d’épigraphie .............................................................................................................................................................................................271-282
Manel GARCÍA SÁNCHEZ
Les femmes et les amphores : épigraphie amphorique rhodienne et histoire de la femme dans le monde hellénistique ......................................................................................................................................................................283-310
Pierre AUPERT, Pavlos FLOURENTZOS
Un exceptionnel document à base cadastrale de l’Amathonte hellénistique.(Inscriptions d’Amathonte VII) .........................................................................................................................................................................................................311-346
Pierre AUPERT
Hélios, Adonis et magie : les trésors d’une citerne d’Amathonte.(Inscriptions d’Amathonte VIII) ......................................................................................................................................................................................................347-387
Patrice HAMON
Études d’épigraphie thasienne (I). Décret pour un historien thasien(fin du IIe s. ou début du Ier s. av. J.-C.) .........................................................................................................................................................................389-401
Nikolaos PETROCHEILOS
Graffiti du Gymnase d’Andros .........................................................................................................................................................................................................403-426
Richard BOUCHON
L’ère auguste : ébauche d’une histoire politique de la Thessalie sous Auguste ........................................427-471
Simone FOLLET, Dina PEPPAS DELMOUSOU
Inscriptions du Musée épigraphique d’Athènes ...................................................................................................................................................473-553
Céramique
Sabine FOURRIER
Le dépôt archaïque du rempart Nord d’Amathonte. VI. Vases du « style d’Amathonte ».............................................................................................................................................................................................555-585
Anastasia YANGAKI
Céramique glaçurée provenant de Nauplie et d’Argos (XIIe-XIIIe siècles) : observations préliminaires ............................................................................................................................................................................................................................587-616
Paléopathologie
Philippe CHARLIER, Christian LE ROY
Les suppliciées de Fourni. Réexamen médico-légal et paléopathologie ..................................................................617-637
L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessa l ie sous Auguste
Richard BOUCHON*
BCH 132 (2008)
* Université de Lyon - Lyon 2, HiSoMA
RÉSUMÉ L'« ère auguste » qui a été en usage en Thessalie n'est en aucune manière une « ère d'Actium » commémorant la victoire d'Octave sur Antoine, comme c'est le cas en Achaïe ou en Macédoine. L' thessalien a été adopté en 10/1 apr. J.-C., pour une raison qui reste inconnue, et a servi pendant plus d'un demi-siècle. Cette nouvelle chronologie permet de mieux rendre compte de la complexité des relations qu'a entretenues la Thessalie avec le pouvoir impérial : pendant tout le règne d'Auguste des périodes de bonne entente, qui se traduisaient par l'octroi de privilèges aux Thessaliens (stratégie fédérale assumée par Auguste, droit de battre monnaie) qui, en retour, rendaient grâce au pouvoir sous diverses formes (culte impérial, utilisation d'une épithète) formée sur le nom de l'empereur, ont alterné avec des moments plus sombres, aux conséquences dramatiques (émeutes, procès devant l'empereur ou privation de liberté), sans que l'enchaînement des causes et des effets soit toujours assuré. C'est donc une ébauche d'histoire politique qu'on propose.
ΠEPIΛHΨH Η εποχή του Αυγούστου: προσχέδιο πολιτικής ιστορίας της Θεσσαλίας την εποχή του Αυγούστου Η « εποχή του Αυγούστου » στη Θεσσαλία δεν είναι σε καμιά περίπτωση μια « εποχή του Ακτίου »
που μνημόνευε τη νίκη του Οκταβίου επί του Αντωνίου, όπως συμβαίνει στην Αχαΐα ή στη Μακεδονία. Το θεσσαλικό ’έτος σεβαστόν υιοθετήθηκε το 10/1 π.Χ., για λόγο που παραμένει άγνωστος, και χρησίμευσε για περισσότερο από μισό αιώνα. Η νέα αυτή χρονολόγηση επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα την πολυπλοκότητα των σχέσεων που διατηρούσε η Θεσσαλία με την αυτοκρατορική εξουσία: κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αυγούστου, τις περιόδους καλών σχέσεων, που μεταφράζονταν στην παραχώρηση προνομίων στους Θεσσαλούς (ανάληψη της στρατηγίας της ομοσπονδίας από τον Αύγουστο, δικαίωμα έκδοσης νομισμάτων), οι οποίοι, σε αντάλλαγμα, εξέφραζαν τις ευχαριστίες τους στην εξουσία με διάφορους τρόπους (αυτοκρατορική λατρεία, χρήση επιθέτου σχηματιζόμενου με το όνομα του αυτοκράτορα), διαδέχονταν πιο σκοτεινές στιγμές, με δραματικές συνέπειες (εξεγέρσεις, δίκες ενώπιον του αυτοκράτορα και στέρηση ελευθερίας), χωρίς η αλληλοδιαδοχή των αιτίων και των αποτελεσμάτων να είναι πάντοτε βέβαιη. Προτείνουμε λοιπόν ένα προσχέδιο πολιτικής ιστορίας.
SUMMARY The Augustan Era: Fragments of Politics and Social History in Augustan Thessaly The “Augustan era” used by Thessalians was by no means an Aktian era, as one would expect from
that very same name as the Macedonian . The Thessalian Confederacy adopted it in 10/1 AD, for a reason still unknown to modern scholars, and had been using it for more than half a century. This new chronology shows how complex were the relations between Thessaly and Roman Imperial power during the whole reign of Augustus; they sometimes happened to be good, leading to grant of privileges, such as the eponymous strategia held by the Emperor, or the right to struck a bronze coinage, to which Thessalians responded willingly by honouring the Emperor through the very first form of imperial cult or by bearing an epithet strucked on his name; but it didn't prevent Thessaly from hard times and dissensies, from local riots to imperial justice and punishment.
428 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)BCH 132 (2008)
Cet article présente une version développée, et légèrement différente quant à ses conclusions, d'un extrait de ma thèse (BOUCHON, Élites, p. 192-198), dont j'avais succinctement exposé la matière à l'occasion du 1er colloque international d'Histoire de la Thessalie, organisé à Larissa en novembre 2006 : « L'empereur Auguste, Tibère et les Thessaliens : intégration de la Thessalie dans l'imperium Romanum », dans 1o
, p. 184-193. Pour leur aide et leurs conseils dans l'élaboration de ce travail, je tiens à remercier chaleureusement L. Darmezin, St. Maillot et B. Helly.
Abréviations bibliographiques :
BOUCHON, Élites = R. BOUCHON, Les élites politiques de la cité de Delphes et du koinon thessalien : institutions, chronologie et pratiques familiales. Ier s. av. J.-C. - IIIe siècle apr. J.-C. Contribution à l'histoire politique et sociale de la Grèce centrale sous administration romaine, thèse, Université de Lyon (2005).
BOWERSOCK, « Römischen Thessaliens » = G. W. BOWERSOCK, « Zur Geschichte des römischen Thessaliens », RhM 108 (1965), p. 277-289.
BURRER, Münzprägung = F. BURRER, Münzprägung und Geschichte des thessalischen Bundes in der römischen Kaiserzeit bis auf Hadrian : 31 v. Chr-138 n. Chr (1993).
HELLY, BCH 1975 = B. HELLY, « Actes d'affranchissement thessaliens », BCH 99, p. 119-144.HELLY, « Diorthôma » = B. HELLY, « Le diorthôma d'Auguste fixant la conversion des statères thessaliens en
deniers : une situation de “passage à la monnaie unique” », dans D. MULLIEZ (dir.), De la drachme au denier, actes du Colloque, Lille 6-7 décembre 1996, Topoi 7 (1997), p. 63-91.
HELLY, Gonnoi = B. HELLY, Gonnoi, I. La cité et son territoire ; II, Les inscriptions (1973).HELLY, « Italiens » = B. HELLY, « Les Italiens en Thessalie aux IIe et Ier siècles », dans M. CÉBEILLAC-GERVASONI
(éd.), Les Bourgeoisies municipales italiennes aux IIe et Ier siècles av. J.-C. (1981), p. 355-380.I. Atrax =Ath. TZIAFALIAS et al., Inscriptions d'Atrax en Pélasgiotide (Thessalie), Ét (à paraître).KRAMOLISCH, « Ära des Claudius » = H. KRAMOLISCH, « Zur Ära des Kaisers Claudius in Thessalien », Chiron 5
(1975), p. 337-347.KRAMOLISCH, Strategen = H. KRAMOLISCH, Die Strategen des thessalischen Bundes vom Jahr 196 v. Chr. bis zum
Ausgang der römischen Republik, Demetrias 2 (1978).LEFÈVRE, Amphictionie = F. LEFÈVRE, L'amphictionie pyléo-delphique : histoire et institutions, BEFAR 298
(1998).LESCHHORN, Antike Ären = W. LESCHHORN, Antike Ären. Zeitrechnung, Politik und Geschichte im Schwarz-
meerraum und in Kleinasien nördlich des Tauros (1992).RPC I = A. BURNETT, M. AMANDRY, P. P. RIPOLLES, Roman Provincial Coinage, I. From the Death of Caesar to
the Death of Vitellius (44 BC- AD 69) (1992).RPC II = A. BURNETT, M. AMANDRY, I. CARRADICE, Roman Provincial Coinage, II. From Vespasian to Domitian
(AD 69-96) (1999).SANCHEZ, Amphictionie = P. SANCHEZ, L'amphictionie des Pyles et de Delphes : recherches sur son rôle historique,
des origines au IIe siècle de notre ère (2001).ZACHOU-KONTOYIANNI, « » = M. ZACHOU-KONTOYIANNI, «
», dans (2003), p. 145-149.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 429
BCH 132 (2008)
La typologie des raisons expliquant l’adoption d’une ère à l’époque romaine est à la fois simple et ouverte1. Elles ressortissent soit à l’histoire locale, prenant leur part dans la construction d’une mémoire civique ou régionale, soit à la plus grande histoire, celle des relations de la communauté avec la puissance dominante du moment : les deux modèles ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Les événements de l’histoire de la cité sont rarement présentés de manière explicite dans les formules de datation des documents officiels : la fondation, la refondation ou une reconstruction partielle après une grande catastrophe, le retour à la liberté forment les motifs les plus fréquemment mis en avant, mais ils ne sont sans doute pas les seuls. Les ères prenant appui sur des événements de plus grande échelle se placent dans la tradition hellénistique du comput par les années de règne des souverains, mais, face au pouvoir de la République romaine, qui ne présentait pas une tête unique et permanente comme dans le cas des royaumes hellénistiques, il a fallu s’adapter. Avant que le Principat ne devînt une forme de gouvernement pérenne, les ères ne pouvaient s’appuyer ni sur les consuls annuels, quand même leur pouvoir était prorogé, ni sur les imperatores, dont le pouvoir était pour le moins instable, sinon proche de l’illégalité. C’est donc à la réduction en province qu’on s’est référé2, comme dans le cas de la Macédoine, et donc à un nouveau statut dans la relation à Rome, ou à une victoire remarquable d’un candidat au pouvoir en passe d’obtenir une situation plus stable, comme César après Pharsale ou Octave après Actium3.
La chronologie de la deuxième confédération thessalienne a fait l’objet, il y a main-tenant trente ans, d’un travail monumental de Herwig Kramolisch4, mais celui-ci ne couvrait que les deux premiers siècles d’existence du koinon, depuis sa fondation en 197/6 av. J.-C. jusque dans le courant du règne d’Auguste. Souhaitant ne pas suspendre sa démonstration à l’année 31 av. J.-C., Kramolisch a intégré une série de stratèges pour lesquels était utilisée une ère spécifique, , portant le même nom que l’ère à laquelle avait recours la province de Macédoine et dont le point d’origine était la victoire
BCH 132 (2008)
1. Je m'appuie sur la synthèse de LESCHHORN, Antike Ären, notamment p. 416-434. Sur les ères locales et provinciales, la bibliographie récente est commodément réunie par D. FEISSEL, « Ères locales et frontières administratives dans le Proche-Orient protobyzantin », dans K. BELKE, Fr. HILD, J. KODER, P. SOUSTAL (éds), Byzanz als Raum. Zu Methoden und Inhalten der historischen Geographie des Östlichen Miteelmeerraumes (2000), p. 65-74. Je remercie J.-B. Yon de m'avoir signalé cette référence.
2. LESCHHORN, Antike Ären, p. 418-420, montre que le terme d'« ère provinciale » est souvent abusif et qu'il vaut mieux parler d'ère « d'incorporation » (Eingliederung), comme ce fut le cas pour Kibyra et certaines cités de Carie intégrées dans la province d'Asie en 85/4 av. J.-C., pour la Paphlagonie intérieure incor-porée à la Galatie en 6/5 av. J.-C. ou pour les cités du Pont en 3/2 av. J.-C. (p. 419-420). La création en 43 apr. J.-C. d'une province de Lycie-Pamphylie a pu donner lieu à l'adoption d'une ère d'incorporation, mais celle-ci est très mal attestée (p. 474).
3. On peut ajouter, en Achaïe notamment et pour une époque plus tardive, la référence à l'epidèmia impé-riale, prenant pour origine un séjour impérial dans la province (ère du voyage de Néron, ère du séjour d'Hadrien).
4. KRAMOLISCH, Strategen.
430 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
d’Actium en septembre 32/31 av. J.-C. Mais, au contraire de la Macédoine propre, où l’usage de l’ère d’Actium a perduré jusque tard dans l’Antiquité, l’etos sebastos de Thessalie n’était pas alors attestée au-delà de la 20e année, c’est-à-dire 13/2 av J.-C. Cette année, considérée comme la fin de l’époque hellénistique pour la Thessalie, a servi de terme à l’ouvrage de Kramolisch.
Disons-le tout de suite : ce choix de rupture chronologique a eu pour effet de scinder artificiellement en deux périodes la documentation thessalienne et d’empêcher de saisir dans un mouvement unique les premiers temps de la Thessalie romaine. Les documents pourtant ne manquent pas, même s’ils relèvent bien souvent du seul type qui soit très courant dans l’épigraphie publique thessalienne tardo-hellénistique et romaine : l’enregis-trement des nouveaux affranchis5.
C’est cette période charnière qu’est le règne d’Auguste que je me propose d’étudier, en essayant de montrer comment s’est littéralement cristallisée une opinio communis autour de la date traditionnellement admise pour l’ère auguste, ne tenant pas compte des déca-lages et des contradictions entre les sources. La reprise point par point de chacun des éléments me permettra de proposer une nouvelle hypothèse chronologique, mieux étayée me semble-t-il, et de présenter un nouveau récit historique d’un exemple de l’intégration par étapes d’une partie du monde grec à l’Empire de Rome.
I. LA THESSALIE SOUS AUGUSTE D’APRÈS LES SOURCES
1. LES SOURCES ÉPIGRAPHIQUES ET NUMISMATIQUES
L’ère auguste
La victoire d’Octave à Actium en septembre 31 av. J.-C. et la disparition de son dernier rival est un événement commode pour dater le changement de nature du régime répub-licain. Elle est certes considérée à présent comme une étape dans un processus, mais le vainqueur manifesta la volonté d’en faire le moment charnière d’un temps nouveau. Certaines provinces l’adoptèrent comme point d’origine d’une nouvelle ère, conforme aux vœux de leur nouveau souverain. Dans certaines cités d’Achaïe, cet , toujours en usage dans la première moitié du IIIe siècle apr. J.-C.6, est parfois explicitement lié à la victoire sur les armées d’Antoine et de Cléopâtre :
5. Près d'une trentaine de cités thessaliennes ont fourni des listes ou des déclarations d'affranchis, sur un modèle toujours très proche, mais dont la mise en forme varie selon le trésorier alors en charge de percevoir une taxe valant reconnaissance du nouveau statut. Le tout permet de connaître plusieurs milliers d'anciens esclaves, mais surtout plus des 2/3 des stratèges éponymes pour la période couverte pour ce type de documents : à savoir entre 160 av. J.-C. et la fin de la confédération thessalienne, dans le dernier tiers du IIIe s. apr J.-C.
6. La 252e année de cette ère date une dédicace de la prêtresse Licinia Timokrateia de Mégare (IG VII 110).
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 431
BCH 132 (2008)
7. Dans la province de Macédoine, elle est nommée plus simplement « ère auguste », 8, et peut être désignée, dans les zones limitrophes thraces, comme un
« comput macédonien9 » : les documents de Macédoine offrent souvent une synchronie avec la datation par l’ère de la province de Macédoine, adoptée en 148/7 av. J.-C., que l’ère auguste supplante même10. Cette ère n’a pu être qualifiée d’auguste qu’à partir du moment où Octave a porté le cognomen d’Augustus, au début de l’année 27 av. J.-C.
Un est bien attesté dans un certain nombre de cités thessaliennes, mais semble n’avoir été en usage que pendant une vingtaine d’années : on n’en connaît pas pour l’heure d’exemple postérieur à la 20e année.
Trois positions ont été adoptées vis-à-vis de l’etos sebaston thessalien, qui a été considéré comme :
– une « datation exprimée en années de règne d’Auguste », à compter de l’année 27/6 av. J.-C.11 ;
– l’ère d’Actium commençant, « comme ailleurs », en 32/112 ;
7. Liste de vainqueurs aux Isthmia, sous le consulat de Marcus Servilius et de Lucius Aelius Lamia, soit 3 apr. J.-C., (B. D. MERITT, Corinth : Results of the Excavations, VIII. 1. The Greek Inscriptions : 1896-1927 [1931], 14) ; décret de Phères de Messénie pour Stephanis fille d’Agathias, [ ] (IG V 1, 1359 A) ; Tégée, [ ], qu’il convient sans doute de corriger en [ ] (IG V 2, 51, 181e année : l’intitulé du document rapporte la synchronie avec une ère dont l’origine est le premier séjour en Grèce d’Hadrien).
8. L. ROBERT, RevPh 1939, p. 129-130 et n. 2 ; Bull. ép. 1949, 99 et Bull. ép. 1965, 236. 9. L’ère d’Actium est appelée, dans une inscription de la ville bulgare de Beljovo sur le bas Strymon (ter-
ritoire de l’antique Paroikopolis, à l’extrémité Nord de la province de Macédoine), « comput des Macédoniens » : [ ] (G. MIHAILOV, IGBulg IV 2305, dédicace à un héros local faite par des Nicopolitains du Nestos, cité qui dépend de la province de Thrace).
10. « Car, et c’est un fait qu’il convient de souligner, s’il y a lieu de parler d’ère officielle en Macédoine, c’est évidemment l’ère d’Actium qui peut prétendre à ce titre » : voir F. PAPAZOGLOU, « Sur l’emploi des deux ères macédoniennes en Macédoine (Notes d’aphie et de topographie macédoniennes) », BCH 87 (1963), p. 517-531, citation p. 525. Quand il y a double datation, c’est toujours l’ère d’Actium qui est mentionnée en premier. Le monnayage de Béroia, le seul à être daté de façon absolue, utilise exclusivement l’ère d’Actium. Si l’ère de la province n’a pas été abandonnée pour autant, c’est qu’elle était bien enracinée dans les milieux populaires.
11. O. Kern et Hiller von Gärtringen exposent leur point de vue en 1907, dans les Inscriptiones Graecae IX 2, dans le commentaire de l’inscription no 1296, editio princeps de l’attestation de l’ère auguste la plus anciennement connue ; W. KROOG, De fœderis Thessalorum praetoribus, Dissert., Halle (1908), p. 35 ; A. ARVANITOPOULOS, AEph 1923, p. 149 ; A. BABAKOS, Actes d’aliénation en commun et autres phénomènes apparentés d’après le droit de la Thessalie antique (1966) (pour la traduction française), p. 20 – la citation est extraite de cet ouvrage.
12. A. ARVANITOPOULOS, AEph 1915, p. 20 (idée qu’il a récusée dès 1923 ; voir n. précédente) ; HELLY, Gonnoi I, p. 127 et HELLY, BCH 1975, 122-124 ; KRAMOLISCH, Strategen, p. 126 ; LESCHHORN, Antike Ären, p. 225. « La conversion des années de l’ère auguste des inscriptions thessaliennes en années du comput julien a donné lieu à des hésitations » (HELLY, BCH 1975, p. 124). La première
432 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
– une ère spécifique à la Thessalie qui commémore un événement remarquable : l’acceptation par Auguste de revêtir la stratégie éponyme du koinon thessalien en 27/6 av. J.-C13.
Année auguste Stratège fédéral Cité Référence
4 Timasithéos 2e str. Larisa ZACHOU-KONTOYIANNI « »
7 Hipparchos Chyrétiai IG IX 2, 349c (ArchEph 1917, p. 118, no 331)
8 Ménékratès Chyrétiai IG IX 2, 349b (ArchEph 1917, p. 118, no 332)
9 [Sôs]andros Chyrétiai ArchEph 1917, p. 124, no 339
13 Poluxénos DolichèIG IX 2, 1296 (ArchEph 1923, p. 128, no 361 et ArchEph 1945-47, p. 110)
14 Apollodôros Dolichè IG IX 2, 1296 (ArchEph 1923, p. 128, no 361)
16 Hippokratidès Cité inconnue HELLY BCH 1975, p. 120, no 1
19 Pétraios Chyrétiai ArchEph 1917, p. 21, no 312
20 Apollodôros2e str. Gonnoi HELLY, Gonnoi II, no 116
Tableau 1. — Attestations de l’ère auguste en Thessalie
année de cette nouvelle ère est 32/1 ou 31/0, selon que l’année de la cité concernée commence au printemps ou à l’automne : pour la Thessalie, c’est donc l’année 32/31 qui devrait être prise comme origine (voir HELLY, Gonnoi I, p. 125, qui s’appuie sur S. ACCAME, Il dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad Augusto [1946], p. 12-13, et qui ne distingue pas le cas de cités de Macédoine de celles d’Achaïe. On prendra garde que les calculs dans le tableau récapitulatif de son article de 1975, qui réaffirme la date de 32/1 sont établis à partir de l’année 31/0). Dans la colonie de Corinthe, la liste des vainqueurs aux Isthmia sous les consuls M. Servilius et L. Aelius Lamia – c’est-à-dire de 3 apr. J.-C. – est datée de la 33e année auguste : la première année de l’ère correspond donc à 30 av. J.-C., c’est-à-dire l’année qui a suivi la bataille. On peut supposer que les cités de la province d’Achaïe qui ont adopté l’ère d’Actium alors que leur année chevauchait deux années consulaires ont fait de 31/0 leur première année dans ce nouveau comput (Mégare, Épidaure, Sparte, Méthana, Phères de Messénie, Tégée). En Macédoine, une synchronie entre la 252e année et les consuls Gratus et Seleucus (ce dernier en restitution) montre que l’inscription ainsi datée doit être placée en 221 apr. J.-C., et que la première année de cette ère est 31 av. J.-C. C’est donc bien l’année même de la bataille qui fut désignée comme année première ; elle correspond à une année à cheval sur les années 32 et 31 selon le calendrier actuel.
13. M. Zachou-Kontoyianni, à l’occasion de la publication d’un document inédit de Larissa daté de la 4e année auguste, pense pouvoir constater que le comput ne peut prendre pour origine la date d’Actium,
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 433
BCH 132 (2008)
Au-delà de ces débats, l’opinio communis a retenu qu’une ère rendant hommage à Octave, restitutor pacis et libertatis, est en usage en Thessalie dans les premières années du Principat, qu’elle prenne pour origine Actium, l’octroi de l’épithète Augustus à Octave ou l’éponymie thessalienne de ce dernier14. Si ces trois éléments ont été couramment mis en relation entre eux, on va voir que, de son côté, la stratégie d’Auguste a été liée à des réformes monétaires d’une certaine ampleur.
Stratégie d’Auguste, diorthôma et émissions monétaires de bronze
Deux déclarations d’affranchissements sont datées par une année « de César » ou « sous la magistrature de César Auguste », l’une de Larissa15 ( ), l’autre de
puisque la 4e année, 29/8 av. J.-C., serait déjà qualifiée de sebastos alors même que le mot latin que cet adjectif traduit, augustus, n’existe pas encore (ZACHOU-KONTOYIANNI, « »). A. CHANIOTIS (SEG 53 (2003) [2007], no 547) a fait remarquer, en renvoyant à LESCHHORN, Antike Ären, p. 215 (erreur pour p. 225), que « the problem does not exist […] if the Aktian era began in Thessaly in 31/30 B.C., as in another parts of the Roman East, and not in 32/31 B.C., as in Macedonia ». Si l’on peut douter d’une si grande rapidité de la diffusion de la traduction officielle du titre-nom Sebastos, on verra plus loin qu’il est une manière simple de trancher cet épineux problème.
14. Par exemple, pour J. A. O. LARSEN, « The Policy of Augustus in Greece », Acta Classica 1 (1958), p. 123-130, l’empereur est célébré par ce comput, car il prodigue des privilèges aux Thessaliens et qu’il a accepté de devenir magistrat fédéral.
15. HELLY, « Italiens », p. 377-379.
Fig. 1. — Déclaration d'affranchissement de Phères, sous la stratégie d'Auguste, mentionnant le diorthôma (IG IX 2, 415) (cliché Chr. Wolters).
434 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
Phères16 (fig. 1) ( ). Si les tout premiers éditeurs n’ont pas reconnu la spécificité de la situation17, il ne fait plus de doute dès la publication du corpus des IG que le texte de Phères est une preuve qu’Auguste est devenu stratège des Thessaliens. Qu’un empereur revête une magistra-ture éponyme locale ne pose pas de problème : les occurrences en ont été recensées régulièrement18 et le cas thessalien apparaît simplement comme l’un des plus anciens connus.
La date de la stratégie a été établie grâce au fait que le versement de la taxe par l’af-franchi est indiquée dans l’inscription de Phères comme suit :
19 « les 15 statères prévus par la loi qui équivalent, d’après le diorthôma, à 22 deniers et demi ». Sur les faces principales de cette même stèle ont été gravées les déclarations faites sous les deux semestres de l’année où Thémistogénès était stratège, puis celles du premier semestre du stratège Eubiotos ; sur la face opposée, très abîmée, les affranchis du second semestre d’Eubiotos. La déclaration faite sous la stratégie d’Auguste est gravée sur un des petits côtés. Sur les faces principales, la monnaie dans laquelle est enregistrée la taxe est le statère ; le petit côté fait état de deniers et du diorthôma. Ce diorthôma, connu par deux autres documents uniquement20, a explicitement pour conséquence une équivalence entre le système moné-taire romain et celui qu’utilisent les Thessaliens depuis le IIe siècle av. J.-C. On en a déduit pour la Thessalie que les très nombreuses déclarations d’affranchis pouvaient être classées en deux groupes : les plus anciennes, qui enregistrent la taxe que doit verser le nouvel affranchi en statères, et celles qui l’enregistrent en deniers. Une telle mesure sonnait le glas du monnayage hellénistique thessalien : les statères ont alors cessé d’être frappés.
De façon plus générale, deux points ont fait couler beaucoup d’encre : qui a promulgué cette décision et dans quelle région est-elle valide ?
Le débat oppose ceux qui assignent à cette décision une portée générale, valable pour toute la province d’Achaïe au moins, et ceux qui rappellent son contexte spécifiquement
16. IG IX 2, 415, face B, l. 73-78.17. Hic non praetor est eponymus, sed imperator Caesar Augustus : J. L. USSING, Inscriptiones Graecae ineditae
(1847), no 4, p. 14.18. Liste dressée par L. ROBERT, Études aphiques et philologiques (1938), p. 143-150, qu’il a lui même mise
à jour dans BCH 102 (1978), p. 395-543 (529 n. 10) et qui est complétée par J. DEVREKER, Les Orientaux au Sénat romain d’Auguste à Trajan », Latomus 41 (1982), p. 492-516 (515). Voir aussi W. Weiser, « Philippus Iunior als “Ehrenbürgermeister” von Sagalassos und Prostanna », SNR 64 (1985), p. 98-100 ; pour un exemple récent, voir D. MULLIEZ, « Notes d'aphie delphique, VIII. L'empereur Claude, témoin et archonte à Delphes », BCH 125 (2001), p. 295, n° 3.
19. IG IX 2, 415, face B, l. 84-91.20. En plus du texte de Phères, le diorthôma est attesté dans une déclaration d’une cité inconnue (HELLY,
BCH 1975, no 1, p. 120), sous le stratège Hippokratidès, lors de la 16e année auguste, ainsi qu’à Thèbes de Phthiotide, sous le stratège Epainétos (P. H. LAZARIDIS, PAAH 1972, no 2, p. 46-48).
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 435
BCH 132 (2008)
thessalien : si M. Crawford date prudemment le diorthôma après Actium et que M. Price estime que la réorganisation des provinces en 27 av. J.-C. forme un terminus ad quem plus raisonnable21, les numismates spécialistes de la Thessalie, dans le sillage de P. Franke22, font de l’année 27 même une date pivot dans l’histoire du monnayage thessalien, B. Helly essayant de montrer combien l’existence d’un taux fixe direct de la monnaie thessalienne en deniers, prenant en compte la valeur monétaire des premières émissions de statères, était « un cadeau fait par Auguste aux Thessaliens23 » : pour tous, en tout cas, « [la mesure] ne peut avoir été faite que par l’autorité romaine, seule souveraine en la matière ».
Ce que certains ont pu appeler « diorthôma d’Auguste » est donc considéré comme une conséquence immédiate de la mainmise du pouvoir impérial sur tous les rouages moné-taires pour les frappes en métal précieux et de la création d’un système qui lui permette sans encombre de récupérer le tribut des provinces24. L’accroissement des pouvoirs, en 27, de celui qui s’appelle désormais Auguste a semblé la date qui convient le mieux pour cette situation de monopole : telle est donc la date du diorthôma et par conséquent celle de la stratégie d’Auguste25.
C’est, par ailleurs, dans ce même contexte de mise en place d’un nouveau système faisant du denier l’unique monnaie de référence que la confédération thessalienne aurait repris les émissions monétaires, en bronze, manifestant une grande volonté de continuité
21. M. CRAWFORD, Coinage and Money under the Roman Republic (1985), p. 270 ; M. PRICE, dans The Coinage of the Roman World in the Late Republic, Proceedings of a Colloquium Held at the British Museum in September 1985, BAR International Series 326 (1987), p. 95-103 ; positions reprises dans RPC I, p. 246. D. KNŒPFLER, « L’intitulé oublié d’un compte des naopes béotiens », dans D. KNŒPFLER (éd.), Comptes et inventaires dans la cité grecque. Actes du Colloque international d’aphie, tenu à Neuchâtel du 23 au 26 sept. 1986 en l’honneur de Jacques Tréheux (1988), p. 284-285, n. 72, comme les auteurs du RPC I, p. 28, estime, en toute prudence, que le diorthôma n’est pas qu’une affaire thessalienne.
22. P. R. FRANKE, Schweiz. Münzblätter 35 (1959), p. 61-67 ; HELLY, Gonnoi I, p. 124 ; BURRER, Münzprägung, p. 6-7 ; HELLY, « Diorthôma », p. 84-91.
23. « Le diorthôma leur permettait d’acheter des deniers avec des statères évalués à la valeur pondérale et marchande qu’ils avaient en Grèce même quand ils avaient été mis en circulation » : HELLY, « Diorthôma », p. 89 ; id. pour la citation suivante. L’auteur y réfute la possibilité de descendre la fin des frappes de statères quelques années après l’année 27, comme cela a été proposé (KRAMOLISCH, Strategen, p. 107-110 et p. 137-138).
24. Les monnaies locales anciennes ont continué de circuler pour ne disparaître que progressivement. Si, à partir d’une certaine date, le versement de la taxe des affranchis thessaliens est systématiquement enregistré en deniers, il s’agit en réalité d’une monnaie de compte : aussi des oboles sont-elles mention-nées à côté des deniers dans les versements de la taxe jusqu’au milieu du Ier s. apr. J.-C. dans certaines cités de l’ancienne Perrhébie. Sur ces questions et le cas thessalien, voir B. HELLY, « Deux attestations du Victoriat dans les listes d’affranchissements de Thessalie », dans T. HACKENS, R. WEILLER (éds), Actes du 9e congrès international de numismatique, Berne 1979, I. Numismatique antique (1982), p. 165-176.
25. 27 av. J.-C. est aussi la date retenue par BOWERSOCK, « Römischen Thessaliens », p. 281-282.
436 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
avec le monnayage fédéral d’époque hellénistique : « les Thessaliens ont maintenu leurs divisions monétaires traditionnelles, auxquelles ils étaient habitués, sous un autre nom26 ». Ainsi à l’obole correspondait une dénomination d’un poids et d’un diamètre à peu près équivalent, qui valait deux as, l’assarion, dans la mesure sans aucun doute où le vieux numéraire continuait de circuler. Les émissions les plus anciennes, selon Friedrich Burrer qui en a publié le corpus27, portent la légende , le portrait d’Auguste au droit, Athéna Itonia ou Zeus Eleuthérios au revers. Il avance la date de 23 av. J.-C. pour cette émission, puisqu’il identifie le responsable de la frappe avec le stratège Sôsandros fils d’Aristonoos, en charge lors de la 9e année auguste. L’interruption de la frappe de monnaies par la confédération n’aurait donc duré que quelques années – à peine dix –, le système précédent étant encore utilisé pour une émission des années 31-2728 : il n’y a dès lors aucun sens à parler de solution de continuité, puisqu’il est admis par tous que le monnayage fédéral hellénistique n’était pas émis de façon régulière, mais qu’il l’était par lots29.
Les autels à Auguste Sôter et l’épithète Sébastèos
Il faut ajouter à ce tableau des sources épigraphiques thessaliennes sous Auguste, une série de petits documents qui ont été reconnus, dès la fin des années 50, comme des autels à l’empereur30. Parmi tous ceux qui ont été élevés à travers le monde grec, tous ceux de la série thessalienne ont recours à la même formule très simple pour désigner l’empereur : . On en connaît à présent plus de 15 exem-ples, dans un nombre restreint de cités thessaliennes, mais réparties sur tout son terri-toire. La grande régularité de leur formulaire donne à penser à une décision de circon-stance prise par le koinon, mais d’une circonstance ignorée de nous. Il est établi, depuis les travaux de S. F. R. Price sur le culte impérial, que le grec théos n’est pas seulement la traduction du latin divus, qu’il ne sert pas systématiquement à désigner l’empereur divinisé, mais qu’il peut être employé du vivant de celui-ci31. On ne peut donc conclure de cette épithète une date postérieure à 14 apr. J.-C. Dans son étude récente sur le culte
26. HELLY, « Diorthôma », p. 83.27. BURRER, Münzprägung, p. 58 et 105-110.28. Le monnayage du koinon des Thessaliens à l’époque hellénistique n’a pas été étudié de façon systéma-
tique : bien des problèmes de chronologie restent posés. F. Burrer a cependant montré qu’il fallait faire remonter à la période 31-27 une émission de bronze dont la légende est au droit et au revers BURRER, Münzprägung, p. 104), qui appartient encore au système pondéral hellénistique.
29. B. HELLY, « Les émissions monétaires de la confédération thessalienne (IIe/Ier s. av. J.-C.) », dans G. DEPEYROT, T. HACKENS, G. MOUCHARTE (éds), Rythmes de la production monétaire (1987), p. 39-53.
30. A. S. BENJAMIN, A. E. RAUBITSCHEK, Hesperia 28 (1959), p. 65-85 (liste p. 68-71) : voir Bull. ép. 1960, 141.
31. S. F. R. PRICE, Rituals and Power (1984) et « Gods and Emperors : the Greek Language of the Roman Imperial Cult », JHS 104 (1984), p. 79-95, surtout p. 81-82.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 437
BCH 132 (2008)
impérial en Achaïe sous les Julio-Claudiens32, Maria Kantiréa propose pour ces autels une datation haute, l’épithète sôter attestée dans les manifestations du culte impérial naissant rendant compte de la situation de paix retrouvée après Actium.
C’est à cette même époque qu’apparaît, pour des Thessaliens, une qualification complémentaire à l’ethnique : dans sa cité, tel personnage est dit , à Delphes tel ressortissant d’Hypata est désigné comme les monnaies fédérales sont émises par les 33. Cette épithète, dérivée de la traduction en grec d’Augustus, n’est attestée nulle part ailleurs dans la partie hellénophone de l’Empire. Même si les conditions d’octroi de ce titre restent l’objet d’hypothèses34, on a pu la mettre en relation avec « la proclamation de la liberté accordée par César aux Thessaliens […] et la réorganisation administrative et politique accomplie par Auguste au début de son règne35 ». Pour l’heure, la plus ancienne attestation remonte à la 8e année auguste36, ce qui, selon le calcul des tenants d’une ère d’Actium, correspond à 24 av. J.-C. : ce serait donc entre 27 et 24 que les Thessaliens auraient eu le droit de porter l’auguste épithète (ou entre 27 et 20, selon le calcul de M. Zachou-Kontoyianni).
Les premières années du Principat couronnent donc une entente très grande entre la confédération thessalienne et le nouveau pouvoir en place qui ne détonne pas dans l’his-toire des relations entre Rome et la Thessalie : une série de décisions du Prince confirme la place d’alliés privilégiés que les Thessaliens occupent depuis la 2e guerre de Macédoine. Il n’y aurait pas lieu de s’en étonner, si les seules sources littéraires conservées faisant mention de la Thessalie sous Auguste ne brossaient pas le portrait d’une région en proie à des diffi-
32. M. KANTIRÉA, Les dieux et les dieux Augustes. Le culte impérial en Grèce sous les Julio-Claudiens et les Flaviens. Études aphiques et archéologiques, Meletemata 50 (2007), p. 51-52. Voir mes remarques dans Bull. ép. 2009, ad loc, et dans I. Atrax, nos 154 à 157.
33. La liste des occurrences est dressée par HELLY, BCH 1975, p. 125-127.34. S’appuyant sur la seule catégorie des individus désignés comme Sebastèoi dans les inscriptions de
Thessalie, A. S. Arvanitopoulos a cru reconnaître dans cette expression une manière de désigner les affranchis impériaux, ce que ne confirme pas l’usage de l’épithète pour des cités ou le koinon dans son entier (A. S. ARVANITOPOULOS, AEph 1923, p. 149). De même, je ne fais que passer sur une hypothèse avancée par L. Robert dans une note d’À travers l’Asie Mineure (1980), p. 217, mais sur laquelle il n’a pas eu le temps de revenir. Remarquant que seules quelques cités étaient connues pour avoir porté cette épithète (Hypata, Larissa, Mélitaia) et qu’il s’agissait là des cités principales des États formant la Thessalie (la Thessalie propre pour Larissa, l’Ainide pour Hypata, l’Achaïe pour Mélitaia) : il émit l’hypothèse que le droit de porter la qualification impériale avait été octroyé aux Thessaliens en com-pensation de la réorganisation des voix amphictioniques opérée par Auguste, dans le but de favoriser Nicopolis. B. Helly révoque cette idée en doute, arguant du fait que l’ensemble de la confédération, d’après les monnaies, pouvait porter l’épithète de Sebasteos : HELLY, « Diorthôma », p. 90, n. 86. L’hypothèse de L. Robert est reprise sans discussion par M. ZACHOU-KONTOYIANNI, «
», 12 (2003-2004), p. 267-268.35. HELLY, BCH 1975, p. 127, n. 27.36. Le trésorier Alexandros, dans un affranchissement de Chyrétiai : AEph 1917, p. 148, no 332, l. 1.
438 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
cultés importantes : il s’agit de l’extrait d’un traité de Plutarque faisant référence à des émeutes populaires, d’une allusion de Suétone à une série de procès tenus devant Auguste, d’un passage de Pausanias commentant la suppression d’une partie des suffrages amphic-tioniques thessaliens et de la liste, dressée par Pline, des cités libres de Grèce continentale. Ces textes soulèvent des questions de chronologie qu’il faut exposer ici.
2. LA THESSALIE SOUS AUGUSTE D’APRÈS LES HISTORIENS ANTIQUES
Le procès devant Auguste
Commençons par le seul événement pour lequel on puisse proposer une date au moins approximative. Son existence est mentionnée par l’historien Suétone, dans sa Vie de Tibère : lors de ses années d’apprentissage de la vie publique (rudimenta), le futur suc-cesseur d’Auguste a pris la défense de cités ou de peuples sous domination romaine dans des affaires qu’avait à juger l’empereur lui-même :
Civilium officiorum rudimentis regem Archelaum Trallianos et Thessalos, varia quosque de causa, Augusto cognoscente defendit (= Tiberius).
« En guise d’apprentissage des charges civiques, Tibère défendit le roi Archélaos, les gens de Tralles et les Thessaliens, chacun pour des causes diverses, devant le tribunal d’Auguste » (Suétone, Tibère VIII).
On ignore tout du contenu de ces affaires, qui n’ont aucun lien entre elles cependant. Glen Bowersock a tenté de montrer que les procès avaient eu lieu tout de suite après le retour de Tibère d’Arménie en 19 av. J.-C.37, mais l’opinion la plus courante admet comme date de cette première passe d’armes judiciaire de Tibère, les années 26-25 av. J.-C.38. Cette chronologie haute est particulièrement intéressante si on la compare avec les sources épigraphiques qui soulignent les excellentes relations qu’entretiendraient les Thessaliens et le pouvoir impérial en 27 av. J.-C. Il y a là un décalage qui n’a pas été repéré et qu’il faudrait expliquer.
La perte des voix amphictioniques
La deuxième situation de difficulté pour les Thessaliens se déduit de l’exposé de Pausanias, au début de sa description de Delphes, sur les divers réajustements des psè-phoi amphictioniques jusqu’à son époque :
37 G. BOWERSOCK, Augustus and the Greek World (1965), p. 157-161 (Appendix III).38. B. LEVICK, Tiberius, the Politician2 (1999), p. 20 et p. 235 n. 47. Octave-Auguste bouleverse le cursus
honorum en imposant les candidatures de Tibère et de Marcellus à des fonctions qu’ils n’étaient pas en âge d’assumer : dès 24, ils sont tribuns militaires, l’année suivante Tibère est édile puis consul dix ans avant l’âge légal. Il semble peu probable que le terme de rudimenta s’applique à une période posté-rieure au milieu des années 20.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 439
BCH 132 (2008)
< >
« L’empereur Auguste voulut qu'aussi les Nicopolitains, voisins d’Actium, prissent part au conseil des Amphictions ; aussi Magnètes, Maliens, Ainianes et Phthiotes seraient-ils comptés avec les Thessaliens, tandis que les Nicopolitains utiliseraient leurs voix ainsi que celle des Dolopes – car il n’existait plus de peuple dolope39 ».
Sous Auguste, le conseil amphictionique est remanié au profit de la cité fondée en mémoire de la victoire d’Actium ; Nicopolis d’Épire reçoit les voix des peuples qui ont rejoint pour la plupart la confédération thessalienne. Georges Daux a ainsi expliqué ce texte : au lieu des dix auxquelles elle pouvait prétendre – les deux siennes ainsi que celles des Maliens-Œtéens, des Ainianes, des Perrhèbes, des Dolopes et des Achéens, qui ont rejoint le koinon –, la Thessalie dut alors se contenter de deux voix, les Nicopolitains récu-pérant les suffrages qui lui avaient été retirés. Il faut sans doute attribuer à Néron un rééquilibrage au profit de la Thessalie40.
On admettra cette reconstitution, bien qu’elle ne soit pas sans poser problème41. La date n’en est pas précisée, mais il est couramment admis que cette redistribution des suffrages amphictioniques a eu lieu peu après la fondation de Nicopolis42, « dans le contexte plus vaste de la réorganisation des anciens koina de l’Orient romain43 », c’est-à-dire peu après 27, dans le contexte d’octroi de privilèges aux Thessaliens.
39. Pausanias, X 8, 3 : traduction de G. Daux, légèrement modifiée. 40. G. DAUX, « La composition du conseil amphictyonique sous l’Empire », dans Recueil Plassart – Études
sur l’Antiquité grecque offertes à André Plassart par ses collègues de la Sorbonne (1976), p. 60-73. Voir la bibliographie afférente chez LEFÈVRE, Amphictionie, p. 127, et chez SANCHEZ, Amphictionie, p. 426-428.
41. Il est peu probable que les voix des Magnètes, qui ont formé un koinon distinct des Thessaliens autour de l’ancienne capitale antigonide Démétrias, aient été comptabilisées parmi les voix thessaliennes. Les Magnètes ont-ils été simplement exclus de l’amphictionie ? On peut en douter. S’ils envoient une délégation (Pausanias a pu les confondre avec les Perrhèbes, qu’il ne mentionne pas), Nicopolis n’a plus que huit voix à se répartir. Pausanias ne donnant aucun chiffre et aucune liste de hiéromnémons n’étant connue par l’aphie pour l’époque impériale, il n’est pas possible de trancher.
42. L’attestation la plus ancienne de Nicopolitains à Delphes date du début du règne de Tibère, en la personne de Théoklès fils d’Eudamos, le premier épimélète des Amphictions connu, honoré de la citoyenneté delphique, sans doute à l’issue de son mandat de quatre ans, et responsable, au nom de l’Amphictionie, de l’érection de la statue du nouvel empereur : décret de Delphes pour Théoklès, gravé sur le trésor de Cnide : Syll 3 791D = FD III 1, 312 ; base de Tibère sous le mandat de Théoklès : CID IV 136 ; bases de statues de Théoklès, épimélète méritant par Delphes et une cité anonyme : Syll 3 791C et Chr. DUNANT, BCH 75 (1951), p. 307, no 1. Voir J. POUILLOUX, « Les épimélètes des Amphictions : tradition delphique et politique romaine », dans Hommage à la mémoire de P. Wuilleumier (1980), p. 281-299. LEFÈVRE, Amphictionie ; SANCHEZ, Amphictionie, p. 529 et 349 et R. WEIR, Roman Delphi and its Pythian Games, British Archaeological Reports. International Series 1306 (2004), p. 55-58.
440 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
Émeutes et « lynchage » de Pétraios
Troisièmement, sous Auguste, la Thessalie a été en proie à de sérieux troubles internes. Prise de colère pour une raison inconnue, la foule thessalienne a « lynché » un person-nage nommé Pétraios, rapporte Plutarque dans un passage de ses Préceptes politiques où il décrit comme indispensable la capacité de l’homme politique à contenir le peuple, afin d’éviter l’intervention de Rome44.
« Il ne faut pas qu’il [= le responsable politique] soulève la tempête, ni, dans le cas où elle s’abattrait, qu’il quitte la barre ; il ne doit pas non plus secouer la cité pour la faire chavirer ; au contraire, si elle est en péril et prête à chavirer, il faut qu’il se porte à son secours, en allant chercher au fond de lui, comme l’ancre sacrée, le franc-parler45, dans les situations extrêmes, telles celles qui ont ébranlé les Pergaméniens sous Néron, les Rhodiens, tout récemment, sous Domitien, et les Thessaliens, sous Auguste, quand ils ont brûlé vif Pétraios. »
Plutarque développe un avatar de la métaphore de la cité-navire, que Dion de Pruse qualifie de cliché bien utile46, et l’imbrique dans une autre image, éculée elle aussi : la cité est un corps qui doit recourir le moins souvent possible au médecin, c’est-à-dire Rome, à charge pour ses dirigeants d’aplanir les déséquilibres trop flagrants et, le cas échéant, de contrôler tous les symptômes séditieux. Dans le cas contraire, Rome intervient en supprimant le peu de liberté qui soit laissé à la cité.
En Thessalie, la scène s’est passée , précise laconiquement Plutarque dont le but n’est pas de faire une histoire politique de la région. On ne peut qu’émettre des hypothèses quant à la fonction de Pétraios et son rôle dans l’affaire. Le texte invite à supposer qu’il faisait partie de ces notables qui ont laissé s’installer la tempête au sein de la communauté alors qu’ils assumaient une charge publique, en l’occurrence et selon toute vraisemblance un mandat fédéral, stratégie ou secrétariat. Les troubles thessaliens ont sans nul doute entraîné une intervention de Rome ainsi que la perte de la liberté, même passagère. Pétraios a payé au prix fort les agissements d’une faction démagogique.
43. SANCHEZ, Amphictionie, p. 426.44. Plutarque, Préceptes politiques 815d. 45. Pour le contexte plus général du discours et l’évolution du sens de , qui ne signifie plus le
droit d’initiative dans un contexte démocratique, mais dans le cadre de la cité d’époque romaine, le courage de s’opposer à la démagogie, voir J.-Cl. CARRIÈRE, « À propos de la Politique de Plutarque », DHA 3 (1977), p. 237-251, notamment n. 30 p. 248.
46. Dion, Or. 34, § 16 : .
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 441
BCH 132 (2008)
Pline et la liberté des Thessaliens
Enfin, on a déduit du rapprochement de deux textes le fait que la Thessalie dans son ensemble a perdu son statut de civitas libera sous Auguste. Dans le premier texte, qui est aussi le plus récent, Plutarque rapporte que la Thessalie a acquis le privilège de liberté grâce à César, au lendemain de la victoire de celui-ci sur Pompée en 48 :
47.
« César, en récompense de la victoire, attribua la liberté au peuple des Thessaliens et partit à la poursuite de Pompée »
Mais selon Pline, dressant une liste des cités thessaliennes dans l’Empire, seule la cité de Pharsale possède le privilège de liberté :
In Thessalia autem Orchomenus, Minyius antea dictus, et oppidum Alimon, ab aliis Holmon, Atrax, Palamna, fons Hyperia, oppida Pherae, quarum a tergo Pieria ad Mace-doniam protenditur, Larissa, Gomphi, Thebae Thessalae, nemus Pteleon, sinus Pagasicus, oppidum Pagasa, idem postea Demetrias dictum, Tricca, Pharsali campi cum civitate libera, Crannon, Iletia48.
« En Thessalie, Orchomène, appelée jadis Minyius ; la ville d’Alimon, appelée par d’autres Holmon ; Atrax, Palamna, la source Hypérie, les villes de Phères, derrière laquelle est la Piéride, s’étendant jusqu’à la Macédoine, de Larissa, de Gomphoi, de Thèbes Thessalienne ; le bois Ptéléon, le golfe Pagasétique ; la ville de Pagasae, appelée plus tard Démétrias ; Tricca, les plaines de Pharsale avec une cité libre, Crannon, Ilétie. »
Le texte pose de nombreuses difficultés, qui ont trait notamment aux sources ayant permis son élaboration, au caractère hétéroclite des éléments le composant, à l’absence de certaines cités pourtant attestées par ailleurs, ou d’autres connues par cette seule mention. Seul importe ici le fait que Pharsale est dite « cité libre » : par défaut, il faut en conclure que les autres cités ne peuvent se targuer d’un tel statut et que la Thessalie a donc perdu sa liberté entre Pharsale et la date de rédaction de la source de Pline49. On admet que Pline a suivi, pour établir ce document, les informations portées sur la carte de l’Empire dressée par Agrippa mais sans doute achevée par Auguste50 : cependant, Pline a aussi mis à jour
47. Plutarque, César 48. Le fait est repris par Appien, Bellum civile III 13 : (« Puis il libéra les Thessaliens, qui avaient combattu à ses côtés. »).
L'expression est courante pour les affranchissements d'esclaves (voir L. Robert, Hellenica XI-XII (1960), p. 87 n. 4), sans être réservée à ce sens juridique (A. Bielmann, Retour à la liberté. Libération et sauvetage des prisonniers en Grèce ancienne, ÉtÉpigr 1 [1994], p. 255-257).
48. Pline l’Ancien, Histoire naturelle IV 8, 29.49. Rien sur cet épisode dans Bowersock, « Römischen Thessaliens ».50. Cl. NICOLET, L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire romain (1988),
p. 241-258.
442 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
une partie des données qu’il exposait. Il existe donc une grande latitude dans l’identifi-cation de l’événement qui a valu aux Thessaliens de n’être plus libres ; pour la plupart des commentateurs, les troubles de l’époque d’Auguste figurent en bonne place51.
II. CROISEMENT DES SOURCES
Mes prédécesseurs ont tenté de tisser la toile de l’histoire politique thessalienne à partir de ces quelques données, cherchant à définir par ce biais les relations unissant la Thessalie à Rome et, par conséquent, le statut du koinon au sein de l’Empire.
Reprenant quelques exemples d’émeutes « où se sont fait écharper un conseiller impo-pulaire ou quelque fonctionnaire romain », liées très souvent à des problèmes agraires, A. H. M. Jones est le premier à avoir supposé que celles qui ont entraîné la mort de Pétraios pouvaient être la cause du procès des Thessaliens devant Auguste52. En s’ap-puyant sur une série de déclarations d’affranchis de la cité de Gonnoi, G. Bowersock a montré que la chose était impossible53. À la suite les unes des autres ont été enregistrées les déclarations des nouveaux affranchis sous les stratèges Eurydamas, Sôsandros
Pétraios 2e stratégie, Kriton et Sôsandros (fig. 2). Identifiant ce « jugement de César » à celui auquel fait référence Suétone, Bowersock en conclut que la cause du procès des Thessaliens ne peut être en aucun cas le « lynchage » de Pétraios, qui est toujours en vie à l’issue du procès. En revanche, il avance plusieurs parallèles au procès où les Thessaliens sont défendus par Tibère pour montrer que la cause pouvait très bien en être la perte de la liberté54. B. Helly, pour sa part, s’est montré plus prudent dans la capacité des modernes à reconstruire la chronologie thessalienne sous Auguste : s’il est possible d’identifier le Pétraios de Plutarque avec le stratège fédéral de la 19e année auguste (13 av. J.-C., selon son calcul), ce n’est qu’à l’occasion de sa deuxième stratégie qu’il aurait subi la colère du peuple, c’est-à-dire dans la dernière décennie du Ier siècle av. J.-C. au plus tôt ; de plus, le
51. La question de la liberté des Thessaliens sous l’Empire et, par conséquent, du rattachement de la région à la province de Macédoine ou d’Achaïe, a été fortement débattue : voir, par exemple, BOWERSOCK, « Römischen Thessaliens », p. 280, R. BERNHARDT, Imperium und Eleutheria. Die römis-che Politik gegenüber den freien Städten des griechischen Ostens (1971), p. 202 et BURRER, Münzprägung, p. 7. J’adopte pour ma part, une position prudente dans « En deçà et au-delà des Thermopyles ou Quelle Grèce pour Néron ? », dans Y. PERRIN (éd.), Neronia VII. Rome, l’Italie et la Grèce. Hellénisme et philhellénisme au premier siècle apr. J.-C., Collection Latomus 305 (2007), p. 213-224.
52. A. H. M. JONES, The Greek City from Alexander to Justinian (1940), p. 271 et p. 324 n. 63. La citation est de J.-Cl. Carrière.
53. IG IX 2, 1042.54. BOWERSOCK, « Römischen Thessaliens », p. 280. Le jeune Néron défend devant Claude les Rhodiens
punis par l’empereur : Tacite, Annales XII 58, 2-4 ; Suétone, Claude XXV 9.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 443
BCH 132 (2008)
procès jugé devant Auguste en 19 av. J.-C. (il retient la date proposée par G. Bowersock) ne peut être lié au par lequel l’empereur a choisi le stratège Sôsandros, puisque le stratège alors en fonction lors de cette 13e année auguste est Polyxénos55. D’autres événe-ments inconnus de nous peuvent tout aussi bien expliquer l’intervention impériale. En dernier lieu, M. Zachou-Kontoyianni, s’appuyant sur une autre chronologie de l’ère auguste, a relancé le débat : rien ne s’opposerait à ce que Sôsandros soit le stratège de l’année 19/8 av. J.-C. ; le texte de Suétone ferait bien référence au choix de l’éponyme thessalien par Auguste56.
Le scénario proposé pour l’instant retient à peu près que les premières années de règne d’Auguste, soit environ la première décennie, semblent favorables à la Thessalie : stratégie d’Auguste, taux de change favorable de l’ancienne monnaie locale en monnaie romaine, privilège de frapper monnaie de bronze, de porter l’épithète impériale ; confirmation du statut de liberté. En guise de remerciements, les Thessaliens se sont volontiers prêtés à l’exercice du culte impérial (série des autels d’Auguste) et ont adopté une ère commé-
55. HELLY, Gonnoi, p. 125-128 ; sa position est moins prudente dans « La Thessalie à l’époque romaine », Mémoires du centre Jean Palerne 2 (1980), p. 43-44.
56. ZACHOU-KONTOYIANNI, « », p. 148.
Fig. 2. — Déclarations d'affranchissements de Gonnoi, sous les stratèges Eurydamas, Sôsandros sur décision de l'empereur, Pétraios pour la 2e fois, Kritôn et Sôsandros (IG IX 2, 1042) (cliché de l'auteur).
444 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
morant soit la victoire d’Actium, soit la stratégie d’Auguste. Tout paraît s’être gâté dans les décennies suivantes, quand plusieurs occasions ont imposé le recours à l’intervention impériale : lors du procès où les Thessaliens sont défendus par Tibère, lors de la dési-gnation du stratège Sôsandros et, un peu plus tard, lorsque Pétraios a été brûlé vif, à quoi il faut peut-être rajouter la réforme amphictionique, si on la considère comme un moyen de punir la Thessalie57.
Le fait que l’usage de l’ère auguste se soit perdu dans la seconde partie du règne d’Auguste s’insère parfaitement bien dans ce scénario en deux temps. Il faut attendre plus d’un demi-siècle pour que la Thessalie retrouve la faveur impériale, sous l’empereur Claude. La confédération adopte, en effet, dès 40/1, une nouvelle ère impériale, qu’on désigne sous le nom d’« ère de Claude », attestée jusqu’à sa 14e (et dernière) année de règne. Elle a la particularité de présenter un double comput, celui des années de règne de l’empereur et celui d’une ère ayant pour départ l’année 10/1 apr. J.-C., pour une raison inconnue de nous et qui devait avoir sens dans la relation qui unissait les Thessaliens à Claude58.
Pour autant, l’incertitude règne dans la reconstruction de ces événements selon les systèmes chronologiques adoptés pour l’ère auguste ou pour les rudimenta de Tibère, suivant que l’on place la série des autels plus ou moins haut dans le règne d’Auguste, mais aussi en fonction de l’identification des personnages Sôsandros et Pétraios. Mais le reproche principal qu’on puisse faire à ce scénario est précisément de ne pas en être un : chacune des parties du système proposé a été mise en lien avec une ou deux autres, pas plus ; le montage de l’ensemble s’est fait de proche en proche, sans qu’on vérifie si les parties entraient ou non en contradiction les une avec les autres. Il convient donc de dévider les fils pour, peut-être, les tisser autrement. La trame générale était jusque-là formée par la conjonction entre la stratégie d’Auguste, l’ère auguste et le diorthôma.
57. Dernière marque d’infortune des Thessaliens dans la seconde partie du règne du premier empereur : le devenir de la prestigieuse cité de Phères. B. Helly a proposé de reconnaître sur une stèle découverte à Larissa l’indice d’une réduction en domaine impériale du territoire de la cité de Phères, qui jouxte celui de Larissa, de Scotoussa, de Thèbes et de Démétrias (A. S. ARVANITOPOULOS, AEph 1910, no 6, col. 354-361 ; Cf. B. HELLY, « La Thessalie à l’époque romaine », Mémoires du centre Jean Palerne 2 [1980], p. 41-42). Un affranchi impérial y consacre un domaine appelé phéraïkè à Auguste et aux trois Césars corégents Tibère, Germanicus et Drusus : l’inscription date donc des années 4-14 apr. J.-C., après la série d’adoptions qu’a entraînées le décès des petits-fils d’Auguste, ses successeurs pressentis, et sans doute même après 7 apr. J.-C., date de la disgrâce d’Agrippa Postumus. Je reviendrai ailleurs plus avant sur ce document.
58. HELLY, BCH 1975, p. 120-122 ; KRAMOLISCH, « Ära des Claudius », p. 337-347 ; M. ZACHOU-KONTOYIANNI, « IG IX 2, 545 », dans
Larissa 26-28.04.1985 (1985), p. 186-198.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 445
BCH 132 (2008)
1. DISJOINDRE DIORTHÔMA, STRATÉGIE ET ÈRE AUGUSTE
On doit constater que l’association du diorthôma, de l’ère auguste et de la stratégie de l’empereur a en réalité nui à la juste interprétation de chacun de ces événements, en poussant la plupart des modernes à polariser leur attention sur les années 31 et 27 : l’inscription de Phères montrerait que la date du diorthôma est liée à celle de la stratégie d’Auguste ; cette dernière déterminerait par ailleurs le début de l’ère auguste si celle-ci n’est pas l’ère d’Actium.
Pour autant, rien ne rend nécessaire de prendre l’année 27 pour la stratégie d’Auguste. Certes, 27 av. J.-C. est l’année de la réorganisation des provinces de l’Empire et de la création de celle d’Achaïe. Mais, en ce qui concerne le choix fait par Auguste d’assumer un mandat fédéral en Thessalie, rien ne vient soutenir cette date plus qu’une autre, sinon l’a priori selon lequel l’empereur, bien disposé vis-à-vis des Thessaliens, aurait inclus la Thessalie dans son plan de restructuration administrative à l’échelle de la Méditerranée ou que les Thessaliens se soient empressés de faire allégeance à la nouvelle administration. On sent combien il s’agit d’une date choisie par défaut, parce qu’il a bien fallu que quelque chose d’important se passe alors. Mais en fait 27/6 av. J.-C. ne forme qu’un terminus post quem pour la magistrature thessalienne de l’empereur et, par conséquent, pour l’ère auguste, si l’on estime que cette dernière est une commémoration de la stratégie d’Auguste – ce qui reste à démontrer.
Je crois par ailleurs qu’on a surinterprété le contenu du diorthôma et je suis enclin à y voir quelque chose de bien plus modeste. Le petit côté de la stèle de Phères qui atteste à la fois le diorthôma et la stratégie d’Auguste porte une déclaration d’affranchi gravée au-dessus de celle qui est datée par Auguste. Le texte est lacunaire :
]. Le nom du stratège est perdu. La déclaration
qui suit est aussi une déclaration individuelle, datée du mois Hermaios, et fait pareillement référence au diorthôma. On a donc pu soutenir qu’il s’agissait d’un document daté de la même année et du même mois59 : c’est bien possible, mais les affranchissements thessa-liens peuvent tout autant fournir des parallèles à cette situation que des contre-exemples. L’année où Auguste est devenu stratège ne forme en fait qu’un terminus ante quem pour l’adoption du diorthôma.
Le sens du mot diorthôma a été dégagé par L. Robert et exploité dans le cas thessalien par B. Helly60. Puisque signifie « rectifier », diorthôma, dans un contexte juridique, a le sens de « règlement rectificatif » à une loi préalable. Pour B. Helly, cette
59. ZACHOU-KONTOYIANNI, « », p. 148.60. HELLY, « Diorthôma », p. 87-88, qui renvoie à L. ROBERT, RPh (1927), p. 130-131 (= OMS II,
p. 1085-1086).
446 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
loi organise le taux de conversion de la monnaie thessalienne par rapport à la monnaie romaine, ce qui ne saurait être une décision propre aux Thessaliens. Mais, selon moi, l’expression doit être comprise en relation avec le qui accompagne toutes les déclarations d’affranchissements et fait référence à la loi fédérale imposant le versement d’une taxe et prévoyant un statut particulier de dépendance pour le nouvel affranchi61. Telle serait la loi que « corrigerait » le diorthôma.
La question qui s’est posée à l’organe législatif thessalien fut la suivante : quelle somme réclamer aux affranchis, alors que la monnaie romaine remplaçait progressivement les monnaies de l’ancien système62. Le diorthôma serait une conséquence, sur une loi précise, de la reconnaissance par les Thessaliens du denier comme monnaie de compte : il n’y a pas de nécessité de le lier à la stratégie d’Auguste, à la constitution de la province d’Achaïe ni même à la victoire d’Actium. On peut supposer que d’autres taxes prélevées par les cités thessaliennes ont subi, elles aussi, un diorthôma. Par le hasard des découvertes, nous ne connaissons que trois textes, sur plusieurs centaines de déclarations d’affranchis, qui se réfèrent au diorthôma. Ces trois trésoriers de la cité, en charge de la mise en forme de la déclaration, ont fait référence non pas à la loi générale sur les affranchis, qui avait toujours cours, mais au diorthôma portant sur le montant de la taxe : les autres s’en sont tenus au terme générique de nomos, par habitude ou parce que le diorthôma n’était qu’un aména-gement de cette loi.
2. UNE DATE POUR LE DIORTHÔMA ?
L’adoption ou plutôt l’usage du denier comme monnaie de compte en Grèce continen-tale n’est pas un phénomène chronologiquement uniforme, loin s’en faut : il semble plutôt précoce à Messène (« quelque part entre 70 et 30 ») et assez tardif à Delphes (« dans les vingt premières années du Ier siècle63 »). À Delphes, qui présente une série continue de documents faisant appel à une comptabilité, « à partir du moment où l’on
61. On se reportera, en attendant la publication de mes travaux de thèse, à B. HELLY, « Lois sur les affran-chissements dans les inscriptions thessaliennes », Phœnix 30 (1976), p. 143-158.
62. Le mot appartient bien au vocabulaire comptable et juridique thessalien : la clause d’affichage du décret honorant des juges d’une cité non connue, gravé au-dessus du célèbre décret sur la livraison du grain thessalien à Rome, précise que la dépense sera prise sur le budget prévu selon les diorthômata, les règlements rectificatifs ( ) : K. GALLIS, AD 31 (1976), p. 176-178 ; cf SEG 34, 558 [GHW 5371 dans les archives thessaliennes de Lyon].
63. Les deux cas sont exposés dans la journée d’études « De la drachme au denier », organisée en 1997 à Lille, Topoi 7 (1997), p. 7-163 (publication, sous la direction de D. Mulliez) : L. MIGEOTTE, « La date de l’oktôbolos eisphora de Messène », p. 51-61, et D. MULLIEZ, « Le denier dans les actes d’affranchissement delphiques », p. 93-102 (la citation qui suit se trouve p. 100). M. VITIELLO, AJN 47 (2000), p. 169-187, reprend les attestations aphiques du passage du monnayage grec au denier (p. 184-187).
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 447
BCH 132 (2008)
voit apparaître la mention de deniers, on ne trouve plus de mention de statères ou de demi-mines dans les affranchissements, non plus que dans le reste de la documentation delphique ». Seule exception, par habitude, le prix de rachat reste très majoritairement exprimé en mines, selon l’ancien système. Ce sont bien des deniers qui circulent ou bien la monnaie athénienne, dont le système pondéral est semblable à celui du denier.
La chose est strictement semblable en Thessalie, à ceci près que la confédération frappe ses propres monnaies et qu’on peut supposer que l’adoption d’une nouvelle monnaie de compte entérine la décision de ne plus battre monnaie. Le monnayage du koinon des Thessaliens à l’époque hellénistique n’a pas été étudié de façon systématique : bien des problèmes de chronologie restent posés. F. Burrer a cependant montré qu’il fallait faire remonter à la période 31-27 une émission de bronze dont la légende est au droit
et au revers 64, qu’il tient pour la dernière émission relevant du système pondéral hellénistique. On doit raisonnablement pouvoir faire de 31 un terminus post quem pour le diorthôma65.
Sous la stratégie d’Eurydamas fils d’Androsthénès, statères et deniers semblent avoir coexisté : cette année-là, le trésorier de la cité de Gonnoi enregistre la taxe en deniers66, tandis que celui de Larissa l’enregistre en statères67, ce que l’on considère comme un indice de la proximité de la stratégie d’Eurydamas avec le diorthôma. Les trésoriers de Larisa se seraient fait tirer l’oreille dans un premier temps avant de se conformer à la volonté du koinon. La présence de statères dans les affranchissements du IIe siècle apr. J.-C. a été ainsi analysée comme une mode archaïsante, propre au goût passéiste de cette époque. À Larissa, cependant, le phénomène n’a pas forcément connu de solution de continuité68 : on jugera, d’après le tableau suivant, combien l’ancien système monétaire est encore prégnant dans la capitale thessalienne, même après l’adoption du diorthôma.
64. BURRER, Münzprägung, p. 104 ; c’est aussi la date acceptée par U. HAHN, Die Frauen des römischen Kaisershauses und ihre Ehrungen im griechischen Osten anhand epigraphischer und numismatischer Zeugnisse von Livia bis Sabina (1994), p. 329, no 73.
65. On verra plus loin que la date de mise en place du nouveau système pondéral doit être abaissée de plus de vingt ans.
66. IG IX 2, 1040b ; HELLY, Gonnoi II, no 115.67. N. GIANNOPOULOS, AEph 1930, p. 176-179.68. La cité de Larissa, sous la responsabilité du trésorier, fait dresser la liste semestrielle des nouveaux
affranchis, depuis le milieu du IIe s. av. jusque dans le courant du IIIe s. apr. J.-C. Des 400 stèles qui ont dû être gravées à l’époque impériale, jusqu’à l’abandon de ce système d’enregistrement semestriel, seules une vingtaine ont été conservées : la faible représentativité des documents à notre disposition invite donc à la prudence.
448 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
MONNAIE TEXTEPÉRIODE
D’ATTESTATIONRÉFÉRENCE
Deniers seuls X < Sous Auguste
HELLY « Italiens », p. 377-379 (stratège Auguste)IG IX 2, 541 (stratège Eubiotos 2)IG IX 2, 549 (stratège Démothersès)
Statères et deniers X <
IIe s. apr. J.-C. IG IX 2, 546 (131-2 apr. J.-C.)IG IX 2, 1344 add. (mi IIe s. apr. J.-C.)
Statères seuls sans précision de somme
Ier et IIe s. apr. J.-C.
ZACHOU-KONTOYIANNI « », p. 145 (30-40 apr. J.-C.)IG IX 2, 542 (Ie ou IIe s. apr. J.-C.)IG IX 2, 547 (mi IIe s. apr. J.-C.)
15 statères
IIe s. apr. J.-C.
[Ier s. apr. J.-C. ?]
IG IX 2, 554 (mi IIe s. apr. J.-C.)IG IX 2, 560 (mi IIe s. apr. J.-C.)[en restitution : ZACHOU-KONTOYIANNI « », p. 145 (13/4 apr. J.-C.)ArchEphem 1910, no 8 (IIe s. apr. J.-C.)]
Tableau 2. — Les monnaies dans les affranchissements de Larissa postérieurs au diorthôma
Il y a donc un usage figé, par synecdoque, du mot « statères », voire de l’expression « 15 statères », pour désigner la taxe due par l’affranchi, qui peut coexister sans problème avec la somme effectivement versé e en deniers, mais qui peut tout aussi bien se substituer à elle69. Le trésorier de Larissa chargé d’enregistrer les affranchis du deuxième semestre sous la stratégie d’Eurydamas fils d’Androsthénès a pu choisir, comme l’ont fait nombre de ses successeurs, d’utiliser l’ancienne façon de désigner la taxe, sans qu’on puisse pour autant en conclure qu’il s’agit de l’année au cours de laquelle le diorthôma a été adopté ou d’une année tout juste postérieure.
69. On pense au « denier du culte ». Voir les exemples de Trikkè (IG IX 2, 302, dans les années 130 apr. J.-C., X <), Échinos (
X <, M. ZACHOU-KONTOYIANNI, « », 1 [1989], p. 207-217) et Aiginion (voir par exemple IG IX 2, 327, à la fin du IIe ou au début
du IIIe s. apr. J.-C., X <, d’après les nouvelles lectures de M. ZACHOU-KONTOYIANNI, « », 7 [2003], p. 47-48). Aucune de ces cités n’ayant livré d’affranchissements plus anciens, on ne peut pas juger de la pratique de ses trésoriers en la matière à plus haute époque.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 449
BCH 132 (2008)
Bref, toutes les inscriptions en denier sont postérieures au diorthôma, mais le contraire n’est pas nécessairement vrai. Le diorthôma semble être une conséquence non pas de l’obligation, mais de la simple possibilité pour les trésoriers d’effectuer les opérations de compte en deniers. Mais, à dire vrai, seule la cité de Larissa paraît avoir pratiqué l’ambi-guïté monétaire.
Pour assigner des termini ad quem au diorthôma, il convient donc de distinguer les cités en fonction des pratiques que chacune a adoptées dans les formulaires d’enregistrement d’affranchis : aucune mention de monnaie (Métropolis, Pharsale ; à Atrax, rien avant le milieu du Ier s. apr. J.-C., I. Atrax no 41, puis deniers uniquement, comme à Gomphoi et Hypata), deniers utilisés systématiquement (Gonnoi), deniers et « statères » en concur-rence (Larissa, Trikkè, Aiginion), deniers et oboles pour les subdivisions (cités de l’an-cienne Perrhébie, jusqu’au milieu du Ier s. apr. J.-C.), statères, puis deniers de manière exclusive (Chyrétiai, Pythoion, Dolichè, Halos, Mélitaia, Scotoussa). C’est dans cette dernière catégorie de cités qu’on cherchera la mention la plus récente des statères.
Une fois ces précautions posées, on peut fixer comme terminus post quem pour le diorthôma l’année de la stratégie de Thémistogénès, qui date le dernier document de Chyrétiai où apparaissent les statères70. Quant au plus ancien document dans lequel l’en-registrement est fait en deniers et pour lequel on puisse avoir quelques éléments de chro-nologie, il s’agit de la déclaration de Gonnoi datée par la stratégie d’Eurydamas71. Le hasard fait que ces stratèges, qui encadrent l’adoption par les Thessaliens du diorthôma, sont tous deux les fils d’Androsthénès, le stratège de 49/8 av. J.-C., connu par le Bellum civile de César. Je laisserai à chacun le soin d’évaluer la fourchette chronologique la plus vraisemblable pour ces deux stratégies postérieures d’une génération à 49/8 apr. J.-C. : une application mécanique de la méthode prosopographique pousserait à établir une date autour de 25-20 av. J.-C., mais ce chiffre d’une génération de 25 ans n’est qu’une moyenne.
C’est donc entre 30 et 10 environ av. J.-C. que la Thessalie adopte le denier comme monnaie de référence : la région présente donc une situation intermédiaire entre celle de Messène et celle de Delphes.
3. UNE DATE POUR LA STRATÉGIE D’AUGUSTE ?
Quant à la stratégie d’Auguste, forcément postérieure à 27 ainsi qu’au diorthôma, que
70. AEph 1917, no 340. Le même Thémistogénès fils d’Androsthénès date une déclaration de Phères (IG IX 2, 415), mais cette cité forme un cas à part, puisque toute documentation la concernant disparaît à la fin du Ier s. av. J.-C. et qu’il n’est donc pas possible de savoir si ses trésoriers ont systéma-tiquement tenu compte du diorthôma, comme à Gonnoi ou Chyrétiai, ou s’ils en ont eu une approche plus souple, comme les magistrats de Larissa.
71. IG IX 2, 1042.
450 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
peut-on en dire ? Les éléments de datation contenus dans les documents qui l’attestent ne sont d’aucune aide réelle, sinon qu’ils invitent à prendre en considération une date dans la première partie du règne de l’empereur, plutôt que vers la fin de celui-ci72.
Hypothèse pour hypothèse, je me demande s’il ne faut pas lier la stratégie d’Auguste avec la série des autels présentée plus haut. La récente publication d’autels de Larissa à Agrippa Théos Sôter, adoptant donc le même formulaire que ceux d’Auguste, donne à penser que tous ces autels ont été « fabriqués » pour la même occasion et doivent être assignés à la période pendant laquelle Agrippa assura la fonction de corégent en Orient, entre 17 et 13 av. J.-C.73. La présence du gendre d’Auguste en Grèce explique peut-être la démarche des Thessaliens sollicitant de l’empereur qu’il accepte leur magistrature éponyme. Faut-il sinon la mettre en relation avec le procès dans lequel ils furent défendus par Tibère ? On restera prudent et l’on se résoudra pour l’heure à ne pas connaître l’enchaî-nement exact de tous ces événements.
L’analyse des documents invite à la prudence dans l’établissement d’une date pour la stratégie et le diorthôma ; elle permet, en revanche, de trouver un point d’ancrage solide pour l’ère auguste, pour peu qu’on observe de plus près ce qu’a été, pour la Thessalie, l’« ère de l’empereur Claude ».
4. UNE NOUVELLE DATE POUR L’ÈRE AUGUSTE
Ère auguste et ère de Claude
Si les cités d’Achaïe et de Macédoine ont, comme ailleurs dans l’Empire, adopté une ère d’Actium, l’usage d’une ère de Claude semble, malgré quelques hésitations dont celle d’Ad. Wilhelm, avoir été propre à la Thessalie74. Ce système chronologique présente une synchronie entre les années de règne de Claude et une ère ayant pour origine l’année 10/1 apr. J.-C. On a donc pu ainsi imaginer un voyage du jeune Claude en Grèce
72. Un des tages de Larissa sous la stratégie d’Auguste est le père d’un manumissor libérant son esclave sous Eurydamas fils d’Androsthénès (Asklépiodôros fils de Mégaloklès et Mégaloklès fils d’Asklépiodôros fils de Mégaloklès), mais on ne peut pas conclure grand-chose de ce chevauchement.
73. V. KALFOGLOU-KALOTERAKI, Hellenika 53 (2003), p. 299-303 (= SEG 53 (2003) [2007], 567ter et 567quater) ; la première de ces inscriptions a été publiée en parallèle par Chr. HABICHT, « Marcus Agrippa Theos Soter », Hyperboreus 11 (2005), p. 242-246.
74. Ad. WILHELM, Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde (1939), p. 152-157, dont les arguments sont appuyés par ceux de A. VON PREMERSTEIN, « Die Claudius-Ära von Jahr 10/11 n. Chr. in Lykosura », JÖAI 15 (1912), p. 200-206. A. J. GOSSAGE a depuis lors montré que l’ère datant le décret de Lykosoura pour Nikasippos, fils de Philippos, et son épouse, selon la formule ’ ’
, était sans aucun doute possible l’ère d’Actium utilisée ailleurs en Arcadie et dans le Péloponnèse et que « the Thessalian era was peculiar to Thessaly and meant nothing to Arcadia », dans « The Date of IG V 2, 516 (SIG3 800) », ABSA 49 (1954), p. 51-56.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 451
BCH 132 (2008)
– il a alors 20 ans et prend goût à la taurokathapsia, le jeu de l’« attrape-taureau », si prisé de ces incorrigibles garçons-vachers qu’étaient les Thessaliens75 : son avènement aurait fourni l’occasion au koinon de lui rendre un hommage, sans doute pour glaner des faveurs. Plus sérieusement, F. Burrer, suivant en cela R. Bernhardt76, a supposé que l’année 10/1 avait pu être celle de la restauration de la liberté pour les Thessaliens, à qui l’on aurait pardonné les émeutes qui avaient coûté la vie à Pétraios. L’hypothèse est séduisante, mais soit laisse dans l’ombre le fait que les Thessaliens ne font mention de ce privilège retrouvé qu’à l’avènement de Claude, c’est-à-dire trente ans après l’événement, soit entraîne qu’on imagine à grands frais une intervention personnelle de Claude dans l’affaire.
Une hypothèse simple n’a pas été émise concernant ces ères thessaliennes : qu’il n’y en ait non pas deux, à un demi-siècle d’intervalle, mais une seule.
On a eu en effet tendance à minimiser, au profit du comput par années de règne de Claude, cette ère « mal placée », en surajout, sans prêter suffisamment attention à la formule qui l’introduisait77 : l’ère de Claude est en fait, dans la plupart de ses attestations, une « ère auguste de Claude »,
(Larisa, IG IX 2, 545), (Hypata, IG IX 2, 13). L’adjectif
est mis en facteur commun dans cette double datation ; la seconde ère n’est autre que l’ère auguste, qui a donc pour origine l’année 10/1 apr. J.-C.78. Il faut donc inverser notre perception de ce système chronologique : ce qu’on a appelé l’ère de Claude n’est que l’équivalence, à des fins honorifiques, d’une année de règne avec un comput essentiel pour la Thessalie.
75. Suétone, Claude 21 : l’empereur fait montre d’un philhellénisme voyant en voulant transplanter à Rome les mystères d’Éleusis et les épreuves de la taurokathapsia thessalienne. Sur la taurokathapsia, voir L. ROBERT, « Deux ammes de Philippe de Thessalonique », JS 1982, p. 148-157 (= OMS VII [1990], p. 516-525).
76. R. BERNHARDT, Imperium und Eleutheria. Die römische Politik gegenüber den freien Städten des griechis-chen Ostens (1971), p. 202 et BURRER, Münzprägung, p. 7.
77. La liste des attestations a été dressée plusieurs fois : HELLY, BCH 1975, p. 120-122 ; KRAMOLISCH, « Ära des Claudius », p. 337-347 ; M. ZACHOU-KONTOYIANNI (supra, n. 58), p. 186-198. Pour cette dernière, par exemple, l’utilisation d’une ère supplémentaire est uniquement honorifique (p. 188).
78. La date anniversaire du dies imperii n’a nullement à être prise en compte dans ce calcul : la « première année auguste » d’un empereur est celle de son avènement, elle ne dure que le temps qui sépare cette date de la fin de l’année traditionnelle thessalienne – Néron ayant accédé au pouvoir le 13 octobre 54, qui est l’année 54/55 des Thessaliens, la 15e année de Claude fut aussi la 1re de Néron et ne dura que deux mois. L’usage d’un comput ayant un seul et même point d’origine permettait qu’il n’y eût aucune ambiguïté. Pour l’instant, aucun document thessalien – pour la plupart des affranchissements rédigés en fin de semestre – ne présente de situation de chevauchement entre deux règnes. C’était déjà l’hypothèse de BURRER Münzprägung, p. 57 et n. 201 qui s’appuyait sur la synthèse de LESCHHORN, Antike Ären, p. 6.
452 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
Cette nouvelle proposition de chronologie a pour conséquence le déplacement une quarantaine d’années plus tard d’une série de stratèges dont on pensait qu’ils étaient en fonction au tout début du règne d’Auguste. Mais aucun élément ne la rend impossible et elle me paraît, au contraire, confirmée par le cas d’un de ces stratèges fédéraux : elle réduit dans des proportions acceptables la carrière d’Apollodôros, dont on connaît quatre stra-tégies, étalées, dans l’ancien système, sur 55 ans, entre la 14e année auguste, dans les premiers temps du règne d’Auguste, et la première année de règne de Claude. Il est plus raisonnable d’estimer qu’il a été stratège environ une fois tous les 5/6 ans, ce qui est le délai qui sépare effectivement ses deux premiers mandats : en 23 apr. J.-C. (quatorzième année auguste79), 29 (vingtième80), une quatrième et dernière fois en 40 (trente-et-unième année auguste et première année de Claude81).
Dès lors, on peut envisager de façon bien différente la date de certains événements que l’on croyait à peu près datés et qui servaient d’étais aux différentes reconstructions chro-nologiques qu’on a exposées plus haut :
– le stratège Pétraios en fonction lors de la 19e année auguste appartient au règne de Tibère (28/9 apr. J.-C.), il ne peut être identifié au magistrat brûlé par la foule
sous Auguste : on doit donc distinguer deux Pétraios. Le Pétraios du règne d’Auguste doit donc être celui dont seule la 2e stratégie – celle qui lui fut peut-être fatale ! – est attestée pour l’instant82 ;
– le stratège Sôsandros fils d’Aristonoos, en fonction lors de la 9e année auguste, appartient lui aussi au règne de Tibère (18/9 apr. J.-C.) : il est donc exclu qu’il soit le stratège sous lequel a été frappée l’émission du règne d’Auguste portant l’effigie de l’empereur régnant et la légende 83, que les numismates plaçaient l’année 23 av. J.-C., et considéraient comme la pre-mière émission monétaire fédérale de bronze d’époque impériale, avant celle du stratège Mégaloklès, frappée entre 4 et 14 apr. J.-C. Le lien entre ces monnaies et Sôsandros fils d’Aristonoos n’est pas à rejeter pour autant, mais il faut l’identifier non au Sôsandros au nominatif, comme le faisait Burrer, mais à celui
79. IG IX 2, 1296 (AEph 1923, p. 128, no 361).80. HELLY, Gonnoi II, no 116.81. IG IX 2, 544 (Larissa).82. Le nom de Pétraios est assez courant en Thessalie : il est attesté dans une des premières familles de
Métropolis, dans laquelle il alterne avec celui de Philoxénidès, mais aussi dans la famille de Thémistogénès de Gyrtôn (Pétraios fils de Thémistogénès de Gyrtôn, au milieu du Ier s. av. J.-C., IG IX 2, 534), dont on a vu plusieurs membres à la tête du koinon. Plus tard, un Hypatéen du nom de L. Cassius Pétraios sera un ami de Plutarque, mais, contrairement à la reconstitution proposée par BOWERSOCK, « Römischen Thessaliens », aucun élément ne vient attester de l’importance de cette famille dans les premiers temps de l’Empire.
83. Voir les références dans BURRER, Münzprägung, p. 53-55.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 453
BCH 132 (2008)
qui est au génitif qui est accompagné du monogramme AR, forme abrégée du patronyme de Sôsandros84 : Sôsandros fils d’Aristonoos n’est pas le stratège en fonction, mais simplement le magistrat monétaire. Le Sôsandros au nominatif peut être le stratège, mais la chose n’est pas assurée pour le monnayage d’époque impériale85 : il est certain cependant qu’il faut l’identifier au stratège qu’Auguste a lui-même placé à la tête de la confédération : Sôsandros . On retiendra en tout cas que les émissions des Sôsandros et Mégaloklès, émises du vivant d’Auguste, sont plus proches dans le temps que l’on pensait et que le koinon thessalien n’a pas frappé de monnaies de bronze avant une époque avan-cée dans le règne d’Auguste ;
– l’enregistrement des affranchis de Chyrétiai pour la 8e année auguste était consi-déré comme le plus ancien document attestant l’usage de l’adjectif dans les documents thessaliens, en la personne du trésorier Alexandros. Mais, puisque le stratège Ménékratès et la 8e année auguste doivent être placés en 17/8 apr. J.-C., l’émission monétaire de Mégaloklès (voir ci-dessus), qui porte au droit la légende et à laquelle l’année 4 apr. J.-C. sert de terminus post quem, constitue désormais la plus ancienne attestation con-nue de l’épithète
84. Le patronyme est rarissime dans les formules éponymiques en Thessalie : il sert le plus souvent à dis-tinguer deux homonymes contemporains. Tel est le cas sur les monnaies : Sôsandros fils d’Aristonoos est distingué d’un Sôsandros dont le patronyme n’a pas besoin d’être mentionné. L’explication qu’a donnée Fr. Burrer de ce monogramme (BURRER, Münzprägung, p. 59-60) m’est impénétrable. Si l’on reprend les monogrammes apparaissant sur les émissions d’époque impériale, on verra qu’au moins dans un second cas, il a fallu recourir à un patronyme : sur les émissions qu’on attribue à un stratège Lykoutas, sous le règne de Tibère, le nom est systématiquement accompagné d’un monogramme complexe, sous la forme d’un surmonté d’un , d’une lettre ronde qui peut être à la fois un luna-ire ou un , puis d’un . Il me semble que le nom Lykoutas, attesté nulle part ailleurs, est à rejeter au profit d’un plus simple Lykos : la légende monétaire serait donc , suivie du monogramme dans lequel je reconnais une partie des lettres formant le nom Aristophylos ; la famille larisséenne où les noms Lykos et Aristophylos alternent avec régularité est une des toutes premières de la cité. Cette hypothèse permet de ramener à une série identifiée l’émission portant la légende mentionnée par les auteurs du RPC II (1999), p. 19-20. Les autres monogrammes restent à identifier.
85. Sur le monnayage hellénistique, ce n’est pas le nom du stratège en exercice qui est mentionné, à l’exception de quelques cas aussi rares qu’ils sont explicites ; les noms des deux ou trois personnages gravés sur les coins devaient être ceux de « magistrats peut-être, mais d’une magistrature à laquelle la contribution personnelle donnait un fort caractère de liturgie ou d’évergésie » : B. HELLY, « Les émis-sions monétaires de la confédération thessalienne (IIe/Ier s. av. J.-C.) », dans G. DEPEYROT, T. HACKENS, G. MOUCHARTE (éds), Rythmes de la production monétaire (1987), p. 39-53, citation p. 53. Pour l’époque impériale, les monnaies mentionnent explicitement le stratège fédéral à partir de la fin du règne d’Auguste : c’est le cas de l’émission , frappée entre 4 et 14 apr. J.-C. puisqu’elle porte au droit le portrait de Tibère sans la qualification d’Auguste, donc avant son avène-ment, mais à un moment où il est associé à l’Empire. L’hypothèse avancée par les auteurs du RPC qui font du nom au génitif un patronyme du nom au nominatif n’est pas à retenir.
454 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
Fig. 4. — Déclarations d'affranchissements d'Atrax, sous le stratège Xénodokos et l'année suivante (I. Atrax 37) (cliché Chr. Wolters).
Fig. 3. — Déclarations d'affranchissements de Dolichè, l'année qui suit le stratège Xénodokos (AEph 1923, no 381) (cliché Chr. Wolters, Estampage, archives IG Berlin).
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 455
BCH 132 (2008)
La nouvelle chronologie permet de montrer que les Thessaliens n’ont obtenu le droit de frapper monnaie de bronze que dans les dernières années du règne d’Auguste et que ce n’est qu’à une date voisine qu’ils se sont désignés comme , tous événements voisins de l’adoption de l’ère auguste. On peut même tirer de deux documents la preuve que, dans les premiers temps, ce même adjectif servait à désigner l’ère thessalienne.
Le premier de ces textes, très mutilé, provient de Dolichè de Perrhébie86. L’intitulé de cette déclaration d’affranchi porte les lettres (fig. 3) :
La quatrième ligne introduisant la mention des trésoriers semestriels dont on a les noms par la suite ( etc.), tout ce qui précède désigne le stratège éponyme.
Le second document provient d’Atrax et sa lecture n’est pas non plus sans offrir quelques difficultés. Cette déclaration d’affranchis est gravée sur un bloc incomplet dans sa partie droite, à la suite d’un texte de même nature daté du stratège Xénodokos (fig. 4)87. Elle se présente comme suit :
.
La ligne suivante commence par le nom du trésorier. Si l’on compare les deux textes, on peut en faire progresser la compréhension. De fait, ces deux intitulés inhabituels rendent avant tout compte d’une situation politique exceptionnelle : une année d’anarchie. La préposition présente dans le texte d’Atrax offre une explication à la forme d’accu-
86. A. S. ARVANITOPOULOS, AEph 1923, no 381, p. 148-150. Je republierai cette inscription en entier dans le corpus des inscriptions de la Tripolis de Perrhébie, fruit de la collaboration entre l’équipe de Lyon et d’Ath. Tziafalias, ancien éphore de Larissa.
87. L’inscription est reprise dans I. Atrax 37, l. 11-15. Le texte a été présenté par M. ZACHOU-KONTOYIANNI, « Manumissions from Atrax », dans Inscriptions and History of Thessaly. New Evidence. Proceedings of the International Symposium in Honor of Professor Christian Habicht (2006), p. 103-111 et pl. 14 et 15. Il existe entre nos deux lectures certaines divergences, qui concernent notamment le présent propos : le numéro de l’année auguste, qu’elle lit , alors que je ne distingue aucune lettre et que sa lecture est impossible ; la séquence de lettres qui suit le mot , qu’elle lit et qu’elle interprète comme le début du nom du stratège, [ ], alors que je lis clairement . Sur sa lecture de la forme verbale , voir le commentaire plus bas : pour ma part, je ne vois aucune trace du N d’ .
456 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
satif que porte le mot dans le texte de Dolichè : l’année y est désignée comme celle qui suit l’année du stratège Xénodokos, [ ] [- - ]
[ ]88, donnant à penser que le magistrat éponyme de l’année courante n’a pu être désigné. Il ne fait dès lors pas de doute que l’intitulé d’Atrax fait référence à la même année de trouble politique – à moins de supposer deux années d’anarchie dans les 6 premières années de l’ère auguste – et présente une forme de parfait indicatif du verbe
( ), ou d’un de ses composés, qui explique le nominatif : l’année est celle pour laquelle il s’est passé quelque chose dans le choix du stratège après le mandat de Xénodokos. Manque une conjonction ou un pronom relatif subordonnant cette proposition au génitif absolu : peut-être est-il possible89. Malgré les incerti-tudes dans la reconstruction de cette phrase, il me semble acquis que, l’année qui a suivi le mandat de Xénodokos, dans les toutes premières années de l’ère auguste, la stratégie est restée vacante.
Surtout, les deux textes se rapportent à l’ère auguste. L’un et l’autre présentent une formule ayant recours à une ère ( ), mais il n’y a pas lieu de corriger, dans le document d’Atrax, l’adjectif en : cette forme est présente deux fois. On doit en conclure que l’ère « auguste » s’est appelée au moins en deux cités différentes
, ère « augustéenne ». Le quantième du comput de ces deux inscriptions n’est pas conservé : on peut donc hésiter sur la période et la fréquence d’utilisation de cette autre forme adjectivée dérivée du titre de Augustus-Sebastos. Toutes les inscriptions posté-
88. Voir, par exemple, pour Athènes, la liste gravée à Delphes des participants à la Dodécaïde : (FD III 2, 66, l. 11-13 ; fin du Ier s. apr. J.-C) ; ou les trois années d’anarchie
du règne de Marc Aurèle : (IG II2 1776 ; 169/70 apr. J.-C.) ; (sic) (IG II2 1739 ; 171/2 apr. J.-C.). Le terme technique
est (Athènes IG II2 1713) ou ( (Téos, CIG 3064 : ).89. On restera prudent, car ce que l’on peut distinguer de la lettre qui précède le ne pousse pas vraiment
à y reconnaître un ?). En revanche, il n’y pas de place pour la restitution proposée par M. Zachou-Kontoyianni : [ ]. Pour un exemple de la conjonction dans un formulaire de datation :
etc. (Arbitrage entre Messéniens et Lacédémoniens, W. DITTENBERGER, K. PUGOLD, Die Inschriften von Olympia (1896), 52 ; 138 av. J.-C.). Pour ce qui est du verbe, [ ] , me semble impossible. J’avais un temps pensé à [ ] , mais la mention d’une procédure d’anthairèsis, de remplacement d’un magistrat, ne s’expliquerait que dans le cas où le reste de l’intitulé comporte le nom du nouveau magistrat, ce qui ne semble pas être le cas. Cependant, contrairement à M. Zachou-Kontoyianni, je ne vois aucune trace du N d’ . Si l’on retient ce dernier verbe, on peut proposer
[ ?] [ ] [ ]. La formule est peu habituelle et l’on peut se demander si elle signifie une simple incapacité à désigner l’éponyme ou si elle cache un bien plus grand mystère. Le verbe suivi d’un abstrait est utilisé pour signifier l’abolition d’un régime politique (voir Xénophon, Cyropédie I, I, I : ), mais n’est pas
. Reste aussi en suspension la construction attributive : l’absence d’article devant le nomi-natif n’est pas sans poser problème. Si l’on revient au simple , il faut supposer qu’un sujet tel était rejeté à la fin de ce membre de phrase. Je préfère ne pas me prononcer.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 457
BCH 132 (2008)
rieures à la 6e année auguste90 mentionnent, comme en Macédoine, un 91. Il est donc légitime de supposer que l’appellation est antérieure à l’appel-lation , dont elle n’est pas une variante mais une forme d’origine et qui l’aurait remplacée entre la 2e et la 6e année. Ainsi, les deux inscriptions appartiennent à cette même période comprise entre 10/1 et 15/6 apr. J.-C.92.
On ne peut décider avec fermeté si l’épithète a d’abord servi à désigner les Thessaliens ou bien l’ère qu’ils utilisaient ou même si les deux usages sont strictement contemporains. En tout cas, l’adjectif affirmait un lien extrêmement fort avec Auguste, bien que sa formation pose problème. Il semble dérivé de la forme qui sert d’épi-thète honorifique pour des cités qui en ont eu l’autorisation. Si l’on est certain que les Thessaliens dans leur ensemble et des Thessaliens en particulier ont porté ce titre, nous n’avons aucune attestation d’une Thessalie .
L’ère auguste thessalienne commence en 10/1 apr. J.-C. ; elle est donc postérieure d’un quart de siècle à la stratégie assumée par l’empereur et n’est donc aucunement liée à celle-ci, pas plus qu’avec la décision des Thessaliens d’utiliser le denier comme monnaie de compte, événement qu’il faut placer à une date plus haute encore dans le règne d’Auguste. En revanche, elle est quasi contemporaine de la reprise des émissions monétaires fédérales, interrompue pendant trente ans au moins. Au contraire, l’ère auguste thessalienne a été mise en place peu avant la mort du premier empereur et a été essentiellement utilisée sous les règnes de Tibère et de Claude, pendant un demi-siècle au moins. Ce n’est que par le hasard des découvertes que l’ère auguste cesse d’être attestée entre la 20e année et la 30e et 1e année de Claude : on peut donc s’attendre à ce que les Thessaliens aient utilisé une ère de Caligula, de même qu’on verra plus loin qu’il a pu exister une ère de Néron, peut-être encore une de Vespasien93. Les documents de la deuxième moitié du Ier siècle apr. J.-C. sont
90. Le texte de Chyrétiai IG IX 2, 349c (AEph 1917, p. 118, no 331), daté de la 7e année auguste, année de la stratégie d’Hipparchos, constitue l’attestation de l’ère la plus ancienne entièrement conservée. L’adjectif est en partie restitué dans le texte de Larissa, ZACHOU-KONTOYIANNI, « », daté de la 4e année.
91. Dans l’inscription de Larissa datée de la 4e année auguste et de la 2e stratégie de Timasithéos, l’adjectif n’est pas conservé : pour les références bibliographiques, on se reportera au tableau ci-dessus (tabl. 1).
92. Dans le monde thessalien, on peut se demander si cette épithète ne s’explique pas plutôt comme une forme d’adjectif en -*yo-, couramment utilisé pour exprimer la patronymie, le nom du mari, l’année de mandant officiel, jusque tard dans le Ier s. av. J.-C. dans certains documents (je remercie L. Darmezin de cette suggestion). La forme en – pourrait s’expliquer par une graphie de substitu-tion, due à un iotacisme prononcé, comme on en trouve dans des inscriptions de basse époque hellénistique (voir le célèbre règlement de consultation de l’oracle d’Apollon Coropaios, IG IX 2, 1109, vers 100 av. J.-C., où la graphie alterne avec la graphie . Le fait ne me semble cependant pas assuré, dans la mesure où la graphie la plus correcte, , n’apparaît nulle part.
458 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
peu nombreux, au contraire de ceux du IIe siècle. Ces derniers ne font jamais référence à l’ère auguste : on estimera donc que son usage a disparu à un moment quelconque dans la seconde moitié du siècle où elle a été adoptée94. En revanche, l’équivalence entre les années de règne et les années civiles thessaliennes est encore attestée, de manière exceptionnelle il est vrai, sous Trajan et Hadrien95.
Une question demeure : pourquoi les Thessaliens ont-ils adopté ce nouveau comput ?
5. POURQUOI L’ÈRE AUGUSTE ?
L’ère thessalienne fait-elle référence à un événement de l’histoire locale ou bien s’inscrit-elle dans une histoire plus large ? Rend-elle compte d’une évolution du statut de la Thessalie dans l’imperium Romanum ou commémore-t-elle un événement de portée générale ? Si l’on s’en remet à la typologie de Leschhorn, une ère peut trouver son origine dans un événement local, dans l’octroi de la liberté ou, au contraire, comme signe de l’intégration à une province et donc de la fin d’un régime favorable96.
Sa dénomination d’ère « auguste », sur le modèle macédonien, l’a fait passer pour une ère d’Actium, mais son nom d’origine ( ), proprement thessalien, invite à déceler derrière son adoption une raison de portée locale. Mais que célébrait-on ? Un privilège nouveau accordé par le pouvoir ou un placement sous sa tutelle ?
On vient de voir que le contexte d’adoption de l’ère auguste par la Thessalie n’est pas celui de la répartition du pouvoir entre le Sénat et le tout récent vainqueur d’Actium, mais celui de la transmission du pouvoir du premier empereur vieillissant, visant à établir une continuité dynastique. De son côté, une partie de la population des cités grecques a pris acte de la stabilité du nouveau régime et a compris qu’il fallait négocier en permanence avec le pouvoir impérial chaque privilège, la liberté ou le droit de frapper monnaie notamment.
93. Voir les paragraphes d’annexe au présent article.94. Pour de possibles attestations de l’ère auguste sous Néron et Vespasien, voir l’annexe au présent article. 95. Pour Trajan, déclaration d’affranchissement de Xyniai (voir l’annexe à ce présent article), datée par le
stratège Alexandros lors la 16e année de Trajan, c’est-à-dire 112/3, puisque Trajan devint empereur en janvier 98, et liste d’affranchis de Larissa IG IX 2, 538, d’une année de règne de l’empereur non con-servée, pas plus que le nom du stratège, mais postérieure à 114, puisque Trajan est Parthicus. Pour Hadrien, liste de Larissa IG IX 2, 546, sous le stratège Cocceius Lykos, lors de la 15e année de l’empereur, qui doit correspondre à l’année 132/3, dans la mesure où le dies comitialis d’Hadrien, sans doute le 17 août 117, fut très proche du début de l’année thessalienne 117/8. Il n’est pas impossible cependant que les quelques jours qui ont pu séparer l’avènement d’Hadrien du début de l’année offi-cielle aient été considérés comme une première année pour ce règne (Cocceius Lykos aurait alors été stratège en 131/2) : il reste trop d’incertitudes sur le calendrier des Thessaliens pour trancher. Mes prédécesseurs (Kramolisch, Helly, Zachou-Kontoyanni) considèrent la mention de l’année de règne de l’empereur comme une équivalence dans le comput romain, dépendant du calcul des puissances tribunitiennes et du dies imperii.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 459
BCH 132 (2008)
La personnalité de deux Thessaliens responsables des premières émissions fédérales dans le nouveau système monétaire local n’est peut-être pas anodine. On a vu plus haut que les toutes premières monnaies de bronze portaient les noms de Mégaloklès et de deux Sôsandros, dont l’un était fils d’Aristonoos. Quoique d’apparence banale, le nom Sôsandros est rarement attesté en Thessalie, sinon dans les cités de la zone Sud, plus récemment intégrée à la confédération. Sôsandros fils d’Aristonoos est originaire d’Hypata : un de ses aïeux Aristonoos fils de Sôsandros fut honoré à Delphes dans les toutes premières années du Ier siècle av. J.-C.97. Le second Sôsandros est aussi originaire de la capitale de l’ancienne Ainide et appartient à une famille où ce nom alterne avec celui de Pleistarchos : si le personnage le plus connu est un Sôsandros fils de Pleistarchos, agonothète des Pythia et épimélète des Amphictions sous Trajan ou Hadrien98, dès 18 apr. J.-C., un Pleistarchos fils de Sôsandros est l’hôte de Germanicus, à l’occasion du voyage en Orient du corégent99, l’année précisément où l’autre Sôsandros, le fils d’Aristonoos, est stratège fédéral. Pleistarchos fils de Sôsandros revêt cette même fonction dans les dernières années du règne de Tibère100. Je crois donc que le stratège désigné par Auguste, est le père de Pleistarchos.
Rappelons par ailleurs que c’est sur les monnaies qu’apparaît pour la première fois, dans l’état de notre documentation, l’épithète , et que Pleistarchos, le fils du stratège désigné par Auguste, est un des premiers particuliers à être désigné comme
en plus de son ethnique propre101. L’usage de cette épithète paraît semblable à celui du terme que l’on trouve ailleurs dans le monde romain et dont les attes-tations les plus anciennes remontent au règne d’Auguste, mais qui semble avoir été forgée
96. LESCHHORN, Antike Ären, p. 418-420.97. FD III 4, 56 et 57, le texte du décret ayant été gravé à deux reprises, au vu des innombrables erreurs du
premier lapicide. Le texte, daté par l’archonte Hèrys, est placé dans le premier tiers du Ier s. av. J.-C. : Aristonoos devrait donc être l’arrière-grand-père de Sôsandros.
98. FD III 4, 63 et Cl. VATIN, BCH 94 (1970), p. 690-691.99. IG IX 2, 41 :
. On ne peut faire de xénos un simple titre honorifique accordé par Hypata à Germanicus (position de Fr. HURLET, Les collègues du Prince sous Auguste et Tibère [1997], p. 508) : c’est oublier que la dédicace est le fait non de la cité, mais d’un particulier. Germanicus est vraisemblablement passé par le Sud de la Thessalie, alors qu’il était en route vers Mytilène. L’itinéraire est décrit par Tacite, Annales II 53-54 : après son séjour à Nicopolis pendant l’hiver 17/8, Germanicus remonte le golfe de Corinthe, est accueilli avec pompe à Athènes, puis gagne Lesbos, « petita inde Euboea, tramisit Lesbum ». Il préfère à l’itinéraire des Cyclades emprunter le canal de l’Eubée, celui d’Oréos, pour rejoindre les Sporades puis Lesbos. Il est tout à fait plausible qu’il ait marqué un arrêt dans le golfe Maliaque.
100. Inscription inédite de Dolichè, que ses inventeurs, L. Dériziotis et S. Kouyioumtsoglou, m’ont auto-risé à mentionner : qu’ils en soient remerciés.
101. IG IX 2, 41 : voir ci-dessus. Notons qu’à aucun moment le monnayage thessalien ne porte mention de l’ère auguste, alors qu’il est certain que plusieurs émissions ont été frappées pendant la période où elle est en usage.
460 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
pour les rois des États-clients mis en place ou confirmés par Auguste102. Sôsandros et sa famille font donc partie de ces notables qui ont acquis une visibilité en s’appuyant sur une collaboration avec le pouvoir romain. Que la famille soit originaire d’Hypata n’offre rien d’étonnant : la vocation romanophile de la cité est connue de longue date103. On ne sait pas pour autant si ce lien personnel que la famille entretient avec les autorités romaines et la famille impériale a été tissé sous Auguste à l’occasion de l’intervention impériale ou bien avant, ce qui expliquerait le choix fait par l’empereur de prendre parti dans un débat thes-salien et de s’appuyer sur Sôsandros.
En tout cas, ces notables, manifestement à l’aise dans le nouveau système clientéliste soutenu par le pouvoir, ont pu amener la communauté des Thessaliens à prendre part à cette relation pour en tirer des avantages. L’adoption d’une ère auguste pourrait avoir été une forme de contrepartie à l’octroi d’un de ces bienfaits impériaux, privilège fiscal, liberté recouvrée, droit de frapper monnaie, sans qu’on sache précisément de quel événement il s’agit : les Thessaliens acceptaient de se mettre symboliquement sous la protection person-nelle de l’empereur en devenant des , comme d’autres exprimaient leur loyauté en se désignant comme 104. C’est là un scénario exprimant une vision opti-miste des événements.
Mais, au contraire, l’ère auguste pourrait tout aussi bien être une conséquence d’une reprise en main par le pouvoir impérial d’une Thessalie en proie aux troubles et faire partie des « ères d’intégration à une province » définies par W. Leschhorn105 ?
Ce scénario moins optimiste ne trouve aucune contradiction dans le fait que les docu-ments officiels du koinon affirment avant tout le lien avec un pouvoir qui avait restreint les
102. Voir J.-L. FERRARY, « Le roi Archélaos de Cappadoce à Délos », CRAI 2001, p. 799-815. En Grèce continentale, le cas le plus ancien que je connaisse est celui de Théoklès de Nicopolis, épimélète des Amphictions à Delphes au début du règne de Tibère : voir n. 42 pour les références.
103. Les liens entre Rome et l’Ainide sont remarquables. Le décret pour Aristonoos fils de Sôsandros a été gravé sur le pilier de Paul Émile, lieu d’affichage régulier pour des décrets honorant des Romains. Dans une démonstration emportant la conviction, Fr. de Callataÿ a établi qu’Hypata, la capitale de la con-fédération des Ainianes avait été le lieu de frappe d’une partie du monnayage d’argent ayant servi à financer les mercenaires qui appuyaient Sulla lors de la 1re Guerre mithridatique (« Le monnayage d’argent au type d’Athéna Parthénos émis au nom des Ainianes »,
7 [2004], p. 125-156 ; sur l’importance des années 88-85 dans l’histoire générale de la Thessalie, je renvoie à mon article « Les porteurs de toge de Larisa », Topoi 15 [2007], p. 251-284). On ajoutera à cela le groupe statuaire associant Auguste aux jeunes Lucius et Caius, prétendants à la succession, érigé par la cité d’Hypata (IG IX 2, 40).
104. Ce lien entre loyauté envers le pouvoir et privilège est particulièrement clair dans le cas d’Aphrodisias de Carie qui, sous Domitien, se désigne comme
: I.Ephesos 233 = J. REYNOLDS, Aphrodisias and Rome, Journal of Roman Studies. Monographs 1 (1982), no 242 : voir le commentaire que fait de cette inscrip-tion A. HELLER, Les bêtises des grecs : conflits et rivalités entre cités d’Asie et de Bithynie à l’époque romaine (129 av. J.-C. / 235 apr. J.-C.) (2006), p. 245-254.
105. LESCHHORN, Antike Ären, p. 418-420.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 461
BCH 132 (2008)
prérogatives et les libertés de celui-ci : les Thessaliens soumis au pouvoir romain se disent Sebastèoi, les Augustéens, tout comme les Augustales sont des affranchis impériaux ou tout comme la Lycie, agrégée à la Pamphylie, et devenue une province en 43, à la suite d’émeutes visant des Romains, s’affirme 106.
D’ailleurs, contrairement à ce qu’on a pu écrire jusque-là, il n’y a aucune impossibilité chronologique à ce que les émeutes qui ont coûté la vie à Pétraios aient entraîné l’inter-vention d’Auguste dans le choix du stratège et la fin de la liberté des Thessaliens.
Seule la série des déclarations d’affranchis de Gonnoi qu’on a sommairement évoquée ci-dessus107 fait peut-être référence au Pétraios que la foule thessalienne a brûlé. Sur la même face est gravée, au-dessus de la déclaration datée par la 2e stratégie de Pétraios, un affranchissement daté du stratège Sôsandros « sur décision de César ». J’ai rappelé que G. Bowersock avait supposé qu’il pouvait y avoir un lien entre la mésaventure de Pétraios et le jugement d’Auguste, mais que cette hypothèse était infirmée par l’ordre de gravure des documents. En se reportant à la figure ici présentée (fig. 5), on se rendra compte qu’on peut sérieusement remettre en cause l’interprétation qu’on a faite de la chronologie de leur
106. Monument de Patara, Base de Claude, 46 apr. J.-C. (S. SAHIN, Lykia 1 [1994 ], p. 130-
137 [SEG 44 [1994], 1205, l. 13-20] ; C. P. JONES, ZPE 137 [2001], p. 161-168 [AE 2001, 1931] ; J. THORNTON, « Gli Aristoi, l’akriton plethos e la provincializzazione della Licia nel monumento di Patara », MediterrAnt 4 [2001], p. 424-446).
107. IG IX 2, 1042 (fig. 2).
Fig. 5. — Déclarations d'affranchissements de Gonnoi (IG IX 2, 1042, détail) (cliché de l'auteur).
462 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
gravure : le texte de la déclaration qui a été faite sous le stratège choisi par Auguste remplit maladroitement, mais entièrement un espace laissé vacant au-dessus de celle qui a été faite lors de la 2e stratégie de Pétraios, au prix de quelques chevauchements de lignes et de lettres. La deuxième stratégie de Pétraios est donc antérieure à l’intervention impériale. Rien n’empêche plus de supposer entre les deux événements un lien de cause à effet. Cette hypothèse n’est pas encore avérée, les stratégies de Pétraios et de Sôsandros n’étant pas nécessairement consécutives : elle a le mérite cependant de placer tous les éléments dans un cadre connu par ailleurs, liant émeutes locales et réduction au rang de province.
Cependant, on peut douter que des émeutes tournées contre un magistrat local et non le pouvoir impérial ou des citoyens romains aient pu avoir pour conséquence la privation de liberté108.
Je ne choisirai pas entre ces deux modèles donnant une explication à l’ère auguste de Thessalie, d’autant qu’ils proposent une vision univoque de la situation. L’alternance, sous le règne d’Auguste, de moments où la Thessalie était en position favorable avec des moments où elle se trouvait dans une situation plus délicate, peut aussi être le signe de l’existence de factions s’affrontant au sein de l’État thessalien : d’un côté, un parti pragma-tique sinon essentiellement pro-Romains, préfigurant l’homme politique avisé des Préceptes politiques de Plutarque, recrutant peut-être dans les régions récemment intégrées à la Thessalie, comme l’Ainide ; de l’autre des Larisséens, peu enclins à le céder en rien au pouvoir impérial, suivant une tradition qu’ils avaient déjà exprimée en prenant parti pour Pompée contre César ? Cette lecture politique de la situation, liée à l’histoire même de la constitution de l’État thessalien, ne manque pas d’intérêt, mais la documentation ne permet guère d’aller plus loin pour l’instant.
CONCLUSION
Comme partout dans la partie hellénophone de l’Empire, la Thessalie, jouissant de la liberté et de l’autonomie depuis Pharsale, a fini par adopter le denier comme monnaie de compte, sans doute dans les années 30-20 av. J.-C., décennie pendant laquelle,
108. On se reportera à G. W. BOWERSOCK, « The Mechanics of Subversion », dans Opposition et Résistances à l’Empire d’Auguste à Trajan, Entretiens sur l’Antiquité classique 33 (1987), p. 291-317, ainsi qu’à M. C. HOFF, « Civil Disobedience and Unrest in Augustan Athens », AJPh 58 (1989), p. 267-276, pour le cas d’Athènes, mais surtout à la synthèse récente de C. BRÉLAZ, La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (2006), p. 56-68 (« émeutes et révoltes à l’intérieur des cités »), qui rappelle que les exemples connus de suppression du privilège de liberté concernent des États (Rhodes, le koinon lycien) où des citoyens romains avaient été mis à mort, ce qui était considéré par le pouvoir impérial comme une sédition. Rome avait recours à une « riposte graduée » face aux émeutes, essentiellement liées aux questions d’approvisionnement, depuis la persuasion et le dialogue, l’appui sur les notables locaux, jusqu’à l’intervention administrative ou militaire, par la présence effective des cohortes, l’interdiction temporaire des magistratures ou la privation de la liberté ou de l’exemption fiscale.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 463
BCH 132 (2008)
devant l’empereur et défendue par le jeune Tibère, elle a dû répondre d’un chef d’accusation inconnu de nous. Un peu avant ou un peu après, Auguste a accepté de devenir stratège éponyme de la confédération thessalienne : l’événement est peut-être à mettre en relation avec la présence d’Agrippa dans les années 17-13 av. J.-C., qui a eu un retentissement suffisamment important pour que des particuliers, suivant sans doute une décision collective, peut-être fédérale, dressent des autels aux deux princes de l’Empire sous les épithètes Sôter et Theos. Une quinzaine ou une vingtaine d’années plus tard, le koinon a obtenu l’autorisation d’émettre des monnaies de bronze. Deux séries inaugurent ce monnayage assez remarquablement abondant pour l’époque : l’une peut-être placée entre 4 et 14 apr. J.-C., à une époque où Tibère est déjà associé au trône ; l’autre est très proche dans le temps, mais peut-être un peu postérieure. Les relations avec Rome sont alors excellentes et les Thessaliens obtiennent même le droit de se désigner par une épithète dérivée du nom du Prince : 109. Peut-être ont-ils alors adopté une ère qualifiée par le même adjectif en 10/1 apr. J.-C.
Mais ces dernières années du règne d’Auguste sont aussi troublées : Pétraios, dont on peut supposer qu’il est le stratège en exercice, est brûlé vif par la foule : réactions violentes d’un peuple soumis à la disette ou luttes entre factions au sein du synedrion ? Cet événement tragique a pu avoir coûté leur liberté aux Thessaliens. On ne sait si cela explique l’intervention de l’empereur dans le choix d’un stratège manifestement favor-able à Rome et l’usage, à partir de 10/1 apr. J.-C., d’une ère locale qui commémore peut-être la soumission de la confédération à un gouverneur ? La punition des Thessaliens a-t-elle compris la perte de ses voix à l’Amphictionie, au bénéfice de Nicopolis, à l’occasion d’une réforme de la prestigieuse institution où fut mis en place un commissaire désigné pour chapeauter pendant quatre années les délégués des cités, l’épimélète des Amphictions ?
Une grande partie de ce scénario repose sur des hypothèses que de nouveaux docu-ments permettront de confirmer ou non. Il s’appuie cependant sur quelques acquis : la date absolue de l’ère auguste ; l’absence de lien entre celle-ci et la stratégie de l’empereur, entre le procès où Tibère défendit les Thessaliens et le lynchage de Pétraios ou le choix du stratège thessalien par Auguste ; la date des premières émissions monétaires, dans les premières années de notre ère.
La Thessalie offre ainsi un exemple de la complexité des relations entre les cités grecques et le nouveau pouvoir impérial, à un moment où l’on sait que Rome ne craint rien tant que les troubles dans ses provinces, alors que les Grecs expérimentent à petits pas quelle est, dans la réalité, leur champ d’action.
109. Je complèterai bientôt ce tableau de la Thessalie sous Auguste par des réflexions liées aux débuts du culte impérial.
464 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
ANNEXE : DERNIÈRES ATTESTATIONS DE L’ÈRE AUGUSTE : XYNIAI ET HYPATA
Je reprends ici deux documents dans lesquels je reconnais deux attestations nouvelles de l’ère auguste : leur présentation dans le corps du texte aurait nui, je crois, à une démon-stration déjà suffisamment dense.
UNE BASE DE NÉRON À XYNIAI ?
La cité de Xyniai est mal connue, bien que le lac, à présent asséché, que surplombe son acropole ait connu une certaine célébrité dans l’Antiquité110. L’ethnique est selon Stéphane de Byzance, mais pour l’heure, seule la forme semble attestée par les inscriptions111. Les vestiges n’ont fait l’objet que d’un nettoyage rapide par l’éphore N. Giannopoulos dans les années 1920, en conséquence d’une fouille clandes-tine. Le bloc qui porte les seules inscriptions connues de la cité antique est entré au musée d’Halmyros en 1928 sous le no d’inventaire 208 : après la publication des textes dans le Deltion, N. Giannopoulos a fait parvenir un estampage de la pierre à l’Académie de Berlin112.
Le premier éditeur n’a pas reconnu que les documents gravés n’étaient pas unique-ment des affranchissements. Son attention s’est en effet portée sur la face qu’il consid-érait comme la plus importante de ce couronnement de base, sur laquelle est gravée une déclaration d’affranchissement de l’époque de Trajan (fig. 6).
]
?
110. Références chez Fr. STÄHLIN, Die hellenische Thessalien (1924), p. 160 et n. 4. On se reportera aux résultats du survey de la haute Achaïe Phthiotide par une mission italienne : Fl. CANTARELLI et al., Acaia Ftiotide, I. Indagini geostoriche, storiografiche, topografiche e archeologiche (2008), p. 101-103.
111. Litige entre Xyniai et la cité de Mélitaia en 214/3 av. J.-C. : Syll 3 546A = IG IX 2, add. No 205 IIIB, repris dans IG IX 12 1, 177 et dans A. MAGNETTO, Gli arbitrati interstatali (1997), no 54 . La pierre est perdue et l’ethnique en partie restitué, mais les restes d’un en fin de mot excluent qu’il s’agisse d’une forme athématique en – , au datif en – .
112. N. GIANNOPOULOS, AD 1926, parart. no 12, p. 53-54. Je remercie chaleureusement Kl. Hallof de m’avoir permis de voir en 2005 l’estampage de Giannopoulos qui a été déposé à la Brandenburgische Akademie der Wissenschaften de Berlin.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 465
BCH 132 (2008)
Une relecture attentive permet de corriger les lignes 3 et 4, peu compréhensibles en l’état, en : le formulaire devient alors conforme à la série thessalienne des déclarations d’affranchis113.
Giannopoulos s’est contenté de publier le texte de l’autre face en majuscules, en intervertissant les lignes 1 et 2 :
.
Mais cette face porte en fait deux inscriptions distinctes (fig. 7) : la dédicace de la statue que le bloc supportait, suivie d’une déclaration d’affranchi qui occupe les trois dernières lignes et doit être lue comme suit :
113. La mention d’ alors qu’on attendrait des tages dans cette cité de la Thessalie impériale ne fait pas problème : le mot est employé ici pour sa valeur générique, le versement de la taxe a été fait « aux autorités mêmes de la cité ».
Fig. 6. — Xyniai : déclaration d'affranchissements sous le stratège Alexandros (AD 1926, parart. no 12, côté gauche, ex face A) (cliché Chr. Wolters).
466 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
]]
]114.
Le stratège Laouchos est mentionné sur une émission monétaire fédérale du règne de Néron, frappée après 63 apr. J.-C., car elle porte au droit le buste de l’empereur du type de la maturité. La légende lie vraisemblablement cette émission aux victoires de Corbulon sur les Parthes et la fermeture des portes du temple de
114. Il conviendrait de décrire la pierre ainsi : bloc parallélépipédique en poros légèrement jaune supporté par une pyramide tronquée inversée, gravé sur deux faces ; il ne reste qu’un tiers gauche de la face antérieure, tandis que le côté gauche est entièrement conservé. Il s’agit du couronnement d’une base. Dimensions : 28 x 30 x 68 cm. Hauteur des lettres des inscriptions de la face antérieure : 2,1 à 2,5 (dédicace) ; 1,5 à 2,1 (affranchissement, sauf dernière ligne = 3). Archives thessaliennes = GHW05055B + estampage TH1986 et 3351 ; photographie. Ce que Giannopoulos a pris pour un est en fait le monogramme des trois premières lettres du participe . Le premier O de est gravé à l’intérieur de l’A.
Fig. 7. — Xyniai : Base de statue de Néron et déclaration d'affranchissements sous le stratège Laouchos (AD 1926, parart. no 12, face antérieure, ex-face B) (cliché Chr. Wolters).
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 467
BCH 132 (2008)
Janus115. L’année 66 forme donc un terminus ante quem pour le premier texte de Xyniai, à moins que l’affranchissement gravé au-dessous ne soit daté d’une seconde stratégie de Laouchos, qui n’est pas attestée par ailleurs.
Pour la première inscription, qui intéresse plus directement notre propos, je lis :
que j’interprète comme le fragment d’une dédicace pour un empereur, fils d’un empere-ur divinisé116 : la cité de Xyniai emploie un formulaire au datif qu’on peut retrouver en Thessalie dans les séries d’autels pour Agrippa ou Auguste (voir supra), mais qui a aussi progressivement contaminé les dédicaces honorifiques, notamment dans le cadre du culte impérial, selon le modèle latin117.
[ ]-[ ]
[ ][ ]
On lit sans difficulté, à la ligne 4, un adjectif ordinal suivi d’une abréviation : et ne font qu’un, le se résumant à un trait horizontal à l’intérieur des barres
horizontales du . La ligne précédente commence par un nom propre au génitif, celui d’un magistrat, responsable de l’érection de la statue ou plus vraisemblablement éponyme formant une synchronie avec la mention de l’x-neuvième année d’une ère impériale, [ ] . S’agit-il de l’ère auguste ou d’un comput régnal ?
On doit éliminer les 9e, 19e et 29e années augustes dont les stratèges sont connus, et, par conséquent, la possibilité qu’il s’agisse d’une base de statue d’Auguste, de Tibère ou de Caligula. Par ailleurs, elle ne peut être celle de Claude, dont le père n’a pas été divinisé, ni celle de Vespasien ni d’un de ses fils (il est fort peu vraisemblable que l’éventuelle deuxième stratégie de Laouchos soit postérieure au règne de Domitien). C’est donc Néron qu’il faut reconnaître dans ce fragment de titulature, le fils adoptif de
115. La série est présentée dans BURRER, Münzprägung, p. 152-166 et p. 38-39, ainsi que par RPC I, p. 283 et RPC II, p. 19-20. P. Franke lui a consacré une étude, « », dans
(1992), p. 370-375.116. Je ne sais si la graphie H pour E dans rend compte d’un trait phonétique (fermeture de <e> en
<i> et graphie iotacisante ?) ou si elle est une simple erreur du lapicide. 117. P. VEYNE, « Les honneurs posthumes de Flavia Domitilla et les dédicaces grecques et latines », Latomus
21 (1962), p. 49-98.
468 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
Claude relatus ad deos. La date de la consécration serait alors la 49e année auguste (58/9 apr. J.-C.), la 59e (= 68/9) étant exclue puisqu’elle a commencé après le suicide de Néron et sa condamnation à l’oubli par le Sénat118. Il faut donc écrire :
[ ][ ]
[ ][ ]
La restitution proposée pour la ligne 3 comporte 28 lettres. La flexibilité des Grecs dans l’usage des titulatures impériales rend incertaine la restitution des deux premières lignes119. La seule mention du stratège suffirait à combler la lacune de la ligne précé-dente, qui comporterait ainsi 25 lettres120. L’hypothèse de l’existence d’un stratège Nikomachos peu avant 60 apr. J.-C., qui n’est pas connu par ailleurs, pourrait être appuyée par celle d’Ulpius Nikomachos aux alentours de 125 apr. J.-C.121 Les deux personnages, possiblement grand-père et petit-fils, appartiendraient à une même famille ayant obtenu la citoyenneté romaine sous Trajan. La fin de l’inscription comprendrait alors, apposée au nom de l’empereur, la raison pour laquelle la cité de Xyniai l’honorait : [ ], par exemple.
On peut cependant envisager aussi que l’inscription utilisait un double comput, par les années de règne de l’empereur et par les années augustes. Il devient, dans ce cas, dif-ficile d’évaluer la partie manquant à droite. Si les Thessaliens ont eu recours à un
vel sim, la 9e année correspondait à l’année 61/2 apr. et à la 52e année auguste. On aurait dans ce cas, par exemple :
[ ][ ]
118. Sur l’application de la damnatio du nom de Néron en Achaïe, voir Chr. HOËT-VAN CAUWENBERGHE, « Condamnation de la mémoire de Néron en Grèce : réalité ou mythe ? », dans Y. PERRIN (éd.) (supra, n. 51), p. 225-249, qui montre que les Grecs n’ont pas manifesté un zèle très grand pour appliquer la décision du Sénat contre celui qui leur avait accordé la liberté : comme dans d’autres cas, dont celui, fameux, de l’inscription d’Akraiphia IG VII 2173, le seul praenomen de Néron a pu être martelé, mais ses deux occurrences possibles dans le texte de Xyniai figuraient dans la partie perdue. La seule base de Néron connue pour la Thessalie est celle d’Atrax (I. Atrax, no 158), dont la dédicace n’a pas été martelée, mais dont on ignore quand elle a été brisée en deux.
119. Il n’est que de voir les exemples réunis par HELLY, BCH 1975, p. 120-122, pour l’ère de Claude, l’empereur y étant tantôt désigné comme (IG IX 2, 544),
(IG IX 2, 206) ou (IG IX 2, 13).120. La taille des lettres n’est pas très régulière : une graphie ramènerait la ligne 3 à 27,
tandis qu’une graphie ferait passer le nombre de lettres de la ligne 2 à 26. 121. Le stratège Ulpius Nikomachos est connu par des affranchissements d’une cité inconnue (HELLY, BCH
1975, no 2 C), ainsi que par un monnayage du règne d’Hadrien : voir BURRER, Münzprägung, p. 183-190.
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 469
BCH 132 (2008)
[ ] 4 [ vacat ? ]122.
Si on accepte cette restitution, la base thessalienne se placerait dans une série de consécrations en l’honneur du prince citharède, cette même année 62/1123. Je ne sais si cela forme un argument en faveur de cette solution, dans la mesure où j’avoue ignorer ce qui peut expliquer une série d’honneurs.
122. Cette seconde hypothèse entraîne des restitutions plus longues d’une dizaine de lettres que la première, la partie conservée de la face correspondrait au quart de celle-ci, et non plus au tiers : dans le premier cas, la largeur initiale de la base serait de 1 m à 1,10 m, dans le second, de 80 à 90 cm.
123. Base de l’Aréopage, du Conseil et du peuple d’Athènes, datée par le stratège des hoplites Tiberius Claudius Nouios pour la 8e fois :
IG II2 3277 [=SEG 32, 251]) ; Base de Thessalonique, datée par l’ère auguste et l’ère de la province de Macédoine : [[ ]] [ ] [ ] (IG X 2, 1, 130). Faut-il attribuer à cette même série la statue d’Atrax mentionnée plus haut ?
Fig. 8. — Liste d'affranchis d'Hypata (IG IX 2, 14) (cliché de l'auteur).
470 Richard BOUCHON
BCH 132 (2008)
UNE LISTE D’AFFRANCHIS À HYPATA SOUS VESPASIEN ?
Je clorai ce travail par une mise au point sur une liste d’affranchis d’Hypata du Ier siècle apr. J.-C., IG IX 2, 14, gravée sur plusieurs blocs d’une exèdre dont un seul est conservé. Je ne reproduis ici que l’en-tête du document (fig. 8).
vacat
Suit alors immédiatement le premier nom d’affranchi. L’adjectif ordinal, au masculin ou neutre singulier, clôt la séquence de datation. H. Kramolisch y a reconnu la mention de l’ère de Claude124 et admettait que Méné– avait exercé sa stratégie lors la 13e année de règne de cet empereur. Mais en fin d’en-tête, on attend plutôt la mention de l’ère auguste.
Les précédents éditeurs interprétaient les lettres de la première ligne comme une partie du nom Epimélèa variante graphique d’Epimeleia. Il faut plutôt reconnaître la mention du magistrat chargé de récupérer la taxe de la main des affranchis. En effet, à Hypata, dans la seconde moitié du Ier siècle apr. J.-C., ce magistrat n’est plus un trésorier, mais un , fonction pluriannuelle dont le terminus post quem est formé par la liste d’affranchis datée de la 37e année auguste125. On restitu-era donc plus volontiers, sur le modèle d’IG IX 2, 13 et 17 :
[ ] [ ] [ ],
et l’on datera cette inscription d’après 47 apr. J.-C. L’année auguste ici utilisée est par conséquent la 43e (52/3), la 53e (62/3), la 63e (72/3), etc.
Un document d’Atrax126 montre qu’un Ménékratès, dans la 2e moitié du Ier siècle apr. J.-C., a été stratège après la première stratégie de Kyllos. Ce dernier, ami de Plutarque et stratège à trois reprises, est un des Thessaliens les moins mal connus de cette période.
124. KRAMOLISCH, « Ära des Claudius », p. 375.125. Je renvoie à mon article « La taxe des affranchis et le financement de la vie publique dans les cités
thessaliennes : nouvelles lectures de documents du IIe s. apr. J.-C. », dans A. MAZARAKIS (éd.), Proceedings of the 2nd Archaeological Meeting of Thessaly and Central Greece (AETHSE), 2009, p. 376-390 (sous presse) : l’inscription datée par le stratège Méné– n’est pas prise en compte dans mes réflexions.
126. IG IX 2, 543 : la pierre était anciennement attribuée à Larissa, parce qu’elle a été découverte dans le village de Koilada, à 12 km au Sud-Ouest de Larissa, mais le formulaire et la prosopographie invitent à réviser cette attribution (voir I. Atrax, nos 42-43)
L'ÈRE AUGUSTE : ÉBAUCHE D'UNE HISTOIRE POLITIQUE DE LA THESSALIE SOUS AUGUSTE 471
BCH 132 (2008)
D’après une série de déclarations d’affranchis de Chyrétiai127, Kyllos fut en charge pour la première fois après Harmôn, qui fut lui-même stratège après Aristiôn128, éponyme sous Néron, après 63 apr. J.-C. Lors de sa troisième stratégie, il est encore désigné comme simple Kyllos tout comme en 91/2 apr. J.-C., quand, en tant qu’épimélète des Amphictions, il apparaît sur la base honorant le proconsul d’Achaïe Avidius Quietus : Domitien lui a donc octroyé la civitas Romana entre 92 et 96 sous le nom de T. Flavius Kyllos. On peut supposer avec B. Puech que son mandat à l’Amphictionie, entre 91 et 95, lui aura valu un tel honneur129. La carrière fédérale de Kyllos correspond donc aux années 65-95 et, par conséquent, la stratégie de Ménékratès, postérieure à 65, peut être placée en 72/3, c’est-à-dire sous le règne de Vespasien, et l’inscription d’Hypata fournirait par conséquent l’attestation la plus récente de l’ère auguste thessalienne130.
127. A. S. ARVANITOPOULOS, AEph 1917, p. 129-132, no 345.128. Liste de Gonnoi : id., AEph 1915, p. 17, no 257 (HELLY, Gonnoi II, nos 129 et 130). Sur les frappes
monétaires du stratège Aristiôn, voir BURRER, Münzprägung, p. 146-151.129. CID IV 143 et B. PUECH, Topoi 8 (1998), p. 264.130. Cette hypothèse repose sur l’identification entre Ménékratès et le stratège Méné– de l’inscription
d’Hypata, identification que je crois très vraisemblable. Pour l’instant, aucun nom ne vient concur-rencer celui de Ménékratès parmi les noms de membres de l’élite politique thessalienne, argument e silentio certes, mais, dans le courant du Ier s. apr. J.-C., les cas d’itération de la stratégie deviennent particulièrement nombreux (on a vu les quatre stratégies d’Apollodôros et les trois de Kyllos) et l’accès aux fonctions fédérales paraît restreint à un tout petit groupe. Le conservatisme en matière d’onomastique (notamment l’application stricte de la papponymie) rend à mes yeux particulièrement possible le retour d’un Ménékratès à l’éponymie fédérale 55 ans après le stratège homonyme de 17/8 apr. J.-C. Par ailleurs, Ménékratès doit être le fils d’Eudèmos fils de Ménékratès, tage de Larissa en 40 apr. J.-C. (IG IX 2, 544). Je renvoie, en attendant sa publication, au manuscrit de ma thèse, BOUCHON, Élites, p. 141-189 (répertoire prosopographique des stratèges fédéraux depuis les années 48 av. J.-C. jusqu’au milieu du IIIe s. apr. J.-C.).
![Page 1: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: « L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022211/63206f14067e4ea67a0f4d34/html5/thumbnails/61.jpg)