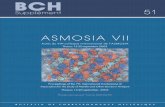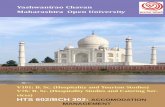"Les orphelins de guerre de Thasos : un nouveau fragment de la stèle des Braves (ca 360-350 av....
Transcript of "Les orphelins de guerre de Thasos : un nouveau fragment de la stèle des Braves (ca 360-350 av....
Dépositaire
DE BOCCARDÉdition - Diffusion
11, rue de Médicis - 75006 PARIS
Création graphique de la couverture
ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNESDidotou 6 GR - 10680 Athènes
www.efa.gr
VIENT DE PARAÎTRE
BCH Supplément 49 La sculpture byzantine (VIIe-XIIe siècles)Actes du colloque international organisé par la 2e Éphorie des antiquitésbyzantines et l’École française d’Athènes (6-8 septembre 2000)édités par Charalambos PENNAS et Catherine VANDERHEYDE
1 vol. 18,5 x 24 cm, 618 p. 80 €
ISBN 978-2-86958-196-8
BIBLIOTHÈQUE DES ÉCOLES FRANÇAISES D’ATHÈNES ET DE ROMEVolume 331 Athènes et Délos à l’époque classique : recherches sur l’administration
du sanctuaire d’Apollon délienpar Véronique CHANKOWSKI
1 vol. 21 x 29,7 cm, 588 p., VI pl. N/B in fine 90€ISBN 978-2-86958-197-5
RECHERCHES FRANCO-HELLÉNIQUESDikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientaleRecherches franco-helléniques dirigées par la Société archéologiqued’Athènes et l’École française d’Athènes (1986-2001)études proposées par Haïdo KOUKOULI-CHRYSSANTHAKI, René TREUIL, Laurent LESPEZ et Dimitra MALAMIDOU
Ouvrage coédité avec la Société archéologique d’Athènes et publié dansla Bibliothèque de la Société archéologique d’Athènes 254
1 vol. 21 x 28 cm, 416 p., ill. n/b et coul.80 €ISBN 978-2-86958-231-5 (École française d’Athènes) 978-960-8145-68-9 (Société archéologique d’Athènes)
Dépositaire : De Boccard Édition-Diffusion • 11, rue de Médicis • F-75006 Paris
ISBN : 978-2-86958-199-9ISSN : 0007-4217
BCH130
2 0 0 6
BU
LL
ET
IN
D
E
CO
RR
ES
PO
ND
AN
CE
H
EL
LÉ
NI
QU
E
2 0 0 6
BCH131
2007
1Études
ÉC O L E FR A N Ç A I S ED ' AT H È N E S
B U L L E T I N D E C O R R E S P O N D A N C E H E L L É N I Q U E
130_1 7/5/09 4:15 PM Page 1
B U L L E T I ND E C O R R E S P O N D A N C E
H E L L É N I Q U E
1Études
É C O L E F R A N Ç A I S E D ’ A T H È N E S
BCH1 3 12007
00_BCH_131_1_PDD 6/10/09 1:35 PM Page V
Comité de rédaction : Dominique MULLIEZ, directeur
Catherine AUBERT, adjointe aux publications
Comité de lecture du BCH 131.1 (2007) : Roland ETIENNE
Bernard HOLTZMANN
Claude ROLLEY
Eva SIMANTONI-BOURNIA
Révision et mise au point des textes : Béatrice DetournayConception et réalisation : Velissarios Anagnostopoulos, Break InCoordination de la fabrication : Velissarios Anagnostopoulos
PhotogravureImpression Reliure : Break In s.a.
© École française d’Athènes 2009 6, rue Didotou GR – 10680 Athènes www.efa.gr
Dépositaire : De Boccard Édition-Diffusion 11, rue de Médicis F – 75006 Paris www.deboccard.com
ISBN 978-2-86958-208-8Reproduction et traduction, même partielles, interdites sans l’autorisation de l’éditeur pour tous pays, y compris les États-Unis.
B U L L E T I ND E C O R R E S P O N D A N C E
H E L L É N I Q U E
131.1 2007
É C O L E F R A N Ç A I S E D ’ A T H È N E S
00_BCH_131_1_PDD 6/10/09 1:35 PM Page VI
SOMMAIRE DE LA LIVRAISON
I. ÉtudesLaurence ALPE, Thierry PETIT et Gilles VELHO
Sondage stratigraphique au palais d’Amathonte en 1997. Nature et chronologie du premier état ............................................................................................................................................................................................. 1-35
Floréal DANIEL, Sabine FOURRIER, Aude PLANTEY et Agnès RÔHFRITSCH
Techniques de décor de la céramique amathousienne archaïque ............................................................................................... 37-65
Sabine FOURRIER
Le dépôt archaïque du rempart Nord d'Amathonte, V.Céramiques culinaires .............................................................................................................................................................................................................................................. 67-93
Thomas BRISART
L’atelier de pithoi à reliefs d'Aphrati. Les fragments du musée Bénaki ..................................................................... 95-137
Heide FRIELINGHAUS
Die Helme von Delphi .................................................................................................................................................................................................................................. 139-185
Myriam FINCKER et Jean-Charles MORETTI
Le barrage du réservoir de l’Inopos à Délos ............................................................................................................................................................ 187-228
Hélène SIARD
Dédicace d'un mégaron dans le Sarapieion C de Délos....................................................................................................................... 229-233
Cédric BRÉLAZ, Angheliki K. ANDREIOMENOU et Pierre DUCREY
Les premiers comptes du sanctuaire d’Apollon à Délion et le concours pan-béotien des Delia .................................................................................................................................................................................... 235-308
Julien FOURNIER et Patrice HAMON
Les orphelins de guerre de Thasos :un nouveau fragment de la stèle des Braves (ca 360-350 av. J.-C.) ...................................................................................................................... 309-381
Alexandre AVRAM, Costel CHIRIAC et Ionel MATEI
Defixiones d'Istros .................................................................................................................................................................................................................................................... 383-420
Athanasios TZIAFALIAS et Bruno HELLY
Décrets inédits de Larissa (3) .............................................................................................................................................................................................................. 421-474
00_BCH_131_1_PDD 6/10/09 1:35 PM Page VII
Yannis KALLIONTZIS
Décrets de proxénie et catalogues militaires de Chéronée trouvés lors des fouilles de la basilique paléochrétienne d’Haghia Paraskévi ...................................................................................... 475-514
Sandrine ELAIGNE
La circulation des céramiques fines hellénistiques dans la région égéenne : un aperçu à partir du mobilier de Délos et de Thasos ......................................................................................................................... 515-557
Christophe FLAMENT
Die et engraver-sharing dans le Péloponnèse entre le règne d’Hadrien et celui de Septime ........................................................................................................................................................ 559-614
Jean-Michel SAULNIER
Le trésor de monnaies médiévales de Potamia (Chypre) .................................................................................................................. 615-719
Jean-Pierre DE RYCKE
Arnould de Vuez, « Peintre flamand » du marquis de Nointelet les premiers dessins du Parthénon en 1674 ...................................................................................................................................... 721-753
00_BCH_131_1_PDD 6/10/09 1:35 PM Page VIII
Les orphelins de guerre de Thasos :un nouveau fragment de la stèle des Braves (ca 360-350 av. J.-C.)*
THANAR 2
Julien FOURNIER et Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
RÉSUMÉ La publication de 22 nouvelles lignes d’un nouveau fragment du « Règlement sur les Braves »(J. POUILLOUX, Recherches sur Thasos I, 141), relatif aux funérailles des citoyens morts pour lapatrie, ajoute trois clauses. La cité assurera l’entretien des orphelins de guerre en leur versant uneallocation journalière, à condition qu’ils soient effectivement nécessiteux. Les fils des métèquesrecevront une indemnité forfaitaire de 17,5 statères. Les fils d’autres individus indéterminés(nothoi ?, affranchis ?) se contenteront de privilèges définis dans un décret antérieur. La publicationest prévue près du prytanée. Le document apporte plusieurs nouveautés, comme l’existence deprytanes. Il permet de réexaminer la question des dénominations monétaires dans le nouveausystème introduit à Thasos, au début du IVe s. L’ensemble du règlement trahit la forte influence dumodèle athénien. Il fut adopté dans des circonstances militaires exceptionnelles, dans lesquelles ilfaut sans doute reconnaître la désastreuse guerre de Datos/Krénidès, en 360-356 av. J.-C.
¶EPI§HæH Τα ορφανά του πολέμου στη Θάσο : ένα νέο θραύσμα της Στήλης των Γενναίων (περίπου 360-350 π.Χ.)
Η δημοσίευση 22 νέων στίχων του « Κανονισμού των Γενναίων » (J. POUILLOUX, Recherches surThasos I, 141), σχετικό με τον ενταφιασμό των πολιτών που έπεσαν για την πατρίδα, προσθέτειτρεις διατάξεις. Η πόλη θα αναλάβει τη συντήρηση των ορφανών του πολέμου δίνοντάς τους έναημερήσιο βοήθημα, με την προϋπόθεση να το έχουν πράγματι ανάγκη. Οι γιοι των μετοίκων θαλάβουν εφ' άπαξ ένα επίδομα 17,5 στατήρων. Οι γιοι άλλων, απροσδιόριστων ατόμων (νόθοι ;απελεύθεροι ;) θα περιοριστούν σε προνόμια που προσδιορίζονται σε παλαιότερο ψήφισμα. Ηστήλη προβλέπεται να εκτεθεί κοντά στο πρυτανείο. Το κείμενο προσφέρει πολλές νέες γνώσεις,όπως η ύπαρξη πρυτάνεων. Επιτρέπει την επανεξέταση του ζητήματος των νομισματικών ονομα-σιών στο νέο σύστημα, που εισήχθη στη Θάσο στις αρχές του 4ου αι. Το σύνολο του κανονισμούπροδίδει την ισχυρή επίδραση του αθηναϊκού προτύπου. Υιοθετήθηκε σε εξαιρετικές στρατιωτικέςπεριστάσεις, οι οποίες συμπίπτουν πιθανόν με τον καταστροφικό πόλεμο Δάτου/Κρηνίδων, μετα-ξύ του 360 και του 356 π.Χ.
SUMMARY War-orphans from Thasos: a new fragment of the « Agathoi Decree » (ca 360-350 B.C).
A new fragment of the « Agathoi Decree » is here published (J. POUILLOUX, Recherches sur ThasosI, 141), which contains arrangements for the public funerals of citizens killed in war. The twenty-two new lines contain three additional clauses. The city guarantees the maintenance of war-orphans through a daily allowance, provided that they are genuinely needy. The sons of metics willreceive a fixed grant of 17,5 staters. A third, unspecified, category (the sons of nothoi? freedmen?)are entitled to certain privileges, specified in an earlier decree. The decree is to be published nearthe prytaneion. The document reveals, among other things, the existence of a board of prytaneis. Italso allows for a reexamination of monetary questions, in particular the denominations of the newcurrency system introduced in Thasos in the early fourth century B.C. The whole decree is stronglyinfluenced by the Athenian model. It was probably adopted in exceptionally grave militarycircumstances, very likely the Datos/Krenides war of 360-356 B.C.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 309
Les fouilles en cours d’une demeure protobyzantine située dans les abords Nord de l’Ar-témision, près de l’agora de Thasos, ont permis la découverte, en septembre 2006, d’ungrand fragment de stèle inscrite. La stèle fut débitée dans l’Antiquité pour être remployéedans un mur de la pièce principale de la maison, dont l’extrémité orientale prenait laforme d’une abside outrepassée. Le fragment est brisé de façon irrégulière en haut ; l’angleinférieur droit avait été préalablement retaillé en biseau, de façon que le bloc s’insère dansl’angle formé par la partie terminale de l’abside1 (fig. 3).
310 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
* Nous remercions Mmes et MM. St. Dadaki, Z. Bonias, A. Muller et Fr. Blondé de nous avoir confié lapublication de cette trouvaille, qui est due à l’œil attentif de T. Kozelj. Nos remerciements s’adressentégalement à MM. Ph. Gauthier, Y. Grandjean, D. Mulliez, O. Picard, Fr. Salviat et R. S. Stroud, qui nousont fait bénéficier de leurs avis, de leurs conseils ou de leurs objections. Les hypothèses que nous formulonsci-après n’engagent que nous. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Y. Grandjean et Fr. Salviatde nous avoir communiqué le texte de l’inscription encore inédite du Délion. Toute notre gratitude vaenfin à Mme M. Wurch-Kozelj et à MM. T. Kozelj et Ph. Collet pour leur collaboration dans l’élaborationde la carte, du dessin de la pierre et des photographies. Le document a fait l’objet d’une brève présentationpréliminaire au colloque annuel de Thessalonique, en mars 2007 : cf. AEMTh 20 (2006), p. 51-53.
Abréviations bibliographiques :
DUCHÊNE 1992 = H. DUCHÊNE, La stèle du port. Fouilles du port I. Recherches sur une nouvelle inscriptionthasienne, ÉtThas XIV (SEG XLII 785).
DUNANT, POUILLOUX 1958 = Chr. DUNANT, J. POUILLOUX, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos II,ÉtThas V.
GRANDJEAN, SALVIAT 1988 = Y. GRANDJEAN, Fr. SALVIAT, « Décret d’Athènes restaurant la démocratie à Thasosen 407 av. J.-C. : IG XII 8, 262 complété », BCH 112 (1988), p. 249-278 (SEG XXXVIII 851).
GRANDJEAN, SALVIAT 2006 = Y. GRANDJEAN, Fr. SALVIAT, « Règlements du Délion de Thasos », BCH 130,p. 293-327.
Guide 2000 = Y. GRANDJEAN, Fr. SALVIAT, Guide de Thasos2.
Nouveau Choix 1971 = Nouveau choix d’inscriptions grecques (Institut Fernand-Courby, 1971 ; rééd. parG. ROUGEMONT et D. ROUSSET, 2005).
PICARD 2000 = O. PICARD, « Le retour des immigrés et le monnayage de Thasos (390) », CRAI 2000, p. 1057-1084.
POUILLOUX 1954 = J. POUILLOUX, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos I, ÉtThas III.
RHODES, OSBORNE 2003 = P. J. RHODES, R. OSBORNE, Greek Historical Inscriptions, 404-323 BC.
SALVIAT 1958 = Fr. SALVIAT, « Une nouvelle loi thasienne. Institutions judiciaires et fêtes religieuses à la fin duIVe siècle av. J.-C. », BCH 82, p. 193-267 (SEG XVII 415).
STROUD 1971 = R. S. STROUD, « Greek Inscriptions. Theozotides and the Athenian Orphans », Hesperia 40,p. 280-301 (SEG XXVIII 46).
VÉRILHAC, VIAL 1998 = A.-M. VÉRILHAC, Cl. VIAL, Le mariage grec, du VIe siècle avant J.-C. à l’époque d’Auguste,BCH Suppl. XXXII (1998).
1. Sur les fouilles, voir M. SGOUROU, Fr. BLONDÉ, A. MULLER et al., « Palaiocristinanikhv oikiva Qavsou sti~
bovreie~ parufev~ tou Artemisivou. Anaskafhv sto oikovpedo H. Kovkkinou 2004 », AEMTh 18 (2004), p. 43-55 ; eid., BCH 128-129 (2004-2005), p. 734-751.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 310
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 311
BCH 131 (2007)
0 10 20 30 40 50 cm
47.2
51.0
85.2
A
B
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44Fig. 1. — La stèle desBraves. Position relativedes fragments A et B (des-sin : EFA, T. Kozelj).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 311
La pierre (inv. 4607) mesure 42 cm de hauteur, 49,4 cm de largeur (mesurée à la l. 33),et de 14 à 14,7 cm d’épaisseur. Elle conserve vingt-deux lignes soigneusement gravéesd’une écriture du IVe siècle av. J.-C.2. Il s’agit de la partie inférieure de l’inscriptioncommunément appelée « Règlement des Braves », qui fut découverte en 1952 en remploidans l’hydragogue central de l’agora et publiée en 1954 par Jean Pouilloux dans le premiervolume de ses Recherches sur Thasos, sous le numéro 1413. Nous désignerons ci-après lapartie supérieure, déjà connue, sous le nom de « fragment A » et la partie inférieure,nouvelle, sous le nom de « fragment B ».
La stèle est de forme nettement pyramidante. Les deux fragments ne sont pas immé-diatement jointifs sur leur face inscrite, mais, grâce à l’aide de Tony Kozelj, nous avons pu,en alignant les bords verticaux conservés, déterminer l’emplacement relatif des deux blocsdans le trapèze idéal ainsi reconstitué (fig. 1). Les deux surfaces de cassure se rejoignent enun point de contact situé dans l’épaisseur de la stèle. Sur la face inscrite, il est quasimentcertain qu’une seule ligne a disparu dans la lacune entre les fragments A et B (l. 24)4. Laface postérieure de la stèle est seulement dégrossie. Le lit inférieur était parcouru sur toutesa longueur, en bordure de la face postérieure, par une feuillure, profonde de ca 1 cm etqui n’est plus conservée (à cause de la découpe en oblique, opérée ultérieurement) que sur3 cm de hauteur. La partie antérieure de la stèle formait un tenon, destiné à être insérédans une mortaise creusée dans une base ou une krépis ; la partie postérieure reposait surle lit supérieur de ladite base ou sur la krépis5. Sur la face antérieure gravée, l’espace anépi-graphe situé sous la ligne 46 est haut de 1,8 cm, ce qui excède la hauteur moyenne desinterlignes : l’inscription se terminait donc, sans aucun doute possible, à cet endroit. Lastèle – dont le sommet est perdu – mesurait à l’origine au moins 86 cm de hauteur.
La nouvelle inscription se déchiffre sans difficulté, sauf dans la partie droite des quatrepremières lignes (l. 25-28), où la surface de la pierre est usée et les lettres assez effacées.L’écriture est strictement la même dans les deux fragments, à la fois par la forme des lettres,
312 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
2. Toutes les dates s’entendent ici « avant J.-C. », sauf précision nécessaire.
3. POUILLOUX 1954, 141, avec la pl. XXXIX, 6. Dimensions : h. : 41 ; l. : 47 en haut, 48,5 en bas ; ép. : de 13à 13,8. Le document a été repris dans les recueils suivants : Fr. SOKOLOWSKI, Lois sacrées des cités grecques.Supplément, TravMém 11 (1962), p. 122-123, no 64 ; Nouveau choix 1971, no 19 (même commentaire quedans POUILLOUX 1954) ; Fl. FRISONE, Leggi e regolamenti funerari nel mondo greco, I. Le fonti epigrafiche(2002), p. 127-128 (commentaire approfondi des lignes 1-11) ; I. ARNAOUTOGLOU, Ancient Greek Laws(1998), p. 94-96, no 78 (traduction anglaise). Il est brièvement commenté par R. LONIS, La cité dans lemonde grec (1994), p. 188-190.
4 Une toute petite partie de cette ligne est même conservée au-dessus des lettres NES de la l. 25, mais lasurface est usée et l’on n’y distingue aucune trace de lettre.
5. Nous remercions J.-Ch. Moretti d’avoir discuté ce point avec nous.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 312
leur hauteur (0,9) et la taille des interlignes (0,8-0,9). La gravure est non-stoichèdon et lenombre de lettres par ligne est irrégulier. Dans l’ancien fragment comme dans le nouveau,le texte est soigneusement aligné sur le bord vertical gauche de la stèle. À droite enrevanche, le lapicide a évité, autant que possible, de couper les mots en fin de ligne. Il apréféré le plus souvent laisser un vacat et revenir à la ligne. Cette règle est scrupuleu-sement respectée dans le fragment A. Elle connaît trois exceptions dans le fragment B :quand le vacat ainsi ménagé risquait d’être trop long et de créer un effet de vide disgra-cieux, le lapicide a gravé certains mots à cheval sur deux lignes, en respectant la coupesyllabique (l. 32-33, l. 37-38 et l. 44-45)6. La fin de la l. 36 porte même la trace d’unrepentir : le lapicide avait commencé à graver les trois (ou quatre) premières lettres du motgenovmenoi ; plutôt que de le couper, il s’est ravisé et a préféré effacer soigneusement ceslettres (·gen‚ ou peut-être ·geno‚) et graver le mot dans son intégralité au début de la lignesuivante7. Ces particularités expliquent que le nombre total de lettres varie beaucoupd’une ligne à l’autre : dans le fragment A, il oscille entre 35 (l. 12) et 52 lettres (l. 6) ; dansle fragment B, pour les lignes intégralement conservées ou restituées avec certitude (l. 28à 38), il oscille entre 38 (l. 36) et 48 lettres (l. 29). Étant donné ces fortes variations, laprudence sera de mise quand il s’agira de proposer des restitutions pour les lacunes situéesen fin de ligne.
Nous avons revu au Musée de Thasos le fragment A (inv. 1032 ; cf. fig. 2), dont lalecture ne pose aucun problème, sauf en ce qui concerne les bribes de lettres de la dernièreligne (l. 23), où notre déchiffrement diffère de celui de J. Pouilloux. Nous reproduisonsci-après le texte des deux fragments, avec une numérotation continue des lignes.
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 313
BCH 131 (2007)
6. On comparera le bail publié par Fr. SALVIAT, BCH 96 (1972), p. 364-373 (avec la fig. 1), qui présente lamême alternance entre des lignes où la coupe par mots est respectée (créant de larges vacat en fin de ligne :l. 3 et 4) et des lignes où c'est la coupe syllabique qui s'applique. La gravure de cette inscription s'apparented'ailleurs beaucoup à celle de la stèle des Braves et il est tentant de l’attribuer au même lapicide (cf. infra).Fr. Salviat en datait l’écriture du milieu du IVe s.
7. On discerne des traces de regravure dans deux autres passages du fragment B : ejpiyhfivzonta~ eJkavstwi
tessevrw≥ªnº (l. 30) et toi~ metoivkoi~ (l. 32). Il s’agit sans doute de fautes commises par le lapicide et relevéespar le secrétaire lors de la relecture.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 313
314 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
Fig. 2. — La stèle des Braves. Fragment A (cliché EFA, Ph. Collet).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 314
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 315
BCH 131 (2007)
Fig. 3. — La stèle des Braves. Fragment B (cliché EFA, Ph. Collet).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 315
A ª- - - - ca 15 l. - - - -º mhde;n oJ ajgorhnovmo~ perioravtw thiªhJºm≥e≥vr≥h≥i h|i a]n ejcfevrwntai pri;n th;n ejcfora;n genevsqai:penqiko;n de; mhde;n poeivtw mhdei;~ ejpi; toi~ ajgaqoi~ aj≥n≥dr≥avsi
4 plevon h] ejn pevnte hJmevrai~: khdeuvein de; mh; ejxevstw: eij de; mhv,ejnqumisto;n aujtwi e[stw kai; oiJ gunaikonovmoi kai; oiJ a[rconte~kai; oiJ polevmarcoi mh; periorwvntwn kai; qwi>wnte~ karteroi; e[stwne{kastoi tai~ qwai~ tai~ ejk twn novmwn: ajnagravfein de;
8 aujtwn ta; ojnovmata patrovqen eij~ tou;~ ΔAgaqou;~ tou;~polemavrcou~ kai; to;n grammateva th~ boulh~ kai; kaleisqaiaujtwn tou;~ patevra~ kai; tou;~ paida~ o{tan hJ povli~ ejntevmnhitoi~ ΔAgaqoi~ Ä didovnai d juJpe;r aujtwn eJkavstou to;n
12 ajpodevkthn o{son uJpe;r timwvcwn lambavnousin:kaleisqai d jaujtwn tou;~ patevra~ kai; tou;~ paida~ kai; ej~proedrivhn ej~ tou;~ ajgwna~: cwrivon de; ajpodeiknuveinaujtoi~ kai; bavqron tiqevnai touvtoi~ to;n tiqevnta tou;~ ajgwna~:
16 oJpovsoi d ja]n aujtwn paida~ katalivpwsin, o{tan ej~ th;nhJlikivhn ajfivkwntai, d≥idovtwsan aujtoi~ oiJ polevmarcoi,a]m me;n a[rsene~ e[wsin, eJkavstwi knhmi`da~, qwvrhka,ejgceirivdion, kravno~, ajspivda, dovru, mh; ejlavssono~ a[xia
20 ªtrºi≥w≥`n mnwn, ÔHr≥akleivoi~ ejn twi ajgwni kai; ajnaggeªlºl≥e≥vªsqwnºªpatrovqen (Ù)º: a]n de; qugatevre~ w\sin, eij~ penqevrioªn - - -ºª- ca 6 l. - o{tan Ù tesºsevrwn kai; devka ejtwn gevnwn≥ªtai - - - -ºª- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ºT≥ . ª. .º pole≥ª- - - - - - - - - - - -º
B 24 ª- - - - - - - - - - - - - - - - -º . ª- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ºª- - - ca 12 l. - - -ºa≥ e[th genevsqai . ª.º . . . . ª. .º . ª- ca 5-15 l. -ºªtºe≥ªteºleuthkovtwn tino;~ trofh~ ejndeeiª~º o[nteª~ ejpivwsinºªejºpi; th;n boulh;n kai; to;n dhmon peri; trofh~ k≥ai; doªkimavzwsinº
28 oiJ a[rconte~ kai; oiJ ajpovlogoi ojmovsante~ ejnd≥eei~ ei≥\n≥ªaiºtou;~ ejpiovnta~ trofh~, ejpidevkesqai aujtou;~ tou;~ pruta≥vªnei~ºk≥ai; ejpavgein, mh; plei`on ejpiyhfivzonta~ eJkavstwi tessevrw≥ªnºojbolwn: ei\nai de; to; ajnavlwma para; tou ajpodevktou:
32 divdosqai de; kai; toi~ metoivkoi~ a[n ti~ ejm polevmwi teleu≥-t≥h≥vshi stathra~ dekaepta; hJmistavthron para; touajpodevktou: kuvrion d jei\nai to; yhvfisma to; ejpi; Bivwno~a[rconto~ gegenhmevnon kai; uJpavrcein w|n oiJ patevre~
36 teteleuthvkasin ejn tw`i polevmwi a[ndre~ ajgaqoi; ·gen‚genovmenoi kai; mh; e[cousiv ti twn ejn twi yhfivsmati ge≥ªgram-ºmevnwn: ajnagravyai de; to; yhvfisma to;g grammatev≥ªa th~ºboulh~ eij~ sthvlhn liqivnhn kai; sthsai pro; t≥ª- - - - - - -º
40 tou prutaneivou: to; de; ajnavlwma eij~ tªh;n sthvlhn (Ù) kai;º
316 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 316
eij~ ta; a[lla dounai to;n ajpodevktªhn - - - - ca 11-21 l. - - - -ºparovnto~ tou grammatevw~ ªth~ boulh~: o{sti~ dΔ a[n tiºmh; pohvshi twg gegramm≥ªevnwn twn ejn twi yhfivsmatiº
44 uJpovdiko~ me;n e[stw≥ ªtwn politwn twi ejqevlonti, ciliv-ºou~ de; stathr≥ªa~ ojfeilevtw to; me;n h{musu thi povlei, to; de;ºh{musu tw≥ªi dikasamevnwi. vac ºvac.
L. 3 : poeivtw, lapis ; poieivtw, P(ouilloux) ; aj≥n≥dªrºavsi, P. L. 18 : E v. WSIN, lapis. L. 20 : ªtºriwn, P. ;ÔHªrºakleivoi~, P. L. 20-21 : ajnaggeªilºa≥vt≥w≥ªsan ⁄ ta; ojnovmataº, P. L. 22 : gevnw≥ªntaiº, P. L. 23 : t≥ªou;~ºpole≥ªmavrcou~º uel sim (?) ; Tª. . .ºP≥UM≥, P. L. 26 : ªejpivwsinº uel ªejpevlqwsinº. L. 27 : doªkimavzwsinºuel doªkimavswsinº. L. 39 : pro; t≥ªou prostwivouº uel t≥ªou toivcouº uel sim. L. 42 : ªo{sti~ dΔ a[n tiº uelªa]n dev tiv~ tiº.
La stèle des Braves compte parmi les documents les plus connus de l’épigraphie thasienne.J. Pouilloux a proposé de la situer vers 350 av. J.-C. : cette date nous paraît convenir etnous essaierons plus loin de la préciser. Depuis sa publication, le document a retenu l’at-tention de nombreux historiens, spécialistes de la guerre ou des cités de l’époque clas-sique. Il offre en effet un parallèle quasiment unique au « patrios nomos » d’Athènes,c’est-à-dire aux règles conformément auxquelles les Athéniens organisaient, depuis la findes années 470 environ, les funérailles publiques des citoyens morts au champ d’honneuret que nous connaissons par la célèbre description que fait Thucydide de cette cérémonie,au livre II de l’Histoire de la Guerre du Péloponnèse, avant de rapporter l’oraison funèbreprononcée à cette occasion par Périclès en 4318. Le règlement thasien fait en outre écho àla législation athénienne relative aux orphelins de guerre – lesquels étaient pris en chargefinancièrement par la cité – et que nous connaissons par divers auteurs du Ve et du IVe siècleet par une inscription découverte en 1971 sur l’Agora9.
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 317
BCH 131 (2007)
8. Thucydide, II 34. Cf. F. JACOBY, « Patrios Nomos. State Burial in Athens and the Public Cemetery in theKerameikos », JHS 64 (1944), p. 37-66 ; R. STUPPERICH, Staatsbegräbnis und Privatgrabmal im klassichenAthen (1977) ; N. LORAUX, L’invention d’Athènes. Histoire de l’oraison funèbre dans la « cité classique »(1981 ; 2e éd., 1993) ; C. W. CLAIRMONT, Patrios Nomos. Public Burial in Athens during the Fifth andFourth Centuries B.C. (1983) ; W. PRITCHETT, The Greek State at War, IV (1985), p. 102-124 ; K. PRINZ,Epitaphios logos (1997). P. SINEUX, « Les morts à la guerre », in P. BRUN (éd.), Guerres et sociétés dans lesmondes grecs (490-322) (1999), p. 97-126.
9. STROUD 1971. Cf. infra.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 317
Le fragment A, publié par J. Pouilloux, peut se traduire comme suit10 :
« […] que l’agoranome ne commette aucune négligence, le jour où l’on procédera au convoifunèbre, avant que ce convoi ait eu lieu ; que personne ne manifeste son deuil, de quelque façonque ce soit, en l’honneur des Braves, pendant plus de cinq jours ; que personne n’ait le droit decélébrer en leur honneur des cérémonies funèbres (sc. à caractère privé) ; sinon, que l’on soit enétat d’impureté religieuse, et que les gynéconomes, les archontes et les polémarques ne laissentpas faire, mais aient chacun la capacité d’infliger les pénalités prévues par les lois ;
en outre, que les polémarques et le secrétaire du Conseil inscrivent leurs noms, avec leurs patro-nymes, sur la liste des Braves, et que leurs pères et leurs garçons soient invités (sc. au banquet),lorsque la cité sacrifiera aux Braves ; pour chacun d’entre eux (sc. des morts), que l’apodecteverse une somme égale à celle que l’on reçoit pour les détenteurs d’une timè ; que leurs pères etleurs garçons soient aussi invités à la place d’honneur dans les concours ; que l’organisateur desconcours leur affecte un emplacement et installe pour eux une estrade ;
pour tous ceux d’entre eux qui auront laissé derrière eux des enfants, lorsque ceux-ci aurontatteint leur majorité, que les polémarques leur remettent, s’ils sont de sexe masculin, à chacun :des jambières, une cuirasse, un poignard, un casque, un bouclier, une lance, dont la valeur nesera pas inférieure à trois mines ; (cette panoplie) leur sera remise aux Hèrakleia lors duconcours, et [qu’ils soient proclamés, avec leurs patronymes (?)] ; si ce sont des filles, pour leurdot […] quand elles auront eu quatorze ans révolus […]. »
Par le présent règlement, la cité de Thasos octroyait le titre posthume d’Agathoi auxcitoyens morts pour la patrie. La partie initiale, perdue, prévoyait selon toute vraisem-blance l’organisation de funérailles publiques pour les « Braves », dont les restes devaientêtre rapatriés sur l’île pour être ensevelis dans la nécropole. Dans l’état de mutilation où ilse trouve, le document ne nous apprend rien de précis sur les modalités pratiques de cettecérémonie ni sur le lieu et le moment où elle se déroulait. En poussant très loin l’analogieavec Athènes, J. Pouilloux a émis sur ces questions une série d’hypothèses fragiles, quel’on doit écarter. Par exemple, un contrat de bail à peu près contemporain de notredocument révèle que les polémarques organisaient régulièrement, dans le sanctuaired’Héraclès, des concours à caractère militaire entre les bataillons (taxeis) de l’arméethasienne, peut-être lors de la fête annuelle des Hèrakleia11. Partant de ce renseignementet de la mention des Hèrakleia à la l. 20 de notre inscription, J. Pouilloux a cru pouvoir
318 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
10. Nous nous inspirons, en les modifiant légèrement, des traductions suivantes : POUILLOUX 1954, p. 371-372 ; Guide 2000, p. 224 ; Fl. FRISONE (supra, n. 3), p. 127-128.
11. M. LAUNEY, BCH 61 (1937), p. 406 (IG XII Suppl 353), l. 9-12, avec le commentaire, p. 396-398. Il estpossible que ces concours se soient tenus lors d’une autre fête en l’honneur d’Héraclès, celle des Sôtèria : cf.SALVIAT 1958, p. 230, n. 4.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 318
déceler un lien étroit entre les cérémonies civiques honorant les soldats morts et le culted’Héraclès. Il a ainsi voulu interpréter le « terrain situé près des portes (sc. la Porte de Zeuset la Porte de Dionysos et d’Héraclès [?]) », qui est mentionné dans un autre règlementrelatif à l’Hérakleion et qui dépendait de ce sanctuaire12, comme la zone de la nécropoleque les Thasiens auraient réservée à ces morts exceptionnels, équivalent local du DèmosionSèma athénien13. Rien n’autorise en fait cette identification. J. Pouilloux proposaitégalement de chercher à Thasos la trace d’un concours funéraire organisé dans le cadre desHèrakleia et inspiré de l’epitaphios agôn athénien, ce qui paraît tout aussi dépourvu defondement solide14.
D’après les clauses conservées, nous savons seulement que la cité s’efforçait derestreindre strictement, à l’occasion de ces funérailles publiques, les manifestationspersonnelles de deuil et la célébration de rites funéraires à titre privé (l. 1-7). Les excèséventuels étaient ordinairement le fait des femmes, ce qui explique que les gynéconomes– magistrats de création récente à Thasos à cette époque – aient été explicitement chargés,avec l’agoranome (qui supervisait l’agora et l’espace public en général), les archontes et lespolémarques, du respect de l’ordre public dans cette circonstance15.
La cité ordonnait en outre que les noms des Braves fussent inscrits sur une listeofficielle, qui leur garantissait ce titre posthume (l. 7-9) : il existait certainement uncatalogue, tenu à jour par les polémarques et conservé dans les archives publiques ;envisageait-on d’ériger en outre une stèle à l’air libre, sur laquelle seraient gravés annéeaprès année les noms des nouvelles victimes, comme le pensait J. Pouilloux ? Rien n’est
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 319
BCH 131 (2007)
12. IG XII 8, 265 (Fr. SOKOLOWSKI, Lois sacrées des cités grecques, TravMém XVIII [1969], 115), l. 3-4 : ªto;
cwrºivon (...) ªto; peri; (uel para;) ta;~º puvla~. Sur la nature du document, voir Fr. SALVIAT, BCH 96 (1972),p. 370-371. POUILLOUX 1954, p. 460, le plaçait vers 350-330, soit à peu près à la même époque que la Stèledes Braves, et était tenté d’y voir « une annexe au règlement sur les ΔAgaqoiv ». O. PICARD, CRAI 1982,p. 418, a montré qu’il fallait remonter cette date de soixante ans au moins et situer le document avant laréforme monétaire de ca 390 (cf. infra). On comparera la formule ta; pro; twm pulevwn pavnta dans le bail dumême verger d’Héraclès publié par M. LAUNEY (n. précédente), l. 8 (avec le croquis de situation, p. 389).
13. DUCHÊNE 1992, p. 101, a repris à son compte l’hypothèse de J. Pouilloux et imaginé que le convoi funèbrepartait de l’Hérakleion pour aboutir à la Porte au poisson, ce qui reste très incertain.
14. POUILLOUX 1954, p. 378 et 410.
15. Sur les gynéconomes, voir POUILLOUX 1954, p. 407-410 (avec les remarques de J. BOUSQUET, BCH 83[1959], p. 402) ; Fr. CROISSANT, Fr. SALVIAT, BCH 90 (1966), p. 460-463 ; GRANDJEAN, SALVIAT 2006,p. 307. Sur l’agoranome (magistrat unique ou quelquefois collège de deux magistrats), qui hérite au IVe s.d’une partie des attributions des épistates du Ve s., voir POUILLOUX 1954, p. 404-405, et DUCHÊNE 1992,p. 68-71. Sur les polémarques, voir POUILLOUX 1954, p. 399-400. Pour le sens d’ejnqumistovn, voirGRANDJEAN, SALVIAT 2006, p. 312-314.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 319
prévu ici pour la financer et il est sans doute permis d’hésiter sur ce point16. Thasoshonorait par ailleurs la mémoire des Braves en célébrant un sacrifice héroïque, à l’occasionduquel les familles des Braves étaient conviées à un banquet : les rites avaient lieu soit lorsd’un jour sacré nouvellement institué, soit dans le cadre de la fête traditionnelle desHèroxeinia17. Les modalités de financement du banquet accompagnant le sacrifice sontimmédiatement précisées par la phrase qui suit (l. 11-12)18 et qui, par son caractèreelliptique, a posé des difficultés aux commentateurs : didovnai d juJpe;r aujtwn eJkavstou to;najpodevkthn o{son uJpe;r timwvcwn lambavnousin. J. Pouilloux s’était en effet mépris sur le sensde l’expression uJpe;r aujtw`n eJkavstou, croyant qu’il s’agissait de verser pour l’occasion « àchacun » des pères et des fils des morts une indemnité compensatoire identique à celle quela cité versait à tous ses « fonctionnaires19 ». G. Gottlieb a montré au contraire que ladépense était consentie « pour chacun d’entre eux », c’est-à-dire dans le but de rendre lesdevoirs à chacun des Braves et d’honorer son souvenir20. Le montant engagé pour chaqueBrave ainsi honoré était fixé sur le modèle de ce que l’on payait ordinairement uJpe;rtimwvcwn, c’est-à-dire pour chaque magistrat et autre détenteur d’une timè21, lors de toutesles cérémonies officielles, afin qu’il participe au banquet. Le verbe lambavnein répond ici àdidovnai : dans toutes les fêtes thasiennes, les responsables – quels qu’ils fussent – recevaient
320 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
16. Mis à part les obituaires athéniens du Céramique et l’exemple de Samos invoqué par POUILLOUX 1954,p. 377, les catalogues de morts gravés sur pierre sont très peu nombreux. Deux exemples sont connusdepuis peu : à Messène, la liste des morts à la bataille de Makistos (SEG XLVII 407) ; à Métropolis d’Ionie,celle de morts de la guerre contre Aristonicos (SEG LIII 1312 A, l. 47-56).
17. Les sacrifices en question sont des enagismata : en principe, ils ne sont donc pas alimentaires ; les invitésthasiens consommaient lors du banquet autre chose que les viandes, qui étaient sans doute brûlées. Sur lesens d’ejntevmnein, voir J. CASABONA, Recherches sur le vocabulaire des sacrifices en grec (1966), p. 225-227, etsur son synonyme ejnagivzein, p. 204-210, et G. EKROTH, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults, KernosSuppl. 12 (2002), p. 135-136. SALVIAT 1958, p. 259, a suggéré que ces sacrifices de type héroïquepourraient s’être tenus lors des Hèroxeinia (plutôt que lors des Hèrakleia, comme le pensait J. Pouilloux).
18. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la ponctuation (Ä) et la présence d’un vacat ne marquent donc pasde rupture nette.
19. POUILLOUX 1954, p. 377 : « Le receveur leur versera à chacun une indemnité égale à celle que l’on reçoitdans l’exercice des dignités » ; voir également p. 393 et p. 404, où J. Pouilloux imagine qu’il s’agit parexemple du misthos versé aux juges, hypothèse dénuée de fondement. Les auteurs du Nouveau Choix 1971ont repris cette traduction, en remplaçant « dans l’exercice des dignités » par « à titre de dignitaire », et ilsglosent le passage en écrivant que « les ascendants et descendants des soldats morts à la guerre sont (...)assimilés aux citoyens privilégiés, les timw`coi, ceux qui possèdent une timhv, on pourrait traduire lesdignitaires » (op. cit., p. 108). Cette interprétation erronée a été suivie, voire amplifiée, par N. LORAUX,L’invention d’Athènes2 (1993), p. 47-49, et par R. LONIS, La cité dans le monde grec (1994), p. 189.
20. G. GOTTLIEB, Timuchen. Ein Beitrag zum griechischen Staatsrecht (1967), p. 38-42, approuvé parL. ROBERT, Gnomon (1971), p. 40 (= OMS VI, p. 656). Voir déjà Fr. SALVIAT, BCH 82 (1958), p. 326 n. 1.
21. Les timwcoi ne sont pas les « fonctionnaires » et le terme de « dignitaires » ne convient guère mieux pour unecité démocratique. Ces « détenteurs d’une timè » regroupent vraisemblablement à la fois les citoyens
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 320
d’ordinaire (lambavnousin) de l’apodecte une somme globale, calculée au prorata dunombre total de timouchoi censés être présents. Lors du sacrifice en mémoire des héros,ceux qui seraient responsables (peut-être les polémarques eux-mêmes) se verraientdésormais remettre (didovnai) une somme calculée en proportion du nombre d’Agathoienregistrés sur la liste. Les bénéficiaires seraient les patevre~ et les paide~ des Braves, admisà cette nouvelle cérémonie patriotique.
On a quelquefois voulu donner un sens très large aux mots patevre~ et pai`de~, en lestraduisant respectivement par « pères et mères » et par « enfants22 ». Il fait cependant peude doute que ce sont les qualités viriles et le prestige des Braves, citoyens et soldatsexemplaires, qui étaient censés rejaillir sur leurs ascendants et (surtout) sur leursdescendants et que, partant, seuls les individus de sexe masculin étaient concernés parl’invitation : il s’agit donc des pères et des garçons mineurs23. Les pères et fils obtinrent enoutre d’autres distinctions, comme celle d’être invités dans les concours – sans doute tousles concours civiques, dans lesquels les jeunes filles n’avaient certainement pas non plusleur place24 –, où un banc à la proédrie leur serait désormais réservé (l. 13-15). À leurmajorité, enfin, la cité de Thasos s’engageait à fournir aux garçons un équipementhoplitique ; elle procurerait une dot aux filles lorsqu’elles atteindraient l’âge légal dumariage, fixé à quatorze ans (l. 16-22 ; cf. infra).
Le nouveau fragment permet de trancher la question de la nature de ce « règlement ».Certains commentateurs ont voulu le désigner sous le nom de « loi ». Il est confirméqu’il s’agit d’un décret de l’Assemblée (yhvfisma, l. 37 et 38)25. Notre inscription fait allusion,à la ligne 7, aux novmoi civiques, expression vague et qui désigne peut-être l’ensemble des
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 321
BCH 131 (2007)
revêtus d’une magistrature (une charge publique étant toujours un honneur) et les citoyens – ainsi peut-être que certains étrangers – à qui a été accordé par décret honorifique le droit d’être associé aux sacrificespublics et d’obtenir une part spéciale. On comparera les « timouques et anciens » de Méthymna(Ph. GAUTHIER, Topoi 7 [1997], p. 358-359), ainsi que « ceux qui détiennent une timè » à Lébédos : o{soi de;
provxenoiv eijsi th~ Lebedivwn povlew~ h] eujergevtªai h] politeivanº h] a[llhn tina; dwrea;n h] timh;n e[cousin para; twn
Lebedivwn ktl. (C. B. WELLES, Royal Correspondence [1934], 3, l. 21-22) ; cf. SEG XXXI 985 a, l. 5-6.
22. Voir la traduction du Nouveau Choix 1971, p. 106, et le commentaire p. 107-108.
23. Fl. FRISONE (supra, n. 3), p. 133 n. 34 et p. 172. Voir déjà N. LORAUX (supra, n. 19), p. 361 n. 32. À la ligne16, en revanche, nous traduisons le même terme paide~ par « enfants », car les descendants des deux sexessont explicitement concernés.
24. S. B. POMEROY, « Charities for Greek Women », Mnemosyne 35 (1982), p. 115-135, part. p. 116-119,envisage la possibilité que les mères et les filles soient concernées par l’invitation aux sacrifices (l. 10) et auxconcours (l. 13), mais n’apporte aucun argument convaincant.
25. Voir les réflexions de M. LAUNEY, BCH 57 (1933), p. 402-403, à propos du règlement de police du port IGXII Suppl 348, qui lui aussi est formellement un décret. La date proposée par M. Launey (seconde moitiédu IIIe s.) est sans doute trop basse.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 321
règles de droit. Il existait bien par ailleurs des « lois » spécifiquement consacrées à tel outel sujet26. Les Thasiens faisaient donc la différence entre « lois » et « décrets » et éta-blissaient sans doute une hiérarchie entre ces deux types d’actes. Nous ignorons en revanchesi la distinction était fondée, comme dans l’Athènes du IVe siècle, sur une différence dansla procédure d’adoption27.
Le fragment ajoute cinq clauses entièrement nouvelles, dont les trois plus importantessont consacrées au traitement que la cité réservait aux ayants droit des Braves. Nousdonnerons dans un premier temps un commentaire suivi des nouvelles clauses, dont nousproposerons une traduction (I). Nous traiterons ensuite, de façon plus détaillée, uncertain nombre de points particuliers, d’ordre institutionnel et financier, et nous nousinterrogerons sur le contexte historique dans lequel le présent décret fut adopté (II). Lelecteur pressé pourra se reporter directement aux pages 371-381, relatives à la date.
I. COMMENTAIRE DES LIGNES 20-46
L. 20-23 : octroi d’une panoplie aux garçons et versement d’une dot aux filles des Braves
Le fragment A s’achève par une clause concernant les orphelins, garçons et filles, que lesBraves laisseront derrière eux. Les garçons recevront une panoplie, qui leur sera remise engrande pompe lors de la fête civique des Hèrakleia28. La cérémonie rappelle celle que lesAthéniens organisaient chez eux lors des Dionysies urbaines et dont Lysias, dans son plai-doyer rédigé pour l’accusateur de Théozotidès (cf. infra), brosse un rapide tableau : « lorsdes Dionysies, lorsque le héraut proclamera, en appelant les orphelins par le nom de leurspères (o{tan oJ khrux ajnagoreuvh/ tou;~ ojrfanou;~ patrovqen) : “voici les jeunes gens dont lespères sont morts à la guerre en combattant en braves pour la patrie et que la cité a élevésjusqu’à leur majorité”, etc.29 ».
322 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
26. IG XII 8, 264, l. 12 (to;n novmon to;n th`~ ajtimivh~ ; le mot yhvfisma est employé immédiatement après etdistingué de novmo~ : l’idée d’un « décret-loi », formulée par M. FEYEL, RPhil 76 [1945], p. 141, est àécarter) ; DUNANT, POUILLOUX 1958, 192, l. 4 (to;n ajgcistiko;n novmon). Voir également POUILLOUX 1954,155 (SEG XVIII 348), l. 5, où le passage, mutilé, est moins clair : ªkata; to;n nºovmon.
27. POUILLOUX 1954, p. 173, partant d’une restitution inacceptable d’un passage du décret IG XII 8, 262(l. 20-21), a voulu reconstituer une procédure d’adoption des nomoi dans laquelle le Conseil aurait rédigéles projets avant de les soumettre au Peuple ; ses hypothèses sont dénuées de fondement. Pour le casd’Athènes, voir Fr. QUASS, Nomos und Psephisma (1971) ; M. H. HANSEN, La démocratie athénienne àl’époque de Démosthène (trad. fr., 1993), p. 195-212.
28. Sur les Hèrakleia, voir SALVIAT 1958, p. 236-237.
29. Lysias, frag. 6 (C. Théozotidès), trad. L. GERNET (Collection des universités de France), légèrement modifiée.Voir également Isocrate, Paix 82 ; Eschine III (C. Ctésiphon) 154.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 322
Le décret thasien prévoit lui aussi, l. 20-21, une proclamation solennelle à cetteoccasion. J. Pouilloux avait restitué le passage, en grande partie disparu : kai;ajnaggeªilºa≥vt≥w≥ªsanº (sc. oiJ polevmarcoi) ⁄ ªta; ojnovmata: ktl.º. La divergence d’aspect entredidovtwsan (présent) et ajnaggeªilºa≥vt≥w≥ªsanº (aoriste) est en principe inacceptable. Il estévident que, la cérémonie étant destinée à se répéter année après année, seul l’aspectprésent convient ici. Il faudrait donc lire : ajnaggellevtwsan uel ajnaggellovntwn. La surfacede la pierre est très usée à cet endroit, mais nous déchiffrons plutôt : ajnaggeªlºl≥e≥v. ª- - -º. Larestitution ªta; ojnovmataº, au début de la l. 21, ne convient guère, car la lacune est sansdoute longue de sept ou huit lettres, plutôt que de neuf ; en outre, la proclamation doit enprincipe être du ressort du héraut et non des polémarques et faire résonner, non seulementles noms des pupilles de la cité, mais surtout ceux de leurs pères. Nous inspirant du passagede Lysias cité plus haut, nous préférerions par conséquent retrouver ici le verbeajnaggevllein au passif, avec pour sujet non exprimé les orphelins majeurs : kai;ajnaggeªlºl≥e≥vªsqwn ⁄ patrovqen (Ù)º. La restitution ªpatrovqenº doit demeurer hypothétique,mais elle a l’avantage d’être plus courte d’une lettre (8 lettres).
La proposition suivante, concernant le versement d’une dot aux filles nubiles, n’aaucun équivalent dans la législation athénienne sur les morts à la guerre30. Le seul parallèleconnu est celui de Rhodes en 305, sur lequel nous reviendrons plus loin. On peut à larigueur invoquer un autre exemple, quoiqu’un peu différent, à savoir celui d’une loid’Érétrie, datée de ca 340, qui protège la démocratie et récompense le meurtrier d’unéventuel tyran en lui octroyant de grands honneurs ou en transférant ces honneurs, s’ilvient lui-même à mourir dans l’attentat, à ses héritiers : une première clause concerne lesfils ; une deuxième, très mutilée, indique que les filles (qugatevre~) aussi étaient concernéeset recevaient vraisemblablement une certaine somme d’argent au moment de leurmariage31. Rappelons en outre que, pour les citoyens reconnus officiellement commebienfaiteurs, les lois athéniennes prévoyaient, sans doute depuis le IVe siècle, que la citéprendrait soin des descendants et en particulier qu’elle pourvoirait à la dot de leurs fillesen cas de nécessité32.
J. Pouilloux ne s’est pas hasardé à rétablir la clause mutilée du décret thasien. Il estcependant probable que ce passage contenait une indication sur le montant (minimum ?)
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 323
BCH 131 (2007)
30. Voir désormais le commentaire de VÉRILHAC, VIAL 1998, p. 163-164.
31. SEG LI 1105, l. 10-14, avec le commentaire d’Ad. WILHELM, JÖAI 8 (1905), p. 16 (= Kleine Schriften II, 1,p. 234) et de D. KNOEPFLER, BCH 125 (2001), p. 213.
32. IG II2 832 (Syll.3 496), l. 18-20 ; cf. VÉRILHAC, VIAL 1998, p. 162-163. Sur le cas douteux des deux fillesd’Aristide, cf. J. K. DAVIES, Athenian Propertied Families (1971), no 1695, part. p. 51-52.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 323
de la dot, exprimé en mines, en statères ou en drachmes (cf. infra). On ne peut restituer lepassage avec certitude, les variantes possibles étant trop nombreuses. Mais on peut envi-sager, à titre d’hypothèse, des suppléments tels que les suivants :
ªpatrovqen (Ù)º : a]n de; qugatevre~ w\sin, eij~ penqevrioªn divdosqai33ºªaujtai~, o{tan tesºsevrwn kai; devka ejtwn gevnwn≥ªtai, eJkavsthi mh;ºªejlavssonna pleion (chiffre + dénomination) - - - ºT . ª. .º pole≥ª- - - - - - - -º
La dernière ligne ne conserve que le sommet de quelques lettres, que J. Pouillouxavait déchiffrées ainsi : T P≥UM≥. Notre lecture est toute différente : T . ª . . º POLE≥. Du taune subsiste que la barre horizontale. Il est suivi d’une lettre qui, semble-t-il, est de formeronde (?). Nous sommes tentés de rétablir : t≥ªou;~º pole≥ªmavrcou~º. Il est en revancheimpossible de savoir si ces deux mots appartiennent à la fin de la clause relative à la dot ousi, au contraire, ils constituent le début de la clause suivante. Rappelons qu’une seule lignea disparu dans la fracture entre le fragment A et le fragment B.
L. 25-31 : versement d’une allocation de subsistance aux ayants droit nécessiteux decitoyens morts en Braves
La première clause du fragment B prolonge et complète les mesures précédentes en faveurdes ayants droit des citoyens morts pour la patrie. Elle concerne plus précisément ceuxd’entre eux que la mort d’un Brave laisserait dans le dénuement et que la cité, en se substi-tuant à lui, prendra à sa charge. Le début de la clause a malheureusement disparu dans lalacune, mais on peut essayer, avec toute la prudence requise, de reconstituer laconstruction et le sens de la phrase ainsi mutilée. Le mot trofhv apparaît à trois reprisesdans les lignes 25 à 31. Il détermine par deux fois l’adjectif ejndehv~, employé au pluriel34.Ceux « qui manquent de moyens de subsistance » sont, comme l’indiquent les bribes deslignes 25 et 26, les parents proches – descendants ou ascendants – de « tel ou tel de ceuxqui sont morts » : ªtwn - - - - - ⁄ tºe≥ªteºleuthkovtwn tinov~. Il faut vraisemblablement rétablirici les mots ªtwn ejm polevmwi (uel ejn twi polevmwi) ⁄ tºe≥ªteºleuthkovtwn tinov~, en s’inspirantdes lignes 32 et 36.
324 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
33. On peut aussi songer à l’infinitif actif didovnai, avec ou sans sujet exprimé. Une forme conjuguée telle quedidovtwsan uel didovtw est également possible : le sujet est-il dans ce cas le même que celui du didovtwsan
précédent (l. 17), à savoir oiJ polevmarcoi (qui serait ici sous-entendu), ou bien doit-on songer à un autrenominatif, tel que oj ajpodevkth~, disparu dans la lacune ? Cf. infra.
34. L’adjectif ejndehv~, employé absolument ou construit avec le génitif, est d’un emploi ordinaire ; voir desexemples chez Lysias : VII 41 (pavntwn) ; XIII 11 ; XIV 14 ; XVIII 23 (twn ejpithdeivwn) ; XXI 25 (pollwn) ; ouencore [Démosthène], X 41 (o{pw~ mhdeno;~ o[nte~ ejndeei`~ periofqhvsontai), 43 (tw`n ajnagkaivwn ejndeei`~
o[nta~).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 324
Qui sont les ayants droit des Braves dont les Thasiens s’engagent ainsi à assurer lasubsistance ? Le principal parallèle est celui d’Athènes et des dispositions prises danscette cité, dès le Ve siècle, en faveur des familles des citoyens morts au champ d’honneur.Les orateurs athéniens chargés de prononcer l’oraison funèbre font très souvent allusion,dans la péroraison de leurs discours, au sort de ces familles, qu’il s’agit de consoler, maisaussi de prendre en charge. C’est même un topos des epitaphioi logoi – qu’ils soientauthentiques ou fictifs – de rappeler que la douleur de la perte touche, d’un côté, lesenfants et, de l’autre, le père et la mère de chaque mort, et que la sollicitude de la citése portera désormais sur les uns et les autres. « Il est pénible », écrit Démosthène dansson oraison funèbre, « pour un père et une mère d’être privés de leurs enfants et de man-quer des plus chers nourriciers de leur vieillesse ; c’est du moins une auguste faveur quele spectacle de ces hommes qui ont obtenu de la cité des honneurs qui ne vieilliront paset la commémoration de leur valeur, ainsi que les sacrifices et les concours immortelsdont ils ont été jugés dignes. Il est douloureux, pour des enfants, de se trouver orphe-lins de père ; c’est du moins un bel avantage que de recevoir en héritage la réputationpaternelle35 ». Et Lysias d’ajouter : « Nous n’avons qu’un moyen, je crois, de témoignernotre reconnaissance à ceux qui reposent ici, c’est de faire grand cas de leurs géniteurs(tokei~), comme ils le faisaient eux-mêmes, de chérir leurs enfants comme si nousétions nous-mêmes leurs pères, et d’assister leurs épouses comme ils les assistaient deleur vivant36 ». Platon fait dire à Socrate, rapportant les paroles d’Aspasie, dans un pas-sage du Ménexène, que la cité « tout simplement, tient lieu aux morts d’héritier et defils, aux fils de père, à leurs parents (gonei~) de tuteur, prenant entièrement soin de touten tout temps37 ».
Les modalités pratiques de cette prise en charge ne sont connues, à Athènes, que pourles orphelins38. Dans le discours que lui prête Thucydide, Périclès évoque en conclusion lesort des seuls orphelins mâles, héritiers présumés des qualités de leurs pères, à l’exclusion
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 325
BCH 131 (2007)
35. Démosthène, LX (Epitaphios) 36-37 : calepo;n patri; kai; mhtri; paivdwn sterhqh`nai kai; ejrhvmou~ ei\nai tw`n
oijkeiotavtwn ghrotrovfwn: semno;n de; gΔ ajghvrw~ tima;~ kai; mnhvmhn ajreth`~ dhmosiva/ kthsamevnou~ ejpidei`n kai;
qusiw`n kai; ajgwvnwn hjxiwmevnou~ ajqanavtwn. Luphro;n paisi;n ojrfanoi`~ gegenh`sqai patrov~: kalo;n de; ge;
klhronomein patrw/va~ eujdoxiva~ (traduction de R. CLAVAUD, Collection des universités de France, modifiée).
36. Lysias, II (Epitaphios) 75 : movnhn dΔ a[n moi dokoumen tauvthn toi~ ejnqavde keimevnoi~ ajpodounai cavrin, eij tou;~
me;n tokeva~ aujtw`n oJmoivw~ w{sper ejkei`noi peri; pollou` poioivmeqa, tou;~ de; pai`da~ ou{tw~ ajspazoivmeqa w{sper
aujtoi; patevre~ o[nte~, tai~ de; gunaixi;n eij toiouvtou~ bohqou;~ hJma~ aujtou;~ parevcoimen oi|oivper ejkeinoi zwnte~
h\san (traduction de M. BIZOS, Collection des universités de France, modifiée).
37. Platon, Ménexène 249 b-c : kai; ajtecnw`~ twn me;n teleuthsavntwn ejn klhronovmou kai; uJevo~ moivra/ katesthkuia,
twn de; uJevwn ejn patrov~, gonevwn de; twn touvtwn ejn ejpitrovpou, pa`san pavntwn para; pavnta to;n crovnon ejpimevleian
poioumevnh.
38. STROUD 1971, p. 280-301, fournit toutes les références utiles.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 325
des filles et des parents âgés : « en ce qui concerne les faits, ceux que nous ensevelissons ontdéjà reçu notre hommage et, pour ce qui est de leurs paide~, la cité les élèvera à partir demaintenant à frais publics jusqu’à leur majorité39 ». Hypéride concentre lui aussi sonattention et celle de ses auditeurs sur l’aide publique accordée aux mineurs : « Pour tousceux qui ont laissé derrière eux des paide~, la bienveillance de la patrie servira de tutrice àleurs enfants40 ». L’idée de faire des orphelins de guerre des pupilles de la cité reviendrait àHippodamos de Milet, si l’on en croit Aristote : « il proposait une loi (...) prescrivant quel’on prenne en charge, sur les finances publiques, la subsistance (trofhv) des pai`de~ desmorts à la guerre, comme si (uel parce que) cette loi n’avait pas encore été prise chez lesautres ; une telle loi existe de nos jours aussi bien à Athènes que dans d’autres cités41 ». Aumoins dès le second quart du Ve siècle, d’après l’Athènaiôn Politeia, la cité d’Athènesassurait effectivement l’entretien des orphelins de guerre, souvent désignés par le simpleterme d’ojrfanoiv42. Il semble clair que les paide~ concernés étaient uniquement les garçonsmineurs. Thucydide ne parle en effet que des fils élevés « jusqu’à leur majorité » (mevcrih{bh~), c’est-à-dire – comme Platon le précise dans le Ménexène – jusqu’à ce « qu’ils fussentdes hommes faits » (ejpeida;n eij~ ajndro;~ tevlo~ i[wsin), en âge de recevoir un équipementmilitaire lors des Grandes Dionysies et d’accéder à l’autonomie juridique et politique43.Au lendemain de la chute des Trente (403/402), les Athéniens décidèrent, sur laproposition de Théozotidès, d’étendre ce privilège insigne aux orphelins des citoyensmorts en combattant pour la démocratie ou qui furent victimes d’une exécution arbitrairesous le régime oligarchique. D’après la stèle retrouvée en 1970 sur l’Agora, ces garçonsfurent assimilés aux fils des morts pour la patrie et reçurent à ce titre une indemnité :ªmerivºsai toi~ ªpaisºi;≥ aª......º t≥ªovtºwªnº ojªbºo≥l≥o;n ªth~º hJmevra~ tªrofhvnº44. Attribuée à tous
326 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
39. Thucydide, II 46 : kai; e[rgw/ oiJ qaptovmenoi ta; me;n h[dh kekovsmhntai, ta; de; aujtw`n tou;~ pai`da~ to; ajpo; tou`de
dhmosivaÛ hJ povli~ mevcri h{bh~ qrevyei.
40. Hypéride, VI (Epitaphios) 42 : o{soi de; paida~ kataleloivpasin, hJ th~ patrivdo~ eu[noia ejpivtropo~ aujtoi~ twn
paivdwn katasthvsetai.
41. Aristote, Politique II 1268 a 8-11 : novmon ejtivqei (...) toi~ paisi; tw`n ejn tw/` polevmw/ teleutwvntwn ejk dhmosivou
givnesqai th;n trofhvn, wJ~ ou[pw touto par Δ a[lloi~ nenomoqethmevnon: e[sti de; kai; ejn ΔAqhvnai~ ou|to~ oJ novmo~ nu`n
kai; ejn eJtevrai~ twn povlewn. Le sens de la conjonction wJ~ (explicative ou ironique) est sujet à discussion, etrien n’indique clairement si cette proposition s’appliquait à Milet, la patrie d’Hippodamos, ou à Athènes,où il séjourna.
42. Aristote, Ath. Pol. 24, 3. Cf. P. J. RHODES, A Commentary on the Athenaion Politeia2 (1993), ad loc. Voirégalement IG I3 6 C, l. 40-41.
43. Lysias, frag. 6 (C. Théozotidès) : touvtou~ hJ povli~ e[trefe mevcri h{bh~ ; Eschine, III (C. Ctésiphon) 154 : mevcri
me;n h{bh~ oJ dhmo~ e[trefe ; Platon, Ménexène 249 a : tou;~ de; paida~ sunektrevfei aujthv.
44. STROUD 1971 (SEG XXVIII 46). La date de 403/402, proposée par l’éditeur et fondée sur l’identificationde l’oligarchie mentionnée l. 5 avec le régime des Trente, a généralement été acceptée (cf.A. G. WOODHEAD, The Athenian Agora XVI. The Decrees [1997], n° 106 A, où le document est signalé,
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 326
sur un pied d’égalité, sans distinction entre les classes censitaires, cette gratification avaitune signification plus honorifique que sociale. Thucydide l’exprime clairement, par lavoix de Périclès, quand il la compare à une « utile couronne [que] la cité offr[ait] à ceshommes et à ceux qu’ils laissaient derrière eux comme prix de tels exploits45 ». Lessituations économiques étaient en fait certainement très différentes d’un orphelin àl’autre. Il est donc douteux que tous aient effectivement profité de la sitèsis qui leur étaitofferte au prytanée. Les plus fortunés se contentaient sans doute du caractère potentiel del’honneur46.
Il n’est jamais question, dans les documents athéniens, du sort des filles mineures47.Celui des parents âgés des défunts est évoqué, on l’a vu, par Lysias, par Démosthène et parPlaton. Mais le propos est généralement plus évasif à leur sujet qu’au sujet des orphelins.La cité doit « prendre soin » ou « faire grand cas » de ces vieillards. Ainsi lit-on, dans laprosopopée des morts, à la fin du Ménexène : « nous inviterions la cité à prendre soin denos pères et de nos fils, en élevant décemment les uns et en nourrissant dignement lavieillesse (ghrotrofou`nte~) des autres. » Et Socrate (ou Aspasie) reprend, un peu plusloin : « à mon tour, je demande en leur nom, aux premiers d’imiter leurs pères, aux secondsde se rassurer sur eux-mêmes, sachant que nous nourrirons votre vieillesse et prendronssoin de vous, à titre privé comme à titre public, partout où l’un de nous rencontrera l’unou l’autre, quel qu’il soit, des parents des morts ; et pour ce qui est de la cité, vous savezvous-mêmes avec quelle sollicitude elle a établi des lois au sujet des garçons et des géni-teurs (pai`dav~ te kai; gennhvtora~) des hommes morts à la guerre et comme elle veille sureux et, plus que les autres citoyens, elle a chargé la magistrature la plus haute de protéger
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 327
BCH 131 (2007)
mais non repris in extenso), sauf par I. CALABI LIMENTANI, « Vittime dell’oligarchia. A proposito del decretodi Teozotide », in Studi in onore di Cesare Sanfilippo, VI (1985), p. 115-128, qui reconnaît dans le régimeincriminé celui des Quatre-Cents et préfère placer le décret vers 410, sans convaincre. Sur le sens del’expression biaivw/ qanavtw/ ajpoqnh/vskein – qui peut en fait s’appliquer tout aussi bien aux crimes de l’année404/403 –, voir les remarques d’I. CALABI LIMENTANI, loc. cit.
45. Thucydide, II 46 : aujtwn tou;~ paida~ to; ajpo; toude dhmosivaÛ hJ povli~ mevcri h{bh~ qrevyei, wjfevlimon stevfanon
toisdev te kai; toi~ leipomevnoi~ twn toiwnde ajgwvnwn protiqei`sa.
46. Voir les remarques de STROUD 1971, p. 291, n. 30. L’accusateur anonyme de Théomnestos, connu par undiscours de Lysias, faisait partie de ces orphelins de l’année 404/403, âgé de treize ans quand son père, unpersonnage important, fut assassiné par les Trente (Lysias, X 4-5 ; 27) : il ne fait pas état, dans son plaidoyer,de l’indemnité à laquelle il était en droit de prétendre, mais il est vrai que l’argumentation porte sur uneautre question.
47. S. B. POMEROY (supra, n. 24), p. 125-126, rapprochant le décret pour Théozotidès et le décret des Braves deThasos, a envisagé la possibilité que le décret athénien ait lui aussi comporté des clauses relatives à la dot desorphelines, mais l’hypothèse ne s’appuie sur aucun élément tangible et n’emporte pas la conviction.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 327
contre l’injustice les pères et les mères (patevre~ te kai; mhtevre~) de ces morts, tandis quepour les garçons, elle se charge elle-même de les élever (tou;~ de; pai`da~ sunektrevfeiaujthv)48 ». Les Athéniens en général étaient donc invités à prêter attention aux vieillardsque l’absence d’autres fils majeurs aurait laissés sans aucun soutien financier. La cité,quant à elle, s’engageait également à ne pas les oublier, mais Platon semble souligner lecontraste existant entre les fils, pour l’éducation desquels elle s’impliquait directement(aujthv), et les parents âgés, que l’archonte éponyme avait simplement le devoir d’assisteren cas d’injustice. Le texte de Platon est relativement imprécis : l’impression en ressortque l’engagement public n’était pas de la même nature pour les uns et pour les autres. Defaçon générale, aucun indice ne permet de penser que la cité d’Athènes ait assuré la ghro-trofiva de ces vieillards par le versement d’une indemnité spécifique. Ce devoir incombaiten principe aux proches parents. Un vieillard démuni et abandonné des siens pouvaitpeut-être solliciter en dernier ressort l’aide publique versée aux invalides et invoquer alorsles services rendus à la patrie par son fils mort à la guerre49.
Il faut invoquer l’exemple d’une autre cité, Rhodes, qui prit à la fin du IVe siècle desmesures analogues. Assiégés en 305 par Démétrios Poliorcète, les Rhodiens, voulant encou-rager l’esprit de résistance, promirent honneurs aux défunts et protection à leurs familles,en s’inspirant peut-être des usages athéniens. À la différence d’Athènes et des « autrescités » auxquelles fait allusion Aristote dans le passage de la Politique cité plus haut, ledécret rhodien prit en considération non seulement le sort des garçons orphelins, maisaussi celui des parents âgés ainsi que des filles des morts, comme en témoigne Diodore :« Ils rédigèrent un décret selon lequel les hommes morts au combat seraient ensevelis àfrais publics, tandis que leurs parents (gonei~) et leurs enfants (paide~) seraient entre-tenus et recevraient une aide versée sur la caisse publique ; par ailleurs, leurs filles seraientdotées par les soins de la cité et l’on octroierait au théâtre, lors des Dionysies, une panoplieà leurs fils, une fois arrivés à l’âge adulte50 ». Le dispositif rhodien était donc plus completet nécessairement plus coûteux que celui en vigueur à Athènes.
Thasos institue elle aussi une allocation de subsistance pour les victimes de guerre : mh;pleion (...) eJkavstwi tessevrw≥ªnº ojbolwn, « à chacun, pas plus de 4 oboles » (l. 30-31). Lemontant indique qu’il s’agit d’une indemnité journalière. On la comparera à l’indemnité
328 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
48. Platon, Ménexène 248 d – 249 a.
49. Le cas – exceptionnel – des deux parentes de Lysimachos, descendant d’Aristide, connu par Plutarque, Vied’Aristide 27, 5, n’a rien à voir avec les morts à la guerre. Cf. J. K. DAVIES, Athenian Propertied Families(1971), no 1695, part. p. 52.
50. Diodore, XX 84 : e[grayan de; kai; tw`n teleuthsavntwn ejn tw/` polevmw/ ta; me;n swvmata dhmosiva/ qavptesqai, tou;~
de; gonei~ kai; paida~ trevfesqai lambavnonta~ th;n corhgivan ajpo; tou koinou tamieivou, kai; ta;~ me;n parqevnou~
dhmosiva/ proikivzesqai, tou;~ dΔ uiJou;~ ejn hJlikiva/ genomevnou~ ejn tw/` qeavtrw/ stefanw`sai toi`~ Dionusivoi~
panopliva/.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 328
d’1 obole par jour octroyée, à Athènes, aux orphelins des morts de l’année 404/40351,ainsi qu’à celle d’1 obole versée aux invalides athéniens adultes à la fin du Ve siècle, etportée ensuite à 2 oboles, taux en vigueur au temps d’Aristote52. Le discours de Lysias,Contre Diogiton, un tuteur accusé d’avoir dilapidé la fortune de ses trois pupilles, permetpar ailleurs de comparer ces montants relativement modiques aux dépenses consentiespour l’entretien et l’éducation d’orphelins de milieu aisé, au tout début du IVe siècle : ellesne sauraient dépasser 1 drachme par enfant et par jour, selon l’accusateur, maisl’estimation comprend la nourriture de deux esclaves attachés à leur service53. L’Assembléede Thasos ne fixe pas une somme forfaitaire pour tous les bénéficiaires concernés ; elledétermine un montant maximal, un plafond de 4 oboles. Les allocations versées variaientdonc peut-être entre 1 et 4 oboles. Nous essayerons plus loin de rendre compte de cetteparticularité, en examinant les différentes modalités de versement envisageables.
Il convient pour l’instant de commenter pas à pas la procédure complexe à laquelledoivent se soumettre les bénéficiaires de la trophè et qui est décrite en grand détail de laligne 25 à la ligne 30. On s’interrogera ensuite sur l’identité de ces bénéficiaires, laquellenous est dérobée par la cassure entre les fragments A et B. Il nous semble que l’on peutenvisager deux hypothèses – mineurs orphelins ou parents âgés – et fournir des argumentsà l’appui de l’une et de l’autre, sans qu’il soit aisé de trancher entre elles. Notons d’embléeun point important concernant la syntaxe du passage en question. La particule de liaisondev n’apparaît pas dans les lignes 25 à 31, alors qu’elle est systématiquement employée tout
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 329
BCH 131 (2007)
51. SEG XXVIII 46, l. 9-10.
52. Lysias, XXIV (Pour l’invalide) 26 ; Aristote, Ath. Pol. 49, 4 : (...) dokimavzein me;n th;n boulhvn, didovnai de;
dhmosiva/ trofh;n duvo ojbolou;~ eJkavstw/ th`~ hJmevra~. Cf. M. DILLON, « Payments to the Disabled at Athens :Social Justice or Fear of Aristocratic Patronage ? », AncSoc 26 (1995), p. 27-57. L’indemnité versée, à la findu IVe s., d’après Plutarque, Vie d’Aristide 27, 5, aux descendantes d’Aristide s’élevait à 3 oboles par jour ; lemontant en fut porté ensuite à 1 drachme. Vers 334, les Athéniens accordèrent à Peisitheidès de Délos, quis’était réfugié chez eux, une allocation d’1 drachme par jour – ce qui, sauf erreur, constitue un cas uniquedans l’épigraphie athénienne : o{pw~ a]n de; mh; ajporh`tai tªrofh`~ Peiºsiqeivdh~, e{w~ a]n katevlqªhi eij~ Dh`ºlon,
to;n tamivan tou` dhvmou ªto;n ajei; tºamªiºeuvonta didovnai Peisªiqeivdhiº dracmh;n th`~ hJmevra~ ejk tw`ªn kata;
yhfivºsmata ajnaliskomevnwn ªtwi dhvmwiº (IG II2 222, l. 35-41 ; cf. M. J. OSBORNE, Naturalization in AthensI [1981], no D 22, et II [1982], p. 87-90]). La loi d’Ilion contre la tyrannie et l’oligarchie, datée du débutdu IIIe s., alloue au meurtrier du tyran, à vie, une pension journalière de 2 drachmes, s’il est citoyen, et sansdoute d’1 drachme, s’il est esclave : I. Ilion 25, l. 27-28 et l. 35-36.
53. Lysias, XXXII (C. Diogiton) 28 ; le tuteur Diogiton estimait lui-même, dans ses comptes de tutellefrauduleux, avoir dépensé 5 oboles par enfant et par jour pour les seuls frais de nourriture (o[yon : ibid., 20),c’est-à-dire sans compter toutes les autres dépenses liées à l’habillement ou à l’éducation. Cette estimationest jugée exorbitante par l’accusateur. La tutelle de Diogiton sur ses trois pupilles, deux garçons et une fille,s’étendit sur huit ans, de 409 à 401. On retrouve le même montant, un peu plus tard au IVe s. :Démosthène, XXVII (C. Aphobos I) 36 estime que son tuteur dépensait 700 drachmes par an pour la trofhv
de ses deux pupilles, soit un peu moins d’1 drachme par jour et par enfant.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 329
au long du texte, sans aucune exception, pour marquer le passage d’une phrase à l’autre :nous avons donc affaire à une seule et même longue phrase, dont la principale est la propo-sition infinitive ejpidevkesqai aujtou;~ ktl. (l. 29). Les mots qui précèdent (l. 25-28) appar-tiennent très vraisemblablement à une proposition subordonnée (conditionnelle),elle-même assez longue : il peut s’agir soit d’une proposition circonstancielle, introduitepar une conjonction de subordination telle que a[n (« si ... »), soit d’une propositionrelative, introduite par le pronom corrélatif indéfini oJpovsoi a[n (« tous ceux qui ... »). Nouspréférerions la seconde construction, qui est très courante en grec et s’appuie sur leparallèle de la l. 16 (oJpovsoi dΔ a]n aujtwn ktl.)54.
La procédure comprend quatre étapes.
1) Les intéressés, s’ils sont nécessiteux (trofh`~ ejndeei`ª~º o[nteª~º, l. 26), devront seprésenter devant le Conseil et l’Assemblée du peuple (ªejºpi; th;n boulh;n kai; to;n dh`mon,l. 27) pour y formuler une requête. Dans son état actuel, la ligne 26 compte trente-septlettres ; après la cassure, la ligne pouvait encore contenir une dizaine de lettres aumaximum. Or ejpi; th;n sont des mots courts, qui auraient très bien pu être gravés aprèso[nte~≥, dans l’espace disponible à la fin de la ligne 26. S’ils ne l’ont pas été, c’est qu’un autremot, long de plus de trois lettres, s’intercalait à l’origine entre o[nte~≥ et ejpiv. Il a été emportédans la cassure. Le participe o[nte~≥ étant nécessairement commandé par un verbeconjugué, il est patent que le mot à restituer est précisément ce verbe, à la troisièmepersonne du pluriel du subjonctif, dépendant de la conjonction (disparue) a[n ou durelatif oJpovsoi a[n.
La démarche consistant, pour un particulier, à se présenter devant (ejpiv) les autoritésciviques est bien attestée dans de nombreuses cités grecques : elle est désignée, selon lesendroits, par le terme technique de prosodos ou d’ephodos. À Thasos, le verbe employé esttoujours ejpevrcesqai, comme l’indique par exemple la clause de sauvegarde de tel décretde la fin du IVe siècle : mh; ejxei`nai uJpe;r touvtwn mhdeni; mhvte eijpei`n mhvtΔ ejpelqei`n uJpe;rluvsio~ mhvtΔ ejpiyhfivsai ajkrateva poih`sai tau`ta ta; ejyhfismevna (« qu’il ne soit permis àpersonne de faire une proposition ou de se présenter [sc. devant le Conseil et l’Assembléepour soumettre un projet de décret] concernant l’abolition [sc. de ces mesures], ni demettre aux voix une proposition visant à rendre caduques les mesures adoptées dans leprésent décret55 »). La démarche des requérants est résumée un peu plus loin, à la
330 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
54. L’aspect indéfini paraît indispensable. Une circonstancielle commençant par a[n tine~ semble exclue à causede la présence du pronom indéfini tino~, complément du sujet de la subordonnée.
55. IG XII 8, 267 (republié par A. L~AJTAR, A. TWARDECKI, Catalogue des inscriptions grecques du musée nationalde Varsovie, JJP Suppl II [2003], no 13), l. 11-13. Voir également IG XII Suppl 350, l. 4-5 ; 355, l. 5-6 ; 362,l. 9-10. Nous n’avons qu’un exemple de proposition effectivement issue d’une telle ephodos, enl’occurrence une proposition faite par les archontes : peri; w|n oiJ a[rconte~ ejfhkoªnº (IG XII Suppl 358, l. 2) ;ejfhvkein est ici une variante d’ejpevrcesqai. [Il me semble que le même verbe ejpevrcesqai, topique à Thasos,
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 330
ligne 29 : tou;~ ejpiovnta~. Il fait peu de doute que c’est le verbe ejpevrcesqai qu’il convientde restituer ici, au subjonctif : ªejpivwsinº (uel ªejpevlqwsinº). Une telle restitution donne untotal de quarante-quatre ou quarante-six lettres, ce qui convient à la longueur des lignes.
On ne peut restituer avec certitude le début de la phrase. On pourrait par exemplesonger à en rétablir le mouvement comme suit : ªoJpovsoi dΔ a]n tw`n - - - tw`n ejm polevmwi ⁄tºe≥ªteºleuthkovtwn tino;~, trofh~ ejndeeiª~º o[nteª~, ejpivwsin ⁄ ejºpi; th;n boulh;n kai; to;n dhmonperi; trof≥h≥`~ ktl. (« Tous les (...) de l’un de ceux qui sont morts à la guerre qui viendront,parce qu’ils sont dépourvus de moyens de subsistance, se présenter devant le Conseil et lePeuple au sujet d’une allocation de subsistance, etc. »). Le relatif oJpovsoi était nécessai-rement précisé par un complément au génitif partitif ; vient ensuite un second partitif –ªtwn ejm polevmwi (Ù) ⁄ tºe≥ªteºleuthkovtwn – qui, lui, détermine l'indéfini tino;~ : pour éviterque les deux génitifs ne se suivent immédiatement, il est possible qu'on ait glissé la propo-sition secondaire ª- - -ºa≥ e[th genevsqai entre les deux (cf. infra)56. La construction demeureincertaine et le sens général est relativement clair.
2) Une fois la demande de prise en charge déposée devant les autorités civiques, deuxcollèges de magistrats procéderont à l’étape suivante. Il s’agit des trois archontes et des sixapologoi. Ce dernier collège a ordinairement une fonction de contrôle, en particulier surles autres magistrats : il est chargé d’introduire devant le tribunal les procès à l’encontredes magistrats défaillants et de se porter accusateur au nom de la cité (cf. infra).
Les nominatifs oiJ a[rconte~ kai; oiJ ajpovlogoi dépendent ici d’un verbe conjugué qui a,lui aussi, disparu en grande partie. Il n’est cependant pas difficile d’en reconnaître la trace,après la conjonction de coordination k≥aiv, à la fin de la ligne 27 : doªkimavzwsinº (ueldoªkimavswsinº57). La restitution du verbe dokimavzein58 peut s’appuyer sur le parallèle
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 331
BCH 131 (2007)
doit être restitué au subjonctif présent dans la clause de sauvegarde du décret sur la restaurationdémocratique (407 ou 390 [?]) : mhde; yhvfisma mhde; o{rko~ mhdei;~ ª- - - - - to; yhvfisma toto, ajllΔ o{ ti a]n ejpivªhi
ti~ para; tauta h] levghi h] ejpiyhfivºzhi h] o{rkon ojmnuvhi pavnta ajkraªteva e[stwº (SEG XXXVIII 851 B, l. 13-16 ;cf. POUILLOUX 1954, p. 169-170, trop hésitant) ; je restituerais de même, dans le décret IG XII 8, 264, l.15-16, qui complète peut-être le précédent : o}~ dΔ a]n para; tautªa ejpivhi h] levghi h] ejpiyhfivzhi a[timo~ Ù e[stwº
kai; ta; crhvmata aujto iJra; e[stw to ÔHraklevªo~.º (P. H.)].
56. On ne peut loger plus d’une vingtaine de lettres après genevsqai, à la fin de la l. 25.
57. L’aspect aoriste, au sens d’un futur antérieur, pourrait ici être préférable à l’aspect présent. Chr. FEYEL,RPhil 2003, p. 37-65, a récemment rassemblé des exemples de dokimavzein et rappelé que le verbe a toujoursle sens d’« examiner en vue d’accepter ou refuser, expertiser, etc. ».
58. Pour d’autres exemples de dokimavzein construit avec une proposition infinitive, voir Lysias XXVI 21 ;Eschine II 113 ; I. Cret. I, XIX (Malla), 3, l. 14-15.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 331
offert par le décret de Théozotidès : celui-ci fait état d’une docimasie des orphelins athé-niens de 404/403, sans qu’on sache si elle incombait à un tribunal populaire ou à laBoulè59. La proposition subordonnée à ejpidevkesqai comprend donc en fait deux verbescoordonnés, ªejpivwsinº et doªkimavzwsinº, dont les sujets sont différents et qui sontconstruits dans une structure en chiasme. Si la subordonnée commençait bien en tant queproposition relative introduite par oJpovsoi a[n, il faut admettre que les mots k≥aivdoªkimavzwsinº oiJ a[rconte~ kai; oiJ ajpovlogoi ktl. introduisent une anacoluthe (le rédacteurayant voulu préciser, par une incise, un point de procédure important – la docimasie –avant de passer à la proposition principale). La structure de la phrase peut surprendre,mais elle ne nous paraît pas inadmissible dans un texte à la syntaxe quelquefois difficile :la phrase précédente (l. 16-22 : oJpovsoi dΔ a]n aujtw`n ktl.) offre un autre exemple deconstruction relativement complexe.
Les deux collèges de magistrats concernés devront prêter serment (ojmovsante~)60. Dansl’épigraphie thasienne, cette précaution rappelle une clause, malheureusement mutiléeet donc très incertaine, du règlement sur les carpologues : ceux-ci, magistrats ou telônai,recevaient des déclarations sur les récoltes exportées hors de Thasos et soumises à destaxes ; il semble qu'ils s'engageaient par serment à vérifier l'exactitude des déclarationsenregistrées et donc à résister à toute tentative de pression de la part de fraudeurs61. Aprèsavoir prêté serment, les archontes et les apologoi ont ici pour tâche de vérifier que lesdemandeurs (tou;~ ejpiovnta~) sont effectivement incapables de subvenir à leurs besoins(ejnªdºeei~ ei\n≥ªaiº (...) trofh~), c’est-à-dire qu’ils ne disposent pas de ressources patrimoniales
332 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
59. SEG XXVIII 46, l. 15 : dªokiºmasav≥tw aujªtºo;≥ª~ - - -º, avec le commentaire de STROUD 1971, p. 297 et enparticulier la n. 30. R. STROUD estime qu’il n’est pas possible de déterminer si la docimasie des orphelinsà laquelle fait allusion le Ps.-Xénophon, Const. Ath. III 4 (ojrfanou;~ dokimavsai), concernait les seulsorphelins de guerre (après la mort de leur père, puis à nouveau au moment de la remise d’une panoplie lorsde la majorité) ou bien tous les orphelins athéniens en général (au moment de leur accession à l’autonomiejuridique). P. J. RHODES, A Commentary on the A.P.2 (1993), p. 309, suggère cependant l’étroite parentéentre ce passage du Ps.-Xénophon et un passage d’Aristote, Ath. Pol. 24, 3, où il est bien question desorphelins de guerre entretenus aux frais de la cité.
60. Comparer une inscription d’Héraclée de Lucanie (IVe s.) : ojmosavnte~ dokimaxovnti kai; ajnangelivonti ejn ajliva/
(IJG, XII, I, l. 118 ; la docimasie porte sur la qualité de terres sacrées louées à des particuliers).
61. Fr. SALVIAT, « Le règlement des carpologues de Thasos IG XII Suppl. 349 », Études classiques III (1968-1970), p. 237-247 (BCH Suppl XIII [1986], p. 152-153 ; SEG XXXVI 792), avec le commentaire p. 245 àpropos de la l. 6 : ª- - -º mhv tiv~ moi dokhi to; tevlo~ ª- - -º. Sur le règlement, qui date du dernier quart du Ve s.environ, voir également M. BRUNET, « L’économie d’une cité à l’époque classique : Thasos », inM. DEBIDOUR (coord.), Économies et sociétés dans la Grèce égéenne (2007), p. 311-331, part. p. 321-322.On comparera le serment exigé des membres d’un tribunal thasien dans un règlement contemporain denotre document : POUILLOUX 1954, 150 (SEG XVII 416), l. 15-16 (dikavzein de; aujtou;~ ojmnuvnta~ ªkata; ⁄
tou;~ novmou~ wJ~ ijsovtºata kai; dikaiovtata).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 332
suffisantes et répondent bien aux critères retenus à Thasos pour définir l’état d’indigence62.En cela, la procédure rappelle la docimasie des invalides effectuée à Athènes par le Conseil,qui devait s’assurer du fait qu’ils étaient incapables de travailler et que leur patrimoineétait inférieur à trois mines63.
3) Si la docimasie confirme l’état d’indigence, la procédure se poursuivra devant l’As-semblée. Les prytanes doivent introduire les requérants devant l’Ekklèsia, comme l’indi-quent les verbes ejpidevkesqai et ejpavgein, qui sont des termes techniques du vocabulairedes assemblées (cf. infra). Une proposition, dont les auteurs ne sont pas explicitementdésignés, mais qui sont peut-être les archontes et les apologoi ou encore les prytanes eux-mêmes (?), est alors soumise au vote des citoyens. Elle consiste, comme on l’a vu, àaccorder une allocation individuelle.
4) L’indemnité sera versée aux intéressés par l’apodecte, administrateur général desfinances de la cité, en charge des revenus civiques (cf. infra). Thasos n’a pas institué unenouvelle magistrature ou commission, spécialement chargée de gérer les fonds réservésaux bénéficiaires de cette allocation, comparable au trésorier athénien des invalides ouencore au collège athénien des ojrfanofuvlake~. Ces derniers sont connus par une brèveallusion de Xénophon et pourraient avoir été chargés de veiller à l’attribution de la trofhvaux orphelins de guerre64. Comme à Rhodes à la fin du IVe siècle, l’indemnité est ici direc-tement prélevée sur la caisse générale de la cité.
Quant à l’identité des bénéficiaires, une première hypothèse consiste à y reconnaître lesorphelins de guerre mineurs et à déceler ici encore une parenté très étroite entre lesmesures prises par les Thasiens et les usages athéniens. Les clauses précédentes (l. 9-22)n’ont envisagé, à propos des orphelins, qu’un certain nombre de privilèges honorifiquesainsi que l’octroi d’une panoplie ou d’une dot, selon le sexe. Rien n’a encore été explici-tement prévu pour leur entretien permanent. Si c’est bien d’eux qu’il est ici question, lanouvelle clause vient donc naturellement compléter le dispositif, en organisant leur trophèjusqu’à la majorité. Les Thasiens se démarquent cependant du modèle athénien sur unpoint important : la prise en charge ne concernera pas tous les orphelins indistinctement,
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 333
BCH 131 (2007)
62. La procédure de docimasie prévue à Athènes en 403/402 visait à vérifier l’ascendance civique desbénéficiaires et la légitimité de leur naissance : cf. STROUD 1971, p. 291 ; elle ne portait donc pas sur lemême objet que celle prévue à Thasos.
63. P. J. RHODES, The Athenian Boule (1972), p. 175-176, avec les références ; M. DILLON (supra, n. 52).
64. Aristote, Ath. Pol. 49, 4 (trésorier des invalides) ; Xénophon, Poroi II 7 (orphanophylaques), avec le com-mentaire prudent de Ph. GAUTHIER, Un commentaire historique des Poroi de Xénophon (1976), p. 68-71.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 333
mais seulement une partie d’entre eux, à savoir ceux que la mort de leur père a plongésdans un réel dénuement. Il ne s’agit donc pas d’une mesure honorifique supplémentaire,à caractère égalitaire, comparable à l’octroi de parts de sacrifices à tous les pères et fils lorsdes cérémonies pour les héros (l. 12) ou à l’attribution d’une panoplie à tous les garçons etd’une dot à toutes les filles (l. 16-22)65. Nous avons ici affaire, au contraire, à une authen-tique mesure d’assistance, à caractère social, attentive à la variété des niveaux de revenus etaux situations individuelles.
À l’appui de l’identification des ayants droit comme les orphelins mineurs, on peutinvoquer deux arguments. Le premier réside dans les bribes de mots au début de la l. 25 :ª- - - - -ºa e[th genevsqai. Il semble que l’on définit ici une limite d’âge supérieure. Noussommes tentés de rattacher ces mots à la procédure de demande de trophè et decomprendre que la démarche ne sera plus possible au-delà du seuil ainsi énoncé : le plussimple est de songer au seuil de la majorité, atteint au bout d’un certain nombre d’années(variable selon chaque individu), par les orphelins. Si l’interprétation est la bonne, il peutthéoriquement s’agir des enfants orphelins en général, c’est-à-dire aussi bien des garçonsque des filles. Cependant, étant donné que la majorité n’est pas la même pour les deuxsexes et qu’une seule limite d’âge semble être ici prise en compte, nous croirions qu’il n’estquestion que des garçons, dont la majorité civique est fixée à seize ou à dix-huit ans66.Pour indiquer une limite d’âge atteinte, à propos de la dot des filles, le texte construit unpeu plus haut le verbe givgnesqai avec le génitif (l. 22 : ªo{tan tesºsevrwn kai; devka ejtw`ngevnwn≥ªtaiº). Le grec emploie en fait aussi bien l’accusatif e[th (le plus souvent avecgivgnesqai au parfait)67. On pourrait donc songer ici à une formule telle que : ªpri;neJkkaivdekºa≥ (uel ojktwkaivdekºa≥) e[th genevsqai, « avant qu’ils n’atteignent l’âge de seize (oudix-huit) ans ». Il est également possible, sinon probable, que e[th soit ici le sujet degenevsqai, construit avec un complément au datif ; la formulation serait quasiment lamême : ªpri;n (aujtoi~) eJkkaivdekºa≥ (uel ojktwkaivdekºa≥) e[th genevsqai, « avant que l’âge deseize (ou dix-huit) ans ne les atteigne68 ».
Le second argument provient du passage immédiatement postérieur (l. 32-38). Laclause que nous étudions s’applique uniquement à des citoyens ou fils de citoyens thasiens
334 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
65. Sur le caractère égalitaire de ces mesures, cf. N. LORAUX, L’invention d’Athènes2 (1993), p. 47-49, avec lesréserves exprimées supra (n. 19) sur l’interprétation des l. 11-12 ; VÉRILHAC, VIAL 1998, p. 164.
66. Cf. l. 16-17 : o{tan ej~ th;n hJlikivhn ajfivkwntai.
67. Aristote, Ath. Pol. 42, 1 : ejggravfontai (sc. les éphèbes) eij~ tou;~ dhmovta~ ojktwv kaiv devka e[th gegonovte~.Comparer IG I3 14, l. 11 ; Lysias, VI 46 ; X 27 ; XIX 55 ; XXX 2 ; frag. 38, 5. Voir également Pollux, s.v.perivpoloi : (...) kai; eij~ me;n tou;~ ejfhvbou~ eijsh/vesan ojktwkaivdeka e[th genovmenoi.
68. Voir Hypéride, C. DIONDAS (ZPE 165 [2008], p. 11), p. 8, 1. 5 (pri;n pevnte kai; ei[kosi e[th soi genevsqai) ;Lysias, X 4 ; et le règlement de Ténos IG XII Suppl 303 (RHODES, OSBORNE 2003, 61) daté du IVe s. etrelatif à la présentation des enfants mâles devant la phratrie (l. 1-2 : (ªmh; ejsavgenº pri;n a]n penthvkonta e[th twi
patri; gevnhtai).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 334
de plein droit. Elle constitue un ensemble cohérent avec les deux clauses suivantes : celles-ci concernent d’autres catégories de la population, auxquelles sont accordées des gratifi-cations moins prestigieuses que la trophè. La première catégorie est celle des métèques ; laseconde comprend d’autres non-citoyens « dont les pères sont morts à la guerre enbraves » : il s’agit bien là explicitement et exclusivement d’enfants orphelins. Par analogie,nous sommes portés à croire que ce sont aussi les fils mineurs des citoyens qui sontconcernés par la première de ces trois clauses parallèles.
Par conséquent, il faudrait restituer le mot pai`de~ (ou peut-être uiJoiv, voire ojrfanoiv[?]) aux lignes 24-25, dans une phrase du type : ªoJpovsoi dΔ a]n tw`n paivdwn - - - tw`n ejmpolevmwi (Ù) ⁄ tºe≥ªteºleuthkovtwn tinov~, trofh`~ ejndeei`ª~º o[nteª~, ejpivwsin ⁄ ejºpi; th;n boulh;nkai; to;n dhmon peri; trof≥h≥`~ ktl. On peut aussi écrire : ªtwn de; paivdwn oJpovsoi a]n ktl.º.
L’hypothèse alternative – à notre avis moins satisfaisante – consisterait à identifier lesbénéficiaires éventuels de la trophè aux parents âgés des Braves. Le principal argument enfaveur de cette identification réside dans la procédure. Elle suppose en effet que chaquerequérant s’adresse en personne aux autorités civiques et vienne, une fois la docimasiefranchie, se présenter devant l’Assemblée. Il est en principe impossible à un mineur d’ef-fectuer lui-même une telle démarche, puisqu’il est juridiquement incapable. Seul sonkyrios – son père ou, s’il est orphelin, son tuteur – peut le faire en son nom. Or le passagerelatif à l’ephodos ne fait aucune allusion à l’intervention des tuteurs légaux des orphanoi.Il est certain, en revanche, qu’un père âgé, citoyen thasien, s’il n’a aucun autre fils ouparent proche capable d’assurer sa ghrotrofiva – situation tout à fait extrême –, pourraitparaître lui-même devant les prytanes et l’Ekklèsia pour déposer une demande de prise encharge. Il faudrait en ce cas restituer le mot gonei~ quelque part dans la lacune des l. 24-25 : (exempli gratia) ªa]n dΔ oiJ gonei~ - - - tw`n ejm polevmwi ⁄ tºe≥ªteºleuthkovtwn tino;~ trofh~ejndeei`ª~º o[nteª~ ejpivwsin ⁄ ejºpi; th;n boulh;n kai; to;n dh`mon peri; trof≥h≥`~ ktl. On objecteraque seul le père est capable de faire une ephodos et qu’en toute logique, on devrait plutôtlire une phrase au singulier. Or la proposition est indubitablement rédigée au pluriel et lepronom indéfini tino~ indique clairement que l’on parle des ayants droit d’un seul etunique Brave, pris séparément, et non des patevre~ en général. Il devient en outre impos-sible de comprendre le sens de la limite d’âge que nous avons cru déceler dans les motsªpri;n - - -ºa e[th genevsqai, si c’est de personnes âgées ou encore des parents au sens large(oijkeioi uel ajgcistei~ uel sim., aussi bien enfants que vieillards) qu’il s’agit.
Les parallèles d’Athènes et de Rhodes nous invitent à supposer a priori que lesorphelins mâles faisaient en priorité l’objet de la sollicitude de la cité et donc à attendreune clause de ce type dans un pareil règlement69. Il serait en revanche très surprenant que
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 335
BCH 131 (2007)
69. VÉRILHAC, VIAL 1998, p. 163, n. 90, avaient remarqué l’absence surprenante d’une pareille dispositiondans le règlement thasien, dans l’état où il leur était connu.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 335
l’on ait organisé le versement d’une pension aux pères âgés, sans rien prévoir par ailleurspour l’entretien des orphelins. Tout bien pesé, nous croyons donc que c’est des orphelinsindigents qu’il est question. Thasos serait l’une de ces « autres cités » (sc. qu’Athènes) quiprenaient en charge leurs orphelins de guerre et dont parle Aristote dans la Politique – quele philosophe ait ou non effectivement eu connaissance du cas thasien. Nous noussommes étonnés que le rédacteur du décret ait pu omettre le rôle des tuteurs dans laprocédure de requête si les requérants étaient des mineurs. Mais cette omission trouvepeut-être une explication dans le simple fait que les fils des Braves sont des orphelins d’untype tout à fait particulier, distincts des orphelins ordinaires, et donc qu’ils ne sont passoumis au régime normal. Il est possible que les orphelins de guerre n’aient pas eu d’autretuteur officiel que la cité elle-même, représentée par les prytanes. Il serait alors naturelqu’ils aient eu directement accès à ces magistrats, sans l’entremise d’un epitropos. Si l’ex-plication touche juste, on remarquera cependant que la demande de trophè ne pouvait pasémaner des tout jeunes enfants, incapables de s’exprimer devant les autorités publiques,mais en fait uniquement des adolescents, c’est-à-dire les paides au sens strict, les garçonsâgés de douze à dix-huit ans environ. La même démarche était, en principe, impossiblepour les filles.
Tout mutilé qu’il soit, le passage semble confirmer que les Thasiens s’inspirèrent despratiques athéniennes en matière de trophè. Ils furent cependant soucieux de justicesociale et peut-être aussi de maîtrise des dépenses publiques, ce qui explique qu’ils aientfait preuve d’une certaine originalité dans la mise en place concrète des mesuresconcernées.
L. 32-34 : versement d’une indemnité de compensation aux ayants droit des métèques
Il est vraisemblable, comme nous l’avons dit plus haut, que toutes les mesures précé-dentes, depuis l’invitation officielle aux sacrifices (l. 9) jusqu’à l’attribution d’une trophèjournalière aux orphelins indigents (l. 25-31), ne concernent que les ayants droit decitoyens thasiens. À partir de la ligne 32 est envisagé le cas des non-citoyens.
Les premiers sont les mevtoikoi. Plusieurs règlements thasiens du Ve siècle font ladistinction entre ajstoiv et xevnoi70, ce dernier terme pouvant inclure aussi bien les étrangersdomiciliés que les étrangers de passage. Nous avons ici affaire, en revanche, à la premièremention des métèques en tant que groupe dans l’épigraphie thasienne. Les inscriptionsfunéraires de l’époque classique nous faisaient certes connaître un certain nombred’étrangers établis à Thasos – dont on connaît par ailleurs l’importance en tant que port
336 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
70. POUILLOUX 1954, 7, l. 9-10 ; SEG XXXVI 792, l. 14 et 19-20 ; SEG XXXVIII 852, B, l. 12.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 336
marchand et place commerciale –, mais rien dans la manière de les désigner n’indiquaits’ils étaient simplement de passage ou bien s’ils résidaient dans la cité en permanence etétaient dotés d’un statut spécifique71. Il est désormais assuré qu’il existait bien, à Thasoscomme dans la plupart des cités classiques, une catégorie sociale institutionnaliséed’étrangers domiciliés. Il est impossible de savoir comment ce statut était défini et s’ils’inspirait directement ou indirectement des règles établies à Athènes à partir du Ve siècle(durée minimale de résidence, choix d’un prostatès, obligations fiscales, etc.)72. Un trèsmaigre fragment du traité de réconciliation conclu entre Thasos et Néapolis, aprèsplusieurs années de guerre (410-407), fait mention du statut des étrangers (ou de certainsétrangers) domiciliés à Thasos (ªejºn Qavswi oijkevosin) : les Néopolitains concernés bénéfi-cièrent peut-être, en l’occurrence, d’une atélie spéciale (ªkata;º taujta; ajtele`~ ejovntwªnº),destinée à faciliter leur séjour et à rétablir des relations de confiance entre les deux citésnaguère ennemies73. Ce serait un indice de l’existence de taxes ordinairement perçues parla cité de Thasos sur les métèques.
Le nouveau document nous apprend que des métèques pouvaient servir aux côtés descitoyens dans les rangs de l’armée thasienne, soit que le « contrat » qui les liait au corpscivique leur en ait fait obligation, soit qu’ils aient été enrôlés à titre exceptionnel et sur labase du volontariat. Le recours aux métèques n’était pas rare dans les cités classiques etfournissait souvent bien plus qu’une simple force d’appoint. Les pratiques en vigueur àAthènes sont ici encore les mieux connues74. Thucydide précise que des métèquesservirent comme hoplites au cours de la guerre du Péloponnèse, uniquement dans dessituations d’urgence : ils étaient trois mille lors de l’invasion de la Mégaride en 431, auxcôtés de dix mille hoplites citoyens ; ils étaient encore présents dans l’armée qui ravagea lePéloponnèse en 428 et à la bataille de Délion en 42475. Un passage des Poroi de Xénophonet plusieurs décrets honorifiques prouvent que, malgré le recours croissant aux merce-naires, des métèques étaient encore couramment intégrés dans les rangs athéniens auIVe siècle, aussi bien comme rameurs que comme hoplites76. En ce qui concerne les autres
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 337
BCH 131 (2007)
71. Voir un certain nombre d’exemples rassemblés par POUILLOUX 1954, p. 316-323.
72. D. WHITEHEAD, « Immigrant Communities in the Classical Polis : Some Principles for a SynopticTreatment », AntCl 53 (1984), p. 47-59 ; Ph. GAUTHIER, « Métèques, périèques et paroikoi : bilan et pointsd’interrogation », in R. LONIS (dir.), L’étranger dans le monde grec (1988), p. 23-46, part. p. 28-30.
73. SEG XXXVIII 852 A, avec les remarques de POUILLOUX 1954, p. 188-190, n. 4, et celles de GRANDJEAN,SALVIAT 1988, p. 273, qui suggèrent à juste titre que la mesure dut être réciproque. Voir égalementO. PICARD, « Thasos et Néapolis », in Mnhvmh D. Lazarivdh, RechFH 1 (1990), p. 541-548, part. p. 545.
74. D. WHITEHEAD, The Ideology of the Athenian Metic (1977), p. 82-86.
75. Thucydide, II 13, 6-7 ; III 16, 1 ; IV 90, 1. Cf. R. P. DUNCAN-JONES, « Metic Numbers in PericleanAthens », Chiron 10 (1980), p. 101-109.
76. Xénophon, Poroi II 2, avec les explications de Ph. GAUTHIER (supra, n. 64), p. 59-62.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 337
cités grecques, nous sommes mal informés sur les obligations attachées au statut demétèque, en particulier les obligations militaires. On trouve cependant çà et là quelquesindices, comme par exemple à Colophon, où le métèque Pyrrhias de Sinope fut honoré,dans les dernières années du IVe siècle, pour avoir pris part à la défense de sa cité de rési-dence77. En 305, pour résister au siège de Démétrios Poliorcète, les Rhodiens alignèrentcomme volontaires, aux côtés de six mille soldats-citoyens, mille pavroikoi et xevnoi : lesparoikoi constituaient une population locale dotée d’un statut particulier ; il est vraisem-blable qu’un grand nombre des xenoi étaient en fait des métèques78.
Certains métèques établis à Thasos peuvent, le cas échéant, mourir au combat et êtrereconnus comme « Braves », au même titre que les citoyens. La cité saura se montrerreconnaissante également à leur égard, mais elle le fera par d’autres moyens. Le texte dit,mot à mot, que l’on versera de l’argent « aux métèques, si l’un d’eux vient à mourir à laguerre » : il est clair que ce sont les survivants qui toucheront cette gratification, à savoirla famille et sans doute plus précisément les fils des métèques ainsi distingués. La citéne met cependant pas ces derniers sur le même pied que les fils des citoyens. Les ayantsdroit des citoyens reçoivent tous indistinctement un certain nombre de privilèges (l. 9-23) ; on se préoccupe en outre spécifiquement de ceux d’entre eux qui sont dans lebesoin, en leur octroyant une allocation quotidienne (l. 25-31). Les fils de métèquesperçoivent quant à eux une indemnité forfaitaire de 17 statères 1/2 qui leur est versée,selon toute apparence, en une seule fois. Il ne s’agit pas d’une allocation de subsistan-ce : des mineurs nécessiteux ne pourraient survivre que pendant un temps limité avecune telle somme, et un montant invariable, versé à des enfants d’âge différent – et parconséquent plus ou moins éloignés de la majorité –, créerait entre eux de fortes inéga-lités. Il faut de toute façon résolument écarter l’idée que la cité puisse « élever » (trev-fein) des non-citoyens : la trofhv, par laquelle les citoyens deviennent collectivement etsymboliquement des pères de substitution (w{sper aujtoi; patevre~ o[nte~, comme l’écritLysias à propos des Athéniens), est un privilège civique79. La somme de 17 statères 1/2
correspond donc à une gratification que la cité octroie à tous les fils de métèques mortsau combat (toi~ metoivkoi~ a[n ti~ ejm polevmwi teleu⁄t≥h≥vshi), quels que soient leur âge etleurs ressources. Il existe un autre exemple, dans la documentation thasienne, d’une gra-tification forfaitaire de ce type : au lendemain du renversement de l’oligarchie, à la findu Ve ou au début du IVe siècle, tous les citoyens ayant participé activement au rétablis-sement du régime populaire se virent offrir une récompense de 30 mines80. Dans le
338 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
77. D. WHITEHEAD (supra, n. 74), p. 57-58.
78. Diodore, XX 84, 2 : twn d’ejn th/ povlei katoikouvntwn paroivkwn kai; xevnwn dovnte~ ejxousivan toi~ boulomevnoi~
sunagwnivzesqai. Cf. Ph. GAUTHIER (supra, n. 72), p. 36 (avec les notes).
79. Sur le sens du mot trophè, voir Ph. GAUTHIER (supra, n. 64), p. 20-32.
80. SEG XXXVIII 851 B, l. 12 et 15, avec les explications de Ph. GAUTHIER, Bull. 1989, 254, p. 395.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 338
décret sur les Braves, la récompense de 17 statères 1/2 est l’équivalent, pour les fils desmétèques, des avantages honorifiques et matériels accordés à tous les fils de citoyensdéclarés « Braves » (l. 9-22).
Les métèques ne sont donc pas oubliés, mais l’inégalité de traitement entre citoyens etmétèques est patente et délibérée. Elle n’a au demeurant rien de surprenant dans une citéde l’époque classique. L’histoire d’Athènes fournit une illustration très claire et bienconnue de cette distinction irréductible. En 403, les métèques et les esclaves furentnombreux, parmi les compagnons de Thrasybule rassemblés à Phylè, puis au Pirée, pourrenverser le régime des Trente et restaurer la démocratie. Lysias nous apprend que « desmétèques, pour avoir porté secours à la démocratie alors que ce devoir ne leur incombaitpas, [furent] honorés d’une manière digne de la cité ». Il est cependant difficile de savoiren quoi consista la récompense : si les Athéniens octroyèrent la citoyenneté – ce qui n’estpas certain –, ils le firent avec une grande parcimonie et seuls certains des métèques purenten bénéficier81. Quant à l’aide publique réservée aux fils de ceux qui trouvèrent une mortviolente en luttant pour la démocratie, le décret de Théozotidès semble bien la réserveraux seuls orphelins de citoyenneté athénienne et en exclure les fils de métèques82. À Ilion,vers le début du IIIe siècle, une loi prévoit, pour le meurtrier d’un tyran ou du chef d’uneoligarchie, des récompenses échelonnées (récompense de 1 talent ou de 30 mines, pensionviagère de 2 ou 1 drachme[s], octroi de la citoyenneté), selon qu’il est citoyen, étranger(c’est-à-dire métèque) ou esclave83.
L. 34-38 : validité d’un précédent décret pour les fils des Braves ne pouvant bénéficier desprésentes dispositions
La clause suivante s’applique à certains ayants droit dont il n’a pas encore été question. Ils’agit cette fois-ci explicitement d’orphelins – « ceux dont les pères sont morts en Braves àla guerre » – et qui ne peuvent cependant bénéficier de l’une ou l’autre des dispositions dudécret : w|n oiJ patevre~ teteleuthvkasin ejn tw`i polevmwi a[ndre~ ajgaqoi; genovmenoi kai; mh;e[cousiv ti twn ejn twi yhfivsmati gegrammevnwn84. Pour ceux-là doit continuer à s’appliquer
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 339
BCH 131 (2007)
81. Lysias, XXXI (C. Philon) 29 ; Aristote, Ath. Pol. 40, 2 ; RHODES, OSBORNE 2003, 4. Voir D. WHITEHEAD
(supra, n. 72), p. 154-159, et J. OULHEN, in P. BRÛLÉ, R. DESCAT (dir.), Le monde grec aux temps classiques,2. Le IVe siècle (2004), p. 275-279.
82. STROUD 1971, p. 286-287 : la précision oJpovsoi ΔAqhnaivwªnº (l. 5) et le fait que chaque bénéficiaire dont lenom est gravé sur la face gauche de la stèle porte un patronyme et un démotique suggèrent que les fils desmétèques, xenoi et esclaves, n’eurent pas part à la trophè proposée par Théozotidès.
83. I. Ilion 25, l. 19-39.
84. Le mot e[cousi est un participe présent à la troisième personne du pluriel du datif, dépendant de touvtoi~,l’antécédent sous-entendu du pronom w|n.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 339
un certain décret, passé sous l’archontat de Biôn, to; yhvfisma to; ejpi; Bivwno~ a[rconto~gegenhmevnon, c’est-à-dire un état antérieur de la législation85.
Les Thasiens comprenaient certainement très bien de quoi ils parlaient. Pour nous, lecaractère allusif de la clause laisse persister deux inconnues. La première concerne lecontenu du décret passé sous Biôn. Il touchait vraisemblablement à un sujet connexe –précisé, modifié ou amplifié par le présent décret sur les Braves, mais non annulé par lui.Il se rapportait donc également – en partie du moins – aux ayants droit d’hommes mortsà la guerre. Peut-être fixait-il certains droits ou devoirs revenant aux orphelins de manièregénérale, mais de façon moins détaillée que ne le fait le nouveau décret. Une autre hypo-thèse serait qu’il définissait les honneurs réservés à toute une liste de bienfaiteurs de la cité,quelle qu’ait été leur action et quel qu’ait été leur statut. La législation présente traitantdésormais en détail de deux catégories bien particulières de ces bienfaiteurs, à savoir lescitoyens et les métèques morts à la guerre, le décret antérieur resterait valable pour tous lesautres.
La seconde inconnue concerne l’identité de ces Braves ou fils de Braves qui n’ont pasété mentionnés dans les clauses précédentes. Après les citoyens et les métèques, il doits’agir d’individus moins considérés – et donc moins privilégiés – et pour lesquels le décretpassé sous Biôn s’appliquera par défaut. Doit-on songer à une catégorie sociale précise ?La formulation très générale laisse plutôt penser que plusieurs groupes d’individus, auxstatuts divers, pouvaient être concernés.
On pourrait songer aux fils de xenoi, c’est-à-dire d’étrangers non domiciliés ni enre-gistrés comme métèques et qui seraient néanmoins morts dans les rangs de l’arméethasienne. Thasos disposait certainement, au IVe siècle, d’un nombre important d’alliés :non seulement Athènes (cf. infra), mais aussi ses colonies de la pérée. Il est donc possiblequ’elle faisait appel, au moins dans certaines situations urgentes, aux renforts de ces citésalliées. Mais il est difficile d’imaginer comment une récompense – de quelque naturequ’elle fût – aurait pu être attribuée aux enfants de tels xenoi, puisqu’ils ne résidaient pas àThasos.
Il est plus plausible que les individus concernés habitaient sur place et appartenaient àla communauté thasienne au sens large, mais à ses catégories les plus marginales. Lapremière catégorie à envisager est celle des enfants dont le père, mort au combat, étaitcitoyen, mais qui ne jouissaient pas eux-mêmes de la citoyenneté. À Athènes, depuis 451,
340 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
85. Une formule analogue, avec le même emploi du participe parfait, apparaît dans le décret relatif au Délion(première moitié du IVe s.) : GRANDJEAN, SALVIAT 2006, p. 296, l. 16-17. POUILLOUX 1954, p. 409, avaitreconnu la référence à un décret antérieur, daté par le nom d’un archonte, dans les bribes du règlement 155(SEG XVIII 348), l. 7.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 340
les enfants nés d’une union mixte entre un citoyen et une étrangère, ou encore les enfantsissus d’une union entre un citoyen et une Athénienne qui n’était pas reconnue comme sonépouse légitime, ne pouvaient acquérir la politeia et étaient définitivement relégués dansle statut de nothoi (« bâtards »). Les règles d’accès à la citoyenneté furent assouplies aucours de la guerre du Péloponnèse, puis rétablies dans toute leur rigueur en 403/40286. Laplupart des cités grecques de l’époque classique et de la haute époque hellénistiqueavaient, pour définir les conditions d’accès à la citoyenneté, des critères aussi restrictifsque ceux en vigueur chez les Athéniens : la règle générale était celle de la double ascen-dance civique ; les nothoi et nothai – qu’ils fussent mètroxenoi, « patroxenoi » ou de nais-sance illégitime – constituaient dans la plupart des cités un groupe social à part entière87.
À Thasos, le terme de novqo~ n’est pas formellement attesté, mais l’existence des nothoine fait aucun doute. On en voudra pour preuve une inscription assez gravement mutilée etqui, jusqu’à présent, n’a pas été correctement interprétée88. Elle se rattache à un épisode destasis, suivi de la restauration de la démocratie, à la fin du Ve ou au début du IVe siècle, et auxefforts de la cité pour reconstituer son corps civique amoindri. L’inscription se compose dedeux textes. Le premier est une proposition soumise par le Conseil à l’Assemblée etoctroyant à un certain groupe de non-citoyens des privilèges de nature indéterminée. Lesecond texte est un amendement de l’Assemblée qui, agréant la première proposition,renchérit en accordant le droit de cité à un second groupe de non-citoyens, qui sont lesenfants (fils et filles) de mères thasiennes. Ces derniers étaient vraisemblablement des« patroxenoi », ce qui indique que la règle de la double ascendance civique était aussi demise à Thasos au IVe siècle : tous ceux qui n’y répondaient pas étaient en principe exclus dupoliteuma et donc traités comme des nothoi. Désireuse d’accroître rapidement le nombrede citoyens, la nouvelle démocratie décida, à titre exceptionnel, d’intégrer des Thasiens deseconde zone au politeuma. Dans son projet de résolution, le Conseil avait sans douted’abord réservé cette opportunité aux mètroxenoi ; l’Assemblée choisit d’aller encore plusloin et d’inclure également – décision beaucoup plus rare – les « patroxenoi89 ». Une fois lasituation démographique rétablie, il est vraisemblable qu’on en revint à la règle
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 341
BCH 131 (2007)
86. Voir la synthèse de D. OGDEN, Greek Bastardy (1996), part. p. 32-212 ; cf. également C. BEARZOT, « Nécittadini né stranieri : apeleutheroi e nothoi in Atene », in M. ANGELI BERTINELLI, A. DONATI (éds), Ilcittadino, lo straniero, il barbaro, fra integrazione ed emarginazione nell’Antichità, Serta antiqua etmediaevalia VII (2005), p. 77-92.
87. Voir les exemples rassemblés et commentés par D. OGDEN (supra), p. 277-317.
88. IG XII 8, 264. Cf. Ad. WILHELM, « Neue Beiträge II », SBWien 1912, 166, 3, p. 30-43 (= Abhandlungen I,p. 110-123) ; M. FEYEL, RPhil 76 (1945), p. 133-141 ; POUILLOUX 1954, p. 205-213.
89. Ad. Wilhelm, M. Feyel et J. Pouilloux ont proposé pour le premier texte – la proposition de la boulè – desrestitutions discutables : tous trois considèrent, sans argument décisif, que les bénéficiaires de ces mesuresexceptionnelles sont les ressortissants d’une cité amie, peut-être Néapolis. J’essaierai de justifier moninterprétation, de façon plus détaillée, en proposant ailleurs une réédition du document [P. H.].
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 341
traditionnelle de la double ascendance civique et que celle-ci créa mécaniquement, parexclusion, de nouveaux nothoi parmi les Thasiens. C’est peut-être à cette catégorie sociale(en l’occurrence des mètroxenoi) que se réfère, entre autres, la présente clause sur le « décretpris sous Biôn ». Si c’est bien le cas, le sacrifice de leur père au champ d’honneur nevaudrait même pas à ces nothoi thasiens d’être assimilés aux fils de citoyens. On sait queThéozotidès refusa précisément de traiter les nothoi et les fils adoptifs à égalité avec les filslégitimes (gnèsioi) de citoyens athéniens, quand il fut question de récompenser lessacrifices consentis dans la lutte contre les Trente, et que ce choix lui valut un procès,connu par un plaidoyer de Lysias et perdu, du reste, par l’accusateur90.
Une dernière hypothèse à examiner est celle des fils d’apeleutheroi, pour lesquels onpeut envisager deux situations. Leurs pères, déjà affranchis par leurs maîtres et jouissantd’un statut marginal (distinct de celui des métèques et sans doute comparable à celuides nothoi91), pouvaient avoir été enrôlés dans les rangs de l’armée thasienne. L’autre pos-sibilité est que la cité combattante ait fait appel à des esclaves, à qui elle aurait préalablementoctroyé la liberté. Un pareil expédient n’était pas courant, vu ses conséquences sociales :il était réservé aux situations tout à fait critiques92. L. Robert en a rassemblé autrefoisdes exemples littéraires et épigraphiques93, parmi lesquels on peut citer le cas d’Athènesen 338 et de Rhodes en 305. Hypéride fit à l’Assemblée une proposition en ce sens aulendemain du désastre de Chéronée, pour organiser la défense de sa cité94. Pour résisterau Poliorcète, les Rhodiens libérèrent et enrôlèrent un certain nombre d’esclaves, commele rapporte Diodore ; l’épisode montre par ailleurs que la qualité de « Brave » pouvaitleur être reconnue à eux aussi95. À Thasos même, à une époque nettement plus tardive– le IIe s. av. J.-C. environ –, un acte d’affranchissement collectif, décidé par un décretdu Peuple, offre peut-être l’écho d’un telle situation de crise, qu’il n’est pas autrementpossible d’identifier96.
342 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
90. Lysias, frag. 6 (C. Théozotidès). Cf. STROUD 1971, p. 286-287 ; D. LOTZE, Klio 63 (1981), p. 164-165 ;contra K. R. WALTERS, ClAnt 2 (1983), p. 327-328, n. 40 ; D. OGDEN (supra, n. 86), p. 79.
91. Pour l’Athènes classique, voir C. BEARZOT (supra, n. 86).
92. Y. GARLAN, « Esclaves grecs en temps de guerre », in Actes du colloque d’histoire sociale, Besançon 1970,Annales littéraires de l’université de Besançon 128 (1972), p. 29-62 ; Kl.-W. WELWEI, Unfreie im antikenKriegsdienst, I-II (1974-1977).
93. L. ROBERT, Études épigraphiques et philologiques (1938), p. 118-126, avec une liste d’exemples, à laquelleon peut ajouter : Polybe, XVI 3, 2 (Abydos en 201) ; OGIS 338, l. 20-26 (Pergame en 133) ; J. REYNOLDS,Aphrodisias and Rome (1982), n° 2b, l. 2 (Aphrodisias en 88).
94. Hypéride, frag. 27-29 (C. Aristogiton), Jensen. C. DIONDAS (supra, n. 68), p. 8, l. 31-32.
95. Diodore, XX 84, 3 : ejyhfivsanto de; kai; tw`n douvlwn tou;~ a[ndra~ ajgaqou;~ genomevnou~ ejn toi`~ kinduvnoi~
ajgoravsanta~ para; twn despotwn ejleuqevrou~ kai; polivta~ ei\nai.
96. POUILLOUX 1954, 178, repris par J. POUILLOUX, Choix d’inscriptions grecques (1960), 39.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 342
L. 38-42 : publication du décret devant le prytanée
Au Ve et au IVe siècle, les lois, décrets et autres règlements étaient généralement gravés surles parois d’édifices publics, sur l’agora de Thasos ou dans l’un ou l’autre des grands sanc-tuaires de la ville, tels celui d’Apollon Pythien, sur l’acropole, ou celui d’Héraclès97. Lapremière stèle connue est celle dite « du port », datée du deuxième quart du Ve siècleenviron : on ignore où elle fut érigée à l’origine. Au tournant du Ve et du IVe siècle, le décretsur la restauration de la démocratie fut publié quant à lui en plusieurs endroits et sur deuxtypes de supports différents : au Pythion « sur pierre » (eij~ livqon), c’est-à-dire sur un murdu sanctuaire, et dans deux lieux de la ville basse, le port et sans doute l’agora, cette fois-cisur des stèles (ªeij~ sthvla~ wJ~º leiotavta~), selon un usage qui se répandit à Thasos à partirde cette époque98.
Le décret sur les Braves doit être gravé en un seul exemplaire, sur une stèle (eij~ sthvlhnliqivnhn) – celle-là même que nous avons retrouvée. Elle ne sera pas érigée dans un sanc-tuaire, mais devant le prytanée. Le choix du lieu s’explique par le fort contenu idéologiquedu règlement : le prytanée est le siège du foyer civique et le cœur symbolique de la polis.C’est de là que doivent provenir la plupart des autres règlements institutionnels duIVe siècle retrouvés sur l’agora, comme J. Pouilloux en avait eu jadis l’intuition99.
Le prytanée thasien n’est pas encore localisé avec certitude. Sa première mention épi-graphique figure dans la « Stèle du port » : des mesures de propreté y sont imposées àl’intérieur du périmètre de l’agora, « depuis le sanctuaire des Charites [sc. le Passage desthéores] jusqu’aux bâtiments où se tiennent et le change et le banquet, et en suivant larue qui longe le prytanée100 ». Il est ensuite mentionné dans un décret du IIIe siècle pourdes juges étrangers : la cité de Thasos les invite, comme le veut l’usage, à venir y prendre
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 343
BCH 131 (2007)
97. POUILLOUX 1954, p. 124 et n. 2. Textes gravés à l’Hérakleion : IG XII Suppl 350 ; au Pythion : IG XII 8,264 ; IG XII Suppl 350 ; cf. POUILLOUX 1954, p. 207, et J. POUILLOUX, REA 61 (1959), p. 274-276. Àpartir de la fin du IVe s., certains décrets honorifiques sont également publiés sur les murs du Pythion (IGXII 8, 268 ; IG XII Suppl 358 ; 360 ; 362) et, dans un cas, de l’Athènaion (IG XII 8, 267).
98. SEG XXXVIII 851 B, l. 16-19 [où je complèterais : ªoiJ de; prostavtºai ajnagravyante~ eij~ livqon qev⁄ªsqw ejpiv to;
iJero;n tou` ΔApovllwno~ tou`º Puqªivouº ajntivgrafav te tw`n gramm⁄ªavtwn - - - eij~ sthvla~ wJ~º leiotavta~
ajnagravyante~ ejlli⁄ªmevni kai; ejn ajgorhi (Ù) - - -º qevsqw ; cf. POUILLOUX 1954, p. 171, n. 2 (P. H.)]. Pourun autre exemple de l’expression eij~ livqon au début du IVe s., voir GRANDJEAN, SALVIAT 2006, p. 296, l. 20,et p. 301.
99. POUILLOUX 1954, p. 390, n. 2. L’identification du Passage des théores comme étant le prytanée, encore envigueur en 1954, est aujourd’hui définitivement abandonnée.
100. DUCHÊNE 1992, p. 19-20, l. 41-44, avec le commentaire topographique, p. 101-104, et le planhypothétique, p. 106. Voir également A. J. GRAHAM, « Thasos : the Topography of the Ancient City »,ABSA 95 (2000), p. 301-327, part. p. 311-315.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 343
un repas d’hospitalité101. Le nouveau fragment de la stèle des Braves fournit une troi-sième attestation102, mais ne permet toujours pas de situer le bâtiment plus précisémentsur l’agora ou dans ses abords immédiats103. Notons qu’il est impossible de tirer argu-ment du lieu de trouvaille des deux fragments (l’un dans l’aulè de l’agora, l’autre en rem-ploi dans un bâtiment tardif édifié près de l’Artémision) : la stèle a été débitée et lesmorceaux ont pu être transportés sur une certaine distance, comme ce fut aussi le caspour la « Stèle de la réconciliation104 ». La seule nouveauté concerne un détail d’ordrearchitectural, qui nous est malheureusement dérobé par la lacune de la fin de la l. 39.La préposition pro; (« devant ») était suivie par un article (t≥ªouº uel t≥ªh~º) et un sub-stantif, déterminés par le complément tou prutaneivou. Le substantif en question devaitoccuper toute la fin de la l. 39, car le mot tou n’a pu s’y glisser et a dû être rejeté audébut de la ligne suivante. Il faut donc rétablir dans la lacune un mot relativement long.Nous songeons par exemple (et avec réserve) à prostw/`on ou à toico~, le premier de cesmots étant peut-être préférable, à cause de sa longueur : kai; sthsai pro; t≥ªou prostwi-vou (Ù)º ⁄ tou prutaneivou105. D’autres possibilités sont certainement envisageables.
L’apodecte est chargé de verser l’argent nécessaire au responsable de la publication(vraisemblablement un adjudicataire des travaux), en présence du secrétaire du Conseil :to; de; ajnavlwma eij~ tªh;n sthvlhn kai;º eij~ ta; a[lla dounai to;n ajpodevktªhn - - - ca 11-21 l. - - -ºparovnto~ tou grammatevw~ ªth~ boulh~º. Le règlement du Délion, un peu antérieur à notredécret, est l’un des rares autres documents thasiens où figure une pareille clause sur lefinancement de la gravure : to; yhvfisma (...) ajnagravyai ejl livqon to;n iJropoio;n th~ Dhlivh~tou` iJrou` ejpΔ h|i a]n dokh`i ejpithvdeion ei\nai (...) : o { ti dΔ a]n ajnavlwma givnhtai ej~ th;n ajna-grafh;n parasªcºen to;n iJeromnhvmona, « que le hiérope d’(Artémis) Déliè fasse transcrire ledécret dans l’endroit du sanctuaire qu’il jugera adéquat (...) ; que le hiéromnèmon four-nisse la dépense engagée pour la transcription106 » ; le document en question fut gravé sur
344 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
101. Ch. V. CROWTHER, Chiron 29 (1999), p. 267-272, n° 3 (SEG XLIX 1108), l. 15-16.
102. Il est très vraisemblablement question du prytanée dans le décret sur la restauration de la démocratie (SEGXXXVIII 851 [fin du Ve ou début du IVe s.], B, l. 1 : [pruta]nei`on). Ph. GAUTHIER, Bull. 1989, 254,p. 395, a suggéré que, parmi les honneurs conférés à ceux qui participèrent au renversement del’oligarchie, figure peut-être l’entretien permanent au prytanée. Comparer I. Ilion 25, l. 24-25.
103. Nous renvoyons à l’étude qu’Y. Grandjean et Fr. Salviat préparent actuellement sur le problèmetopographique du prytanée.
104. PICARD 2000, p. 1059.
105. Comparer V. PETRAKOS, ÔO dhmo~ tou ÔRamnounto~ (1999), 59, l. 29-30 (pro; th~ eijsovdou tou newv) ; OGIS268, l. 18-19 ; SEG XLVIII 1040, l. 34 ; SEG XLIV 699, l. 18-19.
106. GRANDJEAN, SALVIAT 2006, p. 296, l. 26-28 (lire h|i et non w|i [cottation]).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 344
une parastade dudit sanctuaire. Dans le cas du décret sur les Braves, on ne gravera pas letexte sur un mur déjà existant, mais sur une stèle, dont la fabrication constitue la prin-cipale dépense engagée. Nous avons donc préféré restituer ici le mot sthvlhn plutôt qu’aj-nagrafhvn. L’infinitif aoriste dounai prouve par ailleurs que le versement sera ponctuel : ta;a[lla ne peut donc désigner les gratifications et indemnités payées aux ayants droit desBraves, destinées à se répéter d’année en année, mais bien les autres frais afférents à laprésente publication, en particulier le salaire du graveur.
Il est plus délicat de comprendre ce qui a disparu dans la lacune de la fin de la l. 41. Onattendrait une indication sur l’origine des fonds versés par l’apodecte, par exemple : ejktwn dhmosivwn (uel koinw`n) prosovdwn (uel sim.), « en puisant sur les fonds publics (uel com-muns)107 » ou éventuellement ejk th~ dioikhvsew~ uel ejk th~ oijkonomiva~ (uel sim.), « sur lacaisse dévolue aux besoins courants de l’administration publique108 ». L’épigraphie tha-sienne ne fournit cependant aucun exemple de locution de ce type109 : il n’est donc paspossible de savoir quelle formule précise les autorités civiques employaient en pareil cas.
L. 42-46 : clauses pénales
Les dernières clauses portent sur la protection du décret. Elles réglementent l’introductiondes poursuites en cas de défaillance des magistrats investis de responsabilités à l’égard desBraves et de leurs ayants droit : ªo{sti~ dΔ a[n tiº mh; pohvshi tw`g gegramm≥ªevnwn tw`n ejn tw`iyhfivsmatiº110. On désigne le responsable de la poursuite (uJpovdiko~ + initiateur de l’action
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 345
BCH 131 (2007)
107. Voir les quelques exemples rassemblés par L. MIGEOTTE, Chiron 36 (2006), p. 390 et n. 53.
108. Chr. SCHULER, « Die dioivkhsi~ th`~ povlew~ im öffentlichen Finanzwesen der hellenistischen Poleis »,Chiron 35 (2005), p. 385-403, part. p. 392-393, et L. MIGEOTTE, « La planification des dépensespubliques dans les cités hellénistiques », Studi Ellenistici XIX (2006), p. 77-97, part. p. 91-93, ontrassemblé et commenté les exemples de ces locutions.
109. Une clause du décret SEG XLIX 1108, l. 13-15, enjoint à l’apodecte de « verser aux juges [sc. de Cos], pourles sacrifices et à titre de présents d’hospitalité, to; ejk th`~ ajrtuvo~ ». Cette expression constitue un hapax.D’après une glose d’Hésychius qui donne à ajrtuv~ le sens de suvntaxi~, Ch. V. CROWTHER, Chiron 29(1999), p. 271, a voulu y reconnaître une indication sur la provenance des fonds employés et a traduit :« the amount from the funds assigned (for that purpose) ». L. DUBOIS, Bull. 2000, 238 et 502, préfèreinterpréter ajrtuv~ comme un synonyme ionien de novmo~ et reconnaître ici l’équivalent de la locutionbanale to; ejk tou novmou, « la somme prévue par la loi ».
110. Pour des raisons de longueur de la l. 42, nous avons préféré restituer o{sti~ (40 lettres) plutôt que o}~, qui estplus courant dans ce type de formule à Thasos, mais nous semble un peu trop court (37 lettres) ; voir unexemple dans GRANDJEAN, SALVIAT 2006, l. 7-8 : h{ti~ dΔ a]n ejsevlqhi ktl. Une formule telle que ªa]n dev tiv~
tiº mh; pohvshi ktl. serait également possible (cf. IG XII 8, 264, l. 5 ; SEG XXXVIII 852, B, l. 1).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 345
[au datif ], l. 44)111 et l’on prévoit pour lui un intéressement à hauteur de la moitié del’amende (ªto; de;º ⁄ h{musu, l. 45-46). La restitution ªcilivº⁄ou~ de; stath`r≥ªa~º (l. 44-45)nous paraît très probable, à cause du caractère topique de la somme : elle se rencontre dansplusieurs lois et décrets thasiens prévoyant des récompenses en cas de dénonciation ou desamendes en cas de contravention, de la fin du Ve siècle jusqu’au début du IIe siècle112.
Les lacunes nous dérobent l’identité des acteurs de la procédure. Il est cependantpossible de découvrir leur identité en raisonnant à partir des parallèles. Dans la stèle duport, datée de la première moitié du Ve siècle, les magistrats appelés épistates sont chargésaussi bien d’intenter les poursuites que d’assurer la perception des amendes ; ils sont inté-ressés au paiement de l’amende, à hauteur de la moitié113. Dans les inscriptions de la findu Ve siècle, apparaît en outre la possibilité d’une initiative populaire, également assortied’un intéressement : les poursuites peuvent être déclenchées par un particulier sur la basedu volontariat – implicitement dans la première loi sur le vin, explicitement dans ladeuxième114 –, en cas de défaillance des magistrats responsables. À partir du tout débutdu IVe siècle et jusqu’au IIe siècle, ce sont les magistrats dénommés apologoi qui se chargentd’entamer les poursuites et de faire office d’introducteurs en justice dans les procès quimettent en cause les intérêts de la cité115, les épistates continuant dans certains cas d’as-surer l’exécution de la sentence116. Les apologoi ne sont jamais intéressés au paiement del’amende. Eux-mêmes sont redevables d’une amende s’ils n’exercent pas les poursuitesnécessaires (lesquelles devront être lancées par leurs successeurs). L’initiative populaireconstitue toujours une seconde possibilité, mais elle n’intervient que comme garantie
346 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
111. Voir le règlement du port (IIIe s. ? [date sans doute trop basse]), IG XII Suppl 348, l. 8 : ªuJpºovdikoi e[stwsan
toi~ eijsiªouºsin ajpolovgoi~.
112. Le règlement POUILLOUX 1954, 18 (411-407 ?) prévoit l’octroi d’une récompense de 1 000 statères audélateur des ennemis du régime (l. 1). Des décrets d’octroi de citoyenneté du IIIe et du IIe s. menacentd’une amende de 1 000 statères toute personne qui ferait une proposition contraire : IG XII 8, 267, l. 14 ;268, l. 9 (restitué) ; IG XII Suppl 355, l. 6 ; 358, l. 8 et 9 (restitué) ; 362, l. 10 et 11 (restitué).
113. DUCHÊNE 1992, l. 47-48 ; l’autre moitié de l’amende revient à la cité.
114. IG XII Suppl 347 I, l. 2-4 ; 347 II, l. 4-7.
115. M. LAUNEY, BCH 57 (1933), p. 404 ; POUILLOUX 1954, p. 394, 397-399 et 401-402 ; P. FRÖHLICH, Lescités grecques et le contrôle des magistrats (2004), p. 194-198. Des magistrats appelés dèmiorgoi exerçaient,tout comme les particuliers, le rôle d’initiateurs des poursuites contre d’autres magistrats vers la fin du Ve s.Ils ne sont mentionnés qu’une fois, dans la deuxième loi sur le commerce du vin (IG XII Suppl 347 II, l. 7-8), dont la date est discutée. Il est possible qu’ils aient été remplacés par les apologoi au début du IVe s. : cesderniers apparaissent en effet pour la première fois dans le bail du verger d’Héraklès, IG XII 8, 265, l. 10,dont O. PICARD, CRAI 1982, p. 416-417, a fixé la date peu avant ca 390. La première dédicace connued’un collège d’apologoi est approximativement contemporaine du décret sur les Braves : POUILLOUX 1954,p. 232.
116. IG XII Suppl 348, l. 5-6. Sur les attributions des épistates à partir du IVe s., voir SALVIAT 1958, p. 204-206.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 346
supplémentaire : outre les apologoi, un particulier peut déclencher la procédure, ce qui, encas de succès, lui rapportera la moitié (ou le tiers) de l’amende117.
Les clauses pénales du décret sur les Braves sont moins développées que celles desdécrets du IVe et du IIIe siècle, mais la mention d’un intéressement laisse penser à uneinitiative populaire plutôt qu’à celle d’un magistrat. Le particulier agissant de sa propreinitiative est désigné dans les inscriptions thasiennes comme oJ bo(u)lovmeno~118 ou, plussouvent, comme tw`n a[llwn oJ ejqevlwn119. Dans ce dernier cas, « les autres » désignentl’ensemble du corps civique, à l’exception des magistrats à qui il revient en priorité d’in-troduire l’action ; en l’absence d’une telle précision, le droit d’agir en justice est certai-nement reconnu à l’ensemble des citoyens120. Nous restituons par conséquent : uJpovdiko~me;n e[stw ªtwn politwn twi ejqevlontiº (l. 44) et twªi dikasamevnwiº (l. 46). L’omission com-plète des apologoi, dans leur rôle ordinaire d’initiateurs de la procédure, s’explique iciaisément par le fait qu’ils font eux-mêmes partie des magistrats passibles de poursuitesen cas de manquement aux dispositions du décret (cf. l. 28) : ils ne sauraient se trouversimultanément en position de demandeurs et de défendeurs. Ce type de clauses pénalesest par ailleurs tout à fait habituel : en dehors de Thasos, où il est bien attesté, le recoursà l’initiative d’un particulier, avec intéressement à la clef, est une caractéristique de laprocédure judiciaire grecque aux époques classique et hellénistique121.
Traduction
« (...) [avant] d’atteindre l’âge de [seize uel dix-huit (?)] ans, [tous ceux des garçons (?)] de l’unde ceux qui sont morts [à la guerre (?)] qui viendront se présenter devant le Conseil et le Peuple,parce qu’ils sont dépourvus de moyens de subsistance, au sujet d’une allocation de subsistance,et (une fois que) les archontes et les apologoi, après avoir prêté serment, auront vérifié que lespersonnes qui se sont présentées (sc. devant le Conseil et le Peuple) sont bien dépourvues de
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 347
BCH 131 (2007)
117. SALVIAT 1958, p. 203. La formule la plus complète apparaît dans un décret d’octroi de citoyenneté dudébut du IIIe s., IG XII 8, 267, l. 14-16 : dikasavsqwn de; oªiJ ajpovºlogoi : a]n de; mh; dikavswntai, aujtoi;
ojfeilovntwn, dikasavsqwn de; oiJ ajpolovgoi oiJ meta; touvtou~ aiJreqevnteª~º : dikasavsqw de; kai; tw`n a[llwn oJ
ejqevlwn, kai; a]n oJ ijdiwvth~ nikhvshi, meteinai aujtwi to; h{musu th;~ katadivªkh~º. Comparer IG XII 8, 268, l. 10-11 ; IG XII Suppl 348, l. 9-10 (avec la restitution de SALVIAT, loc. cit., p. 205, n. 5) ; 355, l. 7-8 ; 358, l. 10-11 ; 362, l. 13-14 ; POUILLOUX 1954, 150, l. 19 (avec la lecture de SALVIAT 1958, n. 1).
118. IG XII Suppl. 347 II, l. 6 ; POUILLOUX 1954, 150, l. 10, avec la lecture de SALVIAT 1958, p. 203, n. 1.
119. IG XII 8, 267, l. 16 ; 268, l. 10-11 ; IG XII Suppl 348, l. 10 ; 355, l. 7-8 ; 358, l. 10 (restitué) ; 362, l. 13.
120. On comparera une clause d’un décret de Démétrias, vers 100 av. J.-C. (IG IX 2, 1109 [Syll.3 1157], l. 59-61) : uJpovdiko~ e[stw toi~ ejxetastai~ kai; a[llwi twi boulomevnwi twn politwn peri; touvtou tou ajdikhvmato~.
121. Voir L. RUBINSTEIN, « Volunteer Prosecutors in the Greek World », Dike 6 (2003), p. 87-113, part. p. 96-98, où sont analysées les occurrences thasiennes.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 347
moyens de subsistance, que les prytanes les reçoivent et les introduisent (sc. dans l’Assemblée),en mettant aux voix (une proposition conformément à laquelle) sera attribué à chacun pas plusde 4 oboles. Que la dépense soit versée par l’apodecte.
Et qu’également aux métèques qui seront morts à la guerre soit versée par l’apodecte la sommede 17 statères 1 hémistatère.
Que le décret pris sous l’archonte Biôn soit valable et s’applique pour ceux dont les pères sontmorts à la guerre et ont acquis le titre de “Braves”, mais qui ne bénéficient pas de l’une oul’autre des clauses du (présent) décret.
Que le secrétaire du Conseil fasse transcrire ce décret sur une stèle de pierre et la fasse érigerdevant le/la [… (?)] du prytanée. Que l’apodecte verse la somme nécessaire [à la stèle (?)] et auxautres frais [en puisant sur les fonds publics (vel sim.?)], en présence du secrétaire [du Conseil].
Quiconque ne respectera pas l’une des clauses de ce décret sera passible de poursuites de la partde [celui des citoyens qui le voudra] et encourra une amende de 1 000 statères, dont la moitiéreviendra à la cité et l’autre moitié à l’auteur des poursuites. »
II. THASOS AU IVe SIÈCLE AV. J.-C. : INSTITUTIONS, MONNAIE ET GUERRE
LES PRYTANES ET LE FONCTIONNEMENT DE LA BOULÈ THASIENNE
Le nouveau fragment atteste pour la première fois l’existence de prytanes à Thasos. Laprésence d’un prytanée ne pouvait suffire à prouver celle de prytanes, comme on a pul’écrire122. Le prytanée d’une cité grecque peut certes être présidé par un magistrat uniquenommé « prytane », ayant généralement la fonction éponymique, comme on le sait pourde nombreuses poleis d’Ionie par exemple123. Dans le cas de Thasos, ce type d’attributionappartenait nécessairement à une magistrature parmi les plus anciennes et les plus véné-rables, établie – comme le prytanée lui-même – depuis la fondation de la cité par lescolons pariens124. Ch. Picard avait supposé autrefois qu’il s’agissait du collège annuel destrois théores125. Nous savons depuis peu, grâce à un décret du IIIe siècle déjà mentionné,
348 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
122. DUCHÊNE 1992, p. 68 et p. 98-99.
123. Fr. GSCHNITZER, s.v. « Prytanis », RE Suppl XIII (1973), col. 730-801, part. 733-746.
124. I. MALKIN, Religion and Colonization in Ancient Greece (1987), p. 114-134.
125. Ch. PICARD, BCH 45 (1921), p. 93-95, identifiant à tort le Passage des théores et ses environs au prytanée.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 348
que cette responsabilité incombait en fait aux trois archontes, dont l’un faisait office demagistrat éponyme. Le décret en question les charge d’inviter au repas d’hospitalité lesjuges coéens honorés au terme de leur séjour à Thasos : kalesavtwsan dªe; aºujtou;~ oiJa[rconte~ ejpi; xevnia eij~ to; prutanªei`onº. Il est parfaitement normal que les archontesthasiens, qui exercent la première fonction dans l’échelle des magistratures civiques,soient les maîtres du prytanée et les hôtes des invités que la cité y reçoit126.
La stèle des Braves révèle aujourd’hui l’existence, non d’un prytane unique, mais deplusieurs prytanes, constitués en collège ou en commission. Tout porte à croire qu’ilsétaient de création beaucoup plus récente que le prytanée et les archontes. La clauserelative aux orphelins indigents illustre une de leurs fonctions, qui était de mettre lespropositions aux voix dans l’Assemblée. Il paraît vraisemblable que ces prytanesformaient, comme à Athènes, une commission temporaire du Conseil, constituée d’uncertain nombre de bouleutes.
Si les prytanes thasiens s’inspirent bien de ceux d’Athènes, leur existence remonte-t-elle à l’époque de la Ligue de Délos ou ne date-t-elle que des années 390-360 environ ?L’un des décrets relatifs à la reconstitution du corps civique après un épisode de stasis, qu’ilconvient de placer à la toute fin du Ve ou au début du IVe siècle, attribue à un énigmatiquecollège de prostatai, accompagnés d’un secrétaire, la charge de détruire des documentspublics, vraisemblablement des actes émis par le régime oligarchique précédent127. Lesmêmes magistrats apparaissent peut-être également dans le décret relatif au rétablis-sement de la démocratie et au retour des exilés, qui appartient au même contexte. Lacharge qui leur est confiée est du même ordre : Ad. Wilhelm a en effet suggéré autrefois, ànotre avis à juste titre, qu’il fallait restituer leur nom dans la clause de publication (ªoiJ de;prostavtºai ajnagravyante~ eij~ livqon qevªsqw ktl.º)128. Ces prostatai ne sont plus connuspar la suite à Thasos. J. Pouilloux proposait donc d’y voir une magistrature transitoire,chargée de ménager la réconciliation des Thasiens après la stasis, ce qui est une hypothèseplausible, mais non assurée129. Qu’ils aient été créés ad hoc ou que leur existence remonteau Ve siècle, ces « présidents » devaient peut-être leur titre à la fonction de direction desséances du Conseil et de l’Assemblée130, ce qui ferait d’eux les prédécesseurs des prytanes.
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 349
BCH 131 (2007)
126. Ch. V. CROWTHER, Chiron 29 (1999), p. 267-272, n° 3, l. 15-16. Sur les archontes, voir POUILLOUX
1954, p. 400-401, et Fr. SALVIAT, « Les archontes de Thasos », in Actes du VIIIe Congrès internationald’épigraphie grecque et latine, Athènes 1982 (1984), p. 235-258.
127. IG XII 8, 264, l. 13. POUILLOUX 1954, p. 396, reconnaissait lui-même dans le grammateus en question lesecrétaire du Conseil. Sur le document, cf. supra, p. 341.
128. SEG XXXVIII 851 B, l. 16-17. Cf. Ad. WILHELM, MDAI(A) 28 (1903), p. 443.
129. POUILLOUX 1954, p. 388-389.
130. Les magistrats présidant le Conseil et l’Assemblée de Cos et de Calymna, pour ne prendre que ces deuxexemples, portent le titre – du reste assez banal – de prostavtai, au IVe s. et à l’époque hellénistique.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 349
Il est donc possible que les prytanes ne furent pas institués à Thasos avant le deuxièmequart du IVe siècle environ, au moment où la cité remodela en profondeur ses institu-tions, en s’inspirant beaucoup d’Athènes (cf. infra). La création à Thasos d’une prytaniede modèle athénien ne serait du reste pas un cas isolé dans la zone égéenne placée parintermittence sous influence athénienne au cours du Ve et du IVe siècle131. Pour ne citerqu’un exemple, connu depuis peu, une autre cité insulaire – Érétrie – adopta elle aussiune boulè tirée au sort parmi tous les citoyens et présidée par une commission tournantede prytanes, qui reproduisait fidèlement les institutions « clisthéniennes ». Nous le savonsgrâce à une loi contre la tyrannie et l’oligarchie, adoptée vers 340. Après plusieurs épi-sodes oligarchiques au cours du IVe siècle, les Érétriens voulurent en l’espèce préserverla démocratie rétablie de toute nouvelle tentative de renversement. Une clause de cetteloi montre que, parmi les institutions à protéger en priorité, les deux organes du Conseilet de la prytanie incarnaient à eux seuls la démocratie érétrienne, fondée comme à Athènessur le principe de la participation des citoyens ordinaires : « si quelqu’un met aux voixou rédige ou soutient, soit à titre de magistrat soit en tant que particulier, une motionstipulant que les Érétriens doivent établir une autorité politique – quelle qu’elle soit –autre qu’un Conseil et une prytanie dont les membres sont tirés au sort parmi tous lesÉrétriens, etc.132 ». La même définition s’appliquait peut-être au système démocratiquethasien.
En ce qui concerne Thasos, nous n’avions jusqu’à présent que très peu d’informationsur le fonctionnement de la boulè, organe central de la démocratie, ce qui s’explique par lefaible nombre de décrets conservés et par la brièveté du formulaire employé à propos desprocédures de décision. Nous ignorons en particulier le nombre des bouleutes thasiens,leur mode de recrutement (tirage au sort ?) et même l’endroit précis, probablement situésur l’agora, où ils tenaient leurs réunions133. Aucun des décrets thasiens conservés nementionnait jusqu’ici les responsables du bureau, chargés de présider le Conseil et detransmettre ses probouleumata à l’Assemblée. Le nouveau fragment de notre règlementnous vaut d’apprendre que ce rôle incombait aux prytanes, qui étaient assistés du secré-taire du Conseil, déjà mentionné dans le fragment supérieur. Il est possible que chaque
350 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
131. D. M. LEWIS, « Democratic Institutions and their Diffusion », in Actes (supra, n. 126), p. 55-62 (= SelectedPapers in Greek and Near Eastern History [1997], p. 51-59).
132. SEG LI 1105, l. 17-20 : ejavn ti~ ejªpiyhfivzei h] gravfeiº h] fevrei a[n te a[rcwn a[n te ijdiwvth~ wJ~ dei a[llhn tiªna;
kaqistavnai poºliteivan ΔEretria~ ajllΔ h] boulh;n kai; prutaneivhªn ejk pavntwn ΔEretrºiwn klhrwth;n ktl., avecle commentaire de D. KNOEPFLER, BCH 126 (2002), p. 150-161.
133. J.-Y. MARC, in L’espace grec. Cent cinquante ans de fouilles de l’École française d’Athènes (1996), p. 109, aformulé l’hypothèse séduisante selon laquelle l’édifice traditionnellement appelé « bâtiment en pôros » ou« bâtiment de tuf », situé à l’angle Nord de l’agora et datant du IIIe s. (Guide 2000, p. 66, no 11), serait àidentifier comme un bouleutèrion.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 350
commission ait constitué une fraction – un douzième (?) – du nombre total des bouleuteset que les commissions aient alterné mois après mois à la tête de la boulè, comme cela estbien connu dans un certain nombre de cités des îles et d’Asie Mineure134. Comme ce futle cas à Érétrie, l’ensemble du système de recrutement et de rotation des bouleutes à laprytanie dut cependant être adapté à l’organisation du corps civique, différente de celled’Athènes : à Thasos, il s’agissait d’une division en patrai, qui est au demeurant malconnue135.
Le décret thasien trouvé à Cos et récemment publié révèle par ailleurs l’existence deproèdres à Thasos, à une époque plus tardive d’un siècle environ136. Il honore trois jugesvenus de Cos et décide l’élection d’un ambassadeur chargé d’aller en apporter une copiedans leur cité. Le texte du décret proprement dit est suivi, après un vacat, d’une courtesérie d’informations complémentaires, peut-être ajoutées par le secrétaire (l. 21-23).La première d’entre elles se rapporte au rôle joué par les proèdres, probablement lors del’assemblée thasienne qui vota le décret : ª. . . .ºn provedroi: hiJrevqhi Parmevnwn ÔHrak-leivtou (suivent les noms des trois juges coéens). Le mot disparu dans la lacune initiale (4lettres) est certainement un verbe. Il est impossible de restituer ejpestavtoun, proevqhkanou encore ejpeyhvfisan, qui conviendraient pour le sens, mais sont beaucoup trop longs.L’éditeur du document, Ch. Crowther, a rétabli : ªei\paºn provedroi. Suivant unesuggestion de Chr. Habicht, il proposait de comprendre que les proèdres ont « transmisoralement » le résultat de l’élection de l’ambassadeur au secrétaire, qui a ainsi pu consignerle nom de Parménôn à la fin de la copie du décret137. L’ordre des mots fait cependant diffi-culté et l’on objectera surtout qu’eijpei`n a invariablement le sens de « faire une propo-sition » (gnwvmhn) dans les décrets grecs, à Thasos comme ailleurs138. La restitution et
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 351
BCH 131 (2007)
134. Fr. GSCHNITZER (supra, n. 123), col. 749-801.
135. Cl. ROLLEY, BCH 89 (1965), p. 441-483 ; N. F. JONES, Public Organization in Ancient Greece (1987),p. 184-186, a supposé, à partir d’indices très ténus, que les citoyens thasiens étaient en outre répartis enphylai, mais rien ne permet à ce jour de vérifier cette hypothèse.
136. Ch. V. CROWTHER, Chiron 29 (1999), p. 267-272, n° 3, l. 21, avec le commentaire. Une photographie del’estampage, plus lisible que celle fournie ad loc., fig. 6, est disponible sur le site du Center for the Study ofAncient Documents : http://www.csad.ox.ac.uk/CSAD/Images/400/Image491.html.
137. Ch. V. CROWTHER (supra), p. 269 : «They (sc. les proèdres) are presumably simply the presiding officers ofthe assembly who communicated the name of the ambassador elected by the assembly to the secretaryresponsible for drafting the decree. » Il traduit effectivement, p. 268 : « The proedroi [report]ed. »
138. On lit, à Thasos même, dans l’intitulé d’un décret du IIe s. apr. J.-C., la formule : a[rconte~ ei\pon (IG XIISuppl 347 III, l. 1). On trouve d’autres exemples à Maronée (L. LOUKOPOULOU [dir.], ΔEpigrafe;~ th`~
Qravkh~ tou Aijgaivou [2005], E 171 ; 172 : nomofuvlake~ ei\pan) ou encore à Pitanè (IG XII Suppl 142, l. 2 :strathgoi; ei\pan), etc. Il s’agit dans tous les cas de la proposition elle-même, la gnômè. Dans un décretd’Amyzon, la formule (inhabituelle) ei\pan + nomina est le résultat d’une correction intempestive : J. etL. ROBERT, Fouilles d’Amyzon en Carie (1983), p. 122.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 351
l’interprétation de l’éditeur suscitent donc des réserves, mais nous n’avons aucune resti-tution alternative à proposer139.
Le seul fait incontestable est que lesdits proèdres étaient alors impliqués dans laprocédure de décision. Le décret pour les juges de Cos est daté, sur des critères paléogra-phiques et prosopographiques, du cours du IIIe siècle. Il est possible (sans aucunecertitude) que les prytanes, attestés au IVe siècle, aient été remplacés à un moment donnépar des proèdres, attestés au IIIe siècle et peut-être investis de la même fonction. Si l’onpoussait l’hypothèse d’un mimétisme entre institutions athéniennes et institutionsthasiennes au IVe siècle, on pourrait même supposer que prytanes et proèdres aient pucoexister, à Thasos comme à Athènes, les premiers assurant une fonction de suivi desaffaires et élaborant l’ordre du jour des réunions, les seconds étant désignés parmi lesautres bouleutes lors de chaque séance du Conseil ou de l’Assemblée, pour assurer la prési-dence. Les renseignements dont nous disposons sont cependant beaucoup trop lacunairespour nous permettre d’affirmer quoi que ce soit. À l’époque du décret pour les Braves,c’est-à-dire vers 360-350, il est assez clair, d’après notre nouveau fragment, que lesprytanes présidaient aussi bien la Boulè que l’Ekklèsia de Thasos et qu’ils se chargeaienteux-mêmes de la mise aux voix des propositions.
NOTE DE VOCABULAIRE : À PROPOS DU VERBE ejpidevcesqai
Le verbe ejpidevcesqai, qui apparaît à la ligne 29, est employé par les auteurs, par exemplePolybe, mais n’est pas courant dans les documents épigraphiques140. On en rencontre enparticulier deux exemples – dans le même contexte institutionnel qu’ici – à Paros, lamétropole de Thasos, et il est intéressant de s’arrêter sur ces documents pariens, car ils ontété jusqu’ici mal interprétés. Le verbe apparaît en premier lieu dans un décret publié en1983 par V. Lambrinoudakis et M. Wörrle et qui date approximativement du IIe siècleav. J.-C.141. Seules les six premières lignes en sont conservées :
352 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
139. La lacune étant de quatre lettres, des suppléments tels que ªparhsaºn ou encore ªe[dwkaºn uel ªe[dosaºn (sc.yhvfou~) semblent exclus.
140. Pour les auteurs, voir par exemple Polybe, XXI 18, 3. Pour les inscriptions, voir un exemple à Pagai au Ier s.av. J.-C. : IG VII, 190 (cf. A. WILHELM, JÖAI 10 [1907], p. 17-32 [= Abhandlungen I, p. 261-276]), l. 18-19, à propos d’un évergète recevant à ses frais des convives dans un banquet (filanqrwvpw~ te aujtou;~
ejpedevxato ktl.).
141. W. LAMBRINUDAKIS, M. WÖRRLE, Chiron 13 (1983), p. 355-357 (SEG XXXIII 681). Sur la procédure,voir les remarques de P. M. NIGDELIS, Polivteuma kai koinwniva twn povlewn twn Kuklavdwn katav thn
ellhnistikhv kai autokratorikhv epochv (1990), p. 122.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 352
ΔEpi; Qeupovmpou, Batromiwno~ tetravdi iJstamevnoªuº,e[doxen thi boulhi kai; twi dhvmwi, vac.P≥raxiva~ Filivppou ei\pen: ªuJºp≥e;≥r≥ w|n proegravyato oJ newkovro~
4 Praxiva~ o{pw~ bouleuvsht≥a≥ªi hJº boulh; kai; oJ dhmo~ uJ-pe;r twn ginomevnwn ejn twi iJerwi tou Saravp≥i≥o≥~≥, dedovcqai thi≥ b≥o≥ªuº-ªlhiº: ej≥p≥idevxasqai P≥R≥L≥ª– ca 7 l. – tºo;≥n dhmon≥ . O≥NA≥G≥ª≥– ca 6 l. – cºrhma-ª - - -º
Le contenu du décret est entièrement perdu. La formule de relation (ªuJºp≥e;≥r≥ w|n proe-gravyato ktl.) permet seulement de comprendre qu’il était question d’un sanctuaire deSarapis. On voulait régler les difficultés, voire les désordres qui y régnaient et qui sontdésignés ici sous le terme vague de ta; ginovmena142. M. Wörrle a cru pouvoir déceler desbribes du dispositif parmi les mots de la ligne 6, particulièrement difficiles à déchiffrer :« ejpidevxasqai hat vielleicht, wie üblich, Übernahme irgendwelcher Verpflichtungenoder Kosten bezeichnet, zumal da am Zeilenende wohl von crhvmata die Rede war. DieBuchstabenreste nach ejpidevxasqai könnten von einer Wiederaufnahme des NamensPraxiva~ stammen, und vor crhvmata könnte ein ajgwvn erwähnt gewesen sein, aber all dasbleibt fraglich ». En fait, le passage en question n’appartient pas aux décisions proprementdites. Il se rapporte à la procédure de décision. La délibération du Conseil et de l’As-semblée de Paros fut suscitée, en l’occurrence, par l’intervention du néocore Praxias.Celui-ci avait rédigé un rapport écrit (prographè), dans lequel il exposait les difficultésqu’il rencontrait dans la gestion du sanctuaire et sans doute aussi les mesures qu’ilsouhaitait voir prendre par les autorités civiques. Praxias fut vraisemblablement introduitdevant le Conseil parien par les magistrats compétents (à savoir les archontes) et putrépéter oralement devant les bouleutes le contenu de son rapport. Après cette inter-vention, les membres du Conseil n’élaborèrent pas de probouleuma en bonne et dueforme, mais se contentèrent de transmettre l’affaire à l’Assemblée, en offrant à Praxias lapossibilité d’y défendre en personne son projet. Comme le suggérait à juste titreM. Wörrle, il faut en effet lire le nom de l’intervenant Praxias à la ligne 6. Le verbe ejpi-devxasqai doit s’entendre au sens d’« accueillir » ou « recevoir » dans l’ekklèsia (en l’espèce,
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 353
BCH 131 (2007)
142. M. WÖRRLE (supra), p. 356, n. 367, songeait plutôt aux visiteurs (oiJ ginovmenoi), mais on attendrait depréférence une formule telle que : oiJ paraginovmenoi eij~ to; iJerovn (cf. IG IX 2, 1109 [Syll.3 1157], l. 15 et79).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 353
dans une construction impersonnelle). On restituera donc le passage de la façon suivante :
dedovcqai thi≥ b≥o≥ªuº-ªlhiº: ej≥p≥idevxasqai P≥r≥a≥≥ªxivan ejpi; tºo;≥n dhmon≥:ªtºo;≥n d≥e ªdhmon cºrhma-ªtivsai peri; touvtwn ktl.º143
« Plaise au Conseil : que l’on reçoive Praxias dans l’Assemblée du Peuple ; que l’Assemblée duPeuple délibère sur cette question etc. »
L’épigraphie de Paros offre un deuxième exemple, lui aussi méconnu, du verbe ejpidev-cesqai dans l’acception qui nous intéresse. L. Robert publia en 1960 un nouveaufragment d’un décret parien de la fin du IIIe siècle, dont la partie inférieure était connuedepuis longtemps. Ce décret honore des ambassadeurs venus de Pharos, autre colonie deParos. L’intitulé se lit comme suit144 :
22 ªParivwn. “Edoxen th/` boulh/` kaºi; twi dhvmwi: Tevlesi~ªDhmo - - - ei\penº w|n proegravyanto oiJ a[r-ªconte~ uJpe;r twn presbeutwºn≥ twn para; Farivwn: dedov-ªcqai: tou;~ a[rconta~ - - ºq≥ai aujtou;≥~ ejpi; to;n dhmon
26 ª– – – ca 20 l. – – –º, gnwvmhn de; xumbavlles-ªqai th~ boulh~ eij~ to;n dhmºon o{ti dokei th/` boulh/`ªto;n dhmon crhmativsai (Ù) perºi; touvtou: ktl.
Le seul parallèle disponible dans l’épigraphie de Paros est un décret de la fin duIIIe siècle pour des théores de Magnésie du Méandre. Les archontes pariens y sont chargésd'introduire lesdits ambassadeurs devant l'Assemblée : ªdºedovªcºqai : tou;~ a[rconta~ ejpi;to;n dªhºmoªn ⁄ a[ºgein tou;ª~ qºewrou;~ ktl.145. L. Robert avait noté qu’il était impossible derétablir le même verbe a[gein ni le composé ejpavgein dans le décret pour Pharos : « Jerestitue le début de la ligne 25 d’après le sens ; je ne suis pas sûr des mots en l’absence d’unparallèle rigoureux. Un texte de Paros, trouvé dans l’île ou ailleurs, nous apportera unjour, peut-être demain, les formules exactes146 ». Le décret parien sur le sanctuaire de
354 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
143. La formule ªtºo;≥n d≥e ªdhmon cºrhmaªtivsai peri; touvtwn ktl.º m’a été suggérée par Ph. Gauthier [P. H.].
144. L. ROBERT, « Inscriptions hellénistiques de Dalmatie », in Hellenica XI-XII (1960), p. 505-541, part.p. 520-526. J. BOUSQUET, « Inscription hellénistique de Dalmatie », BCH 85 (1961), p. 589-600, apporteplusieurs corrections de détail (cf. Bull. 1963, 129). Le texte est repris dans le SEG XXIII 489. Sur la date,voir P. DEROW, « Pharos and Rome », ZPE 88 (1991), p. 261-270.
145. Syll.3 562 ; K. J. RIGSBY, Asylia (1996), n° 100, p. 237-240. Il faudrait plutôt écrire : ªajgagºei`n uelªejpagagºein.
146. L. ROBERT (supra, n. 144), p. 524. J. BOUSQUET (supra, n. 144), p. 597, proposait avec circonspection derestituer : ªdedov⁄cqai : provsodon me;n dedovsºq≥ai aujtoi`≥~ ejpi; to;n dh`mon ⁄ ªprwvtoi~ meta; ta; iJeravº. Une telleclause n’a pas sa place ici : il s’agit de donner audience, ponctuellement, aux ambassadeurs et non de leuroctroyer le privilège d’un accès permanent à l’Assemblée.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 354
Sérapis offre précisément le parallèle que L. Robert appelait de ses vœux, et le nouveaufragment thasien vient aujourd’hui confirmer qu’ejpidevcesqai est bien le verbe qu’il fautrétablir à la ligne 25 :
(...) : dedov- ªcqai th/` boulh/`: ejpidevxasºq≥ai aujtou;~ ejpi; to;n dhmon
26 ªe.g. ejn th/` prwvth/ ejkklhsiva/º147, gnwvmhn de; xumbavlles-ªqai th~ boulh~ eij~ to;n dhmºon o{ti dokei th/` boulh/`ªto;n dhmon crhmativsai (Ù) perºi; touvtou: ktl.
Les rapports politiques entre Paros et Thasos étaient encore très étroits au IVe siècle etl’on a même soupçonné l’existence d’une convention de sympolitie, à la fin du siècle,entre les deux cités148. On ne saurait par conséquent être surpris de constater la parenté duvocabulaire institutionnel entre la métropole et sa colonie. Le nouveau fragment de décretthasien fournit désormais l’exemple le plus ancien de l’emploi du verbe ejpidevcesqai àpropos d’une ekklèsia. Les prytanes accueillent les orphelins et les adressent à leurs (futurs)concitoyens réunis en assemblée : la junctura ejpidevcesqai kai; ejpavgein met en valeur leurrôle habituel de pivot entre la Boulè et l’Ekklèsia d’une part et entre les particuliers et lesautorités civiques d’autre part.
MINES, STATÈRES, OBOLES : PROBLÈMES DE MÉTROLOGIE ET DE COMPTABILITÉ THASIENNES149
Le fragment B contient plusieurs mentions de fractions du système comptable et moné-taire thasien. Aux mines, déjà citées dans le fragment A (l. 20), s’ajoutent désormais les sta-tères (l. 33 et 45) et les oboles (l. 31). Ces mentions épigraphiques présentent un grand in-térêt, car elles appartiennent à une époque-charnière dans l’histoire monétaire de la cité.Elles invitent à poursuivre la réflexion sur la nouvelle série monétaire mise en place au dé-but du IVe siècle et en particulier sur l’identité et la valeur du statère, qui est peut-être laseule dénomination à avoir persisté entre l’ancien et le nouveau système. Il est nécessaire,
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 355
BCH 131 (2007)
147. Le supplément ªejn th/` prwvth/ ejkklhsiva/º m’a été suggéré par Ph. Gauthier [P. H.].
148. POUILLOUX 1954, p. 430-431.
149. Outre les personnes citées dans la note liminaire, je remercie Mmes et MM. V. Van Driessche, S. Psôma,Ch. Doyen et P. Marchetti, qui ont bien voulu discuter avec moi des aspects proprement monétaires dudécret [J. F.].
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 355
pour l’intelligibilité de notre propos, de faire quelques brefs rappels sur l’histoire de l’orga-nisation monétaire thasienne, en nous appuyant principalement sur les travaux d’O. Pi-card150.
À partir des dernières décennies du VIe et tout au long du Ve siècle, les Thasiens frap-pèrent des monnaies d’argent au type du Silène enlevant une ménade. Cette série obéissaità un système divisionnaire connu surtout dans les cités d’Ionie : l’unité principale, lestatère (8,6 à 10 g), se subdivisait en tritès (tiers de statère), hectès (sixièmes), hémiecta(douzièmes), quarts et huitièmes d’hectè151. Vers la fin des années 390, Thasos réformason système monétaire : les monnaies au Silène et à la Ménade furent décriées et rem-placées par une nouvelle série. Cette réforme radicale – qui coïncida sans doute avec unretour du régime démocratique (cf.. infra) – modifia le nom des divisions du systèmecomptable152. Au statère et à ses subdivisions se substitua un nouveau système divisionnairefondé sur la drachme153 et ses fractions (oboles, hémioboles, etc.) et dont la pièce la pluslourde était, dans les premiers temps, un tétradrachme (pouvant peser jusqu’à 15 g). Lestypes iconographiques furent également renouvelés : les monnaies d’argent de la nou-velle série portent au droit la tête de Dionysos, au revers l’image d’Héraclès archer. Undernier aspect de la réforme fut l’introduction d’une monnaie divisionnaire en bronze.La composition des trésors monétaires montre qu’un système chassa l’autre : il est clairque les monnaies au Silène, décriées, ne circulèrent jamais en même temps que les mon-naies au Dionysos et à l’Héraclès.
En dépit des apparences, la réforme ne provoqua pas un bouleversement profond dusystème métrologique thasien. On observe en effet une correspondance pondérale entre latritè de la série ancienne et la drachme de la série nouvelle (3,6 à 3,9 g), mais égalemententre l’hectè (1/2 tritè) et l’hémidrachme, et entre l’hémiecton (1/4 de tritè) et letrihémiobole (1/4 de drachme). Ces équivalences facilitèrent les conversions et permirent
356 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
150. Pour une présentation synthétique du monnayage thasien au Ve et au IVe s., voir O. PICARD, in Guide2000, p. 303-308.
151. Sur la série au Silène et à la Ménade, voir O. PICARD, « Monnayage thasien du Ve siècle avant J.-C. », CRAI1982, p. 412-424, qui établit la liste des inscriptions thasiennes mentionnant ces dénominations ; il faut yajouter désormais la Stèle du port, qui fournit l’éventail le plus précis (DUCHÊNE 1992 : statère, hectè,hémiecton). Pour le troisième groupe de cette série, voir O. PICARD, « Monnaies et gravure monétaire àThasos à la fin du Ve siècle », in Fivlia “Eph eij~ G. Mulwnan II (1987), p. 150-163.
152. Sur la deuxième série du monnayage thasien, voir O. PICARD, « L’organisation de l’atelier de Thasos au IVe
siècle », in Actes du IXe Congrès international de numismatique, Berne 1979 (1982), p. 118-124 ; id.,« Monnaie et commerce à Thasos », in Les échanges dans l’Antiquité : le rôle de l’État, Entretiens d’histoire etd’archéologie (1994), p. 31-45 ; PICARD 2000, p. 1078-1084.
153. Les deux plus anciennes attestations de la drachme à Thasos apparaissent dans POUILLOUX 1954, 150(SEG XVII, 416), l. 18, et IG XII Suppl 356, l. 10, datables l’un comme l’autre du milieu du IVe s. environ.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 356
la transition en douceur d’une série à l’autre. O. Picard a pu écrire que Thasos n’avait pasvéritablement changé d’étalon monétaire, mais simplement réorganisé son systèmedivisionnaire autour du pivot inchangé que représentait le module de 3,6-3,9 g, c’est-à-dire la tritè/drachme154. Les motivations de la réforme furent peut-être en partieidéologiques : le renouvellement des types pouvait signaler symboliquement, et de façonspectaculaire, le changement de régime politique. Mais la réforme permit sans douteégalement aux Thasiens de conformer leur monnayage à un système alors en pleindéveloppement dans l’Égée du Nord : déjà en vigueur en Chalcidique depuis la secondemoitié du Ve siècle155, il fut adopté vers 370 par la cité d’Amphipolis, puis, au début desannées 350, par Philippe II de Macédoine. Les différentes fractions de ce systèmes’organisent autour d’une drachme de 3,6 g en moyenne et d’un tétradrachme de14,4 g156.
Le décret sur les Braves, daté par des critères externes du milieu du IVe siècle, témoignelui aussi du nouveau système comptable et mentionne plusieurs de ses unités, qu’ellescorrespondent ou non à des divisions effectivement frappées. Nous ferons successivementtrois remarques à ce sujet.
1) Parmi les dénominations mentionnées, la plus faible est l’obole (l. 31). Il s’agitdésormais de la plus ancienne attestation de cette dénomination dans l’épigraphiethasienne157. Peut-être plus sûrement encore que la mine158, l’obole doit être considérée
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 357
BCH 131 (2007)
154. O. PICARD, in Actes du IXe Congrès (supra, n. 152), p. 124-127 ; Guide 2000, p. 306 ; S. PSÔMA « Notes surla terminologie monétaire en Grèce du Nord », RN 162 (2006), p. 93.
155. Selon toute vraisemblance, c’est auprès des Chalcidiens que les Thasiens connurent également l’usage dela monnaie de bronze avant de l’adopter eux-mêmes : cf. S. PSÔMA, Olynthe et les Chalcidiens de Thrace(2001), p. 108-120. L’influence chalcidienne au tournant du Ve et du IVe s. transparaît par ailleurs dans lerôle joué par Acanthos dans la réconciliation des Thasiens après la restauration démocratique : PICARD
2000, p. 1064.
156. S. PSÔMA (supra) parle d’une version « chalcidienne » de l’étalon thraco-macédonien.
157. Une autre mention apparaissait déjà dans le règlement du culte de Théogénès (R. MARTIN, BCH 64-65[1940-1941], p. 175-176, n° 1 [LSCGS 72]). L’inscription fut gravée au IIe s. av. J.-C., mais il est possibleque le règlement lui-même remonte à la fondation du culte du héros vers 390 (cf. O. PICARD, « Les obolesde Théogénès », in M.-M. MACTOUX, E. GENY [éds], Mélanges P. Lévêque 5, Annales littéraires del’université de Besançon 429 [1990], p. 315-323, part. p. 316-317).
158. Le décompte de sommes importantes en mines plutôt qu’en statères, comme c’était auparavant l’usage, aservi d’argument-clé à PICARD 2000, p. 1079, pour dater le décret sur la restauration démocratique dudébut du IVe s., dans les tout premiers temps de la réforme monétaire. Il s’agit en effet de la plus ancienneinscription thasienne où l’usage de la mine est attesté de façon indiscutable. Ch. PICARD, BCH 45 (1921),p. 147, avait autrefois restitué ªtºre`~ kai; devka m⁄ªna`~º dans le règlement des carpologues (IG XII Suppl.349, B, l. 10-11 ; le document, antérieur à la réforme monétaire, est daté du dernier quart du Ve s. parPOUILLOUX 1954, p. 123). Cette restitution est très hypothétique, car le passage est mutilé ; elle n’apparaît
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 357
comme un marqueur du nouveau système monétaire. Son apparition dans la stèle desBraves confirme que, vers 350, la réforme avait été entérinée et que ses effets étaient passésdans l’usage.
2) Le nouveau fragment atteste également la survie du statère en tant que dénomi-nation vers le milieu du IVe siècle, c’est-à-dire une trentaine ou une quarantaine d’annéesaprès l’abandon de la frappe des statères du Ve siècle, les monnaies lourdes de 8,6-10 g autype du Silène et de la Ménade. Nous savions certes déjà que l’usage du mot « statère »n’avait pas définitivement disparu, à Thasos, après la réforme de ca 390. Mais le terme neréapparaissait jusqu’à présent que dans des inscriptions nettement plus tardives, datées dela fin du IVe ou du IIIe siècle159. La stèle des Braves en offre désormais la toute premièreattestation postérieure à la mise en place du nouveau système.
Ce constat chronologique n’est pas sans conséquence sur la valeur à reconnaître austatère du IVe et du IIIe siècle et en particulier sur le rapport entre statère et drachme. Lamonnaie lourde de la nouvelle série fut d’abord, comme nous l’avons rappelé, le tétra-drachme (jusqu’à 15 g). La frappe de ces pièces fut abandonnée aux alentours de 335160 :au tétradrachme succéda alors, en tant que monnaie lourde, le didrachme (6-7 g).O. Picard a proposé d’associer la réapparition du mot « statère » dans les inscriptionsthasiennes de la fin du IVe siècle avec le remplacement du tétradrachme par le didrachme.
358 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
plus dans la réédition de Fr. SALVIAT, Études Classiques III (1971), p. 237-247 (SEG XXXVI 792). Onnotera toutefois qu’il n’y a pas d’impossibilité théorique à la coexistence, au sein d’un même systèmepondéral ou comptable, de la mine et du statère d’origine ionienne, le second représentant une division dela première. Une plaque d’argent découverte à l’Artémision d’Éphèse (SGDI IV, p. 870, no 49 [milieu duVIe s.]) mentionne ainsi conjointement les mines, les demi-mines, les statères, les hectès et les hémiecta : cf.H. NICOLET-PIERRE, « Épigraphie et numismatique : quelques remarques sur les noms de monnaies dansdes inscriptions grecques archaïques », in K. A. SHEEDY, C. PAPAGEORGIADOU-BANIS (éds), NumismaticArcheology, Archeological Numismatics (1995), p. 71-72. D’autre part, la Stèle des Braves montre que lesThasiens, tout en conservant l’usage de la mine, eurent à nouveau recours au statère pour désigner dessommes importantes, y compris les amendes encourues.
159. IG XII 8, 267 (début du IIIe s.) ; IG XII Suppl 348 ; 355 ; 358 et 362 (IIIe s.). Une dernière mention date del’époque julio-claudienne : DUNANT, POUILLOUX 1958, 185. Le denier étant alors la seule monnaied’argent en circulation, ces « statères » n’ont guère de rapport avec ceux du IVe et du IIIe s. av. J.-C. : ilsreprésentent sans doute l’équivalent d’un didrachme attique, soit deux deniers.
160. Voir O. PICARD, CRAI 1985, p. 764-765 ; « Monnaie et commerce » (n. 152), p. 33. Cette datation sefonde principalement sur les données fournies par le trésor de Pixodaros (CH IX [2002], 421), découverten 1978 près du théâtre d’Halicarnasse. Le trésor recelait 29 tétradrachmes thasiens appartenantmajoritairement aux émissions les plus tardives de la série, sur un total d’environ 2 600 monnaies dediverse provenance dont l’enfouissement est daté assez précisément de 341/340. L’absence detétradrachmes thasiens portant des monogrammes (qui succèdent à ceux qui portent des symboles) faitdire à l’un des éditeurs, A. Meadows, que certaines émissions pourraient avoir débuté à l’époque del’enfouissement du trésor de Pixodaros ou très peu de temps après.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 358
Dès lors, le « nouveau » statère aurait ainsi correspondu à une monnaie effectivementfrappée, distincte par son poids (6-7 g), sa valeur et ses types monétaires de l’« ancien »statère du Ve siècle (8,6-10 g). L’intervalle d’une cinquantaine d’années entre le décri desanciens statères et la frappe des nouveaux statères/didrachmes aurait permis d’éviter touteconfusion entre les deux pièces dans l’esprit des Thasiens161.
La mention nouvelle de statères dans notre inscription – une vingtaine d’années environavant l’abandon de la frappe des tétradrachmes – remet en cause l’interprétation d’O. Picardsur ce point précis. Le « statère » est, selon Pollux, le module le plus lourd du systèmeen vigueur à un moment donné dans une cité, quel que soit l’étalon pondéral adopté162.Il paraît douteux que les Thasiens, au milieu du IVe siècle, aient qualifié de « statère »une autre monnaie que le tétradrachme aux types de Dionysos et d’Héraclès archer. Lasomme de 17,5 statères versée aux métèques (l. 33) équivaut dans ce cas à 4 x 17,5 = 70drachmes. Le libellé plaide d’ailleurs peut-être, lui aussi, en faveur d’un statère supérieurà deux drachmes : on dit « 17 statères 1 hémistatère » (stathra~ dekaepta; hJmistavthron)et non « 17 statères 1 drachme » (stathre~ dekaepta; dracmhv), comme dans les actes d’af-franchissement de Delphes postérieurs à 200 av. J.-C., qui utilisent un système comptableoù le statère vaut 2 drachmes163.
La frappe de ces tétradrachmes thasiens remonte, on l’a dit, aux premières annéesde la nouvelle série monétaire164. Il faut donc admettre qu’au statère « ancien » (au Silèneet à la Ménade) succéda presque immédiatement un statère « nouveau », aux types, aupoids et à la valeur différents165. Le terme « statère », inchangé, continua d’être employédans les inscriptions, par delà la réforme et ses effets. On ignore si la distinction fut signaléed’une façon ou d’une autre dans les documents officiels, au moment du passage d’unsystème à l’autre. Une trentaine d’années plus tard, l’absence de précision laisse penser
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 359
BCH 131 (2007)
161. O. PICARD, CRAI 1982, p. 415.
162. Pollux, IX 57-59. Chez les lexicographes Hésychius et Photius comme dans la Souda, le statère désigne letétradrachme, en particulier de poids attique. Voir à ce sujet S. PSÔMA, « Staqmhtikoiv kanovne~ sth
Calkidikhv katav ton 5o kai 4o p. C. », in P. ADAM-VELENI (éd.), ΔObolov~ 4. To novmisma sto makedonikov cwvro
(2000), p. 26.
163. Voir les références fournies infra, n. 169.
164. Voir à ce sujet les remarques d’A. MEADOWS, CH IX (2002), p. 161-166.
165. Un tel phénomène ne serait pas sans parallèle. À la fin du VIe et au Ve s., les cités de Chalcidique avaientfrappé un tétradrachme de poids attico-eubéen (17,2 g) dont le nom d’usage était le « statère » (le termeSTATER figure notamment sur des tétradrachmes de la cité de Sermylia). Dans les années 420, en mêmetemps que débutèrent les premières frappes de la Ligue des Chalcidiens, cet ancien statère futgénéralement abandonné au profit d’un tétradrachme de poids « thraco-macédonien » (14,4 g). Cettenouvelle monnaie lourde fut probablement elle aussi désignée sous le nom de « statère ». Voir S. PSÔMA
(supra, n. 162) ; ead., « Statevr Mavcon. The “Sermylia” Group of Coins », NomChron 20 (2001), p. 31-44.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 359
que la nouvelle valeur du statère était suffisamment intégrée pour qu’il ne fût plus néces-saire de la rappeler. Quant à la persistance des « statères » dans les inscriptions du derniertiers du IVe et du IIIe siècle, c’est-à-dire après que la frappe du tétradrachme eut été aban-donnée, elle signifierait que le statère continua d’être manié en tant que monnaie de compte.Au IIIe siècle, les sommes libellées en statères devaient en fait être payées au moyen dedénominations inférieures, d’argent ou même de bronze166.
3) La question la plus difficile concerne le libellé de « 17 statères 1 hémistatère »,employé pour désigner la somme versée « aux métèques » (l. 33). Cette somme ne doitcertainement rien au hasard et sa signification devait être immédiatement compréhen-sible pour les contemporains. Pour essayer d’en rendre compte, il faut s’interroger ànouveau sur le rapport entre la mine et le statère. Il est naturel de supposer que« 17 statères 1 hémistatère » correspondent à une fraction d’une valeur supérieure dans lesystème divisionnaire. Le rapport qui vient d’emblée à l’esprit est celui que l’on rencontredans le système éginétique, où 17,5 statères valent 35 drachmes, soit une demi-mine167.Cette équivalence comptable trouve son origine dans la division de la mine de 436,6 g en35 statères éginétiques de 12,4 g, soit 70 drachmes de 6,2 g. Le système attique enrevanche, à la suite d’une réforme qu’Aristote fait remonter à Solon, décompose la mêmemine en 100 drachmes de 4,366 g168. Les montants de 17,5 statères sont récurrents, enparticulier, dans la comptabilité – tenue selon le système éginétique – des affranchisse-ments de Delphes, à partir de 200 : l’expression simple « 1 demi-mine (hJmimnai`on) »y coexiste avec la formule développée « 17 statères 1 drachme169 ».
360 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
166. Une telle pratique est connue ailleurs dans le monde grec. Dans l’un des décrets de Kymè pour Archippè(SEG XXXIII 1039, deuxième moitié du IIe s.), la mention de stathre~ calkou (l. 51-52, 56-58) indiqueque des montants exprimés en statères – que ceux-ci correspondent à des tétradrachmes locaux ou à descistophores – pouvaient être payés au moyen du numéraire de bronze : cf. O. PICARD, « Monétarisation etéconomie des cités grecques à la basse période hellénistique : la fortune d’Archippè de Kymè », inR. DESCAT (éd.), Approches de l’économie hellénistique, Entretiens d’archéologie et d’histoire de Saint-Bertrand-de-Comminges 7 (2006), p. 95-97. À Thasos, le règlement du culte de Théogénès, qui prévoyaitque le produit annuel des aparchai (payées en bronze) serait conservé par le hiéromnémon jusqu’à hauteurde 1 000 drachmes (LSCGS 72, l. 9-10), montre que la conversion entre espèces de bronze et d’argent étaithabituelle.
167. D. Mulliez a le premier attiré mon attention sur cet aspect. [J. F.]
168. Aristote, Ath. Pol. 10, 2. Sur la distinction entre mine éginétique et mine attique, voir K. HITZL, DieGewichte griechischer Zeit aus Olympia, Olympische Forschungen 25 (1996), p. 3-41 et 47-65. La minemonétaire, dont l’équivalence en drachmes reste constante, doit par ailleurs être distinguée de la minepondérale, dont le poids et la valeur ont pu augmenter au cours du temps : la mine (pondérale) attiquevaut ainsi 105 drachmes au Ve s., 110 au IVe s., 138 à la haute époque hellénistique, 150 à la basse époquehellénistique (cf. K. HITZL, ibid., p. 105-120).
169. SGDI 2264, 2287; FD III 1, 567; BCH 66-67 (1942-1943), p. 72-73, no 3. Cf. D. MULLIEZ, Topoi 7/1(1997), p. 94 et n. 5.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 360
Il est toutefois difficile de pousser plus avant l’analogie avec la somme mentionnéedans la stèle des Braves. En effet, il est fort peu probable que les 17,5 statères désignent iciune somme exprimée dans l’étalon éginétique, non converti, correspondant à unpaiement effectué dans une autre monnaie que celle de la cité. L’emploi conjoint de deuxsystèmes monétaires est certes bien attesté, dans les inscriptions d’époque hellénistiquesurtout, lorsqu’il devint courant d’associer dans les échanges une monnaie civique et unemonnaie « commune » à vocation internationale. Il n’était pas rare, en particulier, qu’unecité effectuât des paiements à des étrangers dans une monnaie autre que la sienne, plusfacilement échangeable hors de son territoire. Mais dans un tel cas, toute confusion étaitévitée par la distinction explicite entre la monnaie étrangère et la monnaie locale, diteparfois « épichorique170 ». Dans le règlement des Braves, rien ne différencie les 17,5statères payés aux métèques (l. 33) des 1 000 statères d’amende imposés aux contreve-nants (l. 45) et il est impossible que ces sommes aient relevé de deux étalons différents. Les17,5 statères étaient donc frappés dans la monnaie thasienne et payés avec le même numé-raire que les autres sommes exprimées dans le décret.
Il n’est guère plus vraisemblable que Thasos ait elle-même frappé monnaie dans l’étalonéginétique à quelque moment de son histoire. La cité n’appartient pas, en effet, à l’airede diffusion de cet étalon, qui s’étend principalement dans le Péloponnèse, en Grèce cen-trale, dans les Cyclades et en Crète171. Il est exact que Paros, comme la plupart des citéscycladiques, frappa ses premières monnaies dans l’étalon éginétique (drachme locale àenviron 6 g) et adopta même le style de gravure des monnaies d’Égine172. Toutefois, l’ap-parition et le développement de la monnaie à Thasos sont partie prenante d’un phénomène
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 361
BCH 131 (2007)
170. Voir M.-Chr. MARCELLESI, « Commerce, monnaies locales et monnaies communes dans les Étatshellénistiques », REG 113 (2000), p. 326-357.
171. On a pu considérer que les cités d’Abdère et de Maronée, dont l’histoire monétaire est parallèle, avaientponctuellement frappé des émissions d’argent dans cet étalon au tournant du Ve et du IVe s., peut-être pourse démarquer de l’hégémonie athénienne (« période VI » : statères à environ 12,5 g, hémistatères à environ6,25 g). Voir J. MAY, The Coinage of Abdera (1966), p. 25-27 ; E. SCHÖNERT-GEISS, Die Münzprägung vonMaroneia (1987), p. 24-27. Toutefois, ces émissions se situent dans une courbe de poids globalementdécroissante entre le milieu du Ve et le milieu du IVe s. (le poids du tétradrachme chutant de 14,9 à 11,4 g) :que les valeurs pondérales aient frôlé à un moment celle du système éginétique ne prouve en rien que lescités aient délibérément adopté cet étalon. Voir à ce sujet K. CHRYSSANTHAKI-NAGLE, L’histoire monétaired’Abdère en Thrace (2007), p. 88, qui propose de surcroît d’abaisser la période VI à 395-360 av. J.-C.
172. Voir par exemple SNG France 1, collection Delepierre, nos 2437-2456 ; M. PRICE, N. WAGGONER, ArchaicGreek Coinage. The Asyut Hoard (1975), p. 80-81. Sur la gravure, cf. K. A. SHEEDY, « Changes in Personnelat the Archaic Mint of Paros », in Carakthvr. Afievrwma sth Mavntw Oikonomivdou (1996), p. 277-282.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 361
régional, auquel la domination perse n’est peut-être pas étrangère173, mais où les influencesde la métropole semblent absentes. Les émissions du système thasien ancien se rattachentau système « thraco-macédonien » et leurs valeurs pondérales diffèrent sensiblement decelles de l’étalon éginétique. Le poids moyen du statère thasien (8,6-10 g), en particulier,est bien inférieur aux 12,4 g du statère éginétique. Les poids du nouveau système moné-taire thasien (tétradrachme/« statère » à un peu moins de 15 g, drachme à 3,6-3,9 g) necorrespondent pas davantage aux normes éginétiques. Paros, au début du IVe siècle, avaitrecommencé à frapper monnaie après une interruption de plusieurs décennies : les nou-velles émissions avaient cependant abandonné l’étalon éginétique et ne furent produitesque dans un assez faible volume174. Il est donc exclu que Thasos ait pu importer de samétropole, au moment de la réforme monétaire de ca 390, l’usage de l’étalon éginétique.
Il est, à notre avis, encore plus impossible d’envisager que la cité de Thasos aitsimplement emprunté, à tel ou tel moment de son histoire, les pratiques comptables dusystème éginétique et en particulier le rapport : 1 mine = 35 statères175. Cette hypothèseobligerait à remettre en cause l’équivalence postulée par O. Picard entre l’amende de1 000 statères « anciens » (= 3 000 tritès), dans la loi contre les menées anti-oligarchiques(411-407), et celle de 30 mines de type attique (= 3 000 drachmes = 1/2 talent), dans ledécret restaurant la démocratie (qu’il situe en 390 [?])176. Si l’on suppose que la mine vaut35 statères et le statère 4 drachmes, une somme de 30 mines équivaudrait à 1 050 statères,soit 4 200 drachmes.
On peut tenter d’explorer une autre piste pour rendre compte de la somme de« 17 statères 1 hémistatère » sans avoir à supposer un rapport avec l’étalon éginétique. Cemontant atypique pourrait correspondre, après conversion, à une somme « ronde » dansun autre système comptable et monétaire. Selon une hypothèse qui nous a été suggérée
362 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
173. Sur ce point, voir O. PICARD, « Monnayages en Thrace à l’époque achéménide », in O. CASABONNE (éd.),Mécanismes et innovations monétaires dans l’Anatolie achéménide. Numismatique et histoire, Varia anatolicaXII (2000), p. 239-253, qui souligne en particulier la parenté pondérale, iconographique et stylistiqueliant la série thasienne au Silène et à la Ménade à la série au Centaure et à la Ménade frappée au nom destribus thraces des Orreskiens, des Létéens, des Laeitiens et des Zaiéléens.
174. C. M. KRAAY, Archaic and Classical Greek Coins (1976), p. 45-49. Signalons qu’aucune monnaie pariennen’a jusqu’à présent été découverte dans les fouilles de Thasos.
175. L’imitation se limiterait au rapport entre mines et statères et n’affecterait pas le rapport entre mines etdrachmes. Le statère thasien postérieur à la réforme, comme on l’a vu, vaut probablement 4 drachmes, cequi impliquerait une mine à 140 drachmes.
176. POUILLOUX 1954, 18, l. 1 ; SEG XXXVIII 851 B, l. 9-11. Cf. PICARD 2000, p. 1079. Le même postulatd’une équivalence 1 mine = 100 drachmes est adopté par VÉRILHAC, VIAL 1998, p. 164, n. 92, qui évoquentles « 300 drachmes » (en fait les trois mines) que vaut au minimum la panoplie des garçons (l. 20).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 362
par O. Picard, il pourrait s’agir d’une équivalence avec le monnayage attique. En poidsd’argent, 17,5 statères/tétradrachmes thasiens du IVe siècle (drachme entre 3,6 et 3,9 g)équivalent en effet approximativement à 15 tétradrachmes attiques (drachme à 4,36 g) :
Thasos Athènes17, 5 × 4 × 3,6 = 252
Moyenne : 262,5 15 × 4 × 4,36 = 261,617,5 × 4 × 3,9 = 273
À une époque où Athènes était très active dans le Nord de l’Égée et avait fait du portde Thasos une escale importante pour sa flotte (cf. infra), les Thasiens auraient ainsi offertaux ayants droit des métèques morts au combat une somme aisément convertible enmonnaie attique.
On le voit, le montant de 17,5 statères suscite plus d’interrogations qu’il n’apported’informations sûres. Seule la découverte de nouveaux parallèles épigraphiques permet-trait de lever ces incertitudes.
Tableau récapitulatif : le système comptable thasien au IVe siècle av. J.-C., d’après la stèle des Braves.
1 obole4 oboles 2/3 drachme 6 oboles 1 drachme
4 drachmes 1 statère « nouveau »70 drachmes 17,5 statères 0,7 mine100 drachmes 25 statères 1 mine300 drachmes 75 statères 3 mines3000 drachmes 750 statères 30 mines 1/2talent4000 drachmes [1000] statères6000 drachmes 1500 statères 60 mines 1 talent
(En italiques : montants figurant dans SEG XXXVIII 851 et dans le décret sur les Braves.)
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 363
BCH 131 (2007)
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 363
LES FINANCES PUBLIQUES THASIENNES : MAGISTRATS ET PRATIQUES DE GESTION
L’apodecte apparaît dans notre décret comme l’un des principaux exécutants des mesuresprises en faveur des Braves et de leurs ayants droits. Mentionné à quatre reprises, il estresponsable de tous les versements monnayés, qu’il s’agisse des frais de sacrifice pourhonorer la mémoire des Braves (l. 11-12), du paiement de la trophè (l. 31), de l’indemnitéversée aux métèques (l. 33-34) ou encore des frais de la stèle (l. 40-41). Il est possible,sinon probable, qu’il ait été aussi chargé de verser leur dot aux filles des Braves et qu’ilfaille restituer son titre dans la lacune des l. 23-24.
Le nouveau fragment confirme l’importance, dans la gestion des finances thasiennes,de ce magistrat, qui jusqu’alors n’était connu, aux époques classique et hellénistique, quepar le fragment A (l. 12) et par le décret pour les juges de Cos177. Son titre suggère qu’ilétait le principal receveur des revenus publics, chargé de les affecter ensuite aux différentesarchai. La clause sur la publication (l. 40-42) prouve qu’il était en outre lui-même ledépositaire d’une caisse centrale sur laquelle étaient effectués les paiements courants.Comme pour la trophè à Rhodes178, c’est vraisemblablement sur cette caisse qu’étaientprélevées les dépenses liées aux morts honorés et à leurs ayants droit. L’apodecte thasienrépond parfaitement à la définition que donne Aristote de ce type de magistrature dans latypologie des archai qu’il dresse au livre VI de la Politique : « il y a aussi une autremagistrature à laquelle sont versés les revenus communs : ces magistrats les gardent et lesrépartissent entre les différents secteurs de l’administration ; on les appelle des receveurs(ajpodevktai) ou des trésoriers (tamivai)179 ». À Thasos, l’apodecte gérait les revenus publics,tandis qu’un autre trésorier, le hiéromnémon, était chargé de l’administration des fondssacrés, conformément à une séparation observée dans toutes les cités grecques entredhmovsia crhvmata et iJera; crhvmata. L’un et l’autre se conformaient aux ordres du Conseil etde l’Assemblée180.
Dans les grandes cités, ces responsabilités, à la fois lourdes et délicates, étaient généra-lement confiées à plusieurs collèges distincts. À Athènes, au IVe siècle, un collège de dixapodectes était spécialement chargé de percevoir, à chaque prytanie, sous le contrôle duConseil, les revenus courants de la cité et d’affecter immédiatement à chaque archè lasomme qui lui revenait selon un plan de répartition appelé merismov~ ; ces apodectes ne
364 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
177. SEG XLIX 1108, l. 13-15 et 19-20.
178. Cf. supra, n. 50.
179. Aristote, Politique VI 8, 6, 1321b.
180. Sur l’organisation des finances thasiennes, voir POUILLOUX 1954, p. 403-404 ; sur le hiéromnèmon,GRANDJEAN, SALVIAT 2006. Sur l’organisation des finances des cités en général, voir L. MIGEOTTE, « Lahaute administration des finances publiques et sacrées dans les cités hellénistiques », Chiron 36 (2006),p. 379-394.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 364
« gardaient » eux-mêmes aucun trésor181. À Milet, au IIIe siècle, un collège d’ajnatavktaiétait chargé d’établir un plan de répartition des dépenses (ajnavtaxi~), tandis que la gestionquotidienne de la caisse publique incombait à un collège de trésoriers (tamivai)182. Dansles cités petites ou moyennes, en revanche, « les magistratures [étaient] nécessairementmoins nombreuses », comme le note Aristote : les différentes fonctions financières yétaient donc plus souvent cumulées par des magistrats uniques, désignés pour un an183.Le postulat se vérifie à Thasos, cité d’importance moyenne, où le système de perception etde redistribution des revenus publics était moins élaboré qu’à Athènes ou Milet. L’apo-decte thasien concentrait par conséquent entre ses mains des responsabilités écrasantes. Iln’est pas surprenant que la présence du secrétaire du Conseil ait été rendue obligatoire lorsdu déblocage des fonds nécessaires à la publication du décret : parovnto~ tou grammatevw~ªth~ boulh~º (l. 42). C’est probablement le signe que la boulè thasienne s’efforçait d’exercerun certain contrôle sur le magistrat unique en charge des finances publiques184.
Le décret pour les Braves offre par ailleurs une vue partielle de l’organisation desfinances publiques à Thasos. Il fait connaître en particulier certaines modalités de planifi-cation des dépenses publiques.
L’allocation inférieure ou égale à 4 oboles versée aux orphelins constitue un exempledes menues dépenses qu’occasionnait le fonctionnement ordinaire des institutionsciviques. Le paiement du misthos des juges en est un autre exemple : il n’est certes pasattesté formellement par les inscriptions, mais les tessères de bronze découvertes dans lesfouilles, et que l’on peut dater du IVe et du IIIe siècle, permettent de supposer que lesmembres des tribunaux thasiens étaient tirés au sort parmi les citoyens ordinaires et qu’ilsrecevaient une indemnité, à l’instar des dicastes athéniens. Comme l’a suggéré O. Picard,ces versements réguliers de sommes modiques contribuèrent sans doute à l’introductiondu monnayage de bronze, que l’on ne peut expliquer par les seuls besoins des échangesinternes à la cité185.
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 365
BCH 131 (2007)
181. Aristote, Ath. Pol. 48, 1-2. Cf. A. R. W. HARRISON, The Law of Athens, II (1971), p. 27-28 ; P. J. RHODES,The Athenian Boule (1972), p. 98-105 ; id., A Commentary on the A. P.2 (1993), ad loc., p. 557-560 ;L. MIGEOTTE, Studi Ellenistici XIX (2006), p. 77-97.
182. Voir L. MIGEOTTE, ibid., p. 79-82 et Chiron 36 (2006), p. 382-385.
183. Aristote, Politique VI 8, 2, 1321b. Voir les exemples de trésoriers uniques rassemblés et commentés parL. MIGEOTTE, Chiron 36 (2006), p. 379-394, en particulier ceux de Priène et Samos.
184. Dans l’Athènes du IVe s., les registres des apodectes étaient mis à jour « en présence du Conseil », ejnantivon
th`~ boulh`~ : Aristote, Ath. Pol. 48, 1. À Délos au IIIe s., la paradosis du trésor d’Apollon entre collèges dehiéropes, ainsi que certains versements importants, s’effectuaient parouvsh~ boulh`~ uel parovntwn
bouleutw`n (kai; grammatevwn) : Cl. VIAL, Délos indépendante, BCH Suppl. X (1984), p. 105-106. Voirégalement P. ROESCH, Thespies et la Confédération béotienne (1965), p. 172.
185. O. PICARD, CRAI 1985, p. 775-776.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 365
On peut envisager deux modes de versement pour l’allocation des orphelins. Si elleétait versée quotidiennement à chaque bénéficiaire, elle ne pouvait être payée qu’enbronze186. La plus petite dénomination d’argent frappée par Thasos dans la premièremoitié du IVe siècle est en effet le trihémiobole aux types de Dionysos barbu et d’Héraclèsarcher. Le trihémiobole valant 1/4 drachme (1,5 obole), le paiement de toute allocationde 1, de 2 ou de 4 oboles nécessitait le recours à des subdivisions de bronze, tout commele versement d’une offrande d’1 obole pour sacrifier à Théogénès187. Thasos frappait deschalques depuis ca 390 et, à partir de ca 360, des pièces plus lourdes, dans lesquellesO. Picard a reconnu des hémioboles (0,5 obole), avec au droit la tête d’Héraclès et aurevers les armes du héros. Il est cependant peu vraisemblable qu’en temps ordinaire latrophè, même calculée sur une base journalière, ait été versée jour après jour aux orphelins.Ils auraient dû aller trouver quotidiennement l’apodecte pour recevoir leur pension. Ledéblocage de fonds par les magistrats étant toujours une procédure complexe et qui néces-sitait quelquefois l’intervention du Conseil, l’opération n’avait certainement pas lieu aussifréquemment. Il est plus simple de penser que l’indemnité était payée à échéances régu-lières, en versements plus importants – peut-être une fois par mois188 –, ce qui du resten’exclut peut-être pas le recours aux dénominations de bronze.
On remarquera par ailleurs que le montant de l’allocation versée aux orphelins estdégressif, à partir d’un plafond fixé à 4 oboles. La situation est différente de celle quiprévalait dans l’Athènes du IVe siècle, où les allocations du même genre correspondaient àdes sommes forfaitaires (1 obole pour les orphelins, 1 puis 2 oboles pour les invalides).Deux hypothèses s’offrent à nous pour rendre compte de cette particularité.
1) Il est possible que le montant ait varié en fonction de la situation patrimoniale dechaque orphelin, évaluée par les magistrats chargés de la docimasie. La vérification auraitconsisté non seulement à établir si les orphelins étaient ejndeei~ ou non, mais aussi à queldegré ils l’étaient, en fonction de critères qui ne sont pas précisés. On pourrait imaginerque la situation financière du père décédé et la taille de la famille qu’il laissait derrière luiétaient prises en compte dans le calcul du montant journalier octroyé. En ce cas, lesprytanes auraient été chargés de mettre aux voix une proposition de décret indiquant une
366 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
186. Sur le monnayage thasien de bronze du IVe s., voir O. PICARD (supra, n. 157) et « Monnaie et commerce »(supra, n. 152), p. 37-41 ; Guide 2000, p. 308.
187. O. PICARD (supra, n. 157), p. 317, rappelle qu’on ne connaît pas d’oboles thasiennes dans la deuxièmesérie monétaire : l’« obole » du règlement du culte de Théogénès est en réalité une valeur comptable.
188. L’indemnité d’1 drachme par jour accordée par les Athéniens au réfugié Peisitheidès de Délos (ca 334) luiétait versée à chaque prytanie : oJ de; tªamiva~ ajpºodovtw Peiªsiºqeivdei kata; ªth;n prutºaneivan eJkavsthn (IG II2
222, l. 46-48 [cf. supra, n. 52]).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 366
somme fixe et personnalisée pour chaque orphelin, et la cité aurait été obligée de tenir àjour une liste où à chaque nom de bénéficiaire aurait correspondu un taux individualisé.Un tel système paraît excessivement complexe.
2) Il est plus probable qu’aucune distinction n’ait été établie parmi les orphelins jugésejndeei`~, mais que le montant de la trophè variait en proportion de leur nombre total. Sil’on suppose que la cité affectait une somme globale (mensuelle ?) à cette dépense, à diviserensuite entre tous les orphelins enregistrés, le montant individuel journalier aurait étéd’autant plus faible que les orphelins indigents étaient nombreux, d’autant plus élevé –dans la limite supérieure des 4 oboles – qu’ils étaient en nombre réduit. Dans ce cas, lesprytanes mettaient aux voix une proposition unique, valable pour tous les orphelins intro-duits au cours d’une même séance de l’Assemblée et interdisant que chacun perçût plus de4 oboles par jour. Un tel système présentait deux avantages par rapport au précédent.D’une part, il cantonnait les sommes affectées aux orphelins dans certaines limites,définies a priori par l’Assemblée, ce qui évitait de grever les dépenses de la cité en cas deconflit majeur et de pertes élevées parmi les citoyens. D’autre part, il impliquait unmontant unique pour tous les orphelins concernés et facilitait les opérations de la comp-tabilité publique.
C’est le même souci de simplicité financière qui régit le mode de versement men-suel de l’ekklèsiastikon à Iasos à la fin du IVe siècle189. La cité fixait une somme constantede 180 drachmes, qu’elle répartissait chaque mois entre les citoyens arrivés les premiersà l’assemblée. Le système permettait de moduler à chaque fois le montant de l’indem-nité selon le nombre de présents enregistrés avant l’arrêt de la clepsydre. On peut sup-poser que l’indemnité individuelle était plafonnée à une certaine somme, établie en fonc-tion du nombre minimal de citoyens requis pour une ekklèsia (par exemple un trioboleversé à 360 personnes), et que la somme décroissait quand ce nombre était dépassé. Lerecours aux fractions de bronze permettait dans ce cas le paiement de sommes minimes190.
Dans la stèle des Braves, la somme dévolue au poste de la trophè des orphelins n’est pasprécisée, soit que l’Assemblée se soit réservé le droit d’en fixer librement le montant àl’avenir, soit tout simplement que la cité ait choisi d’affecter à cette dépense le produitd’un revenu régulier, dont le montant était lui-même variable. En tout cas, la cité assuraità ses orphelins une indemnité confortable, sans doute au moins égale à la trophè d’1 obolefixée, à Athènes, par le décret de Théozotidès : la somme devait suffire à assurer la subsis-tance quotidienne d’un individu191.
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 367
BCH 131 (2007)
189. Ph. GAUTHIER, « L’inscription d’Iasos relative à l’ekklésiastikon (I. Iasos 20) », BCH 114 (1990), p. 417-443 (SEG XL 959 ; RHODES, OSBORNE 2003, 99).
190. Ph. GAUTHIER (supra), p. 441-443.
191. Voir les exemples invoqués supra, n. 52.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 367
L’hypothèse que nous privilégions s’accorderait bien, par ailleurs, avec les modalités deversement de la dot aux filles des Braves. A.-M. Vérilhac et Cl. Vial ont à juste titreproposé d’expliquer par des raisons d’ordre financier le fait que ce versement se fasse à unâge identique pour toutes les jeunes filles192. Plutôt que de verser la dot à chaque orphelinelors de son mariage (dont l’âge était nécessairement variable), ce qui aurait empêché touteprévision budgétaire, l’Assemblée retint comme point fixe l’âge légal du mariage (quatorzeans) et elle s’engagea à verser alors à toutes les filles nubiles concernées la gratification àlaquelle elles avaient droit. Leur nombre étant connu à l’avance, la cité pouvait prévoir etréserver annuellement la somme à affecter aux dots des jeunes filles de la classe d’âgeconcernée.
Le montant individuel de la dot nous est dérobé par la lacune qui sépare les deux frag-ments. La cité versait une somme identique pour toutes et suffisante pour garantir unmariage honorable. Cette somme venait s’ajouter à celle que l’orpheline recevait éven-tuellement de son tuteur, prélevée sur le patrimoine paternel, ou encore de ses prochesparents193. Il n’est pas possible de déduire du prix de la panoplie des garçons (qui corres-pond à la valeur additionnée des diverses parties de l’équipement) une estimation de ladot versée aux filles. Néanmoins, il paraît peu vraisemblable que la cité ait octroyé àchaque orpheline davantage que les 3 mines – somme déjà considérable – qu’elle consa-crait à chaque garçon. Nous savons qu’à Athènes, au IVe siècle, le parent le plus proched’une fille épiclère de la classe des thètes devait, s’il refusait de l’épouser lui-même, lui as-surer une dot de 150, 300 ou 500 drachmes, selon qu’il appartenait à la classe des zeugites,des hippeis ou des pentacosiomédimnes194. Dans les années 190, la reine séleucide Lao-dice III prit la décision de subventionner les dots des jeunes filles pauvres d’Iasos, frappéepar un séisme et par la guerre195. Pour financer ces dots, la reine s’engagea à fournir aux Ia-siens 1 000 médimnes de blé pendant dix ans, dont une quantité fixe devait être venduechaque année. Le montant des dots ainsi constituées était limité pour chaque jeune fille àmarier à 300 drachmes antiochiques. Le montage financier adopté par Laodice est assezproche de celui que nous sommes tentés de reconnaître pour le versement de la trophè (etpeut-être aussi de la dot des filles), à Thasos. Un revenu particulier était en effet affecté aupaiement d’une allocation, dont le montant individuel était plafonné, mais susceptibled’être revu à la baisse en fonction de deux facteurs : le cours du blé et le produit de sa vented’une part, le nombre des jeunes filles à pourvoir d’autre part.
368 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
192. VÉRILHAC, VIAL 1998, p. 163-164.
193. Quand la dot est versée par la famille de la mariée, le montant varie considérablement en fonction duniveau de fortune du père et du nombre de frères et sœurs. Un extrait des archives publiques de Mykonosau IIIe s. (Syll.3 1215) fournit une partie du registre des dots directes versées dans l’année : leur montantvarie entre 700 et 14 406 drachmes. Voir en général VÉRILHAC, VIAL 1998, p. 125-207.
194. [Démosthène,] XLIII (C. Macartatos) 54. Cf. VÉRILHAC, VIAL 1998, p. 108-109.
195. I. Iasos 4, l. 22-25 (SEG XLII 1043). Cf. VÉRILHAC, VIAL 1998, p. 165-166.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 368
Le décret pour les Braves fournit ainsi de nouveaux indices, dès l’époque classique, dela capacité d’une cité de taille moyenne, sinon à opérer une véritable planification budgé-taire, du moins à s’entourer de précautions pour que la création de dépenses récurrentesne vienne pas obérer les finances publiques196.
DATATION DU DÉCRET : THASOS EN GUERRE AU MILIEU DU IVe SIÈCLE AV. J.-C.
Comme nous l’avons rappelé plus haut, l’emploi des unités comptables propres aunouveau système monétaire – mines, statères et oboles – indique que le document se placeaprès la réforme qui eut lieu, d’après O. Picard, vers 390. Bien qu’il n’ait pu user de cetargument numismatique, J. Pouilloux avait parfaitement reconnu que la stèle datait duIVe siècle, mais il ne disposait que de maigres indices, d’ordre paléographique et linguis-tique, pour en fixer la date de façon plus précise. Il avait ainsi comparé l’écriture à celle deplusieurs listes de magistrats gravées entre 360 et 340 environ. On pourrait faire le rappro-chement avec l’écriture d’un autre règlement ou celle d’un bail, placés tous deux vers lemilieu du IVe siècle197. L’impression fournie par la forme des lettres était renforcée parl’état de la langue et en particulier par la rémanence d’ionismes dans un texte rédigé parailleurs en koinè198. Ces indices conduisaient J. Pouilloux à situer le document « ca. 360-340 » ou aux « environs de 350 ».
Le fragment B fournit un seul exemple supplémentaire d’ionisme – la psilose dansejpidevkesqai (l. 29) – et une nouveauté paléographique, à savoir l’occurrence de la lettrezèta à la l. 30. Le zèta peut affecter deux graphies au IVe siècle, à Thasos. La forme
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 369
BCH 131 (2007)
196. D. M. LEWIS, Hesperia 28 (1959), p. 246-247 (= Selected papers [1997], p. 261-262) voit dans la loi et ledécret d’Athènes sur le financement des Panathénées SEG XVIII 13 (RHODES, OSBORNE 2003, 81), datésca 335, l’exemple d’une décision réservant un revenu déterminé à une dépense particulière. D’autresexemples ont été recensés par L. ROBERT, Nouvelles inscriptions de Sardes (1964), p. 16-18, et parPh. GAUTHIER, Nouvelles inscriptions de Sardes II (1989), p. 87-91. À l’exception d’Athènes, lesplanifications générales des dépenses publiques sont, quant à elles, rares avant l’époque hellénistique : cf.L. MIGEOTTE (supra, n. 108) et Chr. SCHULER, Chiron 35 (2005), p. 394-398.
197. POUILLOUX 1954, 150 (SEG XVII 416), avec la planche XLII, 1 ; Fr. SALVIAT, BCH 96 (1972), p. 364-373(avec la fig. 1).
198. POUILLOUX 1954, p. 372 et 450. La liste complète des faits de langue observables dans le fragment A estdressée dans le Nouveau Choix 1971, p. 106-107. D’autres inscriptions présentent plus ou moins le mêmeétat de langue : par exemple IG XII 8, 265 (antérieur à ca 390 : cf. O. PICARD, CRAI 1982, p. 416-418) ;Fr. SALVIAT, BCH 96 (1972), p. 364. Les ionismes disparaissent complètement (sauf pour les termes duvocabulaire cultuel traditionnel) dans le règlement sur l’endeixis, qui est daté avec certitude du derniertiers du IVe s. : SALVIAT 1958, p. 195.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 369
« ancienne »——π attestée depuis le Ve siècle, perdure au moins jusqu’au dernier tiers du IVe
siècle199. La forme Z est plus récente : le règlement sur l’endeixis, daté de la fin du IVe
siècle, en offrait jusqu’à maintenant l’attestation la plus précoce200 ; la stèle des Braves, quilui est antérieure, en fournit désormais un exemple plus ancien. Les deux formes ——π et Zayant vraisemblablement été utilisées en concurrence pendant tout le cours du IVe siècle,on ne peut préciser par ce biais la date de notre inscription.
Par ailleurs, le nouveau fragment fournit un repère chronologique relatif. On men-tionne, aux l. 34-35, un acte législatif antérieur au présent décret, pris sous l’archontatd’un certain Biôn. Aucun magistrat de ce nom n’est répertorié dans les listes d’archontesconservées pour le IVe siècle. Biôn est un nom assez courant à Thasos : on y recense unedizaine d’individus qui le portent. Parmi les archontes du troisième quart du IVe siècle,figurent deux personnages dont Biôn est le patronyme, peut-être des frères : Luvsi~ Bivwno~et “Amwmo~ Bivwno~ (vers 345-315)201. Le Biôn de notre décret pourrait à la rigueur êtrele père de l’un ou l’autre (ou des deux) et, partant, il pourrait avoir exercé l’archontatune génération avant eux, c’est-à-dire dans le second quart du IVe siècle environ. Maisrien ne prouve que le « décret pris sous l’archonte Biôn » n’était pas très antérieur audécret sur les Braves. On ne peut donc tirer aucune conclusion chronologique de la mentionisolée de ce nom.
S’il n’ajoute aucun indice décisif, le fragment B permet d’avoir désormais une visionplus complète du décret et d’apprécier plus justement sa nature. Réduit aux clauses cen-trales, relatives aux funérailles des soldats morts et aux honneurs conférés à leurs ayantsdroit, il pouvait naguère donner l’impression de traiter de questions religieuses. C’est dureste dans un chapitre de ses Recherches consacré aux cultes de la cité que J. Pouilloux lepublia en 1954, en orientant son commentaire vers le lien supposé avec les fêtes et lesanctuaire d’Héraclès. La fin du décret montre que les vivants, tout autant que les morts,étaient au cœur des décisions prises par l’Assemblée. Thasos est sur le pied de guerre,mobilisée. Elle a dû déjà subir, ou s’apprête à nouveau à subir, des pertes dans les rangsde son armée, où l’on compte non seulement des citoyens, mais aussi – ce qui est plusremarquable – des métèques et même d’autres catégories plus marginales d’habitants.Le règlement est très détaillé sur le caractère composite de cette armée civique. Est-ce là
370 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
199. SEG XXXVIII 851 B, l. 12 et 15 (407 ou 390 [?]) ; IG XII 8, 376, l. 4 (cf. POUILLOUX 1954, p. 232 etpl. XIX, 1 : première moitié du IVe s.) ; POUILLOUX 1954, 34, l. 25 (vers 315) ; 155 (SEG XVIII 348), l. 5(fin du IVe s.). Le zèta n’a pas fait l’objet d’une étude précise dans les pages que POUILLOUX 1954, p. 437-446, a consacrées à l’évolution de l’écriture.
200. SALVIAT 1958, p. 195, l. 1 et 4.
201. POUILLOUX 1954, 34, l. 1 et 8.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 370
le reflet de la situation militaire ordinaire ? Nous croirions volontiers, au contraire, quele décret fut voté à la suite d’engagements militaires d’une intensité inhabituelle, qui exi-gèrent effectivement l’incorporation d’individus appartenant à ces différentes catégorieset qui coûtèrent la vie à un certain nombre d’entre eux, y compris des non-citoyens. Lesouci de récompenser le courage individuel, de célébrer la mémoire des héros et d’ho-norer les survivants, voire de les prendre en charge économiquement, répondprobablement, en outre, à un besoin brûlant : il s’agissait de maintenir la cohésion civiqueet d’entretenir le patriotisme des Thasiens, alors que la cité traversait des moments cri-tiques. Le décret des Braves n’est donc pas un règlement religieux, mais un texte decirconstance, à fort contenu politique et idéologique, exaltant le sens de la patrie et dusacrifice et cherchant à rasséréner une communauté ébranlée par les épreuves de la guerre,sinon encore exposée à des dangers imminents. C’est pour faire face à une menace sansprécédent que les Rhodiens prirent par décret des mesures du même type, en 305.
Est-il possible de formuler des hypothèses crédibles sur le contexte historique quidétermina l’adoption d’un tel décret ? Il est nécessaire, pour ce faire, de retracer briè-vement l’évolution politique et institutionnelle de Thasos entre la fin du Ve et le milieu duIVe siècle, en insistant sur la proximité avec Athènes (dont le document porte des traces),et de passer en revue les principaux moments de l’histoire militaire de la cité.
Devenue membre de la Ligue de Délos, Thasos eut très tôt à subir l’interférence desAthéniens dans la zone continentale qu’elle considérait, depuis l’époque archaïque,comme son aire naturelle d’influence. Après sa vaine tentative de sécession (465-463), elledut renoncer à sa pérée. À la fin du Ve siècle, elle échappa à l’emprise athénienne, au prixd’une série de révolutions politiques et de l’exil durable d’un grand nombre de pro-athé-niens à Athènes202. En 390, le régime laconisant en place à Thasos fut renversé par ungroupe de proscrits. Ils requirent le soutien armé des Athéniens, qui furent accueillis enamis203. Il est probable que les relations entre les deux cités, à peine restaurées, furentinterrompues par la Paix du Roi en 386 : plusieurs décrets athéniens attestent à nouveaula présence de réfugiés thasiens à Athènes vers la fin des années 380 ou le début des années370204. Vers 375, Thasos devint membre de la Seconde Confédération maritime athé-nienne205.
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 371
BCH 131 (2007)
202. IG II2 6 et 17 (cf. M. J. OSBORNE, Naturalization in Athens, II [1982], p. 45-47).
203. Xénophon, Helléniques IV 8, 25-30 (dans la Collection des universités de France, J. HATZFELD est restéfidèle à la chronologie proposée autrefois par G. BELOCH [389/388] et aujourd’hui abandonnée par lesspécialistes : voir par exemple G. L. CAWKWELL, « The Imperialism of Thrasybulus », CQ 26 [1976],p. 270-278) ; Démosthène, XX (C. Leptine) 59.
204. M. J. OSBORNE (supra, n. 202) p. 51-53, s’appuyant sur IG II2 33 ; M. B. WALBANK, « An Inscription fromthe Athenian Agora : Thasian Exiles at Athens », Hesperia 64 (1995), p. 64-65 (SEG XLV 42).
205. Diodore, XV 36, 4 ; IG II2 43 (RHODES, OSBORNE 2003, 22), l. 100.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 371
Les liens entre les deux cités furent dès lors particulièrement étroits. La réintégrationde Thasos dans leur alliance constituait, pour les Athéniens, la condition indispensabledu rétablissement de leur hégémonie dans la région206. À partir des années 360, leur prin-cipal objectif était en effet de récupérer Amphipolis, perdue depuis 424207. Le port deThasos revêtait donc pour eux une importance stratégique majeure : sa position, au centrede la mer de Thrace, permettait aux escadres athéniennes de circuler aisément entre laChalcidique et l’Hellespont (fig. 4). Leurs trières mouillaient ainsi régulièrement à Thasos,ce dont le discours d’Apollodore Contre Polyclès offre un précieux témoignage208. Triérarquependant l’année 362/361, Apollodore y décrit ses longs mois de service, en particulierpendant l’expédition conduite par le stratège Timomachos en mer de Thrace. C’est àThasos qu’Apollodore fut relevé de ses fonctions, avec retard, par Polyclès : il rapporteles entrevues qu’il eut avec son successeur, sur l’agora et dans une maison privée, situéeà l’extérieur des remparts, et l’on entrevoit à cette occasion la présence d’Athéniens engrand nombre – stratège, triérarques et hommes de troupe – dans la ville et le port deThasos209.
La situation interne de Thasos au début du IVe siècle est plus difficile à saisir. Le retourà la démocratie fut opéré une première fois en 390, sans doute pour quelques annéesseulement, puis définitivement acquis vers 375. Les événements nous échappent engrande partie. Leur reconstitution dépend entre autres de la « Stèle de la réconciliation »,un document mutilé et dont l’interprétation reste discutée. Rappelons qu’il s’agit d’undécret organisant le rétablissement de la démocratie et la réconciliation entre Thasiens,après la chute d’un régime oligarchique. L’événement a été identifié par Y. Grandjean etFr. Salviat comme la première restauration démocratique, en 407210. Pour O. Picard, ils’agirait de la deuxième restauration démocratique, en 390211. Sans entrer ici dans cedébat complexe, on notera que plusieurs éléments du formulaire se retrouvent dans desdécrets thasiens de la première moitié du IVe siècle212 et qu’il paraît vraisemblable que ledécret émane de Thasos, dont les institutions étaient alors progressivement remises en
372 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
206. Démosthène XX 59 : parascovnte~ fivlhn uJmi`n th;n aujtw`n patrivda ai[tioi tou` genevsqai suvmmacon to;n peri;
Qra/vkhn tovpon uJmin ejgevnonto.
207. Voir l’étude détaillée de J. HESKEL, The North Aegean Wars, 371-360 B.C. (1997), ainsi que le chapitre desynthèse de J. BUCKLER, Aegean Greece in the Fourth Century B.C. (2003), p. 351-377.
208. [Démosthène,] L (C. Polyclès). Pour la chronologie de la triérarchie d’Apollodore, voir J. HESKEL, supra,p. 71-77.
209. [Démosthène,] L 29-40 ; 51.
210. GRANDJEAN, SALVIAT 1988 (SEG XXXVIII 851 A et B). Cf. Ph. GAUTHIER, Bull. 1989, 254.
211. PICARD 2000, s’appuyant sur Démosthène, XX (C. Leptine) 59 et 61. Cf. Ph. GAUTHIER, Bull. 2002, 329.
212. Voir supra, n. 55 et 98.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 372
route. S’il convient bien de retenir une date au début du IVe siècle (?), le « décret de récon-ciliation » serait en quelque sorte l’acte de naissance de la nouvelle démocratie thasienne.D’autres mesures furent prises dans les mêmes circonstances, en particulier la réformemonétaire (cf. supra). Le plus important pour notre propos est de noter que les institu-tions ainsi réorganisées se distinguent par une imitation délibérée des pratiques démocra-tiques athéniennes. Nous l’avons souligné à propos de la création d’une commissiontournante de prytanes. C’est également vrai dans le domaine de la justice, où l’ancientribunal des Trois-Cents fut remplacé par des tribunaux populaires, désignés par tirage ausort et dont les membres recevaient peut-être un misthos, selon une hypothèsed’O. Picard213.
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 373
BCH 131 (2007)
213. Voir le règlement POUILLOUX 1954, 150 (SEG XVII 416) et les plaquettes de juges republiées parJ. H. KROLL, Athenian Bronze Allotment Plates (1972), p. 272-277. Cf. O. PICARD (supra, n. 157). Sur lesemmènoi dikai, voir SALVIAT 1958, p. 209-212.
THASOS
SAMOTHRACE
IMBROS
TÉNÉDOSLEMNOS
Symbolon
Lékané
Chersonèse
Athos
Pangée
Pacheiè
HEBROS
HELLE
SPONT
NESTOS
STRYMO
N
AINOSDrysMARONÉE
ABDÈREDIKAIA
Strymé
THASOS
SAMOTHRACE
PISTIROS
TRAGILOS
BERGÈ
OesyméAMPHIPOLIS
AKANTHOS
OLYNTHE
POTIDÉE
TORONÉ
ApolloniaGalepsosARGILOS
NÉAPOLISDATOS
Chalcidique
ROYAUMEde MACÉDOINE
ROYAUME des ODRYSES
M.W-K. 2007
GalepsosTHASOS
emplacement hypothétique
emplacement avéré
localité ou cité dépendante d’une autre cité
cité indépendante
Légende :rivage actuel
0 50 100 km
Rh
od
op
e
Fig. 4. — La Macédoine orientale et la Thrace vers 360 av. J.-C. (dessin EFA, M. Wurch-Kozelj
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 373
Pour sa défense, la cité disposait d’une armée dont les inscriptions permettent d’en-trevoir l’organisation214. L’état-major était constitué par un collège de cinq polémarques,connu par plusieurs dédicaces à Sôteira215. Ils devaient se répartir les responsabilités, tellesque la surveillance des remparts et de la chôra, le commandement de la marine216 et celuide l’infanterie. Thasos possédait une flotte, sans doute assez modeste, abritée dans le portde guerre. Un passage du Contre Polyclès révèle que les Thasiens débauchèrent en 361 desrameurs embarqués sur les trières athéniennes et qui n’avaient pas touché leur solde217.Quant aux soldats à pied, une clause du règlement sur l’endeixis et l’apagogè, daté dudernier quart du IVe siècle, laisse deviner leurs activités. Elle suspend certaines procéduresjudiciaires lorsque les citoyens sont mobilisés : « il n’est pas permis de dénoncer pardélation sommaire ni avec contrainte par corps (...) ni en temps de revue militaire, ni entemps d’expédition de secours, ni en temps de garde (mhde; ejn ejxetavsei, mhde; ejn bohqeivai,mhde; ejm fulakhi)218 ». Les citoyens thasiens, formés au gymnase dans les exercices hopli-tiques, étaient donc soumis à des revues militaires régulières, sans doute organisées par lespolémarques. Ils étaient aussi contraints, semble-t-il, à un service de garnison dans leterritoire (et sans doute aussi à un service régulier de ronde sur les remparts) et ils devaientrépondre aux ordres de mobilisation en cas d’expédition, dans l’île même ou à l’extérieur,la phalange étant répartie en bataillons219. Le décret pour les Braves montre que la citépouvait recruter, en cas d’extrême nécessité, des soldats supplétifs parmi les non-citoyens.Il n’est pas douteux qu’elle avait également recours à des mercenaires, par exemple desrameurs ou des soldats légers, pour compléter son dispositif, spécialement lors des opéra-tions de grande envergure220. C’est une des raisons – sinon la raison principale – qui moti-vèrent la frappe de grosses dénominations d’argent au IVe siècle, en l’espèce destétradrachmes appelés « statères ».
Le dispositif militaire thasien n’avait pas une vocation uniquement défensive. Il étaitl’instrument d’une politique extérieure entièrement orientée vers la reconstitution de la
374 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
214. POUILLOUX 1954, p. 411-412.
215. SALVIAT 1958, p. 230, n. 5, avec les références.
216. Le décret honorant les juges venus de Cos au IIIe s. charge les polémarques, ainsi que les archontes et lesapologoi, de veiller à leur retour, ce qui laisse supposer qu’ils durent les raccompagner à Cos sur un navirede la flotte thasienne (?) : SEG XLIX 1108, l. 17-20, avec les parallèles invoqués par Ch. V. CROWTHER, adloc.
217. Cf. A. SIMOSI, « To arcaivo polemikov limavni th~ Qavsou », AD 49-50 (1994-1995), p. 133-160 ; Guide2000, p. 53-57 ; [Démosthène,] L 14.
218. SALVIAT 1958, p. 195 (SEG XVII 415), l. 4-5, avec l’exégèse d’Y. GARLAN, BCH 88 (1964), p. 147-150.
219. Les taxeis concouraient les unes contre les autres dans les épreuves militaires des Hèrakleia : cf. M. LAUNEY,BCH 61 (1937), p. 396-397, et J. POUILLOUX, « Lampadédromies thasiennes », RA 1948, p. 847-857.
220. C’est peut-être le cas des peltastes que les Thasiens employèrent pour assiéger Strymè en 361 :[Démosthène,] L 21 (cf. infra).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 374
pérée (perdue en 463) – ce domaine continental que l’on pourrait qualifier de micro-empire (fig. 4). Comme M. Brunet l’a mis en lumière dans un article récent, le processusavait été amorcé dès la fin du Ve siècle, lorsque Thasos réussit – en 411, puis en 405 –à échapper à l’emprise athénienne221. Se heurtant à l’esprit d’indépendance de Néapolis,les Thasiens ne purent d’abord recouvrer que les fondations situées plus à l’Ouest, aupied du Symbolon. Elles sont qualifiées, dans un document daté de 408, de « colonies »(ajpoikivai), ce qui traduit le rétablissement d’une certaine forme de sujétion politique222.Le résultat de cette reprise en main se lit, à la fin des années 360, dans la liste des théa-rodoques d’Épidaure, chargés d’accueillir les théores annonçant les Asklèpieia223. Sur lacôte de Thrace, outre Thasos, la liste enregistre les cités d’Abdère, Dikaia, Maronée etAinos. Dans l’ancienne pérée thasienne, Néapolis est mentionnée, ce qui illustre le faitqu’elle avait réussi à préserver son indépendance, acquise en 463. En revanche, les coloniessur lesquelles les Thasiens avaient remis la main – Galepsos, Apollonia et Oisymè – n’ap-paraissent pas : elles avaient alors le statut de cités dépendantes, incorporées à un ensemblegéopolitique que l’on peut comparer à ce que sera, au IIIe siècle, la Pérée sujette des Rhodiens.
À partir des années 360, les Thasiens cherchèrent à étendre leur domaine continental,à la fois vers l’Est et vers le Nord. Les deux engagements militaires thasiens connus pourcette période concernent Strymè, un ancien établissement thasien situé entre Dikaia etMaronée, et Datos, un établissement thrace, situé plus à l’intérieur, entre le Pangée et laLekanè.
On sait que les ports de la pérée servaient de relais au commerce avec la Thrace inté-rieure et cela explique que la cité négocia avec le roi odryse Cotys Ier (383-359), dans les an-nées 370 ou 360, le droit pour ses marchands de s’établir durablement à Pistiros (Vetren),dans la vallée du Haut Hébros224. Les enjeux commerciaux expliquent aussi la concurren-ce tenace qui existait entre les différentes cités de la côte thrace. La première rivale de Tha-sos était alors Maronée. C’est contre elle que les Thasiens déclenchèrent en 361 un conflit
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 375
BCH 131 (2007)
221. M. BRUNET, « Thasos et son Épire à la fin du Ve et au début du IVe siècle avant Jésus-Christ », in P. BRÛLÉ,J. OULHEN (éds), Esclavage, guerre, économie en Grèce ancienne : hommages à Y. Garlan (1997), p. 229-242.Chr. PÉBARTHE, « Thasos, l’empire d’Athènes et les emporia de Thrace », ZPE 126 (1999), p. 131-154,part. p. 146-152, défend l’idée ancienne d’une restitution partielle de la pérée aux Thasiens par lesAthéniens dès les années 440 et propose une reconstitution différente de l’histoire du « continent »thasien, qui, par sa complexité même, nous semble moins convaincante.
222. IG XII Suppl 347 II, l. 3. La date demeure incertaine : Fr. SALVIAT, BCH Suppl XIII (1986), p. 185 propose411-410 ; M. BRUNET (supra), p. 239-242, conjecture une date entre 405 et 390, voire après larestauration démocratique de 390.
223. Fr. HILLER VON GÄRTRINGEN, IG IV2 1, 94. Voir désormais P. PERLMAN, City and Sanctuary in AncientGreece (2000), p. 67-74 et Ep. Cat. E 1, p. 177-179.
224. V. CHANKOWSKI, L. DOMARADZKA, « Réédition de l’inscription de Pistiros et problèmesd’interprétation », BCH 123 (1999), p. 247-256 (SEG XLIII 486 ; XLIX 911).
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 375
armé pour reprendre possession de Strymè. Ils sollicitèrent à cet effet l’aide de la flotte athé-nienne, qui stationnait alors chez eux. L’affaire fut réglée par un arbitrage des Athéniensdont le résultat n’est pas connu225.
L’attention des Thasiens se portait par ailleurs, au même moment, sur le pays de Datoset des Datènoi, un peuple de Thraces édoniens, établis au pied du Pangée et de ses minesd’or et d’argent, dans une zone qui ouvrait, vers le Nord, l’accès à l’hinterland thrace. Il estmalaisé de comprendre la situation politique qui prévalait alors dans cet arrière-pays de laPiérie du Pangée. Le toponyme de Datos est connu par les sources littéraires dès leVe siècle. Il est possible, comme le suggère H. Koukouli-Chrysanthaki, que ce nom nedésigne pas simplement une région, mais une ville plus ou moins hellénisée226. AuIVe siècle, Datos est mentionnée par le Pseudo-Scylax, qui prend la peine de noter qu’elleest une povli~ ÔEllhniv~, précision peut-être nécessaire parce que ce caractère grec n’étaitpas évident au premier abord227. Son nom figure enfin dans la liste des théarodoquesd’Épidaure. Fr. Hiller von Gärtringen avait considéré autrefois que la Datos qui accueillaitles théores épidauriens n’était autre que le nouvel établissement thasien. Mais commentcroire que la colonie, à peine créée, ait pu immédiatement désigner un théarodoque ets’intégrer, comme polis indépendante (dotée à cet égard d’un statut différent d’Oisymè etGalepsos), dans le cercle des participants aux fêtes panhelléniques, alors qu’elle était enproie, et pour plusieurs années, à de graves difficultés ? K. J. Rigsby a récemment émisl’hypothèse que la Datos de la liste ne serait pas la fondation thasienne, mais une petitecité hellénisée, ou en tout cas un État indépendant, mi-grec mi-thrace228. Il propose desituer l’élaboration de la liste vers la fin des années 360, avant la mort de Perdiccas III en360/359 et avant l’arrivée des Thasiens.
L’entreprise thasienne, datée par Diodore de 360/359, n’est connue que par quelquesallusions chez les auteurs du IVe siècle et surtout par des sources tardives229. Elle consistaità annexer de nouveaux territoires et à en assurer le contrôle durable par l’implantationd’un contingent de Thasiens au lieu-dit Krénidès (qu’il faut identifier à la ville préexistante
376 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
225. [Démosthène,] L 21-23 ; 35 ; XII (Lettre de Philippe) 17. Cf. POUILLOUX 1954, p. 221-222.
226. H. KOUKOULI-CHRYSANTHAKI, « Arcaiva Bevrgh », in Murtov~. Mnhvmh I. Botokopouvlou (2000), p. 351-375,part. 369.
227. Cf. P. COUNILLON, « Datos en Thrace et le Périple du Pseudo-Skylax », REA 100 (1998), p. 115-124, quireste persuadé que la cité de Datos fut fondée ex nihilo en 360.
228. K. J. RIGSBY, « The Foundation of Datos », Historia 56 (2007), p. 111-113.
229. Diodore, XVI 3, 7. Sur la fondation de Krénidès, voir la synthèse de Ph. COLLART, Philippes, ville deMacédoine (1937), p. 133-160, qui rassemble les sources. Cf. également POUILLOUX 1954, p. 218-220 et429-430 ; N. G. L. HAMMOND, G. T. GRIFFITH, A History of Macedonia, II (1979), p. 234-235 et 246-250.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 376
de Datos ou bien situer dans sa chôra230). Thasos s’apprêtait donc à créer une colonie depeuplement en bonne et due forme, la première depuis l’époque archaïque, et ce futcertainement pour la cité une affaire d’importance majeure, qui mobilisa les énergies etsuscita de grands espoirs. Les Datènoi étaient vraisemblablement autonomes par rapportau pouvoir des Odryses231. Les Thasiens voulurent peut-être cependant mettre à profitla situation troublée qui régnait alors sur le continent : Cotys Ier fut assassiné en 359 etson royaume éclata en trois entités rivales ; la confusion politique dura encore plusieursannées en Thrace ; d’autre part, en Macédoine, rien ne laissait présager en 359 quePhilippe II réussirait à affirmer aussi rapidement son autorité, après la mort de PerdiccasIII232. Du point de vue des Thasiens, l’occasion pouvait paraître rêvée pour lancer leurentreprise contre Datos.
Les lexicographes, ainsi que le Pseudo-Scylax, affirment que le chef des opérations nefut pas un Thasien, mais un Athénien, Callistratos d’Aphidna, stratège et homme poli-tique d’envergure, qui avait alors fui sa cité sous le coup d’une condamnation. L’un desacteurs secondaires, le Thasien Léodamas, nous est probablement connu par la lettre XIde Platon. Léodamas avait demandé à son maître de l’aider à établir les lois d’une« colonie » dans la fondation de laquelle il était personnellement impliqué. Fr. Salviat aanalysé la réponse de Platon à son disciple et soutenu, contre le scepticisme des modernes,que la fondation en question était celle de Krénidès233. Pour justifier son refus, le maîtreobjecte que l’entreprise lui semble mal partie, dépourvue qu’elle est d’hommes de biencapables de jouer le rôle de législateur et d’éducateur. Il est possible qu’il faille percevoir làle peu d’estime qu’avait Platon pour Callistratos, l’aventurier à qui les Thasiens eurent letort de confier leur destin sur le continent.
La situation des Thasiens implantés à Datos-Krénidès était effectivement précaire. Àpeine installés, ils furent en butte à l’hostilité des Thraces habitant le territoire de Datos.
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 377
BCH 131 (2007)
230. Sur la situation géographique de Datos-Krénidès, qu’il ne faut peut-être pas (malgré STRABON, VII, frag.41-42) chercher à l’emplacement exact de la future Philippes, mais dans les environs, voir les hypothèsesdivergentes de Cl. VATIN, in Actes (supra, n. 126), p. 265-268, S. SAMARTZIDOU, in Mnhvmh D. Lazarivdh,RechFH 1 (1990), p. 575-578, et P. COUNILLON (supra, n. 227).
231. D. ZANNI, L. GAY-DES-COMBES, A. G. ZANNIS, « Les Thraces autonomes de la région comprise entre leStrymon et le Nestos », in A. IAKOVIDOU (éd.), Thrace in the Graeco-Roman World : Proceedings of the 10thInternational Congress of Thracology, Komotini-Alexandroupolis 18-23 October 2005 (2007), p. 745-754.
232. Sur cette période troublée, voir la mise au point de K. JORDANOV, « The Political History of the OdrysianKingdom, 359-339 BC », in J. BOUZEK et al. (éds), Pistiros I (1996), p. 223-240. Voir égalementChr. VELIGIANNI, « Abdera, Maroneia, Ainos und der Odrysenstaat », Tekmeria 1 (1995), p. 136-170 ;Chr. VELIGIANNI-TERZI, Oi ellhnivde~ povlei~ kai to basivleio twn Odruswvn (2004).
233. Fr. SALVIAT, « La lettre XI de Platon, Leôdamas de Thasos, Kallistratos d’Athènes et la fondation deKrénidès », in Études classiques II (1967), p. 43-56.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 377
Il faut supposer qu’ils eurent à mener des combats acharnés, avec le renfort continu detroupes venues de l’île. L’un des auteurs du corpus hippocratique, un médecin itinérantactif en Thrace à cette époque, raconte qu’il eut à soigner un dénommé Tychôn, « blessépar un tir de catapulte lors du siège de Datos » : il s’agissait vraisemblablement d’un colonou de l’un des Thasiens appelés en renfort, entre 360 et 356234. Pendant ses premièresannées d’existence, la colonie ne semble pas avoir joui du statut de cité autonome. Unmonnayage d’or et de bronze fut frappé localement, peut-être dès 360 : il emprunte sestypes à l’iconographie thasienne et porte la légende « des Thasiens du Continent » (QASIONHPEIRO). O. Picard a proposé d’y voir le signe d’une sécession : un groupe de Thasiensaurait été exilé de l’île et serait parti s’établir sur le continent, à Krénidès, ou bien leshabitants des possessions thasiennes du continent auraient déclaré unilatéralement leurindépendance235. Dans cette hypothèse, la colonie, installée en milieu hostile, ne seraitplus une création issue des ambitions territoriales de la cité et pour la défense de laquellecelle-ci aurait affronté les indigènes, mais le produit d’une guerre civile entre Thasiens.L’hypothèse repose sur des bases fragiles et oblige à écarter la plupart des témoignages.Le nombre très important de monnaies de bronze des « Thasiens du Continent » retrouvéesdans les fouilles de la ville de Thasos – alors que les émissions ne durèrent pas plus dequatre ans en tout et pour tout – suggère par ailleurs que, loin de rompre les ponts, lesThasiens de l’île entretinrent des relations suivies avec leurs concitoyens du continent236.Plutôt que d’y reconnaître l’écho d’une stasis, nous préférerions voir dans l’ethnique« Thasiens du Continent » le signe d’un lien politique encore très fort avec la métropole :il n’est du reste pas impossible qu’il ait englobé non seulement la jeune colonie de Datos,mais aussi les autres apoikiai de la pérée, réunies dans un ensemble placé sous l’autoritéthasienne et constituant une excroissance de la cité sur le continent237.
Quoi qu’il en soit, les attaques répétées des Thraces eurent raison de la colonie deDatos-Krénidès, qui ne vécut pas plus de quatre ans. Si l’on s’en tient à l’hypothèsetraditionnelle d’un projet colonial piloté depuis l’île, il faut croire que les Thasiens de la
378 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
234. [Hippocrate,] Épidémies V 94 (cf. VII 121). Sur les circonstances de la composition de cette partie du livreV, voir les explications de J. JOUANNA dans l’édition de la Collection des universités de France (2000),p. XXXIX-XLV, qui rapporte l’événement à la prise de Krénidès par Philippe II et retient à tort la date de 358-357.
235. O. PICARD, « Les Thasiens du continent et la fondation de Philippes », in M.-O. JENTEL, G. DESCHÊNES-WAGNER (éds), Tranquillitas, Mélanges en l’honneur de Tran Tam Tinh (1994), p. 459-473, et, avec unelégère inflexion, O. PICARD, Guerre et économie dans l’alliance athénienne (2000), p. 169.
236. M.-C. MARCELLESI, « Thasos et ses colonies d’après les monnaies », in Actes du colloque en mémoire deMarina Sgourou, Thasos, septembre 2006 (à paraître), recense 62 chalques des « Thasiens du Continent »parmi les trouvailles faites sur l’île, appartenant à deux séries distinctes.
237. Voir le cas des « Samiens de Minoa », rapidement évoqué par O. PICARD, (supra, n. 235, 1994), p. 465-466 : ils constituaient une portion du corps civique samien, en quelque sorte « détachée » à Amorgos.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 378
métropole furent incapables de fournir à leur colonie un appui militaire suffisant. Subirent-ils une défaite décisive ou des pertes trop importantes ? Les colons furent-ils bientôtabandonnés à leur sort ? Les sources sont trop maigres pour nous permettre de reconstituerles événements. Nous savons simplement que Krénidès dut se tourner, en 356, vers laseule puissance régionale capable de l’aider dans la résistance désespérée qu’elle opposaitaux Thraces, à savoir Philippe II. Le jeune roi de Macédoine venait de s’emparerd’Amphipolis, de l’autre côté du Pangée (357). Il secourut les gens de Krénidès et enprofita pour supplanter les Thasiens dans le rôle de protecteur de la cité. Celle-ci futrefondée sous le nom de Philippes et définitivement acquise à la Macédoine238. Strabonfait par ailleurs allusion à la destruction de Galepsos et d’Apollonia par Philippe II239.Ce fut sans doute une conséquence directe de l’occupation de Krénidès : il est vraisemblableque les Thasiens durent alors renoncer à toutes leurs colonies littorales. Oisymè, libéréede la tutelle thasienne, frappa un monnayage de bronze, qu’O. Picard a proposé avecprudence de placer à cette date-charnière de son histoire240. Elle figure, à la fin du IIIe
siècle, dans la liste des théarodoques de Delphes, aux côtés des cités d’Amphipolis, dePhilippes et de Néapolis241.
Le monnayage thasien conserve la trace des efforts financiers considérables que la citéeut à fournir pour mener la guerre et des difficultés que le désastre final de 356 entraînapour elle. O. Picard a en effet identifié deux brèves émissions de bronze aux types – et doncà la valeur – des monnaies d’argent : il s’agit d’un monnayage « de nécessité », au coursforcé, caractéristique des périodes de crise242. La perte de toute la pérée mettait un termeau rêve impérial des Thasiens et venait clore un cycle historique. Nous avons relevé plushaut que le décret pour les Braves, daté par un faisceau d’indices vers le milieu du IVe siècle,se signale par sa couleur patriotique. Notre hypothèse est que la « guerre de Datos »pourrait précisément être l’événement dramatique qui ébranla les Thasiens et lesconduisit à adopter le décret.
Si nous avons vu juste, le décret pour les Braves se situerait entre 360 et 356 av. J.-C. oupeu après cette date. Il livrerait l’écho indirect des dangers encourus et des échecs subis parles Thasiens sur le continent et laisserait percevoir l’orgueil blessé d’une cité qui, en se
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 379
BCH 131 (2007)
238. Diodore, XVI 8, 6 ; Étienne de Byzance, s.v. « Fivlippoi ».
239. Strabon, VII, frag. 35.
240. O. PICARD, « Le monnayage de bronze d’Oisymè », NomChron 12 (1993), p. 13-16.
241. A. PLASSART, BCH 45 (1921), p. 18, col. III, l. 81. Skaptè Hylè, située entre le territoire de Philippes et leNestos, figure aussi sur la liste (l. 94), ce qui indique que la partie orientale de la pérée fut égalementperdue.
242. O. PICARD, « Innovations monétaires dans la Grèce du IVe siècle », CRAI 1989, p. 673-685, et, pourl’interprétation historique, id., NomChron 12 (1993), p. 15 ; Guide 2000, p. 308.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 379
heurtant à la puissance montante de l’époque – la Macédoine –, voyait s’effondrer enquelques années son hégémonie régionale et s’essouffler la dynamique de reconstructionqui l’animait depuis deux ou trois décennies. Il est peut-être permis d’établir un rapideparallèle entre notre décret, qui illustre chez les Thasiens le besoin de se ressaisir et deserrer les rangs après un désastre, et les nombreuses mesures patriotiques adoptées par lesAthéniens une vingtaine d’années plus tard, au lendemain de la défaite de Chéronée(338), pour tenter de relever leur cité243.
Par ailleurs, le décret est, par son contenu, le signe le plus explicite de ce que nousserions tentés d’appeler la culture athénienne des Thasiens, telle que nous l’avons observéedans les institutions rénovées du IVe siècle. J. Pouilloux et les autres commentateurs dufragment A n’ont pas manqué de relever qu’un certain nombre de dispositions rappe-laient les pratiques du patrios nomos athénien : la cérémonie de remise de leurs armesaux pupilles de la cité, au cours des Hèrakleia, est par exemple analogue à celle qu’or-ganisaient chaque année les Athéniens lors des Grandes Dionysies. Il nous a semblé quela prise en charge des survivants était, elle aussi, apparentée aux règles athéniennes rela-tives aux orphelins de guerre. Les Thasiens se contentèrent, il est vrai, de limiter l’attributiondes pensions aux nécessiteux, mais l’esprit général de ces mesures complémentaires estle même que dans la cité de Périclès et de Démosthène. Un certain nombre de Thasiensavaient passé de longues années d’exil à Athènes pendant la guerre du Péloponnèse etdans la période qui suivit la chute des Trente en 403. Ces années athéniennes contri-buèrent sans doute à les imprégner des usages démocratiques de la cité qui les accueillait.Les relations étroites qui furent restaurées entre les deux cités à partir de 375 environ eten particulier la présence continue d’Athéniens à Thasos même renforcèrent certainementcette influence. Pour bien des Thasiens, Athènes était à n’en pas douter une référence etun modèle sans équivalent. Le décret pour les Braves laisse deviner en tout cas, chez lesThasiens, une connaissance approfondie des institutions politiques, mais aussi des céré-monies patriotiques en usage à Athènes.
Il n’y a aucune raison de douter que le décret ait été mis en application. Les mesureseurent peut-être, sur le coup, l’effet psychologique escompté. Une fois clos l’épisode deDatos et le choc qu’il produisit (si c’est bien de cela qu’il s’agit), les Thasiens observèrent-ils encore longtemps l’usage d’ensevelir publiquement leurs soldats morts, d’honorer lesorphelins de guerre et d’entretenir les pupilles de la cité ? Nous l’ignorons. Il est assezprobable, comme l’a remarqué O. Picard, que le dispositif militaire thasien se réduisitpeu à peu à un rôle de défense du territoire insulaire et que la cité n’eut guère plus l’oc-casion, à partir du milieu du IVe siècle, d’engager des opérations importantes ni d’essuyer
380 Julien FOURNIER, Patrice HAMON
BCH 131 (2007)
243. M. FARAGUNA, Atene nell’età di Alessandro (1992) ; Chr. HABICHT, Athènes hellénistique (trad. fr., 2000),p. 35-37 et 41-48.
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 380
des pertes massives. La cité renonça même, à la fin du IVe siècle et pendant près d’un siècleet demi, à frapper des tétradrachmes et donc sans doute à recruter régulièrement desmercenaires en nombre important. La fin du IVe et le IIIe siècle constituèrent pour Thasosune phase de repli politique et militaire, dans l’ombre du royaume de Macédoine244.
La stèle des Braves resta cependant dressée en plein cœur de l’agora de Thasos, devantl’entrée ou la façade du prytanée. Ce n’est sans doute qu’à la toute fin de l’Antiquité, au IVe
ou au Ve siècle ap. J.-C., que les bâtiments et autres monuments de l’agora furent systé-matiquement démantelés pour construire la basilique paléochrétienne et certaineshabitations environnantes, en particulier la vaste demeure dans un mur de laquelle lefragment B a été découvert. Une autre inscription, la « Stèle de la réconciliation », connutexactement le même destin : débitée en moellons, elle servit de matériau de constructiondans des aménagements tardifs, tels que le muret avoisinant la même demeure245. Aupa-ravant, de l’époque classique jusqu’à la fin de l’Antiquité, les deux stèles étaient sans douterestées visibles et lisibles, pour tout un chacun, sur l’agora246. La première offrait le por-trait d’une cité délivrée de l’oligarchie, vers le tournant du Ve et du IVe siècle, et réaffirmant,malédictions et serments collectifs à l’appui, les principes de liberté et de gouvernementpar le peuple – idéaux civiques encore longtemps vivaces, au moins à l’époque hellénis-tique247. La seconde évoquait en termes édifiants les Thasiens qui, vers 360-356 av. J.-C.,s’étaient dévoués à leur polis jusqu’à la mort et témoignait de la juste reconnaissance que lapatrie avait su leur montrer. Réduits à leur état de documents historiques, ces deux mo-numents purent jouer à travers les siècles, dans une cité devenue spectatrice desbouleversements politiques de l’époque hellénistique, puis de l’époque impériale, un rôlede « lieux de mémoire » et contribuer à entretenir l’attachement des citoyens à leur polis et,plus généralement, le sens de l’identité thasienne.
LES ORPHELINS DE GUERRE DE THASOS : UN NOUVEAU FRAGMENT DE LA STÈLE DES BRAVES 381
BCH 131 (2007)
244. O. PICARD, « Thasos et la Macédoine au IVe et au IIIe siècle », CRAI 1985, p. 761-776, part. p. 773-775 ;id., « Monnaie et commerce » (supra, n. 152), p. 33.
245. PICARD 2000, p. 1059.
246. Le bon état de conservation des deux fragments de la Stèle des Braves laisse penser qu’ils n’eurent pas àsubir plusieurs remplois successifs, mais qu’ils furent débités pour être immédiatement remployés dans lesédifices où ils ont été retrouvés.
247. Cf. PICARD 2000, p. 1065, à propos de la « Stèle de la réconciliation » : « il serait possible que (...) lesThasiens aient décidé à un moment ultérieur de leur histoire de faire disparaître de l’intitulé de notreaccord la reconnaissance des divisions de la cité, qui paraissaient fâcheuses [sc. en effaçant le nom de l’unedes deux factions], tout en gardant l’ensemble du texte dont les prescriptions contre l’oligarchie et pour leretour des exilés avaient une valeur pérenne ».
009BAT_BCH_131_01 6/10/09 2:59 PM Page 381
Dépositaire
DE BOCCARDÉdition - Diffusion
11, rue de Médicis - 75006 PARISwww. deboccard.com
Création graphique de la couverture
BCH130
2006
2Études
RapportsChronique
ÉC O L E FR A N Ç A I S ED ' AT H È N E S
B U L L E T I N D E C O R R E S P O N D A N C E H E L L É N I Q U E
ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNESDidotou 6 GR - 10680 Athènes
www.efa.gr
BCH130
BU
LL
ET
IN
D
E
CO
RR
ES
PO
ND
AN
CE
H
EL
LÉ
NI
QU
E
2 0 0 6
VIENT DE PARAÎTRE
COLLECTION DU CENTRE JEAN BÉRARDImage et religion dans l’Antiquité gréco-romaineActes du colloque organisé du 11 au 13 décembre 2003, à Rome, par l’École françaisede Rome, l’École française d’Athènes, ArScAn (UMR 7041 : CNRS, Paris I, Paris X),l’équipe ESPRI et l’ACI jeunes chercheurs ICAR,publiés sous la direction de S. ESTIENNE, D. JAILLAR, N. LUBTCHANSKY
et Cl. POUZADOUX
1 vol. 18 x 22,5 cm, 502 p., 6 plans, 2 cartes, 312 fig. n/b, 7 fig. couleur in texte Collection du Centre Jean Bérard, ISSN 1590-3869 ; 28© Centre Jean Bérard - ISBN 978-2-903189-95-2© École française d’Athènes - ISBN 978-2-86958-236-1 50€
ETUDES THASIENNES XXLes céramiques d’usage quotidien à Thasos au IVe siècle av. J.-C.par Francine BLONDÉ
avec la collaboration de Maurice PICON
2 vol. 21 x 29,5 cm, 206 p., 92 planches n/b, 19 photographies couleur1 DVDISBN 2-86958-211-0 125€
FOUILLES DE DELPHES II : TOPOGRAPHIE ET ARCHITECTUREL’aire du pilier des Rhodiens (fouille 1990-1992)À La frontière du profane et du sacrépar Jean-Marc LUCE
avec des contributions de Ph. MARINVAL, L. KARALI, K. CHRISTANIS, J. MISKOVSKY,St. THIÉBAULT et M.-Fr. BILLOT
2 vol. 25 x 32 cm. Vol. I : 464 p., vol. II : 5 photographies couleur, 114 photographiesn/b, 1 carte, 5 fig. couleur, 43 dessins au trait, 39 planches de figures, 2 dépliants ISBN 978-2-86958-200-2 125€
Dépositaire : DE BOCCARD Édition-Diffusion |11, rue de Médicis | F-75006 Paris | www. deboccard.com
ISBN : 978-2-86958-204-0ISSN : 0007-4217
Break In • GR-106 81 Athènes
BCH_130_2couv 7/5/09 5:52 PM Page 1



















































































![« L'ère auguste : ébauche d'une histoire politique de la Thessalie sous Auguste », BCH 132 (2008)[2010], p. 427-471](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63206f14067e4ea67a0f4d34/-lere-auguste-ebauche-dune-histoire-politique-de-la-thessalie-sous-auguste.jpg)