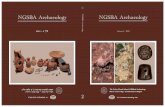L'ALLIAGE DES MONNAIES DE BRONZE (AMPHIPOLIS, THASOS, MARONÉE)
Transcript of L'ALLIAGE DES MONNAIES DE BRONZE (AMPHIPOLIS, THASOS, MARONÉE)
@A>O>TIPCITE» TAE» KAI TEXNOAOIIA
ATIO TOT» IIPOI»TOPIKOY>XPONOY» O» »HMEPA
THASOSMATrÈnps PREMrÈnE s
ET TECHNOLOGIE DE LApnÉHrsrornp À Nos JoURS
flpornro Are0vouç luveôpi.ou
Actes du Colloque International
Âtpevapto O<ioou
26 - 29t9tt995
Thasos, Liménaria
EXTRAIT
UALLIAGE DES MONNAIES DE BRONZE(AMPHTPoLIS, THASos, MARoxÉn)
Par définition, les monnaies de << bronze » frappées par les cités grecques devraientêtre faites d'un alliage de cuivre et d'étain, selon des proportions variables. En faitd'autres métaux peuvent s'ajouter, voire se substituer, à l'étain. Si l'apport d'étain aucuivre donne un matériau possédant des qualités métallurgiques bien adaptées à la frappemonétaire, une plasticité qui permet aux types monétaires de bien s'imprimer, et unebonne résistance à l'usure, ce métal doit être importé de contrées lointaines et même lors-qu'il est disponible sur le marché, il est beaucoup plus coûteux que les métaux de subs-titution, surtout le plomb dont les alliages se prêtent cependant moins bien à la monnaie.On sait d'autre part que Rome a joué, en particulier à l'époque impériale, de la com-position de ses << bronzes >>, notamment par l'utilisation de l'orichalque, alliage de cuivreet de zinc, qui avait une couleur jaune d'or, flatteuse pour une monnaie. Il n'est pasdouteux que les autorités des cités grecques ont été elles aussi sensibles, au moment defaire frapper une émission, à des considérations de coût, mais aussi de prestige, qui ontpesé sur le choix de l'alliage.
Le chimiste américain Calley', qui avait fait un certain nombre d'analyses de bronzesgrecs, concluait que leur composition aurait connu une transformation continue et régu-lière, passant d'un alliage cuivre/étain à un alliage comprenant une proportion croissantede plomb. Les analyses qui ont été faites par France Beauchêne sur les bronzes de Thasosdu Cabinet des Médailles, puis par Maria Guerra, en 1994-1995, sur ceux d'Amphipolis etde Maronée, dans le cadre des recherches du Centre Ernest Babelon à Orléans, montrentque le phénomène est beaucoup plus complexe.
Mais avant d'en publier les résultats, il convient présenter la méthode utilisée.
1. L'ANALYSE DES MÉTAUX CUIVREUX.
L'analyse des monnaies de bronze se heurte à un certain nombre de difficultés quitiennent tant à l'hétérogénéité de l'alliage originel qu'à l'importance des phénomènes decorrosion ayant affecté la surface au contact du milieu ambiant. Ainsi le profil réalisé par
(1) E. R. Car-nv, The Composition of Ancient Bronze Coins, MAP6S 11 (1939).
t96 MARIA GUERRA, OLIVIER PICARD
microscopie électronique d'un sesterce de Gordien III, fait d'un bronze au plomb, montreque la patine peut atteindre quelques dizaines de microns et que des précipités de plombse forment en n'importe quel point du flan monétaire (frg. 1). De ce fait les analyses quisont faites à partir de prélèvements d'un échantillon limité ou celles qui se fondent surdes mesures de surface, telles la fluorescence X et le PIXE, fournissent des résultats quine sont pas représentatifs de la composition de l'ensemble de la monnaie. Seules lesanalyses chimiques globales procuraient des données fiables, mais elles ne pouvaient êtreque d'un emploi limité parce que nécessairement destructrices.
Ces défauts sont palliés par la technique d'analyse développée par le Centre ErnestBabelon au cyclotron du CERI-CNRS d'Orléans. L'analyse par activation avec desneutrons rapides produits par le cyclotron n'est pas destructrice, tout en s'effectuant surla totalité de l'objet; elle donne des résultats représentant une valeur moyenne qui n'estpas affectée par les phénomènes d'hétérogétéité se produisant lors de la fabrication del'alliage puis tout au long de l'histoire de la pièce de monnaie. Par rapport à la méthodeclassique d'activation aux neutrons de réacteurs, qui ne portait que sur un échantillon etse heurtait donc aux difficultés posées par l'hétérogénéité, elle présente les avantagessuivants :
- elle permet d'effectuer une mesure globale, car l'énergie plus élevée des neutronstraverse toute la monnaie ;
- elle procure, avec un bon choix de l'énergie incidente, de meilleures limites dedétection pour une dizaine d'éléments car les réactions nucléaires produites par desneutrons d'énergie plus élevée induisent d'autres réactions nucléaires.
Les caractéristiques fondamentales de cette technique résultent donc du choix du fluxd'énergie de neutrons produits par le cyclotron. Ce genre d'analyse procure un maximumde sensibilité dans la mesure des éléments dosés pour un minimum d'interférence.
Les conditions expérimentales qui répondent le mieux à nos exigences sont les sui-vantes :
- les neutrons sont produits par réaction nucléaire d'un faisceau de deutons de17,5 MeV d'énergie sur une cible épaisse en béryllium (frg. 2) ;
- l'intensité du courant de deutons sur la cible est maximale : 30 pA ;
- la monnaie est soumise à une irradiation de 5 minutes par 5 grammes de cuivre.
Les monnaies sont irradiées au moyen d'un passeur automatique, contrôlé à l'exté-rieur de la salle d'irradiation, qui permet de traiter successivement jusqu'à 12 monnaiessans intervention humaine.
Après irradiation, les monnaies sont soumises à une spectrométrie gamma. Chaqueisotope ayant un spectre gamma caractéristique, la spectrométrie permet d'identifier leséléments qui composent la monnaie (analyse qualitative) et d'évaluer la concentration dechacun d'eux (analyse quantitative). Le calcul de concentration est effectué au moyen dela méthode de l'étalon interne : la concentration des divers éléments est calculée parrapport à l'élément utilisé comme étalon interne. Pour les alliages des monnaies de bronze,c'est le cuivre qui est utilisé comme étalon interne.
La précision de l'analyse est, comme pour les autres techniques d'activation, inférieureà 3 % relatif pour les éléments majeurs et à 10 o/o relatif pour les éléments traces. Leslimites de détection expérimentales de la méthode, pour les éléments qui sont habituelle-ment dosés dans les alliages cuivreux, sont comprises entre 0,1 et 40 ppm (frg. 3,tableau I).
Les dix éléments mesurés sont le cuivre, l'étain, le plomb, le fer, le zinc, le nickel,l'antimoine, l'arsenic, l'argent et l'or. Les sept derniers, qui n'ont pas servi à des ajouts
L,ALLIAGE DES MONNAIES DE BRoNZE 197
volontaires, ne sont présents qu'à l'état de trace et ne nous retiendront pas. En revanchela proportion de cuivre, d'étain et de plomb est le résultat d'une pratiquè délibérée. Nousprésentons donc les résultats dans des diagrammes indiquant, type par type, les propor-tions d'étain et de plomb et, pour les monnaies de Thasos, danÀ un diagiamme triangu-laire, chaque côté donnant le pourcentage d'un des trois métaux.
2. LES MONNAYAGES.
Les bronzes du Cabinet des Médailles que nous analysons ici' ont été frappés aury" siècle et à l'époque hellénistique par Thasos, dont O. Picard prépare le corpùi, ainsique par Amphipolis et, pour une série, par Maronée. La comparaison entre ces mon-layages mérite d'être étudiée, du fait de la proximité et, en même temps, de la disparitéde l'histoire des trois cités. Elles étaient voisines et avaient de nombreux échanges, cômmele prouvent les trouvailles de monnaies, mais leur histoire politique diverge trèJ vite : citéindépendante frappant monnaie à ses types (tête d'Apollon / torche de éourse) au début!u tv" siècle, Amphipolis est intégrée au Royaume de Macédoine à partir de 357; atdébut, elle frappe encore au moins deux petites émissions à la tête d'Héraclès, 'mais
bientôt sa seule activité monétaire connue est d'abriter le principal atelier monétaire duRoyaume ; on admet traditionnellement qu'elle retrouve une activité monétaire propre àpartir d'une réforme faite par Philippe V en 187, ce qui se manifeste par un grandnombre de types différents, la logique du système monétaire restant à élucider, cependantque le classement et la datation des émissions s'avèrent particulièrement délicats3.
Dans son île, Thasos a su presque toujours préserver son indépendance. Au IV" siècle,plus précisément entre 390 et le début du Iu" siècle, elle frappè une longue série debronzes à la tête d'Héraclès et aux armes du héros, en un puli trois modules ; l'évolu-tion régulière de la série n'est perturbée que par deux épisodes, la frappe, sans doutevers 360, de deux émissions aux types des monnaies d'argent (tête de Dionysos etHéraclès archer, un genou en terre), puis, dans la dernière décennie du rv" siècle, degrosses émissions à la tête de Déméter / Dioscureso. Le ur siècle et le début du u. voientun très net fléchissement du monnayage, avec seulement trois émissions de types diffé-rents- À partir de 175, Thasos inaugure une nouvelle série longue, qui durerï jusqu'auI"' siècle, en frappant des grands bronzes au type d'Artémis et des bronzes moÿenJ quireprennent à la série du rv" siècle l'image d'Héraclès.
Quant à Maronée, les neuf pièces que nous avons analysées occupent une place trèsparticulière dans le monnayage de la cité : en bronze ou, pour quelques unes ên bronzeavec une mince pellicule d'argent, elles portent les types non des monnaies de bronze,mais de l'argent, à la manière des deux émissions thasiennes mentionnées ci-dessus' :
P. R. Franke a supposé qu'il s'agissait de monnaies de nécessité frappées au moment dela conquête de Maronée par Philippe II de Macédoine.
(2) Nous donnons leur numéro(3) Faute d'étude d'ensemble
H. GÀsI-Bn, Die antiken Münzen yon
d'inventaire, précédé de A pour Amphipolis et de M pour Maronée.du monnayage de bronze d'Amphipolis, nous utilisons le recueil deMakedonia und Paionia II (1935), p. 30-43, pl. VIII-X (désormais cité :
GÀnmn).(4) Voir le tableau dressé
NoltXpov 9 (1990), p. 15-31.par G. LE RTDER, in Guide de Thasos (1968), p. 185-191, pl. I-V ; O. prc.q.no,
(5) E. ScuONnnr-GEIss, Die Münzpriigung ÿon Maroneia (1987), p. 52-61. O. Prc,q.n», « Innovations moné-taires dans la Grèce d],_ ry" siè"I" >>, CRAI (1989), p. 678-680. P. R. Fnalre, « Das Ende der Münzprâgungder Thrakischen Stadt Maroneia », in ApTa[a @prirq II (1997), p. 661-663.
198
3. LES ANALYSES.
MARIA GUERRA, OLIVIER PICARD
Les résultats de ces analyses montrent des différences sensibles dans les alliages, maisune grande cohérence à l'intérieur d'une même série typologique.
Les chalques d'Amphipolis au type d'Apollon, qui sont antérieurs à 359 (type 7, A363à 369A, GÀntnR, pl. V[.19-22), sont signalés par un triangle clair dans les tableaux II-III(fig. a-5) :c'est de beaucoup la série la plus riche en étain, la seule qui dépasse 14o/o,avec deux exemplaires à près de 20 "/" et w seul au-dessous de l0 7o. Corrélativement,le plomb est toujours inférieur à 2 "/", le plus souvent même à I'y", c'est-à-dire qu'il n'estprésent qu'à l'état de trace. Il est remarquable que, des trois multiples (types 2 et 3, A360à A362, GÀnLrR, pl. VI[.17-L8; losange clair et noir), un seul présente la même com-position, les deux autres étant sensiblement plus pauvres en étain (5 à 6 %) et ayant faitl'objet d'un ajout de plomb (3 à 6 %).
Les quatre bronzes qui se placent aussitôt après par leur date, les émissions à la têted'Héraclès et au lion ou au sanglier, ont été frappés par la cité immédiatement après saconquête par Philippe6 (type 4, A431-434, GÀet-pn, pl. IX.IZ; *noir);ils présentent unecomposition très différente : une proportion faible, mais constante, d'étain (autour de 3 à4 "/"), et, pour les trois pièces de module moyenT, une très forte proportion de plomb(17 à 23 %), alors que le grand bronze n'en possède pratiquement pas ; ceci les rangeparmi les quatre émissions présentant la plus forte concentration de plomb.
Le tableau III (fig. 5) montre que la composition de l'alliage amène à répartir laplupart des bronzes hellénistiques selon deux schémas d'organisation : il y a les types dontla dispersion se fait parallèlement à l'axe des abscisses, avec une proportion généralementtrès faible de plomb (de 0 à 2 "/") et un pourcentage variable d'étain, qui varie de 5 à73 "/", et qui est donc sensiblement plus faible que pour les bronzes antérieurs à 357 ; àce groupe s'opposent les pièces qui se répartissent dans une bande parallèle à l'axe desordonnées, avec une proportion plus faible, mais relativement constante d'étain (entre2 et 8 7o), mais dont le plomb varie fortement, de quelques traces à plus de 25"/".
Le premier groupe comprend les types suivants :
- Poséidon / massue dans couronne (type 7, A377-380,382, GÀeLER, pl. IX.1-2;triangle noir), où l'on note une pièce (A379) qui est un cuivre presque pur ;
- Strymon / dauphin dans couronne (type 8, A403-406, GÀeLEr, pl. YLII.24-25; X);
- Zeus / taureau bondissant (type 10, A409-411, GÀntnR, pl. IX.11 ; +), où le plombcommence à apparaître, entre 0,15 et 0,35 7;" ;
- Artémis / deux boucs (type 11, A381, 399-402A, GÂntER, pl. IX.9; cercle blanc) :
le plomb augmente légèrement (0,75 à 1,6"/"), tout en restant inférieur à 2"/".
On classera dans ce groupe les trois types suivants, pour lesquels les résultats sontdifficilement utilisables, car nous n'avons disposé que d'une pièce pour analyse :
- Héraclès / centaure (type 5, A417, GÀnrnn, p1.VlI.23; *gris);
- tête janiforme I 2 centatres dos à dos (type 9, A419, GÀnr-ER, pl. IX.15 ; trianglegris) ;
- Artémis / taureau (type 12, A418, GÂnI-nR, pl. IX.S ; carré gris).
(6) O. PrcanD, « Deux émissions de bronze d'Amphipolis >>, BCH 118 (1994),pl. IX.l2.
(7) Si peu satisfaisants qu'ils soient, les termes de « bronze moyen >), « grand >>
d'une analyse précise de la valeur de ces pièces.
p. 207-214. Cf. GÀsren,
sont employés ici faute
L,ALLIAGE DES MONNAIES DE BRONZE
Il convient aussi d'y rattacher le type suivant qui comporte une proportion d'étainentre 5 et 12 7o, c'est-à-dire comparable à celle du groupe précédent, mais où le plombmonte jusqu'à 5-7 o/o
:
- tête de Persée / ethnique dans couronne (type 6, 4387-388A, GÂeLpR, pl. lx.4;tiret long).
. Le deuxième groupe présente un faible pourcentage d'étain (2 à 8 "/o), avec un apportde olomb qui, en dehors de quelques exceptions, dépasse régulièrem ent 5 "/o et
- peut
atteindre 25 Y" :
. _ . Zets I proue (type 13, A389-394, GÂetER, pl. IX.16; cercle noir), avec une pièce(A393) sans plomb;
- Poséidon / cheval (type L4, A413-475, GÀnLER, pl. IX.S; losange gris), dont lestrois pièces montrent une dispersion remarquable des valeurs du plomb ;
- Apollon I épi (type 15, A435-440, GÀnLrR, pl. IX.5; cercle gris), qui présente uncas particulier, avec des valeurs de l'étain constantes (entre 5 et i,5 %), mais celles duplomb très dispersées (0 - 2,3 - 13,5) ;
- Artémis / taureau (type 16, A420-423, Gi\st-BR, pl. lx.l7; petit tiret), dont unedes pièces possède le maximum de plomb (25,8y"), pratiquement sàns étarn;
- Athéna I aigle (type 17, A445-447, GÀnrrR, pl. IX.22; carré noir) ;
- zets I aigle (type 18, A442-444 et 450-451, GÀBLER, pl. IX.18 ; carué blanc).
Pour le monnayage de Thasos (frg. 6, tableau IV), nous nous limiterons ici à pré-senter l'analyse des bronzes frappés entre 390 et 360, ceux qui appartiennent au pre-i"tgroupe avant l'introduction des grands modules. Nous distinguerons les chalquei de lapremière phase, où, au revers, les armes d'Héraclès s'inscrivent dans un carré inèus (cerclenoir sur le schéma), !"1 chalques de la deuxième phase, où le carré incus a disparu(triangle noir) et les trioboles en bronze aux types de l'argent (losange noir). Les premierset les seconds ont une composition très homogène, avec 12 à 15 ô/o d'étain, et pas dutout ou pratiquement pas de plomb ; seuls trois chalques de la première phase (iur 16,et 7 chalques de la deuxième phase) ont entre 3 et 7 o/o de cuivre et entre 5 et 9 oÂ
d'étain. Le tableau des trioboles est bien différent : les 6 exemplaires analysés compor-tent nettement moins d'étain (entre 2 et 5 7o, sauf une pièce, qui monte à 8 %) et, enrevanche, l.e plus souvent, un ajout important de plomb, entre fu et 15 o/o, à l'exceptionde deux pièces qui sont en cuivre presque pur.
Les neuf pièces de Maronée (frg. 7, tableau V) qui sont toutes du même type etappartiennent donc à un même ensemble monétaire, présentent une nette homogénéilé decomposition en ce qui concerne l'étain qui se situe entre 6 et 8,5 % (à l'excepiion d'unep-ièce où il tombe à 4 y"). En revanche le plomb varie très fortement, de quelques traces(M376, 377, 380 et même 381, où il atteint 1,,6 %) à ll "/o (M374). L'argent est quasimentabsent (entre 0,02 et 0,03 %) de ces pièces dont certains exemplaireJ étaient iaucés etdevaient avoir la valeur d'un triobole.
4. ESSAI D'INTERPRETATION.
Le cas d'Amphipolis paraît le plus complexe, ne serait-ce que parce que les nombreuxtypes datés ordinairement de la basse époque hellénistique ont été classês sommairementet n'ont pas été datés avec précision. D'autre part, tous les types réunis par Gâbler n'ontpas fait l'objet d'une analyse et nous ne saurions prétendre piocéder ici à une étude sys-
t99
200 MARIA GUERRA. OLTVIER PICARD
tématique. Certains regroupements sont cependant possibles, en tenant compte des carac-téristiques techniques ou stylistiques des pièces.
Les bronzes dont le type de droit s'inscrit dans un cercle de grènetis et celui derevers dans une couronne de chêne et dont les émissions sont distinguées par plusieursmonogrammes parfois accompagnés de symboles, appartiennent manifestement à une mêmesérie que le dessin de la couronne rapproche des bronzes frappés par les deux derniersrois de Macédoine et des tétradrachmes de Macédoine Première, dont Amphipolis était lacapitale. La série comprenait au moins' :
- un très grand module, Tête de Persée / ethnique dans couronne (type 6) ;
- un grand module, Tête de Poséidon / massue (type 7);
- un module moyen, Tête du Strymon / dauphin (type 8).
Les deux derniers modules, qui appartiennent au groupe I, ont la même composition,sans plomb avec un pourcertage d'étain allant de 5 à 13 7o. Les trois pièces du trèsgrand module ont le même pourcentage d'étain, mais avec un ajout de plomb autour de5 "Â. La série paraît donc présenter le même phénomène que les bronzes antérieurs à357, où les plus grands modules ont eux aussi fait l'objet d'un ajout de plomb, dans lesmêmes proportions. Mais on n'en fera pas une règle, car la situation est exactementinverse pour le type 4, où c'est le grand module qui ne comporte pas de plomb.
Une autre série se dessine également, avec monogrammes, mais sans couronne aurevers :
- un grand module, Tête de Zeus I proue (type 13) ;
- un module moyen, Tête de Poséidon / cheval (type 14);
- un module plus petit, Tête d'Artémis / épi (non analysé).
Les deux types ont un pourcentage d'étain faible (entre 3 et 7 "/"), avec un apporten plomb qui peut être très fort pour le très grand module. La différence d'alliage entreles deux séries est très nette. Nous reviendrons en conclusion sur la manière de l'inter-préter. Mais disons d'ores et déjà que, sans esquisser ici une histoire monétaire d'Am-phipolis à la basse époque hellénistique ni proposer de date, nous y voyons la marqued'une différence chronologiquee.
Parmi les autres émissions, GÀsI-Bn avait constitué, pl. IX.7 à LL, un ensemble com-prenant les grands bronzes à la tête d'Artémis / ethnique dans couronne, avec mono-grammes (GÀnrnn, pl. IX.7, non analysé), Artémis / 2 boucs, avec monogrammes (type L1,GÀnLnR, pl. IX.9), Artémis / taureau cornupète, sans monogramme (type 12, GÂnLnn,pl. IX.8), le style du droit des trois types étant effectivement très proche. Les analysesmontrent que les pièces de ce groupe ont un alliage comparable, avec très peu de plomb,et invitent à les placer juste après le type 10, Zets / taureau bondissant (GÀnrrn,pl. IX.11), où le plomb commence à apparaître. Il faut vraisemblablement associer à cetensemble le type Z,eus I 2 boucs (GÀnlrn, pl. IX.10), non analysé, et placer le tout entrela série à la couronne (à laquelle se rattache le type Artémis / ethnique dans couronne)et l'autre série.
(8) Nous n'avons pas analysé de bronzes Artémis / ethnique dans couronne (GÀnlen, pl. IX.7), qui pos-sèdent les mêmes caractéristiques.
(9) Sur l'histoire monétaire d'Amphipolis à cette période, voir I. TounArsocI-ou, H voptoltaarrl rcuil"o-
Qopia oryv apTaia Mareùovïa (xep. 200 n.X. - 268-286 tt.X). H paprupia rav 9rloaupdv, BtpTtoùjrr1 qç H)l7-wrriç Noptoltarrcrjç Eratpeiaç I (1993).
L,ALLIAGE DES MoNNAIES DE BRONZE
Deux émissions se situent à part dans cette histoire monétaire. Le type 5, Héraclès /Centaure, qui est peu abondant, était placé par Gâbler au tout début de la reprise dumonnayage civique par Amphipolis, qu'il datait de 187. En fait le style de la têted'Héraclès amène à penser à une date plus anciennel.. Quant au type q. iête janiforme /2 centatres, dont Gâbler avait bien noté la parenté avec les as romains, il se situe tout1 f,uit à part dans le monnayage d'Amphipolis; le type est frappé avec beaucoup plusd'abondance par Thessalonique, où il apparaît en plusieurs modules (GÀnien,pl. XXIII.S-I1).
Les autres types appartiennent à des émissions sans marque de contrôle. Il faut dis-tinguer parmi elles les types 15 (Apollon I épi) et 16 (Artémis / taureau), où I'ethniqueest disposé horizontalement, et qui doivent dater du r"' siècle av. J.-C. et les types 17(Athéna I aigle) et 18 (Zetts / aigle), où l'ethnique est disposé circulairement. Bien qu'ilssoient classés par Gâbler à l'époque hellénistique, il me paraît plus probable qu'ils appar-tiennent déjà à l'époque impériale, en particulier le type 18, où lÈthnique èst tranicritsous la forme AMOIIO^EITON. Il est intéressant de noter que la composition de cespièces est comparable à celle des monnaies frappées par les duovirs de Ôorinthe,,.
Les monnaies de Thasos se répartissent clairement en deux ensembles qui se distin-guent aussi bien par leur typologie que leur alliage. Les chalques, que l'on peut qualifierde monnayage régulier de la cité, ont une composition très proche, pour ne pas dire iden-tique, de celle des premiers chalques d'Amphipolis : il ne faut sans doute aitribuer qu'auhasard de notre échantillonnage le fait que les chalques thasiens ne dépassent pas 16 %d'étain sans atteindre les 20 "Â attestés à Amphipolis. En revanche, le§ pièces qui sontchimiquement des bronzes, mais qui, considérées d'un point de vue monétaire, âevaientêtre des trioboles car elles présentent les types, le poids et le module de monnaiesd'argent, ont une composition bien différente : leur alliage cuivre / plomb comportebeaucoup moins d'étain. Indiquons simplement ici que l'emploi d'un alliagê au plomb pourun groupe limité ne constitue qu'un bref épisode et que les émissions ultérieurei dechalques attestent le retour à un bronze crtivre I étain.
Les neuf pièces de Maronée appartiennent toutes à un même groupe d'émissions dontnous avons rappelé le caractère exceptionnel. Faute d'analyses, il n'est pas possible de lescomparer aux autres émissions de bronzes de la cité datant du rv" siècle. mais il nous aparu intéressant de les situer par rapport aux monnayages d'Amphipolis et de Thasos, oùnous avons distingué des émissions ordinaires et des émissions exceptionnelles.
5. ALLIAGE ET POLITIQUE MONÉTAIRE.
L'analyse de la composition de l'alliage amène donc à constater deux phénomènesdifférents : d'une part une évolution, qui n'est sans doute pas linéaire ni iégulière, setraduit par le remplacement progressif d'une partie de l'étain en forte proportiôn à l'ori-gine (de 15 à 23 "/") par du plomb, qui, très faible au départ, peut attéindre 15 à 20 "/o ;d'autre part des anomalies apparaissent dans des monnaies dont l'iconographie signalaitdéjà qu'il s'agissait d'émissions particulières.
(10)(11)
type n'apparaît pas dansAturaNonv, Le monnayage
les trésors recensés par I. TounarsocI-ou.des duovirs de Corinthe, BCH Suppl. XV (1988), p. 88.
201
LeM.
202 MARIA GUERRA, OLIVIER PICARD
Dans ce dernier cas, le plomb apparaît en forte proportion dès le rv" siècle dans desbronzes circulant apparemment pour une valeur très surévaluée, sans doute en réponse àdes difficultés financières particulières, liées peut-être à des guerres, comme on l'avaitsupposé, avant même nos analyses, à Thasos et à Maronée, ou à des circonstances diffi-ciles pour la cité, comme à Amphipolis après la conquête de la ville par Philippe II deMacédoine. I1 n'y a pas de raison de penser que nos cités aient eu le monopole de tellesmesures et une enquête élargie amènerait certainement d'autres découvertes analogues. Lephénomène est digne d'intérêt. Si l'expression de monnayage de nécessité (qui s'appliqueà l'époque contemporaine à une monnaie émise non par l'Etat, mais par une autorité quidoit s'y substituer à cause de la défaillance de l'Etat, par exemple dans une ville assiégée)ne convient pas, car le mécanisme monétaire est différent, il ne fait pas de doute quel'emploi d'un bronze au plomb a répondu souvent à une difficulté monétaire.
Comment expliquer le mécanisme financier d'une telle mesure ? Remplacer de l'étain(qui ne se trouve pas en Grèce) par du plomb (métal vil parce que surabondant, notam-ment dans la galène) permettait sans doute une économie financière en achat de métal,et une autre en combustible (parce que le point de fusion de l'alliage est plus bas). Toute-fois les bénéfices retirés de cette substitution paraissent avoir été minimes : si, commel'indique Pline, HN XXXIV 161, le plomb coûtait environ onze fois moins cher que l'étain,7 deniers contre 80 deniers à la livre, le petit volume du métal utilisé fait que les sommesconcernées restent faibles. En fait la principale source des revenus procurés par cesmesures extraordinaires résulte de la surévaluation de la monnaie que les types moné-taires nous amènent à supposer. Or celle-ci est indépendante de l'alliage. Il faut doncchercher une autre explication à ce recours au plomb : l'avantage présenté par ce métaltient peut-être à ce qu'il était répandu partout, et donc disponible immédiatement; sonemploi permettait de procéder immédiatement à la frappe, avec les moyens locaux, sansavoir à s'approvisionner en métal à l'extérieur.
L'explication ne rend pas compte de l'autre phénomène, rien n'autorisant à penserqu'Amphipolis à la basse époque hellénistique (ou Corinthe au temps des duovirs) aitconnu constamment de graves difficultés financières. On a affaire ici, apparemment, à uneévolution de la technologie du bronze (tout au moins du bronze utilisé pour les monnaies)qui s'explique peut-être par raisons financières, le prix de l'étain montant constamment del'époque hellénistique au début de l'Empire : c'est la conclusion que tire G. Le Riderl2d'une comparaison entre un prix donné par un compte athénien des années 420 et celûqu'indique Pline l'Ancien. Mais il y avait peut-être aussi des raisons techniques que nousconnaissons mal, en dehors de l'abaissement du point de fusion, mais aussi du caractèreplus cassant de l'alliage obtenu : il serait intéressant de mener des recherches dans cedomaine. Quoi qu'il en soit, l'étude de l'alliage peut procurer des informations impor-tantes sur l'homogénéité ou l'hétérogénéité de séries monétaires aux types différents.
En tout cas, il nous paraît certain que, comme le choix des types et des dénomina-tions, le choix de l'alliage relève de la politique monétaire de la cité : il conviendra d'entenir compte dans l'étude d'un monnayage.
Maria GUERRA, Olivier PrcRR»,Centre Ernest Babelon, Orléans.
(12) G. LE RIDER, « Antiochos IV et le monnayage de bronze séleucide >>, BCH 118 (1994), p. 29-31..
L,ALLIAGE DES MoNNAIES DE BRONZE
Deux émissions se situent à part dans cette histoire monétaire. Le type 5, Héraclès /Centaure, qui est peu abondant, était placé par Gâbler au tout début de la reprise dumonnayage civique par Amphipolis, qu'il datait de 187. En fait le style de la têted'Héraclès amène à penser à une date plus anciennelo. Quant au type g. fOte janiforme /2 centatres, dont Gâbler avait bien noté la parenté avec les as romains, il se situe toutq f,uit à part dans le monnayage d'Amphipolis; le type est frappé avec beaucoup plusd'abondance par Thessalonique, où il apparaît en plusieurs modules (GÀnien,pl. XXIII.S-I1).
Les autres types appartiennent à des émissions sans marque de contrôle. Il faut dis-tinguer parmi elles les types 15 (Apollon I épl) et 16 (Artémis / taureau), où l'ethniqueest disposé horizontalement, et qui doivent dater du I"' siècle av. J.-C. et les types 17(Athéna / aigle) et 18 (Zous / aigle), où l'ethnique est disposé circulairement. Bien qu'ilssoient classés par Gâbler à l'époque hellénistique, il me paraît plus probable qu'ils appar-tiennent déjà à l'époque impériale, en particulier le type 18, où lèthnique èst tranicritsous la forme AMOIIO^EITON. Il est intéressant de noter que la composition de cespièces est comparable à celle des monnaies frappées par les duovirs de Ôorinther,.
Les monnaies de Thasos se répartissent clairement en deux ensembles qui se distin-guent aussi bien par leur typologie que leur alliage. Les chalques, que l'on peut qualifierde monnayage régulier de la cité, ont une composition très proche, pour ne pas dire iden-tique, de celle des premiers chalques d'Amphipolis : il ne faut sans doute aitribuer qu'auhasard de notre échantillonnage le fait que les chalques thasiens ne dépassent pas 16 %d'étain sans atteindre les 20 % attestés à Amphipolis. En revanche, les pièces qui sontchimiquement des bronzes, mais qui, considérées d'un point de vue monètaire, àevaientêtre des trioboles car elles présentent les types, le poids et le module de monnaiesd'argent, ont une composition bien différente : leur alliage cuivre / plomb comportebeaucoup moins d'étain. Indiquons simplement ici que l'emploi d'un alliagè au plomb pourun groupe limité ne constitue qu'un bref épisode et que les émissions ultérieurei dechalques attestent le retour à un bronze ouivre I étain.
Les neuf pièces de Maronée appartiennent toutes à un même groupe d'émissions dontnous avons rappelé le caractère exceptionnel. Faute d'analyses, il n'est pas possible de lescomparer aux autres émissions de bronzes de la cité datant du rv. siècle, mais il nous aparu intéressant de les situer par rapport aux monnayages d'Amphipolis et de Thasos, oùnous avons distingué des émissions ordinaires et des émissions exceptionnelles.
5. ALLIAGE ET POLITIQUE MONÉTAIRE.
L'analyse de la composition de l'alliage amène donc à constater deux phénomènesdifférents : d'une part une évolution, qui n'est sans doute pas linéaire ni iégulière, setraduit par le remplacement progressif d'une partie de l'étain en forte proportiôn à l'ori-gine (de 15 ù 23 Y") par du plomb, qui, très faible au départ, peut attéindre 15 à 20 o/o
;d'autre part des anomalies apparaissent dans des monnaies dont l'iconographie signalaitdéjà qu'il s'agissait d'émissions particulières.
201
(10)(11)
LeM.
type n'apparaît pas dansAlr,nNo«v, Le monnayage
Ies trésors recensés par I. Toun.+rsocr-ou.des duovirs de Corinthe, BCH Suppl. XV (1988), p. 88.
L,ALLIAGE DES MoNNAIES DE BRoNZE
nÉsuntÉ - TTEPTAHYH
Présentation de la méthode d'analyse de monnaies de bronze par activation avec des neutronsrapides et analyse des résultats obtenus pour les bronzes d'Amphipolis (rv" s.) et pour des sériesde bronzes de Thasos et de Maronée. Les bronzes ordinaires du rv" s. possèdént une teneurmaximum en étain (autour de 15 "/"), et pratiquement pas de plomb. Le plômb apparaît d'aborddans des émissions exceptionnelles du Iv" s., dont la valeur semble avoir éié fortement surévaluée.Par la suite, il semble bien que la teneur en plomb augmente, au détriment de l'étain, dans lecourant de l'époque hellénistique. Ce facteur permet de sérier les séries de bronze d'Amphipolisdont le classement restait très confus.
llopouoi.oorl îIÇ pe0ôôou ovriÀuo'r1ç ;gtil,rrvolv vopropdtrrrv pe ,cayeLa evepyoruoiqoq vetpovirrlv rorovoluorl tolv onoteÀeopotrov rcou npoéruvov yro to yiÀrrvo tr1ç ApQiroî,îç (tou 4ou orrôvo) Kot Tlcoerpéç ;gol.rivrrlv t1ç @tioou Kol rIç Moporverog. To rorv«i 1ol.ruvo tou 4ou orôvo epQovt(ouv roÀüpeloÀr1 rceplertlrôolro oa roooi"tepo (yüpar oto 15 o/") ror o1eôôv roOôl,ou pôl"uBôo. O p6l"upôoqepQovi(etor opprcd oe ronéç ertôç oerpdg tou 4ou orrrlvo, tr»v onoirrlv 11 o(io Qoivetor vo un(p(erôroitepo urceptrpqpévn. ,rn ouvé1ero, Qoiveror roOopri nrrç I neprertrrôtqto oe pôl.uBôo ou(«ivi-ro1, o€ pdpoç tou roooitepou, roto t1 ôrdprero trrlv eÀÀrlvrotrrôv 1pôvrrlv. O nopdyovtoç ourôç- enr"-rpéna trlv to(rvôpr1ol î0)v oerprôv trov yiÀrtvrov cr1ç ApQiruol,r1g, trov onoi.rrlv n Oéo"n ruopépàve rrlq trôpoorpooôrôprotq.
203
204
.11'-'-.Il
I
I
rI
Fig. 1. - Monnaie en bronze plombé n" 4 :
profil pour le plomb, l'étain et le cuivre,obtenu par microscopie électronique à balayage.
MARIA GUERRA, OLIVIER PICARD
Deute rons
Cyclocron vacuum
Sample holder
Water
§- RoraÈtve axis
BerylIiumÈa rgeÈ
Fig. 2. - Le passeur de monnaies.
OFHC CTIFI ) LD 1 2 u)
Fe <40 <40 40 <31 31 30
Ni 2,7 8 0.5 3.4 0.5 2
Zn 47 <50 20 <44 44 20
As 0.94 <0.5 0,5 1.1 0.5 0.5
Ae t4 <10 t0 t2 8 8
Sn 0-85 <0-5 0.5 <0.4 0-4 o.4
Sb 29 t2 0.1 I 0-6 0-lAu <o.4 <0-4 0.4 <o_2 0.2 0.2
Pb <35 <30 30 <25 25 25
OFHC: Oxveen Free Hieht ConductivitvCTIF: Centre Technique des lndustries de la Fonderie
Limites de détection oour les neutrons raoides
Fig. 3. - Tableau I : limite de détection pour les neutrons rapides.
If Symbole Types Module Inv. Paris GI|BLER, PI.
I l\ Anollon / torche de course chaloue 4363-3691^ YrIJ t9-222 + Aoollon /torcbe de course moyen A36t-162 VIII. 17-18
1 O Anollon / torche de corrrse srând 43604 * Héraclès / lion srand+moven A43t-434 rx.125 À. Héraclès / centaure srild A4t7 YIII.2?6 Persée / ethnioue dans courorme srand 4187-388A rx47 ^ Poséidon / massue dans couronne erand 4377-380.382 rx. t-28 x Sfnrmon / rlarrnhin danq cnrrronne moven Aq3-q6 VIII.M-259 Â Tête ianifonne I 2 cnttaures très srand A4t9 x, 15
10 + Zeus / taureau erud A4r]/9-4tt x. 11
11 o Artérnis / ? hnrrcq srànd A38r.399-402A IX.912 ET Artémis / taureau comuoète srand 4418 x.8L3 o Zeus / proue erand 4389-394 IX. 16
14 + Poséidon / cheval moven A4L3-4r5 IX.1415 .î:a! Anollon / éni Detit A.435-//;0 Ix.5L6 Artémis I tarrea,u sâlonant moYen ê'420-423 rx. tl17 I Ashênz lilole moven 44/.5-4,r'.'7 [X.2218 tr Zeus I au.sle môven+nefil 4442-44 + 50-51 x. 18
L,ALLIAGE DES MoNNAIES DE BRONZE
Fig. 4. - Tableau II : les types d'Amphipolis.
3Wo
2s%
2ÿ%
t5%
tw
5%
o%
+xx
oa
a
O:E
ooo^o*. o
15% Sn 2wo
6Type IoType2o Type 3
x Type 4::l Type 5
-Type 6
tTypeTI Type 8
:4Type9+ Typeo Type 1l:.çType 12
o Type 13.i2,Type 14
* Type 15
+ Type 16
tType 17
oType 18
205
Fig. 5. - Tableau III : distribution du plomb et de l'étain dans les bronzes d'Amphipolis.
r
206 MARIA GUERRA, OLIVIER PICARD
1" phase (393-375)
2" phase (375-360)
Émissions particulières
100 95 90 85 E0
%Cu
Fig. 6. - Tableau IV : schéma ternaire de la composition des bronzes de Thasos (390-360).
t2%
lü/o
8o/o
60/o
4o/o
2o/o
U/o
ox*
r\
o','",'7\l
7\t7\t
\/\t\,r\7
t ,' tt
\,\t,,
,' t*
ftr ,' !tta
,' tt
,'
/\t7\t
1\//\t
/\t/ \ tl
\l\7
.Fig. 7. - Tâbleau V : distribution du plomb et de l'étain dans les trioboles de bronze de Maronée.