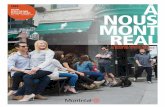Histoire du mot «démocratie» au Canada et au Québec. Analyse politique des stratégies rhétoriques
La démocratie difficile à l'ère des masses. Lettres d'Hubert Lagardelle à Robert Michels...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La démocratie difficile à l'ère des masses. Lettres d'Hubert Lagardelle à Robert Michels...
Willy GianinazziHubert Lagardelle
La démocratie difficile à l'ère des masses. Lettres d'HubertLagardelle à Robert Michels (1903-1936)In: Mil neuf cent, N°17, 1999. pp. 103-148.
Citer ce document / Cite this document :
Gianinazzi Willy, Lagardelle Hubert. La démocratie difficile à l'ère des masses. Lettres d'Hubert Lagardelle à Robert Michels(1903-1936). In: Mil neuf cent, N°17, 1999. pp. 103-148.
doi : 10.3406/mcm.1999.1206
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mcm_1146-1225_1999_num_17_1_1206
La démocratie difficile
à Vère des masses
Lettres d'Hubert Lagardelle à Robert Michels
(1903-1936)
Willy Gianinazzi
Foules menaçantes et masses passives
L'époque fut inquiète. Quand bien même certains s'attardaient à peindre des foules chaotiques et criminelles qui renvoyaient davantage aux topoi fantasmatiques de Taine qu'aux mutations sociales en cours, c'est bien l'avènement des masses, c'est-à-dire des foules organisées prétendant défier le politique, qui apparut dès les années quatre-vingt du xixe siècle comme une donnée sociologique nouvelle dont la portée réclamait un examen attentif, sinon dépassionné. En perturbant les équilibres et les médiations politiques traditionnels, cette montée des agissements collectifs interrogeait le fond de la démocratie et appelait à en mieux définir les normes et les procédures. La France républicaine et l'Italie libéralo-monarchique, qui abritaient des mouvements ouvriers remuants et mal corsetés par un traitement social balbutiant, offrirent une matrice de choix, mais non exclusive, à la réflexion. Deux fronts se dessinèrent. Aux solutions de « gauche » des Durkheim, Bougie, Léon Bourgeois et autres sociologues optimistes qui préconisaient l'intégration en douceur, s'opposa une lignée conservatrice et pessimiste, au mieux libérale, qui, de Mosca à Pareto, de Le Bon à Ostrogorski, finissait par jeter une lumière sombre sur toute velléité de transformation sociale. Il était loisible d'enrôler dans ce dernier courant l'œuvre maîtresse de Robert Michels
103
sur l'oligarchie dans Les partis politiques. Opération justifiée quant aux réponses que l'auteur apportait aux problèmes soulevés (« L'histoire semble nous apprendre - résumait-il - qu'il n'est pas de mouvement populaire, quelque énergique et vigoureux qu'il soit, qui soit capable de provoquer dans l'organisme social du monde civilisé des transformations profondes et permanentes l »). Elle ne l'était point en revanche quant aux motivations qui aiguillonnèrent sa recherche et qui relevaient d'un tout autre univers culturel et politique. Michels fut un homme de gauche qui se résigna à ne trouver des solutions qu'à droite. Mais chacun sait combien les réponses dépendent de la façon de poser les questions. Voilà une bonne raison pour s'arrêter prioritairement sur ces dernières et sur leurs biais.
Les partis politiques, publiés en Allemagne à la fin de 1910, couronnaient quelques années de réflexion passées au contact avec le mouvement ouvrier de différents pays européens, principalement l'Allemagne et l'Italie. Il est certain que, pendant ces années formatrices, la pensée de Michels s'échafaudait à partir d'un point de vue interne au mouvement socialiste et avec en arrière-fond les traits spécifiques de l'Allemagne où la puissance de la classe ouvrière paraissait bridée par la rigidité de l'institution impériale. À l'origine de son parcours, une interrogation peu banale qui portait sur la teneur réelle des facultés d'émancipation sociale que célébrait le mouvement ouvrier, mais de façon souvent abstraite et apodictique.
Assurément, un souci qui n'avait rien de commun avec la psychologie des foules diffusée en France. Dans des circonstances particulières liées au souhait de voir traduite dans ce pays son œuvre majeure, Michels pouvait bien écrire à Gustave Le Bon, son éditeur: «J'ai simplement appliqué sur le terrain des partis politiques et [de] leur structure administrative et politique, les théories que vous avez établies de manière
1. R. Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen iiber die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, Leipzig, Klinkhardt, 1911, p. 377 (trad, fr., Les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties — 1914 —, Paris, Flammarion, 1971, p. 292). On sait que la version en français doit être utilisée avec précaution : elle est amplement écour- tée et simplifiée, quoique sans doute sur indication de l'auteur (voir l'invitation en ce sens du directeur de collection, Gustave Le Bon, dans une lettre adressée à Michels le 12 novembre 1912 —Archives Roberto Michels, Fondation Luigi Einaudi, Turin, ci-après ARM).
104
aussi lumineuse sur le terrain de la vie collective des foules 2 ». Reste que les préoccupations de départ chez ces deux auteurs n'en étaient pas moins opposées. Le Bon était taraudé par une obsession : comment enrégimenter des foules incontrôlables et menaçantes, versées à tous les excès. Alors que Michels plongeait dans la perplexité en raison de l'impression que les masses, bien qu'exploitées, étaient passives et incapables de prendre en main leur destin. Un constat qu'il partageait plutôt avec Ostrogorski qui, dans son registre à lui - comment faire marcher la démocratie ? -, posait exactement le même problème 3. La mollesse des syndicats allemands, la déconfiture en Italie de plusieurs grèves dites générales (entre 1906 et 1908) confirmaient Michels dans ce sentiment. Il était ainsi amené à faire fi du déterminisme simpliste et optimiste de ces marxistes pris au filet du « matérialisme économique » 4.
Groupes héroïques et guerriers
À l'instar de Georges Sorel et des syndicalistes révolutionnaires italiens tel Arturo Labriola, Michels accordait toute son importance au ressort psychologique à l'œuvre dans les relations sociales. Mais alors que les premiers en faisaient un ingrédient essentiel des facteurs propices aux mouvements sociaux, Michels le voyait à l'inverse comme un frein permanent. Pour lui, le salut dépendait plutôt d'idées qui résumaient
2. Lettre de R. Michels à G. Le Bon du 23 novembre 1911, citée par Serge Moscovici, L'Âge des foules. Un traité historique de psychologie des masses, nouv. éd., Bruxelles, Complexe, 1985, p. 84.
3. « Aussi le premier problème qui se pose dans la pratique démocratique est-il celui-ci: comment organiser l'action politique de manière à développer l'action spontanée et régulière, à stimuler les énergies individuelles et à ne pas les laisser s'endormir ? » (Moisei Ostrogorski, La démocratie et les partis politiques - 1903 —, Paris, Fayard, 1993, p. 664). Le constat étant que « la grande masse est naturellement passive» (ibid. p. 661). Il est étonnant que dans la première édition allemande de son livre Michels ne prêtait guère attention à Ostrogorski qu'il ne citait qu'une seule fois et pour l'incorporer aux anarchistes négateurs des partis (op. cit. , p. 348, trad, fr., p. 266) !
4. Notons au passage que le même type de problématique désenchantée informera plus tard le freudo-marxisme de Wilhelm Reich, Erich Fromm et Herbert Marcuse, aux prises avec les masses amorphes, pis, autoasservies du nazisme, et celles pacifiées de nos sociétés occidentales du conformisme et de la consommation.
105
le socialisme : les élites intellectuelles auraient sans doute su les préserver et, par une patiente pédagogie auprès des masses, su les transformer en conscience de classe. Un souhait qui ne pouvait réduire son pessimisme foncier. Celui-ci n'avait pas d'égal, pas même chez Sorel travaillé par l'idée de décadence, mais apologiste de la vitalité populaire. C'est parce qu'il admettait que « les tendances les plus naturelles des classes ouvrières » les portaient au renoncement, appelé ici « le réformisme », que Sorel louait avec d'autant plus de force les « groupes prolétaires » traversés par l'héroïsme et l'esprit guerrier5. Et c'est bien cette considération qu'Edouard Berth opposait à la vision michelsienne de masses privées de l'intelligence socialiste 6. Cette façon de voir avait chez Michels son lot de conséquences.
Michels et le syndicalisme révolutionnaire. Une adhésion affective
En contact avec Gaetano Mosca depuis 1907, grâce à l'aide duquel il obtint la libéra docenza à l'université de Turin, Michels finit par acquiescer, dans un chapitre de son ouvrage célèbre, à la théorie de la « classe politique », dont il qualifiait pourtant l'auteur de «théoricien conservateur»7. Alors que trois ans auparavant, la version primitive de ce chapitre publiée sous forme d'article en Italie invoquait le marxisme comme antidote et annonçait une réfutation prochaine 8. À cette époque -je l'ai dit - le cœur de Michels battait encore du côté d'une émancipation possible. Cependant l'appel au marxisme ne donna pas lieu à démonstration et la réfutation fut renvoyée aux calendes grecques. L'épisode aurait été anodin s'il avait été isolé. Pour être au contraire fréquente en cette
5. Voir par exemple la lettre de Sorel à Marcel Dalbertoz du 8 septembre 1908 in Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Michel Prat (éd.), Paris, Éd. du Seuil, 1990, p. 318-319.
6. Voir Edouard Berth, « Revue critique. Prolétariat et bourgeoisie dans le mouvement socialiste », le Mouvement socialiste, 179, octobre 1906, p. 164-170.
7. R.Michels, op. cit., p. 362-381 (l'expression est à la p. 369), trad, fr., p. 279-293 (l'on parle ici, p. 279, de « courant conservateur » auquel Mosca appartient).
8. R. Michels, « L'oligarchia organica costituzionale. Nuovi studi sulla classe politica », la Riforma sociale, 12, décembre 1907, p. 961- 983.
106
phase d'incertitude du Michels à la fois sociologue et socialiste, cette rhétorique incantatoire révèle une forme d'esprit qui mérite d'être signalée 9. Un seul exemple des formules employées en conclusion de ses articles suffira à donner la mesure de ce qu'il tenait autant pour un argument décisif que pour une clause de style en forme de « chute » : « Le jour viendra où ces militants s'apercevront des erreurs de la social- démocratie : ce jour-là verra le réveil glorieux du socialisme allemand 10 ». Alors qu'il cumulait froidement les démonstrations des lourdeurs qui affectaient les organisations ouvrières, son adhésion au mouvement ouvrier reposait sur l'espoir qu'en dernier ressort la victoire aurait appartenu aux bons sentiments. À la face du sociologue démystificateur s'opposait chez Michels l'autre face du militant fidéiste marqué par un fond intellectualiste emprunté à la tradition illuministe. On voit bien que le pot de fer du savant aurait facilement brisé le pot de terre du socialiste. Mais c'est une histoire ultérieure. À cette histoire appartiennent d'ailleurs le rapprochement de Michels avec Max Weber et l'insistance précoce (1910) du premier sur le rôle fatal du chef : le volontarisme de Michels pouvait trouver là un débouché.
La posture sus-décrite peut aider à comprendre que Michels fut réceptif à tel ou tel courant socialiste en formation, dès lors qu'il se distingua par sa vigueur idéale ou morale. Cela posé, l'on peut se demander si Michels fut ou non un partisan du syndicalisme révolutionnaire ll.
De cœur, il le fut assurément car, à son avis, le syndicalisme révolutionnaire et ses dirigeants étaient, en Italie et en France, l'expression la plus brillante et prometteuse du socialisme marxiste. Sur un plan doctrinal, les choses étaient beaucoup plus floues. Avant tout parce que Michels avait en point de mire le cas spécial de l'Allemagne : comment aurait-il pu accorder une valeur absolue à la primauté du syndicat sur le
9. Elle est repérée dans la structure argumentative de plusieurs articles de Michels de la période par Pino Ferraris, Saggi su Roberto Michels, s.l., Jovene Ed., 1993, p. 109, 131, 133 (un livre qui m'a été précieux).
10. R. Michels, « Le socialisme allemand après Mannheim », le Mouvement socialiste, 182, janvier 1907, p. 22.
11. Le débat avait été lancé à la suite des doutes émis par Pino Ferraris dans ses études des années quatre-vingt (maintenant réunies in Saggi su Roberto Michels, op. cit.).
107
parti dès l'instant où les syndicats allemands faisaient figure de bastions conservateurs ? Un regard international l'amenait ainsi à moduler l'hypothèse syndicaliste en fonction des situations nationales : de ce point de vue, il n'y avait donc pas « un mais des syndicalismes révolutionnaires 12 » ; il est vrai que Sorel n'avait pas d'autre approche 13. Et aussi sur une foule d'autres thèmes - comme le préalable de la république, la démocratie, le parlement et les élections, la violence, la place des intellectuels - les divergences avec l'un ou l'autre défenseur du syndicalisme révolutionnaire ne manquèrent pas. Inutile cependant de se lancer dans de subtils et interminables distinguo car la question a bien des chances d'être mal posée d'emblée. Elle présuppose en effet comme aune de comparaison un corpus défini et achevé de la théorie syndicaliste révolutionnaire. Or il s'agit d'un stéréotype qui vole en éclat lorsque l'on fait état de ce que fut réellement la nébuleuse doctrinale du mouvement.
Quoiqu'une unité d'inspiration puisse être dégagée, c'est surtout l'extrême variété des positions syndicalistes qui frappe en effet les observateurs. Les quelques grands principes n'excluant pas dans le détail des aménagements qui étaient moins des tâtonnements que l'expression de la volonté de coller au plus près à une réalité forcément plus prosaïque. Préservée des cristallisations idéologiques qui marqueront le mouvement ouvrier de Г après-Grande Guerre, la mouvance reflétait dans la pluralité des cheminements de pensée une situation sociale et institutionnelle hétérogène. Sans carcan organisationnel propre, elle avait même le don de l'ubiquité institutionnelle : intellectuels organisés - plus nombreux que les esprits indépendants type Sorel - et militants ouvriers se partageaient la plupart du temps entre parti socialiste et syndicats. Situation curieuse au premier abord. Fâcheuse sans doute aux yeux de Sorel, qui se morfondait à voir son ami Lagardelle se démener à perte dans les coulisses et sur les estrades des congrès socialistes. Mais on sait qu'à l'époque, dans un souci pratique toujours présent, le mouvement syndical lui-même, y compris dans son expression syndicaliste, ne fut pas réfractaire à tout contact avec le socialisme politique - avec qui il lui arriva de
12. Jean-Luc Pouthier, « Roberto Michels et les syndicalistes révolutionnaires français », Cahiers Georges Sorel, 4, 1986, p. 50.
13. Cf. Georges Sorel, « Le syndicalisme révolutionnaire », le Mouvement socialiste, 166-167, 1-15 novembre 1905, p. 280.
108
partager localement le personnel ! -, quitte à rappeler haut et fort les principes de l'autonomie 14.
C'est ainsi que les prises de position de Michels, quelles que fussent les polémiques qu'elles déclenchaient, ne choquaient pas plus que d'autres états d'âmes qui s'exprimaient dans les revues syndicalistes françaises et encore plus italiennes. Qu'il suffise de noter, à titre d'exemple, que l'affection de Michels pour le parti en tant que dépositaire de la conscience, ainsi que sa sympathie initiale pour Kautsky furent des sentiments qui, pour être contestés, ne furent pas rares chez les syndicalistes révolutionnaires français et italiens.
Hubert Lagardelle, fondateur de la « nouvelle école »
Et pourtant le dessein de charpenter une pensée syndicaliste révolutionnaire exista bel et bien. Des jalons furent posés petit à petit de 1903 à 1906. La paternité en revenait au groupe du Mouvement socialiste et spécialement à ses trois principaux rédacteurs : Hubert Lagardelle, Edouard Berth, puis Georges Sorel 15. En Italie, Arturo Labriola et sa feuille milanaise Avan- guardia socialista s'y attelèrent ď arrache-pied sans attendre la première grande grève nationale qui vint à point nommé en septembre 1904 ; alors qu' Enrico Leone devint en 1905 le conférencier attitré aux formules bien carrées. Mais en cette affaire il semble bien que Lagardelle s'arrogea le premier rôle.
Sans ressasser la vulgate guesdiste, dès 1903 il entreprit de réintroduire le marxisme en France par la gauchisation du révisionnisme bernsteinien. Ce dernier était incontournable : tout théoricien marxiste revenu du dogme catastrophiste n'avait-il pas salué en son temps cette volonté, qui fut celle en premier de Bernstein, d'asseoir le mouvement ouvrier dans toute la richesse des pratiques vouées à le sortir de sa mino-
14. Voir Jacques Julliard, « Indépendance réciproque et concurrence : le syndicalisme français et la politique d'action directe (1900-1914) », in là., Autonomie ouvrière. Études sur le syndicalisme d'action directe, s.L, Éd. du Seuil-Gallimard, 1988, p. 199-219.
15. Pour une mise en perspective de leur pensée en cette phase, voir Marco Gervasoni, Georges Sorel, una biografiq intellettuale. Socialismo e libéralisme nella Francia délia Belle Époque, Milan, Unicopli, 1997, p. 210-244, 263-290.
109
rite, qu'elle fût politique ou sociale ? C'était vrai pour Sorel, mais aussi pour les révisionnistes italiens comme Labriola et Leone. Seul Antonio Labriola, séduit un moment par les thèses de Bernstein, avait choisi de se désolidariser. Depuis, le volet de la participation aux institutions politiques avait toutefois montré ses limites. En invoquant un Marx érigé en champion des syndicats, Lagardelle en appelait au « révisionnisme révolutionnaire ». Dans cette optique et en prolongement d'une attention de vieille date pour les associations ouvrières, il jugea pouvoir se prévaloir du Sorel prophète de «l'avenir syndical du socialisme». L'idée d'autonomie ouvrière, qui avait imprégné le syndicalisme d'action directe de l'anarchiste Fernand Pelloutier mais aussi le corporatisme d'Auguste Keufer, toujours à la tête du Livre, fut infléchie dans le sens de la rupture. À l'action directe, au « socialisme ouvrier », Lagardelle accola une définition plus tranchée : c'est dans sa bouche qu'au lendemain du congrès cégétiste de Bourges, le syndicalisme révolutionnaire - c'est-à-dire à tendance révolutionnaire qui allait en s 'affermissant par l'union des « ouvriers de tradition anarchiste et de ceux d'origine socialiste révolutionnaire » - devint de mot adjective mot composé 16. Sa qualification idéale devint l'attribut même du syndicat. Désormais, l'appellation aurait moins recouvert un mouvement qu'une orientation, une manière de voir, un esprit ; à savoir, le refus des idéologies extérieures aux pratiques ouvrières et l'affirmation de l'autonomie et des buts derniers de celles-ci. Pour se donner une légitimité symbolique et gagner en résonance, il semblait que cette sécession devait être dite, quitte à engendrer la contradiction entre les « producteurs de mots », les intellectuels, et les producteurs tout court. « Ce qui caractérise le syndicalisme français », risquait dès lors Lagardelle dans une lettre à Michels, c'est « la partie théorique » 17. Audacieux raccourci ! En parlant eux- mêmes de « nouvelle école », Lagardelle, Berth et Sorel se rendaient-ils compte qu'ils appuyaient le trait ?
On aurait tort toutefois de scinder trop brutalement les « penseurs » du Mouvement socialiste d'avec les troupes de la CGT. Si Sorel ne croyait pas nécessaire de visiter les locaux
16. H. Lagardelle, « Le congrès de Bourges et le socialisme ouvrier », le Mouvement socialiste, 142, 1er novembre 1904, p. 29-30.
17. Lettre du 16 juillet 1906, ci-après.
110
de la CGT 18, c'est sans doute par respect des rôles de chacun, mais c'est sans doute aussi parce que ses amis et vraisemblablement lui-même (dans des formes qui restent mal connues 19) cultivaient déjà des liens avec les animateurs de la CGT 20.
En tout état de cause, l'accentuation de l'appel à l'action directe dans le sens de la secessio plebis, était en phase, en ces premières années du siècle, avec une évolution et sociale et politique.
Les transformations techniques et l'essor des nouvelles industries déqualifièrent ou disciplinèrent dans un cadre d'usine, d'une part, des ouvriers jusque-là imbus de leur métier et attirèrent, d'autre part, une masse flottante d'ouvriers spécialisés, peu habitués à la discipline d'usine et qui subissaient de plus en plus l'emprise du patron via la maîtrise. La demande d'autonomie unissait en conséquence les ouvriers qualifiés, amoindris dans leur savoir polyvalent et frustrés de la liberté qui en découlait, et les ouvriers spécialisés qui se pliaient mal à la soumission 21.
Sur un plan politique, la période enregistrait une offensive, débutée avec Millerand et poursuivie rondement par Clemen-
18. D'après Cornelissen dans des souvenirs reproduits partiellement in Homme Wedman, «Christian Cornelissen (1864-1942). Appunti per una biografia », Rivista storica dell'anarchismo, 1, janvier-juin 1996, p. 43.
19. Sorel, par exemple, eut aussi des rapports personnels avec des militants à la base dont il ne manquait pas de s'enquérir du sort matériel, tel Taboulot (alias Gabriel Beaubois), postier révoqué lors de la grève de 1909.
20. Voir Shlomo Sand, L'illusion du politique. Georges Sorel et le débat intellectuel 1900, Paris, La Découverte, 1985, p. 12-14.
21. Pour l'identité de classe du syndicalisme révolutionnaire, en France et ailleurs, qui, contrairement à une idée reçue, fut loin d'être l'apanage d'ouvriers professionnels, voir les actes du colloque pionnier de Piombino de 1974 (in Ricerche storiche, 1, janvier-juin 1975) et Marcel van den Linden, Wayne Thorpe, « Essor et déclin du syndicalisme révolutionnaire », le Mouvement social, avril-juin 1992, p. 3-36. Ces derniers auteurs, cependant, tordent le bâton dans l'autre sens en omettant de considérer, par exemple, que le mouvement se prévalut de maints organisateurs professionnels issus des gens de métiers (Griffuelhes en tête ; voir Bruce Vandervort, « Nouvelles perspectives sur Victor Griffuelhes », le Mouvement social, juillet-septembre 1995, p. 51-62). Ce qui ne devait pas être indifférent dans la formation de l'imaginaire syndicaliste. Témoignaient de cette ambivalence l'attrait pour l'ouvrage « bien fait » et les formes de désaffection extrêmes du travail telles que le sabotage.
111
ceau et Briand, pour amener la classe ouvrière, avec l'aval des socialistes, à accepter un système de médiation sociale et lui ôter, par la force si nécessaire - et ce le fut -, toute marge d'initiative conflictuelle ou autonome. Mais pour la masse des travailleurs, rompus à un turn over de plus en plus serré, voire à une persistante fluctuation saisonnière des tâches, et étrangers à cette mémoire de classe qui permet de concevoir un avenir collectif, la grève condensait un imaginaire de lutte qui se suffisait à lui-même : il paraissait normal que les conflits fussent tranchés par les intéressés sur le champ et non pas par la médiation extérieure ou par le renvoi à des conventions futures au contrôle malaisé.
Du côté de l'autonomie existentielle, il y aurait d'ailleurs une autre piste de recherche à explorer 22. La fréquence du travail intermittent - due autant à la discipline accrue qu'à un marché du travail abondant - ne révélerait-elle pas une résurgence du réflexe pré-industriel (aujourd'hui de retour !) de limitation du travail aux besoins éprouvés ?
En 1904 Lagardelle livra sa bataille en cherchant à renouveler les contacts internationaux qu'il avait déjà soigneusement tissés autour de sa revue. Le coup de barre à gauche n'exclut pas au départ la possibilité d'un accord, au moins tactique, avec les socialistes révolutionnaires. Sans donc écarter Karl Kautsky, avec qui il avait noué des relations amicales depuis leur rencontre à Berlin en 1898. Déjà collaborateur du Mouvement socialiste, Kautsky joua le jeu, tout comme il le fit avec les Italiens de YAvanguardia socialista, jusqu'à ce que les divergences se décantassent. Le processus arrivait à son terme lorsque le 16 décembre 1904, le théoricien social-démocrate écrivit encore à Jean Longuet, rédacteur de la Vie socialiste, pour lui préciser qu'il réservait en priorité ses articles au Mouvement socialiste 23. C'est à peu près à ce moment-là que la correspondance (connue) entre Lagardelle et Kautsky prit fin 24 et que le premier
22. Suggérée par Jacques Julliard, Le génie de la liberté, Paris, Éd. du Seuil, 1990, p. 166, et par André Gorz, « L'écologie politique entre expertocratie et autolimitation », Actuel Marx, 12, 2e sem. 1992, p. 25.
23. Lettre mentionnée par Gilles Candar, Jean Longuet (1876- 1938). SFIO et Deuxième Internationale, Saint-Denis, Université de Paris VIII, 1995 (thèse), p. 62.
24. Voir infra, p. 123, note 9.
112
estima désormais qu'« il y a un très beau courant international à créer sur le terrain syndicaliste révolutionnaire 25 ».
Quant à Robert Michels, de son propre aveu alors plutôt proche de Kautsky 26 et ayant débuté à la mi- 1903 sa collaboration à Г ' Avanguardia socialista, il n'excluait pas à la même période d'écrire pour la revue de Lagardelle 27. Comme en témoigne le petit billet qui ouvre la correspondance publiée ci- après, lors de sa venue en France à l'automne il n'eut pas seulement des contacts avec Paul Lafargue, Edouard Vaillant et autres pointures du Parti socialiste de France, mais aussi sans doute avec Lagardelle. Un autre document atteste que seul vraisemblablement un contretemps - un énième problème de santé de Lagardelle - l'empêcha d'inaugurer dès juin 1904 sa collaboration au Mouvement socialiste 28. Celle-ci, débutée à la fin de 1904, ne cessa qu'en 1913 29. Pendant toutes ces années, Michels fit montre d'esprit d'indépendance ; d'autant plus grand qu'à partir de 1908, il abandonna progressivement son engagement politique. Il eut à faire front aux objections des syndicalistes, mais pour peu que « l'on puisse être l'ami de quelqu'un et néanmoins le critiquer30», son amitié pour Lagardelle ne faillit jamais. Les lettres que lui adressa celui-ci prouvent la réciproque.
25. Lettre à Michels du 17 octobre 1904, ci-après. 26. Voir sa lettre à Augustin Hamon du 5 août 1903, in Corrado
Malandrino (éd.), «Lettere di Robert Michels e di Augustin Hamon », in Annali délia Fondazione Luigi Einaudi, 1989, p. 520.
27. Comme le sous-entendait une lettre d'Eugène Fournière à Michels du 29 juillet 1903 (ARM, mentionnée par M. Gervasoni, op. cit., p. 236).
28. Voir la lettre de Michels à Luigi Einaudi du 1er juillet 1904, in R. Michels, Potere e oligarchie, Ettore Albertoni (éd.), Milan, Giuf- frè, 1989, p. 54-55. Ce document, faisant état d'une lettre de Lagardelle à Michels, prouve que la correspondance publiée ci-après n'est pas complète.
29. Une anthologie existe : R. Michels, Critique du socialisme. Contribution aux débats du début du XXe siècle, Pierre Cours-Salies et Jean-Marie Vincent (eds.), Paris, Kimé, 1992 (édition incomplète, peu maniable — privée de la table des matières foliotées — et par endroits illisible).
30. R. Michels, Revue socialiste, 338, février 1913, p. 192 (à propos d'une recension de Michels d'un ouvrage de Lagardelle, au demeurant fort critique. Cf. infra, p. 141, note 62).
113
Coterie et oligarchie. Ostrogorski plutôt que Michels
Michels fut moins le contempteur des partis que celui qui mit le doigt sur leur processus interne de bureaucratisation et de hiérarchisation. La « nouvelle école » alla plus loin en formulant une critique fonctionnelle du parti politique 31. Sorel, qui reprenait volontiers Ostrogorski, se faisait l'écho de la tradition libérale-conservatrice du xixe siècle - inspirée elle-même par le spectacle de la Révolution - pour interpréter le parti comme le lieu séditieux de la faction, aveuglée par ses intérêts de groupe et de personne. Tout parti au pouvoir profitait de la légitimité que lui attribuait, via le suffrage universel, le mythe de la volonté générale pour exercer la mainmise sur la société ; les partis populaires, chantres du mythe version souveraineté populaire, prétendant être les mieux armés pour accomplir cette tâche qu'ils voyaient comme philanthropique. Il est significatif que la réticence de Sorel, tout comme celle de Lagardelle, à l'égard de la proportionnelle tenait à la crainte de voir renforcé l'esprit de corps des coteries.
Les syndicalistes furent tout de même gênés aux entournures par la loi michelsienne de l'oligarchie que son auteur étendait à toute organisation, y compris syndicale, du moment où le principe de la représentation y était pratiqué. Berth nia le problème ; Lagardelle reconnut l'inconvénient, mais il s'attacha à le minimiser32. Pour le syndicalisme révolutionnaire, en effet, il était plus important de souligner le dynamisme social qu'incarnaient les associations ouvrières, écoles irremplaçables de gestion, de libération morale et de solidarité entre pairs. Quitte à admettre que des pressions extérieures pussent venir troubler l'harmonie par l'introjection des méthodes centralisatrices et directives dénoncées par Michels : ce fut précisément l'analyse que Sorel fit de ce qui lui apparaissait comme la dérive politicienne et jacobine de la CGT après 1908 33. En tous cas, c'est bien sur le seul terrain de l'expérimentation économique, en toute indépendance de l'État et de ses tentacules politiques, que pouvaient prendre
31. Voir Marco Gervasoni, «Integrita della societa e macchina politica : Georges Sorel, la "nouvelle école" e il partito politico », Ricerche di storia politica, 2, 1998, p. 171-197.
32. Voir É. Berth, art. cit., et la lettre du 15 mars 1911, ci-après. 33. Voir Georges Sorel, « I dolori dell'ora présente », il Divenire
sociale, 18-19, 16 septembre- 1er octobre 1909, p. 236-240.
114
corps les institutions ouvrières fédérées qui annonçaient le socialisme.
Quelle place revenait dès lors au mouvement ouvrier dans son rapport à la démocratie ?
Lagardelle et les pièges de la démocratie
Après la guerre, Sorel et Berth devinrent, à leur façon, des sympathisants du bolchevisme. Michels et Lagardelle des partisans déclarés du fascisme. Choquera-t-on les historiens rivés à des généalogies idéales convenues en constatant qu'avant la guerre, les deux derniers furent sans conteste plus conciliants envers la démocratie que les deux premiers ? Réservons la solution de l'énigme pour la suite.
Des syndicalistes révolutionnaires français, ce fut Lagardelle qui martela avec le plus de persévérance le thème de la démocratie. Jusqu'en 1910, sans solution de continuité34. Mais Lagardelle ne fut guère original : on y reconnaîtra aisément l'inspiration de Sorel. Précisément le Sorel de 1899-1901 qui s'illusionna un instant sur les vertus possibles de la démocratie. Sans confondre ni les procédures institutionnelles ni les pratiques politiques avec l'esprit de la démocratie, c'est bien ce dernier, par l'ouverture à la liberté que permettait son formalisme juridique, qui était jugé hautement profitable au mouvement ouvrier. Il consentait au déploiement des antagonismes sociaux, à la critique permanente et à la défense des libertés individuelles. Tout au moins dans les limites assignées par la volonté étatique de concilier les conflits de classes avec le régime capitaliste. Ainsi, synthétisait Lagardelle, « on peut dire, en modifiant légèrement une formule déjà donnée [par Sorel en 1899], que le socialisme ne peut être autre chose qu'un mouvement ouvrier révolutionnaire dans une démocratie 35 ». En toute autonomie.
Tandis que Sorel - en désaccord avec son ami dès 1908 - imputait à la démocratie la responsabilité d'avoir amadoué le mouvement syndical et ne cessait de déplorer la déchéance des mœurs qui en découlait, Lagardelle, pas moins déçu par la
34. Cf. le recueil d'articles réunis à la fin de 1910 : H. Lagardelle, Le socialisme ouvrier, Paris, Rivière, 1911.
35. H. Lagardelle, « Action de parti et action de classe », le Mouvement socialiste, 149, 15 février 1905, p. 285.
115
tournure des événements, s'orientait vers un autre chemin. En 1911, les accointances anti-démocratiques de Sorel avec des gens d'Action française le poussèrent à insister sur son attachement critique à la démocratie. En 1912 toutefois, en des termes nouveaux (c'est alors, d'ailleurs, qu'il commença à collaborer à l'Humanité). Comme Sorel au demeurant, Lagar- delle pensait que le régime démocratique était irréversible en dépit de sa décadence. Mais ce qui était vécu généralement comme une crise de l'État était, à son sens, une évolution libérale du pouvoir étatique qui était grosse de nouveaux équilibres entre celui-ci et des entités soit décentralisées en son sein soit démultipliées au niveau du tissu social et économique : administrations et pouvoirs régionaux aux compétences accrues et, en lutte ou en rivalité avec l'État, des groupes, nouveaux ou anciens, tels les syndicats soit ouvriers soit patronaux, les chambres de commerce, les ligues à but ponctuel ou limité 36. Pour infléchir à notre tour la formule citée, Lagardelle portait désormais l'accent sur les groupes qu'il ne concevait plus que dans la démocratie. En osmose, quitte à la combattre.
La voie était tracée. Revenu en 1915 sur ses terres du Sud- Ouest toulousain où il se transforma en exploitant arboricole, il accepta des missions officielles de coordination économique de sa région. Pendant les années vingt, son engagement régio- naliste aux côtés des chambres de commerce le fortifia dans l'idée que les groupes intermédiaires entre État et individus avaient leur rôle à jouer dans la dynamique sociale, tandis que toute référence à la lutte de classes était mise sous le boisseau. La prise de contact, dans la décennie suivante, avec Georges Valois et avec la nouvelle génération non conformiste, dont il faisait office de père spirituel exactement comme Sorel l'avait été pour sa génération, l'incita à reproposer son syndicalisme. Dans la revue Plans qu'il co-fonda en 1931, il était désormais question de la démocratie individualiste qui écrase l'individu et du groupe qui le libère. Le syndicalisme, qui incarne le groupe des producteurs, pouvait être autant le fait du prolétariat que l'adoption par la société d'un principe nouveau. Une
36. H. Lagardelle, « La démocratie en France », le Mouvement socialiste, 246, décembre 1912, p. 321-332, et 247-248, janvier- février 1913, p. 13-29.
116
invite, en somme, à Г «ardeur constructive» pour préparer l'économie nouvelle 37.
On sait que Lagardelle fut de 1933 à 1940 chargé de mission à l'ambassade de Rome. La correspondance avec Michels révèle que c'est bien celui-ci qui, en 1932, joua les intermédiaires pour que Lagardelle assiste au congrès de Rome sur les problèmes internationaux et les questions sociales. Les renseignements que le Français rapporta enthousiaste de ce voyage, effectué pour le compte du ministre de l'Éducation, son ami Anatole de Monzie, furent à l'origine de la proposition de mission que lui confia le nouvel ambassadeur Henri de Jouvenel, autre ami de longue date. Fort du prestige de ces années passées à villa Farnese, il fut appelé par Vichy en 1942 au ministère du Travail. Mais soupçonné de vouloir réintroduire des principes sociaux séditieux sous couvert de corporatisme, il fut écarté du pouvoir l'année suivante.
Y aurait-il donc chez Lagardelle une continuité idéale du syndicalisme à la Révolution nationale ? Ses biographes ne sont pas loin de le croire 38. Et il semble bien qu'on ne saurait repérer dans sa pensée des ruptures brutales comme l'on en trouve, par exemple, chez Gustave Hervé. Néanmoins, il faut observer que s'il peut y avoir chez Lagardelle une relative remanence du champ sémantique d'avant-guerre, notamment dans ses écrits des années trente, elle ne préserve aucunement des glissements de sens qui sont, en l'occurrence, d'autant plus considérables qu'ils s'inscrivent dans des contextes politiques et personnels très différents. Chez le Lagardelle désenchanté de 1912-1913, chez le propriétaire foncier mêlé aux
37. H. Lagardelle, «Au-delà de la démocratie», I. « De l'homme abstrait à l'homme réel», II. «L'homme réel et le syndicalisme», III. « La fin d'une culture», Plans, janvier, mars, mai 1931; Id., « Sources du syndicalisme », Plans, février 1932, cités par Marie- Christine Bouneau-Bouillare, H. Lagardelle, un bourgeois révolutionnaire et son époque (1874-1958), Bordeaux, Université de Bordeaux III, 1996 (thèse), p. 715-724. Sur la revue, voir aussi Sylvie Guillaume, «Plans et la révolution collective», in Gilbert Merlio (éd.), Ni gauche, ni droite : les chasses-croisés idéologiques des intellectuels français et allemands dans l'entre-deux-guerres, Talence, Éd. de la MSHA, 1995, p. 197-207.
38. Marion Dachary-de Fiers, Lagardelle et l'équipe du Mouvement socialiste, Paris, IEP, 1982 (thèse), p. 27, 280, et, plus nuancée, M.-Ch. Bouneau-Bouillare, op. cit., p. 728, 878-879. Pour une autre approche : Jeremy Jennings, Syndicalism in France : A Study of Ideas, Londres, MacMillan, 1990, p. 200-210.
117
chambres de commerce, chez le publicisté maître à penser du syndicalisme constructeur, chez le ministre pétainiste prêt à faire usage de l'État, il y a bel et bien dénaturation de l'esprit du syndicalisme révolutionnaire tel qu'il mûrit à ses meilleures heures au contact de la CGT ou tel qu'il perce à travers la pensée ouverte de Georges Sorel.
La séparation du syndicalisme et de l'État oubliée
Le syndicalisme révolutionnaire fut avant tout une conception du devenir social fondée sur la valorisation du conflit social en tant que lieu d'affirmation de la liberté ouvrière. Mouvement d'opposition à l'ordre économique, ce n'est que sur ce terrain qu'il s'était préparé à la lutte. Indépendant de l'État, du politique, il ne se posait ni en conquérant ni en réorganisateur du pouvoir central. La visée d'une révolution politique lui était étrangère. Quant aux valeurs de combat, d'éducation et de solidarité ouvrières, elles relevaient d'une socialite qui ne participe pas plus du politique : lorsque par un tour de force l'on prétend les y appliquer, elles se dénaturent et produisent des effets opposés. Mû par des minorités agissantes qui comptaient davantage sur la discipline et la haute moralité des troupes engagées que sur les principes de majorité et d'égalité que véhiculait de préférence le socialisme politique, ce syndicalisme revêt un caractère hiérarchique et autoritaire dès qu'il se place sur le plan de l'État. Piero Gobetti, un sorélien italien qui paya cher son anti-fascisme, disait tout cela très bien : « Le problème du mouvement ouvrier est un problème de liberté et non pas d'égalité sociale, la critique de l'État a une valeur dynamique et non pas de reconstruction 39 ».
C'est dans le quotidien des luttes et des expériences collectives que prenaient vie des embryons d'institutions ouvrières qui devaient préfigurer une réorganisation sociale de la production. Mais cela n'allait pas sans l'apparition d'un droit nouveau qui ne pouvait cependant se formaliser que sous l'effet de mœurs et d'une moralité nouvelles. Parce que fondé sur l'expérience vécue, ce droit annonçait une liberté qui semblait autrement substantielle que la liberté assurée par le cadre
39. Piero Gobetti, La révolution libérale (trad, par Marilène Raiola, postf. de Marco Gervasoni), Paris, Allia, 1999, p. 119, voir aussi p. 126.
118
bourgeois. Mais la question, quoique centrale pour Sorel40, était loin d'être réglée ou même approfondie. Comment le droit issu du conflit autour du travail aurait-il pu investir l'espace public ? Aujourd'hui que l'idée de l'autogestion pâlit au profit d'une aspiration à l'autonomie qui déborde la sphère du travail, on perçoit que la dimension communautaire développée par les associations ouvrières impliquait une démocratie close sur elle-même, un nombrilisme qui rendait impraticable l'hypothèse d'une société affranchie gérée par les seuls producteurs41.
Lagardelle eut un parcours intellectuel qui ne peut être séparé des déceptions politiques et des aléas professionnels de sa vie. Mais son jeu d'équilibre vis-à-vis de la démocratie l'amena au jeu périlleux de vouloir transposer les formes de son syndicalisme sur le terrain de la politique ; en privilégiant le groupe sur l'individu, il finit par céder à une vision holiste de la société, puis à l'engouement pour le corporatisme fasciste ; enfin, contrairement à ce critique libéral-conservateur de la démocratie que fut Sorel 42, il ne sut guère interroger les fondements de celle-ci dans une réflexion sur le droit et la liberté.
40. Voir Shlomo Sand, « Lutte de classes et conscience juridique dans la pensée de Georges Sorel », in Id., Jacques Julliard (eds.), G. Sorel en son temps, Paris, Éd. du Seuil, 1985, p. 225-245, et Patrice Rolland, « L'enjeu du droit », in Georges Sorel, Paris, L'Herne, 1986, p. 28-44.
41. Voir les réflexions sur l'autogestion de Jacques T. Godbout, « De l'autogestion à l'autonomie », Bulletin du Mauss, 25, mars 1988, p. 128-136, et, sur l'esprit communautaire, de Jean-Marie Vincent, « Liberté et socialite », in Alberto Burgio, Domenico Losurdo, Jacques Texier (eds.), Égalité / Inégalité, Naples, Quattro Venti, 1992, p. 245-256.
42. Voir Patrice Rolland, « Georges Sorel et la démocratie au XXe siècle », Mil neuf cent, 8, 1990, p. 123-154, et 9, 1991, p. 129-161.
119
Lettres d'Hubert Lagardelle à Robert Michels (1903-1936) *
[11 novembre 1903]
Hubert Lagardelle Docteur en Droit
Avocat à la Cour d'Appel Directeur du Mouvement Socialiste
Professeur au Collège Libre des Sciences Sociales
sera très heureux de recevoir M. Robert Michels et d'avoir des nouvelles du camarade Weill l. Il est chez lui tous les matins. M. Michels voudra bien le prévenir simplement des jours où il viendra le voir.
11 nov. 18, Avenue Reille (XIVe)
Paris, le 17 oct. 1904 30, avenue Reille
Cher Camarade, J'ai bien regretté que votre mot me soit parvenu trop tard :
d'abord parce que j'aurais accepté avec joie votre article ; ensuite parce que je n'aurais pas demandé un article, qui ne me satisfait nullement, à un autre camarade allemand 2.
La correspondance de Lagardelle (1874-1958) avec Michels (1876-1936) est conservée dans les Archives Roberto Michels de la Fondation Luigi Einaudi à Turin (ci-après ARM). L'adresse de destination n'est indiquée que lorsqu'elle est connue. Une police distincte signale les caractères imprimés (sur cartes de visite ou télégrammes). La typographie a été uniformisée selon le code en vigueur aujourd'hui.
1. Georges Weill (1882-1970), déjà collaborateur du Mouvement socialiste, traducteur des articles de Lagardelle dans die Neue Zeit, était alors à Strasbourg pour terminer ses études de sciences politiques ; il fréquentait les réunions que Lagardelle organisait chez lui avec ses amis syndicalistes révolutionnaires.
2. Probablement Raphael Friedeberg, qui avait participé à l'enquête du Mouvement socialiste sur « La grève générale et le socialisme » avec la transcription d'une conférence qui ne portait guère sur le sujet (voir le Mouvement socialiste, 15 août- 15 septembre 1904, p. 484-514).
120
Mais je vous demande de collaborer à notre œuvre. Labriola et Mocchi me disent que vous partagez, en gros, nos points de vue 3. Si vous voulez vous associer à notre mouvement de révisionnisme révolutionnaire je serais tout heureux. Il n'est pas facile, en Allemagne, de trouver des camarades étant parvenus à nos points de vue ! Cela tient, je le sais, à des conditions très spéciales de développement de la social-démocratie allemande.
Mais il faut avouer que, si le révisionnisme réformiste d'un Bernstein a eu pour lui beaucoup de logique et de netteté, la situation d'un Bebel est fausse, dangereuse et bien vieille. Le radicalisme politique n'est possible à tenir que dans les conditions pareilles aux vôtres : il se dissout dans la démocratie, comme cela a eu lieu en France et en Italie, comme cela aura lieu partout où se développera la démocratie pure.
C'est cela qu'il faut dire - partout et toujours. La social- démocratie allemande n'est unie qu'en apparence. Dès que vous aurez plus de liberté politique, ce sera la débâcle... réformiste. Les Sudekum et Cie 4, et autres saltimbanques, sont nombreux chez vous - tout autant que chez nous. La lutte sur le terrain exclusivement parlementaire aboutit à de telles conséquences inévitables. Seul un fort courant syndicaliste révolutionnaire peut sauver le socialisme. C'est sur ce terrain seul que se développe la conscience de classe, le sentiment de la lutte, de l'énergie, de la responsabilité, de la confiance en soi.
Il faut avoir le courage de dire la vérité sur votre parti. Jus- qu 'ici les camarades allemands ont parlé avec un saint respect et une mystérieuse angoisse de leur unité / Pourquoi cela, alors qu 'en fait il y a des germes profonds d'oppositions - comme partout à cette heure ? Je ne dis pas de ne pas être prudent en disant ces choses : mais il faut ne plus les cacher.
Il y a un très beau courant international à créer sur le terrain syndicaliste révolutionnaire. Voulez-vous y participer et être des nôtres ?
Un mot je vous prie ; mieux encore un article. Mes hommages à Madame Michels. Bien à vous,
Hubert Lagardelle
3.Arturo Labriola (1873-1959) et Walter Mocchi (1870-1955), dirigeants de l'aile révolutionnaire du parti socialiste italien. Michels, qui collaborait à leur journal Avanguardia socialista depuis juillet- 1903, les avait rencontrés au congrès socialiste de Bologne, en avril 1904.
4. Albert Sudekum (1871-1944), député social-démocrate au Reichstag.
121
Paris, le 23 oct. 1904 30, avenue Reille
Cher Camarade, Merci de votre mot, qui me montre que, d'une façon au moins
générale, nos vues concordent. Je ne jette pas l'enfant avec le bain, selon un proverbe allemand, et je ne suis pas antiparlementaire au point d'être purement et simplement un anarchiste anti-votard. Il se peut que Friedeberg ait été maladroit et que sa pensée ne soit pas suffisamment claire 5. Je ne partage pas tous ses points de vue. Mais il y a dit de rudes vérités !
Ce qu'à mon sens il faut faire, c'est dévoiler l'illusion parle- mentariste, réduire au second plan, ou au dixième, si vous voulez, V action parlementaire, qui n'est nullement, l'expérience le prouve, un terrain de culture pour les idées socialistes ! La lutte de classe ne peut pas se mener là. La conscience révolutionnaire ne peut pas se développer là. Songez à la France, tout autant qu 'à l'Allemagne ! Guesde, au Parlement, a fait ce qu'a fait Jaurès et Millerand ! Et Bebel et Vollmar se sont rencontrés, à Brème, pour protester ensemble contre les idées nouvelles, socialistes révolutionnaires 6 /
Le problème est de préciser le rapport d'un parti politique socialiste possible avec le syndicalisme révolutionnaire. Mais il ne peut être pleinement résolu que dans une démocratie, et nos points de vue, à nous, français ou même italiens, ne peuvent évidemment être exactement les vôtres. Mais nous causerons de tout cela !
Ne m'envoyez pas d'article sur le Congrès de Brème 7 - mais un article sur la situation socialiste en Allemagne, où vous exposeriez vos points de vue.
Donnez-moi, je vous prie, les adresses de tous les camarades allemands et autrichiens capables de s'intéresser à notre mouvement : je leur enverrai la Revue, et leur demanderai, à ceux du moins qui en sont capables, leur collaboration, II s 'agit de faire
5. R. Friedeberg [(1863-1940) médecin, défenseur d'un point de vue anarchisant au sein de la social-démocratie allemande, dont il sera exclu en 1907], art. cit. Dans cet article, il dévaluait le suffrage universel et le parlementarisme de la social-démocratie allemande.
6. Le congrès social-démocrate de Brème avait eu lieu en septembre 1904.
7. Lagardelle en parlera dans sa « Chronique politique et sociale » (le Mouvement socialiste, 142, 1er novembre 1904, p. 113-115) en s'ins- pirant notamment de R. Michels, « Un congresso funèbre », Avan- guardia socialista, 14 octobre 1904.
122
pénétrer nos idées partout. Je voudrais que le Mouvement socialiste fut l'organe du révisionnisme révolutionnaire.
Bien à vous. Bons souvenirs à Madame Michels,
Hubert Lagardelle
Paris, le 25 nov. 1904 30, avenue Reille
Mon cher Michels, J'ai fondu en français votre article, en le dénaturant le moins
possible 8. Je n 'ai en rien trahi ou corrigé, bien entendu, votre pensée ! Je me suis borné à des corrections de style et à un arrangement nécessaire.
Par une erreur de l'imprimeur, je n'ai pu vous adresser plus tôt les épreuves. Si vous admettez l'article tel quel, s'il n'y a pas de retouche grave à faire, je l'imprimerai tel quel. Au cas contraire — ce que je ne crois pas — vous me télégraphi[e]riez d'attendre ! Mais - pour ne pas nous retarder -je vous demande de [le] laisser comme il est. Je le trouve fort bien, et du plus haut intérêt.
Vous le verrez: en quelques endroits j'ai ajouté quelques mots complétant votre pensée - pour l'intelligence du public français. Mais je n'ai rien ajouté à votre pensée.
Je m'excuse de vous soumettre si tard les épreuves : cela n'arrivera plus !
Donc, si lundi je n'ai pas de télégramme me disant d'attendre, nous tirons la revue.
Kautsky m'accuse d'être antiparlementaire ! Où a-t-il vu ça ? C'est Laf argue qui a dû le lui écrire 9 / À bientôt.
Amitiés, Hubert Lagardelle
8. R. Michels, « Les dangers du Parti socialiste allemand » (daté d'octobre 1904), le Mouvement socialiste, 144, 1er décembre 1904, p. 193-212.
9. Le même jour Lagardelle écrivait à Kautsky : « Je crains que vous n'ayez été mal informé et influencé tant par les intrigues de Longuet que par les récriminations de Lafargue. Mais il n'est pas exact que je sois devenu anti-parlementaire, je poursuis seulement une évolution lointaine, vous le savez — qui me fait donner au parlementarisme la seconde place et au mouvement ouvrier révolutionnaire la première [...] La solution c'est d'aller vers le syndicalisme révolutionnaire» (voir la lettre in Archives Karl Kautsky, Institut international d'histoire sociale, Amsterdam, D XV 187. Il n'est peut-être pas fortuit que ce soit la dernière conservée entre Lagardelle et Kautsky).
123
Paris, le 28 mars 1905 Mon cher Michels,
J'ai reçu votre article et vous en remercie 10. C'est fort bien, et il était nécessaire de dire d'aussi salubres paroles.
J'espère que vous passerez par Paris. C'est utile pour que nous causions et que nous nous concertions pour mener le plus hardiment possible notre action internationale.
L'unité, en France, n'a que la valeur d'une alliance électorale : il s 'agit de se grouper pour arrêter la décadence des partis en présence et d'utiliser l'éloquence jaurésiste pour les élections générales de 1906. Tous ces frères ennemis oublient les âpres disputes d'hier et se coalisent tous... contre l'électeur !
Aussi l'unité se fera contre les tendances syndicalistes révolutionnaires, et, nous autres, nous passerons de mauvais quarts d'heure ! La lutte va devenir intéressante. Il s'en allait temps !
Nous créons un journal hebdomadaire n. Nous vous enverrons dans 2 ou 3 jours notre circulaire. Je compte sur vous pour être correspondant pour l'Allemagne. Ça ne vous engagera qu'à nous adresser de courtes notes de temps en temps. C'est surtout un acte de solidarité que nous vous demandons. Dites-moi aussi à qui nous pouvons demander de collaborer en Allemagne. Sont-ce les mêmes que vous m'avez indiqués pour le Mouvement socialiste ?
En Hollande, les partis sont horriblement divisés, et je ne pense pas que les socialistes soient disposés à venir vers nos tendances. Mme Roland-Holst a de très bonnes intentions, mais je ne pense pas qu'elle vienne entièrement jusqu'à nous 12.
Un « anarchiste » très peu « anarchiste » - mais surtout syndicaliste révolutionnaire - Cornelissen, qui vit à Paris, serait très intéressant pour vous à connaître, pour la Hollande 13. // mène d'ici la lutte contre l'anarchisme individualiste de Domela Nieu- wenhuis et est à la veille de l 'attaquer violemment u. Il ne sera à Amsterdam qu'à Pâques : c'est regrettable pour vous. Vous le verrez à Paris, si vous passez, comme je le pense.
10. R. Michels, « La grève générale des mineurs de la Ruhr », le Mouvement socialiste, 152, 1er avril 1905, p. 481-489.
11. L'Avant- garde, journal syndicaliste révolutionnaire créé en avril 1905 par Lagardelle et ses amis du Mouvement socialiste.
12. Henriette Roland-Holst (1869-1952), membre du parti ouvrier social-démocrate hollandais, dont elle représentait l'aile gauche.
13. Christian Cornelissen (1864-1942 ou 1943), syndicaliste et publicisté néerlandais, installé à Paris depuis 1898.
14. Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919).
124
Л Bruxelles, je vois peu de gens disposés à écouter nos idées ! Le socialisme belge est... bizarre. Je vous envoie un mot : 1) pour Octors, qui s 'occupe du mouvement syndical ; 2) pour Maes, secrétaire du parti, qui pourra vous être utile ; 3) pour un ami personnel, Vandermeeren, peu mêlé au parti mais qui vous donnera des renseignements vrais que les autres cacheront ; 4) pour Vander- velde, que vous connaissez et que je n 'ai pas à vous caractériser 15 ; 5) pour de Brouckère, qui a de bonnes intentions mais qui est... loin de nous 16 /
À Lille, centre du vieux guesdisme, nous sommes un peu... compromis. Voici un mot : 1) pour un ami personnel Dr. Verhaeghe, qui vous donnera des renseignements précieux; 2) pour Samson, secrétaire de la Coopérative L'Union, homme officiel du parti; 3) pour Delory, député, homme ultra-officiel ; 4) pour Ghesquière, rédacteur du Travailleur, journal du guesdisme dans le Nord - qui est furieusement opposé à nos tendances ll.
À Roubaix, vous pourrez voir : 1) Wattremez [sic], bon gues- diste 18, 2) un correspondant dépositaire du Mouvement, dont je vous enverrai l'adresse.
Je veux faire un article sur « Les nouvelles tendances révolutionnaires dans le Socialisme International ». Pouvez-vous m 'indiquer - en dehors de vos articles du Mouvement - si vous avez écrit autre chose dans ce sens et ой : envoyez-moi quelques citations. De plus, en Allemagne, voyez-vous possibilité de signaler quelques déclarations, écrits, etc. de camarades dans nos tendances, - et où ?
Bien à vous,
Hubert Lagardelle
15. Ce mot destiné à Emile Vandervelde (1866-1938), dirigeant du parti ouvrier belge, est conservé dans les archives de Michels, ce qui laisse supposer que celui-ci n'eut pas besoin d'en faire usage (cf. ARM).
16. Georges Maes mis à part, Alphonse Octors, G. Vandermeeren, Vandervelde et Louis de Brouckère (1870-1951) avaient été ou étaient des collaborateurs du Mouvement socialiste.
17. Désiré Verhaeghe (1874-1927), médecin, son épouse était d'origine biélo-russe et certainement en relation avec l'épouse de Lagardelle; Henri Samson (1864-1925); Gustave Delory (1857- 1925), déjà maire de Lille, député depuis 1902 ; Henri Ghesquière (1863-1918), tous guesdistes et anciens collaborateurs du Mouvement socialiste.
18. Henri Watremez (1872-1934).
125
6
[Adressée à Barfussertor 30, Marburg, Hesse] [12 juin 1905]
Monsieur et Madame Hubert Lagardelle ont le plaisir de vous faire part de la naissance de leur fils Pierre.
Paris, le 26 mai 1905 30 avenue Reille
21 août [1905] Chouzy (Loir et Cher)
Mon cher ami, Je ne crois pas que sur la Guerre vous ayez des réponses bien
intéressantes. L'Enquête de la Vie socialiste est lamentable, au- dessous de tout19. Vraiment, nos pontifes socialistes n'ont plus rien dans le ventre. C'est une stérilité et une puérilité de la pensée qui est invraisemblable. Donc, à mon avis, votre enquête risque de venir un peu tard, après celle de la Vie socialiste, et après celle que je vais publier dans le Mouvement 20.
Cornély ne paie pas pour ces sortes de volumes. Il ne le prendrait pas, après la publication de l 'Enquête prochaine du Mouvement et d'une étude de moi, que je prépare, sur l'« Idée de Patrie et le socialisme » 21.
5/ vous croyez toutefois poser des questions nouvelles, qui provoqueront des réponses intéressantes, et que tout cela ne soit pas trop long, peut-être pourrait-on l'insérer dans le Mouvement. Mais encore une fois songez à la difficulté de la chose, surtout après les deux enquêtes que je vous rappelle. Cela me paraît bien peu tentant.
Ne tardez pas à m 'envoyer votre article. En toute hâte. Bien à vous,
Hubert Lagardelle
19. Enquête sur « Socialisme et internationalisme », publiée de juin à août 1905 avec la participation entre autres de Bebel, Bernstein, Hervé, Kautsky, Lafargue et Vaillant.
20. Lagardelle joignit à sa lettre une circulaire sous forme de questionnaire, datée du 1er août 1905, concernant l'« Enquête sur l'idée de patrie et la classe ouvrière». Celle-ci parut d'août à novembre 1905 et fut publiée en volume chez Cornély en 1906 ; elle recueillit principalement les avis de militants syndicaux français.
21. Elle ne paraîtra qu'incomplète sous forme d'article dans le Mouvement socialiste (174-175, 15 mai-15 juin, p. 5-32 ; 177-178, août- septembre 1906, p. 329-340).
126
8
[Adressée à Barfussertor 30, Marburg, Hesse] 1er octobre 1905
Chouzy-sur-Cisse (Loir et Cher) Mon cher ami,
J'attends avec impatience votre article sur léna. Quelle débâcle ! C'en est bien fini du prestige de la social-démocratie allemande. L'effet produit à l'étranger est lamentable. Même Jaurès n'ose pas la défendre franchement ! C'est au-dessous de tout.
Mais ce sont vos impressions qui importent. Je les attends 22. Bien vôtre
Hubert Lagardelle
9 Paris, le 31 octobre 1905
30, avenue Reille Mon cher ami,
Vos articles vous seront payés, si vous le voulez bien, chaque année, en janvier. Vous savez que les revues socialistes en France sont pauvres - pauvres de fonds et pauvres d'abonnés. Leur vie se heurte aux pires difficultés, il faut les soutenir, les subventionner. Personnellement, j 'ai donné au Mouvement socialiste tout ce que j 'avais de sommes disponibles, et je ne touche aucune indemnité comme directeur ou rédacteur. La plupart des collaborateurs ne sont pas payés : on réserve aux correspondants étrangers le peu d'argent dont on peut user. L'éditeur n'est nullement engagé : lui, il ne risque que de... gagner, puisqu'il perçoit un «pour cent » déterminé et que с 'est moi qui suis responsable du déficit.
J'ai cru, il y a plusieurs mois, qu'on pourrait rémunérer assez normalement les collaborateurs. Les abonnements venaient nombreux et j 'avais obtenu quelques fortes souscriptions. Hélas ! ces souscriptions se sont évanouies, devant la campagne syndicaliste révolutionnaire, antimilitariste, antipatriotique. Et il faut nous contenter des simples abonnements, insuffisants encore pour permettre une vie normale.
Nous n'avons pas derrière nous de juifs millionnaires comme l'Humanité de Jaurès ni la caisse d'un riche parti comme die Neue Zeit.
Excusez ces confessions d'un directeur qui doit s'occuper de la cuisine de son périodique. Mais je vous les devais, pour établir entre nous des relations claires. En janvier, on vous dira ce que
22. R. Michels, « Le socialisme allemand et le congrès d'Iéna », le Mouvement socialiste, 166-167, ler-15 décembre 1905, p. 281-307.
127
l'on peut vous donner et on vous l'adressera. Ce ne sera pas une somme forte, mais ce ne sera pas non plus une somme dérisoire.
Reste votre venue à Paris pour quelques conférences. La faiblesse de nos ressources vous montre que nous ne pouvons guère engager ici encore de dépenses. Songez qu 'il faut encore faire vivre Г Avant-garde, et que les Français n'ont guère l'habitude à s'abonner aux journaux, même amis ! Toutefois dites-moi ce qu' ap
proximativement coûterait votre voyage : on pourra voir alors s 'il est possible d'organiser quelque chose.
Adressez-moi un exemplaire de votre étude sur le socialisme italien : j'en ferai un compte-rendu 23.
Ne pourriez-vous m' envoyer une correspondance sur la grève des électriciens de Berlin 24 ? Il semble bien que cet échec confirme une fois de plus les critiques dirigées contre l'aveulissement du mouvement ouvrier et socialiste allemand. Ici, même les journaux bourgeois ont signalé ce manque absolu du sens de la lutte. Il serait bon qu'on ait quelques pages de vous là-dessus. Puis-je y compter ?
En France, le socialisme officiel, le socialisme électoral de Guesde et Jaurès réunis, se décompose avec une rapidité qu'on ne pouvait prévoir. C'est la fin du parti socialiste en tant que représentant d'un mouvement de transformation sociale. La cuisine électorale intéresse seulement cette association de sous-officiers, en quête de places ou de sièges, et toutes leurs discussions roulent sur la composition de la sauce électorale.
Par contre, le mouvement syndicaliste est fort combattu par le gouvernement, et en dessous par les socialistes politiciens. Il aura de rudes difficultés à vaincre. Mais cela ne peut que l'aguerrir, lui donner conscience de ce qu 'il doit et de ce qu 'il peut.
À vous lire bientôt. Bien à vous,
Hubert Lagardelle
23. R. Michels, « Proletariat und Bourgeoisie in der sozialisti- schen Bewegung Italiens », Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpoli- tik, vol. XXI, 1905, p. 347-416 ; vol. XXII, 1906, p. 80-125, 424-466 et 664-720. Edouard Berth se chargera du compte rendu.
24. R. Michels, « La grève des métallurgistes de Berlin » [dans le secteur électrique], le Mouvement socialiste, 170, 15 janvier 1906, p. 96-100.
128
10
[Adressée au 25, rue des Saints-Pères, Paris] Lundi soir [29 janvier 1906]
Mon cher ami, Je suis un peu souffrant et ne puis quitter ma chambre. Je ne suis
pas capable d'aller vous voir ce soir. Si vous êtes libres demain matin, mardi, tâchez de venir jusqu'à l'avenue Reille.
Excuses et amitiés, Hubert Lagardelle
11
[Adressée au 25, rue des Saints-Pères, Paris] 30, avenue Reille
4.2.06 Mon cher Michels,
Je vous attendais hier soir, à mon cours, avec nos amis du Mouvement et de /'Avant-garde. Nous espérions fixer avec vous sujet et jour de votre conférence. C'est un peu ennuyeux que vous ne m'ayez pas prévenu : je vous aurai[s] fixé un rendez-vous après dîner, le soir.
De même, vous avez oublié que le dimanche seulement quelques amis sont libres et que je devais les inviter chez moi pour causer avec vous. J'en avais déjà prévenu la plupart, comptant que vous viendriez, comme il avait été convenu.
Enfin ces malentendus sont réparables. La conférence aura lieu le 9, si /'Hôtel des Sociétés Savantes ne l'a pas loué [sic] ; hier soir, si on vous avait vu, pour le sujet, on l'aurait arrêté. Demain matin, lundi, je passerai rue des Saints-Pères vous voir - ou vous laisser un mot si vous êtes sorti 25.
À vous, Hubert Lagardelle
12
Montauban, le 6 avril 1906 Cher ami,
Mille excuses de mon long retard à vous écrire. Mais, j 'ai eu d'assez gros ennuis dès votre départ. La Compagnie des Aciéries
25. La conférence, qui portait sur le socialisme et les syndicats allemands, aura lieu le 12 février 1906 sous les auspices du Collège libre des sciences sociales.
129
de Longwy m'a intenté, pour un article publié sur les grèves de Longwy dans le Mouvement socialiste de décembre 26, un procès me réclamant... cinquante mille francs de dommages et intérêts et elle a compris l'éditeur et l'imprimeur dans sa citation devant le tribunal... correctionnel. Vous pensez la tête faite par l'éditeur et l'imprimeur ! J'ai eu à trouver des avocats, des avoués, etc. et à préparer ce procès, qui viendra dans 2 ou 3 semaines.
Puis j'ai quitté Paris le 28 mars et suis venu faire une tournée de conférences dans les Bourses du Travail du Midi de la France. J'ai dû parler souvent et beaucoup, et n'ai pas encore fini. Je dois avouer que je suis un peu fatigué. Mais la croissance du mouvement syndicaliste, jeune encore mais déjà assez fort, que je viens de constater méfait oublier un peu ma lassitude physique.
J'ajoute enfin que la création de cette École Russe d'études sociales dont je vous ai parlé m 'a pris pas mal de temps et créé pas mal de soucis. Elle est sur pied et après Pâques fonctionnera 21.
Cher ami, j 'attends avec impatience votre conférence mise au point, pour vous défendre contre des attaques aussi furieuses qu'imbéciles 28. Dites-moi si je dois l'attendre pour le n° d'avril ? - Cette conférence pourrait ensuite être tirée en brochure (j'en ferai les frais) et nous la répandrions à flots 29.
De même, envoyez-moi, si vous le croyez utile après la publication de votre Conférence, l'article que vous me proposez sur les rapports du prolétariat français et du prolétariat allemand.
Et votre compte-rendu du Sombart ? Ça presse et j'y tiendrais] beaucoup 30.
Mes meilleures félicitations à Madame Michels et à vous pour l'heureuse façon dont votre petite famille se porte. Nous vous attendons avec impatience. Écrivez-nous, à Paris, nous ferons tout
26. Alphonse Merrheim, « Le mouvement ouvrier dans le bassin de Longwy», le Mouvement socialiste, 168-169, 1er- 15 décembre 1905, p. 425-482.
27. Lagardelle donnera des cours en 1906 au Collège russe d'études sociales, dont la mise en place profitait sans doute de la fermeture à la fin de 1905, à la suite de dissensions politiques, de l'École russe des hautes études sociales.
28. Pour la réponse de Michels aux critiques suscitées en Allemagne par ses conférences parisiennes, cf. « Polémiques sur le socialisme allemand », le Mouvement socialiste, 176, juillet 1906, p. 228-237.
29. Le texte de la conférence paraîtra ailleurs : R. Michels, « Mouvement social. Allemagne», Revue internationale de sociologie, 11, novembre 1906, p. 801-812.
30. R. Michels, recension de Werner Sombart [1863-1941], Sozia- lismus und soziale Bewegung, 5e éd., le Mouvement socialiste, 174-175, 15 mai-15 juin 1906, p. 178-180.
130
pour vous faire préparer le logement que vous penserez retenir. Nous avons été si heureux de votre amitié que nous espérons bien l'affermir encore et la fortifier davantage, si c'était possible.
Pardonnez-nous donc et mes plus vives amitiés à vous tous, Hubert Lagardelle
Je serai à Paris le 9 avril.
13
Paris, le 16 juillet 1906 30, avenue Reille
Cher ami, Mes procès du Mouvement socialiste, de gros ennuis financiers
avec mon éditeur, m'ont fait craindre un moment que j'allais tout abandonner. C'est pourquoi, fort angoissé par tant d'ennuis, je ne vous ai pas écrit. Votre amitié ne m 'en tiendra pas rigueur, n 'est- ce pas ?
Je vous envoie mon travail pour la revue de Sombart31. Je l'ai fait le plus consciencieusement possible. Mais j'ai dû donner aux conceptions, c['est]-à-d[ire] à la partie théorique, presque toute la place, car c'est cela qui caractérise le syndicalisme français. L'historien n'est intéressé que par l'état d'esprit des militants syndicalistes, et une pareille étude se ramène forcément à une description de psychologie collective.
Je vous ai renvoyé vos épreuves. Prière de les réexpédier sans retard.
Avez-vous reçu nos numéros mai-juin ? Il y a eu beaucoup d'erreurs postales, dans cet envoi. Écrivez à l'administration si vous n 'avez pas eu votre exemplaire-double.
Je suis honteux de n 'avoir pu payer encore ma dette à votre égard. Mais vous savez quelle est ma situation : с 'est moi qui paie tout le déficit de la Revue et je me suis trouvé un peu écrasé pas les pertes qu 'il a fallu combler. Mais je n 'oublie pas ma dette et je pense pouvoir m'en acquitter sous peu. Pardonnez-moi.
Je n 'ose vous demander un article sur les débats actuels sur la grève générale dans la social-démocratie allemande. Toutefois si vous avez quelque peu le temps, et si vous avez toujours gardé votre sympathie à l 'œuvre difficile que nous poursuivons, tâchez de m 'envoyer quelques pages là-dessus 32.
31. H. Lagardelle, «Die syndikalistische Bewegung in Fran- kreich », Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. XXVI, janvier, p. 96-143 et mai 1908, p. 606-648.
32. R. Michels, « Le socialisme allemand après Mannheim », le Mouvement socialiste, 182, janvier 1907, p. 5-22.
131
Ma femme est en Russie depuis déjà quelque temps, et je suis toujours inquiet à son sujet. J'espère qu'il ne lui arrivera rien 33 /
Nous sommes, en France, en pleine démocratie ! Et je pense que Briand et Clemenceau vous auront converti sur les vertus du régime démocratique « avancé » 34 / Le syndicalisme suit toujours sa voie normale.
Amitiés de nous tous. Mes meilleurs hommages à Mme Michels. Bien vôtre
Hubert Lagardelle
14
Paris, le 6 déc. 1906 30, avenue Reille
Mon cher ami, Je suis de retour à Paris et suis sans d'autres nouvelles de vous.
Comment vous portez-vous maintenant ? Seriez-vous encore souffrant ?
Un mot, je vous prie, et dites-moi si je puis compter sur votre article bientôt.
Je suis encore tout abruti de la période d'instruction militaire de 28 jours que je viens de faire : mais ça m'a permis de voir de près l'armée, que je n'avais pas approchée depuis quelques années. L'esprit militaire disparaît de plus en plus en France et j'ai trouvé beaucoup d'officiers inquiets et découragés de cette décomposition du sentiment guerrier.
Amitiés de nous tous à vous tous. Vôtre
Hubert Lagardelle
15
[Adressée à Barfiissertor 30, Marburg, Hesse] 30, avenue Reille 12 janvier [1907]
Cher ami, Merci de votre article. Mais votre réponse à Berth est bien
méchante. Pourquoi des termes aussi vifs ? Non, il faut être, dans
33. Zénaïde (Zina) Gogounzova (1872-?), Ukrainienne d'origine noble et fille d'un officier tsariste, militante socialiste, avait connu Lagardelle à Berlin avec qui elle s'était mariée en 1899.
34. Aristide Briand (1862-1932), alors ministre de l'Instruction publique ; Georges Clemenceau (1841-1929), alors ministre de l'Intérieur.
132
les mots, moins féroce ! Je vous enverrai les épreuves. Votre réponse paraîtra dans le n° de février ; celui de janvier est déjà composé 35.
Alors, vous devenez italien 36 ? Je pense qu'à Turin vous pouvez avoir pas mal de succès... Mais viendrez-vous à Paris ? Il le faut, pour nous entendre, avec Labriola et les autres, afin d'agir au Congrès de Stuttgart... 37 Votre idée de consacrer un n° au Congrès de Stuttgart est excellente : il faudra que nous la réalisions 38.
Mon travail va partir (enfin !) pour Heidelberg 39. À bientôt. Amitiés,
Hubert Lagardelle
16
[Adressée à la poste restante de Cologne] 30, avenue Reille
7 mars 1907 Mon cher ami,
Nous vous attendons à Paris avec impatience et nous serons bien heureux de voir Madame Michels vous accompagner.
Faites adresser chez moi toutes vos correspondances, etc. Et si vous avez besoin que je fasse quelque chose pour vous, avant votre arrivée, écrivez-moi vite.
À bientôt. Nos amitiés à vous deux, vôtre
Hubert Lagardelle
35. R. Michels, « Controverse socialiste », le Mouvement socialiste, 184, mars 1907, p. 278-288. Michels répondait à la recension d'Edouard Berth de son essai « Proletariat und Bourgeoisie in der sozialistischen Bewegung Italiens », parue dans le Mouvement socialiste, 179, octobre 1906, p. 164-170.
36. Michels était en passe d'obtenir la libéra docenza à l'université de Turin. Il s'installera en Italie en avril.
37. Le 3 avril 1907 se tiendra à Paris une conférence internationale sur le syndicalisme et le socialisme avec la participation de Victor Griffuelhes (président de séance), Lagardelle, Michels, Arturo Labriola et Boris Kritchewsky.
38. Un seul article paraîtra sur ce sujet : R. Michels, « Le prochain congrès socialiste international », le Mouvement socialiste, 188, 15 juillet 1907, p. 38-46.
39. Voir supra, note 31.
133
17
30, avenue Reille Paris, le 13 mars 1909
Cher ami, Je serai absent de Paris du 27 mars au 3 avril et je m'en irai
encore pour le Congrès socialiste de St-Étienne, qui aura lieu pendant la semaine de Pâques. Je serai donc là seulement du 3 au 10 avril, et encore c'est peu sûr que j'y sois tout le temps.
Si la température ne s'améliore pas, le séjour à Paris sera froid : jamais un hiver si pluvieux, si long n'avait été observé. Il neige tous les jours et le climat est insupportable.
Je serai pourtant très heureux de vous voir, amicalement, affectueusement. Je suis dans une période triste : le trouble est profond dans le syndicalisme et le socialisme français. C'est le désarroi. Autour de moi, с 'est la débandade. Sorel a depuis cinq mois lâché le Mouvement et Berth vient de le suivre40. L'un et l'autre ont été la proie du pire des intellectualismes et ils en sont à admirer les petites formules abstraites qu 'ils ont fabriquées. De vive voix, je vous expliquerai ces invraisemblables choses : j'en ai été fort peiné.
J'ai eu de gros ennuis avec mon éditeur ; il a fallu en chercher un autre 41 ; la Revue ne va pas ; et je n'ai pas d'argent. Plus de collaborateurs réguliers ! Les beaux jours sont passés.
Et cela au moment où l 'attention est de plus en plus fixée sur nous. Personnellement, je n 'ai jamais eu tant de monde, de foule dois-je dire, à mes cours 42 ; mes conférences sont extrêmement suivies aussi. Je ne me plains donc pas par déception d'ordre personnel ! Pour moi, c'est le succès.
Je serai très heureux de vous voir, pour causer de beaucoup de choses. Si vous venez après Pâques, après le 17 ou le 18 avril surtout, ce serait le mieux. Mais pourrez-vous ?...
Je ne suis pas allé en Italie, cet hiver, hélas ! Tous mes ennuis m 'en ont empêché, et puis j 'ai eu trop à dépenser pour la Revue.
40. Sorel s'en expliqua en privé dans des lettres à Lagardelle (du 31 octobre 1908 et sq., in « Lettere di Sorel a Lagardelle », Educazione fascista, 11, novembre 1933, p. 968 sq.), à Giuseppe Prezzolini (du 6 décembre 1908, in Bruno Somalvico, « Lettere di Sorel a Prezzolini », in Id., Diana Riiesch, eds., La Voce e l'Europa, Rome, Pres. del Consiglio dei ministři, [1995], p. 584-589) et à Agostino Lanzillo (du 28 mars 1910, in Francesco Germinario, « 'Cher camarade'... Sorel a Lanzillo », Annali délia Fondazione L. Micheleîti, 1993-1994, p. 115-117).
41. Le contrat d'édition du Mouvement socialiste avait été rompu avec la maison Marcel Rivière dès janvier 1909. L'éditeur Giard & Brière lui avait succédé.
42. Depuis des années, Lagardelle donnait des cours hebdomadaires au Collège libre des sciences sociales.
134
Inutile de vous dire qu'un article de vous, soit sur les choses d'Allemagne, soit sur celles d'Italie, sera le bienvenu L.. Les articles ne viennent plus, maintenant ! Envoyez-moi donc ce que vous pourrez — et le plus tôt que vous pourrez.
Nos plus affectueuses amitiés pour vos enfants, Madame Michels et vous-même.
Vôtre Hubert Lagardelle
18
1er avril [1909] 30, avenue Reille
Cher ami, De vive voix, je vous exposerai plus longuement la situation que
ma dernière lettre vous a indiquée. Je ne crois pas que Sorel et Berth reviennent jamais. Je regrette que Berth ait cru suivre Sorel dans son départ et brisât ainsi notre vieille amitié. Mais Berth est un solitaire et un pur intellectualiste... Tout cela me fait évidemment mal, mais qu 'y puis-je ?
Comme je vous l'ai écrit, du 11 au 19-20, je ne serai pas à Paris. Mes enfants sont déjà partis à la campagne ; le 11, commence à St-Étienne le Congrès socialiste, et, après le Congrès, j 'irai retrouver mes gosses.
Le 7 avril, jour de votre arrivée, je vous enverrai un pneumatique à votre hôtel, pour vous fixer un rendez-vous.
Amitiés de nous deux à vous tous. Vôtre
Hubert Lagardelle
19
[Adressée à via Andrea Prována 1, Turin] Paris, 30 avenue Reille
26 avril 09 Cher ami,
Je n 'ai pas voulu gâter votre séjour à Paris par ma demande intempestive d'article ! Mais dès que vous serez un peu reposé de votre voyage, envoyez-moi votre copie - surtout si, comme je crois, elle est presque finie 43.
43. R. Michels, « La politique étrangère et le socialisme », le Mouvement socialiste, 210, mai 1909, p. 321-333.
135
Madame Michels va-t-elle mieux et ne se sent-elle plus mal ? Nous serions bien heureux de l'apprendre.
Bons souvenirs à Mrs et Mmes Mucchi, Mariáni44 et à Mr. Cuneo !
Amitiés de nous deux à vous deux, Hubert Lagardelle
20
[Adressée à via Andrea Prována 1, Turin] Paris, 30 avenue Reille
9 mai 1909 Cher ami,
Vous m'annonciez votre article. Je ne l'ai pas reçu. L'auriez- vous mal adressé — ou bien n 'était-il pas encore prêt ? Un mot, s.v.p. 45.
Bonnes amitiés à vous deux et bons souvenirs à vos aimables compagnons de voyage.
Vôtre Hubert Lagardelle
21
30, avenue Reille Paris, le 14 janv. 1910
Mon cher Michels, Bien merci de vos vœux cordiaux de nouvel an. Recevez aussi,
vous tous, les nôtres. Nous serons bien heureux de vous revoir en France, cette année. Nous n 'espérons pas aller encore en Italie ! Ma femme est embarquée dans des expériences de pédagogie et elle se donne un mal énorme 46. De mon côté, je suis très pris et ne vois pas la possibilité d'un long déplacement.
J'ai été frappé du long travail qu'a dû coûter à Madame Michels la préparation et la confection de son livre, si remarquablement intéressant41. J'en parlerai prochainement.
44. Le peintre Anton Maria Mucchi, Edoardo Mariáni et leur épouse étaient des relations turinoises de Michels.
45. Voir supra, note 43. 46. Voir Z[ina] Lagardelle, Méthode Lagardelle. La lecture directe sans
syllabation, Paris, Larousse, 1912. 47. Gisela Michels-Linder, Gemeindebetriebe in Italien, Leipzig,
Duncker und Humblot, 1909.
136
Quant à la traduction de votre Étude, с 'est le Mouvement socialiste qui va la publier, en plusieurs fois 48. Les combinaisons avec les éditeurs français ne marchent jamais bien ! C'est donc la Revue qui fera connaître votre travail.
Le socialisme italien me semble bien bas. Et quant au syndicalisme, il me semble encore plus terne. Qu 'y a-t-il de vrai dans cette impression ? Renseignez-moi un peu, si vous avez le temps.
Nos bonnes amitiés à vous tous. Vôtre
Hubert Lagardelle
22
[Adressée à via Andrea Prována 1, Turin] Le Burgaud, Hte Garonne
10 sept. 1910 Cher ami,
Je reçois votre mot, dans le Midi, à mon retour d'un long voyage. Je ne pense pas, hélas !, être là quand vous viendrez. À moins que vous ne demeuriez plusieurs semaines. Et tout cas, je pars d'ici sous peu, et n'étant pas sûr de mon itinéraire, je vous écrirai rue de Seine, dès que vous serez arrivé.
J'aurais tant de plaisir à vous voir ! Amitiés à vous tous de nous tous. Bien vôtre
Hubert Lagardelle
23
19 déc. 1910 Cher ami,
je vous envoie la traduction de votre étude sur le Socialisme allemand. J'en ai publié le premier chapitre dans notre n° de novembre (sans les notes), en annonçant l'apparition prochaine du volume 49. Dès que vous aurez revu et complété le manuscrit, soyez assez aimable de me le renvoyer.
48. Étude à laquelle Lagardelle se référera par la suite sous le titre de Socialisme allemand.
49. R. Michels, « L'ancienne hégémonie du socialisme allemand », le Mouvement socialiste, 225, novembre 1910, p. 241-251. Le volume ne paraîtra pas.
137
Bien merci pour l'envoi de votre dernier livre 50. Les comptes rendus de vos ouvrages 51 et de celui de Mme Michels paraissent dans notre numéro de décembre. Mais je consacrerai un article spécial aux problèmes de la démocratie que pose votre dernier ouvrage.
Il est toujours entendu que mon voyage de Pâques sera pour moi un enchantement. Si mes conférences peuvent se faire, vous savez que j'en serai ravi 52.
Le syndicalisme italien me semble être une pitrerie. M. Orano, M. Lanzillo vantent le néo-monarchisme sorellien 53 / On n 'est pas plus sot. Malheur aux gens qui veulent être toujours le « dernier cri de Paris ». D 'ailleurs la combinaison sorellienne a avorté !
Le dernier congrès syndicaliste de Bologne a montré l'inextricable confusion qui règne dans les cerveaux de ces vaillants syndicalistes italiens 54 /
Bonnes amitiés à Madame Michels et à vous de nous tous. Bien vôtre
Hubert Lagardelle
24
[Adressée à via Andrea Prována 1, Turin] 30, avenue Reille
Paris, 4 janvier 1911 Cher ami,
Je vous envoie un ex. de mon livre 55. Mais ma préface annonce plus tôt [sic] des livres ultérieurs qu'elle ne commente celui-là.
50. R. Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demo- kratie. Untersuchungen fiber die oligarchischen Tendenzen des Gruppen- lebens, Leipzig, Klinkhardt, 1911.
51. Michels avait publié précédemment Storia del marxismo in Italia. Compendio critico, Rome, Mongini, 1909 (sur la couverture : 1910). Le compte rendu en sera fait par Arturo Labriola : « À propos du marxisme », le Mouvement socialiste, 233, juillet-août 1911, p. 81-87.
52. Lagardelle sera en Italie en avril-mai 1911 où il prononcera une série de conférences. Il y retournera en juin 1912.
53. Paolo Orano (1875-1945), fondateur de la revue la Lupa qui accueillit dans son premier numéro du 10 octobre 1910 un article sur l'évolution récente de Sorel et traduisit la « Déclaration » de la Cité française, programme d'une revue (avortée) que montaient Sorel et Berth avec Georges Valois et Pierre Gilbert de l'Action française. Agostino Lanzillo (1886-1952) venait de publier une monographie sur Sorel.
54. Le second congrès national du syndicalisme révolutionnaire italien se tint du 10 au 13 décembre 1910. Composé uniquement d'intellectuels, il fut dominé par les divergences.
55. H. Lagardelle, Le socialisme ouvrier, Paris, Giard & Brière, 1911.
138
C'est surtout pour montrer que jamais notre critique de la démocratie ne pouvait conduire aux folies néo-monarchiques des Sorel et Berth, que j'ai réuni ces éléments du débat. Mais j'aurai à mieux m 'expliquer sur la politique nouvelle que je préconise.
J'attends toutes les invitations que vous voudrez bien me faire faire pour mes conférences en Italie. Toutes rouleront sur la France actuelle : politique, économique, littéraire.
Bonnes amitiés à vous deux de nous tous - et Bonne Année ! Vôtre
Hubert Lagardelle
Donnez-moi, s.v.p. une liste de noms à qui envoyer mon livre et des numéros de ma Revue.
25
[Adressée à via Andrea Prována 1, Turin] Paris, 30 avenue Reille
31 janvier 1911 Mon cher ami,
J'ai omis de vous prier de me renvoyer dès que vous le pourrez la traduction de votre Socialisme allemand. N'y manquez pas, cher ami, pour qu 'on le publie aussitôt.
Amitiés, Hubert Lagardelle
26
[Adressée à via Andrea Prována 1, Turin] [2 février 1911]
Carissimo, Votre mot me parvient trop tard. Comme vous verrez, votre article
est déjà publié^. Mais quel inconvénient y peut-il avoir ? C'est de la réclame par avance ! En tout cas, mon intention a été pieuse.
Je serai vraiment très heureux d'aller faire ces conférences, si votre amitié vigilante parvient à les mettre debout !
En tout cas, j'irai toujours en Italie, conférencier ou non. Et votre Socialisme allemand ? Affectueux souvenirs à vous tous. Vôtre
Hubert Lagardelle
56. R. Michels, « La composition autocratique des partis », le Mouvement socialiste, 227, janvier 1911, p. 21-33, 228, février 1911, p. 87- 97, tiré de son étude Zur Soziologie des Parteiwesens.
139
27
30, avenue Reille 15 mars 1911
Mon cher Ami, Je viens de lire attentivement votre livre et le compte rendu en
sera fait par moi 57. // est plein d'aperçus extrêmement ingénieux et je ne manquerai pas de les relever. J'adhère sans réserve à vos conclusions sur l'impuissance du socialisme politique à faire mieux que les partis qui l'auront précédé. Mais je pose le problème d'une façon un peu différente que vous.
1°) II s'agit de réduire le champ de la vie politique, de l'action des partis, du rôle des « mandataires ». En cela le syndicalisme, opposant la réalité sociale à /'abstraction politique, a indiqué les moyens.
2°) L'oligarchie, la hiérarchie, la domination de chefs, toute puissante dans le domaine de la politique (vu l'incompétence née des masses, leur éloignement des problèmes à résoudre et la nature même de ces problèmes), peut être réduite à son minimum (je ne dis pas supprimée, car je suis avec vous contre Berth 58j dans les institutions sociales.
Tout cela, je l 'exposerai plus longuement, et surtout plus clairement.
Avez-vous une réponse de Venise ? Je pourrais y faire ma conférence dans la semaine qui va du 3 au 5 (le 6, je suis à Milan). Le 4 serait bien.
Je pense qu'il serait possible défaire en ce moment cette conférence. Figurez-vous que la conférence « socialiste » que Schiavi m'a demandée à Milan ne peut avoir lieu que le 1159 !
Si je pouvais aller au Congrès de philosophie de Bologne, je verrai[s] les gens de Florence 60. Peut-être sera-t-il possible que j'y fasse ma conférence sur Bergson et les problèmes sociaux après Pâques, à mon retour du Sud ?
A vous lire. Bonnes amitiés à vous tous, Hubert Lagardelle
57. R. Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens, op. cit. Le compte rendu de Lagardelle paraîtra dans le Mouvement socialiste, 243, juillet-août 1912, p. 136-139.
58. Cf. É. Berth, art. cit., supra, note 35. 59. Alessandro Schiavi (1872-1965), militant socialiste italien,
déjà correspondant des revues de Lagardelle la Jeunesse socialiste et le Mouvement socialiste.
60. Sans doute Giuseppe Prezzolini, Giovanni Papini et les autres collaborateurs de la revue florentine la Voce. Le Congrès se tiendra du 6 au 12 avril 1911.
140
28
[Adressée à via Andrea Prována 1, Turin] Le Burgaud, Hte G[aron]ne
30 oct. 1912 Mon cher ami,
J'ai envoyé ta copie à l'impression. Tu en recevras bientôt les épreuves61.
À Paris, on n'a pas su, en mon absence, retrouver ton paquet de livres. Je vais rentrer. Je ferai faire l'expédition tout de suite. Pardon de ce retard involontaire.
Cordialement à vous tous, Hubert Lagardelle
29
[Adressée à via Andrea Prována 1, Turin] 101, rue Dareau
17 décembre 1912 Mon cher Michels,
En rentrant de voyage, je trouve ta note en réponse à Laskine ; je te la renverrai sans tarder avec les appréciations que tu me demandes 62.
Tu as dû recevoir les livres qu'on t'a envoyés en mon absence. Si le paquet ne t'est pas parvenu, écris-moi aussitôt.
Ton article et ma réponse paraîtront seulement dans le numéro de janvier du Mouvement socialiste 63. J'ai dû retarder cette publication à cause des articles trop nombreux qui attendaient sur le marbre.
Bonnes amitiés à vous tous, Hubert Lagardelle
61. Voir infra, note 63. 62. Le jeune socialiste normalien Edmond Laskine (1890- ?), qui
n'en était pas à sa première pique contre Michels, avait accusé ce dernier d'avoir eu, dans une recension du Socialisme ouvrier de Lagardelle parue dans Y Archiv fiir die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung (vol. I, 1911, p. 512-514) des formules blessantes à l'endroit de celui-ci (E. Laskine, «Une revue d'histoire du socialisme», Revue socialiste, 332, août 1912, p. 174). Une lettre rectificatrice de Michels envoyée au directeur de la revue avait été suivie de la réplique de Laskine {Revue socialiste, 335, novembre 1912, p. 477-480). La réponse de Michels, datée du 8 décembre 1912, paraîtra dans la Revue socialiste, 338, février 1913, p. 189-192.
63. R. Michels, « L'oligarchie et l'immunité des syndicats. Réponse à Hubert Lagardelle », le Mouvement socialiste, 247-248, janvier- février 1913, p. 90-96. La réplique de Lagardelle ne paraîtra pas.
141
J'ai écrit au Prof. Diena pour sa collaboration à la Revue pratique de Droit International Privé, que je fonde avec Lafont 64. Je te serai reconnaissant de dire un mot à M. Diena, si tu en as l 'occasion, pour le pousser à accepter. Merci !
30
[1913]
Hubert Lagardelle Docteur en Droit, Avocat à la Cour d'Appel
Directeur des Questions pratiques de Droit International Privé
Professeur au Collège Libre des Sciences Sociales et à l'Université Nouvelle de Bruxelles
1 ter, Square Rapp, Paris (33, avenue Rapp) Cher ami,
En ť envoyant mon changement d'adresse (personnel, non familial), je te demande de vouloir bien m' envoyer la Bibliographie que tu peux avoir sur Bakounine 65. Je n'ai pas noté les divers articles parus sur ce sujet, mais tu m'as dit les avoir. Je te serais bien reconnaissant de me les indiquer.
Ma femme m'a transmis ton rappel de photographie. Je te l'enverrai sans tarder.
À vous tous amical[emen]t, Hubert Lagardelle
Ma femme est dans le Midi, avec les enfants 66.
64. Questions pratiques de droit international privé verra le jour en avril 1913 et durera jusqu'à la guerre. Giulio Diena, professeur à l'université de Turin, collaborera à la revue. Ernest Lafont (1879- 1946), avocat, ancien collaborateur du Mouvement socialiste, reprendra tout seul la direction de la revue en 1917.
65. Lagardelle publiera trois articles sur Bakounine dans le Mouvement socialiste (249-250, mars-avril, p. 255-261 ; 251-252, mai -juin 1913, p. 286-297 ; 263-264, mai-juin 1914, p. 289-318).
66. Les Lagardelle, qui avaient deux enfants, avaient divorcé le 30 octobre 1912. Zina Gogounzova se remariera après la guerre avec Ernest Lafont.
142
31
Le Burgaud (Haute Garonne) 67 le 4 nov. 1932
Mon cher Michels, Une grippe malencontreuse, qui m 'a immobilisé trop longtemps,
m 'a empêché de vous remercier de votre aimable envoi, sitôt reçu. Je trouve, dans ces divers articles, des éléments d'information, sinon entièrement nouveaux, mais authentiques - et, en quelque sorte, les plus officiels que je puisse désirer.
Je n'ai ici que quelques-unes des choses que j'ai publiées ces temps derniers : un petit essai sur le Sud-Ouest toulousain et 2 articles « Au-delà de la démocratie » 68.
Je ne sais quand je pourrai rentrer à Paris. Je vous ferai signe, dès que je quitterai le Midi, et je vous enverrai, avec mon adresse, de nouveaux papiers de moi.
Bien amicalement et encore une fois merci, Hubert Lagardelle
32
[Adressée à via Palestro 14, Rome] Le Burgaud (Hte Garonne)
le 7 nov. 1932 Mon cher Michels,
Je suis infiniment sensible à votre si amicale intervention pour le Convegno de l'Académie d'Italie 69. Je suis, hélas ! encore souffrant et je voudrais bien être guéri pour aller vous revoir et observer de près la Nouvelle Italie. Bien entendu, une entrevue avec Mussolini serait pour moi une chose de haut prix, après l'exposé sur le fascisme où il nous donne comme le filon premier de ses idées 70. De tout cela, mille fois merci.
67. En 1915, Lagardelle s'était installé dans le Sud-Ouest en transformant un domaine de famille en exploitation d'arbres fruitiers.
68. H. Lagardelle, Sud-Ouest, une région française, Paris, Librairie Valois, 1929; Id., «Au-delà de la démocratie», Plans, 1, janvier, 3, mars et 5, mai 1931.
69. Congrès international sur les problèmes européens et les questions sociales. À cette occasion, Lagardelle rencontrera Mussolini, qu'il avait côtoyé vingt ans auparavant lors de ses conférences à Milan.
70. « Dans le grand fleuve du fascisme vous trouverez les filons qui remontent à Sorel, à Péguy, à Lagardelle du Mouvement socialiste, et à ce groupe de syndicalistes italiens» (Benito Mussolini, «Fascismo. Dot- trina », in Enciclopedia italiana, Rome, Treccani, vol. XIV, 1932, p. 848).
143
Mais, même si je puis entreprendre ce voyage, faut-il encore que je reçoive l 'invitation officielle. Je ne l 'ai pas reçue.
Je ne sais si je pourrais rester longtemps en Italie, au cas où je viendrais à Rome. La situation économique rurale - source principale de mes revenus - est fort mauvaise, cette année, et je suis prisonnier des exigences pratiques. Je pense cependant, grâce à vous et aux anciens amis qui sont là-bas, que je serai guidé dans mes observations et que je n'aurai pas besoin d'un trop long séjour pour une première prise de vue.
Dans l'hypothèse où je ne viendrais pas à Rome, ce ne serait, en tout cas, que partie remise. Je le regretterais, car je sens toute la valeur exceptionnelle de l'occasion que vous m'offrez avec tant d'amitié.
De toute façon, je vous ferai savoir ce que les circonstances me permettent défaire, dès que j'aurai l'invitation officielle et dès que mon état de santé me fixera sur mes possibilités de déplacement.
Mille bons souvenirs, à votre famille et à vous, Hubert Lagardelle
33
[Télégramme adressé à via Palermo [sic] 14, Rome] [10 novembre 1932]
BURGAUD RIEN REÇU. TÉLÉGRAPHIEZ SI DOIS VENIR. REMERCIEMENT. LAGARDELLE.
34
[Télégramme adressé à via Palestro 14, Rome] [14 novembre 1932]
TOULOUSE VOYAGE ÉTANT ORGANISÉ ÉTUDES PERSONNELLES. ARRIVERAI DEMAIN
SOIR DIX-HUIT HEURES. LAGARDELLE.
35
[Adressée à via Palestro 14, Rome] Le Burgaud (Hte Garonne)
le 12 déc. 1932 Mon cher Michels,
Me voilà rentré en France, tout plein d'observations et d'impressions, que je vais maintenant clarifier et dont je vous ferai part.
144
Faut-il vous répéter, mon cher ami, combien je vous ai de gratitude d'avoir provoqué ce voyage ? Non seulement il m'a permis de vous retrouver, vous et votre charmante famille, mais encore il m'a ouvert des vues nouvelles et fait connaître des institutions et des états d'âme peu compréhensibles du dehors. L'Italie d'aujourd'hui doit être sentie pour être interprétée.
J'espère, en tout cas, que cette première rencontre après tant d'années et d'événements, et qui nous rappelle notre jeunesse ardente, sera suivie de bien d'autres et que ces liens renouvelés seront désormais continus.
J'ai retrouvé un Midi de la France qui rappelle encore, sans en atteindre la splendeur, bien des aspects de l'Italie. La civilisation méditerranéenne n 'est pas un mot, dans la mesure où une civilisation exprime des états de fait et de conscience semblables ou connexes, et une culture qui pousse sur un sol identique. Grand dommage que ce soient les peuples qui sont naturellement le plus près les uns des autres qui se trouvent - par là même - les plus obstinés à souligner leurs antagonismes. Espérons qu'un jour viendra...
Cher ami, encore une fois, pour vous et pour les vôtres, ma reconnaissante et chaude amitié.
Bien vôtre Hubert Lagardelle
36
Le Burgaud (Hte Garonne) le 25 décembre 1932
Cher ami, J'arrive de Paris, où mes descriptions de l'Italie de l'an XI ont
eu un vif succès de curiosité et presque d'étonnement, et je reviens ici, où je trouve avec plaisir de vos nouvelles. J'ai grand regret à savoir que l 'accident survenu à votre femme a eu des suites plus graves que vous ne le supposiez' J'espère que les choses iront cependant rapidement de mieux en mieux et que vos prochaines lettres me le confirmeront.
Les éditeurs Denoël et Steele - jeunes éditeurs, pleins de moyens et ayant déjà de gros succès de librairie - avec lesquels j'ai traité pour mon volume sur l'Italie mussolinienne (syndicalisme au centre), seraient prêts à faire paraître en français La dot- trina del fascismo, telle qu'elle vient d'être publiée dans la « Biblioteca délia Enciclopedia italiana », с 'est-à-dire suivie de ristoria del movimento fascista di Gioacchino Volpe71. Je le leur
71. Gioacchino Volpe (1876-1971), historien officiel du régime.
145
ai suggéré et ils m 'ont prié de m 'enquérir des possibilités et des conditions de cette publication.
Puis-je vous prier de donner un coup de téléphone à l '« Enci- clopedia Italiana » et de demander ces renseignements. Je n 'ose écrire directement au Professeur Gentile 72, qui ne doit guère s 'occuper de ces questions d'édition et vous pourriez mieux que moi savoir la procédure à suivre. La publication en français dépend- elle de Mussolini ? ou de l'Enciclopedia fascista ? ou de Trêves, Treccani ou Tumminelli 73 ? Et aussi de Giacchino Volpe ?
Puis-je aussi vous demander de me donner ces indications dès que vous les aurez ?
Vous le voyez, j'use de votre amabilité sans hésitation. Mais n'est-ce pas la loi de l'amitié ? Et puis peut-être cette initiative ne sera-t-elle pas désagréable à Mussolini lui même 74 ?
Je ne vous répéterai pas, à mon tour, combien je suis heureux de vous avoir retrouvé - et avec vous les souvenirs vivants de notre jeunesse.
Mes souhaits bien amicaux à votre femme et aux vôtres. Cordialement,
Hubert Lagardelle
37
[Adressée à via Palestro 14, Rome] Paris, 1 bis rue Clément Marot
le 16 janvier 1933 Mon cher ami,
Je suis attristé de voir que votre femme se rétablit si lentement. Ce sont, hélas !, de ces traumatismes lents à se réparer. De toute mon amitié, je souhaite que les choses aillent beaucoup plus vite et transmettez tous mes veux à Madame Michels, dont l'amitié a toujours été si affectueuse pour moi.
Je rentre pour deux semaines dans le Midi. Mais je vous fais savoir en hâte deux nouvelles, qui vous permettront d'attendre un peu pour les démarches en vue de la traduction du volume de Mussolini.
72. Giovanni Gentile (1875-1944), philosophe, directeur de l'Institut de l'Enciclopedia italiana.
73. Trêves, éditeur, Giovanni Treccani, bailleur des fonds, et Calogero Tumminelli étaient, avec Gentile, les responsables de l'Enciclopedia italiana.
74. Benito Mussolini, Le fascisme. Doctrine et institutions, Paris, Denoël et Steele, 1933 (trad. d'H. Lagardelle, non certaine).
146
1° D'abord, figurez-vous que ce que j'ai rapporté, dans mes conversations avec quelques personnalités officielles, sur ce que j'avais vu et appris de l'Italie nouvelle, a paru une vraie révélation. Et pourtant Rome est à 24 heures de Paris !
De Jouvenel15, qui est depuis longtemps de mes amis, m'a demandé de longs renseignements et ce que je lui ai dit lui a paru d'un tel intérêt, qu'il ma prié de lui donner, pour quelques mois à Rome, ma collaboration personnelle, pour une connaissance plus approfondie des institutions et des réalisations économiques et sociales de l'Italie de l'an XI.
Je ne sais pas si je pourrai accepter, quelque attrait qu'ait pour moi, et surtout pour le volume que j 'écris, un contact plus long avec l'Italie nouvelle 76. Et vous pensez bien combien je serais heureux de vous retrouver !
Ma décision doit être prise d'ici la fin du mois, de Jouvenel partant pour Rome le 21. Je vous écrirai pour vous dire ce que j'ai décidé 77.
2° Ensuite, je me suis résolu à donner à Gentile, qui me l'a demandé, un assez gros travail sur Sorel 78. Mon étude sera précédée de la publication de la correspondance de Sorel avec moi, de 1898 à 1908-09. Je viens de préparer et d'annoter ces lettres, en les faisant brièvement comprendre par une courte introduction 79.
En France, pour des raisons que vous comprendrez, j'ai toujours hésité à écrire sur Sorel et surtout à publier sa correspondance. Mais Ну a, me semble-t-il, un intérêt historique à faire cette publication en Italie ?
75. Henri de Jouvenel (1876-1935), sénateur, ancien ministre, auteur en 1928 d'un livre au titre significatif, Pourquoi je suis syndicaliste, venait d'être nommé, le 18 décembre 1932, ambassadeur extraordinaire de France à Rome, poste qu'il occupa pendant six mois.
76. H. Lagardelle, Vingt ans d'histoire d'Italie, Le Document, 1937 [non repéré, publication incertaine]. Entre-temps, Lagardelle publia une notice sur « Le régime fasciste en Italie », in Encyclopédie française, juin 1935.
77. Lagardelle s'installa dès janvier à l'ambassade en tant que chargé de mission. Rémunéré par le ministère des Affaires étrangères, il y restera jusqu'en mai 1940.
78. Voir la lettre de Giovanni Gentile à Lagardelle datée du 1er décembre 1932, in Fonds Lagardelle, Institut d'histoire sociale, Nanterre. Lagardelle renoncera au projet. Il ne publiera pas davantage en France un ouvrage qu'il entendait intituler Un bourgeois révolutionnaire. Georges Sorel et son époque.
79. H. Lagardelle, « Lettere di Giorgio Sorel a Uberto Lagardelle » [de 1898 à 1910, en réalité à 1911], Educazione fascista, mars à novembre 1933. Les lettres ne furent pas publiées intégralement.
147
Puis-je vous demander - si vous avez une minute - votre avis sur ces 2 choses ?
Bien vôtre Hubert Lagardelle
Écrivez-moi au Burgaud.
38
[Adressée à via Palestro 14, Rome] 31, via di Villa Rujfo
Rome, le 25 avril 1933 Cher ami,
Je suis de nouveau souffrant. Cette fois, un petit accident, une chute, due au mauvais état de ma santé. J'ai donc été obligé de rester quelques jours à la chambre. Mais cela va mieux, je pourrai sortir et vous voir bientôt.
Mille excuses et amitiés à vous tous. Vôtre
Hubert Lagardelle
39
[Adressée à via Palestro 11, Rome] Paris, le 13 janvier 193[6] 80
Cher Ami, Bons souvenirs de Paris !... où je trouve toujours tant d'autres
« souvenirs ». À bientôt,
Hubert Lagardelle
40
[Adressée à via Palestro 11, Rome] Paris, 30janv. 1936
Mille souvenirs de ce Paris, où nous avons tant de souvenirs communs de jeunesse. . .
Hubert Lagardelle
80. L'original porte « 1935 ». Rectifié d'après le cachet.