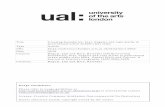Un bras de fer sur la décroissance urbano-touristique
Transcript of Un bras de fer sur la décroissance urbano-touristique
Via@ - revue internationale interdisciplinaire de tourisme
n°2 – 2014 Varia
1
Un bras de fer sur la décroissance urbano-touristique
Macià Blázquez Salom
• Contradictions du capitalisme touristique
Le tourisme de masse se développe selon les diktats du capital et les principes de base du capitalisme, que sont l’accélération du retour sur capital et l’expansion géographique par assimilation d’espaces et de ressources. David Harvey (Harvey, 2004) définit ce processus d’accumulation de capital par la dépossession et la marchandisation de domaines jusqu’alors étrangers au marché. Par conséquent, la production sociale de l’espace résulte de cette assimilation territoriale au système capitaliste. Ces principes intrinsèques déterminent l’existence de contradictions que le capitalisme déplace mais ne résout pas (Harvey, 2014). En premier lieu, la suraccumulation de capital du fait des crises de surproduction, qui se déplace et se fixe dans l’espace en fonction de l’impératif de croissance. Et en deuxième lieu, la limitation qu’impose au capitalisme le caractère limité de l’environnement et des ressources naturelles. Les mécanismes de déplacement, qui ne résolvent rien de ces contradictions du capitalisme, incluent le capitalisme vert en vue de combattre la détérioration environnementale (Magdoff et Foster, 2010), l’écotourisme (Fletcher et Neves, 2012; Fletcher, 2011) ou la conservation elle-même de la nature afin de différer l’accumulation de capital (Büscher et Fletcher, 2015).
• Les crises comme bras de fer entre le capital et la démocratie
Le développement du libre marché autorégulé, caractéristique du capitalisme, repose sur l’accumulation de bénéfices aux dépens de l’exploitation de travail et des ressources naturelles. En allant plus loin dans la définition de sa relation avec l’ individualisme compétitif et la société dans son ensemble, le capitalisme se caractérise par l’application du “principe de l’individualisation du gain et de la socialisation du risque” (Wallerstein, 1988 : 44). Ces mêmes définitions sont applicables au tourisme, du fait de la démonstration de sa marchantisation du loisir (Fletcher et Neves, 2012, p. 61) et de l’espace (Britton, 1991, p. 462) au moyen de l’investissement du capital dans des biens immobiliers et les infrastructures (Harvey, 1989) ou sa contribution au réchauffement global, avec un développement des émissions dues au tourisme de 200 % pour 2030, rattachée à l’ « effet rebond » (paradoxe de Jevons1) de l’augmentation de l’efficacité énergétique (Hall, Scott et Gössling, 2013 : 118).
Les crises du capitalisme répondent à sa dynamique interne, ce qui veut dire qu’elles lui sont inhérentes. Les crises sont “les occasions que le capital met à profit pour se restructurer et se rationaliser afin de restaurer sa capacité d’exploitation de travail et d’accumulation” (O’Connor, 1988:18). C’est-à-dire qu’elles sont “non seulement inévitables mais nécessaires, étant donné que c’est la seule manière de retrouver un équilibre et de faire que les contradictions internes de l’accumulation de capital puissent être tout au moins temporairement résolues” (Harvey, 2010 : 71). Le tourisme contribue aussi à créer et à résoudre les crises du système économique, pour maintenir ainsi le capitalisme. Un exemple est la création d’une fiction autour de la neutralité, voire la vertu du tourisme, qui occulte ses effets négatifs, sociaux et environnementaux (Blázquez-Salom, 2013).
Le capitalisme néolibéral affronte la crise systémique – environnementale, sociale et financière – avec plus de marchandisation, pour tirer profit – mais en faisant comme si il le résolvait – du problème des limites environnementales à la croissance économique (Castree, 2008 : 146). C’est ainsi que le dernier Sommet de la Terre, Rio+20, s’est fondé sur la proposition d’une “économie verte” comme solution à la crise du capitalisme (UNEP, 2011). Cette instrumentalisation démontre comment le bloc historique du développement durable (Sklair, 2001) manipule le consentement afin de maintenir l’hégémonie de l’élite dirigeante (Igoe, Neves et Brockington, 2010). Et de la même façon que le capitalisme vert offre le commerce les droits d’émissions de gaz à effet de serre comme solution au problème environnemental du chauffage global, le tourisme s’attribue des contributions à la durabilité d’une véracité douteuse : il vend la solution romantique selon lquelle celui qui consomme sauve la planète (Igoe, Neves et Brockington, 2010 : 503), qu’une économie de services peut générer une croissance avec la moindre consommation de biens et d’énergie (WCED, 1987) – parce qu’il délocalise non seulement la production mais aussi la consommation, en délocalisant aussi plusieurs de ses externalités négatives -, ou qui fournit un enrichissement personnel illimité d’expériences – en manière de succédané d’une l’accumulation illimitée du capital – (Fletcher et Neves, 2012). Évidemment, il s’agit de solutions pour le capitalisme et non pour les problèmes environnementaux. Des accords pour les crises de suraccumulation de capital, au moyen desquelles “le capitalisme change les problèmes environnementaux que lui même croit en opportunités de plus grandes marchandisations de biens et d’expansion du marché” (Igoe, Neves et Brockington, 2010 : 489).
Karl Polanyi (2001) a caractérisé cette déconnexion, disembedding, entre l’économie et la société comme la plus grande menace qui pèse sur le marché autorégulé. L’accumulation primitive inhérente au capitalisme fait pression pour convertir en marchandises échangeables le
Via@ - revue internationale interdisciplinaire de tourisme
n°2 – 2014 Varia
2
territoire, les ressources naturelles et le travail, “en réduisant l’humain et le non humain à de simples “choses”, des objets et des instruments d’échange” au moyen de “fermeture, déplacement et aliénation tendant à vider les relations socio-naturelles de leur contenu substantiel” (Prudham, de 2013, p. 1579). La domination des intérêts mercantiles sur les intérêts généraux de la société ouvre une brèche institutionnelle c’est-à-dire politique. La société répond – au moyen de ce qu’il a nommé un “contre-mouvement” – essayant de se protéger des excès mentionnés par l’exercice de la démocratie qui crée de la stabilité. Le schéma établi par Karl Polanyi éclaire cette analyse des tensions entre les institutions économiques et politiques.
• La spécialisation touristique des Iles Baléares
Les Îles Baléares concentrent les sièges sociaux des principales entreprises touristiques espagnoles. Les facteurs qui contribuent à leur configuration comme haut-lieu touristique s’expliquent par la connivence de ce grand entreprenariat avec l’État – depuis la dictature franquiste jusqu’aux gouvernements de la monarchie -, ses alliances avec des opérateurs touristiques non européens et la primauté de ces îles comme destination touristique fortifiée par l’appartenance espagnole à l’Union Européenne et à l’OTAN (Rullan, 2012; Yrigoy, 2013).
84% du produit intérieur brut des Iles baléares proviennent du secteur des services ; les Baléares ont reçu 12 992 745 touristes en 2013, avec une augmentation de la fréquentation de 14,5% depuis 2010 (http://ibestat.caib.es; ATB, 2014). Ces dernières années, l’instabilité des destinations touristiques d’Afrique du Nord a favorisé cette destination choisie par les Allemands (31,5% des arrivées en 2013), des Britanniques (25,7%) et des Espagnols (15,1%).
Leur capacité d’accueil a évolué à la hausse, avec une croissance de 13,3 % entre 2001 et 2008, en passant de 2,2 millions de lits à 2,5 ; majoritairement concentrée dans les logements théoriquement résidentiels (qui ont crû de 15,9 %, en passant de 1,8 à 2,1 millions de lits), plus que dans des hébergements touristiques marchands (qui ont seulement crû de 2,2 %, en passant de 414 000 lits à 423 000) (Murray, 2010). Cette discordance si accentuée est due à la perte d’intérêt du développement des hébergements touristiques marchands durant la “bulle immobilière” et l’internationalisation du capital hôtelier baléare. L’intérêt du capital allait vers la construction résidentielle, mais pour profiter de la valeur d’échange spéculatif de ces logements ou de leur potentiel touristique plutôt que pour leur usage spécifique (Hof et Blázquez, 2013).
• Le consensus social contre la baléarisation
Dans le cas qui nous occupe, les excès du capitalisme ont leur expression territoriale dans ce qu’on nomme la “baléarisation”, dénomination péjorative adoptée par la propre société baléare pour dénoncer la détérioration environnementale et sociale provoquée par le tourisme. L’acceptation sociale de cette disqualification du modèle économique peut être entendue comme un mouvement de protection de la société contre la marchandisation touristique d’une grande diversité de biens et de valeurs communes : la côte, le paysage, l’espace urbain, la prise de décisions politiques dans une démocratie ou la qualité des emplois. Les tensions entre les abus du capital touristique et les dénonciations et demandes de la société ont été résolues, entre d’autres réactions sociales, au moyen des campagnes écologiques de défense du territoire et un va-et-vient dense de mesures légales de planification territoriale et touristique. Les alliances sociales en vue de la défense du territoire ont disposé des appuis tant des secteurs patronaux touristiques (du commerce et de l’hôtellerie) que des institutions conservatrices (la Société de la Promotion du Tourisme de Majorque ou l’évêques des Baléares) (Barceló, 2002; Deig, Ubeda et Ureña, 1990). Mais la défense du territoire a reçu l’essentiel de son appui social des classes moyennes propriétaires qui, en tant qu’héritières de petits patrimoines contribuant à leur fournir travail ou rente, combattent la concurrence future due à une plus forte croissance urbaine et touristique. Une large alliance sociale articule et répand des discours critiques sur la “baléarisation”, de l’écologisme au conservatisme parce que la conservation caractérise l’ADN baléare (Rullan, 2010). Coïncidant avec le modèle défini par Karl Polanyi, la défense territoriale et environnementale ne consiste pas, par conséquent, en propositions pour résoudre la tension entre le capital et le travail, provoquée par l’exploitation de travail et la réduction salariale. Un mouvement de protection “autour des intérêts sociaux menacés par le marché et non autour des intérêts de classe” (Polanyi, 2001, p. 169) répond à cette dépossession de biens communs. A cette dépossession de biens communs répond un mouvement de protection “autour des intérêts sociaux menacés par le marché et non autour des intérêts de classe” (Polanyi, 2001, p. 169).
• La protection du territoire
L’histoire de la planification territoriale et touristique des Iles baléares s’est caractérisée par l’application de mesures de limitation de la croissance. Il en a été ainsi depuis les débuts de la démocratie, avec la première loi autonomique baléare en 1984, jusqu’au commencement de l’actuelle crise, avec la dernière loi autonomique protectionniste en 2008 (Rullan, 2010). On a appliqué des mesures de protection d’espaces naturels et de la frange côtière non urbanisée, l’interdiction de constituer de nouveaux noyaux urbains, la limitation de la croissance de la surface urbanisée, le déclassement de secteurs de sol urbanisable, l’établissement de quotas pour la concession de permis de
Via@ - revue internationale interdisciplinaire de tourisme
n°2 – 2014 Varia
3
construire dans des zones urbano-touristiques (Rullan, 2005), la résorption d’enclaves touristiques obsolètes, la nécessité de réduire le nombre des lits touristiques pour pouvoir en construire de nouveaux, etc. (Salom, 2011). Le consensus social sur les “moratoires sur la croissance” (Bianchi, 2004) a amené à caractériser ce processus comme une “véritable course pour le déclassement de sols urbanisables” (Blasco, 2002, p. 234). Ces réductions du potentiel de croissance ont été interprétées comme des exemples de forte durabilité, fondées sur des décisions démocratiques de grande qualité (Bauzá, 2007, p. 17).
D’un autre côté, Alícia Bauzá a aussi attiré notre attention sur le développement des infrastructures, moins apparent que le développement urbain, et qui ne s’est pas arrêté pendant toute la période des “moratoires sur la croissance”. Tant est si bien que les mouvements sociaux, qui se sont mobilisés pour exiger le freinage de la croissance urbaine, négligèrent de s’opposer à ces développements qui augmentent substantiellement la capacité d’accueil de croissances futures de la consommation d’espace et de ressources naturelles (Bauzá, 2013). Son étude a porté en particulier sur l’extension de l’aéroport de Palma (Bauzá, 2013), qui a doublé sa capacité grâce à un agrandissement en 1997 avec pour conséquence la prise en charge de fonctions de redistribution d’un hub, en particulier pour les compagnies aériennes low cost. A cette infrastructure qui fonctionne comme l’entrée principale de l’île, s’ajoute le transport intérieur, comme les autoroutes (Blázquez-Salom, 2006) ou les réseaux de fourniture d’eau par dessalement (Hof, Blázquez-Salom, Comas et Baron, 2014), l’alimentation électrique, le traitement de l’incinération des déchets solides, etc. (Murray-Mas, 2012, p. 1298-1303). Ces développements se sont produits dans un contexte de fortes entrées de capitaux et de fonds européens. Par exemple, l’agrandissement de l’aéroport en 1997 (investissement de 240 000 000 €) a été financé à 75% par des fonds de l’Union européenne (Bauzá, 2013). Le développement de ces méga projets de transport et d’approvisionnement urbain a supposé la fixation spatio-temporelle du capital, comme une solution à leur crise de suraccumulation (Harvey, 2003). De la sorte, le capital accroît le retour sur bénéfice tout en se fixant spatialement. Cette fixation spatio-temporelle caractérise la mondialisation néolibérale, définie par la flexibilité financière des mécanismes d’accumulation du capital (Coq-Huelva, 2013).
• La trahison de la trajectoire protectionniste
Dès 2008, la tradition normative baléare de protection du territoire s’est inversée avec l’excuse de la crise. La monnaie ne pouvant pas dévaluer du fait de l’unification monétaire de l’euro, c’est le territoire qui a été dévalué, comme cela s’est fait pour les salaires, les pensions ou les dotations publiques d’éducation ou de santé (De Castro y Pedreño, 2012).
Le capitalisme globalisé impose la compétitivité territoriale et urbaine, qui suppose une plus grande “flexibilité spatiale” (Jessop, 1992) en concordance avec le régime d’accumulation post-Fordiste (Harvey, 1989). La flexibilité spatiale se matérialise dans le fait que l’espace superpose divers usages et significations (Mayhew, 2009), pour mieux s’adapter aux circuits globaux du capital.
La déréglementation signifie, en termes généraux, la réduction normative des obligations et responsabilités de toutes sortes – de travail, fiscales, environnementales …-, pour favoriser la libre initiative patronale, sous couvert de créer un milieu favorable à l’investissement (et à la croissance), à la concurrence et l’innovation. Cette déréglementation – “roll back” (refoulement) de l’État – constitue l’un des outils du capitalisme néolibéral, compatible avec de nouvelles formes de régulation favorables à de nouvelles voies d’accumulation du capital – “roll forward” (redéploiement) – (Brenner et Theodore, 2002 : 369) ou re-régulation (Castree, 2008 : 142).
Stephen Britton nous donne le mode d’emploi pour relier la fixation de capitaux au marché touristico-immobilier : “Avec les énormes réserves de capitaux qui circulent dans le monde à la recherche d’investissements à haut rendement et sans risque, il y a eu une forte augmentation de la spéculation internationale” (1991, p. 471). Le relâchement des normes de planification urbaine et régionale aux Baléares attire des flux de capitaux vers les nouveaux marchés de biens fonciers, davantage pour un usage spéculatif que un usage de logement (Hof et Blázquez, 2013). On a ainsi obtenu qu’aux Îles Baléares, “les hôtels, centres touristiques, résidences secondaires pour retraités et ports de plaisance soient reconnus par les investisseurs institutionnels et les petits investisseurs comme un segment attractif du marché immobilier” (Britton, 1991, p. 472). Pour attirer et accueillir ces capitaux, on légifère et on développe la planification territoriale qui supprime la protection du territoire et favorise l’urbanisation. A la faveur de la crise, on en profite pour relancer les projets urbains ratés, devenus des actifs toxiques pour leurs promoteurs et les entités financières qui les appuient. La régulation revitalisante de ces “zombis urbainistiques” – définis comme “des projets qui avaient provoqué un fort rejet social et qui semblaient le propre d’époques révolues” (Murray, 2013a, p. 274) – sert à assainir les comptes financiers de ces actifs toxiques.
La crise a permis que l’intérêt du lobby urbano-touristique triomphe dans son opposition à la limitation, en imposant son critère de maximisation de l’accumulation du capital à la faveur d’un cadre légal favorable à la croissance (Artigues-Bonet et Blázquez-Salom, 2012; Yrigoy, Artigues et Blázquez-Salom, 2013). On peut donc appeler ce moment une “course à l’amnistie des illégalités”. Cette instrumentalisation de l’État traduit une détérioration de la
Via@ - revue internationale interdisciplinaire de tourisme
n°2 – 2014 Varia
4
démocratie, selon les termes utilisées par Karl Polanyi (2001).
Karl Polanyi a identifié la sortie de la crise de 1929 à travers trois mécanismes de réponse politique et d’éloignement de la doctrine du libre marché, qu’il a appelés la “Grande Transformation” : le New Deal américain, le socialisme autoritaire et le fascisme. Carlos de Castro et Andrés Pedreño (2012) ont transposé cette même analyse aux crises du capitalisme régulé des années 1970 et du capitalisme néolibéral initié en 2008, en mettant l’accent sur la solution « dé-démocratisante » de la vie sociale. Cette « dé-démocratisation » peut se comparer aux trois réponses politiques à la crise systémique du capitalisme de 1929 de la première moitié du XXe siècle identifiées par Polanyi, qui se caractérise par la subordination du pouvoir des États et l’érosion du pouvoir organisationnel des travailleurs, en faveur des intérêts des corporations patronales et financières.
Nous en avons la preuve dans de nombreuses réformes législatives permettant au capitalisme de se doter de nouvelles structures favorables de régulation à l’accumulation de capital. Pour le dire plus prosaïquement, la régulation étatique se laisse guider par le marché néolibéral, « roulant de conserve », roll with it, par exemple grâce à la dérégulation territoriale. De même que Castro et Pedreño (2012) analysent les modifications législatives relatives au domaine financier et de travail, nous envisagerons les traits communs des nouvelles politiques de (dé)planification touristique aux Baléares, ainsi que les tensions résultant de la résistance de la société générées par la dépossession néolibérale et la « dé-démocratisation » concernant les biens communs. Nous entendons par biens communs « les résultats de la production sociale, qui sont nécessaires pour l’interaction sociale et la production postérieure comme les savoirs, langages, codes, informations, affects » (Hard et Negri, 2011 : 10). Etant donné que la qualité de l’environnement est le support de l’activité économique touristique aux Baléares, sa durabilité a suscité l’intérêt de nombreux agents sociaux qui s’allient pour la préserver ou pour l’utiliser pour leur propre compte. Le cas le plus emblématique est celui des hôteliers. Et on comprend que leur expression populaire a consisté en une dénonciation de la baléarisation.
• La domination politique des hôteliers baléares
Joan Amer (2006) a analysé l’action politique des hôteliers baléares, arrivant à la conclusion qu’elle modèle la règlementation législative de ces îles dès avant l’instauration de l’actuelle monarchie parlementaire. Joan Buades (2014) analyse l’internationalisation de ces mêmes hôteliers, qui ont amplifié leur activité en devenant des entreprises transnationales. Ivan Murray (2012) attribue un rôle de premier plan à cette classe capitaliste globale au centre de son analyse de l’évolution géohistorique du
capitalisme baléare, pour être la promotrice de la globalisation néolibérale. L’activité de ces entreprises touristiques repose sur la satisfaction de la minorité habitant le “Nord Global”, déplaçant continuellement son activité vers de nouvelles destinations émergentes (Britton, 1982) en y développant de nouvelles enclaves touristico-immobilières. Le capitalisme néolibéral a favorisé le renforcement des entreprises transnationales, avec, dans le cas du tourisme, les modalités suivantes : des stratégies d’intégration horizontale et verticale au moyen de l’absorption d’autres entreprises, les modalités de gestion des établissements en commercialisant la propriété de l’immeuble, spécialement aux fonds de placement (Real Estate Investment Trusts) et d’un capital-risque, ou l’évasion fiscale en localisant des filiales dans des paradis fiscaux pour réaliser des opérations financières (Raymond, 2002; Murray, 2012). Au XXIe siècle survient la fin de la “globalisation heureuse” du capitalisme hégémonique après la chute du bloc de l’Est (Fernández Durán, 2003) qui favorise les destinations touristiques sûres, comme les îles les Baléares ou les Caraïbes, celles-là mêmes dans lesquelles se sont spécialisées les chaînes touristiques baléares. Mais l’instauration de la monnaie unique européenne rend encore plus rentables les destinations touristiques hors de l’Espagne, étant donné que “avec l’entrée en vigueur de l’euro *le 1er janvier 2001+, l’Espagne devient un espace cher, particulièrement pour les touristes qui jusqu’alors étaient attirés par un différentiel notable dans les taux de change entre les monnaies des pays émetteurs et la peseta espagnole” (Murray, 2012, p. 771).
L’implantation des hôteliers baléares dans des pays pauvres a permis la mise au point de son know how patronal, expérimenté et perfectionné aux Îles Baléares, y compris l’instrumentalisation de l’État (Blázquez, Murray et Artigues, 2011a) pour “dé-démocratiser” les sociétés (De Castro et Pedreño, 2012). Le capital touristique baléare domine l’environnement social pour soumettre le cadre règlementaire à son intérêt. C’est ce qui se produisit avec sa campagne réussie d’élimination de l’”écotaxe » baléare (2002-2003). L’écotaxe visait à fournir au bout du compte des recettes aux administrations publiques pour qu’elles puissent investir dans des améliorations de l’environnement; mais aussi à contrôler l’offre de logement touristique en stagnation du fait de l’application de moratoires sur la croissance, la délocalisation des opérations touristico-immobilières des hôteliers et l’attraction du capital par le développement immobilier touristico-résidentiel non régulé (Blázquez et Murray, 2010; Binimelis, 2002). Le même gouvernement marionnette qui a éliminé l’éco-taxe, a aussi levé la protection d’environ 22 400 hectares de parcs naturels, ce qui donne une idée de son orientation politique et du pouvoir du caciquisme touristique (Murray, 2005).
Mais comme on dit en catalan, volta al món i torna al Born. La capacité hégémonique de cette classe capitaliste
Via@ - revue internationale interdisciplinaire de tourisme
n°2 – 2014 Varia
5
internationale imprègne idéologiquement la société baléare, qui assume son modèle de développement, perfectionné après son aventure américaine d’accumulation par dépossession et gentrification touristique (Blazquez-Salom, Vallon et Murray, 2011). Les hôteliers baléares reprennent leurs aises dans leur lieu d’origine. La crise globale, le renchérissement des combustibles et l’augmentation des tensions sociales leur font redéfinir leurs intérêts, en donnant un tour de vis supplémentaire à leur exploitation touristique des Îles Baléares.
• La croissance du contrôle du tourisme baléare par les entreprises
L’actualité nous donne des exemples du changement de modèles d’investissements par les entreprises hôtelières aux Baléares (Artigues, Blázquez et Yrigoyen, 2014). Iberostar choisit un nouvel emplacement près de l’autoroute de ceinture de Palma (Majorque) pour son nouveau siège social, construit entre 2008 et 2011. Barceló Hotels International achète en 2006 l’hôtel Formentor, établissement doyen de l’offre touristique baléare et célèbre son 75e anniversaire, « comme un témoignage de gratitude envers l’île qui l’a vu naître » (www.barcelo.com, consulté le 8/10/2013). Meliá Hotels International obtient une “déclaration d’intérêt autonomique” (30/09/2011) lui permettant de remodeler et “gentrifier” les enclaves hôtelières qui ont été à l’origine de la chaîne à Magaluf, avec en outre, dans l’arrière-pays de la même zone, le projet de quatre nouveaux hôtels et d’un centre commercial de la chaîne Viva Hoteles. Le projet Meliá Hotels International adopte le format beach club et, sous le nom de Calviá Beach Resort, offre un usage préférentiel de la plage publique. Matutes fait un pari similaire en transformant son établissement Fiesta Hotel Playa, à En Bossa (Ibiza) en un beach club nommé Ushuaïa Ibiza Club Hotel (Aversa, 11/12/2013). Le remodelage de la plage de Palma renvoie aussi à de nombreux intérêts (Artigues, Blázquez, 2012) favorables à la « machine de croissance » urbano-touristique (Logan et Molotch, 1987) avec, comme nouveauté, l’approbation initiale d’une nouvelle version du Plan de Reconversion Intégral qui permettrait davantage de sol urbanisé, au préjudice des espaces libres et naturels, en fournissant un supplément de 111,67 ha de sols urbanisables (Yrigoyen et al. 2013). La présence des chaînes hôtelières n’a cessé de croître, montrant leur hégémonie en matière de capacité de logement touristique. (voir le graphique 1 et le tableau 1).
Graphique 1. Nombre de lits touristiques gérés par les chaînes hôtelières aux Iles Baléares. Source : Murray, 2012
Tableau 1. Pourcentage de lits gérés par les chaînes hôtelières aux Iles Baléares. Source : Murray, 2012
La crise a justifié des changements des règles pour favoriser le retour au bercail du capital baléare, désireux d’augmenter la rentabilité des capitaux spéculatifs dans le contexte de la crise et tenté par une plus grande intégration du tourisme au secteur immobilier. Les administrations publiques ont favorisé cet investissement urbano-touristique de différentes façons : par l’intervention keynésienne qui tenta, pendant les premières années de la crise, de réactiver le secteur de la construction, par exemple grâce à des méga-projets urbains (Artigues et al., 2013) ; par des sauvetages financiers d’entités bancaires (Commission nationale des marchés et de la concurrence, 2014) ; par la légalisation de parcelles illégales, pour revaloriser des actifs financiers (Hof et Blázquez, 2013) ; par la revitalisation de projets urbanistiques paralysés, pour revaloriser les actifs toxiques (Murray, 2013b) ; et enfin, par la flexibilisation des zones touristiques (Artigues-Bonet; et al., 2013; Yrigoy et al., 2013). Les hôteliers ont été les principaux acteurs des changements d’attitude des administrations publiques, en ce qui concerne le dernier point.
• Flexibilisation socio-environnementale négative
Les interventions pour la reconversion des enclaves touristiques génèrent en corollaire d’importantes conséquences. Les plus graves sont la gentrification de l’espace, l’instrumentalisation de la durabilité et la flexibilité négative de la force de travail.
Les projets de restructuration de ces zones renforcent la ségrégation des classes sociales, en accusant le tourisme de masse, à faible pouvoir d’achat, de détériorer
Via@ - revue internationale interdisciplinaire de tourisme
n°2 – 2014 Varia
6
l’environnement. Avec ces restructurations des centres touristiques, on met l’accent sur la différenciation spatiale des aires choisies pour la reconversion, en donnant lieu à un processus de gentrification (Smith, 2002) en soumettant les espaces publics à l’exploitation des établissements touristiques privés. L’argument de l’environnement ou du durable est l’alibi pour favoriser la privatisation des zones côtières par la construction de beach clubs, en application de la modification, mentionnée plus haut, de la Loi sur les littoraux qui, du reste, prend le nom de « Loi 2/13 du 29 mai, de protection et usage durable du littoral ». Ce nom est un bon exemple de la rhétorique utilisée pour ce changement normatif néolibéral.
L’hégémonie de l’élite liée au tourisme aux Baléares peut se démontrer aussi par la légitimation et la propagation de sa manière de comprendre le développement durable (Igoe, Neves et Brockington, 2010) comme un capitalisme vert (Magdoff et Foster, 2011) illustrant le concept de « bloc historique de développement durable » (SKLAIR, 2000). Son adaptation au problème environnemental à son bénéfice implique la mise en place d’alliances avec d’autres institutions sociales. Par exemple, avec l’Université des Iles Baléares dont les entreprises patronnent certaines chaires : la chaire Sol Meliá sur les Études Touristiques, patronnée par la chaîne hôtelière Meliá Hotels International, et qui travaille sur le discours sur la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises ; et la Fundación Cátedra Latinoamericana présidée par Barceló Hotels and Resorts. Les chaînes hôtelières baléares ont joué un rôle leader dans la société, à l’intérieur comme à l’extérieur des Iles, une fois réalisé leur projet de prise de pouvoir comme classe capitaliste ; et ce, malgré les graves conséquences du développement urbano-touristique sur la dégradation sociale, démocratique et environnementale aux Baléares (Blázquez, Artigues y Murray, 2011a; Murray, 2011 ; Murray, Blázquez y Amer, 2010). La formation de l’empire touristique baléar implique donc le caciquisme de la classe hôtelière, qui aujourd’hui fait partie de la « marque baléare » (Buades, 2009). La réhabilitation de destinations touristiques anciennes se fait sous le drapeau de la durabilité, masquant ainsi une plus grande croissance urbanistique (Artigues-Bonet, Blázquez-Salom y Yrigoy, 2014) et l’augmentation du domaine corporatif : Iberostar, Riu, Barceló, Hipotels, Aqua Magica, Grupotel, Hoteles HM, Mac, etc. à Platja de Palma (Ruiz y Mateis, 06/06/2013 ; Preferente, 24/04/2013 ; Hosteltur, 30/04/2013) ; Meliá Hotels International à Magaluf ; Matutes à Platja d’en Bossa.
La domination sociale des hôteliers est telle qu’ils en arrivent même à s’en vanter. Leurs propres sources d’information évoquent leur lobbying pour changer la législation, en connivence avec le pouvoir politique : ils prennent l’initiative de projets d’investissements qu’ils déclarent « en attente de l’approbation du Décret-Loi sur les Mesures Urgentes » qui « garantirait » ceux-ci
(Preferente, 24/04/2013; Hosteltur, 30/04/2013). Ils expliquent aussi les chantages exercés par les hôteliers sur le gouvernement pour lui assurer un appui politique en échange de régulations à la carte en cas de reconversion des zones de reconversion à l’étude, indiquant, non sans une certaine ironie, que les grands groupes hôteliers des familles Matutes, Barceló et Escarrer « ont des intérêts concrets qui dépendent des décisions politiques des institutions gouvernées par le PP2 » (Diari de Balears, 9/10/2013).
Avec la crise on en profite pour flexibiliser la force de travail. L’emploi dans le secteur touristique est déjà par essence de mauvaise qualité : faible rémunération, faible qualification, peu de sécurité d’emploi (Britton, 1991). En l’absence de possibilité de dévaluation de la monnaie unique dans les pays de l’UE, la baisse salariale est une alternative, un moyen pour attirer davantage d’investissements et de demande touristique. Les salaires des travailleurs de l’hôtellerie baléare ont été les plus bas de tous les secteurs économiques en 2011, d’après l’Enquête Annuelle sur la Structure Salariale (INE, 2013a ; Diario de Mallorca et EFE, 28/06/2013). Selon la Comptabilité Nationale d’Espagne, la part des salaires dans le PIB (au total 44,24%) est tombée sous le niveau des revenus du capital ou excédent brut d’exploitation (46,16%) en 2012 (INE, 2013b, Bolaños, 28/02/2013). De plus, l’embauche illégale est monnaie courante. Sur ce sujet, l’Inspection du Travail enquête sur les entreprises Nikki Beach de Magaluf (partie prenante du projet de reconversion de Meliá Hotels International) et Hotel Formentor, de la chaîne Barceló (Manso, 09/12/2012). Même après une année record en matière touristique, le syndicat patronal hôtelier réclame le gel des salaires (Hosteltur, 10/12/2013). Les grandes entreprises hôtelières transfèrent leur know how –dans ce cas, la flexibilité négative des conditions de travail– depuis les nouvelles périphéries touristiques vers les régions d’origine, dans ce cas les Iles Baléares (Blázquez, Cañada y Murray, 2011).
• Résistances citoyennes et contre-mouvements pour créer de la stabilité
Le mouvement écologique a dénoncé les formes les plus agressives d’urbanisation liées au tourisme et au développement d’infrastructures – par exemple par l’usage de la dénomination méprisante de “baléarisation” -, avec des résultats appréciables en termes de consensus social (Carte 1). De ce consensus a dérivé la promulgation des normes de protection du territoire.
Une explication plus complexe serait que, comme cela s’est aussi produit aux Îles Canaries, les restrictions à l’expansion urbano-touristique favorisent l’accumulation du capital au bénéfice de ” coteries régionales de pouvoir qui ont pu consolider leur monopole sur les moyens de production du tourisme au travers de ses groupes de pression, en
Via@ - revue internationale interdisciplinaire de tourisme
n°2 – 2014 Varia
7
soutenant un modèle de durabilité fondé sur le ‘ tourisme de qualité ‘ ” (Bianchi, 2004, p. 517). Ainsi il arrive que la manipulation rhétorique du défi de la durabilité résolve le problème de l’accumulation de capital fondée sur l’investissement immobilier, des principales entreprises touristiques et du secteur de la construction. Les entreprises dominantes manipulent le mécontentement populaire, qui s’exprime au moyen de la critique de “baléarisation”, en utilisant l’appât du “développement du tourisme durable et de qualité” pour continuer de croître et favoriser l’accumulation de capital (Hof et Blázquez-Salom, n.d.); ce faisant, “tout change pour que rien ne change”, selon le célèbre adage de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Le système se vaccine de ses propres contradictions, par exemple par des alliances entre classes, qui éviteraient l’effondrement; en reprenant l’analyse de Karl Polanyi : “le contre-mouvement de protection devait arriver pour prévenir le désastre d’une économie désintégrée. Polanyi suggère qu’un mouvement orienté à promouvoir l’économie du laissez faire nécessite un contre-mouvement pour créer une stabilité” (Block, 2001, p. xxviii).
Carte 1. Carte interactive dénonçant les conflits territoriaux et environnementaux à Majorque. Source : Fuente: GOB Mallorca (consultée le 8 novembre 2013).
– See more at: http://www.gobmallorca.com/la-campanya/mapa-de-conflictes.html#sthash.AnIa1Ty5.dpuf
Le conflit social pour la défense du territoire n’est pas l’unique brûlot aux Baléares. L’endettement hypothécaire et le sauvetage bancaire se sont soldés par des expulsions, dénoncées par la Plate-forme de Victimes d’Hypothèque (http: // afectadosporlahipoteca.com/), et par la détérioration de la dotation publique de santé et d’éducation, à la suite des coupes budgétaires. La défense d’une éducation publique et de qualité a donné lieu à la plus grande manifestation de l’histoire des Îles Baléares, le
29/9/2013, à l’initiative de l’Assemblée des Enseignants (http: // assembleadocentsib.blogspot.com.es/).
• Décroissance urbano-touristique et radicalité démocratique
Il a été prouvé qu’il existe une relation directe entre le tourisme de masse, l’épuisement des ressources énergétiques fossiles et le changement climatique (Hall, Scott y Gössling, 2013). Le tourisme de masse, avec ses déplacements fréquents et de longue distance, est le type de tourisme le plus préjudiciable à l’environnement. C’est aussi la plus contrôlée par le capital corporatif, qui s’approprie la majorité des bénéfices en les expatriant –fuite des capitaux ou leakeage– du lieu d’accueil des touristes (Britton, 1992). Le contrôle de la corporation au niveau international s’appuie sur les Etats qui, ainsi, mettent en avant le maintien du crédo du développement, le maintien de l’échange inégal et, finalement, du système capitaliste. Le tourisme en soi n’est pas discutable, à l’instar d’autres activités humaines. Ce qui est discutable c’est le capitalisme, du fait qu’il dépend d’une croissance composée, qui n’est pas possible à long terme, car elle provoque des crises environnementales et sociales non soutenables, consubstantielles à l’accumulation de capital par la classe sociale dominante.
Par conséquent, on peut plaider pour que la durabilité arrive par le biais de la décroissance (Georgescu-Roegen, 1971). Dans ce sens, certaines des mesures proposées pour faire face à ces menaces et rendre le tourisme plus durable concernent sa fréquence, les distances parcourues et les moyens de transport utilisés ; c’est-à-dire, si on applique au moins ces mesures palliatives : moins voyager, aller plus près, avec des séjours plus longs, en utilisant des moyens de transport plus efficaces et recommandés (Hall, 2009). D’autres propositions ont davantage d’impact sur les limitations de la croissance urbano-touristique, en particulier dans les espaces insulaires où la population montre son mécontentement devant l’excès de pression touristique (Bianchi, 2004). Tout cela sans oublier que l’insularité même ou le caractère saisonnier dû au climat impliquent des limites à la croissance urbano-touristique dans les petites îles, d’autant plus si elles sont éloignées du continent (Rullan, 2010).
Conclusions
Le capital d’entreprise marque le devenir la société capitaliste. Dans le cas des Baléares, il s’agit principalement des hôteliers qui ont renforcé et étendu leur activité à la faveur de la globalisation néolibérale, en inspirant des publiques politiques conformes à leurs intérêts, tant aux Baléares que dans les nouvelles destinations qu’ils colonisent. Le bras de fer entre leurs intérêts et la société se manifeste à l’évidence dans le fait de négocier ou de
Via@ - revue internationale interdisciplinaire de tourisme
n°2 – 2014 Varia
8
supprimer les “moratoires” à la croissance aux Baléares. Les changements de règles qu’ils suscitent dans le contexte de la crise actuelle démontrent leur influence dé-démocratisante qui instrumentalise les résistances en tant que contre-mouvements faits pour favoriser la stabilité du système. Le bras de fer illustre la domination des entreprises, face à l’exigence de radicalité démocratique de la société.
Comme avec la flexibilité touristico-territoriale analysée ici – que Ivan Murray compare à un “shock territorial” (2013a, p. 274) -, les mesures néolibérales qui s’appliquent mettent en place un marché autorégulé au détriment du bien-être et de la durabilité. Comme on l’a démontré, plutôt qu’un marché autorégulé il s’agit d’une instrumentalisation de l’Etat pour réguler le marché au bénéfice du capital. Tout cela ajouté à la répression des contre-mouvements de la société, par des mécanismes de contrôle et de répression sociale, aboutit à un recul de la liberté, véritable dé-démocratisation de la société. Il est évident qu’il faut faire avancer les contre-mouvements démocratiques au-delà de l’assainissement et du maintien du système, au-delà des solutions – plutôt des rafistolages – aux contradictions du capitalisme. De nouvelles approches anticapitalistes “co-révolutionnaires” (Harvey, 2011, p. 20) de l’action sociale, favorables à la décroissance, y compris du tourisme, deviennent urgentes et seront indispensables.
REMERCIEMENTS
Nous remercions pour leur aide les professeurs Rémy Knafou et Alfonso Fernández Tabales, ainsi que le réviseur anonyme pour ses corrections et ses remarques.
La recherche qui a donné lieu à cet article a été financée dans le cadre du projet intitulé “Géographies des crises: analyses des territoires urbano-touristiques des Iles Balécares, de la Costa del sol et des principales destinations touristiques des Caraïbes” (CSO2012-30840) du ministère de l’Economie et de la Compétitivité.
NOTES
1 Ajout du traducteur.
2 Partido popular, Parti populaire, parti conservateur et libéral, à nouveau au pouvoir (à Madrid comme à Palma de Majorque) depuis 2011 (Ndt)..
BIBLIOGRAPHIE
Agéncia de turisme de les Illes Balears, ATB, 2014, El turismo a les Illes Balears. Anuari 2013. Palma: Agència de Turisme de les Illes Balears, Conselleria de Turisme i Esports. Govern de les Illes Balear. Disponible online: (consultado el 3/12/2014).
Aversa, L., 11/02/2013, “Cuatro proyectos privados ya han logrado del Govern el interés autonómico que pide Matutes”. Ultima Hora. Disponible online: http://ultimahora.es (consultado el 8/10/2013).
Amer, J., 2006, Turisme i Política. L’empresariat hoteler de Mallorca. Palma: Documenta Balear.
Artigues A.A., Blázquez M., 2012, “¿Reconversión o desregulación? Análisis de planes de reconversión turístico-inmobiliaria de la Playa de Palma (Mallorca)”. Cuadernos de Turismo, 29, pp.11-34.
Artigues A.A., Bauzá A., Blázquez M., González, J. Rullan O., Vives S., Yrigoy I. (Grup d’Investigació en Sostenibilitat i Territori), 2013, “La profundización de la vía urbano-turística-financiera en Palma (2007-2011): políticas y materialización en tiempos de crisis”. Observatorio Metropolitano de Madrid (eds.). Paisajes devastados. Después del ciclo inmobiliario: impactos regionales y urbanos de la crisis. Madrid: Traficantes de Sueños, pp. 355-388. Disponible onlineconsultado el 14/10/ 2013).
Artigues-Bonet A.A., Blázquez-Salom M., Yrigoy I., 2014, “La planificació territorial i la reconversió de zones turístiques madures a les Illes Balears en l’actual crisi”. Grimalt, A. (ed.). Anuari del Turisme de les Illes Balears. Palma: Fundacio Gadeso, p. 135–146. Disponible online:(consultado el 4/11/2014).
Barceló B., 2002, “Historia del turisme a Mallorca”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, XV (50), pp. 31-55).
Bauzá van Slingerlandt A., 2007, “Insular Land Use Planning on the Balearic Islands (Spain): Weak or Strong Sustainability?”. Proceedings of the Inaugural Meeting of the IGU Commission on Islands, Island Geographies International Conference. Taipei, Taiwan, 29 October–3 November 2007; Volume I, pp. 4-20.
Bauzá van Slingerlandt A., 2013, En l’espai – temps Homenatge a Alícia Bauzà van Slingerlandt. Palma: GIST, Grup d’Investigació en Sostenibilitat i Territori, Universitat de les Illes Balears y LUCID, Centre d’Excellència per a la Integració de les Dimensions Natural i Social de la Sostenibilitat, Universitat de Lund.
Bianchi R., 2004, “Tourism restructuring and the politics of sustainability: a critical view from the European periphery (the Canary Islands)”. Journal of Sustainable Tourism, 12 (6), pp. 495-529. DOI:10.1080/09669580408667251.
Binimelis J., 2002, “Canvi rural i propietat estrangera a Mallorca”, in Picornell M. et Pomar A.M. (éd.). L’espai turístic. Palma: Grup d’Investigació del Territori, Turisme i Oci, GITTO, Insitut d’Estudis Ecològics, INESE, pp. 207-236.
Via@ - revue internationale interdisciplinaire de tourisme
n°2 – 2014 Varia
9
Blasco Esteve A., 2002, “Planificación y gestión del territorio turístico de las Islas Baleares”. BLANQUER, D. (dir). Ordenación y gestión del territorio turístico. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 213-184.
Blázquez-Salom M., 2006, “Matas, megaproyectos S.A.”. Ecología Política. Cuadernos de Debate Internacional, (31), 53–56.
Blázquez-Salom M., 2013, “Tourism as a green fix to capitalism crisis”. Citarella, F. (Ed.), Economic Recesion interpretations, performances and reifications in the tourism domain. Palermo: Loffredo Editore, p. 87–103.
Blázquez M., Murray I., 2010, “Una geohistoria de la turistización de las Islas Baleares”. El Periplo Sustentable, 18, pp. 69-118.
Blázquez M., Murray, I., Artigues, A.A., 2011, “La balearización balear. El capital turístico en la minoración e instrumentación del Estado”. Investigaciones Turísticas, 2, 1-28.
Blázquez-Salom M., Cañada E., Murray I., 2011, “Búnker playa-sol. Conflictos derivados de la construcción de enclaves de capital transnacional turístico español en El Caribe y Centroamérica”. Scripta Nova-Revista Electronica De Geografia Y Ciencias Sociales, 15(368), 1–17. Disponible online: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-368.htm.
Block F., 2001, “Introduction”. Polanyi, K. The Great Transformation: the political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press, pp. xviii-xxxviii.
Bolaños A., 28/02/2013, “Los excedentes de las empresas superan a las rentas salariales en el reparto del PIB”. El País. Disponible online: (consultado el 25/7/2013).
Brenner N., Theodore N., 2002, “Cities and the Geographies of ‘Actually Existing Neoliberalism’”, Antipode, vol. 34, nº 3, pp. 349-379.
Britton S.G., 1982, “The political economy of tourism in the Thrid World”. Annals of Tourism Research, 9, 331-358.
Britton S.G. (1991). “Tourism, capital and place: towards a critical geography of tourism”, Environment and Planning D: Society and Space, 9 (4), pp.452-478.
Buades J., 2014 [2006], Exportando paraísos. La colonización turística del planeta. Alba Sud. Disponible online:(consultado el 3/12/2014).
Buades J., 2009, Do not disturb Barceló. Viaje a las entrañas de un imperio turístico. Barcelona: Icaria.
Büscher B., Fltescher R., 2015, “Accumulation by Conservation”. New Political Economy, DOI: 10.1080/13563467.2014.923824.
Castree N., 2008, “Neoliberalising nature: the logics of deregulation and reregulation”. Environment and Planning, A, 40, p. 131-152. DOI: 10.1068/a3999.
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2014, Informe de la CNMC sobre las ayudas púbicas en España 2014. Madrid: CNMC.
Coq-Huelva D., 2013, “Urbanisation and Financialisation in the Context of a Rescaling State: The Case of Spain”. Antipode, 45 (5), 1213-1231. doi: 10.1111/anti.12011
De Castro C., Pedreño A., 2012, “El péndulo de Polanyi: de la desdemocratización a la resistencia social”. AREAS. Revista internacional de Ciencias Sociales, 31, pp. 9-24.
Deig A., Ubeda T., Ureña M., 1990, “Carta pastoral dels bisbes de les Balears. Ecologia i turisme a les nostres illes”. El Mirall, 37, pp. 24-34.
Diari de Balears, 9/10/2013, “Els hotelers que entren a la batalla del TIL són ostatges del PP”. Diari de Balears. Disponibe online: http://dbalears.cat/actualitat/balears/els-hotelers-entren-batalla-del-til-son-ostatges-del-pp.html (consultado el 11/10/2013).
Diario de Mallorca EFE, 28/06/2013, “El sueldo medio en Baleares fue de 21.351 euros en 2011”. Diario de Mallorca. Disponible online: consultado el 29/7/2013).
Fernández Durán R., 2003, Capitalismo (Financiero) Global y guerra permanente. El dólar, Wall Street y la guerra contra Irak. Barcelona. Virus.
Fletcher R., 2011, “Sustaining Tourism, Sustaining Capitalism? The Tourism Industry’s Role in Global Capitalist Expansion”. Tourism Geographies, 13(3), 443–461.
Fletcher R., Neve K., 2012, “Contradictions in Tourism: The Promise and Pitfalls of Ecotourism as a Manifold Capitalist Fix”. Environment and Society: Advances in Research, 3 (1), pp.60-77. DOI: http://dx.doi.org/10.3167/ares.2012.030105.
Georgescu-Roegen N., 1971, The Entropy law and the Economic Process. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Hall C. M., 2009, “Degrowing Tourism: Décroissance, Sustainable Consumption and Steady-State Tourism”.
Via@ - revue internationale interdisciplinaire de tourisme
n°2 – 2014 Varia
10
Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 20 (1), 46–61. Disponible online: (consultado el 24/12/2014).
Hall M.C., Scott D., Gösssling S., 2013, “The Primacy of Climate Change for Sustainable International Tourism”. Sustainable Development, 21 (112–121), pp.112-121. DOI: 10.1002/sd.1562.
Hard M., Negri A., 2011, Commonwealth: el proyecto de una revolución en común. Madrid: Akal.
Harvey D., 1989, The condition of postmodernity: an inquiry into the origins of cultural change. Oxford: Basil Blackwell.
Harvey D., 2003, The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.
Harvey D., 2004, “El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión”. Socialist Register, 99–129.
Harvey D., 2010, The enigma of capital. And the crises of capitalism. London: Profile Books.
Harvey D., 2011, “Roepke Lecture in Economic Geography. Crisis, Geographic Disruptions and the Uneven Development of Political Responses”. Economic Geography, 87(1), pp. 1-22.
Harvey D., 2014, Seventeen Contraditions and the End of Capitalism. London: Profile Books.
Hof A., Blázquez M., 2013, “The Linkages between Real Estate Tourism and Urban Sprawl in Majorca (Balearic Islands, Spain)”. Land, 2 (2), pp. 252-277. DOI: 10.3390/land2020252.
Hof A., Blázquez-Salom M., en prensa, “Changing tourism patterns, capital accumulation, and urban water consumption in Mallorca, Spain: a sustainability fix?” Journal of Sustainable Tourism. DOI :10.1080/09669582.2014.991397
Hof A., Blázquez-Salom M., Comas M., Baron A., 2014, “Challenges and solutions for urban-tourist water supply on Mediterranean tourist islands. The case of Majorca, Spain”. The Global Water System in the Anthropocene. Berlin: Springer, p. 125–142.
Hosteltur, 30/04/2013, “Invertirán 100 M € en cuatro hoteles de nueva construcción en Playa de Palma”. Hosteltur, 3765. Disponible online: http://www.hosteltur.com/148490_invertiran-100-m-cuatro-hoteles-nueva-construccion-playa-palma.html (consultado el 26/7/2013).
Hosteltur, 10/12/2013, “Congelación salarial: los hoteleros de Mallorca ponen precio a la competitividad”. Hosteltur. Disponible online: http://www.hosteltur.com/126630_congelacion-salarial-hoteleros-mallorca-ponen-precio-competitividad.html (consultado el 18/12/2013).
Igoe, J., Neves, K., Brockington D., 2010, “A spectacular eco-tour around the historic bloc: theorising the convergence of biodiversity conservation and capitalist expansion”. Antipode, 42 (3), pp. 486-512. DOI: 10.111/j.1467-8330.2010.00761.x.
Instituto Nacional de Estadística, INE, 2013ª, Encuesta anual de estructura salarial. Disponible online: (consultado el 25/7/2013).
Instituto Nacional de Estadística, INE, 2013b, Contabilidad Nacional de España. 1er. Trimestre de 2013. Disponible online: (consultado el 25/7/2013).
Jessop B., 1992, “Fordism and post-Fordism: a critical reformulation”. Scott S. et Stoper M. , Eds., Pathways to industrialization and Regional Development. Londres: Routledge, pp. 42-62.
Keil R., 2009, “The urban politics of roll-with-it neoliberalization”. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, 13, pp.230–245. DOI: 10.1080/13604810902986848.
Logan J., Molotch H., 1987, Urban fortunes: the political economy of place. Berkeley: University of California Press.
Manso M., 09/12/2012, “Les pagas 300 euros al mes y si trabajan más de 8 horas, ya lo arreglamos”. Diario de Mallorca. Disponible online:(consultado el 25/7/2013).
Magdoff F., Foster J., 2010, “What every environmentalist needs to know about capitalism”. Monthly Review, 1–31. Disponible online: http://web.boun.edu.tr/ali.saysel/ESc307/Foster Magdoff 2010.pdf
Mayhew S., 2009, A dictionary of Geography. Oxford University Press, Oxford, 4ª ed.
Murray I., 2005, “El pisotón ecológico (y empresarial) en las Islas Baleares”. Medio ambiente y comportamiento humano, 6 (2), pp.123-166.
Murray I., (Coord.), 2010, Els Indicadors de Sostenibilitat Socioecològica de les Illes Balears (2003-2008), Versió Extensa. Observatori de Sostenibilitat i Territori, Grup d’Investigació sobre Sostenibilitat i Territori, Universitat de
Via@ - revue internationale interdisciplinaire de tourisme
n°2 – 2014 Varia
11
les Illes Balears: Palma (Mallorca). Disponible online:(consultado el 20/11/2013).
Murray I., 2012, Geografies del capitalisme balear: poder, metabolisme socioeconòmic i petjada ecològica d’una superpotència turística. Tesis doctoral inédita. Disponible online(consultado el 14/10/2013).
Murray I., 2013a, “Anexo II. Análisis detallado de las Islas Baleares. Islas Baleares: la “intelligentsia” responde a la crisis preparando un nuevo tsunami urbanizador”. Prieto, F. y Ruiz, J. B. (coord.). Costas Inteligentes. Madrid: Greenpeace España, pp. 267-275. Disponible online (consultado el 14/10/2013).
Murray I., 2013b, “Actius tòxics: Ses Fontanelles”. Contrainfo.cat. Disponible on line: (consultado el 25/7/2013).
Murray I., Blázquez M., Amer, J., 2010, “Doblers, poder i territori de ‘marca balear’ (1983-2009)”. Journal of Catalan Studies, 13, p. 321-350.
O’Connor J., 1988, “Capitalism, nature, socialism: a theoretical introduction”. Capitalism, nature, socialism, 1 (1), pp. 11-38.
Peck J., Tickell A., 2002, “Neoliberalizing Space”. Antipode, 34 (3), pp.380-404.
Peck J., Theodore N., Brenner N., 2010, “Postneoliberalism and its Malcontents”. Antipode, 41, 94–116. DOI:10.1111/j.1467-8330.2009.00718.x
Polanyi K., 2001 [1944], The great transformation : the political and economic origins of our time. Boston, MA: Beacon Press.
Preferente, 24/04/2013, “Proyectan cuatro nuevos hoteles en Playa de Palma”. Preferente.com, noticias de turismo para profesionales. Disponible online: (consultado el 31/7/2013).
Prudham S., 2013, “Men and things. Karl Polanyi, primitive accumulation and their relevance to a radical Green political economy”. Environment and Planning A, 15, pp. 1569-1587.
Ruiz J.L., Mateis A., 6/06/2013, “Unos veinte hoteles crecerán entre cuatro y ocho metros de altura en la Platja de Palma”. Ultima Hora. Disponible online: http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/plan-reforma-platja-palma-aprobara-final-ano.html (consultado el 31/7/2013).
Rullan O., 2005, “Una técnica urbanística para contener el crecimiento residencial en espacios con fuerte presión Inmobiliaria”. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. IX, 194 (32).
Rullan O., 2010, “Las políticas territoriales en las Islas Baleares”, 43, 403-428. Cuadernos Geográficos. Disponible online: (consultado el 24/12/2014).
Rullan O., 2011, “La regulación del crecimiento urbanístico en el litoral mediterráneo español”. Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, XLIII (168), pp. 279-297.
Rullan O., 2012, “Las políticas territoriales en las Islas Baleares”. Cuadernos Geográficos, 47, pp.403-428.
Salom A., 2011, Las limitaciones al crecimiento poblacional y espacial establecidas por la normativa territorial y urbanística. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
Sklair L., 2000, “The transnational capitalist class and the discourse of globalization”, Cambridge Review of International Affairs, 14, pp. 67-85. DOI: 10.1080/09557570008400329.
Sklair L., 2001, The transnational capitalist class. Oxford: Blackwell. DOI: 10.1080/09557570008400329.
Smith N., 2002, “New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy”. Antipode, 34 (3), p. 427-450. DOI: 10.1111/1467-8330.00249.
UNEP (2011). Towards a Green Economy: pathways to sustainable development and poverty eradication. Nairobi: UNEP.
Wallerstein I., 1988), El capitalismo histórico. Madrid: Siglo veintiuno editores.
World Commission on Environment and Development (WCED),1987, Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
Yrigoy I. (2013). “La urbanització turística com a materialització espacial de l’acumulació de capital hoteler: els casos de Platja de Palma (Mallorca) i Saïdia (Marroc)”. Treballs de la Societat Catalana de Geografía, 75, pp.109.-131.
Yrigoy I., Artigues A.A., Blázquez M., 2013, “El papel del Estado en la renovación urbano-turística de espacios turísticos. El caso de la Playa de Palma, Mallorca (España)”. Bitácora urbano territorial, 22 (1), pp.141-152.
Via@ - revue internationale interdisciplinaire de tourisme
n°2 – 2014 Varia
12
POUR CITER CET ARTICLE
Référence électronique :
Macià Blázquez Salom, Un bras de fer sur la décroissance urbano-touristique, Via@, Varia, n°2, 2014, mis en ligne le 23 janvier 2015.
URL : http://www.viatourismreview.net/Article35.php
AUTEUR
Macià Blázquez Salom
Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad y Territorio, GIST, Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de las Islas Baleares
TRADUCTION
Rémy et Hélène Knafou


















![JOKNAL DO BRAS] © JORNAl DO BRASH. SA 1996 RIODE ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633b771f0f0c3d681d0320f5/joknal-do-bras-jornal-do-brash-sa-1996-riode-.jpg)