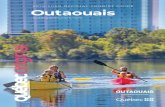TOURISME EN MEDITERRANEE : DEVELOPPEMENTS ET IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT COTIER
Transcript of TOURISME EN MEDITERRANEE : DEVELOPPEMENTS ET IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT COTIER
Programme des Nations Unies pour l'EnvironnementPlan d'Action pour la Méditerranée
Centre d'Activités Régionales pour le Programme d'ActionsPrioritaires
Forum"Gestion Intégrée des Zones Côtières en Méditerranée : Vers un protocole
régional"Cagliari, 28-29 mai 2004
TOURISME EN MEDITERRANEE : DEVELOPPEMENTS ET IMPACTS SURL’ENVIRONNEMENT COTIER
Alessio SattaEcobilancio, Rome, Italie
1 Introduction
Le tourisme est l’une des activités économiques les plus importantes danstous les pays méditerranéens et l’Espagne, la France et l’Italie comptentparmi les cinq premières destinations touristiques du monde en termesd’arrivées. La Méditerranée est la première destination touristique dumonde. Un touriste sur trois choisit de s’y rendre. C’est dans les années60 que le tourisme en Méditerranée a connu un essor considérable grâce àl’émergence simultanée de plusieurs facteurs : l’amélioration de la qualitéde vie dans les pays de l’Europe du nord, la réduction de la durée du tempsde travail, les congés payés et l’augmentation de la vitesse des transportsde masse. Pendant longtemps, le tourisme en Méditerranée a été considérécomme le tourisme du soleil, de la plage et de la mer et le climatméditerranéen reste le premier facteur qui attire les touristes enprovenance du monde entier. Le tourisme n’est pas un phénomène homogène,ni dans ses origines ni dans ses caractéristiques. Le tourisme est bienplus développé dans la partie nord de la méditerranée, même si l’on adepuis peu assisté à un élargissement de la zone touristique vers le sud.Pendant longtemps, la situation politique instable et le manqued’infrastructures ont été les principales raisons de cette différence. Lesstatistiques concernant les flux touristiques fournies par l’OrganisationMondiale du Tourisme ou par Eurostat sont collectées au niveau national etne font pas de distinction selon les régions (par ex. les régions situéesau bord de la Méditerranée et celles situées au bord de l’Atlantique).Lorsque nous affirmons que la Méditerranée représente 30% des arrivées dutourisme mondial, nous considérons les flux touristiques dans les paysentiers. Les côtes du bassin méditerranéen ont été exposées à une pressionmassive lors des dernières décennies mais cette pression n’est pasuniformément répartie et est principalement concentrée sur la partie nordde la Méditerranée lors de la saison touristique qu’est l’été. Le tourisme
1
en Méditerranée a toujours été basé sur un modèle de développement et decroissance ayant les caractéristiques suivantes :
- une activité commerciale ayant comme premier objectif l’augmentationdu nombre de touristes indépendamment des capacités d’accueil d’unterritoire ;
- une priorité donnée aux bénéfices et revenus à courts termes sansprise en compte des conséquences sur l’environnement à moyen et longterme : en fait, le tourisme tend à homogénéiser et à standardiser lamanière d’aménager le territoire et l’architecture qui deviennentpartout identiques ; en outre, il exerce des pressions importantessur l’environnement, des retombées sur les ressources naturelles etsur la beauté des paysages ainsi que sur la collectivité locale etsur le patrimoine culturel.
Les dégâts causés par le tourisme dans les zones côtières proviennent de laconstruction d’infrastructures (comme les hôtels, les ports de plaisances,les installations pour le transport et le traitement des déchets, etc.) etdes aménagements pour les loisirs (terrains de golf, sports nautiques,parcs à thème, accès à la plage, parkings, etc.). A la différence desautres secteurs économiques, la dégradation de l’environnement a pourconséquence la dégradation de l’industrie elle-même, ce qui a, par un effetdomino, un impact sur les autres industries. Les organisationsinternationales et la Communauté Européenne ont fait beaucoup d’efforts.Nous allons nous focaliser plus précisément sur le Plan d’ActionMéditerranéen (PAM) et particulièrement sur le PLAN BLEU et le Centred'Activités Régionales pour le Programme d’Actions Prioritaires. Le Bureaudu Programme International Méditerranéen du WWF (WWF MedPO) élaboreactuellement une série de directives pour les investissements dans letourisme durable dans les zones écologiquement vulnérables le long descôtes méditerranéennes. D’autres initiatives ont prouvé qu’il étaitpossible d’avoir un développement durable du tourisme dans les paysméditerranéens moyennant une coopération étroite entre les paysméditerranéens : à Calvia et dans la province de Rimini, un importantprojet intégrant le développement durable du tourisme et la gestion de lazone côtière a été réalisé. Le tourisme est un facteur clé pour l’économiedes pays méditerranéens car il constitue une réelle opportunité pour undéveloppement rapide et intégré dont les autres secteurs pourront tirerprofit. Nous conclurons en proposant certains principes pour uneintégration de la philosophie du tourisme durable dans l’approche de lagestion intégrée de la côte et pour la préparation du protocole de GIZC.
2 Développements et tendances du tourisme en Méditerranée
2.1 Chiffres clé du tourisme dans les pays méditerranéens
2.1.1 Situation générale
2
Depuis le milieu des années 90, l’industrie du tourisme a généré de plus enplus d’emplois dans la région méditerranéenne. Si l’on compare l’année 1995à l’année 1998, on s’aperçoit que l’Algérie, par exemple, a vu le nombred’emplois dans ce secteur progresser de 48% , que la Turquie a comptabilisé45% d’emplois supplémentaires et qu’en Tunisie le nombre de personnestravaillant dans ce domaine a augmenté de 14%. Dans l’Union Européenne, lesressources employées dans les hôtels et le secteur de la restauration ontaugmenté de 2,3% au cours des mêmes années. En Italie en revanche, ellesont diminué de 21%. La France, l’Espagne et l’Italie, qui font toutes troispartie de la région méditerranéenne, comptent parmi les 10 destinationstouristiques les plus prisées du monde. La part du marché de cesdestinations en termes d’arrivée dans la région méditerranéenne estrespectivement de 32%, de 21% et de 18% et elle est de 23%, de 24% et de21% en termes d’accueil de touristes internationaux. Il y a égalementbeaucoup de touristes qui viennent de ces pays là. Le tourisme intérieurjoue donc un rôle majeur dans ces pays car une grande proportion des gensvivant à la ville se rendent sur les côtes .
2.1.2 Part des voyages dans la balance des paiements
En 1995, les recettes internationales totales des voyages dans la régioneuro-méditerranéenne s’élevaient à 140 247 millions d’euros desquels 90%étaient attribuables à l’Union Européenne. En 1998, les recettes totalesdes voyages pour la région Méditerranéenne s’élevaient à 175 823 millionsd’euros, ce qui correspond à 25.4% de plus qu’en 1995. En 1998, les paysméditerranéens ont enregistré une augmentation de 32.7% dans leurs revenustotaux provenant du tourisme international par rapport à 1995 alors quel’Union Européenne n’enregistrait qu’une augmentation de 24.6%. Tous lespays méditerranéens ont enregistré une telle progression :: l’Algérie, avecune augmentation de 169.8%, le Maroc (71.9%), la Turquie (68.9%), laPalestine (52.8%), la Jordanie (36.5%) et la Tunisie (26.8%) suivis deMalte, de Chypre, de l’Egypte, d’Israël et de la Syrie. Pour ce qui est despays européens, la France, l’Espagne et l’Italie sont les pays qui gagnentle plus d’argent grâce au tourisme international avec des revenus pourl’année 98 de respectivement 26 745 millions, 26 666 millions et 26 640millions d’euros. De tous les autres pays méditerranéens, la Turquie estcelui à qui le tourisme international rapporte le plus (6 402 millionsd’euros). En 1998, la Turquie a enregistré le plus grand excédent avec 4837 millions d’euros, suivie par la Tunisie avec 1 268 millions d’euros etl’Egypte avec 1 264 millions d’euros. En 1998, la Jordanie a enregistré leplus grand accroissement en pourcentage de son bilan net touristique(108.5%) suivi du Maroc avec 74 .9%. . Le bilan touristique net del’ensemble des pays méditerranéens s’élevait à 11 166 million d’euros,comparé à 8 679 millions d’euros en 1995, soit une augmentation de 28,7 %.Entre 2000 et 2002, nous avons assisté à une forte réduction des recetteset de la balance des paiements à cause de la crise du 11 septembre. Si nousanalysons la différence entre 2001 et 2002 dans les pays du sud et de l’estde la Méditerranée, nous remarquons un déclin général : le Maroc aenregistré une baisse de 12%, l’Egypte une baisse de 16% et la Turquie unebaisse de 11%. Les pays européens de la Méditerranée semblent avoir moinssouffert de la crise en 2002 : l’Espagne n’a enregistré qu’un déclin de 5%,
3
l’Italie un déclin de 3% et la France a même vu son tourisme légèrementaugmenter (+2%). Si nous considérons l’ensemble des pays méditerranéens,nous constatons une baisse de 4% pour les recettes et une baisse de 5% dansla balance des paiements.
2.1.3 Infrastructure et capacité hôtelière
En 1998, il y avait plus de 194 669 hôtels et établissements assimilablesdans la région euro-méditerranéenne et les pays méditerranéens encomptaient 8 177 avec une capacité d’hébergement de presque 1.2 millions delits. Si l’on compare avec 1995, le nombre des hôtels et établissementsassimilables dans la région euroméditerranéenne a légèrement diminué (-1.1%) alors que le nombre de lits a augmenté (+5.6%). Entre 1995 et 1998,le nombre d’hôtels et établissements assimilables a beaucoup augmenté dansles pays méditerranéens (+10.1%) et le nombre de lits encore plus (13.5%).Le pays méditerranéen qui a enregistré la plus forte augmentation du nombred’hôtels et établissements assimilables dans cette période est laPalestine (53.4%) avec un taux de croissance annuel moyen de 15.4% sur ces4 années. Dans la même période, d’autres pays méditerranéens ont aussienregistré des hausses : l’Algérie 19.6%, l’Egypte 15.6%, la Tunisie 13.1%et le Liban 12%. La France et l’Italie en revanche ont enregistré unediminution du nombre à hauteur respectivement de 2.9% et de 2.2% pour lesmêmes années de référence. Tous les pays méditerranéens ont également vu lenombre de lits disponibles augmenter, bien qu’à différents degrés. LaPalestine a vu le nombre de lits disponibles augmenter de plus de 32%,l’Egypte de 29%, le Liban de presque 25% et Israël de 20%.
Hôtels et établissements Nombre delits (2001-2002) assimilables (2001-2002)
4
Dans les pays européens, la France et l’Irlande ont connu des augmentionssubstantielles du nombre d’établissements et des lits dans la périodeentre 1995 et 1998 (respectivement 21.6% et 20.9%). Suivant la mêmeapproche,, nous vous proposons une comparaison du nombre de lits entre 2001et 2002. Le résultat est une baisse de 5%, qui s’explique par une tendancegénérale à réduire le nombre de lits et de chambres d’hôtel pour avoir uneamélioration de la qualité des chambres.
2.1.4 Demande touristique
Entre 1995 et 1998, les pays européens du bassin méditerranéen ont tousenregistrés des augmentations du nombre de nuitées : 14.5% en Grèce, 12.0%en Espagne, 12.7% en France et 2.6% en Italie. De tous les pays du bassinméditerranéen, ce sont le Liban et la Turquie qui ont enregistré lesaugmentations les plus importantes dans le nombre de nuitées en hôtel ouétablissements assimilés pour les mêmes années de référence avecrespectivement 70.8% et 63.2%. En revanche, certains pays ont connu uneforte diminution de ce nombre. C’est le cas de l’Algérie (-17.7%), de laJordanie (-9.3%) et de la Syrie (-6.3%). Avec l’exception d’Israël (-18.8%), de l’Egypte (-1.5%) et de la Syrie (-1.0%), le nombre de nuitéesdes non-résidents dans les hôtels et établissements assimilés des pays dubassin méditerranéen a augmenté entre 1995 et 1998. La Turquie a enregistréle plus grand nombre de nuitées des non-résidents avec une augmentation dece nombre de 64.7% dans les mêmes années de référence. Ce nombre aincroyablement augmenté en Palestine (450.5%) lors de la même période. En1998, le nombre de nuitées des non-résidents dans les hôtels etétablissements assimilés dans presque tous les pays de l’EU et de laMéditerranée représentait la part la plus importante. L’Algérie fait figured’exception car les non-résidents ne comptent qu’à hauteur de 4.4% dans lenombre total de nuitées. Le nombre total de visiteurs et de touristes(visiteurs restant au moins une nuit) se présentant aux frontières aglobalement connu une croissance au cours des mêmes années à l’exceptiond’Israël qui a connu une baisse de 13.5% du nombre de visiteurs. La Turquiea enregistré le plus grand nombre d’arrivées de visiteurs de tous les paysnon européens du bassin méditerranéen avec une augmentation de ce nombre de26.2%. En 1999, tous les pays non européens ont encore vu le nombre devisiteurs augmenter à l’exception de la Turquie.
Le nombre total de nuitées dans des établissements touristiques collectifsest resté stable entre 2000 et 2002. Ce résultat s’explique essentiellementpar le bilan entre les nuits passées par des résidents et les nuits passéespar des non résidents dans les différents pays.
5
Nombre total de nuitées dans des établissements touristiques collectifs entre 2000 et 2002.
3 Impacts des activités touristiques dans les zonescôtières de la Méditerranée
3.1 Considérations générales
Le tourisme est une source essentielle de revenus pour de nombreusescollectivités de la côte. Attirées par la perspective d’augmenter leursrevenus, elles sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers letourisme qui représente une activité économique complémentaire.L’altération de la qualité de l’environnement est souvent tolérée car denombreux autochtones deviennent plus prospères. De nombreuses destinationstouristiques ont perdu leur attrait à cause d’un surdéveloppement et d’unedégradation de l’environnement. Si la zone côtière n’est plus attrayante, àcause d’une pollution de l’eau par exemple (cf. la Riviera Adriatique aprèsla crise « mucilagineuse » en 1987), la principale source de revenus de cesrégions se tarit et, en conséquence, les opportunités pour attirer d’autresactivités que le tourisme disparaissent. Les impacts du tourisme enMéditerranée ne sont pas uniformément répartis à cause de concentrationsdisparates à la fois dans l’espace et dans le temps le long d’une étroitebande côtière.
3.2 Impacts associés à la construction d’infrastructurestouristiques
3.2.1 Installations touristiques
L’augmentation de la construction d’installations touristiques et de loisirfait peser encore plus de pressions sur les ressources naturelles et surles paysages. L’utilisation d’un terrain pour construire des hôtels oud’autres éléments de l’infrastructure et l’utilisation de matériaux de
6
construction peuvent causer des impacts directs sur les ressourcesnaturelles renouvelables et non renouvelables. Les forêts souffrent souventdes impacts négatifs du tourisme qui prennent la forme de déforestationcausée par la collecte de bois pour le chauffage ou par la déforestationpour utiliser l’espace à d’autres fins. La construction de stationsbalnéaires nécessite souvent un déboisement. Les marais côtiers sontsouvent asséchés et remblayés faute d’avoir des lieux plus propices à laconstruction d’installations et d’infrastructures pour le tourisme. Cesactivités peuvent causer des troubles sévères et une érosion del’écosystème local, voir même à long terme sa destruction. Lesinstallations pour le tourisme de masse, en particulier les complexesd’hôtels et d’appartements, ont été construites à outrance dans la partienord de la côte méditerranéenne dès les années 60 et continuent à sedévelopper dans le sud et au moyen orient. Ce développement du front demer a eu pour conséquence une érosion de la plage et des dunes à grandeéchelle. Ceci n’est pas seulement un problème écologique mais également unproblème économique : les installations situées sur les plages sontsusceptibles de causer de graves dommages et d’accélérer l’augmentation duniveau de la mer. La construction de ports de plaisance cause également desdégâts car les marinas et les brise-lames peuvent entraîner un changementdans les courants et sur les côtes. En outre, l’extraction de matériaux deconstruction tels que le sable endommage les barrières de coraux et lesforêts, ce qui entraîne une érosion et la destruction des habitats.
3.2.2 Impacts des activités de loisir
Les impacts des activités de loisir peuvent être attribués à undéveloppement touristique intensif ou à des pressions exercées par lesactivités récréatives non touristiques dans les zones urbaines et / oururales. Le bruit des bateaux à moteur, des jet skis, des voitures, desbus, de la vie nocturne et d’autres activités représente l’un desprincipaux problèmes générés par les activités de loisir . Les terrains degolf sont depuis longtemps associés aux zones côtières. Dans de nombreusesrégions, ces terrains occupent une place importante au sein de l’économielocale et nombre d’entre eux ont permis de conserver de précieux fragmentsd’habitats de dunes de l’emprise de l’urbanisation et de l’agriculture.Entre autres impacts de ce développement on constate une modification dessols des dunes, une perte de la végétation naturelle, une perturbation dela faune et de la flore les plus sensibles et une demande supplémentaire eneau qui est une ressource limitée.
3.3 Epuisement des ressources naturelles et pollution
3.3.1 Les pressions exercées par le tourisme épuisent les ressources
Le développement du tourisme peut exercer une pression sur les ressourcesnaturelles lorsqu’il augmente la consommation de ces ressources dans leszones où elles sont déjà rares. Le tourisme a des impacts sur la qualité del’environnement – le traitement et l’élimination des déchets solides et /ou liquides, particulièrement lors des pics de la saison touristique, peut
7
ne pas être suffisant ou, dans le pire des cas, inexistant. Une grandequantité d’eau est consommée, non seulement pour boire mais également pourse laver, pour la lessive, pour les piscines et pour l’entretien desterrains de golf, ce qui peut s’avérer être un problème majeur dans lesrégions ou les ressources en eau douce sont limitées. Etant donné que leszones côtières sont les principales destinations touristiques,l’environnement marin et côtier vulnérable et les communautés de la côtesouffrent terriblement. Ceci est également dû au manque de consensus et àl’incompatibilité des utilisations dans la zone côtière qui génèrent desconflits entre les différents intérêts des personnes impliquées. Le niveaucomplexe de l’interaction des impacts démontre la nécessité d’élaborer unegestion intégrée de la zone côtière.
3.3.1.1 Ressources en eau
L’eau douce est l’une des ressources naturelles les plus précaires.L’industrie du tourisme surexploite en général les ressources en eau pourles hôtels, les piscines, les terrains de golf et l’utilisation personnellede l’eau par les touristes. Ceci peut avoir pour conséquence un manqued’eau et la dégradation des canalisations ainsi que la génération d’unvolume beaucoup plus important d’eau usée. Dans les régions sèches comme laMéditerranée, le problème de la rareté de l’eau est de toute premièreimportance. A cause du climat chaud et de la tendance des touristes àconsommer plus d’eau lorsqu’ils sont en vacances que lorsqu’ils sont chezeux, la quantité d’eau utilisée peut s’élever jusqu’à 400 / 500 litres parjour et par personne. L’entretien des terrains de golf participe égalementà épuiser les ressources en eau douce. Ces dernières années, le tourisme dugolf est devenu très populaire et le nombre de terrains de golf a connu unecroissance rapide. Les terrains de golf ont besoin d’une énorme quantitéd’eau chaque jour ce qui, comme pour tout ce qui nécessite une extractionexcessive de l’eau, peut entraîner un manque d’eau. Si l’eau provient depuits, un pompage excessif peut causer une intrusion saline dans les eauxsouterraines.
3.3.1.2 Ressources locales
Le tourisme peut faire peser d’énormes pressions sur les ressources localesque sont l’énergie, la nourriture et autres matières premières qui peuventdéjà n’exister qu’en petite quantité. Une extraction et un transport plusintensifs de ces ressources exacerbent les impacts physiques associés àleur exploitation. A cause du caractère saisonnier de l’industrie, denombreuses destinations comptent dix fois plus d’habitants à la hautesaison que lors de la basse saison. Ces ressources sont donc ponctionnées àoutrance pour pouvoir satisfaire les attentes des touristes (chauffagesatisfaisant, eau chaude, etc.).
3.3.2 Pollution générée par les activités touristiques
8
Le tourisme peut engendrer les mêmes formes de pollution que n’importequelle autre industrie : émissions dans l’air, bruit, déchets solides,abandon de détritus, fuites d’égouts, d’huile ou de produits chimiques etmême pollution architecturale / visuelle.
3.3.2.1 Pollution de l’air et bruit
Le transport aérien, routier et ferroviaire est en constante augmentation àcause du nombre croissant de touristes et de leur plus grande mobilité. Unedes conséquences de la démocratisation des transports aériens est que lestouristes représentent aujourd’hui plus de 60% des passagers des avions. Letourisme est donc responsable d’une part importante des émissions dansl’air. Les émissions des moyens de transport et celles provenant de laproduction et de l’utilisation de l’énergie ont des conséquences sur lespluies acides, le réchauffement de la planète et la pollutionphotochimique. La pollution de l’air par les moyens de transport destouristes a des impacts sur le niveau global des émissions, etparticulièrement sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dues àl’utilisation d’énergie pour les transports. En outre, cette pollutioncontribue à polluer de manière importante l’air local.
3.3.2.2 Déchets solides et détritus
Dans les zones qui comptent une forte concentration d’activitéstouristiques et de sites naturels attrayants, le stockage des déchets estun sérieux problème qui, faute de trouver une solution adéquate, peutgravement dévaloriser l’environnement naturel – rivières, paysages et bordsde routes. Les déchets solides et les détritus peuvent dégrader l’apparencephysique de l’eau et du littoral et entraîner la mort d’animaux marins. Lestockage des déchets solides est un problème qu’il s’agit de résoudred’urgence, particulièrement dans les petites îles qui sont confrontées àune production massive durant le pic estival et qui n’ont pas de déchargeurbaine.
3.3.2.3 Eaux usées et pollution des eaux souterraines
La construction d’hôtels, l’aménagement d’espaces pour les loisirs etautres installations ont souvent pour conséquence d’augmenter la pollutionpar les eaux usées. Les eaux usées ont pollué les mers et les lacs situésprès des principaux endroits touristiques, causant des dommages à la fauneet à la flore. Les fuites des égouts peuvent sérieusement endommager lesécosystèmes sous-marins comme les barrières de coraux car ils stimulent laprolifération des algues qui recouvrent le système de filtre dont lescoraux se servent pour se nourrir, compromettant leurs chances de survie.Les changements dans la salinité et la disparition de zones marécageuses.La salinisation est une conséquence directe de l’augmentation de lapopulation et de la surexploitation des puits, ce qui provoque uneintrusion de l’eau salée. La quantité d’eau nécessaire pour approvisionner
9
la population en été ne peut pas être trouvée dans les ressources en eaudisponibles dans les petites îles méditerranéennes.
3.3.2.4 Pollution de l’eau de mer
Elle est en grande partie causée par des évacuations occasionnelles ouaccidentelles en provenance de la mer ou de la terre. En été, nous pouvonsremarquer et enregistrer un amoindrissement notoire de la qualité de l’eaude mer à cause de la pollution marine directe et indirecte et desécoulements des rivières de montagne lors de pluies torrentielles.
3.4 Impacts sur la biodiversité
Les sites attirants, tels que les plages de sable, les lacs, les bords desrivières, sont souvent des zones de transition caractérisées par desécosystèmes riches en espèces. Entre autres impacts physiques le plussouvent observés, il y a la dégradation de ces écosystèmes. Un écosystèmeest une zone géographique avec tous les organismes qui y vivent (habitants,plantes, animaux et micro-organismes), leur environnement physique (commele sol, l’eau et l’air) et les cycles naturels qui les régissent. Lesécosystèmes les plus menacés par la dégradation sont les zonesécologiquement fragiles telles que les marais, les barrières de coraux etles prairies marines. Les menaces et les pressions qui pèsent sur cesécosystèmes sont souvent importantes car ce sont des endroits trèsattirants à la fois pour les touristes et pour les promoteurs. Ces endroitssont donc envahis sans que le patrimoine naturel et culturel ne soitprotégé de manière adéquate. Nous pourrions citer en exemple lesconséquences des mouillages des bateaux dans les prairies sous-marines dePosidonie qui mettent en péril la survie de l’algue. L’une des activitésles plus dévastatrices pour la faune marine est la pêche amateur et plusparticulièrement la pêche sous-marine qui est en plein essor.
4 Plan d’Action pour la Méditerranée et tourismedurable : activités, outils et instruments
Les pays méditerranéens et l’Union Européenne travaillent ensemble depuis1975 grâce au Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) qui est placé sousl’égide du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Ce plana eu pour objectif premier la protection de l’environnement marin et,depuis 1995, la promotion du développement régional durable, la protectionde la biodiversité et la gestion intégrée des zones côtières, tout celadans le cadre de la Convention de Barcelone et du PAM Phase II. Le PAMincite différents secteurs de la société méditerranéenne à s’impliquer dansla protection des ressources humaines et naturelles très riches de larégion qui se sont appauvries sous l’effet du développement rapide pastoujours planifié, en gardant à l’esprit le besoin de durabilité.Les objectifs de ce plan sont :
10
Combattre la pollution d’origine terrestre, notamment dans les zonesayant la concentration la plus importante de polluants provenantd’activités humaines qui sont aussi dénommés « points noirs » ;
Eviter les accidents marins et les déversements illégaux à partir desbateaux : le PAM a contribué de façon considérable à l’acquisition d’unesécurité maritime dans la région grâce au Protocole de prévention etd’urgence ;
Protéger les ressources naturelles et culturelles ; Gérer les zones côtières ; Intégrer l’environnement et le développement. Dans de nombreux pays
méditerranéens, l’environnement n’est pas pris en compte par lespolitiques de développement, ce à quoi le PAM s’efforce de remédier.
4.1 Recommandations du Plan d’Action pour la Méditerranée etpropositions pour un tourisme et un développementdurable.
Lors du 11ème meeting, les Parties Contractantes de la Convention deBarcelone ont adopté plusieurs recommandations et propositions concernantle tourisme et le développement durable en Méditerranée. Cesrecommandations sont le résultat des efforts de la CommissionMéditerranéenne pour le Développement Durable (CMDD) qui a été créée en1996. La CMDD a travaillé à mettre en avant des propositions concrètesdestinées aux pays ayant ratifié la Convention de Barcelone. Troisprincipaux domaines d’intervention ont été définis :
gestion des impacts environnementaux; promotion d’une meilleure intégration du tourisme dans l’environnement
et le développement durable; stimulation du développement et de la coopération en Méditerranée.
Ces considérations ont amené à définir un plan comprenant les actionssuivantes :
1. échange d’informations entre les destinations touristiques de laMéditerranée
2. incitation à l’utilisation des écolabels méditerranéens3. sensibilisation au niveau régional4. incitation à l’utilisation d’instruments financiers et économiques
pour la protection et la gestion des destinations touristiques5. étude d’un système de coopération régionale6. organisation d’un atelier régional en 2002
4.2 Activités du Plan Bleu
Le Plan Bleu fonctionne comme un Centre Régional d’Activité (CRA) du Pland’Action pour la Méditerranée (PAM) ; c’est un centre de recherche quis’occupe de la région méditerranéenne et qui a l’infrastructure d’uneorganisation à but non lucratif pour sa gestion et son fonctionnement. LePlan Bleu dispose d’une grande quantité de données ainsi que d’études
11
systémiques et prospectives -qui vont parfois de pair avec des propositionsd’actions- qui permettent de fournir des informations pour avoir undéveloppement socio-économique durable sans provoquer une dégradation del’environnement. Le Plan Bleu a pour tâche d’observer, d’évaluer etd’explorer les relations entre les populations, l’environnement et ledéveloppement ainsi que les études et les rapports sur les thèmes qui sontdes priorités pour le bassin méditerranéen. Le Plan Bleu est amené à jouerun rôle important de « centre de soutien » pour la CommissionMéditerranéenne pour le Développement Durable (CMDD). En tant que tel, il aparticulièrement contribué au travail réalisé sur les propositionsstratégiques concernant l’eau, l’industrie du tourisme et les indicateursdu développement durable.
Dans sa fonction d’Observatoire de l’Environnement et du Développement dela Méditerranée, le Plan Bleu cherche à promouvoir la créationd’observatoires nationaux, l’utilisation d' «indicateurs» del’environnement et du développement durable et la formation dans le domainedes statistiques environnementales (MEDSTAT-Projet pour l’environnement).
4.2.1 Perspective du développement du tourisme en Méditerranée
Dans le rapport « Tourisme et Environnement en Méditerranée : Enjeux etProspective » publié en 1995, les experts du Plan Bleu ont défini plusieursscénarios à long terme pour développer le tourisme dans la Méditerranéetout en préservant l’environnement.D’après les études de l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) et du PlanBleu, les variables exogènes suivantes vont fortement influer sur ledevenir du tourisme en Méditerranée :
variations sociales et démographiques importantes (vieillissement dela population, augmentation du travail de la femme, réductions àvenir du temps de travail) ;
peu d’améliorations de la situation financière et économique ; changements politiques et législatifs accompagnés d’un processus plus
lent d’orientation de l’opinion publique vers la protection del’environnement des zones côtières ;
progrès technologiques dans les transports et dans la production etla transmission des données ;
augmentation des échanges commerciaux ; développement des infrastructures du réseau de transport1 ; sécurité du voyageur (santé, criminalité, terrorisme).
Toutefois, les experts du Plan Bleu soulignent qu’il n’y aura plus decroissance du tourisme en Méditerranée comparable à celle que l’on a connupar le passé car les autres marchés, notamment ceux d’Asie du Sud-Est,deviennent de plus en plus compétitifs. Quelques scénarios prenant encompte la complexité du phénomène ont été proposés.
1 Cette analyse ne prend pas en compte l’émergence des compagnies aérienneslow-cost.
12
Scénario DescriptionTendance aggravéeT2
Caractérisée par un tourisme international de luxe etpar une stagnation du tourisme national qui entraînerala création d’autres pôles du tourisme d’élite. Un telphénomène pourrait entraîner une immigration illégale,une dérégulation totale, un protectionnisme, undéveloppement du crime et du terrorisme et uneinjustice sociale. La nature ne serait protégée quedans quelques rares oasis et la qualité del’environnement se détériorerait à cause de lararéfaction des ressources disponibles pour lescollectivités locales.
Tendance modéréeT3
Croissance à long terme, de type néolibérale.Croissance économique dans les pays méditerranéens.Ressources supplémentaires pour la protection del’environnement. Tendance à la standardisation duproduit du tourisme et augmentation du nombre depetites excursions et randonnées. Innovationstechnologiques permettant une meilleure gestion desressources naturelles. Développement économique pluséquilibré entre les pays du nord et ceux du sud de laMéditerranée. Scénario comportant de sérieux dégâtsinfligés à l’environnement par les pressions que letourisme fait peser sur les côtes et recherche de laqualité à l’intérieur des terres.
Coopérationalternative :scénario de développementdurable A1
Basé sur la protection de l’environnement, solidaritévolontaire entre pays du nord et du sud de laMéditerranée. Le résultat est la création de complexestouristiques intégrés occasionnant peu de dégâts. La CEva encourager l’émergence d’une politiqueméditerranéenne basée sur le développement économiquemodéré et la protection de l’environnement encollaboration avec les pays hors UE . Les principauxaspects de cette politique sont : développement dutourisme rural à l’intérieur des terres allant de pairavec un développement de l’agriculture ; éducation desautochtones ; gestion équilibrée des ressources en eaugrâce à une contribution financière du tourisme ;tourisme en tant qu’outil de formation et d’intégrationet de promotion sociale.
Alternative auregroupementrégional A2
Ce scénario suggère une stratégie pour un « repli sursoi-même ». La tendance va être le regroupement parrégion : intégration des politiques environnementaleset d’aménagement du territoire, d’avantage d’échangesde flux touristiques entre le nord et le sud de laMéditerranée.
Les impacts environnementaux de chaque scénario ont été considérés en sebasant sur les évaluations des experts du Plan Bleu. Les scénarios, quiprévoient moins de touristes dans les zones côtières, causeront peut-êtremoins de dégâts que les scénarios alternatifs en terme de consommation des
13
ressources. En revanche, ces scénarios basés sur l’individualisme national,régional et privé exacerbent les risques naturels et écologiques etl’instabilité sociale.
4.3 CAR/PAP
Le Programme d’Actions Prioritaires (PAP) du Plan d’Action pour laMéditerranée (PAM) fait partie du Programme des Nations Unies pourl’Environnement (PNUE). Le PAP travaille depuis 17 ans sur le« Développement du Tourisme en Méditerranée en Harmonie avecl’Environnement » avec la participation active de 14 pays méditerranéens.Le lancement de ce programme en 1985 était lié directement à l’expériencedu PAM. Leur travail a permis de montrer que les tendances socio-économiques, qui étaient à la fois le résultat d’une mauvaise gestion etd’une mauvaise planification du développement, sont la cause des principauxproblèmes environnementaux et également qu’il n’est pas possible dedissocier protection de l’environnement et développement social etéconomique. Le travail officiel est basé sur quatre principaux objectifs :
la planification intégrée du développement et de la gestion du bassinméditerranéen,
la surveillance de la pollution et le programme de recherche pour lebassin méditerranéen qui va avec,
le développement de solutions à ce problème et d’une législationpréventive et
le cadre institutionnel et financier.
L’activité appelée « Développement du Tourisme en Méditerranée en Harmonieavec l’Environnement » était composée d’une série de séminaires et demeetings d’experts organisés sur la base de rapports nationaux et d’étudesde cas des pays participants (1986-1989). Elle a abouti en une synthèse deces études et en la réalisation des « Directives pour une ApprocheEnvironnementale de la Planification et de la Gestion du Tourisme dans lesZones Côtière Méditerranéennes ».
4.3.1 Développement de la méthodologie de l’évaluation de la capacitéd’accueil en matière de tourisme
La méthodologie pour l’évaluation de la capacité d’accueil en matière detourisme (ECAT) a été définie après l’étude de plusieurs rapports et aprèsles expériences acquises au travers du travail sur le projet global« Développement du Tourisme en Méditerranée en Harmonie avecl’Environnement » mis en œuvre par le PAP/CRA. En 1995, une équiped’experts a préparé les « Directives pour une évaluation de la capacitéd’accueil en matière de tourisme dans les zones côtières méditerranéennes »qui ont finalement été adoptées lors de l’atelier régional à Split enjanvier 1997. Le PAP/CRA a organisé des cours de formations spéciaux pourles planificateurs locaux et les membres officiels du gouvernement dans lapréparation des Evaluations de la capacité d’accueil en matière de tourismesur la base des « Directives pour une évaluation de la capacité d’accueil
14
en matière de tourisme dans les zones côtières méditerranéennes ». Cescours ont eu lieu à Tartous (Syrie), à Tripoli (Libye), à Alger (Algérie)et à Beyrouth (Liban). Le PAP se base sur la définition du développementdurable comme développement qui ne dépasse pas la capacité d’accueil d’unécosystème et sur les expériences de l’organisation dans les différentesrégions pour prôner une approche flexible de l’ECAT. L’option du tourismedurable est le résultat logique du processus d’ECAT. Comme tous les paysparticipants ont trouvé que cette approche était la mieux adaptée pour larégion méditerranéenne, la méthodologie du PAP a été récemment utiliséedans deux études préparées par des équipes nationales qui étaientsupervisées par le PAP –pour l’archipel de Malte et pour la province deRimini en Italie. Toutes les expériences acquises par les experts duPAP/CRA ont été collectées et évaluées dans le « Guide de bonne pratiqued’une évaluation des capacités d’accueil en matière de tourisme » préparéspar les experts du PAP/CRA en 2003.
4.3.2 Création d’une écotaxe sur le tourisme
Dans le cadre du PAS MED (Programme d’Action Stratégique pour combattre lapollution en provenance de sources et d’activités menées à terre dans lamer méditerranée), le Centre Régional d’Activités du Programme d’ActionPrioritaire (PAP/CRA) du PNUE-PAM est responsable du composant du projetintitulé « Développement et mis en œuvre des instruments économiques pourla pérennité du PAS MED ». Sept projets pilotes ont été définis de manièreà ce que certains pays méditerranéens soient en mesure d’analyser, dedévelopper et, éventuellement, de mettre en œuvre différents instrumentséconomiques pour résoudre les problèmes urgents de pollution marine. Leprojet pilote intitulé « Combattre la pollution d’origine terrestre dans lamer côtière de la ville de Hvar » est l’un de ces sept projets pilotes. Ilest composé de deux parties principales : la première étant la création etla mise en œuvre d’une écotaxe (le tourisme étant à la fois un moteur dudéveloppement et une menace pour l’environnement) et la seconde étantl’identification et l’élaboration d’autres instruments économiques quipermettront de garantir un développement respectueux de l’environnement ducentre de la Baie de Vira.
5 L’Agenda 21 pour le tourisme
En 1992, les dirigeants du monde entier se sont rencontrés lors du Sommetde la Terre à Rio, au Brésil. Ce sommet a été un pas important dansl’histoire de la relation entre l’humanité et la planète terre. Laconférence de Rio est parvenue à proposer un certain nombre d’accords quiont marqué un progrès considérable dans les accords entre les gouvernementsà un niveau international. L’Agenda 21 est l’un de ces accords qui ont étératifiés, un agenda qui va nous amener dans le 21ème siècle. L’Agenda 21donne un aperçu des objectifs et des actions qui peuvent être considérés auniveau local, national et international et offre une épure générale pourles nations du monde qui ont entrepris de faire la transition vers undéveloppement durable .
15
Le processus est constitué de cinq étapes2:
1. création d’un forum et / ou de groupes de discussions sur l’Agenda21 local;2. discussion et analyses des principaux problèmes locaux ;3. identification des objectifs et des idées pour les actions pour ledéveloppement durable au niveau local ;4. intégration de ces objectifs et de ces idées dans l’Agenda 21local ;5. mise en œuvre du plan d’action avec la participation de tous lespartenaires concernés.
Les aspects suivants de l’Agenda 21 local doivent être présents dans lastratégie commune pour un tourisme durable :
garantie que la planification du tourisme et le développementprennent en compte les impacts économiques, sociaux etenvironnementaux du tourisme ;
intégration du tourisme dans le contexte général de développementdurable ;
fourniture d’un cadre pour le processus de participation etimplication des différents acteurs principaux ;
détermination du profil de la destination à laquelle sera attribué unlabel de « durabilité » (collectivité locale) et aide à cettedestination pour attirer l’attention des visiteurs.
Les destinations du tourisme côtier dans les pays de la Méditerranée ontbesoin de repenser leur stratégie de développement du tourisme et l’Agenda21 local peut leur fournir un cadre structuré pour cette stratégie.
6 Synergies entre les stratégies de développementdurable du tourisme et la gestion intégrée de lacôte
6.1 Intégration des ECAT dans la planification et la gestiondes zones côtières
Dans les pays méditerranéens, le développement du tourisme et autres typesd’activités similaires reste du ressort des plans nationaux , grâce à la2 UNEP and ICLEI (2003), Tourism and Local Agenda 21: The role of localauthorities in sustainable tourism
16
mise en œuvre de programmes d’études de la capacité d’accueil, de contrôlesde la planification et de la gestion. Il faut faire des choix et descompromis entre les intérêts des utilisateurs et des utilisations des zonescôtières lorsqu’il s’agit d’éviter une escalade dans les conflits ou unedégradation des ressources. La méthode d’ECAT du PAP a été conçue dès ledépart pour être une partie intégrante de la phase de planification de laméthode de Gestion intégrée de la zone côtière. En outre, l’ECAT devraitfaire partie des plans de développement du tourisme. Dans de nombreux cas,l’ECAT joue un rôle clé dans l’aménagement du territoire. De plus, l’étudeECAT disponible dans tous ces pays représente une approche solide etdurable pour bâtir une planification du tourisme à venir. L’ECAT a étédéfinie comme un outil flexible et dynamique qui reste modifiable enfonction des derniers résultats des ECAT. L’ECAT ne doit pas uniquementêtre considérée comme un outil de planification et de gestion du tourismecomme les autres mais également comme un processus dynamique qui permetd’analyser et de programmer le développement durable du tourisme danstoutes les destinations de la Méditerranée et du reste du monde.
6.2 Améliorer la durabilité des investissements dans letourisme dans les zones côtières
6.2.1 Risques des investissements non contrôlés
L’investissement dans la gestion de la zone côtière et dans le tourisme esttrès important, à la fois en termes de dépense publique et d’investissementprivé. Pour protéger cet investissement, d’autres investissements dans laprévention de la dégradation de l’environnement et dans la réparation desdégâts sont également nécessaires. En fait, le développement du tourismeest très dépendant de la qualité de l’environnement : les installationstouristiques ne suffisent pas à rendre une destination attrayante, bienqu’ils puissent œuvrer au début à créer un lieu de villégiatureautosuffisant qui satisfasse les touristes. Cependant, lorsque lestouristes arrivent à destination, ils veulent voir tout le site et sescaractéristiques. En conséquence, les facteurs externes sont aussiimportants que la qualité des hôtels et des services. Si l’on permet que lecapital environnemental se dégrade, il est probable que l’industrie dutourisme ne puisse pas perdurer car les touristes vont partir à larecherche d’autres destinations. Les bénéfices chuteront, il y aura moinsd’emplois, les infrastructures vont se détériorer et les problèmes sociauxvont augmenter.
Comme il est indispensable d’avoir un environnement sain pour avoir unebonne activité commerciale, le développement durable d’une destination estla manière la plus simple de parer au problème. En fait, le modèle actuelde développement durable consiste à équilibrer les perspectivesécologiques, économiques et sociales en prenant en compte les ressourcesexistantes et leurs utilisations futures. C’est pourquoi les politiques etles investisseurs, tout comme les établissements et les prestataires deservices, doivent considérer la question de la gestion de la destinationpas seulement avec la perspective de faire des profits mais également avec
17
l’idée d’assurer sa pérennité. Aujourd’hui, le besoin d’avoir des outilspratiques pour développer les systèmes de surveillance et d’information esttrès fort chez les décideurs. C’est un pas extrêmement important vers ledéveloppement d’une économie locale forte car il offre aux investisseurs àla fois une vision commune et un processus de planification stratégiquepour une zone donnée.
6.2.2 Directives pour des investissements dans un tourisme durabledans les zones écologiquement vulnérables
Le Bureau du Programme Méditerranéen International du WWF a mis en œuvreune série de directives pour les investissements durables dans le secteurdu tourisme qui concernent les zones côtières écologiquement vulnérables dela Méditerranée. Le projet va fournir aux investisseurs des informationsdétaillées et des outils pour évaluer les risques économiques etenvironnementaux des investissements non durables dans les zonesécologiquement vulnérables. Ce projet porte sur le bassin méditerranéen,une région qui a une valeur culturelle et écologique exceptionnelle maisqui est également l’une des régions les plus menacées du monde. Dans lapremière phase du projet, les données et les informations concernant lalégislation, la qualité de l’environnement des côtes et les impacts dudéveloppement du tourisme dans le bassin méditerranéen ont été recueilliesdans quatre pays pilotes : la Croatie, la Turquie, le Maroc et la Tunisie.Le WWF est également en train d’élaborer un outil d’évaluation facile àutiliser pour éviter les investissements non durables dans les zonesvulnérables. Cet outil est élaboré à l’aide des étapes suivantes :
définition du profil de l’investissement (en termes d’impactsenvironnementaux, économiques et sociaux) ;
réalisation d’une « carte des risques » pour évaluer la compatibilitédes investissements ;
évaluation de la capacité d’accueil en matière de tourisme de larégion ;
évaluation de la compatibilité entre profil de l’investissement etcaractéristiques de la zone étudiée.
Enfin, une Carte digitale des Risques des pressions du tourisme va êtreréalisée basée sur la valeur écologique et la vulnérabilité (simultanémentavec la prise d’images satellites permettant de détecter les changementsdans l’aménagement du territoire). Cette carte sera un outil important pourles acteurs principaux.
6.3 Plan de gestion intégrée de la municipalité de Calvia etde la Province de Rimini
6.3.1 Cadre général de Calvia et de Rimini
18
La municipalité de Calvia et la région de Rimini ont été les deuxpartenaires principaux du projet « Life Med-coasts : outils et stratégiespour un tourisme durable dans les zones côtières de la Méditerranée » quicomprenait le plan pour la gestion intégrée des zones côtières. Le Planeuropéen a permis de faire la comparaison entre deux exemples différents deproblèmes similaires, ce qui s’est avéré être un exercice utile. Calvia etRimini sont parmi les destinations les plus populaires pour le tourisme demasse en Méditerranée: elles sont visitées par des milliers de touristes,particulièrement pendant les mois d’été. Le littoral a connu destransformations urbaines majeures et l’environnement a subi de gros dégâts.
6.3.2 Plan de gestion intégrée de la riviera de Rimini
Le projet LIFE3 dirigé par les experts de l’institut de recherche AmbienteItalia pour la province de Rimini a commencé par l’étude de la capacitéd’accueil de « Tolérance au stress » de l’industrie du tourisme (l’« ECAT » entreprise en 2001 sous la supervision du PAP/CRA) comme elleavait été décrite dans la méthodologie du PNUE. C’est au cours del’évaluation de cette étude que la zone étudiée, ainsi qu’un grouped’indicateurs décrivant au mieux la situation du moment, ont été définis.Ces indicateurs focalisaient sur les zones soumises à d’importantespressions, sur les ressources et sur les facteurs précaires de la région,particulièrement ceux concernées par les activités touristiques. Lors de laphase suivante, la tolérance au stress du système était étudiée en seplaçant dans la perspective des scénarios potentiels pour le développementdu tourisme. Deux des modèles développés pour l’ECAT – un pour ledéveloppement de l’intérieur des terres, l’autre pour la requalification dutourisme sur la côte – ont été sélectionnés comme étant les solutions lesplus appropriées pour le développement futur. Le modèle qui en a résulté,le Riviera de Rimini 2010, est considéré comme un composant pour ledéveloppement de la GIZC (Gestion intégrée de la zone côtière). Il estainsi devenu un composant incontournable pour les modèles futurs4.
Le modèle de projet, qui avait été réalisé grâce à une méthodologiesimilaire à celle utilisée à Calvi, a été mis en œuvre, permettantd’imaginer quelle serait l’évolution de la situation jusqu’en 2010 dans lecas du scénario ¨poursuite de l’activité commerciale¨ et dans le cas de
3 Le projet LIFE impliquait les partenaires suivants : Province de Rimini,Municipalité de Calvi, Institut de Recherche de l’Ambiante Italia etFederalberghi.
4 Pour plus d’informations, veuillez consulter la section sur le Projet LIFEsur le site web du tourisme dans la Province de Rimini :(http://www.provnicia.rimini.it/progetto/info turismo/indexsostenibile.htm). L’étude complète sur la tolérance au stress et autresmodèles pour le développement d’un tourisme durable sont disponibles surCD, L’analisi di Carrying Capacity e le sue relazioni con il Piano Integrato di Gestione Costiera”,Juin 2002.
19
celui de ¨meilleurs résultats¨. Le modèle ¨poursuite de l’activitécommerciale¨a été développé sur le postulat que les pratiques du passé nechangeront pas jusqu’en 2010. Au contraire, le modèle des ¨meilleursrésultats¨s’appuyait sur l’introduction de mesures correctives destinées àinverser radicalement les tendances des indicateurs enregistrée cesdernières années. Le modèle des ¨meilleurs résultats¨pourrait êtreconsidéré comme un ¨but ultime¨à atteindre qui serait très ambitieux mêmesi il demeure techniquement possible. Parmi les autres propositions quecontenait le plan, certaines sont devenues des projets qui avaient lepotentiel de devenir des « actions pilotes ».
7 Quelle pourrait être la valeur ajoutée par leprotocole de GIZC au tourisme durable ?
D’après la Charte de Rimini sur le Tourisme Durable (2001), il estimportant de souligner l’urgence d’avoir une action concertée pourexploiter efficacement l’augmentation de la demande et de l’offretouristique. En fait, cette croissance a eu d’importantes répercussionsenvironnementales et sociales et risque même aujourd’hui de compromettre laqualité et la dynamique de l’offre touristique. Si l’on veut garantir ladurabilité de l’industrie du tourisme et des ressources côtières utiliséespar les autres secteurs des économies méditerranéennes, il va falloirporter une attention particulière à l’amélioration du processus dedécision, de la planification intégrée et de la gestion des ressources dela côte et de l’industrie du tourisme et changer l’orientation desprofessionnels et des acteurs industriels pour qu’ils adoptent desapproches de développement plus respectueuses de la société et del’environnement.
D’après les prévisions formulées par les experts du Plan Bleu (voirparagraphe 4.2.1), la non prise en compte du protocole de GIZC aura pourrésultat le scénario tendanciel T2 (aggravé) ou T3 (modéré). Ces scénariosne considèrent pas la protection de l’environnement de la zone côtièrecomme une priorité lors de la phase de planification et dans les politiquesnationales. De nombreux exemples récents ont montré que la coopérationintra-méditerranéenne et l’échange d’expérience sont le seul moyend’arriver au développement durable des pays méditerranéens grâce au partaged’objectifs communs. Les pays méditerranéens devraient simultanémentassumer la responsabilité de reconsidérer leurs modèles et leurs stratégiesde développement et innover dans ce qu’ils proposent aux touristes enaffirmant leur identité et leurs différences culturelles et en donnant dela valeur à leurs produits, aux ressources humaines et aux économieslocales lors de la gestion de la durabilité sociale économique etenvironnementale du tourisme et de la qualité de l’environnement de leurterritoire. Ces objectifs devraient être clairement définis dans leprotocole de GIZC.
D’après les résultats obtenus grâce aux scénarios du PLAN Bleu et lesrecommandations de la CMDD à l’occasion de la 11ème réunion des Parties
20
contractantes à la Convention de Barcelone, les recommandations suivantesont été proposées pour être inclues dans les critères concernant leprotocole de GIZC :
1. Minimiser les impacts des activités du tourisme sur l’environnement :éliminer la pollution causée par la production de déchets et réduirela pollution des eaux souterraines et de l’eau de la mer ;
2. la GIZC est un bon instrument pour l’aménagement et la gestion duterritoire dans une perspective de développement durable etparticulièrement pour le développement du tourisme durable ;
3. Une GIZC devrait offrir des opportunités de faire des plans pouréviter les risques et pour créer des alternatives ainsi que pourdéfinir des scénarios de tourisme ; la méthode d’Evaluation descapacités d’accueil en matière de tourisme devrait être considéréedès le tout début ;
4. L’importance de la participation du public et particulièrement del’implication des gens et des organisations qui travaillent sur lacôte devrait être soulignée. La participation est le facteur clé pourle développement durable du tourisme ;
5. l’échange d’expériences entre les destinations touristiques de laméditerranée ; l’étude d’un système pour une coopération régionale ;
6. encourager la protection et valoriser l’intérieur des terres ;7. Il y a un besoin de mettre en place un processus de GIZC pour
promouvoir et apprécier à sa juste valeur l’éducationenvironnementale sur les zones côtières de manière à élargir lesconnaissances relatives à l’écotourisme des touristes et desorganisateurs du tourisme dans la région méditerranéenne ;
8. Lorsqu’une GIZC est mise en œuvre, il est recommandé de mener uneexpérience et une initiative pilote en parallèle qui doiventcomprendre des projets de tourisme durable ;
9. Introduire le critère de systèmes de gestion de l’environnement(EMAS, ISO 14001 et l’éco label) : évaluation, révision, contrôleopérationnel, observatoire, pour une GIZC ;
10. Une GIZC devrait comporter des mécanismes permettant unecontribution financière du tourisme à la protection del’environnement (comme les écotaxes sur le tourisme).
BIBLIOGRAPHIE
Ajuntament de Calvia Mallorca, (2002): Plan de Gestion Integral del Litoral de Calvia-PILC, Calvià;CONTE G., CIPRIANI E., DODARO G., LEONELLI M., MIRULLA R., SATTA A.,
(2002): Valutazione della Capacità di Carico Turistica della Provincia di Rimini, Provinciadi Rimini;
Eurostat, (2001), Tourism Trends in Mediterranean Countries, Office for OfficialPublications of the European Communities, Luxembourg;
LANQUAR, R. (1994), Tourisme et environnement en Méditerranée ; UNEP/MAP, (1999), Tourisme et Développement Durable – Recommandations et
propositions par la Commission méditerranéenne du développement durable (CMDD) et adoptespar la Onzième réunion ordinaire des Parties contractantes à la convention de Barcelone, Malta;
21
UNEP/MAP/PAP, (1995): Guidelines for integrated Management of Coastal and Marine Areas-with special reference to the Mediterranean basin, UNEP regional Seas reports andstudies No. 161, Split;
UNEP/MAP/PAP, (1997): “Guidelines for carrying capacity assessment for tourism inMediterranean coastal areas”, Priority Action Programme, Regional ActivityCenter, Split;
UNEP/MAP/PAP, (2003): Sustainability of sap med pilot project: "combatingthe land-based pollution in the coastal sea of the town of Hvar", Reporton procedure of and measures for development and implementation of thetourist eco-charge, Priority Actions Programme/Regional Activity Centre,Split;
SATTA A, PALMISANI F. for UNEP/MAP/PAP (2003) : “Évaluation de la Capacitéd'Accueil pour le développement du tourisme dans les régions côtièresméditerranéennes ». Split: PAP/RAC.
UNEP/MAP/PAP, (2003): “Guide to Good Practice in Tourism Carrying Capacity Assessment”,Split: PAP/RAC.
UNEP/ICLEI, (2003): “Tourism and Local Agenda 21 – The Role of Local Authorities inSustainable Tourism ”, Paris;
World Tourism Organisation, (2001): “Tourism Market Trends 2001 Edition – Europe”,WTO: Madrid.
22