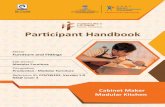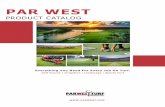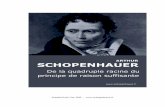Textes réunis par
-
Upload
mshparisnord -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Textes réunis par
Textes réunis par Jean CHAPELOT
Trente ans d’archéologie médiévale en France
Un bilan pour un avenir
Trente ans d’archéologie médiévale en FranceUn bilan pour un avenir
En trente ans, l’archéologie médiévale s’est imposée commeun champ disciplinaire spécifique avec ses thématiques, sesméthodes de travail, son apport décisif à la connaissance desterritoires et à des aspects variés et parfois inattendus de l’his-toire de cette période. La grande réussite de l’archéologiemédiévale n’est pas la croissance du nombre de fouilles : elle estintellectuelle. Comme toute discipline scientifique, son essor etson affirmation sont le résultat du travail d’un nombre croissantde spécialistes et de la sortie de publications originales etmarquantes.Le congrès que la société d’archéologie médiévale, créée en
1983, a organisé en 2006 voulait montrer cette maturité intel-lectuelle. Les vingt-cinq communications ont été confiées auxmeilleurs spécialistes appartenant à toutes les institutions activesdans le domaine, venus de toute la France et appartenant àtoutes les générations au travail. Elles ont été définies de manièreà couvrir tous les aspects, traditionnels ou nouveaux, del’archéologie médiévale et à faire un point détaillé et documentésur l’état de la recherche.L’histoire de l’archéologie médiévale est exposée en intro-
duction. Puis sont présentés d’une manière cohérente etexhaustive tous les thèmes de travail et de réflexion des archéo-logues médiévistes en ce début du XXIe siècle : les paysages, lessites ruraux, les villes, les églises et les inhumations, les châteaux,les résidences aristocratiques, l’étude du bâti et des matériaux ettechniques de construction, les mines et la métallurgie, lesespèces cultivées et domestiquées, la céramique médiévale etpost-médiévale, la batellerie et les territoires fluviaux. Enconclusion sont donnés un état de la discipline et les perspec-tives d’avenir.Cet ouvrage sans équivalent pour aucune autre période de
l’archéologie de la France métropolitaine marquera parce qu’ilest un effort collectif pour faire le bilan et préparer l’avenir d’unediscipline jeune mais en plein essor intellectuel.
50 €
Trente ans d’archéologie médiévale en France. Un bilan pour un avenir
9 782902 685721
ISBN 978-2-902685-72-1
© Publications du CRAHM - 2010
couverture 30 ans_Copie de Couverure 29/01/10 15:42 Page1
EN CONCLUSION d’un colloque qui a été l’occasiond’un bilan sans précédent, fait de surcroît en présence
d’un peu plus de trois cents personnes inscrites, il paraîtnécessaire de livrer à la réflexion de tous quelques élémentssur la situation actuelle de la discipline et sur ce qu’ilconviendrait de faire pour qu’elle évolue au mieux dansles prochaines années1.Au départ de la lecture de ce qui va suivre, il faut avoir
à l’esprit ce qu’a été l’émergence progressive de l’archéologiemédiévale dans les trente dernières années2. La réflexionqui suit commence par un état de l’archéologie médiévale
au début du XXIe siècle, examinant successivement : d’abordle plus important, les acteurs, hommes et femmes, qui lafont vivre, ensuite la nature de leurs travaux, enfin, lesrésultats, en particulier les publications. Suivent un bilandes thématiques actuelles de la recherche et des propositionsd’action et de réflexion à l’usage de la communauté scien-tifique et de ses diverses autorités de tutelle.
1. Les chercheurs, leurs activités et leurs publications
1.1. Les acteurs de la recherche
L’annuaire établi en 2006 à l’occasion du congrès de bilanorganisé par la Société d’archéologie médiévale recense457 personnes qui, à temps plein ou à temps partiel et ycompris comme gestionnaires administratifs, travaillent aubénéfice de l’archéologie médiévale3.
* Directeur de recherche au CNRS, UMR 8558, Centre derecherches historiques, EHESS, CNRS, Paris.
1. La rédaction du présent texte répond à une demande du Comitédes publications et de la diffusion de la recherche archéologique(CPDRA) auprès de la Direction de l’architecture et du patrimoine,relayée par cette dernière et qui, en accordant une aide financière pourl’édition des actes du congrès, a souhaité que cet ouvrage «comprenneun chapitre conclusif consacré aux perspectives de la recherche».
2. CHAPELOT et GENTILI 2010, ci-dessus. 3. CHAPELOT et RIETH 2006a.
L’ARCHÉOLOGIE MÉDIÉVALE EN FRANCE AU DÉBUT DU XXIe SIÈCLEOU COMMENT CHANGER D’ÉPOQUE
JEAN CHAPELOT*
«Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté»Antonio GRAMSCI dans ses Cahiers de prison
Trente ans d’archéologie médiévale en France, Publications du CRAHM, 2010, p. 393-436
Pour des raisons diverses, il manque quelques dizaines depersonnes de statuts variés dans cet état, au plus unecinquantaine. Depuis la date d’établissement de cet annuaireen 2006, la situation n’a changé qu’à la marge et nouspouvons donc considérer qu’il existe environ 500 salariéstravaillant au bénéfice de l’archéologie médiévale.
Les chercheurs et le personnel de recherche
Il est essentiel, avant d’aller plus avant, de bien fixer unpoint essentiel : si la fouille est une activité de recherche,elle ne fait pas automatiquement de ceux qui la prati-quent des chercheurs, cette qualité apparaissant quandles données brutes sont exploitées et publiées.Dans tous les pays possédant un système de recherche,
un chercheur est au moins titulaire d’un doctorat. C’est,dans les établissements publics de recherche comme lesuniversités ou le CNRS, le cas des professeurs et maîtresde conférences, des directeurs et chargés de recherche. Aucôté de ces derniers travaillent dans ces établissementsd’autres personnels de recherche qui sont les ITA(ingénieurs, techniciens et administratifs), que l’onretrouve aussi dans les Services régionaux de l’Archéo-logie avec les conservateurs.La situation est plus difficile à apprécier pour les
salariés des services archéologiques de collectivités ou del’Institut national de recherches archéologiques préven-tives (INRAP) qui ne sont pas des organismes derecherche. Évaluer dans ces cas le nombre de ceux quiont une activité de recherche nécessite de recourir àd’autres éléments d’appréciation que le statut.
Dans les services archéologiques de collectivités ou lessociétés privées, une telle évaluation est facile à partir del’annuaire réalisé en 2006 et d’une connaissance person-nelle d’un milieu qui n’est pas de très grande taille.La démarche est plus difficile dans le cas de l’INRAP.
On peut partir du nombre de salariés de cet instituttitulaires d’un doctorat ou ayant un niveau de diplômeéquivalent : selon le serveur de l’INRAP ils étaient enavril 2009 au nombre de près de 100 parmi les2000 salariés, soit 5 % de l’effectif total, à comparer auplus de 70 % dans les établissements publics de recherchefrançais comme le CNRS ou les universités. À partir desdeux annuaires des archéologues et des thèses publiés parla SAM en 20064, on peut considérer que le nombre desalariés de l’INRAP titulaires d’un doctorat dans ledomaine de l’archéologie médiévale est de l’ordre de 25.Quelques données permettent de cerner le nombre
de ceux qui, en dehors des précédents, participent à desactivités de recherche à l’INRAP (fig. 2).Pour aller un peu plus loin dans l’évaluation, on peut
utiliser l’état des personnes qui ont sollicité un projetd’action scientifique (PAS) pour participer aux travauxd’un projet collectif de recherche, d’une action collectivede recherche (ARC), d’une unité mixte de recherche(UMR), pour préparer une publication ou pour d’autresactivités de recherche : au début de l’été 2009, un total de108 médiévistes étaient dans ce cas, dont
4. CHAPELOT et RIETH 2006a et 2006b.
1
Fig. 1 : Rattachements des 457 professionnels présents
dans l’annuaire des archéologues médiévistes édité en 2006.
2004 2005 2006 2007 2008 Nombre de journées consacrées à la recherche 13500 16000 16879 17935 17242 Articles et ouvrages publiés dans l’année 208 305 220 - - Actions collectives de recherche (ACR) 30 30 27 - - regroupant (nombre de salariés I ) 182 195 150 - - Projets collectifs de recherche (PCR) 60 67 44 - - regroupant (nombre de salariés I ) 182 296 300 - - Axes de recherche Inrap pour 2005-2009 - - 8 9 9 regroupant (nombre de salariés I ) - - 140 - - Unités mixtes de recherche (UMR) - - - 28 28 regroupant (nombre de salariés I ) - - - 254 254 Source : rapports d’activité annuels de l’I . Ceux de 2007 et 2008 ne donnent plus certaines informations.
Figure 2. - Recherche à l’Inrap selon les quatre rapports d’activité 2004-2007
2004 2005 2006 2007 2008 Total Diagnostics réalisés 2014 1978 1950 1808 1452 9202 Rapports de diagnostics remis 1973 1793 1737 1786 1556 8845 Fouilles réalisées 254 321 282 277 251 1385 Rapports de fouille remis 137 164 209 136 218 864
Source : bilans d’activités annuels de l’I
Fig. 3 : Opérations préventives réalisées par l’Inrap de 2004 à 2008 hors DOM1.
1. Les chiffres donnés par le Rapport au Parlement 2006, t. I, p. 81 sont sensiblement différents pour 2004.
CNRS 41 8,9 % Université Professeurs 20 4,3 % Maîtres de conférences 36 7,8 % Autres 9 1,9 % Chercheurs associés 14 3 % Total 79 14,3 % Culture 63 13,7 % INRAP 165 36,1 % Collectivités 68 14,8 % Associations (probablement salariés) 16 3,5 % Entreprises 25 5,4 % Total 457 100 %
Fig. 1 : Rattachements des 457 professionnels présents dans l’annuaire des archéologues médiévistes édité en 2006.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
394 JEAN CHAPELOT
60 archéologues à temps complet et 15 à mi-temps,11 anthropologues, 15 céramologues et 7 autres spécia-listes travaillant dans le domaine de l’archéozoologie ou dela carpologie. Quelques personnes doivent manquer, maisnous avons ici néanmoins le noyau dur des spécialistesd’archéologie médiévale à l’INRAP, soit de l’ordre d’unpeu plus d’une centaine de personnes en équivalent tempsplein si l’on tient compte du fait que certains travaillent enpartie sur d’autres périodes que le Moyen Âge.Cela étant, la situation de ces personnels est parti -
culière dans un établissement public administratif dont lavocation principale, rappelée à plusieurs reprises par lesautorités de tutelle ou les rapports d’inspection de cesdernières années, est en priorité de se consacrer sur leterrain aux diagnostics et aux fouilles préventives5. Lapart de temps de travail consacrée effectivement à larecherche est une donnée essentielle.En 2007, la «recherche» représentait 6,7% du total des
journées de travail des personnels de la filière scientifique ettechnique et 6,4% l’année suivante (fig. 2). En 2009, cettepart, en baisse constante depuis 2005 où elle était de 7,2 %,est tombée à 6,2 %. Le bilan publié en janvier 2008 indiqueque cent équivalents temps plein ont été en 2007 consacrésà la recherche6. Si l’on estime à un quart le personneltravaillant dans le secteur de l’archéologie médiévale, celacorrespond à vingt-cinq équivalents temps plein.
En conclusion, les agents de l’INRAP assimilables àun personnel de recherche ne peuvent consacrer qu’unefaible part de leur temps de travail à celle-ci, beaucoupmoins dans tous les cas que le personnel des universitéset du CNRS. Les personnels des Services régionaux del’archéologie sont dans la même situation que ceux del’INRAP.
Les bénévoles
L’activité des bénévoles, contrairement à une idée reçue,reste significative et se situe à deux niveaux : la partici-pation à certains chantiers ou à des activités deprospection ou postérieures à la fouille ; comme respon-sables d’opération et auteurs de publication.L’examen du nom de tous les responsables d’opération
cités dans les «Chroniques » de la revue Archéologiemédiévale pour les années 2001-2004 (étant entenduqu’une part importante des opérations n’est pas recenséedans ces chroniques) permet d’évaluer à 200 le nombred’archéologues bénévoles qui pendant ces quatre annéesont eu une activité de responsables d’opération de terrain,une moitié intervenant chaque année7.Les annuaires du Centre national d’archéologie urbaine
de Tours (CNAU) montrent que, de 2000 à 2004, entre8 et 16 opérations d’archéologie urbaine ont été dirigéeschaque année par des bénévoles. Le bilan de la CIRA Estrelève que sur les 693 opérations évaluées par elle entre2003 et 2006 un total de 132 (soit 19 %) est attribué à des
5. Rapport sur l’INRAP 2006, p. 19. Ce rapport et un autre un peuplus daté (Rapport d’audit sur l’archéologie préventive 2003) donnentune analyse de la situation de la recherche à l’INRAP.
6. Bilan des six premières années de l’INRAP 2008, p. 3. 7. CHAPELOT et RIETH 2006a, p. XII.
1
Fig. 1 : Rattachements des 457 professionnels présents
dans l’annuaire des archéologues médiévistes édité en 2006.
2004 2005 2006 2007 2008 Nombre de journées consacrées à la recherche 13500 16000 16879 17935 17242 Articles et ouvrages publiés dans l’année 208 305 220 - - Actions collectives de recherche (ACR) 30 30 27 - - regroupant (nombre de salariés I ) 182 195 150 - - Projets collectifs de recherche (PCR) 60 67 44 - - regroupant (nombre de salariés I ) 182 296 300 - - Axes de recherche Inrap pour 2005-2009 - - 8 9 9 regroupant (nombre de salariés I ) - - 140 - - Unités mixtes de recherche (UMR) - - - 28 28 regroupant (nombre de salariés I ) - - - 254 254 Source : rapports d’activité annuels de l’I . Ceux de 2007 et 2008 ne donnent plus certaines informations.
Figure 2. - Recherche à l’Inrap selon les quatre rapports d’activité 2004-2007
2004 2005 2006 2007 2008 Total Diagnostics réalisés 2014 1978 1950 1808 1452 9202 Rapports de diagnostics remis 1973 1793 1737 1786 1556 8845 Fouilles réalisées 254 321 282 277 251 1385 Rapports de fouille remis 137 164 209 136 218 864
Source : bilans d’activités annuels de l’I
Fig. 3 : Opérations préventives réalisées par l’Inrap de 2004 à 2008 hors DOM1.
1. Les chiffres donnés par le Rapport au Parlement 2006, t. I, p. 81 sont sensiblement différents pour 2004.
79 14,3 %
Fig. 2 : Recherche à l’INRAP selon les cinq rapports d’activité 2004-2008.
Publications du CRAHM, 2010
395CONCLUSION
bénévoles, dont 16 % pour le Moyen Âge et 30 % pourl’histoire des techniques de l’Antiquité au Moyen Âge8.
Environ 500 salariés de statuts variés travaillent, d’unemanière ou d’une autre, au bénéfice de l’archéologiemédiévale. Parmi eux, 300 personnes ont une activité derecherche que l’on peut identifier par leur statut pourcertains et pour tous par leurs publications.Dans les universités et au CNRS, nous avons
120 chercheurs auxquels s’ajoutent des ITA. Un peu plusd’une centaine de salariés ont une activité de recherche àl’INRAP, d’autres font de même dans les Servicesrégionaux de l’archéologie, les musées, les services decollectivités et des sociétés privées. Il faut ajouter quelquesbénévoles de bon niveau.Deux éléments importants doivent tempérer ce qui
précède : une part de ces personnes n’est active qu’à tempsplus ou moins partiel ou travaille hors de France ou dudomaine de l’archéologie médiévale pour une part de leurtemps. L’examen des publications, qui sera fait plus bas,nous permettra de préciser ce qu’est réellement le nombrede chercheurs actifs : comme nous le verrons, une centainede personnes au plus publient chaque année au moinsun article ou un livre qui rend compte de la rechercheconsacrée à l’archéologie médiévale (fig. 11, 12, 13 et 15).
1.2. Les activités de recherche
Faire le bilan de la recherche dans le domaine de l’archéologiemédiévale, c’est d’abord connaître le nombre d’opérations deterrain réalisées chacune de ces dernières années.
Nombre d’opérations de terrain toutes périodes confondues conduites ces dernières années
Il n’existe pas de bilan récent des opérations de terrain.Après les deux bilans établis pour 1985-1989 par leConseil supérieur de la recherche archéologique (CSRA)et pour 1990-1994 par le Conseil national de larecherche archéologique (CNRA)9, nous n’avons riendepuis celui édité par ce même conseil et qui concerneles années 1995-1999 : son indigence, tout spécialementà propos du Moyen Âge, est étonnante10.La publication annuelle de bilans scientifiques par
chaque Service régional de l’archéologie, entreprise en1991, marque le pas depuis dix ans : de 2000 à 2007, il en
a été publié 93 sur les 176 qui auraient dû l’être par les 22régions métropolitaines11. Gallia Informations n’existe plus.Le projet du ministère de la Culture et de la Communi-cation de constitution d’une base de données en lignerecensant les opérations de terrain n’avance guère12. Labase Patriarche est d’une utilisation délicate dans l’optiquequi nous intéresse ici13. L’un des seuls instrumentspermettant de suivre une part des travaux de terrain estl’annuaire des opérations édité par le Centre nationald’archéologie urbaine (CNAU) : il risque de disparaîtreavec cette structure du ministère de la Culture et avec luile capital d’expérience dans le domaine de l’informationscientifique des personnels qui élaboraient ces annuaires.Les bilans de fin de mandat des commissions interré-
gionales de la recherche archéologique (CIRA), officialiséspar le décret du 11 mai 200714, n’existent actuellementpour la période 2003-2006 que pour quatre des six CIRAde la France métropolitaine : celles de l’Est, de l’Ouest, duSud-Est et du Centre-Est15. Il manque une bande Nord-Sud composée des CIRA Centre-Nord et Sud-Ouest avecnotamment deux des régions parmi les plus actives sur leterrain, l’Île-de-France et le Centre. Par ailleurs, ces bilansne portent que sur une part des opérations réalisées : lesrapports de diagnostics le plus souvent seulement quandils sont suivis de fouilles et les rapports de fouilles préven-tives et programmées16. On ne trouve pas dans ceuxpubliés à ce jour de données chiffrées synthétiques17.
8. Bilan CIRA Est 2008, p. 123-128.9. La recherche archéologique en France 1990 et 1997.10. La recherche archéologique en France 2002.
11. Cet état est dans http://www.archeologie.culture.gouv.fr.12. Une préfiguration appelée Archéologie de la France – Informa-
tions et contenant 1500 notices est accessible depuis le début de l’été2009 (http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/index). La plupart de ces noticessont des numérisations des Bilans scientifiques régionaux concernant ladécennie 1990. En 2000, le prototype accessible sur Internet contenait818 notices concernant sept régions de France.
13. Voir à ce sujet La recherche archéologique en Picardie 2005,p. 253 à propos de l’archéologie urbaine.
14. Bilan CIRA Est 2008, p. 7 et Bilan CIRA Est 2008, p. 8.15. Bilan CIRA Est 2008; Bilan CIRA Ouest 2008; Bilan CIRA
Sud-Est 2009; Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008 (Voir le t. II quicontient le Bilan quadriennal de la CIRA (2003-2006) suivi de laProgrammation scientifique interrégionale qui est l’équivalent d’un bilandécennal comme ceux évoqués plus bas).
16. Cf. notamment Bilan CIRA Est 2008, p. 13, p. 15-16, etsurtout p. 129-130.
17. Le vade-mecum rédigé par l’Inspection générale de l’archi-tecture et du patrimoine (archéologie) le 15 mai 2006 «à l’usage desexperts des CIRA en vue de la rédaction d’un rapport quadriennal»précise pourtant que ces bilans doivent donner la liste et la carto-graphie « de toutes les opérations effectuées dans chaque régionpendant la période 2003-2006, qu’elles aient fait l’objet d’un examenen CIRA ou non» (Bilan CIRA Est 2008, p. 134).
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
396 JEAN CHAPELOT
Le bilan publié par la CIRA Centre-Nord à la fin du bilande la recherche archéologique de Picardie ne porte que surcette région et est un exposé très rapide18.Dans une circulaire du 1er juin 2004, le directeur de
l’architecture et du patrimoine (DAPA) a demandé auxpréfets de régions d’organiser par le biais des Servicesrégionaux de l’archéologie (SRA) «des bilans quantitatifset qualitatifs des opérations et travaux réalisés ces dernièresannées dans le but de dresser un “état de la recherche”régionale, en rassemblant et en ordonnant par périodes etpar thèmes les éléments d’information disponibles […]».À ce jour, cette circulaire a conduit pour ce qui concernele Moyen Âge à la rédaction de trois bilans décennauxsur vingt-deux : ceux des régions Alsace, PACA et Rhône-Alpes19. Différents les uns des autres, certains seulementdonnent un état chiffré du nombre d’opérations de terrainréalisées dans la région pendant la période 1995-2004.Le bilan de la recherche archéologique en Picardie est
une initiative originale qui présente d’autant plus d’intérêtqu’elle concerne une part de la CIRA Centre-Nord qui n’apas encore rédigé son bilan de fin de mandat20.La documentation disponible est donc lacunaire et
hétérogène, mais elle a l’immense intérêt de donner lavision de l’état actuel de l’archéologie française par lesmembres des CIRA qui, même s’ils n’ont pas les moyensd’examiner l’ensemble des résultats, sont les plus enmesure d’avoir la possibilité et la légitimité pour émettreune opinion informée et indépendante. Il s’agit d’unesituation sans précédent dans l’histoire de l’archéologiefrançaise et c’est pour cela qu’il sera fait un large usage deces avis.Le rapport sur l’archéologie préventive remis par le
ministère de la Culture au Parlement en 2006 ne contient
qu’un tableau pour les années 2002-2005 du nombretotal de prescriptions de diagnostics et de fouilles émises,annulées et suivies d’effet : il montre qu’il a été réalisé autotal 10349 diagnostics et 1821 fouilles préventives, soiten moyenne chaque année 2587 diagnostics et455 fouilles préventives toutes périodes confondues21.Les rapports annuels de l’INRAP donnent des chiffres
qui sont essentiels, compte tenu du poids de l’archéo-logie préventive dans les opérations de terrain (fig. 3).Les documents qui précèdent nous conduisent à consi-
dérer que pour chacune des deux dernières années, le nombrede diagnostics et de fouilles préventives a été, avec ceuxréalisés par les opérateurs agréés et les entreprises privées,d’environ 1800, à quoi il faut, pour établir le nombre totald’opérations de terrain, ajouter les fouilles programméesdont il n’existe pas, à ma connaissance, de bilan chiffré précis,mais qui doivent être quelques centaines par an.
On peut donc considérer qu’en 2007-2008 le nombred’opérations de terrain se situe entre 2100 et 2300. Pourapprécier ce chiffre et l’analyse de la situation de l’archéo-logie médiévale qui va suivre, il faut faire une comparaisonavec la situation d’il y a vingt ans.Contrairement à une idée reçue, il n’y a pas eu de forte
croissance du nombre d’opérations de terrain dans les vingtdernières années. De 1983 à 1987, le nombre total desauvetages urgents, sauvetages programmés et fouillesprogrammées est passé de 1551 à 191823. En 1988 ont étéréalisés 801 sauvetages urgents, 197 sauvetagesprogrammés et 347 fouilles programmées, soit au total1345 opérations24 à comparer aux 2100 à 2300 de 2008.
18. La recherche archéologique en Picardie 2005, p. 277-293.19. Bilan scientifique Alsace 2006; Bilan scientifique Provence-Alpes-
Côte-d’Azur 2008; Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008.20. La recherche archéologique en Picardie 2005.
21. Rapport au Parlement 2006, t. I, p. 78.22. Les chiffres donnés par le Rapport au Parlement 2006, t. I,
p. 81 sont sensiblement différents pour 2004.23. Rapport annuel sur la recherche archéologique en France s.d.,
p. 2.24. La recherche archéologique en France 1990, p. 23 et 27.
1
Fig. 1 : Rattachements des 457 professionnels présents
dans l’annuaire des archéologues médiévistes édité en 2006.
2004 2005 2006 2007 2008 Nombre de journées consacrées à la recherche 13500 16000 16879 17935 17242 Articles et ouvrages publiés dans l’année 208 305 220 - - Actions collectives de recherche (ACR) 30 30 27 - - regroupant (nombre de salariés I ) 182 195 150 - - Projets collectifs de recherche (PCR) 60 67 44 - - regroupant (nombre de salariés I ) 182 296 300 - - Axes de recherche Inrap pour 2005-2009 - - 8 9 9 regroupant (nombre de salariés I ) - - 140 - - Unités mixtes de recherche (UMR) - - - 28 28 regroupant (nombre de salariés I ) - - - 254 254 Source : rapports d’activité annuels de l’I . Ceux de 2007 et 2008 ne donnent plus certaines informations.
Figure 2. - Recherche à l’Inrap selon les quatre rapports d’activité 2004-2007
2004 2005 2006 2007 2008 Total Diagnostics réalisés 2014 1978 1950 1808 1452 9202 Rapports de diagnostics remis 1973 1793 1737 1786 1556 8845 Fouilles réalisées 254 321 282 277 251 1385 Rapports de fouille remis 137 164 209 136 218 864
Source : bilans d’activités annuels de l’I
Fig. 3 : Opérations préventives réalisées par l’Inrap de 2004 à 2008 hors DOM1.
1. Les chiffres donnés par le Rapport au Parlement 2006, t. I, p. 81 sont sensiblement différents pour 2004.
79 14,3 %
Fig. 3 : Opérations préventives réalisées par l’INRAP de 2004 à 2008 hors DOM 22.
Publications du CRAHM, 2010
397CONCLUSION
Le plus remarquable en vingt ans est la croissance desmoyens humains et financiers. En 1989, les fouillesprogrammées avaient reçu du ministère de la Culture14,3 millions de francs et l’Association pour les fouillesarchéologiques nationales (AFAN) 19,3 millions de francsdu ministère et 120 millions de francs de créditsextérieurs, soit un total de 140 millions de francs25. En2008, le budget de l’INRAP, qui a succédé à l’AFAN, a étéde près de 140 millions d’euros26. Les services de collec-tivités et les sociétés privées agréées ont bénéficié aussi definancements pour réaliser des opérations préventives.L’effectif employé en équivalent temps plein pour
l’archéologie de sauvetage était en 1989 de 547 personnesà l’AFAN27, celui de l’INRAP en 2008 pour le préventifde 2090,5 personnes28, auxquelles il faut ajouter lepersonnel d’autres intervenants aussi bien en 1989 qu’en2008. On peut situer autour de 150 le nombre de ceuxqui se consacraient à la recherche archéologique médiévaleil y a vingt ans, contre 300 en 2008.Cette croissance des moyens humains et financiers
permet désormais d’organiser des chantiers de plus grandesurface et de plus longue durée réunissant des équipescomplètes et diversifiées : c’est cela qui, avec l’apparition dethématiques nouvelles de travail sur le terrain, est le plussignificatif dans l’évolution de ces vingt dernières années.Au titre du sauvetage urgent, l’équivalent de nos
actuelles fouilles préventives, 128 opérations avaientbénéficié en 1988 d’un financement supérieur ou égal à100000 francs (un peu plus de 15000 euros)29. Propor-tionnellement, la part des opérations qui ont reçu en2008 un financement comparable est infiniment plusgrande. Le rapport de l’INRAP pour 2008 permet de sefaire une idée sur ce point. Cette année-là, les1484 diagnostics concernaient une surface de 10435 haet 75126 journées de travail leur avaient été consacrées,soit une moyenne par diagnostic de 7 ha et 50 journéesde travail. La même année, les 254 fouilles préventives ontporté sur 257 ha étudiés par 175472 journées, ce quidonne par opération une moyenne d’un hectare et690 journées30. Des opérations de terrain de cette ampleurétaient rarissimes il y a vingt ans alors qu’elles sontdésormais usuelles.
L’évolution du préventif, qui constitue la majeurepartie du travail de terrain, permet de bien caractérisercelle de l’ensemble de l’archéologie en vingt ans : sesmoyens financiers ont été multipliés par sept et ses effectifspar quatre, le nombre d’opérations de terrain, programmécompris, augmentant au plus de 60 %, mais avec dessurfaces et des durées d’intervention sans communemesure avec ce qui se pratiquait il y a deux décennies.
Bilan des activités de terrain dans le domaine de l’archéologie médiévale.
Une baisse marquée du nombre d’opérations et des surfaces concernées
Il faut maintenant évaluer ce que sont les activités deterrain dans le domaine de l’archéologie médiévale et à lalumière des observations générales qui précèdent.Ce qui frappe d’emblée est la diminution du nombre
d’opérations dans le domaine du préventif. Cette baisse esttrès nette à l’examen des cinq bilans annuels de l’INRAPpour 2004-2008 qui montrent aussi une chute dessurfaces concernées (fig. 4)31.Même si l’on ajoute aux opérations conduites par
l’INRAP celles réalisées par les opérateurs agréés ou lessociétés privées, dont la part, même si elle est croissante,reste marginale32, la tendance générale à la baisse est unedonnée certaine de l’archéologie de ces dernières années.Elle est relevée par plusieurs des bilans de fin de mandatdes CIRA, par exemple celui de la CIRA Est33 ou de laCIRA Ouest qui souligne la chute de la surface totaleétudiée34. En Picardie et pour la période 1991 à 2005, labaisse, surtout celle des fouilles préventives etprogrammées, est sensible à partir de 200235.Le Moyen Âge est naturellement concerné par cette
tendance générale. Pour la Picardie, le bilan rédigé par laCIRA Centre-Nord souligne, pour les années 1999-2005et à propos du haut Moyen Âge, un fort tassement36. Le
25. La recherche archéologique en France 1990, p. 27 et 17.26. Rapport d’activités INRAP 2008, p. 7627. La recherche archéologique en France 1990, p. 23.28. Rapport d’activités INRAP 2008, p. 80.29. La recherche archéologique en France 1990, p. 23.30. Rapport d’activités INRAP 2008, p. 74 et 88.
31. Le Rapport d’activités de l’INRAP pour 2008, p. 10 et p. 54-56, relève cette diminution qui est de 18 % en un an pour lesprescriptions de diagnostics, le nombre de ceux-ci diminuant dans lamême proportion, tandis que pour les fouilles préventives le nombrede prescriptions reste stable, mais celui des opérations réalisées baisse.
32. Rapport au Parlement 2006, t. I, p. 80 et p. 84.33. Bilan CIRA Est 2008, p. 14.34. Bilan CIRA Ouest 2008, p. 17 et 18.35. La recherche archéologique en Picardie 2005, graphique p.13.36. La recherche archéologique en Picardie 2005, p. 289. Cf. aussi
Ibid., p. 306, le bilan du comité de pilotage de ce bilan : il va dans lemême sens pour le haut et le bas Moyen Âge.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
398 JEAN CHAPELOT
bilan scientifique d’Alsace donne un état des châteauxétudiés depuis 1980, soit un total de 89 opérations sur54 sites différents : la baisse est sensible à partir de 199937.Le bilan de la CIRA Centre-Est relève une régression dunombre de sites médiévaux étudiés dans les quatre années2004-200738.Deux communications dans ce volume confirment
cette baisse générale et à l’échelle de la France. ÉdithPeytremann montre le nombre d’interventions et de sitesnouveaux d’habitats ruraux du haut Moyen Âge décou-verts chaque année dans la moitié nord de la France de1980 à avril 2006 : la baisse est régulière à partir de 2001,avec en 2004 des chiffres inférieurs à ceux de 1980-198239. Marie-Pierre Ruas met en lumière l’évolution dunombre d’auteurs ayant réalisé de 1965 à février 2006une analyse carpologique sur un site archéologiquefrançais datant du Moyen Âge ou de l’époque moderne40 :après une croissance du nombre d’intervenants corréléebien évidemment à l’essor de l’archéologie médiévale, lenombre de sites étudiés stagne en 2000-2006 tandis quecelui des travaux publiés ou inédits, après un maximumen 1995-2004, décroît ensuite.
Nombre d’opérations d’archéologie médiévale
À défaut d’un bilan précis, il faut nous contenter d’éva-luations faites à partir du poids, estimé à partir dediverses sources, du Moyen Âge dans l’ensemble desopérations de terrain. Le rapport d’activité 2008 del’INRAP indique que la part de cette période dans lesfouilles préventives a été de 22 %41. Les bilans des CIRAdonnent des chiffres comparables : dans le Sud-Est,28 % des fouilles programmées et préventives42, dans leCentre-Est, un quart du programmé43, dans l’Ouest,24 % aussi bien en préventif qu’en programmé44, et dansl’Est, 33 % pour le programmé et 24 % pour lepréventif45.On peut donc estimer que le Moyen Âge constitue
environ 25 % du nombre total annuel d’opérations, soitde l’ordre de 550 par an. Cette évaluation peut êtrerecoupée grâce aux «Chroniques des fouilles» de la revueArchéologie médiévale et aux Annuaires des opérations deterrain du CNAU.
37. Bilan scientifique Alsace 2006, p. 153-154.38. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 45-48.39. PEYTREMANN 2010, p. 108. Cf. aussi sa remarque à propos de
cette baisse, p. 113.40. RUAS 2006, p. 20.
41. Rapport d’activités INRAP 2008, p. 56. La part de la proto -histoire est de 28 % et celle de l’Antiquité de 34 %. Les rapportsd’activités de 2004-2007 fixent la part du Moyen Âge entre 20 et23 %, toujours un peu en dessous de celle de la protohistoire, un tiersdes fouilles étant consacré à l’Antiquité.
42. Bilan CIRA Sud-Est 2009, p. 19.43. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 8.44. Bilan CIRA Ouest 2008, p. 26.45. Bilan CIRA Est 2008, p. 26.
S
I’ldéii’d
oppar:ecuroS
oN:4ig.F
.I’ledsétivitca’dstro
uiederbmonelehcuagà(rstnevérpsnoitarépo’derbm
letiordà,scitsongaidedtesellui2à4002edparnI’lrapseésiér
.)seénrecnocsecrussecrapseéecnocsecruste8002
ic-sellec
N:5ig.F
dniotarépo’dsecitonederbmoN
deeuiqnorhC«alsdinarreted
lhAeuvera»selilusde
e
N:5ig.F
édniotarépodsecitonederbmoN
1791nenoitaércassiupedadeeuiqnorhC«alsdinarreted
.lhAeuveralde»selilusde
e
oN: 6ig.F
dteniotarépo’dsecitonederbm
.6891nselsdseéecnocselilved
inigro’lsiupedUNACudseriaun
neein
2
9
S
I’ldéii’d
oppar:ecuroS
oN:4ig.F
.I’ledsétivitca’dstro
uiederbmonelehcuagà(rstnevérpsnoitarépo’derbm
letiordà,scitsongaidedtesellui2à4002edparnI’lrapseésiér
.)seénrecnocsecrussecrapseéecnocsecruste8002
ic-sellec
N:5ig.F
dniotarépo’dsecitonederbmoN
deeuiqnorhC«alsdinarreted
lhAeuvera»selilusde
e
N:5ig.F
édniotarépodsecitonederbmoN
1791nenoitaércassiupedadeeuiqnorhC«alsdinarreted
.lhAeuveralde»selilusde
e
oN: 6ig.F
dteniotarépo’dsecitonederbm
.6891nselsdseéecnocselilved
inigro’lsiupedUNACudseriaun
neein
2
9
S
I’ldéii’d
oppar:ecuroS
oN:4ig.F
.I’ledsétivitca’dstro
uiederbmonelehcuagà(rstnevérpsnoitarépo’derbm
letiordà,scitsongaidedtesellui2à4002edparnI’lrapseésiér
.)seénrecnocsecrussecrapseéecnocsecruste8002
ic-sellec
N:5ig.F
dniotarépo’dsecitonederbmoN
deeuiqnorhC«alsdinarreted
lhAeuvera»selilusde
e
N:5ig.F
édniotarépodsecitonederbmoN
1791nenoitaércassiupedadeeuiqnorhC«alsdinarreted
.lhAeuveralde»selilusde
e
oN: 6ig.F
dteniotarépo’dsecitonederbm
.6891nselsdseéecnocselilved
inigro’lsiupedUNACudseriaun
neein
2
9
S
I’ldéii’d
oppar:ecuroS
oN:4ig.F
.I’ledsétivitca’dstro
uiederbmonelehcuagà(rstnevérpsnoitarépo’derbm
letiordà,scitsongaidedtesellui2à4002edparnI’lrapseésiér
.)seénrecnocsecrussecrapseéecnocsecruste8002
ic-sellec
N:5ig.F
dniotarépo’dsecitonederbmoN
deeuiqnorhC«alsdinarreted
lhAeuvera»selilusde
e
N:5ig.F
édniotarépodsecitonederbmoN
1791nenoitaércassiupedadeeuiqnorhC«alsdinarreted
.lhAeuveralde»selilusde
e
oN: 6ig.F
dteniotarépo’dsecitonederbm
.6891nselsdseéecnocselilved
inigro’lsiupedUNACudseriaun
neein
2
9
Fig. 4 : Nombre d’opérations préventives réalisées par l’INRAP de 2004 à 2008 et surfaces concernées par celles-ci (à gauche le nombre de fouilles et de diagnostics, à droite les surfaces concernées en hectare).
Publications du CRAHM, 2010
399CONCLUSION
La «Chronique des fouilles» d’Archéologie médiévale(fig. 5) montre un pic en 1998 suivi d’une chute jusqu’en2005 et une remontée les deux années suivantes à unniveau qui est celui de 1990-1991. L’annuaire des opéra-tions de terrain du CNAU indique exactement la mêmeévolution (fig. 6). Ces deux évolutions parallèles s’expli-quent de diverses manières, dont un fort taux denon-réponses des fouilleurs aux questionnaires46, maispour une part il s’agit des conséquences de la baisse dunombre d’opérations.Malgré leurs lacunes, ces deux outils documentaires
permettent d’établir un nombre minimal d’opérationsrelevant de l’archéologie médiévale. Les annuaires desopérations de terrain du CNAU montrent qu’en 2000-2004 le Moyen Âge était présent dans environ150 opérations. Les Chroniques d’Archéologie médiévalerecensent 250 opérations chacune de ces dernières années :si l’on enlève ce qui concerne l’archéologie urbaine, il resteplus de 200 opérations. Ces deux instruments documen-taires nous font donc connaître un minimum de350 opérations d’archéologie médiévale, à comparer aux550 opérations probables relevant de l’archéologiemédiévale et réalisée chacune de ces dernières années.
Des changements récents et mal perceptibles de la naturedes opérations de terrain
Les lacunes documentaires sont d’autant plus préoccupantesque des changements importants sont à l’œuvre depuis
quelques années dans les motifs, la nature et les lieuxd’intervention comme conséquence de l’essoufflementd’équipes dans certaines régions, d’effets de mode, de laterritorialisation des personnels intervenant en archéo-logie préventive, mais surtout des changements dans lapression de l’aménagement du territoire. Tout cela setraduit par la concentration des moyens sur de grandesopérations de diagnostic susceptibles de déboucher surdes fouilles préventives importantes, une augmentation dela surface et une chute du nombre de diagnostics,notamment ceux de petite surface, une baisse des opéra-tions en centre-ville au profit de celles de la périphérieurbaine, le développement d’opérations préventiveslinéaires en milieu urbain lors de l’installation detramways, etc. Ces pratiques nouvelles ont des consé-quences mal perceptibles, mais sans doute importantesquant à la nature des secteurs et aux types de sites diagnos-tiqués puis fouillés.
Les thématiques des opérations de terrain
C’est en tenant compte des observations qui précèdentqu’il faut maintenant examiner les thématiques du travailde terrain. Nous ne pouvons nous appuyer pour connaîtrece point que sur les Chroniques de la revue Archéologiemédiévale qui ne rapportent qu’une part de la réalité (fig. 7et 8).Pour l’année 2007, les constructions et habitats civils,
qui regroupent les sites urbains (H 19 de la program-mation du CNRA) et ruraux (H 20), représentent un46. Les données du CNAU 2007, p. 14-15.
S
I’ldéii’d
oppar:ecuroS
oN:4ig.F
.I’ledsétivitca’dstro
uiederbmonelehcuagà(rstnevérpsnoitarépo’derbm
letiordà,scitsongaidedtesellui2à4002edparnI’lrapseésiér
.)seénrecnocsecrussecrapseéecnocsecruste8002
ic-sellec
N:5ig.F
dniotarépo’dsecitonederbmoN
deeuiqnorhC«alsdinarreted
lhAeuvera»selilusde
e
N:5ig.F
édniotarépodsecitonederbmoN
1791nenoitaércassiupedadeeuiqnorhC«alsdinarreted
.lhAeuveralde»selilusde
e
oN: 6ig.F
dteniotarépo’dsecitonederbm
.6891nselsdseéecnocselilved
inigro’lsiupedUNACudseriaun
neein
2
9
S
I’ldéii’d
oppar:ecuroS
oN:4ig.F
.I’ledsétivitca’dstro
uiederbmonelehcuagà(rstnevérpsnoitarépo’derbm
letiordà,scitsongaidedtesellui2à4002edparnI’lrapseésiér
.)seénrecnocsecrussecrapseéecnocsecruste8002
ic-sellec
N:5ig.F
dniotarépo’dsecitonederbmoN
deeuiqnorhC«alsdinarreted
lhAeuvera»selilusde
e
N:5ig.F
édniotarépodsecitonederbmoN
1791nenoitaércassiupedadeeuiqnorhC«alsdinarreted
.lhAeuveralde»selilusde
e
oN: 6ig.F
dteniotarépo’dsecitonederbm
.6891nselsdseéecnocselilved
inigro’lsiupedUNACudseriaun
neein
2
9
S
I’ldéii’d
oppar:ecuroS
oN:4ig.F
.I’ledsétivitca’dstro
uiederbmonelehcuagà(rstnevérpsnoitarépo’derbm
letiordà,scitsongaidedtesellui2à4002edparnI’lrapseésiér
.)seénrecnocsecrussecrapseéecnocsecruste8002
ic-sellec
N:5ig.F
dniotarépo’dsecitonederbmoN
deeuiqnorhC«alsdinarreted
lhAeuvera»selilusde
e
N:5ig.F
édniotarépodsecitonederbmoN
1791nenoitaércassiupedadeeuiqnorhC«alsdinarreted
.lhAeuveralde»selilusde
e
oN: 6ig.F
dteniotarépo’dsecitonederbm
.6891nselsdseéecnocselilved
inigro’lsiupedUNACudseriaun
neein
2
9
Fig. 5 : Nombre de notices d’opération de terrain dans la «Chronique des fouilles» de la revue Archéologie
médiévale depuis sa création en 1971.Fig. 6 : Nombre de notices d’opération et de villes concernéesdans les annuaires du CNAU depuis l’origine en 1986.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
400 JEAN CHAPELOT
tiers des opérations en nombre et beaucoup plus enmoyens mobilisés. Les constructions ecclésiastiques et lessépultures et nécropoles (H 23 du CNRA) constituent unautre tiers, les édifices fortifiés (H 24) 20 % et tout ce quiconcerne les techniques (H 25) et la culture matérielle(H 26) un peu moins de 10 %. L’étude des réseaux decommunications terrestres et fluviaux (H 27), des aména-gements portuaires et du commerce maritime (H 28) etenfin l’archéologie navale (H 29), dans la mesure où unelarge part des travaux de terrain sur ces thèmes est inclusedans l’étude des villes ou du monde rural, représententquelques pour cent de l’activité de terrain.
Dans les quatorze dernières années, l’évolution a ététrès marquée (fig. 7 et 8).– croissance en pourcentage (le nombre annuel d’opérationsrecensées étant en 2007 pratiquement le même qu’en 1994)de ce qui relève de l’habitat civil et de l’environnementurbain et surtout rural et des sépultures et nécropoles;
– stabilité en pourcentage mais diminution en nombred’opérations de ce qui relève des installations artisanales ;– forte décroissance en pourcentage et en nombre desconstructions ecclésiastiques et de l’habitat fortifié, lesopérations rattachées à ces deux thématiques étant deuxfois moins nombreuses en 2007 qu’en 1994.
Les activités de recherche post-fouille
Pour l’essentiel, l’étude des résultats du terrain estfinancée par des crédits affectés qui déterminent lesprogrammes de recherche de l’INRAP (PRI) et surtoutceux soutenus par le ministère de la Culture et de laCommunication (PCR) ou par l’ensemble des interve-nants potentiels (ACR). Il faudrait ajouter lesprospections-inventaires et les prospections-thématiquesqui jouent un rôle très important dans le développementde certains thèmes de recherche, comme les techniquesou l’habitat fortifié, mais dont il ne semble pas possibled’établir un état.
3
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I. Cons . et habitats civils. Environnement rural et urbain 80 56 92 64 106 76 84 66 61 52 67
47
75
83 II. Const. et habit ecclésiastiques 102 62 67 69 94 85 83 71 61 55 49
46
60
46
III. Const. et habit fortifiés 98 100 65 79 91 79 74 80 58 51 44
29
44
47
IV. Sépultures et nécropoles 33 35 20 25 32 28 32 24 20 16 27
12
20
33
V. Install. artisanales : céramique 14 8 6 3 10 6 3 5 8 3 1
2
4
5
V. Install. artisanales : métallurgie 15 15 16 17 20 16 17 19 8 17 10
7
6
10
V. Install. artisanales : autres 4 7 2 4 9 3 3 3 7 3 4
1
4
3
VI. Archéologie subaquatique 3 3 6 9 2 1 - 5 7 14 3
5
4
5
VII. Prospections-inventaire 8 2 5 15 7 6 7 17 8 8 6
-
-
-
VIII. Diverses chroniques - - - 4 3 2 3 - - - -
3
13
5 Total 357 288 279 289 374 302 306 290 238 219 211 152 230 237
NB : les projets collectifs de recherche, analysés depuis 2003 dans ces Chroniques, ne sont pas pris en compte.
Fig. 7 : Thématiques des fouilles et des prospections des années 1994-2007 recensées dans la « Chronique des fouilles » de la revue Archéologie médiévale.
Fig. 8 : Pourcentage de chacune des six thématiques principales des « Chroniques des fouilles » d’Archéologie
médiévale (fouilles et prospections recensées de 1994 à 2007).
1994 1995 1996 1997
1997 1998 1999 2000 2001 2002
2002 2003 2004 2005 2006
2006 2007
icstatibahte.snoCI.larurtnemenonrivEn
niaburtibahte.tsnoCII.
seuqistaésilcectibahte.tsnoCIII.
séfiitrfoteserutlupéS.IV
seloporcné
.slivite
80 56 92 64
102 62 67 69
98 100 65 79
33 35 20 25
4 106 76 84 66
69 94 85 83 71
79 91 79 74 80
25 32 28 32 24
61 52 67 47 75
61 55 49 46 60
58 51 44 29 44
20 16 27 12 20
75 83
60 46
44 47
20 33
:selanasitra.llatsnIV.euqimarcé
:selanasitra.llatsnIV.eigrullatmé
:selanasitra.llatsnIV.sertau
eigoloéhcrA.VIeuqitauqabsu
snoitcepsorP.IVI -eiranteinv
:14 8 6 3
:15 15 16 17
:4 7 2 4
3 3 6 9
8 2 5 15
3 10 6 3 5
17 20 16 17 19
4 9 3 3 3
9 2 1 - 5
15 7 6 7 17
8 3 1 2
8 17 10 7
7 3 4 1
7 14 3 5
8 8 6 -
4 5
6 10
4 3
4 5
- -
eiranteinv
qinorhcsesrveiD.IIVIlatTo
NB setjor pes: l
8 2 5 15
seuq - - - 4357 288 279 289
s dséylan, aehcerhce re dsffsitecllo c
7.gFi liusedseuqitaméhT: «a ls euqinorCh
15 7 6 7 17
4 3 2 3 -289 374 302 306 290
uqinorh Cess cna d300 2siueps d
énsedsnoitcepsorpsedtesellselliused euveraled» h
8 8 6
- - - 3 13238 219 211 152 230
.etmpoc ensirs pa ptnsoe ns,eu
4991seé - seésnecer07 20ameo
13 5230 237
8.gFi oP:
htx issedenucahcedegatnecruo
a selliu
3
«sedseipcinrpseuiqtaméh Ch9 1deseésnece rsnoitcepsor pt es
selliusedseuqinorCh ’d» h
.)700499
eo
Fig. 7 : Thématiques des fouilles et des prospections des années 1994-2007 recensées dans la «Chronique des fouilles» de la revue Archéologie médiévale.
Publications du CRAHM, 2010
401CONCLUSION
Trois projets de recherche INRAP (PRI) concernentl’archéologie médiévale47. Les actions collectives derecherche (ACR) ont été lancées en 2002 et poursuiviesen 2003 : sur un total de 30 ACR sept relevaienttotalement ou partiellement de l’archéologie médiévale48.Le mode de financement des activités de recherche
postérieures au terrain le plus courant reste les Projetscollectifs de recherche (PCR) créés au début des annéesquatre-vingt. Dans un état qui doit recenser la grandemajorité des opérations de ce genre financées dans les années1991-2008 et être pratiquement exhaustif pour les six ousept dernières années, 93 PCR concernent totalement oupartiellement l’archéologie médiévale (fig. 9)49. L’étude des
édifices religieux regroupe le plus grand nombre deprojets de recherche (23 au total), avec un très fortdéséquilibre entre l’étude des bâtiments (21 opérations)et celle des nécropoles et cimetières (2 opérations). Ledéséquilibre observé dans les opérations de terrain estdonc ici accentué. L’étude du monde rural, avec 23opérations, est au même niveau que le thème précédent.On relève un fort contraste entre l’étude du paysage etde l’environnement (16 opérations) et celle des résultatsdes fouilles (7 opérations). Avec dix-huit opérations,
47. Voir http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/L-INRAP/Projets-de-recherche/ p-278-PRI.htm
48. Voir http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/L-INRAP/Projets-de-recherche/p-276-ACR.htm ethttp://www.archeologie.culture.gouv.fr avec la liste des opérationsfinancées en 2002-2003.
49. Cette liste est constituée à partir de celle éditée dans CHAPELOTet RIETH 2006b, p. XII, d’un état accessible sur le serveur de l’INRAP
(http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/L-INRAP/Projets-de-recherche/p-277-PCR.htm), des comptes rendus de PCR publiés dansles Chroniques de la revue Archéologie médiévale depuis le t. XXXIV(2004) et de quelques informations glanées par exemple dans les Bilansde fin de mandat des CIRA Ouest (Bilan CIRA Ouest 2008, p. 16) etEst (Bilan CIRA Est 2008, p. 223-224, uniquement pour la régionLorraine). Un court bilan des PCR a été fait dans l’avis n° 23 du17 juillet 2003 du CNRA (Avis du CNRA) : en conclusion, il estrecommandé le développement de l’accessibilité aux résultats des PCR«au travers d’une base de donnée, une publication ou les actes d’unerencontre scientifique. Une fiche d’activité sur le Web pourrait donneraussi de la visibilité aux PCR». Cette demande reste d’actualité.
3
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I. Cons . et habitats civils. Environnement rural et urbain 80 56 92 64 106 76 84 66 61 52 67
47
75
83 II. Const. et habit ecclésiastiques 102 62 67 69 94 85 83 71 61 55 49
46
60
46
III. Const. et habit fortifiés 98 100 65 79 91 79 74 80 58 51 44
29
44
47
IV. Sépultures et nécropoles 33 35 20 25 32 28 32 24 20 16 27
12
20
33
V. Install. artisanales : céramique 14 8 6 3 10 6 3 5 8 3 1
2
4
5
V. Install. artisanales : métallurgie 15 15 16 17 20 16 17 19 8 17 10
7
6
10
V. Install. artisanales : autres 4 7 2 4 9 3 3 3 7 3 4
1
4
3
VI. Archéologie subaquatique 3 3 6 9 2 1 - 5 7 14 3
5
4
5
VII. Prospections-inventaire 8 2 5 15 7 6 7 17 8 8 6
-
-
-
VIII. Diverses chroniques - - - 4 3 2 3 - - - -
3
13
5 Total 357 288 279 289 374 302 306 290 238 219 211 152 230 237
NB : les projets collectifs de recherche, analysés depuis 2003 dans ces Chroniques, ne sont pas pris en compte.
Fig. 7 : Thématiques des fouilles et des prospections des années 1994-2007 recensées dans la « Chronique des fouilles » de la revue Archéologie médiévale.
Fig. 8 : Pourcentage de chacune des six thématiques principales des « Chroniques des fouilles » d’Archéologie
médiévale (fouilles et prospections recensées de 1994 à 2007).
1994 1995 1996 1997
1997 1998 1999 2000 2001 2002
2002 2003 2004 2005 2006
2006 2007
icstatibahte.snoCI.larurtnemenonrivEn
niaburtibahte.tsnoCII.
seuistaésilcectibahte.tsnoCIII.
séfiitrfoteserutluéS.IV
seloporcné
.slivite
80 56 92 64
102 62 67 69
98 100 65 79
33 35 20 25
4 106 76 84 66
69 94 85 83 71
79 91 79 74 80
25 32 28 32 24
61 52 67 47 75
61 55 49 46 60
58 51 44 29 44
20 16 27 12 20
75 83
60 46
44 47
20 33
:selanasitra.llatsnIV.euimarcé
:selanasitra.llatsnIV.eirullatmé
:selanasitra.llatsnIV.sertau
eioloéhcrA.VIeuitauabsu
snoitcesorP.IVI -eiranteinv
:14 8 6 3
:15 15 16 17
:4 7 2 4
3 3 6 9
8 2 5 15
3 10 6 3 5
17 20 16 17 19
4 9 3 3 3
9 2 1 - 5
15 7 6 7 17
8 3 1 2
8 17 10 7
7 3 4 1
7 14 3 5
8 8 6 -
4 5
6 10
4 3
4 5
- -
eiranteinv
inorhcsesrveiD.IIVIlatTo
NB setjor pes: l
8 2 5 15
seu - - - 4357 288 279 289
s dséylan, aehcerhce re ditecllo c
7.gFi liusedseuqitaméhT: «a ls euqinorCh
15 7 6 7 17
4 3 2 3 -289 374 302 306 290
uqinorh Cess cna d300 2siueps d
énsedsnoitcepsorpsedtesellselliused euveraled» h
8 8 6
- - - 3 13238 219 211 152 230
.etmpoc ensirs pa ptnsoe ns,eu
4991seé - seésnecer07 20ameo
13 5230 237
8.gFi oP:
htx issedenucahcedegatnecruo
a selliu
3
«sedseipcinrpseuiqtaméh Ch9 1deseésnece rsnoitcepsor pt es
selliusedseuqinorCh ’d» h
.)700499
eoFig. 8 : Pourcentage de chacune des six thématiques principales
des «Chroniques des fouilles» d’Archéologie médiévale (fouilles et prospections recensées de 1994 à 2007). NB : les chiffres entre parenthèses après l’intitulé des thèmes renvoient à la programmation établie par le CNRA en 1997.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
402 JEAN CHAPELOT
l’étude des édifices fortifiés est le troisième thème. Lecontraste est fort entre l’étude du château de pierre(12 opérations) et celle des mottes et enceintes de terre(6 opérations) et cela d’autant plus que ce second thèmene concerne pratiquement que les deux régionsnormandes et émane d’une même équipe animée parAnne-Marie Flambard Héricher. Aucun projet neconcerne les maisons fortes et les bourgs castraux. Nousretrouvons ici les déséquilibres observés lors de l’examendes opérations de terrain, avec une légère correction enfaveur de la fortification de terre.
Dans l’étude de la ville, qui est, dans l’ordre d’impor-tance et avec 16 projets le quatrième thème, on relève unfort déséquilibre entre les suites de fouilles urbaines(15 opérations) et l’étude du bâti (une seule opération).Ce contraste traduit les difficultés d’implantation del’archéologie du bâti dans les villes, faute d’un nombresuffisant de chercheurs spécialisés et d’une législation etd’un financement adaptés. Enfin, l’addition des thèmes
qui relèvent des techniques et de la culture matérielle(onze dans chaque cas) donne un nombre total de projetsde recherche qui est à l’égal de ceux qui portent sur lemonde rural, ce qui montre le dynamisme de ce secteuravant tout orienté vers les mines et la métallurgie et l’étudede la céramique.Les responsables de ces 103 projets de recherche sont
les quelques dizaines de chercheurs les plus actifs dans lechamp de l’archéologie médiévale (fig. 10). Les universi-taires sont les plus nombreux et avec le CNRS constituentprès de la moitié des responsables. On remarquenéanmoins le nombre important d’agents des SRA et del’INRAP50.
50. Dans son avis n° 23 et sans citer de chiffres, le CNRA relevaiten juillet 2003 que «les agents de l’INRAP sont très peu présents» dansles PCR (Avis du CNRA), ce qui semble donc avoir changé.
4
Thématiques selon la programmation du CNRA
de 1997 Sous-thèmes Nombre
19. Le fait urbain A Fouilles en contexte urbain B Maisons de villes et caves
15 1
20. Espace rural, peuplement et productions agricoles aux époques médiévale et moderne
A Paysage et environnement rural B Fouilles d’habitats ruraux
16 7
23. Établissements religieux et nécropoles depuis la fin de l’Antiquité
A Bâtiments religieux B Nécropoles, inhumations, cimetières
21 2
24. Naissance, évolution et fonctions du château médiéval
A Châteaux de pierre B Mottes et enceintes de terre C Maisons fortes D Bourgs castraux
12 6 0 0
25. Histoire des techniques et archéologie industrielle
Notamment mines, outillage agricole, moulins, charpente, pierre, ateliers de production de terre cuite, etc.
11
26. Culture matérielle, de l’Antiquité aux Temps modernes
Notamment céramique d’habitat, alimentation, pêche, animaux domestiques, ostéologie animale, études d’objets issus de fouilles, etc.
11
27. Le réseau des communications 1 28. Aménagements portuaires et commerce maritime
3
29. Archéologie navale 0 Fig. 9 : Thématiques des 93 PCR, des 3 PRI et des 7 ACR concernant l’archéologie médiévale constitués de 1991 à 2008.
Universités 35 Services régionaux de l’archéologie 22 I 21 CNRS 17 Collectivités 6 Associations et bénévoles 7 Entreprise privée d’archéologie 1 Statut inconnu (probablement pour une part étudiants) 8 Total 117
Fig. 10 : Statut des responsables des 103 PCR, PRI et ACR financés depuis 1991 et relevant de l’archéologie médiévale pour tout ou partie. Quand plusieurs personnes sont responsables d’un projet, il a été tenu compte de chacune d’entre elles d’où un nombre de responsables plus élevés que celui des 103 opérations financées.
Fig. 9 : Thématiques des 93 PCR, des 3 PRI et des 7 ACR concernant l’archéologie médiévale constitués de 1991 à 2008. Ces projetsde recherche ont été classés selon la programmation élaborée par le CNRA en 1997, affinée pour les besoins de la présente analyse.
Certains, peu nombreux, relèvent de deux thèmes et ont donc été pris deux fois en considération dans ce tableau.
Publications du CRAHM, 2010
403CONCLUSION
Conclusion : des discordances entre les activités de terrainet les recherches post-fouille
Si l’on confronte les observations faites à propos desopérations de terrain et des projets de recherche, on peutdistinguer trois situations :– le même niveau de présence sur le terrain et dans lesprojets de recherche, de l’ordre du tiers du total pourl’étude de la ville et du monde rural, autour de 20 %pour les édifices fortifiés ;– une présence moindre de l’étude du bâti religieux etdes nécropoles et inhumations dans les programmes derecherche que sur le terrain;– une surreprésentation de l’étude des techniques, de laculture matérielle et du paysage et de l’environnementdans les projets de recherche par rapport à la place de cesthèmes sur le terrain. La prise en compte des prospections-inventaires et
des prospections-thématiques renforcerait proba-blement les tendances qui viennent d’être exposéesci-dessus.Ces constats montrent que les divers modes de finan-
cement de la recherche prolongent pour une part lesdéséquilibres du terrain, permettent peu le développementde thématiques de recherche encore embryonnaires ouabsentes et ne préparent pas assez le renouvellement de ladiscipline. La principale explication de cette situation, endehors de l’absence d’une politique de financement suffi-samment volontariste et dotée des moyens nécessaires,est le trop faible nombre de chercheurs en mesure detravailler dans certains domaines.
1.3. Les résultats
L’archéologie médiévale produit, en dehors des vestigeseux-mêmes, trois sortes de résultats : le matériel archéologique ; les rapports ; les publications. Nousévoquerons rapidement les deux premiers qui concernentde la même manière l’ensemble de l’archéologie.
La conservation et la présentation du matériel archéologique
La création systématique de dépôts de fouille de l’État, enprojet depuis des années51, n’a jamais été mise en œuvreet des régions importantes n’ont pas les moyens deconserver le matériel archéologique dans des conditionsdécentes52. La situation est tout aussi désastreuse en ce quiconcerne la présentation des résultats au public. Nombred’orientations nouvelles ou de découvertes importantes del’archéologie médiévale de ces dix ou vingt dernièresannées ne sont nulle part exposées en permanence auxchercheurs ou au public par les médiateurs spécialisés quesont les musées53.
Les rapports d’opération
Tous ceux qui ont eu à conduire des opérations de terrainsavent que les retards d’achèvement des rapports sontinévitables. Mais les données dont on dispose pour
51. Gestion de la documentation scientifique 2008; PAPINOT 1998;DUVAL 2004.
52. Gestion de la documentation scientifique 2008, p. 178, cf. aussip. 179.
53. Sur le problème du dépôt final des collections archéologiquesdans les musées : Gestion de la documentation scientifique 2008, p. 182et p. 190.
4
Thématiques selon la programmation du CNRA
de 1997 Sous-thèmes Nombre
19. Le fait urbain A Fouilles en contexte urbain B Maisons de villes et caves
15 1
20. Espace rural, peuplement et productions agricoles aux époques médiévale et moderne
A Paysage et environnement rural B Fouilles d’habitats ruraux
16 7
23. Établissements religieux et nécropoles depuis la fin de l’Antiquité
A Bâtiments religieux B Nécropoles, inhumations, cimetières
21 2
24. Naissance, évolution et fonctions du château médiéval
A Châteaux de pierre B Mottes et enceintes de terre C Maisons fortes D Bourgs castraux
12 6 0 0
25. Histoire des techniques et archéologie industrielle
Notamment mines, outillage agricole, moulins, charpente, pierre, ateliers de production de terre cuite, etc.
11
26. Culture matérielle, de l’Antiquité aux Temps modernes
Notamment céramique d’habitat, alimentation, pêche, animaux domestiques, ostéologie animale, études d’objets issus de fouilles, etc.
11
27. Le réseau des communications 1 28. Aménagements portuaires et commerce maritime
3
29. Archéologie navale 0 Fig. 9 : Thématiques des 93 PCR, des 3 PRI et des 7 ACR concernant l’archéologie médiévale constitués de 1991 à 2008.
Universités 35 Services régionaux de l’archéologie 22 I 21 CNRS 17 Collectivités 6 Associations et bénévoles 7 Entreprise privée d’archéologie 1 Statut inconnu (probablement pour une part étudiants) 8 Total 117
Fig. 10 : Statut des responsables des 103 PCR, PRI et ACR financés depuis 1991 et relevant de l’archéologie médiévale pour tout ou partie. Quand plusieurs personnes sont responsables d’un projet, il a été tenu compte de chacune d’entre elles d’où un nombre de responsables plus élevés que celui des 103 opérations financées.
Fig. 10 : Statut des responsables des 103 PCR, PRI et ACR financés depuis 1991 et relevant de l’archéologie médiévale pour tout oupartie. Quand plusieurs personnes sont responsables d’un projet, il a été tenu compte de chacune d’entre elles d’où un nombre de
responsables plus élevés que celui des 103 opérations financées.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
404 JEAN CHAPELOT
analyser la situation montrent que le taux de rapportsnon remis est élevé.Un rapport achevé en janvier 2006 et qui analyse les
activités de l’INRAP en 2004-2005 donne pour lesdiagnostics réalisés en 2001 un taux de non-remise desrapports de 12 %, pour ceux réalisés en 2003 de 14 %,tandis que pour ces deux mêmes années ce taux est de56 % et 67 % pour les fouilles préventives54. Les rapportsd’activités pour les années 2004-2008 montrent quependant cette période l’INRAP a réalisé 9202 diagnosticset 1385 fouilles préventives et n’a remis aux SRA que8845 rapports de diagnostics et 864 rapports de fouille :il manque donc 3,87 % des rapports de diagnostics (357au total) et 35 % des rapports de fouille (481 au total)(fig. 3). Cette situation n’est pas propre à l’INRAP et àl’archéologie préventive. Parmi d’autres, le bilan de laCIRA Centre-Est évalue, pour les années 2003-2006, à90 % le taux de rapports remis dans le secteur du préventifet à 80 % dans celui du programmé55.Néanmoins, dans la majorité des cas, les rapports de
fouille sont remis aux SRA. Comme l’écrivent tous lesmembres des CIRA quand ils s’expriment sur le sujet, il estcertain que la qualité de ces documents s’est considéra-blement améliorée au point qu’il est souvent possible deconsidérer qu’il s’agit d’une sorte de publication. Cela étant,plusieurs bilans de CIRA soulèvent les problèmes queposent certains rapports de diagnostics qui constituent,faut-il le rappeler, l’essentiel des opérations de terrain. Lesmédiévistes qui évoquent ce point dans les bilans des CIRAinsistent, en particulier à propos de l’habitat rural de la findu haut Moyen Âge, sur les incertitudes ou les absences dedatation et de caractérisation des sites, ferme, hameau ouvillage dans nombre de rapports de ce type56. Très souvent,le diagnostic laisse à la fouille le soin de répondre à cesquestions pourtant essentielles57. Dans ces conditions, siune fouille est organisée, il est impossible de construire uneproblématique d’intervention et s’il n’en est pas ainsi, lerapport ne présente que peu d’intérêt scientifique.La conservation et l’utilisation des rapports d’opéra-
tions posent des problèmes importants qu’il faut résoudre
d’une manière urgente58. Trois décisions essentiellesdevraient être mises en œuvre :– donner à tous les rapports quand ils arrivent dans lesServices régionaux un numéro d’enregistrementpermettant de gérer cette documentation;– déposer immédiatement à leur arrivée dans chaque SRA– comme le pratiquent déjà certains de ceux-ci – unexemplaire de chaque rapport aux Archives départemen-tales du département de l’opération et à celles de lacapitale régionale59. La pérennité et le libre accès à cesdocuments seront assurés ;– numériser tous les rapports et les mettre en place sur desserveurs.
Une telle politique relève, comme celle qui concerne lesdépôts de fouille, de la responsabilité du gestionnaireréglementaire de l’archéologie, émetteur des autorisationset destinataire final du matériel archéologique et desrapports, c’est-à-dire le ministère de la Culture et de laCommunication. Procéder ainsi ne pose pas de problèmestechniques ou financiers insurmontables. L’INRAP, dansle bilan de ses six premières années publié en janvier 2008,annonçait l’ouverture au début de 2009 et sur son siteInternet d’un portail contenant «une bibliothèque derapports finaux d’opération60». Dans son rapport d’acti-vités pour 2008, l’INRAP revient sur cette opération et sadirectrice générale indique que «plus de 250 rapportsfinaux d’opération sont déjà disponibles sur l’Intranet et,à partir de 2009, ils seront consultables sur le portail del’INRAP61». Il faut souligner l’importance de ce projet, lemettre en place le plus rapidement possible, faire en sortequ’il soit, autant que faire se pourra, rétroactif et que bienentendu ces documents soient accessibles librement pourtous.L’expérience montre que, dans l’immense majorité des
cas, les opérations de terrain ne seront pas suivies de publi-cations, celles-ci n’étant d’ailleurs pas systématiquementindispensables. Par contre, il faut être très clair : lesrapports sont des données brutes irremplaçables qui, pourla grande majorité des opérations, seront la seule trace
54. Rapport sur l’INRAP 2006, p. 20 et annexe II, p. 11-13. Cf.la réponse de la directrice générale de l’INRAP à ce propos, Ibid.,p. 85 et la réponse des inspecteurs p. 98.
55. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 13.56. Bilan CIRA Est 2008, p. 90 et p. 96; cf. aussi ibid. à propos
des châteaux. Cette CIRA étant allé jusqu’à voter à ce propos unemotion remise au CNRA en février 2003 (ibid., p. 139-141).
57. Bilan CIRA Est 2008, p. 88-89 et p. 100.
58. Gestion de la documentation scientifique 2008, p. 184.59. C’est aussi la solution envisagée lors du séminaire de la
SDAchetis consacrée à ce sujet (Gestion de la documentation scientifique2008, p. 185 et p. 190).
60. Bilan des six premières années de l’INRAP 2008, p. 8.61. Rapport d’activités INRAP 2009, p. 64 et p. 10; cf. aussi p. 11.
Au début de l’été 2009, aucune consultation en ligne n’était pas encorepossible.
Publications du CRAHM, 2010
405CONCLUSION
écrite qui subsistera. Cela signifie que cette littératuregrise doit être sauvegardée et diffusée par les techniquesmodernes.
Les publications
Publier est la seule justification de la recherche, ce quifait d’un fouilleur un chercheur. Le volume et la naturedes publications ainsi que le statut de leurs auteurs sontdonc des éléments essentiels d’appréciation.
Le bilan quantitatif
Une faible production éditoriale est depuis longtempsune donnée de base de l’archéologie médiévale française.Les rapports d’activité de l’INRAP permettent d’établirdes chiffres minimaux. Ils donnent en effet le nombre depublications (articles et livres) toutes périodes confondueséditées par le personnel de cet institut, étant entendu qu’ils’agit pour une part de très brefs comptes-rendus et parailleurs d’articles et de livres cosignés avec des auteursextérieurs. Pour chacune des trois années 2004-2006, lechiffre total se situe entre 208 et 305 (fig. 2). Le bilan del’INRAP pour les six années 2002-2007 donne un totalde 2000 publications pendant cette période, soit unchiffre annuel moyen d’un peu plus de 30062. Si l’onapplique à ces chiffres le ratio d’un quart concernantl’archéologie médiévale, on peut fixer autour de 75 lenombre d’articles ou de livres consacrés à celle-ci.L’analyse détaillée de la bibliographie des
521 personnes, professionnels et autres, qui ont réponduà la demande de constitution de l’annuaire des archéo-logues médiévistes en 2006 montre qu’une fois exclus lesbrefs comptes-rendus, il a été publié en 2002-2005 untotal de 850 articles et 80 ouvrages de taille et de naturetrès variées. Si l’on ne retient que les textes d’au moins dixpages, on arrive au chiffre de 450 articles environ, soit unpeu plus de cent par an, ce qui est cohérent avec lesdonnées précédentes extraites des rapports de l’INRAP.
Le rapport récemment consacré aux quinze revuesnationales et interrégionales d’archéologie subventionnéespar le ministère de la Culture et de la Communicationpendant la période 1995-2004 permet une évaluation dela part de l’archéologie médiévale dans ces supports63. Unarticle publié dans le présent volume fournit ces donnéesqui ne seront donc pas reprises ici64 : seuls des éléments
essentiels pour la démonstration seront présentés ci-dessous. Certaines de ces quinze revues ont consacré endix ans à l’archéologie de la période médiévale 5721 pageset de l’ordre de 200 articles, dont la moitié dans Archéo-logie médiévale et Archéologie du Midi médiéval65. À cesrevues de premier plan il faut en ajouter d’autres commela Revue archéologique de Picardie qui a publié de 1995 à2004 un total de 1120 pages consacrées au Moyen Âgeet à l’époque moderne66. Avec les revues précédentes, celareprésente environ 680 pages et 20 à 30 articles consacréschaque année à l’archéologie médiévale. Il faut ajouter cequi est publié chaque année dans d’autres revues françaisesnationales, régionales ou départementales ou dans desrevues étrangères, soit 20 à 30 autres articles. Au total,nous en arrivons à une cinquantaine d’articles et à environ1200 pages publiés chaque année dans des périodiques debon niveau scientifique avec en complément des articlespubliés dans un très grand nombre de périodiques detoute nature existants en France : avec eux, nous attei-gnons l’évaluation globale avancée plus haut d’environune centaine d’articles par an.
Dans les dix années 1999-2008, il a été publié377 ouvrages qui traitent plus ou moins largementd’archéologie médiévale française : cela va des actes d’uncolloque dont la thématique est purement historique ourégionaliste et qui ne contient qu’un article relevant del’archéologie médiévale à des thèses intégralement consa-crées à cette discipline. Parmi ces 377 ouvrages, 168s’intéressent quasi exclusivement à l’archéologiemédiévale : ils totalisent 51071 pages, dont un dixièmene concernant pas l’archéologie médiévale. Les 209 autresouvrages représentent environ 45000 pages dont au plusun cinquième consacré à l’archéologie médiévale. Il paraîtdonc en moyenne chaque année une quarantaine de livrestraitant d’archéologie médiévale, un peu moins de lamoitié étant presque entièrement consacrés à cette disci-pline qui publie par ce biais chaque année environ5400 pages.
Si la création de nouvelles revues interrégionales etrégionales il y a une trentaine d’années et l’ouverture crois-sante de celles-ci et des autres plus anciennes àl’archéologie médiévale se sont traduites par une augmen-tation du nombre d’articles, la croissance du nombre de
62. Bilan des six premières années de l’INRAP 2008, p. 3.63. Enquête sur les revues d’archéologie 2007.64. FAURE-BOUCHARLAT et FLAMBARD HÉRICHER 2010.
65. Enquête sur les revues d’archéologie 2007, p. 164.66. Enquête sur les revues d’archéologie 2007, p. 164.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
406 JEAN CHAPELOT
livres consacrés à cette discipline paraît moins sensible.Elle n’a dans tous les cas pas augmenté en proportion decelle du nombre de chercheurs et des niveaux de finan-cement dont nous avons vu précédemment qu’ils ont étéen vingt ans multipliés respectivement par deux et parsept. Le volume total d’articles et d’ouvrages publiés, del’ordre de 6600 pages par an, n’est pas très élevé, s’agissantde la production d’une communauté scientifique de300 personnes, dont, il vrai, certains ne se consacrent quepartiellement à la recherche ou à l’archéologie du MoyenÂge français. Il faut aussi souligner que les archéologuesaccordent une part notable de leur temps de travail à larédaction de rapports de plus en plus longs, détaillés etélaborés.
Qui publie?
Les bibliographies figurant dans les fiches envoyées à laSociété d’archéologie médiévale en 2006 pour constituerl’annuaire des archéologues montrent que la moitié des521 personnes, professionnels et autres, a publié pendantles quatre années 2002-2005 au moins un texte de dixpages ou, dans certains cas, un livre67.Un autre examen de ces mêmes publications des
années 2002-2005 a été fait afin de déterminer le nombrede ceux qui ont publié des livres ou des articles relevantde la recherche en archéologie médiévale, étant entenduque cette appréciation a été faite en examinant la naturedes supports d’édition (fig. 11). Il s’agit au total de69 personnes, ce qui relativise notre évaluation précé-dente de 300 personnes ayant une activité de recherchedans le domaine de l’archéologie médiévale.
Le rapport sur les revues déjà utilisé ci-dessus permetde préciser qui sont les auteurs d’articles portant surl’archéologie médiévale68. Quelques traits sont à soulignercomme la place essentielle, sauf cas particulier, des auteursvenant de l’Université et du CNRS qui représentent lamoitié en volume des articles publiés et la part importantedes étudiants dans des revues comme Archéologie du Midimédiéval ou la Revue archéologique du Centre et de l’Île-de-France. On relève aussi, dans quelques cas comme la Revuearchéologique de l’Est, la part significative des archéologuesamateurs. La place des auteurs issus de l’INRAP estvariable d’une revue à l’autre. Dans Aquitania, la Revuearchéologique de l’Est, la Revue du Nord, Archéologie duMidi médiéval et Archéologie médiévale, ils représentent11 à 20 % des auteurs69, mais 30 % dans la Revue archéo-logique du Centre et de l’Île-de-France et beaucoup plusdans la Revue archéologique de l’Ouest 70. La croissance deleur apport est nette dans plusieurs de ces revues.À l’opposé, la participation marginale ou même trèsmarginale des agents du ministère de la Culture est uneconstante, celles des archéologues de collectivités étantbien évidemment liée à l’existence ou non dans la zone dediffusion des revues de services de ce genre. Pourl’ensemble des quinze revues examinées dans le rapportdéjà cité, les articles issus de l’archéologie programméetoutes périodes confondues représentent 38,2 % dunombre total de pages. La part de l’archéologie préventiveest en augmentation, mais il n’en reste pas moins que sa
67. CHAPELOT et RIETH 2006a, p. XV.
68. Enquête sur les revues d’archéologie 2007 et FAURE-BOUCHARLATet FLAMBARD HÉRICHER 2010.
69. Enquête sur les revues d’archéologie 2007, p. 13, 34-35, 28, 51,116 et tableaux 9 et 10, p. 118
70. Ibid., p. 23 et 18.
5
4 publications 2 publications total Université 10 10 20 CNRS 15 2 17 I 4 12 16 Collectivités 2 5 7 Culture ( Musée ) 2 2 4 Associations 1 2 3 Entreprises 1 1 2 Total 35 34 69
Fig. 11 : Nombre de personnes figurant dans l’annuaire des archéologues médiévistes de 2006 et ayant publié en 2002-2005 un ou des livres ou des articles dans des revues de niveau national ou
interrégional.
Fig. 12 : Statuts des auteurs des 377 ouvrages édités de 1999 à 2008 et traitant intégralement ou marginalement
d’archéologie médiévale. Certains ouvrages sont écrits ou édités par plusieurs auteurs.
2snoitaciblup4
snoitaciblup ltato
téisreviUnSRCN
IiivtcellCo sté
)eésuM(erutlCusniotiacosAs
sesirpertEnlatTo
p1015
42211
35
p10 20
2 1712 16
5 72 42 31 2
34 69
11.gFi osrepederbmoN: 2002neéilbuptanay - 05 20
deriaun’lsnadtrugsennoselcitraseduoservilseduonu05
.noigérretin
edsetsivéidémseugoloéhcrasedersedsnads itanuaveinedsevu
te6002uono
21.gFi atS:
garo773sedsruetuasedstuta
egarvuoinsatrCe
iartte8002à9991edsétidéseg.evédié megioloéhcrad’
iesulprapséitdéuositrcéntosse
nigramuotnemergétnitnati
.sruetuasru
tnemel
5
Fig. 11 : Nombre de personnes figurant dans l’annuaire des archéologues médiévistes de 2006 et ayant publié en 2002-2005 des livres ou des articles dans des revues de niveau national ou interrégional.
Publications du CRAHM, 2010
407CONCLUSION
place ne correspond en rien à son poids sur le terrain enpourcentage du nombre d’opérations – qui est de plus de80% – et surtout en crédits et en personnel – qui est encoreplus élevé. Le contenu d’Archéologie du Midi médiéval est très carac-
téristique de l’état actuel de la discipline. Cette revue publieen effet peu d’articles liés à des opérations de fouilleproprement dite71. La moitié des pages publiées pendantdix ans sont des études monographiques et synthétiquesqui font appel pour l’essentiel à une documentation quin’est pas issue de fouilles. Cela illustre un aspect importantde l’archéologie médiévale : une part des publications consa-crées à l’étude des témoignages matériels du Moyen Âge nevient pas de la fouille, mais de l’analyse de sources documen-taires autres, du bâti aux documents graphiques en passantpar l’histoire et l’histoire de l’art. On retrouve dans Archéo-logie médiévale ces mêmes tendances72. Avec chaque annéeen moyenne six articles ordinairement de 20 à 40 pages,Archéologie médiévale a publié en dix ans 53 articles écrits parune centaine d’auteurs et formant un total de 1611 pages,à comparer aux 171 articles et 3464 pages publiés par Galliapendant la même période73. Cette situation traduit deuxétats de fait : il n’est pas possible de publier plus d’articlesdans Archéologie médiévale ou ailleurs faute de propositionssatisfaisantes en nombre et en qualité et les pages consa-crées à l’archéologie médiévale sont chaque année moinsabondantes que celles qui le sont à l’époque gallo-romaine.Les publications dans le domaine de l’archéologie de
l’époque moderne nous mettent sur la piste de l’une desexplications de la faiblesse de celles consacrées à l’archéologiemédiévale. Le rapport sur les revues d’archéologie souligneà plusieurs reprises la faible part de l’archéologie post-médiévale dans les revues : 1,5 % des pages utiles, soit àpeu près le même score que le paléolithique, avec un nombreet un volume d’opérations de terrain infiniment plus consi-dérables74. Comme le souligne ce même rapport, «ce constatrévèle, en creux, un déficit de publication pour le domaineurbain, puisque l’essentiel des données de l’archéologiemoderne provient de fouilles urbaines […]75 ». En fait, ilfaudrait aller jusqu’au bout de l’analyse ainsi amorcée : cesfouilles urbaines relèvent quasi exclusivement de l’archéo-logie préventive. Le déficit de publications sur l’époquemoderne est une conséquence directe de la faible produc-
tivité scientifique de l’archéologie préventive et cettesituation a les mêmes conséquences dans le secteur duMoyen Âge. La conséquence de tout ce qui précède est que les revues
spécialisées ou qui publient chaque année un ou quelquesarticles relevant de l’archéologie médiévale sont confrontéesà un même problème : un éditeur peut se passer pendantquelques années de publier des livres d’archéologiemédiévale, les revues doivent paraître régulièrement et doncchaque année rassembler à elles toutes quelques dizainesd’articles. Elles le font difficilement surtout si elles veulentmaintenir un certain niveau et toujours au prix d’unimportant travail sur la forme et le fond des textes qui leursont proposés.
Beaucoup des 377 ouvrages édités de 1999 à 2008sont des actes de colloques ou des synthèses dont laproblématique essentielle est avant tout historique, ce quiexplique pour une part le poids important des historiensparmi les auteurs ou éditeurs scientifiques et donc lenombre des universitaires et des chercheurs du CNRS(fig. 12). Mais la situation est pratiquement la mêmequand on fait l’analyse du statut des auteurs ou éditeursdes 168 ouvrages qui sont consacrés presque exclusi-vement à l’archéologie médiévale (fig. 13).La surreprésentation massive des universitaires et des
chercheurs CNRS (fig. 12 et 13) confirme les observationsfaites à propos des auteurs des articles publiés dans lesrevues. Il apparaît néanmoins quelques différences : dansl’édition d’ouvrages, les personnels des SRA et ceux descollectivités occupent une place plus importante que dansles revues, de même que les bénévoles et les associations.Par contre, la place des personnels de l’INRAP est plusmarquée dans les revues.
La nature des ouvrages et les régions concernées
Les 377 ouvrages publiés dans les années 1999-2008 etqui concernent totalement ou partiellement l’archéologiemédiévale peuvent être partagés en quatre catégories(fig. 14) :– les catalogues d’exposition;– les actes de colloques et congrès ;– les monographies consacrées à une fouille ou à unbâtiment ;– les synthèses.La distinction entre ces quatre catégories n’est pas toujoursaisée, certains catalogues d’exposition ou des actes decolloques étant par exemple des monographies de sitesou de monuments.
71. Enquête sur les revues d’archéologie 2007, p. 163.72. Ibid., p. 115.73. Ibid., p. 162.74. Ibid., p. 164.75. Ibid., p. 165.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
408 JEAN CHAPELOT
Le nombre d’actes de colloques contenant un ou desarticles portant sur l’archéologie médiévale française auraitpu être notablement augmenté en y incluant notammentles publications éditées hors de France.L’importance des colloques est à relever, ainsi que le
petit nombre de monographies de sites ou de monuments.La faiblesse du nombre de monographies publiées est
souvent déplorée par les CIRA76. Il s’agit d’un problèmeréel car ce sont les monographies qui fondent une discipline en permettant la réflexion méthodologique, par
76. Cf. Claude Raynaud, Bilan CIRA Est 2008, p. 98 et PhilippeRacinet, Ibid., p. 99, qui considère qu’il s’agit d’une priorité. Cf. aussiPEYTREMANN 2010, p. 112.
5
4 publications 2 publications total Université 10 10 20 CNRS 15 2 17 I 4 12 16 Collectivités 2 5 7 Culture ( Musée ) 2 2 4 Associations 1 2 3 Entreprises 1 1 2 Total 35 34 69
Fig. 11 : Nombre de personnes figurant dans l’annuaire des archéologues médiévistes de 2006 et ayant publié en 2002-2005 un ou des livres ou des articles dans des revues de niveau national ou
interrégional.
Fig. 12 : Statuts des auteurs des 377 ouvrages édités de 1999 à 2008 et traitant intégralement ou marginalement
d’archéologie médiévale. Certains ouvrages sont écrits ou édités par plusieurs auteurs.
2snoitaciblup4
snoitaciblup ltato
téisreviUnSRCN
IiivtcellCo sté
)eésuM(erutlCusniotiacosAs
sesirpertEnlatTo
1015
42211
35
10 202 17
12 165 72 42 31 2
34 69
11.gFi osrepederbmoN: 2002neéilbuptanay - 05 20
deriaun’lsnadtrugsennoselcitraseduoservilseduonu05
.noigérretin
edsetsivéidémseugoloéhcrasedersedsnads itanuaveinedsevu
te6002uono
21.gFi atS:
garo773sedsruetuasedstuta
egarvuoinsatrCe
iartte8002à9991edsétidéseg.evédié megioloéhcrad’
iesulprapséitdéuositrcéntosse
nigramuotnemergétnitnati
.sruetuasru
tnemel
5
Fig. 12 : Statuts des auteurs des 377 ouvrages édités de 1999 à 2008 et traitant intégralement ou marginalement d’archéologie médiévale. Certains ouvrages sont écrits ou édités par plusieurs auteurs.
6
Fig. 13 : Statut des auteurs des 168 ouvrages édités en 1999-2008 et qui relèvent uniquement de l’archéologie médiévale.
Synthèses 158 42 % Colloques 131 35 %
Monographies 60 16 % Catalogues d’exposition 28 7 %
Total 377 100 %
Fig. 14 : Nature des 377 ouvrages publiés en 1999-2008 et concernant l’archéologie médiévale totalement ou marginalement.
Catalogues
d’exposition Actes de colloques
Monographies de fouilles ou de
bâtiments
Synthèses Total
Universités 2 15 16 40 73 CNRS 1 4 8 14 27 Culture et SDA 2 8 4 8 22 Collectivités 4 1 12 8 25 Bénévoles et associations
1 4 7 8 20
I 0 1 4 6 11 10 33 51 84 178
Fig. 15 : Nature des auteurs et des 168 ouvrages consacrés uniquement à l’archéologie médiévale qu’ils ont publiés.
.gFi 3 1 tatS: .evéidmé
garvuo861sedsruetuasedtut
9991nesétidéseg - iuqte8 200
hcra’ledtnemeuqinutnevèleri
eigoloéh
41.gFi taN: nmeenigrma
nlCoonMoeuolatCaTo
3sederut séiblupsegaro77.tn
sesèhtn 158seuoll 131
seihpargo 60nioitsoxe’ds 28
latTo 377
9991ne - tnrecnocte8 200
%42 %35 %16 %7
%100
metotevéidémeigoloéhcra’l
uotnem
stéisreviUnSRCN
DSteerutlCuséitivtcellCoteselovénBésnoiaticosas
seuotCanoitisopxed’
21
AD 241
edsetAcseuqollco
edseihronMoeduoselliufo
stnemitbâ15 164 88 41 124 7
e sesèht tTo
40 7314 278 228 258 20
tndosesèth
281322
snoiaticosasI
51.gFi utaN:
010
aro861sedtesruetuasederu
1 433 51
ra’làtnemeuqinusércasnocsega
6 1184 178
tnosli’uqevéidémeigoloéhcr
541
.séilbpu
6
Fig. 13 : Statut des auteurs des 168 ouvrages édités en 1999-2008 et qui relèvent uniquement de l’archéologie médiévale. Certains de ces ouvrages ont deux auteurs ou plus : chacun est pris en compte ci-dessus. On remarque la part notable des archéologuesbénévoles ou membres d’associations. L’apport de l’INRAP est d’autant plus marginal que cinq des onze ouvrages édités par ses salariés
sont les thèses de ceux-ci.
Publications du CRAHM, 2010
409CONCLUSION
exemple sur les pratiques de terrain, et en mettant à dispo-sition une documentation de base.Nous avons vu précédemment qui sont les auteurs des
168 ouvrages d’archéologie médiévale identifiés. Il estintéressant de rechercher ce que sont les catégoriesd’ouvrages qu’ils publient (fig. 15).Les universitaires et les chercheurs du CNRS
publient avant tout des ouvrages de synthèse ; lespersonnels des services archéologiques de collectivités etles bénévoles et membres d’associations, des monogra-phies de fouilles ou de bâtiments ; les personnels duministère de la Culture (musées et Services régionaux del’archéologie), des actes de colloques. Parmi les sixouvrages de synthèse publiés par des agents de l’INRAP,cinq sont leurs thèses. Près de la moitié des monogra-phies de fouilles ou de bâtiments sont le fait desuniversitaires et des chercheurs CNRS, l’apport despersonnels de l’INRAP étant faible. Les thèses repré-sentent en nombre presque le quart des 168 ouvragesd’archéologie médiévale publiés en 1999-2008 et avec
16 170 pages près du tiers des 51 071 pages quecomptent ensemble tous ces ouvrages. L’importance desthèses dans le développement récent de l’archéologiemédiévale est donc à souligner.Il est intéressant d’examiner les régions concernées par
les 168 ouvrages uniquement consacrés à l’archéologiemédiévale (fig. 16).Si l’on raisonne à partir des 118 ouvrages qui
concernent tout ou partie d’une région (en excluant doncles 50 qui intéressent plusieurs régions, ce qui fausse unpeu le commentaire qui va suivre) on constate que dixrégions, avec 6 à 12 publications, ont été bien traitées cesdix dernières années.Les bilans d’activités annuels de l’INRAP montrent
que les trois régions qui sont en tête de 2004 à 2008 parle nombre de diagnostics ou de fouilles préventives et lessurfaces étudiées sont l’Île-de-France, le Centre et laChampagne-Ardenne, suivies par le Nord-Pas-de-Calais,la Picardie, le Languedoc-Roussillon, la Lorraine, leRhône-Alpes et les Pays-de-la-Loire. Cela ne se traduit pas
6
Fig. 13 : Statut des auteurs des 168 ouvrages édités en 1999-2008 et qui relèvent uniquement de l’archéologie médiévale.
Synthèses 158 42 % Colloques 131 35 %
Monographies 60 16 % Catalogues d’exposition 28 7 %
Total 377 100 %
Fig. 14 : Nature des 377 ouvrages publiés en 1999-2008 et concernant l’archéologie médiévale totalement ou marginalement.
Catalogues d’exposition
Actes de colloques
Monographies de fouilles ou de
bâtiments
Synthèses
2 15 16 40 1 4 8 14 2 8 4 8 4 1 12 8 1 4 7 8
I 0 1 4 6 10 33 51 84
Fig. 15 : Nature des auteurs et des 168 ouvrages consacrés uniquement à l’archéologie médiévale qu’ils ont publiés.
.gFi 3 1 tatS: .evéidmé
garvuo861sedsruetuasedtut
9991nesétidéseg - iuqte8 200
hcra’ledtnemeuqinutnevèleri
eigoloéh
41.gFi taN: nmeenigrma
nSylCoonMoeugolatCaTo
3sederut séiblupsegaro77.tn
sesèhtn 158seuqoll 131
seihpargo 60nioitsopxe’ds 28
latTo 377
9991ne - tnrecnocte8 200
%42 %35 %16 %7
%100
metotevéidémeigoloéhcra’l
uotnem
stéisreviUnSRCN
DSteerutlCuséitivtcellCoteselovénBésnoiaticosas
seuotCanoitisopxed’
21
AD 241
edsetAcseuqollco
edseihronMoeduoselliufo
stnemitbâ15 164 88 41 124 7
e sesèht tTo
40 7314 278 228 258 20
tndosesèth
281322
snoiaticosasI
51.gFi utaN:
010
aro861sedtesruetuasederu
1 433 51
ra’làtnemeuqinusércasnocsega
6 1184 178
tnosli’uqevéidémeigoloéhcr
541
.séilbpu
66
Fig. 13 : Statut des auteurs des 168 ouvrages édités en 1999-2008 et qui relèvent uniquement de l’archéologie médiévale.
Synthèses 158 42 % Colloques 131 35 %
Monographies 60 16 % Catalogues d’exposition 28 7 %
Total 377 100 %
Fig. 14 : Nature des 377 ouvrages publiés en 1999-2008 et concernant l’archéologie médiévale totalement ou marginalement.
Catalogues
d’exposition Actes de colloques
Monographies de fouilles ou de
bâtiments
Synthèses Total dont thèses
Universités 2 15 16 40 73 28 CNRS 1 4 8 14 27 1 Culture et SDA 2 8 4 8 22 3 Collectivités 4 1 12 8 25 2 Bénévoles et associations
1 4 7 8 20 2
I 0 1 4 6 11 5 10 33 51 84 178 41
Fig. 15 : Nature des auteurs et des 168 ouvrages consacrés uniquement à l’archéologie médiévale qu’ils ont publiés.
.gFi 3 1 tatS: .evéidmé
garvuo861sedsruetuasedtut
9991nesétidéseg - iuqte8 200
hcra’ledtnemeuqinutnevèleri
eigoloéh
41.gFi taN: nmeenigrma
nlCoonMoeuolatCaTo
3sederut séiblupsegaro77.tn
sesèhtn 158seuoll 131
seihpargo 60nioitsoxe’ds 28
latTo 377
9991ne - tnrecnocte8 200
%42 %35 %16 %7
%100
metotevéidémeigoloéhcra’l
uotnem
stéisreviUnSRCN
DSteerutlCuséitivtcellCoteselovénBésnoiaticosas
seugolaaltCanoitisopxed’
21
AD 241
edsetAcseuqollco
edseihpaaprgonMoeduoselliufo
stnemitbâ15 164 88 41 124 7
e sesèhtnSySyn laaltTo
40 7314 278 228 258 20
tndosesèth
281322
snoiaticosasI
51.gFi utaN:
010
aro861sedtesruetuasederu
1 433 51
ra’làtnemeuqinusércasnocsega
6 1184 178
tnosli’uqevéidémeigoloéhcr
541
.séilbpu
6
Fig. 14 : Nature des 377 ouvrages publiés en 1999-2008 et concernant l’archéologie médiévale totalement ou marginalement.
Fig. 15 : Nature des auteurs et des 168 ouvrages consacrés uniquement à l’archéologie médiévale qu’ils ont publiés.Certains ouvrages sont édités par deux auteurs ou plus, ce qui conduit à un total de 178 titres analysés. Les thèses, prises en compteseulement quand elles ont été publiées, ont été attribuées au personnel des institutions qui rémunèrent actuellement leurs auteurs.
Quand il n’a pas été possible de connaître la situation actuelle de ceux-ci, les thèses ont été inscrites au bénéfice général des universités.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
410 JEAN CHAPELOT
dans le nombre d’ouvrages publiés : Champagne-Ardenne,Picardie, Lorraine et Pays-de-la-Loire sont peu présentsdans l’édition alors que Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon le sont beaucoup, de même que des régionsqui ne sont pas en pointe dans le domaine du préventifcomme Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Bourgogne, Midi-Pyrénées ou les deux régions normandes. Nous touchonslà une nouvelle fois une évidence : la présence d’universitéset d’équipes de recherche induit plus de publications qu’unniveau élevé d’activité de terrain.L’examen des thèses permet de vérifier cette affir-
mation. Leur nombre en proportion des publicationsvarie considérablement d’une région à l’autre. Cette obser-vation, combinée avec le nombre de thèses inéditessoutenues dans les universités françaises ces dix dernièresannées, traduit des situations universitaires contrastéesqu’il faudrait analyser dans le détail, mais il n’en reste pas
moins que leur rôle dans les progrès de l’archéologiemédiévale est grand77. Parallèlement, une chose estcertaine : si l’on examine la situation dans les années2001-2005, parmi les trente-cinq universités qui avaientalors des doctorants en archéologie médiévale, plusieursont produit peu de thèses, le nombre de celles soutenuesest faible (environ 30 pendant ces cinq années, dontprobablement la moitié par des docteurs qui pour desraisons variées ne seront ou ne pourront jamais êtrecandidats à des emplois universitaires ou du CNRS) et desthèmes très présents sur le terrain sont peu étudiés78.
77. CHAPELOT et RIETH 2006b. Le bilan de l’université de Nancy,communiqué par Gérard Giuliato, a été omis par mégarde dans cettepublication.
78. CHAPELOT et RIETH 2006b, p. V.
7
Nombre d’ouvrages dont nombre de thèses Rhône-Alpes 12 5 Île-de-France 12 3 Languedoc-Roussillon 11 3 Centre 10 1 Provence-Alpes-Côte-d’Azur 9 3 Bourgogne 7 1 Midi-Pyrénées 6 3 Nord-Pas-de-Calais 6 2 Basse-Normandie 6 2 Poitou-Charentes 6 0 Alsace 5 2 Auvergne 4 1 Bretagne 3 1 Franche-Comté 3 2 Lorraine 3 0 Haute-Normandie 3 0 Pays-de-la-Loire 3 1 Picardie 3 1 Aquitaine 2 1 Limousin 2 0 Champagne-Ardenne 1 0 Corse 1 1 Plusieurs régions ou France entière 50 8 Total 168 41
Figure 16. - Régions étudiées par les 168 ouvrages exclusivement consacrés à l’archéologie médiévale et publiés de 1999 à 2008
Fig. 16 : Régions étudiées par les 168 ouvrages exclusivement consacrés à l’archéologie médiévale et publiés de 1999 à 2008.
Publications du CRAHM, 2010
411CONCLUSION
Les thèmes traités dans les ouvrages (fig. 17)
Le thème le plus traité et de loin, avec un tiers desouvrages, est l’édifice fortifié, avant tout les châteaux depierre (H 24a), étudiés par leur bâti et le plus souventsans fouille. La vitalité de ce secteur de la recherche estainsi illustrée une fois de plus. La fortification de terre, lesmaisons fortes et les bourgs castraux sont représentés àégalité et pour chacun de ces trois sous-thèmes à peinemoins que les fouilles urbaines (H 19a).Les quatre autres grands thèmes, la ville, le monde
rural, les établissements religieux et les inhumations etenfin, ensemble, la culture matérielle et la techniquesont pratiquement tous traités au même niveau et
chacun environ moitié moins souvent que les édificesfortifiés.Dans le cas du monde urbain (H 19), il y a autant
d’ouvrages qui traitent des villes (H 19a) que des maisons(H 19b), mais les auteurs ne sont pas exactement lesmêmes dans les deux cas. Pour ce qui concerne le monderural, les études de paysage (H 20a), massivement publiéespar des universitaires et dans une moindre mesure pardes chercheurs du CNRS et des personnels de Servicesrégionaux, sont à peine moins nombreuses que cellesconsacrées aux résultats des fouilles de sites ruraux(H 20b).L’étude des édifices religieux (H 23a) produit un peu
plus de publications que celle des inhumations (H 23b).
8
Les thèmes traités dans les ouvrages
Thèmes Universités CNRS Culture et SDA
Collectivités Bénévoles Inrap Total
Le fait urbain (19) Fouilles (19a) 4 3 0 4 0 2 13
Maisons et caves (19b) 4 0 4 1 4 0 13 Total 19 8 3 4 5 4 2 26 Espace rural (20)
Paysage et environnement (20a) 9 1 2 0 1 0 13 Sites ruraux (20b) 6 2 2 1 4 4 19 Total 20 15 3 4 1 5 4 32
Établissements religieux, inhumations (23)
Bâtiments religieux (23a) 11 7 0 2 0 0 20 Inhumations (23b) 6 2 1 4 1 2 16 Total 23 17 9 1 6 1 2 36
Édifices fortifiés (24) Châteaux de pierre (24a) 19 3 4 4 11 0 41
Mottes, enceintes de terre (24b) 5 0 1 1 1 0 8 Maisons fortes (24c) 6 0 1 1 1 0 9 Bourgs castraux (24d) 7 0 1 1 1 0 10 Total 24 37 3 7 7 14 0 68
Techniques (25) 4 2 1 0 0 0 7 Culture matérielle (26) 11 3 3 4 1 4 26 Réseaux de communications (27) 1 0 2 0 0 0 3 Aménagements portuaires (28) 1 0 0 1 0 0 2 Archéologie navale (29) 0 1 0 1 0 0 2 Total 94 24 22 25 25 12 202
Fig. 17 : Les thématiques traités par les auteurs des 153 publications traitant d’archéologie médiévale et qui s’intègrent dans la thématique d’analyse, certains ouvrages traitant l’ensemble du Moyen Âge ou des sous-périodes. Fig. 17 : Les thématiques traités par les auteurs des 153 publications traitant d’archéologie médiévale et qui s’intègrent
dans la thématique d’analyse, certains ouvrages traitant l’ensemble du Moyen Âge ou des sous-périodes. Des ouvrages relèvent de plusieurs thèmes, ce qui explique le nombre total de 202 qui n’est pas celui des livres examinés.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
412 JEAN CHAPELOT
Celle de la culture matérielle (H 26), avec la moitié desouvrages consacrés à la terre cuite, est très bien repré-sentée, alors que celle des techniques (H 25), presquetotalement orientée vers la métallurgie et la construction,l’est nettement moins. Proportionnellement à leurnombre, les spécialistes rattachés à l’INRAP et travaillantsur la culture matérielle semblent plus présents dans lespublications que les responsables d’opérations de cetinstitut dans les secteurs liés aux thèmes classiques del’archéologie préventive comme la ville ou le monde rural.Les voies de communication (H 27), les aménage-
ments portuaires et fluviaux (H 28) et les épaves (H 29)apparaissent peu.Les auteurs sont pour moitié des universitaires. La place
du CNRS, des SRA, des collectivités et des bénévoles estégale et ils constituent ensemble pratiquement l’autremoitié des auteurs. Le poids de l’Université est spécia-lement fort dans le secteur de l’espace rural, desétablissements religieux et des inhumations, des édificesfortifiés et des techniques, celui des SRA dans l’étude dubâti urbain et de l’espace rural. Les archéologues de collec-tivités publient un peu dans tous les domaines et lesbénévoles sont spécialement actifs dans l’étude des édificesfortifiés, du bâti urbain et des sites ruraux. Le personnel del’INRAP publie peu d’ouvrages et dans des secteurs liés aupréventif (fouilles urbaines et de sites ruraux, inhuma-tions) et surtout dans le domaine de la culture matérielle,en fait la céramique issue des fouilles.L’archéologie préventive, qui concentre des moyens
financiers et humains très importants, produit peu depublications dans les domaines où elle est très présentealors que l’archéologie programmée, avec un nombred’opérations réduit et un faible financement, édite lamajorité des publications et dans tous les domaines. Dansdes thèmes comme les inhumations ou la culturematérielle, une large part de la documentation desouvrages vient des fouilles préventives et ces publicationssont très souvent le résultat de thèses. Il en est spécia-lement ainsi pour l’étude de la céramique issue des sitesd’utilisation.L’une des réussites que l’on porte usuellement au crédit
de l’archéologie préventive est la croissance du volumed’observations et la diversification de celles-ci dans dessecteurs variés et souvent originaux. Il s’agit là d’une réalitéindiscutable, mais on en est droit de se demander ce qu’ap-portera à moyen terme cette croissance du nombred’observations et des données brutes récoltées sur le terrain.Les fouilles d’habitats ruraux de la fin du haut Moyen
Âge, l’une des révélations de l’archéologie préventive de
ces dernières décennies, sont l’illustration la plus frappantede cette situation. En 1991, faisant un bilan des fouillessur ce thème en Île-de-France79, j’en étais arrivé, aprèsdiscussion avec les fouilleurs, à la conclusion que seulstrois, peut-être quatre des 42 sites étudiés récemment àcette date seraient éventuellement publiés sous formed’une monographie dans les années à venir : presque vingtans plus tard, ce n’est le cas pour aucun. Un bilan établien 2000 de l’état des fouilles sur ce même sujet montreque dans la région Île-de-France et pour l’essentiel dansla décennie précédente, plus de 230 fouilles ou sondagesavaient permis la découverte dans 150 à 160 communes(sur un total de 1281 communes couvrant 12011 km2)d’un, parfois plusieurs habitats ruraux des Ve-XIe siècles80.On peut être certain qu’une très large part de ces fouillesne sera jamais connue par autre chose que le ou lesrapports de fouille et de brefs comptes-rendus publiésdans les Bilans scientifiques régionaux ou la revue Archéo-logie médiévale. Ce n’est pas forcément un drame dans lecas de la majorité de ces opérations, mais il n’en reste pasmoins qu’un problème d’ensemble existe et qu’il n’est paspropre à l’Île-de-France et à ce thème de fouille.
Conclusion : il faut engager une réflexion sur la publica-tion en archéologie médiévale
C’est la publication du résultat de ses fouilles qui faitd’un archéologue un chercheur. De ce point de vue, lasituation de l’archéologie médiévale n’est guère brillante :le volume total de publication n’est pas très élevé comptetenu de la taille de la communauté scientifique; certainstypes de chercheurs sont nettement plus productifs qued’autres ; les thèmes abordés par les publications rendentmal compte du travail de terrain dont des pans entiers, liésen particulier à l’archéologie préventive, n’apparaissentpas ou mal dans les publications.Cette situation conduira à terme à une perte massive
d’informations, mais elle a aussi des conséquences intel-lectuelles graves : en l’absence de publications et d’unediffusion rapide des résultats du terrain, une disciplinene peut pas vivre et se développer d’une manière normale.Sans y insister, car il s’agit d’un problème qui concerne
toute l’archéologie, il faut ajouter qu’il est nécessaire àtrès court terme de réfléchir au problème de l’édition.Une partie des supports, périodiques comme ouvrages,sont de création récente et mal ou peu diffusés, surtout à
79. CHAPELOT 1993.80. CHAPELOT à paraître.
Publications du CRAHM, 2010
413CONCLUSION
l’étranger ; ils relèvent pour une grande part d’entre euxde la littérature grise, comme certains catalogues d’expo-sition ou beaucoup de publications de circonstance.Des phénomènes récents posent d’autres problèmes.
Ainsi la politique de publication d’ouvrages destinés augrand public et de communication mise en place pourvaloriser et légitimer l’archéologie préventive. Tout cela estévidemment important et nécessaire, mais une part desmoyens humains, par ailleurs peu abondants, est ainsienlevée à la diffusion des résultats de la recherche.Tout ce qui précède a une conséquence : la très faible
visibilité de l’archéologie médiévale française, notammentà l’étranger. Une recherche à partir des noms d’un groupehomogène par l’âge et le statut professionnel d’unevingtaine de spécialistes d’archéologie médiévale salariésdes universités et du CNRS faite dans Google recherchede livres montre le petit nombre de citations des travauxde la plupart d’entre eux. La même étude faite à proposd’historiens de même âge et de même statut donne unnombre de citations plusieurs fois plus élevé, ce quis’explique par le fait que les historiens médiévistes sontplus nombreux que les archéologues médiévistes, maissurtout qu’ils publient individuellement chacun plus queces derniers et que de surcroît ils évoluent dans un milieuscientifique dont les travaux sont plus diffusés et lus.À tout cela vont s’ajouter les effets du classement des
publications en cours sous l’égide de l’Agence d’évaluationde la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES)et dont les effets risquent d’être redoutables si cettepolitique n’est pas maîtrisée.En juin 2009 et pour effectuer son classement des
revues dans les catégories A, B et C, le groupe d’expertsde l’AERES en avait examiné environ dix milleconcernant le secteur des sciences de l’homme et de lasociété et éditées dans le monde entier81. Pour en resteraux cas des seules revues subventionnées par le ministèrede la Culture et de la Communication et susceptibles depublier des articles d’archéologie médiévale, les résultatsétaient les suivants :– est en catégorie A Archéologie médiévale ;– sont en catégorie B Archéologie du Midi médiéval, Gallia,la revue archéologique de l’Est, la revue archéologique dePicardie, la Revue archéologique du Centre et de l’Île-de-France, la revue d’archéométrie, la revue duNord-Archéologie.
– est en catégorie C la Revue archéologique de l’Ouest, avecles Nouvelles de l’archéologie et quelques très rares revues desociétés savantes.Des revues comme Aquitania, Archeologia, les Dossiers
de l’archéologie et Archéopages et la masse des revues desociétés savantes n’avaient pas à cette date été examinéesou prises en considération.Dans le domaine des ouvrages et indépendamment de
leur qualité et de leur nature, seuls ceux qui portent unnuméro ISBN (International Standard Book Number)peuvent être pris en considération. Cette indication estobligatoire en France sur tous les ouvrages imprimés, maisn’est pas systématiquement respectée. Par ailleurs, une thèse,dont le contenu a été validé par un jury, est mieux classéequ’un ouvrage édité sans contrôle scientifique des pairs etsurtout que des actes de colloques qui sont généralementclassés en C ou non pris en considération.Dans ces conditions et à l’avenir, seules quelques
centaines de pages par an de l’ensemble de l’édition enarchéologie médiévale de ces dernières années seraientconsidérées comme relevant des catégories A et B, ce quine manquera pas de poser des problèmes aux archéo-logues salariés d’établissements publics de recherche quidoivent justifier leur activité en ayant publié tous lesquatre ans quatre articles ou ouvrages dans des supportsbien classés.Dans le domaine de l’édition comme dans d’autres,
nous sommes actuellement à la fin d’une époque.
2. Bilan et perspectives de la recherche archéologiquemédiévale
En tenant compte des observations qui précèdent, il fautmaintenant esquisser un tableau de l’état de la recherchearchéologique médiévale en ce début de XXIe siècle. Nousutiliserons le cadre de la programmation établie par leCNRA en 1997 : il est un peu artificiel, mais il permet unecomparaison entre les trois points examinés précédemment,le travail de terrain, les projets de recherche financés et lesrésultats publiés. L’objectif est de dégager les faiblesses et lesréussites afin de proposer ensuite les moyens d’une dynami-sation de la recherche archéologique médiévale.
2.1. La ville (H 19 de la programmation du CNRA de1997)
C’est sans doute dans le domaine de la ville que l’origi-nalité de l’apport de l’archéologie est le plus troublant :
81. http://www.aeres-evaluation.fr/La-liste-des-revues-scientifiques(Situation en juin 2009. Il s’agissait à cette date d’un travail de classi-fication inachevé).
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
414 JEAN CHAPELOT
contrairement à l’habitat rural, mal ou peu documenté parles sources écrites, la ville, surtout pour les derniers sièclesdu Moyen Âge, est depuis longtemps un thème classiqued’étude des historiens. Pourtant, l’archéologie est en trainde modifier profondément notre vision de la ville et passeulement en nous documentant sur les périodes malconnues. Sur celles-ci, qui vont du début de notre èrejusqu’aux XIe-XIIe siècles et comme le montre HenriGalinié, ce sont tous les concepts sur lesquels était fondéenotre vision de la ville qu’il faut revoir et repenser82. Qu’ils’agisse de la genèse et de la signification des terres noiresou de l’intérêt récent des archéologues pour les périphériesde villes83, nous sommes face à un renouvellementprofond à court terme de la vision de la ville médiévale.L’un des grands intérêts de l’étude des villes est de
rendre possible une évaluation de ce que nous pouvonsattendre de l’archéologie. On peut en effet estimer, dansune région donnée, combien de villes grandes et petitesexistaient au Moyen Âge, par exemple 150 à 200 pour laPicardie84 ou 71 pour l’Alsace85, et savoir, en faisant lebilan des fouilles, quelle est la part connue de l’espaceurbain. C’est ce que font Yves Henigfeld, Jean-JacquesSchwien et Maxime Werlé qui évaluent à seulement 2 %la surface urbanisée ancienne de Strasbourg explorée parles fouilles, bien que l’archéologie urbaine y soit activedepuis plus d’une vingtaine d’années86. À Saint-Denis, oùles archéologues sont au travail depuis 1973, plus tôt quepresque partout ailleurs en France, Nicole Meyer-Rodrigues considère que malgré un bilan sans guèred’équivalent en Europe de 160 opérations d’archéologiepréventive, c’est seulement 13 % de la surface de la villemédiévale qui a été examinée, dont 3 % par des fouillessystématiques87. Dans le secteur de la ville, le parent pauvreest le haut Moyen Âge, la période XIe-XVe siècle étant lamieux représentée, mais avec des observations restant leplus souvent partielles ou limitées88. Dans l’interrégionCentre-Est, l’archéologie urbaine représente 17% des sitesétudiés et ceux-ci le sont uniquement dans le cadre dupréventif89. Cette situation semble la même partout.
Quelques thématiques originales sont apparuesrécemment comme des diagnostics et des études sur lesremparts urbains90 et l’importance accordée à la place del’eau et à l’hygiène, dont les latrines91. D’une manièregénérale, l’archéologie du bâti urbain pose des problèmessoulignés un peu partout92. Difficile à mettre en œuvrepour des raisons réglementaires et financières, elle restesouvent le fait d’archéologues bénévoles et concerne avanttout certaines maisons de ville ou des châteaux. Elle estpeu présente dans le secteur de l’archéologie préventive93et n’arrive pas, sauf exceptions, à intégrer l’étude du petitbâti urbain commun ou des petites résidences aristocra-tiques. Le bilan de la CIRA Centre-Est remarque quel’étude du bâti porte le plus souvent sur des résidences deprestige situées avant tout dans de grandes villes94. Cegenre d’études est récent un peu partout : en Alsace, lepremier exemple a été la maison du 17, rue des Halle-bardes à Strasbourg, étudiée entre 1996 et 199895. Destravaux récents se sont développés sur les maisonsurbaines. En marge de l’archéologie de terrain tradition-nelle et de celle du bâti strictement définie et souventdans l’urgence, il s’agit dans la majorité des cas de l’étudesans fouille et sans intervention dans les murs de maisonsconservées en élévation et datant du XIIe siècle jusqu’à lafin du Moyen Âge. Ce genre d’étude a permis d’aborderd’une manière neuve le problème des maisons urbaines etrurales, un sujet très négligé par la recherche depuislongtemps.Un aspect de l’étude du bâti urbain est apparu en
Lorraine et en Alsace dès la fin des années 1970 et s’estdéveloppé récemment dans cette région et ailleurs : l’étudedes charpentes, des pans de bois, des lambris, des plafondspeints des maisons urbaines96. Mais le même bilan relèveen Alsace, en même temps que les conditions difficilesde l’étude du bâti urbain, un essoufflement de ce genre derecherche à partir de 200097. De même, alors qu’Anne-Marie Flambard Héricher indique la place considérable del’archéologie du bâti dans l’étude des sites fortifiés en1999 et Danièle Alexandre-Bidon et Françoise Piponnier
82. GALINIÉ 2010.83. HENIGFELD, SCHWIEN et WERLÉ 2010, p. 356; Les données
du CNAU 2007, p. 14.84. La recherche archéologique en Picardie 2005, p. 253.85. Bilan scientifique Alsace 2006, p. 115.86. HENIGFELD, SCHWIEN et WERLÉ 2010, p. 356.87. MEYER-RODRIGUES 2010, p. 370.88. Bilan scientifique Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2008, p. 94 ;
ALEXANDRE-BIDON et PIPONNIER 2000-2001, p. 206.89. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 45.
90. ALEXANDRE-BIDON et PIPONNIER 2005, p. 181; FLAMBARDHÉRICHER 2000-2001, p. 279 (en 1999) et p. 435 (en 2000).
91. ALEXANDRE-BIDON et PIPONNIER 2000-2001, p. 205, 2005,p. 181, 2006, p. 247, 2007, p. 175 ;
92. Bilan scientifique Alsace 2006, p. 124-125 et p. 130.93. Bilan CIRA Ouest 2008, p. 113.94. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 4795. Bilan scientifique Alsace 2006, p. 12496. Bilan scientifique Alsace 2006, p. 12497. Bilan scientifique Alsace 2006, p. 124
Publications du CRAHM, 2010
415CONCLUSION
sa percée en 2000-2002 dans le secteur du bâti civil98,ces deux dernières soulignent à partir de 2004 le déclin dece type d’activités de terrain, notamment en ville99.Bruno Desachy et Dominique Gemehl, à propos de la
Picardie, font un bilan qui a une valeur générale en ce quiconcerne l’archéologie urbaine100. Ils développent unedistinction entre villes d’archéologie urbaine et villesd’opportunisme archéologique. Dans le premier cas sesituent des villes qui disposent de services ou d’embryonsde services archéologiques : là
un suivi scientifique permanent permetd’entretenir un état synthétique des connais-sances (publié ou non). Le résultat de chaqueopération peut alors être mis en relation avecl’ensemble des données précédentes acquiseset, ainsi, modifier ou faire évoluer cet étatgénéral des connaissances. Cela permet dedéfinir des objectifs précis et des choix d’in-tervention préalablement à chaque nouvelleopération. De même, ce suivi donne du sensaux opérations de faible importance envolume et aux observations limitées (surveil-lance de travaux de réseau…) […]101.
Dans le cas des villes d’opportunisme archéologique, lecapital documentaire préexistant à une opération deterrain est faible et les possibilités de mise en place d’unearchéologie préventive efficace et productive sontréduites102. Cette analyse, qui explique la faible produc-tivité scientifique des fouilles préventives en ville, a valeurgénérale dans tous les secteurs de l’archéologie médiévaleet pose le problème de la territorialisation de l’archéo-logie préventive.La ville (H 19) et le monde rural (H 20) représentent
en nombre chacun un tiers des opérations de terrain etinfiniment plus en moyens humains et financiers puisquec’est là que se concentre pour l’essentiel l’archéologiepréventive. Ces deux thématiques ont un poids propor-tionnellement comparable dans les PCR et dans lespublications, mais des sous-thèmes comme le bâti urbain
ou le paysage, peu présents dans l’archéologie préventive,sont au contraire très représentés dans les projets derecherche et surtout dans les publications (fig. 9 et 17).
2.2. Le monde rural (H 20 de la programmation duCNRA)
Dans le secteur des sites ruraux, l’activité de terrain laplus courante, en croissance continue depuis les années1980 et jusqu’à ces dernières années, concerne la fin duhaut Moyen Âge, avec notamment l’apparition récente defouilles de ce type dans des régions naguère peu actives,hors du noyau originel que constituaient l’Île-de-France,la Picardie, l’Alsace ou Rhône-Alpes103. C’est ce que nemanquera pas de souligner, lorsqu’il sera publié, le bilande la CIRA Sud-Ouest pour la plupart des régionsconcernées. A contrario, le bilan de la CIRA Centre-Estindique que la part des sites ruraux du haut Moyen Âgeest très faible ici, limitée à quelques traces trouvées enpréventif104.L’habitat rural de la fin du haut Moyen Âge est
exemplaire de l’apport des fouilles préventives puisqu’il aquasi totalement été révélé par celles-ci dans les vingt outrente dernières années. Par l’importance du corpusdocumentaire constitué, il a été possible pour la premièrefois dans le domaine de l’archéologie médiévale et dès ledébut des années 1990, avec le développement desdécapages de grandes surfaces, de se poser des problèmesméthodologiques fondamentaux comme la représenta-tivité de la surface fouillée et la nature des établissementsétudiés105.Mais depuis quelques années, ce secteur évolue d’une
manière problématique. Les fouilles prennent un caractèretechniciste et répétitif, soulignés par des spécialistescomme Claude Raynaud106 et qui est caractéristique d’unetendance assez générale de l’archéologie préventive.Certains, comme Danièle Alexandre-Bidon et FrançoisePiponnier, en viennent même à penser que les fouillesrécentes n’apportent plus grand-chose de nouveau107. Leproblème est désormais dans ce secteur, comme l’écrit
98. FLAMBARD HÉRICHER 2000-2001, p. 435; ALEXANDRE-BIDONet PIPONNIER 2008, p. 165.
99. ALEXANDRE-BIDON et PIPONNIER 2005, p. 181; 2006, p. 247(mais résultats remarquables, par exemple à Orléans) ; 2007, p. 175;2008, p. 165.
100. La recherche archéologique en Picardie 2005, p. 247 et ss.101. Ibid., p. 257.102. Ibid., p. 253.
103. CHAPELOT à paraître ; ALEXANDRE-BIDON et PIPONNIER2000-2001, p. 206.
104. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 45.105. CHAPELOT 1993 et ID. à paraître ; PEYTREMANN 2003 et
ID. 2010; GENTILI 2010.106. Bilan CIRA Est 2008, p. 89 et 97-98.107. ALEXANDRE-BIDON et PIPONNIER 2000-2001, p. 205; 2006,
p. 247; 2007, p. 175.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
416 JEAN CHAPELOT
François Gentili, de passer à des analyses complexesinsérant l’habitat dans son environnement large, avec desmodes de lecture relevant de l’archéogéographie108. Il s’agitd’un problème de méthode que souligne bien la CIRAOuest en analysant les résultats des fouilles de ce type desites : rareté de l’insertion de ces opérations dans uneétude de l’environnement (pédologie, palynologie, carpo-logie, étude faunique), faible exploitation des observationsde traces de parcellaire ou de clôture et difficultés pourdéfinir le statut de ces habitats109. Dans le cas de laPicardie, les auteurs du bilan régional considèrent aussique si le corpus des sites ruraux de la fin du haut MoyenÂge n’est pas encore représentatif, bien inférieur à ce quia été réuni sur le même type de sujet pour l’époqueromaine ou même la protohistoire récente, ces sites,souvent partiellement fouillés et très rarement publiés,posent des problèmes d’interprétation mal ou peuabordés : «La plupart des habitats découverts corres-pondent à des établissements agro-pastoraux indéfinis, etn’ont souvent pour mérite principal que d’alimenter uncorpus qui est encore bien léger110». Ces auteurs estimentnotamment que la typologie des bâtiments de surfacereste à faire, que l’interprétation sociale ou économiquede ces fragments de sites est le plus souvent inexistante,que la nature du peuplement (habitat dispersé ou groupé)est incertaine et, enfin, que des thèmes entiers commel’étude de l’environnement, les formes d’exploitation dessols, l’extension de la forêt, les artisanats sont à peineévoqués par les archéologues111. Les remarques ainsiformulées s’appliquent parfaitement aux rares monogra-phies de sites ruraux de la fin du haut Moyen Âgeactuellement publiées112.De nombreux auteurs soulignent l’absence de
recherches de terrain sur les origines du village, unequestion qui est pourtant au centre des problématiquesdéveloppées depuis longtemps par les historiens duMoyen Âge113. Mais ici, nous touchons aux contraintesqu’impose une demande sociale, celle des aménageurs,qui n’est guère programmable dans ses localisations ouses calendriers. L’étude des origines du village supposedes fouilles dans les sites ruraux actuels, en profitant des
moindres parcelles accessibles, ce qui requiert de la partdes prescripteurs de diagnostics et de fouilles une gestionde l’espace fine et reposant sur une problématique établiebien en amont du passage au terrain114. Dans une régioncomme l’Île-de-France, de telles opérations se sontdéveloppées depuis quelques années, y compris dans lecœur de Paris, et avec des résultats probants115.L’exemple picard permet de comprendre pour une part
le problème qui se pose dans le secteur de la fouille des sitesruraux. Une intéressante analyse est proposée pourexpliquer qu’il «n’est pas certain que l’archéologie picardedu haut Moyen Âge soit en bonne santé, en cette premièredécennie du XXIe siècle, même si les opinions diffèrent surl’état du patient116!». La fouille des habitats du haut MoyenÂge, très active dans cette région dans les décennies 1970-1980 par le biais d’archéologues bénévoles et de fouillesprogrammées, n’a pas profité du décollage de l’archéologiepréventive dans les années 1985-1995 car, pour l’essentiel,ces fouilles préventives ont été faites par des archéologuesqui n’étaient pas spécialistes du Moyen Âge et sans accom-pagnement par des structures scientifiques régionales117.Dix ans plus tard, il y a finalement peu de spécialistes duhaut Moyen Âge en Picardie : à l’INRAP une seulepersonne sur 30 ou 40 responsables d’opération, plus deuxou trois qui interviennent occasionnellement118. Cetteanalyse, qui s’applique aussi à l’habitat rural de la secondepartie du Moyen Âge dans la même région, est valablepour d’autres thèmes de terrain et pose une fois de plus laquestion de la territorialisation des fouilleurs qui travaillentdans le préventif.Les études de terrain portant sur les sites ruraux du bas
Moyen Âge sont jusqu’à une date récente et sauf excep-tions, restées en déshérence. Ce constat est celui deFrançois Blary et d’Isabelle Parron dans le bilan de laCIRA Ouest119 et il est général. Mais à l’examen de lasituation dans l’ensemble de la France, Danièle Alexandre-Bidon et Françoise Piponnier considèrent qu’il y a unredémarrage de l’étude des sites ruraux des XIIIe-XVe sièclesà partir de 1999120 et un bon niveau d’étude en 2007 de
108. GENTILI 2010.109. Bilan CIRA Ouest 2008, p. 115-116.110. La recherche archéologique en Picardie 2005, p. 228-229.111. Ibid., p. 229-230 ; remarques convergentes de Claude
Raynaud dans Bilan CIRA Est 2008, p. 91.112. CHAPELOT à paraître (a).113. La recherche archéologique en Picardie 2005, p. 230 et p. 289.
114. Bilan CIRA Est 2008, p. 92.115. CHAPELOT à paraître (a).116. La recherche archéologique en Picardie 2005, p. 231.117. La recherche archéologique en Picardie 2005, p. 306; cf. aussi
Ibid., p. 225-226.118. La recherche archéologique en Picardie 2005, p. 231.119. Bilan CIRA Ouest 2008, p. 111.120. ALEXANDRE-BIDON et PIPONNIER 2000-2001, p. 206; 2006,
p. 247; 2007, p. 175 et 2008, p. 165.
Publications du CRAHM, 2010
417CONCLUSION
ceux des Xe-XIIe siècles, une période jusqu’alors peuconcernée par ce genre de fouille121.L’étude des origines et des formes de l’habitat rural
dispersé est très peu développée, comme le souligne lebilan de la CIRA Sud-Est, mais comme cela pourrait êtredit à propos d’autres régions122.Deux thématiques originales de recherche sont
apparues depuis quelques années dans le Sud-Ouest et leSud-Est : elles ont, pour de multiples raisons, une valeurexemplaire. L’une est l’étude des habitats ruraux perchésde la basse Antiquité et du haut Moyen Âge, avec audépart les travaux de Laurent Schneider à Argelliers, auRoc de Pampelune (Hérault), suivis par ceux plus récentsd’Olivier Passarrius123. Cette thématique s’est déplacéeensuite dans la région PACA124 et dans le Vivarais125.L’autre thématique originale récente s’intéresse à l’habitatet aux modes d’exploitation des zones de montagne. Auxtravaux de Laurent Fau dans le Cézallier126 sont venuess’ajouter les recherches sur le pastoralisme de ChristineRendu127 puis celles conduites sur le même sujet dans leMercantour dès 1995-1996 et plus récemment dans leChampsaur128. À propos de ces recherches sur de grandessurfaces, Danièle Alexandre-Bidon et Françoise Piponnierparlent d’une « approche remarquable aux résultatsimpressionnants129 » et dont l’une des forces est qu’elleest croisée avec l’étude des sources écrites et une connais-sance historique et ethnographique du milieu. Dans lecas de ces deux thématiques, il faut souligner trois chosesessentielles : la mise en œuvre au départ d’une probléma-tique fine reposant sur la constitution d’un corpusdocumentaire aussi complet et diversifié que possible ; lefait que ces recherches s’appuient exclusivement sur desétudes programmées ; l’importance en volume et enintérêt des publications réalisées de surcroît trèsrapidement. Comme cela ressort des textes de LaurentSchneider130 et de Patrice Conte, Laurent Fau et FlorentHautefeuille131, ces deux thématiques d’étude de l’habitatrural perché du haut Moyen Âge ou dispersé en montagne
illustrent ce qu’est une archéologie pensée dans le cadred’une problématique originale.La problématique des relations hommes/milieux, qui
est désormais au centre des préoccupations de beaucoupd’archéologues spécialistes du Moyen Âge132, estexemplaire de la situation actuelle de cette archéologie, surle terrain comme après celui-ci. Dans l’interrégion Centre-Est, Bruno Dufaÿ et Pierre-Yves Laffont remarquent quece genre de problématique et la collecte de donnéespaléoenvironnentales sont pratiquement nulles dansl’ensemble de l’archéologie médiévale, à l’exception de lafouille de Charavines et, d’une certaine manière, del’archéologie minière133. Ce n’est pourtant pas fauted’études exemplaires récentes qui reposent pour une partsur l’accumulation grâce à l’archéologie préventive d’uncorpus de données exploitables. Ainsi, Aline Durand134,Armelle Querrien135 et Marie-Pierre Ruas136 montrentl’évolution récente et rapide dans ces domaines, lesapproches inédites ainsi ouvertes, mais aussi comment cetype de travail n’est possible qu’avec des problématiquesfondées sur l’ensemble de la documentation disponible,y compris les textes, et au prisme d’une culture historiqueforte. L’archéozoologie, telle que la présentent BenoîtClavel et Jean-Hervé Yvinec d’un côté 137, Isabelle Rodet-Belarbi et Vianney Forest de l’autre138, est exactementdans la même situation et ouvre les mêmes possibilités derenouvellement des approches dans l’étude des mondesurbains et ruraux. Tous ces auteurs évoquent un pointessentiel que l’on retrouve ailleurs, par exemple à proposde l’archéologie funéraire : la constitution récente grâce àl’archéologie préventive de corpus amples et représen-tatifs qui permettent désormais des synthèses. Mais ilapparaît bien dans tous les cas évoqués ci-dessus quel’exploitation de ces corpus n’est possible qu’au prix d’untravail post-fouille long et réalisé par des spécialistes : lesréussites que l’on peut évoquer dans les secteurs de lacarpologie ou de l’étude des restes animaux, parmid’autres, n’ont été possibles qu’à ce prix.Ce qui limite l’exploitation et la publication des
données issues de l’archéologie préventive étudiant lessites ruraux est la faiblesse des moyens humains121. ALEXANDRE-BIDON et PIPONNIER 2008, p. 165.
122. Bilan CIRA Sud-Est 2009, p. 60.123. Ibid., p. 56.124. Bilan scientifique Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2008, p. 95125. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 47.126. FAU 2006; Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 47.127. RENDU 2003a et ID. 2003b.128. Bilan scientifique Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2008, p. 104.129. ALEXANDRE-BIDON et PIPONNIER 2005, p. 181, 2006, p. 247.130. SCHNEIDER 2010.131. CONTE, FAU et HAUTEFEUILLE 2010.
132. BURNOUF et al. 2008.133. Bilan CIRA Sud-Est 2009, p. 45.134. DURAND 2010.135. QUERRIEN et al. 2010.136. RUAS 2010.137. CLAVEL et YVINEC 2010.138. RODET-BELARBI et FOREST 2010.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
418 JEAN CHAPELOT
disponibles pour le travail post-fouille. On peut prendrel’exemple des limites de parcellaire, des haies et desclôtures, des réseaux viaires et plus largement du paysage.Les grands décapages en milieu rural produisent des tracesde ce genre parfois en quantité, y compris lors d’opéra-tions, par exemple en périphérie de ville, qui, dans lesrapports de diagnostic sont présentées comme négativesparce qu’aucune structure bâtie n’est mise au jour. Cesdiagnostics «négatifs» puisqu’ils ne débouchent pas surune fouille préventive ne le sont pas forcément dans lecadre d’une étude de terroir, mais dans la majorité descas, de telles observations seront difficilement exploitablesou peu exploitées. Nous sommes ici en face d’unproblème très général, qui est celui des possibilités dedéveloppement d’approches globales des terroirs.Quelques thèses soutenues récemment ou en cours etrelevant de cette thématique ont néanmoins utilisé avecsuccès ces possibilités139.L’étude du monde rural est certainement, parmi les
thèmes classiques d’intervention de terrain, celui qui exigele plus et au plus vite une profonde réflexion quant à sesméthodes et ses problématiques. Il n’a pas, à la différencede l’étude des villes ou de l’archéologie funéraire, pour neciter que deux exemples, bénéficié récemment de laréflexion méthodologique qu’il mérite et que l’impor-tance des travaux de terrain exige, même si l’on peutobserver quelques percées intellectuelles récentes remar-quables. L’examen des thèmes des projets de recherche etdes publications a donc ici une très grande importance.Quand on regarde l’état des PCR et autres thèmes de
recherche post-fouille qui portent sur le monde rural(fig. 9), on remarque qu’ils sont proportionnellement lesplus nombreux – avec ceux consacrés à l’étude des édificesreligieux et des inhumations –, mais que les deux tierss’intéressent au paysage et à l’environnement, l’autre tiersétant pour l’essentiel consacré aux résultats de la fouille desites ruraux de la fin du haut Moyen Âge. Les publicationssur le monde rural ne sont pas très abondantes et si lamajorité d’entre elles sont des résultats de fouille (fig. 17),
pour une bonne part d’ailleurs d’habitats postérieurs auXIe siècle, le nombre d’ouvrages sur les paysages et l’envi-ronnement est plus élevé. L’image donnée par ces thèmesde recherche et ces publications correspond bien à unsecteur d’où se dégagent depuis peu des orientationsnouvelles axées sur le paysage et l’environnement, avecmalheureusement très peu de publications de monogra-phies présentant le travail de terrain, en particulier surles sites de la fin du haut Moyen Âge.
2.3. Édifices religieux et archéologie funéraire (H 23 de laprogrammation du CNRA)
L’étude de terrain des édifices religieux est plutôt enrégression, le haut Moyen Âge étant de surcroît en généralpeu présent. Le bilan de la CIRA Ouest relève la baisse dunombre de travaux de terrain sur ce thème, mais soulignel’amélioration de la qualité des opérations tout enindiquant que l’attention est concentrée avant tout sur lebâti au détriment de l’espace cimetérial140. Il en est demême dans la région PACA, où l’étude des édificesreligieux a toujours été active141. Dans l’interrégionCentre-Est, une forte place est accordée à l’étude deséglises (y compris avec la dimension funéraire associée) etdes châteaux qui, ensemble, représentent 58 % des sitesétudiés, dont 35 % pour les églises, la part de l’archéologieprogrammée étant ici essentielle142. Dans cette région,l’ensemble du haut Moyen Âge n’apparaît que parquelques traces dans des sites ruraux et les phases paléo -chrétiennes d’édifices religieux143. En Alsace, où lesrésultats de l’étude des édifices religieux sont donnéscomme modestes144, les traces de ceux du haut MoyenÂge, délaissés par les fouilleurs, manquent145. L’inter-région Est est l’une de celle où l’étude du bâti religieux estle plus développé, avec des recherches sur les bâtimentscisterciens en Champagne-Ardenne, les granges monas-tiques en Franche-Comté et dans cette même région surles monastères du haut Moyen Âge. Mais le pôle principalde recherche est ici l’activité de Christian Sapin au traversdu Centre d’études médiévales d’Auxerre, aussi bien parles études conduites sur le groupe épiscopal et canonial deSaint-Nazaire à Autun et la cathédrale d’Auxerre que sur139. GANDINI 2008. On peut citer aussi l’exemple de la thèse (en
cours) de Claire Bénard (L’exploitation des ressources du plateau de Saclay(Essonne) : analyse archéologique de l’évolution d’un paysage) qui utiliseles résultats des fouilles préventives de grande surface faites récemmentdans ce secteur au sud de Paris. À propos de ces deux thèses et plusgénéralement de la recherche dans ce domaine, voir les communica-tions faites lors de la deuxième rencontre des doctorants en SHS surla modélisation des dynamiques spatiales tenue à Avignon en décembre2007 (http://isa.univ-tours.fr/modys/rencontre.php?year=2007).
140. Bilan CIRA Ouest 2008, p. 111.141. Bilan scientifique Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2008, p. 101.142. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 45.143. Ibid., p. 45.144. Bilan scientifique Alsace 2006, p. 135145. Ibid, p. 93 et p. 134
Publications du CRAHM, 2010
419CONCLUSION
nombre d’églises petites ou grandes dans la mêmerégion146. L’étude par Anne Baud des restes de l’abbaye deCluny vient s’ajouter aux précédentes pour faire de laBourgogne l’une des régions les plus avancées dansl’analyse du bâti religieux médiéval.En deux ou trois décennies, comme le montre
Christian Sapin, notre approche du bâti religieux et de sonenvironnement a été profondément renouvelée par untravail coordonné d’historiens, d’archéologues et d’histo-riens d’art147. Il s’agit ici, comme dans d’autres secteurs del’archéologie médiévale comme les mines et la métallurgie,d’un travail convergent de spécialistes venus d’horizonsparfois différents, mais qui se sont approprié les modesd’étude des autres spécialistes. Une large part des publi-cations archéologiques sur le bâti religieux est le faitd’historiens ou d’historiens d’art qui se sont trouvés, parcequ’ils avaient une formation universitaire solide, les seulsen mesure d’étudier des édifices complexes sur lesquelsexiste une documentation, écrite ou relevant de l’histoirede l’art, dont l’exploitation est délicate.À propos des nécropoles et des inhumations, les
remarques faites dans le bilan scientifique de l’Alsace sontvalables ailleurs : l’étude du funéraire avant l’an Mil estl’un des champs privilégiés de la recherche depuislongtemps alors qu’après cette date c’est un parentpauvre148. Pour ce qui concerne le bas Moyen Âge, l’undes manques essentiels est l’étude des grands cimetières,urbains notamment, rarement fouillés et jamais sur unegrande surface représentative et dont l’étude, y comprissur le terrain, pose des problèmes de méthodes qui nesont que partiellement résolus actuellement. FrédériqueBlaizot écrit à ce propos : «La grande terreur durapporteur en archéologie funéraire concerne lescimetières d’églises en contexte urbain». Elle expliquecomment, après des diagnostics souvent insuffisants, onpart dans l’inconnu pour monter des opérations difficilesà concevoir et le plus souvent mal maîtrisées149.Néanmoins, l’un des grands apports récents est
justement l’étude de vastes ensembles funéraires urbains del’époque moderne liés à des épidémies de peste ou autres :fouillés en préventif à Lambesc, Martigues ou Marseille(Bouches-du-Rhône), ils ont été étudiés par une série dethèses écrites par des spécialistes formés à Marseille150.
D’autres sites analogues sont en cours d’étude dansl’équipe qu’animent Dominique Castex et IsabelleCartron à Bordeaux.Le renouvellement des études anthropologiques ces
dernières années est l’un des éléments les plus remar-quables de l’archéologie médiévale, avec une série deréserves et de problèmes qui sont exposés par FrédériqueBlaizot dans le bilan de la CIRA Est151. Comme le montreCécile Treffort, il s’agit d’un thème qui est l’un des plusanciennement étudiés par les archéologues médiévistes,mais qui a été totalement renouvelé par une approched’historiens de la mort ou par celles des anthropologuesbiologistes étudiant les squelettes, dans les deux cas sousl’influence directe du développement de l’archéologiepréventive qui les a conduit à réfléchir et à trouver lesmodalités de traitement d’une documentation abondanteet nouvelle152.Frédérique Blaizot et Cécile Treffort considèrent que
l’apparition d’anthropologues que l’on peut qualifier deterrain, connaissant l’anatomie squelettique et capablesd’étudier la taphonomie, c’est-à-dire d’observer lesmodalités de décomposition des corps et leurs consé-quences archéologiques, est un acquis fondamental deces dernières années. Cécile Treffort souligne qu’ainsi « lefait funéraire n’est plus réduit à la récolte d’ossements etd’objets traités séparément mais a acquis une dimensiondynamique, l’éphémère et le périssable y retrouvant enquelque sorte droit de cité153». Ce point est fondamentalà un moment où l’on voit de plus en plus dans le secteurde l’archéologie préventive se développer des pratiquesexactement inverses, comme l’étude du mobiliercéramique par des spécialistes qui ne viennent plus sur leschantiers.L’une des questions centrales que se posent depuis
longtemps les historiens est celle de la formation ducimetière médiéval, comme le soulignent plusieurs auteursqui font remarquer que cette question est mal documentéepar l’archéologie154. Nous nous trouvons dans la mêmesituation qu’avec la question de la naissance du village, cequi n’est d’ailleurs pas étonnant. Ce sont des ouvragesd’historiens comme ceux de Michel Lauwers155 ou de
146. Bilan CIRA Est 2008, p. 101-102.147. SAPIN 2010.148. Bilan scientifique Alsace 2006, p. 141.149. Bilan CIRA Est 2008, p. 110.150. Bilan scientifique Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2008, p. 121.
151. Bilan CIRA Est 2008, p. 111-112. Voir aussi l’avis n° 20 du6 janvier 2003 du CNRA qui définit bien ce que devrait être l’archéo-logie funéraire de terrain (Avis du CNRA).
152. TREFFORT 2010.153. TREFFORT 2010, p. 216.154. La recherche archéologique en Picardie 2005, p. 288.155. LAUWERS 2005.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
420 JEAN CHAPELOT
Cécile Treffort156 qui ont fait progresser nos connaissancesà propos de la naissance du cimetière, beaucoup plus queles fouilles archéologiques qui, quand elles pourraient nouséclairer sur ce sujet, restent très largement inédites.L’état des thèmes de recherche et des publications
traduit bien l’écartèlement entre bâti religieux et archéo-logie funéraire. L’étude du bâti religieux et desinhumations, qui forme un tiers des opérations de terrain(fig. 7 et 8) est proportionnellement moins présente dansles PCR (fig. 9) et dans les publications (fig. 17), mêmesi ces dernières sont les plus nombreuses après celles consa-crées aux édifices fortifiés. Les PCR et autres opérationsanalogues se consacrent pour la plupart au bâti, l’archéo-logie funéraire étant très marginale, ce qui trahit une foisde plus le manque de spécialistes.Le nombre d’ouvrages consacrés à l’un ou à l’autre
des deux sous-thèmes bâti religieux et archéologiefunéraire (fig. 17) est assez semblable. En fait, rapportéeau nombre d’opérations de terrain, la part des publicationsliées à l’archéologie funéraire et à l’anthropologie biolo-gique est faible, comme le souligne Frédérique Blaizotdans le Bilan de la CIRA Est157. Cette situation est généralehors de ce secteur géographique.
2.4. Habitats fortifiés (H 24 de la programmation duCNRA)
Dans le domaine de la fortification et des résidencesaristocratiques, Anne-Marie Flambard Héricher évoqueune baisse générale du nombre d’opérations de terraindès avant 1999, confirmée en 2000 et suivie d’un effon-drement en 2002158. Les orientations de recherche restentsensiblement les mêmes depuis des années, mais AnnieRenoux montre à la fois la relative ancienneté des travauxarchéologiques sur les châteaux et les modificationsrécentes profondes des thématiques et des modalités detravail159. Une part importante de la nouveauté vient deprospections thématiques, dont il faut une fois de plussouligner l’importance dans le renouvellement deplusieurs thèmes de l’archéologie médiévale.Les recherches sur les premiers châteaux160 et sur les
fortifications de terre161 sont rares. Aucun grand palais
mérovingien ou carolingien n’a été non seulementfouillé mais même localisé ces quinze dernièresannées162. La problématique sur les résidences fortifiéesdes Ve-Xe siècles a pourtant très fortement évoluérécemment, mais pratiquement sans le support defouilles, comme cela est exposé dans le bilan décennalde la région Poitou-Charentes qui doit paraître prochai-nement163.L’accent est mis avant tout sur le Moyen Âge central
et tardif et sur les châteaux de pierre, l’étude des résidencesaristocratiques restant rare, sauf dans la CIRA Ouest164 etla CIRA Centre-Est où certaines maisons fortes ont étéétudiées alors que l’étude des mottes est absente165. EnChampagne-Ardenne, quelques opérations préventivesont été conduites sur des maisons fortes et cette questionest suivie en Lorraine par une équipe universitaire quiétudie aussi le réseau castral166. En Alsace, une région oùl’étude des châteaux forts de pierre, surtout ceux demontagne, est une tradition ancienne par le biais defouilles programmées conduites par des bénévoles et oùce type de recherche reste très actif, peu de choses sontfaites sur les maisons fortes et l’étude des mottes, naguèredynamique, est abandonnée167. La situation est la mêmedans l’interrégion Centre-Est168. En revanche, en Haute-et Basse-Normandie la recherche sur la fortification deterre, interrompue depuis longtemps, a été repriserécemment par le biais de PCR dirigés notamment parAnne-Marie Flambard Héricher. Le nombre de châteauxde pierre étudiés a diminué en PACA, mais des avancéesconsidérables y sont sensibles ces dernières années grâceà des fouilles programmées, plusieurs thèses, des PCR etdes prospections thématiques et à un travail de fond encollaboration entre professionnels et amateurs169. Dansl’interrégion Sud-Est, l’étude des châteaux seigneuriauxruraux des XIIe-XVe siècles est une spécialité, le plus souventsous la forme de fouilles programmées de très longuedurée170. Un renouvellement est apparu récemment avecl’étude des habitats paysans groupés autour de ces sites
156. TREFFORT 1996.157. Bilan CIRA Est 2008, p. 113158. FLAMBARD HÉRICHER 2000-2001, p. 279 et p. 435; 2003,
p. 267.159. RENOUX 2010.160. FLAMBARD HÉRICHER 2000-2001, p. 435.
161. FLAMBARD HÉRICHER 2003, p. 267.162. La recherche archéologique en Picardie 2005, p. 230.163. BAUDRY-PARTHENAY et al. à paraître. Je remercie Luc
Bourgeois qui a bien voulu me communiquer ce texte inédit.164. Bilan CIRA Ouest 2008, p. 111.165. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 46-47.166. Bilan CIRA Est 2008, p. 101.167. Bilan scientifique Alsace 2006, p. 147 et 149.168. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 47.169. Bilan scientifique Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2008, p. 100.170. Bilan CIRA Sud-Est 2009, p. 59.
Publications du CRAHM, 2010
421CONCLUSION
castraux et avec une attention plus grande aux périodesanciennes des VIIIe-XIe siècles171.On note quelques études sur le mode de vie aristocra-
tique dans l’habitat fortifié à partir du mobilier172, unrenouveau des recherches sur les habitats seigneuriauxsecondaires, souvent intercalaires173 et des orientationsnouvelles comme l’étude des fortifications rupestres ettroglodytiques de la haute vallée du Rhône et de l’habitattroglodytique dans le Nord de la Drôme174, qui, une foisde plus, reposent sur des travaux universitaires et desprospections thématiques.Deux aspects récents de l’étude du bâti fortifié
retiennent l’attention. Un nombre croissant d’interven-tions dans des châteaux ont pour origine desaménagements ou des restaurations portant sur une petitepart d’un bâti souvent très vaste175. Beaucoup de cesétudes sont faites sans l’accompagnement d’une archéo-logie des sols et des murs parce qu’il n’est pas toujourspossible de faire autrement pour des raisons de délais etdes difficultés de financement de l’archéologie du bâtiévoquées plus haut. Ce genre de travail n’est pourtant passans intérêt comme le montre l’exemple du châteaucomtal de Carcassonne étudié par François Guyonnet176 :il est parfaitement possible avec des moyens limités,notamment sans échafaudages et sans fouilles dans lessols et les murs, d’interpréter correctement un édificemajeur, mais qui, comme beaucoup de ceux-ci, est enréalité souvent mal connu. L’autre aspect récent àsouligner est qu’il y a de moins en moins dans le domainede l’habitat fortifié de recherches programmées de longuedurée qui sont pourtant, comme l’écrit Anne-MarieFlambard Héricher, les seules capables d’«éclairer la genèsedu château, son organisation spatiale et son mode devie177». C’est ce que démontre Philippe Racinet après dixans d’étude du château de Boves178. Ajoutons que pluslargement encore, il faut aussi insérer les châteaux dansleur espace rural comme le propose Claude Raynaud179.L’étude des sites fortifiés, avec environ 20 % des opéra-
tions de terrain et bien moins en ce qui concerne les
moyens humains et financiers car cette thématique n’estpas essentielle dans le domaine du préventif, est présenteà un niveau proportionnellement comparable parmi lesPCR où le château de pierre l’emporte très largement surles mottes et la fortification de terre, les maisons fortes etles bourgs castraux n’apparaissant pas. En revanche, lebâti fortifié, avec un tiers des ouvrages publiés, est de trèsloin le sujet le mieux représenté dans les publications,notamment de livres (fig. 17), avec encore une fois uneplace majeure pour le château de pierre.
2.5. L’étude des techniques (H 25) et de la culture maté-rielle (H 26)
Les deux thèmes H 25 (Histoire des techniques) et H 26(Culture matérielle) produisent des résultats contrastésd’une région à l’autre. L’une des données de base del’archéologie médiévale de ces vingt ou trente dernièresannées est l’ampleur croissante de la recherche sur les sitesminiers et la métallurgie, du fer et du plomb essentiel-lement. Il s’agit de l’exemple typique d’une rechercheengagée à partir des années 1970 par un tout petit nombrede spécialistes, universitaires et CNRS, en Bourgogne,dans l’Est de la France et dans les Alpes180, majoritai-rement sinon exclusivement fondée sur l’archéologieprogrammée et qui s’est progressivement étendue à unelarge partie de la France, notamment le Sud-Ouest181. EnAlsace, la recherche sur les mines et la métallurgie estparticulièrement active depuis un certain nombred’années, mais elle intéresse avant tout la fin du XVe siècleet la période qui suit jusque vers le milieu du XVIIe siècle182.Dans l’interrégion Centre-Est et à la suite des travaux deMarie-Christine Bailly-Maître, une part notable de larecherche archéologique se fait sur le secteur minier183. Larecherche sur les mines et la métallurgie est, comme lemontrent Marie-Christine Bailly-Maître et PhilippeDillmann184, un thème exemplaire qui illustre la manièredont des secteurs nouveaux de l’archéologie médiévale sesont créés récemment et travaillent. Ce type de recherche,même s’il reste très fortement impulsé par des universi-taires et des chercheurs du CNRS, réunit sur le terrain despersonnes de statuts variés et notamment des amateursbénévoles. Il ne s’est développé que grâce à des
171. Bilan CIRA Sud-Est 2009, p. 60172. FLAMBARD HÉRICHER 2000-2001, p. 435.173. ALEXANDRE-BIDON et PIPONNIER 2007, p. 175174. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 47175. FLAMBARD HÉRICHER 2000-2001, p. 279 et p. 435.176. GUYONNET 2010.177. FLAMBARD HÉRICHER 2000-2001, p. 279 et p. 435.178. RACINET 2010.179. Bilan CIRA Est 2008, p. 92.
180. Bilan scientifique Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2008, p. 109.181. Bilan CIRA Est 2008, p. 121.182. Bilan scientifique Alsace 2006, p. 157.183. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 46.184. BAILLY-MAÎTRE et DILLMANN 2010.
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
422 JEAN CHAPELOT
problématiques préalables au travail de terrain et reposantsur une bonne connaissance historique et technique et ledépouillement des sources écrites, l’étude géologique, lesprospections, l’interdisciplinarité, etc., par un recoursrationnel et développé à l’archéométrie et une activité derecherche qui veut maîtriser toute la filière, de la mine auxobjets issus des fouilles d’habitat en passant par la métal-lurgie secondaire. C’est ce qu’expose Florian Tereygeolquand il définit les orientations futures souhaitables dansle domaine de l’étude des mines et de la métallurgie185. Ilestime qu’il faut, dans le secteur des métaux non ferreux,renforcer l’interaction entre archéologie et archéométrie etdévelopper l’étude des ateliers de surface et celle, prati-quement absente, de la métallurgie secondaire enaccordant plus d’attention aux fouilles d’habitat. Dans ledomaine du ferreux, il considère qu’il faut développerl’étude du procédé indirect sur lequel rien n’est fait dansl’interrégion Est (où seul le procédé direct est étudiédepuis longtemps). La situation sur ce point est prati-quement la même dans l’ensemble de la France alors quel’apparition du procédé indirect est un changementtechnique essentiel à la fin du Moyen Âge.On remarque un peu partout le très petit nombre
d’opérations concernant les sites de productioncéramique, surtout ceux du haut Moyen Âge (fig. 18).En Alsace, par exemple, aucun site de ce genre et de cetteépoque n’a été localisé à ce jour186. En revanche, l’étudede la céramique issue des habitats a notablement progresséen France, essentiellement grâce à des thèses exploitant lesrésultats de fouilles programmées ou préventives. On peutsignaler par exemple le cas de la région PACA avec uneforte progression des connaissances sur la céramique desVIIe-Xe siècles187. Il en est de même en Bourgogne grâce auxfouilles et à l’étude de l’atelier de Sevrey (Saône-et-Loire) :cette céramique est désormais « l’un des fossiles directeursles mieux connus du haut Moyen Âge » pour les VIe-VIIe siècles dans une ample région qui va du Jura à laMéditerranée en suivant les bassins de la Saône et duRhône188.Pour les périodes plus récentes, l’étude de la
céramique, essentiellement consacrée à celle issue deshabitats, s’est bien développée même si, comme lemontrent Philippe Husi et Yves Henigfeld, il subsiste defortes inégalités d’une région à l’autre et des périodes de
transition comme les Ve-VIe et les Xe-XIe siècles, qui restentmal connues comme dans le cas de bien d’autres thèmescomme l’habitat rural ou la ville189. L’archéologie despériodes moderne et contemporaine, abordée lors ducongrès de la Société d’archéologie médiévale uniquementpar le biais de la céramique, devient progressivement etessentiellement grâce aux fouilles urbaines un secteur àpart entière de la recherche. Son apport à la connaissancede la culture matérielle est montré à partir de l’exempledes céramiques lyonnaises par Alban Horry qui expose lesproblèmes spécifiques de méthode liés notamment àl’abondance du matériel de ces époques190.Au-delà des mines, de la métallurgie et de la céramique,
de nouveaux thèmes de recherche sont apparus dans lesecteur de l’artisanat et de la production, ainsi en PACAles activités en liaison avec la forêt : pour la première foissont ainsi étudiés l’habitat temporaire, les chaufourniers,la production de poix, de cade et de chaux191. Il n’en restepas moins que dans certains secteurs géographiques,comme l’interrégion Ouest, rares sont les opérations deterrain dans le domaine de l’artisanat et de l’industrie192. Dans l’étude de la culture matérielle, un trait
marquant de ces dernières années est l’intérêt croissantpour les techniques de construction. Il en est ainsi enAlsace193 et tout spécialement dans l’interrégion Centre-Est à la suite des travaux de Nicolas Reveyron et d’IsabelleParron-Kontis en Rhône-Alpes et de Bruno Phalip enAuvergne : avec l’étude du secteur minier, 17 % des opéra-tions dans cette interrégion sont centrées sur desproblématiques technologiques ou artisanales194. Une foisde plus, nous constatons que des historiens ou historiensd’art mettent en œuvre des méthodes de travail quipouvaient paraître réservées aux seuls archéologues deterrain traditionnels et que, ce faisant, ils obtiennent etpublient d’excellents résultats qui modifient, comme nousl’avons déjà vu précédemment, la manière d’étudier lesédifices, religieux et autres.L’étude des matériaux de construction est une autre
direction de recherche qui s’est bien développée en unequinzaine d’années, comme l’exposent Stéphane Büttneret Daniel Prigent195. Elle est fondée sur une convergence
185. Bilan CIRA Est 2008, p. 121.186. Bilan scientifique Alsace 2006, p. 93.187. Bilan scientifique Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2008, p. 104.188. Bilan CIRA Est 2008, p. 95.
189. HENIGFELD et HUSI 2010.190. HORRY 2010.191. Bilan scientifique Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2008, p. 104.192. Bilan CIRA Ouest 2008, p. 111.193. Bilan scientifique Alsace 2006, p. 134.194. Bilan scientifique Rhône-Alpes 2008, p. 46.195. BÜTTNER et PRIGENT 2010.
Publications du CRAHM, 2010
423CONCLUSION
JEAN CHAPELOT424
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
À gauche, pour douze régions de la moitié nord de la France, nombre de communes dans lesquelles un ou plusieurs foursde potier ont été découverts pendant chacune des années 1973-2002 lors de 119 opérations de terrain programmées oupréventives réalisées dans 58 communes différentes.
Source : retraitement d’une partie des données de Grill 2003 qui recense les indices de production céramique médiévale(poterie, brique et tuile) découverts depuis 1970 dans les douze régions Alsace, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse et Haute-Normandie et Picardie à partir dudépouillement des Bilans scientifiques régionaux, des Annuaires des opérations de terrain du CNAU, des «Chroniques desfouilles» de la revue Archéologie médiévale et d’une manière générale de toute la documentation disponible.
À droite, nombre de notices de la «Chronique des fouilles» de la revue Archéologie médiévale consacrées de 1983à 2007 à des opérations (fouilles, prospections inventaires ou thématiques, projets collectifs de recherche) organiséesdans l’ensemble de la France et relatives aux ateliers de productions céramiques.
Source : «Chroniques des fouilles» de la revue Archéologie médiévale.
Ces deux histogrammes concernent des activités qui ne sont pas les mêmes (fouilles avec découvertes de fours d’un côté,recherches sur les ateliers de production de l’autre). ils reposent sur une documentation partiellement différente et n’intéressentpas le même espace géographique. ils montrent pourtant la même évolution : augmentation dans les décennies 1970 et 1980,avec l’essor de l’archéologie médiévale, du nombre d’opérations ou de découvertes, optimum en 1988-1992, puis chute trèsforte puisqu’en douze ou quinze ans le nombre d’opérations a été divisé par quatre…
Cette baisse, plus précoce et plus marquée ici que dans l’ensemble de l’archéologie médiévale, concerne en faitcelle-ci dans son ensemble et s’explique par des raisons multiples : diminution depuis dix ans du nombre d’opérations deterrain et des surfaces concernées, recul des fouilles programmées et des prospections inventaires ou thématiquesconsacrées à l’artisanat de la terre cuite médiévale, effacement des bénévoles qui étaient très souvent à l’œuvre sur leterrain dans l’étude des ateliers de potiers, lassitude de certains professionnels ou changement de leurs thèmes derecherche, etc. les nombreuses études pluriannuelles qui, au cours de la période 1987-1991, débutent ou se poursuiventsur les ateliers de potiers de Chartres-de-Bretagne (ille-et-Vilaine), Douai (Nord), Dourdan (Essonne), Fosses (Val-d’Oise),Ger (Manche), la Haute-Chapelle (Orne), la londe (Seine-Maritime), la Saulsotte (Aube), le Molay-littry (Calvados) etVannes (Morbihan) s’arrêtent pratiquement toutes en 1992-1993. Elles ne sont suivies, sauf exceptions, que par unnombre réduit d’opérations ponctuelles non reconduites au-delà d’une campagne.
Une telle situation est grave : le développement de l’archéologie médiévale n’est possible qu’avec une connaissancesolide des productions céramiques; celles-ci, pour certaines sous-périodes du Moyen Âge ou dans plusieurs régions,sont actuellement sous-étudiées; les ateliers de potiers sont des sites essentiels qui se caractérisent par des structuresdiffuses, souvent nombreuses et dispersées sur de grandes surfaces, mais qu’il faut localiser et identifier pour les étudieret les protéger. l’étude des ateliers de potiers médiévaux montre crûment de quelle manière, livrés au hasard desopérations préventives et faute des possibilités qu’ouvrirait une recherche programmée vigoureuse, organisée et bienfinancée, des aspects essentiels de l’archéologie médiévale ont régressé brutalement en quelques années.
Grill A.2003, «les ateliers de production céramique (iiie-xixe s.) en France : une documentation à partir des années 1970», DEA
sous la direction de Jean Chapelot, École des hautes études en sciences sociales, octobre 2003, 155 p.
Fig. 18 : un exemple d’évolution de la recherche : l’étude des ateliers de potiers médiévaux.
CONCLUSION 425
Publications du CRAHM, 2010
entre l’archéologie du bâti, une utilisation renouvelée dessources écrites et des possibilités des laboratoires aussibien dans l’analyse des matériaux que dans les techniquesde datation, l’intérêt renforcé des archéologues pour l’his-toire des techniques, par exemple la production et letravail du métal, venant renforcer ces orientationsnouvelles. Des recherches récentes sont en développementsur l’emploi du métal dans l’architecture, en Haute-Normandie196 mais aussi au château de Vincennes, auPalais des Papes d’Avignon ou ailleurs. D’autres le sontaussi sur le bois et le montage des structures charpentéesen particulier en Normandie et dans l’Ouest, en liaisonétroite avec les spécialistes de dendrochronologie197.L’histoire des techniques et l’étude de la culture
matérielle sont peut-être, avec le château de pierre, lethème qui illustre le mieux le décalage entre les moyensattribués au terrain et la nature et le nombre de publica-tions : ces deux thématiques qui constituent moins de10 % en nombre des opérations de terrain et infinimentmoins en financement car elles sont peu présentes enarchéologie préventive sont pourtant à l’origine de 20 %des PCR et d’autant de publications. Parmi les PCR et lesouvrages publiés, l’étude des techniques et de la culturematérielle sont également représentées (fig. 9) et à ellesdeux autant que des thèmes très étudiés sur le terraincomme le monde rural, la ville ou le bâti religieux et lesinhumations (fig. 17).
2.6. Le réseau des communications (H 27), les aménage-ments portuaires (H 28) et l’archéologie navale (H 29)
L’étude des épaves de rivière puis celle des aménagementsde berges se sont développées progressivement, grâce àdes fouilles programmées d’abord et plus récemment àquelques fouilles urbaines préventives pour le secondpoint. L’ampleur réelle des découvertes, en dehors decelles d’épaves, apparaît mal car une large part d’entreelles se font lors d’opérations d’archéologie préventive enville : sauf découvertes exceptionnelles comme l’exemplede Bordeaux évoqué ci-dessous, elles sont mal identi-fiables compte tenu des difficultés d’accès aux résultatsdes fouilles. Il n’en reste pas moins que ce genre d’obser-vations s’est multiplié en nombre et diversifié en natureces dernières années.Éric Rieth et Virginie Serna font le point sur les direc-
tions variées qu’il est possible désormais d’aborder, de la
batellerie intérieure aux aménagements de rivière enpassant par la Waterfront archaeology198. Se sont ainsirévélés des sujets sur lesquels on ne savait rien il y a vingtou trente ans, comme les bateaux fluviaux, en mêmetemps qu’apparaissait, selon un glissement que l’onobserve plus ou moins dans toutes les thématiques del’archéologie médiévale, la nécessité d’intégrer chaque sitedans une vision d’ensemble, ici l’hydrosystème fluvialselon le concept cher à J.-P. Bravard. Une fois de plusnous sommes en présence d’une approche novatrice,apportant à la connaissance du Moyen Âge des matériauxtotalement inédits étudiés au prisme de problématiquesutilisant la fouille comme un moyen documentaireessentiel, mais qui ne prend son sens que confronté àl’ensemble d’une documentation, ici dans les domaines del’environnement et de l’histoire régionale et commerciale.L’exemple type de telles recherches est la Charente oùplusieurs épaves des VIIe et XIe siècles ont été fouillées etpubliées récemment et qui est actuellement en Europe lefleuve ou la rivière et même plus largement le secteur oùont été identifiées le plus grand nombre d’épaves médié-vales199.Quelques grosses fouilles préventives récentes, comme
celle qui a précédé l’aménagement d’un tramway àBordeaux, ont abordé un sujet peu étudié en France alorsqu’il s’agit d’une direction de recherche très active depuislongtemps dans l’Europe slave, germanique, scandinave etanglo-saxonne : les aménagements de berge.Les trois thèmes H 27, 28 et 29 sont très peu présents
dans les PCR (fig. 9) et dans les publications (fig. 17) àcause du petit nombre de spécialistes.
Dans un contexte de décroissance du nombre d’opé-rations de terrain et des surfaces concernées, on note unebaisse ou un manque d’intérêt plus ou moins marquépour des thèmes comme les édifices ecclésiastiques, lesfouilles urbaines, l’habitat rural du bas Moyen Âge, lafortification de terre. Des thématiques se maintiennentcomme l’étude des châteaux de pierre, d’autres se relèventun peu comme l’habitat rural de la fin du haut MoyenÂge ou se développent comme les mines et la métallurgie.L’archéologie médiévale accorde une place beaucoup plusimportante à l’histoire des techniques et à l’emploi desméthodes d’analyse ou de datation en laboratoire qui ontmodifié profondément notre approche de certains sujets
196. Bilan CIRA Ouest 2008, p. 113197. Ibid., p. 114.
198. RIETH et SERNA 2010.199. Une mise au point paraîtra prochainement dans le bilan
décennal de Poitou-Charentes (CHAPELOT à paraître b).
JEAN CHAPELOT426
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
comme les inhumations et l’étude de tous les bâtis. Demême, elle cherche à insérer les sites ou le bâti qu’elleétudie dans un environnement large, avec une attentionsoutenue pour l’étude des milieux.La mutation intellectuelle de l’archéologie médiévale
a été forte en dix ou vingt ans, et pour des raisonsmultiples. La plus visible, celle qui est le plus souventmise en avant, est l’essor de l’archéologie préventive. Enfait, plus qu’une augmentation du nombre d’opérationsde terrain, qui ne sont pas considérablement plusnombreuses aujourd’hui qu’il y a vingt ans, ce quel’archéologie préventive a apporté de plus important estla croissance de surface d’une part de ces opérations,l’importance des financements qui peuvent être mobilisés,la possibilité de mettre en œuvre des équipes diversifiéesde spécialistes, la plus grande qualité des pratiques deterrain, etc. L’archéologie préventive a aussi mis à dispo-sition des chercheurs une masse d’information, artefactsou observations variées, qui alimentent une part impor-tante de la recherche.Mais ce qui a été le plus essentiel dans la mutation de
l’archéologie médiévale, même si cela est moins visibleque l’essor de l’archéologie préventive, c’est la réflexion etle travail des chercheurs, ce qui est après tout normal dansune discipline scientifique. Il n’y a pas, faut-il le rappeler,de progrès de la recherche sans réflexion méthodologiqueet circulation rapide des résultats et cela ne peut se fairequ’à partir de publications et notamment de thèses dontla place dans l’évolution intellectuelle de l’archéologiemédiévale a été importante et doit être soulignée.Un autre point important à porter au crédit de
l’archéologie médiévale de ces dernières années est d’avoir,par ses publications, attiré l’attention de chercheursd’autres disciplines. L’une des tendances les plus remar-quables de ces dernières années est l’appel auxarchéologues dans des congrès et colloques, séminairesou manifestations scientifiques variées organisés par deshistoriens ou d’autres scientifiques : la vision archéolo-gique de thèmes, classiques ou non, de la recherchehistorique traditionnelle est sollicitée et écoutée. Mais enretour, il est évident aussi que certains travaux d’historienssont devenus les bases incontournables de problématiquesarchéologiques.Cette maturité intellectuelle de l’archéologie médiévale
a une autre conséquence : l’appropriation de ses méthodeset de ses pratiques d’étude des témoignages matériels, lebâti en particulier, par des chercheurs qui étaient restésjusqu’à une date récente étrangers à l’archéologie commeles historiens de l’architecture ou les historiens d’art.
L’intérêt pour l’archéologie médiévale et ses résultatsdépasse désormais le milieu des historiens et historiensd’art et de l’architecture : il a atteint des mondes biendifférents comme ceux des spécialistes de la biodiversité,de la climatologie ou des hydrosystèmes. L’archéologiemédiévale, comme mode d’acquisition et de validationde données scientifiques, a atteint sa majorité et sonautonomie intellectuelle. La question est désormais desavoir comment cette situation nouvelle peut être encou-ragée et renforcée.
3. Changer d’époque : les responsabilités des adminis-trations de tutelle et de la communauté scientifique
L’archéologie est à la croisée des chemins en France :après une phase de fort développement plus ou moinsbien maîtrisé, elle est dans une situation qui exige uneréflexion collective et l’achèvement d’un processus deréforme engagé en 2000, mais qui n’a pas été achevé. Lacogestion de fait depuis une dizaine d’années de l’archéo-logie préventive par certains archéologues et lesadministrations de tutelle a conduit à un consensus decirconstance et fait oublier un principe de base : dans ledomaine de la recherche, partout et toujours, il fautallier le pessimisme de l’intelligence, la vision critiquequi doit être celle des intellectuels, et l’optimisme etl’esprit d’anticipation qui doivent caractériser lesadministrations de tutelle.L’examen du projet de loi sur l’archéologie
préventive en 2000 marque symboliquement unchangement d’époque : pour la première fois, la repré-sentation nationale se penchait sur la situation del’archéologie. Celle-ci est désormais au cœur d’enjeuxculturels, scientifiques, politiques, financiers, d’amé-nagement du territoire, etc., comme elle ne l’a jamaisété. Elle est entrée dans le champ du politique, elle yrestera et il est positif qu’il en soit ainsi. Ce contextenouveau met les archéologues dans une situationoriginale. Les problèmes de l’archéologie préventive ontpendant deux ou trois décennies mobilisé l’attentionet les énergies d’une bonne part des archéologues audétriment d’une réflexion sur la nature de la discipline,ses conditions d’exercice, le contenu de la formationde ses chercheurs. Mais désormais l’archéologiepréventive n’est plus au centre des préoccupations desarchéologues, médiévistes et autres : il est donc possiblede parler de recherche, de faire un état des problèmeset de proposer des solutions.
CONCLUSION 427
Publications du CRAHM, 2010
3.1. Les responsabilités des administrations de tutelle
Achever la réforme amorcée en 2000
La loi sur l’archéologie préventive a été élaborée en 2000dans l’urgence et l’improvisation et avec un seul objectif :régler au plus vite la situation très menacée de l’AFAN etl’avenir de son personnel. L’un des meilleurs spécialistesdu secteur du patrimoine, le sénateur Yann Gaillard, apu écrire à ce propos
qu’une «erreur stratégique» avait sans douteété commise en 2001 lors de la création del’INRAP, compendium du système françaiscomprenant une mésentente entre minis-tères, des incompétences administratives, desimpôts complexes, des contestations des col-lectivités territoriales et une révolte des per-sonnels compétents200.
Les médiocres conditions du débat parlementaire en 2000ont eu au moins deux conséquences graves.La première est une introduction très limitée de préoc-
cupations de protection du patrimoine archéologique. Ila fallu l’amendement d’un député huit mois après lepassage en première lecture du projet de loi devant lesdéputés pour que soient introduites le 5 octobre 2000,lors d’un passage devant les sénateurs, des mesures deprotection des vestiges archéologiques immobiliers. Maisce même jour, le secrétaire d’État au patrimoine et à ladécentralisation culturelle, rejetant des amendementsvisant à assurer la conservation de sites d’intérêt excep-tionnel en en empêchant la fouille préventive, a déclaréque leur adoption serait «préjudiciable au service publicque nous créons » ou se ferait « au détriment de sonéquilibre financier201». Renvoyé à un futur projet de loijamais élaboré depuis, le dispositif de protection du patri-moine archéologique reste incomplet. Or, comme on peutle lire dans l’un des bilans de CIRA et comme c’est uneévidence pour tous les archéologues, la meilleure archéo-logie préventive est celle qui évite la fouille202.La seconde conséquence des conditions du travail
parlementaire en 2000 est l’exclusion de l’archéologie dubâti du champ d’application de la loi sur l’archéologiepréventive. Lors du débat, le problème a été abordé, maisdans l’urgence et l’improvisation toute solution a été
écartée. La conséquence, abondamment et régulièrementrelevée depuis par de nombreux spécialistes, est quel’étude du bâti, notamment dans le cadre de la réhabili-tation urbaine, est très difficile à mettre en œuvre fauted’un cadre législatif et d’un financement203. L’archéologiedes périodes médiévale et moderne, plus que celle detoutes les périodes antérieures, est victime de cettesituation qui exclut de fait de son champ d’interventionune documentation importante qui est par ailleursdétruite massivement chaque année.Plus largement, d’autres points, qui n’ont pas été
évoqués ou vus en 2000, imposent une réflexion et unemodernisation législative et règlementaire. La mise enplace de l’INRAP a été imaginée en 2000-2001 par sespromoteurs comme une fin de l’histoire : la création d’unestructure unique, regroupant à terme tous les archéo-logues. Cette vision a eu pour conséquence de bloquer,lors du débat parlementaire et depuis, toute réflexion surles relations entre l’INRAP et les autres intervenants, qu’ils’agisse des universités, du CNRS, des services archéolo-giques de collectivités et surtout des Services régionaux del’archéologie. La situation a évolué et l’utopie totalitaired’un Centre national de la recherche archéologiqueréunissant tous les archéologues français s’est dissoute,mais l’absence de cette réflexion initiale reste unhandicap : depuis 2001, les seuls éléments nouveaux ontété quelques décrets permettant de fixer la participationde l’INRAP aux CIRA et modernisant les modalités defonctionnement de celles-ci et du CNRA.En fait, le système archéologique n’est pas stabilisé et
il est loin d’être au mieux de ses possibilités. Il est néces-saire de réfléchir à la manière dont la communautéscientifique doit fonctionner, s’interroger sur une situationqui se caractérise par un surencadrement des activités deterrain et une sous-administration de la recherche. Plusgénéralement, il faut admettre que le système de gestionde l’archéologie, qui remonte pour l’essentiel aux années1990, n’est plus adapté, en particulier au développementde la recherche et à la multiplicité des formes de celle-ci.Ce système a été conçu avant tout pour permettre lecontrôle et l’évaluation des activités de terrain. Commecelles-ci sont pour l’essentiel la conséquence d’unedemande sociale solvable qui vient des aménageurs, il est
200. Rapport d’information 2005, p. 44.201. CHAPELOT 2000.202. Bilan CIRA Sud-Est 2009, p. 16.
203. Le CNRA s’est ému deux fois de cette situation. Dans sonavis n° 21 du 6 janvier 2003, il a demandé que la révision de la loi surl’archéologie préventive soit l’occasion de combler cette lacune puis ila réitéré cette demande dans son avis n° 2 de janvier 2006 (Avis duCNRA).
JEAN CHAPELOT428
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
peut-être envisageable de programmer partiellement letravail de terrain, mais il est impossible par principe dedynamiser et de piloter la recherche. Le suivi des seulesopérations de terrain demande des moyens humains queles CIRA, comme elles l’expriment toutes et très biendans leurs bilans récents, ne possèdent pas et un travaildans la durée qu’elles ne peuvent envisager204.Nous sommes arrivés, avec le développement de
l’archéologie et sa maturité intellectuelle, dans unesituation où il faut distinguer deux problèmes différents :le contrôle du travail de terrain, qui est et doit rester sousla responsabilité du ministère de la Culture et de laCommunication; la définition et la dynamisation d’unepolitique de recherche dans le secteur de l’archéologie,qui est une autre question.
Se donner les moyens d’un pilotage, d’un financement etd’une évaluation de la recherche archéologique
Pour accéder au statut de discipline scientifique à partentière, l’archéologie doit être conduite et évaluée dansson ensemble, du terrain aux résultats, et selon les procé-dures habituelles dans les autres aspects de la recherche.Le ministère de la Culture et de la Communication a eu,ces dernières années, le grand mérite d’engager unepolitique que l’on peut critiquer, mais qui a permis derégler le problème récurrent de l’archéologie préventive.Il serait souhaitable que le ministère de tutelle de laRecherche et de l’Enseignement supérieur joue enfin lerôle qui doit être le sien : dynamiser un secteur importantde la recherche en sciences humaines et sociales.La formation est le premier point auquel il faut
réfléchir. La diversification du métier d’archéologue a faitnaître des filières de formations différentes. La créationrécente de masters professionnels, fondée sur des espoirsde développement de l’archéologie préventive, était indis-pensable pour former les techniciens de terrain dontcelle-ci a besoin. Mais, à cause de la pénurie des moyenshumains disponibles et d’a priori en partie idéologiqueset conjoncturels, cela s’est fait, sauf dans quelques univer-sités, au détriment de la formation des chercheurs dans lesfilières traditionnelles qui conduisent au doctorat. Ce quiest en jeu est notamment la spécificité de la formation desfuturs archéologues médiévistes qui doivent avoir unebonne formation historique.Un autre aspect est la gestion des carrières des
personnels en poste, notamment ceux qui travaillent dans
le domaine de l’archéologie préventive. Certains, qui sontà mi-chemin de leur carrière, sont porteurs d’uneexpérience professionnelle, de pratiques de terrain et deconnaissances qui, pour des raisons diverses, n’ont pastrouvé la place qu’elles méritent dans les publications etl’enseignement universitaire. De tels sujets, portés parcertains de ceux qui les ont développés dans les dix ouquinze dernières années, doivent entrer dans l’ensei-gnement universitaire, ce qui exige des mobilités decarrières qui, au-delà des pétitions de principe205, n’ontjamais été sérieusement mises en œuvre. Au printemps2000, au début du débat parlementaire sur l’archéologiepréventive, le ministère de la Recherche et de l’Ensei-gnement supérieur s’était engagé à créer enaccompagnement vingt emplois de maîtres de conférencesd’archéologie de la France métropolitaine : il n’est pastrop tard pour tenir cette promesse.Une autre priorité est de créer des emplois de
chercheurs. L’INRAP, ces dernières années, a privilégié lerecrutement de techniciens et d’agents assurant lesfonctions supports, au détriment de l’encadrement scien-tifique et technique, c’est-à-dire les responsablesd’opération et les spécialistes qui en 2008 constituentrespectivement 39 % et 6 % de son personnel206. Dans lesuniversités et au CNRS, il faut développer des théma-tiques prometteuses et renforcer les équipes dynamiques.Il appartient aux ministères de tutelle de l’INRAP et desétablissements publics de recherche de prendre leursresponsabilités et de définir, en concertation avec le milieuscientifique, une politique de recrutement.Il est indispensable parallèlement de structurer la
recherche archéologique, comme le reste de la recherche,autour de pôles universitaires. La seule politique affichéedepuis 2000 est le renforcement de certaines UMR et leregroupement en leur sein des archéologues d’une région,quels que soient leurs statuts. Une telle politique est satis-faisante dans le principe, elle permet de mutualisercertains moyens et de favoriser les échanges intellectuels,mais ne peut développer la recherche : en archéologiecomme ailleurs, cela ne peut venir que de formationsspécialisées assurées d’une certaine stabilité dans le temps,travaillant sur des thèmes définis et s’appuyant sur unenseignement universitaire. Les succès de l’archéologiemédiévale autour de certains thèmes évoqués plus hautn’ont comme seule explication que l’activité de quelques
204. Bilan CIRA Est 2008, p. 129-130.205. Avis n° 18 du 23 octobre 2003 du CNRA (Avis du CNRA).206. Rapport d’activités 2008, p. 80.
CONCLUSION 429
Publications du CRAHM, 2010
universitaires et chercheurs du CNRS ayant constitué detelles équipes.Enfin, il faut affirmer avec force que pour conduire
une politique de recherche, il faut des moyens financiers.Les procédures actuelles, par exemple les PCR, nepermettent pas de mobiliser les moyens nécessaires pourfinancer les indispensables fouilles programmées.La situation actuelle est particulièrement favorable
pour mettre en place une telle politique. Depuis lacréation de l’INRAP en 2002, la faiblesse de la redevanced’archéologie préventive a fait que chaque année leministère de la Culture et de la Communication a dû luiaccorder une forte subvention : 65 millions d’euros pourles cinq années 2004-2008, dont une part pour financerses activités de recherche207. Le relèvement le 29 janvier2009 du taux de la redevance d’archéologie préventive etl’attribution à l’INRAP peu après et au titre du plan derelance de vingt millions d’euros devraient sortir cetinstitut de son déficit structurel et permettre au ministèrede la Culture et de la Communication de redéployer sescrédits.Une occasion unique est ainsi ouverte : permettre,
avec une intervention financière complémentaire duministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur,qui s’est tenu jusqu’à ce jour à l’écart du financement del’INRAP et plus largement de la recherche archéologique,de mettre en place une politique de développement. Celasuppose la mobilisation de moyens financiers ouverts àtous et dispensés par les instances normales de finan-cement de la recherche, c’est-à-dire l’Agence nationale dela recherche (ANR), le CNRS et les universités, avec enparallèle une politique volontariste de recrutement dechercheurs et l’élaboration d’une politique de rechercheet d’évaluation des résultats.
3.2. Les responsabilités de la communauté scientifique
La communauté des archéologues médiévistes a desobligations qui doivent venir en complément de ce quel’on est en droit d’attendre des administrations de tutelle.
L’enseignement universitaire
La première des obligations de la communauté scienti-fique, d’autant plus urgente que les maquettes
d’enseignement doivent être revues, est de faire des choixrationnels et cohérents entre la formation de technicienspar le biais de masters professionnels et celle de chercheurspar celui du doctorat. Dans tous les cas, il faut aussi sedonner les moyens de dispenser aux futurs archéologuesmédiévistes une culture historique. Beaucoup de membresde CIRA, parmi d’autres observateurs, soulignentl’absence d’étude d’archives dans les rapports208.Ce problème est réel mais plus largement, c’est bienl’absence d’une culture historique qui est la plus frappanteà la lecture de certains rapports, d’ouvrages ou d’articlesconsacrés à l’archéologie médiévale.La deuxième obligation du milieu est de faire en sorte
que pénètrent dans l’enseignement universitaire desthématiques qui n’y ont actuellement pas leur place ouoccupent une place marginale. L’enseignement universi-taire doit être en relation avec ce qui se pratique sur leterrain, ce qui veut dire qu’il faut notamment recruterdes spécialistes qui ont fouillé et fouillé récemment.
Réfléchir sur la discipline, son mode de fonctionnement etsa nature
La principale priorité de la communauté des archéologuesmédiévistes doit être de s’interroger sur sa discipline, sonmode de fonctionnement, sa définition et son position-nement intellectuel, par rapport à l’histoire mais pasuniquement par rapport à celle-ci209.L’un des traits caractéristiques actuels de l’archéo-
logie, médiévale ou autre, est qu’elle ne fonctionneguère dans son ensemble comme une discipline scien-tifique. L’appréciation de la qualité d’un archéologue sefait de plus en plus selon des critères étrangers à ceuxqui ont cours dans un milieu scientifique classique.Dans le domaine de la recherche historique, les réputa-tions se forment sur des publications accessibles àchacun. Dans le secteur de l’archéologie, médiévale etautres, les publications sont rares et les réputations seforment à partir d’éléments comme l’importance deschantiers conduits et leur couverture par les médias, cequi n’a qu’un rapport lointain avec la qualité du travailscientifique.
207. Rapport d’activités INRAP 2004, p. 37 et 39; Rapport d’acti-vités INRAP 2005, p. 37 et 39; Rapport d’activités INRAP 2006, p. 36et 39; Rapport d’activités INRAP 2007, p. 40, 41 et 43; Rapport d’acti-vités INRAP 2008, p. 76 et 79.
208. Bilan CIRA Est 2008, p. 69, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 81, àpropos des rapports examinés ; cf. aussi Ibid., p. 99, l’opinion dePhilippe Racinet. Cf. aussi La recherche archéologique en Picardie 2005,p. 237. Il serait possible de multiplier ce type de remarques.
209. CHAPELOT 2005; CARTRON et BOURGEOIS 2008.
JEAN CHAPELOT430
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
Le problème des relations entre la recherche etl’archéologie préventive est une question centrale. ClaudeRaynaud écrit à ce propos que :
Malgré de brillantes exceptions […], une largepart des données de terrain restent confinéesdans une approche archéographique qui nepermet pas de les insérer dans une perspectivehistorique», ajoutant qu’il existe désormais«un divorce, en France, entre une archéologiede sauvetage aux puissants moyens maisdémunie en regard de l’analyse et de la publi-cation des résultats, et une recherche institu-tionnelle évanescente dans de larges régions210.
Cette seconde archéologie est pratiquée pour l’essentielpar des chercheurs de l’université et du CNRS et ellerepose, pour une part, sur le traitement de données venantde l’archéologie préventive. L’un des enjeux essentiels de cesprochaines années est de faire en sorte que ces deux archéo-logies travaillent ensemble et échangent leurs expériences,leurs connaissances et surtout leur personnel. Il ne semblepas que l’on prenne un tel chemin. Placée dans un contextetrès particulier, avec des contraintes de coût et surtout decalendrier, l’archéologie préventive devient de plus en plusune activité normée, standardisée et techniciste211. Unebonne fouille préventive est une opération faite dans lesdélais, avec un coût maîtrisé et conduite par des archéo-logues polyvalents, selon l’expression de Jean-PaulDemoule, c’est-à-dire des techniciens adaptables auxpriorités de leur employeur plutôt que des spécialistes d’unterrain, d’un problème ou d’une période212.Si nous n’y prenons garde, un grave problème va
apparaître très vite et dans le secteur de l’archéologiemédiévale plus qu’ailleurs : une fracture entre deux sortesd’archéologie. Dans les conclusions du bilan de larecherche archéologique en Picardie, une bonne analysedu problème est donnée :
Isoler l’archéologie préventive de ses parte-naires naturels, qu’ils soient universitaires,chercheurs au CNRS ou dans d’autres labora-toires notamment environnementalistes, nepeut que paupériser les problématiques ou, dumoins, s’expose à cantonner celles-ci à desprocédures répétitives, des interprétations sté-réotypées répercutant seulement une succes-sion d’inventaires de structures déjà connuespar des modèles anciens dépourvus d’argu-mentaires critiques susceptibles de réactualiserles problématiques de recherche213.
Deux archéologies sont en train de se constituer. L’une vasur le terrain pour chercher les réponses à un problèmedéfini auparavant : dans ce cas, le rapport aux sourcesécrites ne pose pas de problème particulier puisqu’elles ontété exploitées et analysées en amont du passage au terrainqui crée tout naturellement les conditions d’un retourdialectique vers la documentation et les problématiquesantérieurement réunies ou élaborées. L’autre démarchearchéologique est centrée sur la fouille d’un site et sapréoccupation la plus courante n’est pas d’insérer celle-cidans un état de la question et une problématique avantd’ouvrir le chantier : c’est le plus souvent après le travailde terrain que l’on recherche les éventuelles sources écritesqui documentent le site.Ce sont deux démarches différentes dont l’une ne
peut, surtout dans le cas de l’archéologie médiévale, queconduire à une impasse et creuser un peu plus un fosséentre d’un côté des «historiens» et de l’autre des «archéo-logues», les premiers vus comme des «bourgeois» et lesseconds se voyant comme des «pousseurs de brouettes».Dans un article récent, Isabelle Cartron et Luc Bourgeoisévoquent ce risque dont le développement aurait de gravesconséquences pour la discipline214.Seule une formation historique de tous les futurs
archéologues médiévistes, une gestion fluide des carrières,la crédibilité d’un enseignement universitaire suffi-samment ouvert sur les pratiques et les thématiquesactuelles du terrain peuvent permettre d’éviter ce genre decrispation : il est inutile de dire qu’il s’agit d’une prioritépour l’archéologie médiévale.
210. Bilan CIRA Est 2008, p. 98.211. Ibid., p. 97, où Claude Raynaud parle de la «dérive techni-
cienne dont on voit les premiers effets dans la difficulté croissante àsituer les résultats de fouille dans un contexte historique».
212. Dans Le Monde du 11 septembre 2002, Jean-Paul Demoule,alors président de l’INRAP, exposait ce que devait être selon lui laformation universitaire des futurs archéologues : «Il faut aussi que lesétudiants soient rompus à l’archéologie préventive sous toutes sesformes, qu’ils sachent comment préparer un dossier, commenttravailler dans l’urgence, comment diriger une fouille sur un sitelacustre, dans une carrière, dans un site urbain, dans une grotte… Enbref, qu’ils soient polyvalents».
213. La recherche archéologique en Picardie 2005, p. 237.214. CARTRON et BOURGEOIS 2008, p. 137-141.
CONCLUSION 431
Publications du CRAHM, 2010
Conclusion
L’une des grandes réussites de l’archéologie médiévaledans les vingt dernières années est d’avoir ouvert deschamps de recherche nouveaux, d’aborder des questionsvariées qui sont des sources inattendues et de plus en plusessentielles pour la connaissance du Moyen Âge. Dansces conditions, les chercheurs spécialisés se doivent dedéfinir des problématiques de recherche sur telle ou tellequestion en incluant la fouille parmi d’autres techniquesd’acquisition d’information : la fouille n’est pas une fin enelle-même, mais un moyen de connaissance parmid’autres.La programmation de la recherche archéologique
médiévale (qui est autre chose que celle des opérations deterrain) est d’autant plus nécessaire que la plupart desgrandes questions en suspens actuellement ne peuvent,comme nous l’avons vu, trouver une réponse dans lesseules pratiques de terrain : il faut, grâce à une stratégiede recherche déterminée à partir d’un état des questions,utiliser les sources écrites, la prospection, l’étude du bâti,les analyses en laboratoire, les techniques de datation, etc.Ce mode de cheminement de la recherche est classique
dans le domaine scientifique, mais il prend dans le cas del’archéologie du Moyen Âge des formes extrêmes.Contrairement aux périodes antérieures, le Moyen Âge estriche de textes, mais aussi de vestiges matériels impor-tants tels que le bâti, et l’étude de cette période n’est pasle fait des seuls archéologues. Nous ne sommes pas dansla situation des protohistoriens qui peuvent se permettred’étudier leur période à partir de la seule approche archéo-logique : quand nous abordons le Moyen Âge, surn’importe quel sujet, il y a toujours d’autres chercheursque les archéologues qui ont déjà écrit ou qui écriront etavec lesquels nous devons dialoguer.L’archéologie médiévale n’est pas et ne peut pas être
une discipline autonome. Il ne faut pas faire d’unesituation de croissance qui a permis en quelques annéesdes créations d’emplois et la mobilisation de crédits en trèsforte augmentation les fondements d’un champ discipli-naire nouveau. Il était nécessaire que l’archéologie passepar une phase d’expansion et de redéfinition de sespratiques, mais cela ne doit pas conduire à faire de cetteévolution une fin en elle-même.
Il faut réfléchir à ce qu’est notre discipline. L’archéo-logie médiévale est un mode d’étude des vestiges matériels,enfouis ou non, qui subsistent avec pour objectif lacompréhension de certains aspects de l’histoire de cettepériode215. Les trois aspects de cette définition sont impor-tants : l’archéologue n’est pas le seul à étudier les vestigesmatériels, les historiens d’art, parmi d’autres, font la mêmechose que lui ; la fouille n’est pas la seule techniqued’acquisition documentaire des archéologues, par exempledans le cas de l’étude du bâti ; l’objectif de l’archéologieest d’écrire l’histoire, ce qui implique quelques obliga-tions intellectuelles. Elle n’est pas non plus une illustrationd’un discours traditionnel d’historien ou un palliatif :cette vision de l’archéologie médiévale a longtemps été lefait d’un certain nombre d’historiens et il est étonnant dela retrouver dans un récent guide des méthodes del’archéologie qui, il est vrai, donne une vision très datéede la discipline216.La question qui se pose actuellement, autant aux
archéologues qu’aux historiens, est de savoir si l’archéo-logie médiévale est soluble dans l’histoire217. S’interroger,comme ce fut souvent le cas dans les années passées, surl’utilisation des sources écrites par les archéologues n’aguère d’intérêt : pour répondre aux obligations quidécoulent de la nature de la discipline et des modalités demise en place de programmes de recherche, un archéo-logue médiéviste doit avoir une formation d’historien,donc être capable de lire et d’utiliser les textes, maissurtout et plus largement d’inscrire les résultats de sesfouilles dans une démarche historique.L’archéologie médiévale a changé d’époque et il nous
faut maîtriser ce changement. Les questions exposées ci-dessus et qui sont les signes de ce changement profondsont en train de venir au centre des préoccupations desarchéologues médiévistes. Le congrès que la Sociétéd’archéologie médiévale a organisé en 2006 a été l’un despremiers signes de cette mutation qui doit être assuméeet discutée par la communauté scientifique et les autoritésde tutelle.
215. CHAPELOT 2005.216. DEMOULE et al. 2002, p. 198, sous la plume de Jean-Paul
Demoule qui donne comme objectif à l’archéologie des périodes histo-riques de fournir des informations sur des sujets, comme la viequotidienne, sur lesquels les sources écrites nous donneraient peu dechoses.
217. CHAPELOT 2005, p. 144.
JEAN CHAPELOT432
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
ALEXANDRE-BIDON D. et PIPONNIER F.2000-2001, «Chroniques des fouilles médiévales en France en1999. I - Constructions et habitats civils – Environnementrural et urbain», Archéologie médiévale, 30-31, p. 205-206.
2005, «Chroniques des fouilles médiévales en France en 2004.I - Constructions et habitats civils – Environnement ruralet urbain», Archéologie médiévale, 35, p. 181.
2006, «Chroniques des fouilles médiévales en France en 2005.I - Constructions et habitats civils – Environnement ruralet urbain», Archéologie médiévale, 36, p. 247.
2007, «Chroniques des fouilles médiévales en France en 2006.I - Constructions et habitats civils – Environnement ruralet urbain», Archéologie médiévale, 37, p. 175.
2008, «Chroniques des fouilles médiévales en France en 2007.I - Constructions et habitats civils – Environnement ruralet urbain», Archéologie médiévale, 38, p. 165.
Avis du CNRAAvis du Conseil national de la recherche archéologique depuis1999, http://www.archeologie.culture.gouv.fr
BAILLY-MAÎTRE M.-C. et DILLMANN P.2010, «Mines et métallurgies au Moyen Âge. Évolution d’unediscipline», dans CHAPELOT 2010, p. 227-237.
BAUDRY-PARTHENAY M.-P., BOLLE A., BOURGEOIS L.,FAUCHERRE N., RÉMY C. et VIVIER D.
à paraître, «Naissance, évolution et fonctions du châteaumédiéval (programme 24)», dans le Bilan décennal des opéra-tions d’archéologie médiévale en Poitou-Charentes(1995-2005), 18 p.
Bilan CIRA Est2008, Commissions interrégionales de la recherche archéologique. Bilandu mandat 2003-2006. -t. I : Interrégion Est. Alsace, Bourgogne,Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Ministère de laculture et de la communication, Direction de l’architecture etdu patrimoine, Sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie,de l’inventaire et du système d’information, 2008, 227 p.,http://www.archeologie.culture.gouv.fr
Bilan CIRA Ouest2008, Commissions interrégionales de la recherche archéologique. Bilandu mandat 2003-2006. -t. 2 : Interrégion Ouest. Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Ministère de la
culture et de la communication, Direction de l’architecture etdu patrimoine, Sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie,de l’inventaire et du système d’information, 216 p.,http://www.archeologie.culture.gouv.fr
Bilan CIRA Sud-Est2009, Commissions interrégionales de la recherche archéologique.Bilan du mandat 2003-2006. -t. 3 : Interrégion Sud-Est. Corse,Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d’Azur,Ministèrede la culture et de la communication, Direction de l’archi-tecture et du patrimoine, Sous-direction de l’archéologie, del’ethnologie, de l’inventaire et du système d’information,146 p., http://www.archeologie.culture.gouv.fr
Bilan des six premières années de l’INRAP 2008, 2002-2007 : bilan des six premières années de l’INRAP,INRAP, janvier 2008, 15 p., http://www.inrap.fr/userdata/c_bloc_file/5/5748/5910_fichier_Dossier_de_presse_bilan.pdf
Bilan scientifique Alsace2006, Direction régionale des affaires culturelles Alsace. Servicerégional de l’archéologie, Bilan scientifique Hors série 2/2,Périodes historiques, Ministère de la culture et de la commu-nication, Direction de l’architecture et du patrimoine,sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie, de l’inven-taire et du système d’information, 229 p.
Bilan scientifique Provence-Alpes-Côte-d’Azur2008, Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Service régional de l’archéologie. Bilan scientifiqueHors série, Ministère de la culture et de la communication,Direction de l’architecture et du patrimoine, sous-directionde l’archéologie, de l’ethnologie, de l’inventaire et dusystème d’information, Mission archéologie, 313 p.
Bilan scientifique Rhône-Alpes2008, Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes.Service régional de l’archéologie, Bilan scientifique 2006-2,Ministère de la Culture et de la Communication, Directionde l’architecture et du patrimoine, sous-direction del’archéologie, de l’ethnologie, de l’inventaire et du systèmed’information, mission archéologique, 2 vol., t. 2 : Bilanquadriennal de la CIRA (2003-2006), Programmation scien-tifique interrégionale - Antiquité, 174 p.
BIBLIOGRAPHIE
CONCLUSION 433
Publications du CRAHM, 2010
BURNOUF J., BECK C., GUIZARD-DUCHAMP F., BAILLY-MAÎTRE
M.-C., DUCEPPE-LAMARRE F., DURAND A. et PUIG C.2008, «Sociétés, milieux, ressources : un nouveau paradigmepour les médiévistes», dans Être historien du Moyen Âge auXXIe siècle, XXXVIIIe Congrès de la Société des historiensmédiévistes de l’enseignement public, Cergy-Pontoise, Évry,Marne-la-Vallée, Saint-Quentin-en-Yvelines, 31 mai-3 juin2007, Paris, Publications de la Sorbonne, 306 p. (Collection«Histoire ancienne et médiévale»), p. 95 et ss.
BÜTTNER S. et PRIGENT D.2010, «Les matériaux de construction dans le bâtimentmédiéval», dans CHAPELOT 2010, p. 179-194.
CARTRON I. et BOURGEOIS L.2008, «Archéologie et Histoire du Moyen Âge en France : dudialogue entre disciplines aux pratiques universitaires», dansÊtre historien du Moyen Âge au XXIe siècle, actes duXXXVIIIe congrès de la Société des historiens médiévistesde l’enseignement public, juin 2007, Paris, Publications dela Sorbonne, 306 p. (Collection «Histoire ancienne etmédiévale»), p. 133 et ss.
CHAPELOT J.1993, «L’habitat rural : organisation et nature», dans L’Île-de-France, de Clovis à Hugues Capet, du Ve siècle au Xe siècle,catalogue d’exposition, musée archéologique de Guiry-en-Vexin, Guiry-en-Vexin, janvier 1993, p. 178-199.
2000, «Un projet porteur de conflits », Le Figaro, mercredi20 décembre 2000, p. 16.
2001a, «Archéologie (politique de l’) », dans WARESQUIEL E. DE(dir.), Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis1959, Paris, Larousse et CNRS éditions, p. 23-25.
2001b, «Association pour les fouilles archéologiques nationales(AFAN)», dans WARESQUIEL E. DE (dir.), Dictionnaire despolitiques culturelles de la France depuis 1959, Paris, Larousseet CNRS éditions, p. 55-56.
2005, «Quelques aspects de la production céramique à lalumière des sources écrites ou comment pratiquer l’archéo-logie médiévale », Archéologie médiévale, 35, p. 141-173.
à paraître (a), «L’habitat rural du haut Moyen Âge dans lamoitié nord de la France. Quelques réflexions sur ce quenous en fait connaître l’archéologie », dans Autour du«village». Établissements humains, finages et communautésrurales entre Seine et Rhin (IVe-XIIIe siècles), Hommage auProfesseur René Noël, Université de Louvain-la-Neuve, actesdu colloque de mai 2003.
à paraître (b), «Programmes H 27 (Voies de communication),H 28 (Aménagements portuaires), H 29», dans le Bilan
décennal des opérations d’archéologie médiévale en Poitou-Charentes (1995-2005), à paraître, 48 p.
CHAPELOT J. (éd.)2010, Trente ans d’archéologie médiévale en France. Un bilanpour un avenir, actes du IXe congrès international de laSociété d’archéologie médiévale (Vincennes, 16-18 juin2006), Caen, Publications du CRAHM.
CHAPELOT J. et GENTILI F.2010, «Trente ans d’archéologie médiévale en France», dansCHAPELOT 2010, p. 3-24.
CHAPELOT J. et RIETH A.-S. collaboratrice2006a, Annuaire des archéologues médiévistes professionnels ourattachés à une formation de recherche et étudiant la Francependant les années 2002-2005, Société d’archéologiemédiévale, Caen, juin 2006, XX-248 p.
2006b, L’archéologie médiévale en France. Histoire de l’ensei-gnement dans les universités et les grands établissements. Étatdes thèses inscrites et soutenues de 1980 à 2005, Caen, Sociétéd’archéologie médiévale, juin 2006, XIX-72 p.
CLAVEL B. et YVINEC J.-H.2010, «L’archéozoologie du Moyen Âge au début de la périodemoderne dans la moitié nord de la France», dans CHAPELOT2010, p. 71-87.
CONTE P., FAU L. et HAUTEFEUILLE F.2010, «L’habitat dispersé dans le sud-ouest de la France médiévale(Xe-XVIIe siècles)», dans CHAPELOT 2010, p. 163-178.
DEMOULE J.-P., GILIGNY F., LEHÖERFF A. et SCHNAPP A.2002, Guide des méthodes de l’archéologie, Paris, La Découverte,293 p. (Guides repères).
DURAND A.2010, «L’émergence d’outils empruntés aux sciences biolo-giques végétales en archéologie médiévale en France», dansCHAPELOT 2010, p. 25-38.
DUVAL A.2004, Étude de la situation et du statut des collections archéologiquesappartenant à l’État, à l’attention de Mme la Directrice des Muséesde France et de M. le Directeur de l’Architecture et du Patrimoine,janvier 2004, 137 p., http://www.dmf.culture.gouv.fr/documents/Rapport_sur_les_collections_archeologiques.pdf
JEAN CHAPELOT434
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
Enquête sur les revues d’archéologie2007, Enquête sur les revues d’archéologie du territoire national,Comité des publications et de la diffusion de la recherchearchéologique (CPDRA), Direction de l’architecture et dupatrimoine (IGAPA ; SDArchetis), août 2007, 179 p.,http://www.archeologie.culture.gouv.fr
FAU L. (dir.)2006, Les Monts d’Aubrac au Moyen Âge. Genèse d’un mondeagropastoral, Paris, Maison des sciences de l’Homme, 224 p.(Documents d’archéologie française, 101).
FAURE-BOUCHARLAT É. et FLAMBARD HÉRICHER A.-M.2010, «L’édition scientifique dans le domaine de l’archéologiemédiévale en France», dans CHAPELOT 2010, p. 375-392.
FLAMBARD HÉRICHER A.-M.2000-2001, «Chroniques des fouilles médiévales en France en1999 et en 2000. III- Constructions et habitats fortifiés»,Archéologie médiévale, 30-31, p. 279, 435.
2003, «Chroniques des fouilles médiévales en France en 2002.III- Constructions et habitats fortifiés », Archéologiemédiévale, 33, p. 267.
GALINIÉ H.2010, «La question urbaine entre Antiquité et Moyen Âge : “l’entre-deux des cités” (250-950)», dans CHAPELOT 2010, p. 337-350.
GANDINI C.2008, Des campagnes gauloises aux campagnes de l’Antiquitétardive : la dynamique de l’habitat rural dans la cité desBituriges Cubi (IIe s. av. J.-C.-VIIe s. apr. J.-C.), Tours,FERACF/ARCHEA, 500 p.
GENTILI F.2010, «L’organisation spatiale des habitats ruraux du hautMoyen Âge : l’apport des grandes fouilles préventives. Deuxexemples franciliens : Serris “les Ruelles” (Seine-et-Marne)et Villiers-le-Sec (Val-d’Oise) », dans CHAPELOT 2010,p. 119-131.
Gestion de la documentation scientifique2008, Gestion de la documentation scientifique et des mobiliersissus des opérations archéologiques dans le cadre de la régle-mentation actuelle, actes du séminaire, Centre archéologiqueeuropéen du Mont-Beuvray, Glux-en-Glenne (Nièvre), 25-27 septembre 2006, Paris, Ministère de la culture et de lacommunication, Direction de l’architecture et du patri-moine, Sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie, de
l’inventaire et du système d’information, 199 p.,http://www.archeologie.culture.gouv.fr.
GUYONNET F.2010, «Le château comtal de Carcassonne : nouvelle approchearchéologique d’un grand monument méconnu», dansCHAPELOT 2010, p. 271-289.
HENIGFELD Y. et HUSI P. 2010, «La céramique médiévale dans la moitié Nord de laFrance : bilan et perspectives », dans CHAPELOT 2010,p. 305-319.
HENIGFELD Y., SCHWIEN J.-J. et WERLÉ M., coll. SEILLER M.2010, «L’apport de l’archéologie à la connaissance de la villemédiévale : le cas de Strasbourg», dans CHAPELOT 2010,p. 351-368.
HORRY A.2010, «Terra incognita ? Céramiques et archéologie des tempsmodernes : Premier bilan et réflexions à partir de l’exemplede Lyon», dans CHAPELOT 2010, p. 321-335.
La recherche archéologique en France1990, La recherche archéologique en France 1985-1989, Paris,Ministère de la Culture, 290 p.
1997, La recherche archéologique en France. Bilan 1990-1994 etprogrammation du Conseil national de la recherche archéolo-gique, Ministère de la Culture, Direction du patrimoine,sous-direction de l’archéologie, Paris, éditions de la Maisondes Sciences de l’homme, 461 p.
2002, La recherche archéologique en France : bilan 1995-1999 duConseil national de la recherche archéologique, Les Nouvellesde l’archéologie, 88, deuxième trimestre 2002, 80 p.
La recherche archéologique en Picardie2005, La recherche archéologique en Picardie : Bilans & perspec-tives. Journées d’études tenues à Amiens les 21 et 22 mars 2005,Revue archéologique de Picardie, 3-4, 346 p.
LAUWERS M.2005, Naissance du cimetière, Paris, Aubier, 393 p.
Les données du CNAU2007, Les données du Centre national d’archéologie urbaine.Aperçus statistiques, Tours, Direction de l’architecture et dupatrimoine, Sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie,de l’inventaire et du système d’information, Centre nationald’archéologie urbaine, 76 p. et un cédérom.
CONCLUSION 435
Publications du CRAHM, 2010
MEYER-RODRIGUES N.2010, «Saint-Denis, archéologie, territoire et citoyenneté »,dans CHAPELOT 2010, p. 369-374.
PAPINOT J.-C. et VERRON G. collaborateur1998, La conservation du mobilier archéologique. Rapport àMonsieur le Directeur de l’architecture et du patrimoine,décembre 1998, I-Rapport de synthèse, 34 p., II-Analyses etdéveloppements, 188 p., t. III-Le réseau des dépôts archéolo-giques, multipaginé, http://www.archeologie.culture.gouv.fr
PEYTREMANN É.2003, Archéologie de l’habitat rural dans le nord de la France du IVeau XIIe siècle, Saint-Germain-en-Laye, septembre 2003, 2 vol.,452 + 442 p. (t. XIII des mémoires publiés par l’AFAM).
2010, «L’archéologie de l’habitat rural du haut Moyen Âgedans le Nord de la France : trente ans d’apprentissage»,dans CHAPELOT 2010, p. 105-117.
QUERRIEN A., BUI THI MAI et GIRARD M.2010, «Évolution et exploitation du paysage végétal en Berryau Moyen Âge : données polliniques », dans CHAPELOT2010, p. 39-54.
RACINET P.2010, «Dix ans de fouilles programmées à Boves (Somme) :autour d’un château (début Xe-fin XIVe siècle) », dansCHAPELOT 2010, p. 257-270.
Rapport annuel sur la recherche archéologiques.d., Ministère de la Culture et de la Communication, Directiondu patrimoine, sous-direction de l’archéologie, Rapport annuelsur la recherche archéologique en France, 1987, Paris, s. d.,94 p.
Rapport au Parlement2006, Rapport au Parlement. Mise en œuvre de la loi modifiée du17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, Ministèrede la Culture et de la Communication, Direction de l’archi-tecture et du patrimoine, février 2006, t. 1, 97 p., t. 2,448 p., http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/archeo-preventive2006/rapport-archeo.html
Rapport d’activités INRAPh t t p : / / www. i n r a p . f r / a r c h e o l o g i e - p r e v e n t i v e /L-INRAP/Rapport-d-activites/p-274-Rapport-d-activites.htm
2004, Rapport d’activités INRAP 2004, Paris, 2006, 112 p.
2005, Rapport d’activités INRAP 2005, Paris, 2006, 137 p.2006, Rapport d’activités INRAP 2006, Paris, 2007, 152 p.2007, Rapport d’activités INRAP 2007, Paris, 2008, 160 p.2008, Rapport d’activités INRAP 2008, Paris, 2009, 201 p.
Rapport d’audit sur l’archéologie préventive2003, Rapport d’audit sur l’archéologie préventive et l’Institutnational de recherches archéologiques préventives, établi parA. Bolliet, S. Bouquerel, J. Charpillon, G. Chomier, juillet2003, 27 p., 8 annexes, http://www.archeodroit.net/Textes/Orgadmin/archprev_rapport.html (sans les annexes).
Rapport d’information2005, Rapport d’information n° 440 (2004-2005) de M. YannGaillard, fait au nom de la commission des finances, déposé le29 juin 2005 au nom de la commission des finances, ducontrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation surl’Institut national de recherches archéologiques préventives(INRAP), Les rapports du Sénat, 82 p. (Annexe au procès-verbal de la séance du 29 juin 2005), http://www.senat.fr
Rapport sur l’INRAP2006, Rapport sur l’Institut national de recherches archéologiquespréventives (INRAP), par M. Langlois-Berthelot, F. Lenoël,P. Olivier, E. Pitron, sous la supervision de N. Briot, janvier2006, 27 p., annexe I (14 p.), annexe II (19 p.),h t tp : / /por ta i l .documenta t ion .deve loppement-durable.gouv.fr/cgedd/results.xsp?question=igf
RENDU C.2003a, La Montagne d’Enveig : une estive pyrénéenne dans lalongue durée, Perpignan, Éd. du Trabucaïre, 2003, 606 p.
2003b, Dossier spécial sur les Habitats et systèmes pastorauxd’altitude (Pyrénées, Massif central, Alpes). L’occupation de lahaute montagne, premiers acquis et perspectives, actes de latable ronde tenue à Lattes, 30 janvier 2002, Archéologie duMidi médiéval, 21, 85 p.
RENOUX A.2010, «Châteaux, palais et habitats aristocratiques fortifiés etsemi-fortifiés», dans CHAPELOT 2010, p. 239-256.
RIETH É. et SERNA V.2010, «Archéologie de la batellerie et des territoires fluviaux auMoyen Âge», dans CHAPELOT 2010, p. 291-304.
RODET-BELARBI I. et FOREST V.2010, «Les activités quotidiennes d’après les vestiges osseux»,dans CHAPELOT 2010, p. 89-104.
JEAN CHAPELOT436
Trente ans d’archéologie médiévale en France, p. 393-436
RUAS M.-P.2006, «Carpologie médiévale en France, essor et terrains», dansL’archéologie médiévale en France depuis 30 ans, Dossiers del’archéologie, 314, juin 2006, p. 18-21.
2010, «Des grains, des fruits et des pratiques : la carpologiehistorique en France», dans CHAPELOT 2010, p. 55-70.
SAPIN C.2010, «L’Église dans tous ses états, 30 ans d’archéologie des siteset édifices religieux», dans CHAPELOT 2010, p. 195-211.
SCHNEIDER L.2010, «De la fouille des villages abandonnés à l’archéologiedes territoires locaux. L’étude des systèmes d’habitat du
haut Moyen Âge en France méridionale (Ve-Xe siècle) :nouveaux matériaux, nouvelles interrogations », dansCHAPELOT 2010, p. 133-161.
TREFFORT C.1996, L’Église carolingienne et la mort. Christianisme, ritesfunéraires et pratiques commémoratives, Centre universitaired’histoire et d’archéologie médiévales, Lyon, PUL, 230 p.(Collections d’histoire et d’archéologie médiévales, 3).
2010, «Une archéologie très “humaine” : regard sur trente ansd’étude des sépultures médiévales en France », dansCHAPELOT 2010, p. 213-226.