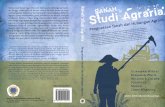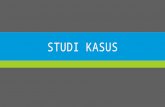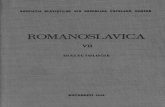Il Fascino inquieto dell'Utopia. Percorsi storici e letterari in onore di Marialuisa Bignami
STUDI LETTERARI E CULTURALI - CORE
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of STUDI LETTERARI E CULTURALI - CORE
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
in cotutela con Università Paris-Est
DOTTORATO DI RICERCA IN
STUDI LETTERARI E CULTURALI
Ciclo XXXI Settore Concorsuale: 10/F4 – Critica Letteraria e Letterature comparate
Settore Scientifico Disciplinare: L-FIL-LET/14 - Critica Letteraria e Letterature comparate
Illustrer La Comédie humaine. Entre texte et image Vol.I
Presentata da: Silvia Baroni
Coordinatore Dottorato Supervisore
Silvia Albertazzi Donata Meneghelli
Supervisore
Mireille Labouret
Esame finale anno 2019
Remerciements
Mes remerciements les plus chaleureux vont à mes directrices de thèse, Mme Donata Meneghelli et
Mme Mireille Labouret, qui ont suivi avec patience et constance mes travaux, en m’offrant leur
soutien et leurs excellents conseils. Un grand merci aussi à ma co-directrice, Maria Chiara Gnocchi,
qui a toujours témoigné un vif intérêt à l’égard de mon parcours universitaire, et qui est toujours
prête à donner sa disponibilité et son aide.
Je tiens à exprimer ma gratitude aux deux groupes de recherche balzacienne, le GEB et le GIRB,
qui m’ont permis d’approfondir ma connaissance sur Balzac à travers la fréquentation des
séminaires qu’ils ont organisés pendant les années 2016-2017 et 2017-2018, période de mon séjour
à Paris. Ces séminaires ont été l’occasion d’échanges stimulants et riches, lieu de rencontre avec
d’autres jeunes collègues et spécialistes balzaciens que je remercie tous. Une pensée particulière à
Mme Nathalie Preiss, présidente du GEB, pour l’amabilité avec laquelle elle a partagé avec moi ses
connaissances sur l’illustration et sur Balzac, en me donnant des références bibliographiques et des
matériaux très précieux.
J’adresse ma gratitude profonde à la Maison de Balzac, pour les heures passées à étudier là où La
Comédie humaine a été conçue et écrite en grande partie ; un remerciement particulier aux deux
bibliothécaires et « ange-gardiens » de la Maison, Axel Radiguet et Evelyne Maggiore, qui ont veillé
sur mes recherches dans la bibliothèque.
Je remercie vivement mes collègues de doctorat, en particulier à ceux du XXXI cycle de Bologne,
avec lesquels j’ai partagé cette expérience pendant trois années, Carlotta Beretta et Mattia Petricola,
et auxquels je souhaite un avenir lumineux dans le monde académique. Grand merci aussi à Ilaria
Vidotto, amie et collègue, des moments que nous avons passés ensemble dans ces trois années,
souvent en causant de Balzac et de Proust ; de même, à Jaroslav Stanovsky, collègue de l’UPE,
merci d’avoir partagé avec moi l’exploration de la ville de Paris et de ses bibliothèques.
Enfin, j’adresse ma profonde gratitude à ma famille, qui m’a soutenue pendant toute ma formation
universitaire, en me poussant toujours à poursuivre mes études en me redonnant confiance ; à
Andrea, mon compagnon, pour l’amour toujours nouveaux et vif qu’il me donne chaque jour que
nous passons ensemble ; à mes amis, Alice, Anna, Chiara, Cristian, Federico, Francesco, Giuseppe,
Manila, Mattia et Roberta, pour le bonheur de passer ensemble des moments merveilleux.
Sommaire
Abréviations 9
Introduction 13
Partie I. Balzac et l’émergence de l’illustration romantique 23
Chapitre 1. Des prémices essentielles :
l’illustration au seuil de la décennie 1820-1830 25
1.1. Petite histoire de l’illustration jusqu’au XVIIIᵉ siècle :
la valeur didactique et ornementale de l’image 32
1.2. L’évolution de l’illustration grâce aux innovations techniques 36
1.3. Les trois ancêtres du livre romantique. Vers le règne du personnage 40
Chapitre 2. Balzac romancier et éditeur avant 1830 : les débuts de l’illustration 55
2.1. Les frontispices des Œuvres de Jeunesse 56
2.2. Balzac et l’édition des Œuvres complètes de Molière et de La Fontaine 67
2.3. Balzac imprimeur : entre tradition et innovation 72
Chapitre 3. Balzac journaliste : la naissance du « type iconique » 83
3.1. Le type balzacien : une mosaïque de perspectives 86
3.2. La naissance du corps du personnage littéraire : le « type iconique » 89
3.3. Balzac et la presse : les critiques des albums lithographiques 98
Partie II. Le monde de la littérature illustrée entre 1830-1840.
Gravures balzaciennes 111
Chapitre 4. Le règne du frontispice et de la vignette de titre entre 1830-1838 113
4.1. En dehors de l’œuvre littéraire :
le frontispice comme façade de la cathédrale en papier 115
4.2. Le livre romantique à vol d’oiseau : petit panorama en guise de contexte 124
4.3. Les frontispices balzaciens : à la recherche de la scène dramatique 133
Chapitre 5. Figurez-vous un livre de Balzac illustré :
La Peau de Chagrin Delloye et Lecou de 1838 145
5.1. L’illustration comme « paratexte » versus l’illustration comme « iconotexte » 147
5.2. Vestibules 158
5.3. Splendeurs et misères du personnage illustré : le héros comme archétype 165
5.4. « Faire briller les moindres petites choses » :
les objets, personnages saisissants de La Peau de chagrin 179
Chapitre 6. Du mythe au type : de l’Histoire de l'Empereur aux Physiologies 189
6.1. Le personnage mythique dans l’Histoire de l’Empereur 191
6.2. Le type « en miettes » : les physiologies balzaciennes 207
Partie III. L’explosion du type 219
Chapitre 7. Des Français peints par eux-mêmes au Diable à Paris :
le type « panoramique » 221
7.1. Les Français peints par eux-mêmes et le paradigme du type « panoramique » 223
7.2. Les Métamorphoses du type panoramique
dans les Scènes de la vie privée et publique des Animaux 236
7.3. La Grande Ville, ou la renaissance de la caricature 248
7.4. Le Diable à Paris, ou le tiroir de l’image 267
Chapitre 8. La Comédie humaine illustrée. Un monument de statues 278
8.1. L’entreprise Furne : derrière les coulisses avec le péritexte 280
8.2. La Comédie humaine illustrée. Le vertige de la liste 285
8.3. Le retour du personnage illustré : un système manqué 292
Chapitre 9. Un duel entre crayons :
Paris marié de Gavarni et les Petites misères de la vie conjugale de Bertall 306
9.1. Intertextualité : comment l’illustration ouvre de nouveaux chemins 307
9.2. Paris marié commenté par Gavarni.
Une interprétation à l’enseigne de la caricature 319
9.3. Petites misères de la vie conjugale : un contre-texte en sourdine 333
Conclusion 339
Bibliographie 347
Abréviations
AB + millésime : L’Année balzacienne, Paris, Garnier (1960-1982) ; Paris, PUF (1983 ; 2018).
Corr + n° volume : Correspondance de H. de Balzac, édité par Roger Pierrot dans l’édition
Garnier, 5 volumes, 1960-1969.
Corr Pl + n° volume : Correspondance de H. de Balzac, édité par Roger Pierrot et Hervé Yon
dans édition Pl, 3 volumes, 2006 (t.I), 2011 (t.II) et 2017 (t.III).
LH + n° volume : Lettres à Madame Hanska éditées par Roger Pierrot, Paris, Laffont, 2
volumes, 1990.
OD + N° volume : Œuvres diverses de H. de Balzac, en édition Pl.
Pl : « Bibliothèque de la Pléiade ». Sauf indications contraires, c’est à La Comédie humaine
publiée en 12 volumes (1976-1981) sous la direction de P.-G. Castex que renvoient les
références au texte de Balzac.
« La véritable gloire et la vraie mission de Gavarni et de Daumier a été
de compléter Balzac, qui d’ailleurs le savait bien et les estimait comme
des auxiliaires et des commentateurs »
Charles Baudelaire, « Quelques caricaturistes français »,
Œuvres complètes, Pl., t.II, p. 560
13
INTRODUCTION
Le monde illustré de Balzac
Trop souvent le lecteur d’Honoré de Balzac oublie ou ignore que certaines de ses œuvres
ont paru, à son époque, illustrées. Cela s’explique par de nombreuses raisons : on pense
d’abord au fait que très peu de rééditions publient aujourd’hui les illustrations originales du
XIXᵉ siècle, ce qui justifie la faible connaissance que les lecteurs contemporains ont de ces
images ; de plus, les éditions originales sont difficiles à trouver, il faut s’adresser à des
bibliothèques spécialisées ; et même quand on consulte une édition originale, on n’a jamais
la certitude que les illustrations présentes dans cet exemplaire en consultation ne différent
pas de celles contenues dans le même livre gardé dans une autre bibliothèque : c’est le
problème auquel le lecteur de Balzac doit se mesurer lorsqu’il trouve, à la bibliothèque de la
Maison de Balzac, quatre exemplaires de La Peau de chagrin de l’édition Delloye et Lecou,
parue en 1838, parmi lesquels un seul conserve la couverture originale (qui n’est pas la
même que celle conservée à la Bibliothèque nationale) ; trois possèdent une vignette de titre
avec un squelette qui traîne un jeune homme dans un tombeau, tandis que le quatrième
exemplaire contient la même image, mais le squelette a été effacé. Pourquoi cette
différence ? L’édition et l’année de publication sont les mêmes, et pourtant la vignette en
page de titre a changé, sans qu’aucune explication ne soit donnée au lecteur. Cela n’est
qu’un cas exemplaire d’une situation qui arrive souvent à ceux qui analysent les livres
illustrés de l’époque romantique.
Par ailleurs, le manque d’étude consacrée à ce sujet n’aide pas les balzaciens à
s’orienter dans un monde resté aux marges, dont on ne peut que pressentir la complexité.
Notre premier contact avec les illustrations des œuvres de Balzac nous l’a bien démontré :
en cherchant des illustrations pour enrichir notre mémoire de master, nous nous sommes
trouvée dans un univers incontrôlé et chaotique, où les informations qui circulent dans
l’internet sont fréquemment fragmentaires et douteuses. Illustrations attribuées à tort à tel
ou tel artiste ; confusion sur l’édition où l’image avait été publiée originairement ; même
Gallica, la bibliothèque digitale de la BnF, présente une erreur importante, à savoir la
digitalisation de La Comédie humaine en édition Houssiaux, c’est-à-dire la seconde édition de
14
l’œuvre, cataloguée comme édition Furne, première édition de La Comédie humaine sur
laquelle Balzac a construit le « Furne corrigé » publié chez Houssiaux après sa mort.
Face à ce problème d’importance, nous nous sommes proposée de consacrer notre
thèse de doctorat à ce sujet, le monde des œuvres illustrées de Balzac, car la composition
d’un catalogue nous semblait la solution la plus pratique pour résoudre la confusion qui le
caractérise. À partir de là, un projet plus vaste s’est dessiné : l’idée de conduire une
recherche sur l’illustration des œuvres de Balzac de son vivant à aujourd’hui ; le sujet de
l’analyse aurait été consacré au rapport que les illustrations entretiennent avec le texte.
Toutefois, lorsque nous avons dressé le catalogue de toutes les éditions françaises
illustrées des œuvres de Balzac, que nous avons recueillies dans le deuxième volume de la
présente étude, la quantité surprenante de matériaux retrouvés et leur caractère hétérogène
nous a obligée à redéfinir la période chronologique à considérer. Cette restriction était
nécessaire pour deux raisons : d’abord, parce que la seule consultation de toutes les éditions
que nous avons insérées dans le catalogue aurait exigé bien plus d’une année, temps qui
nous restait pour rédiger la thèse ; deuxièmement, une première vue superficielle d’une
partie des éditions cataloguées a rendu évident qu’il aurait fallu traiter de manière
complètement différente les éditions illustrées publiées du vivant de Balzac et celles parues
après sa mort. C’est-à-dire que non seulement la présence de l’écrivain soulève des
questions à propos du contrôle qu’il pouvait exercer sur la production des illustrations de
ses œuvres, problème qui ne se pose plus après sa mort, mais l’évolution du livre illustré
aussi, et les changements des politiques éditoriales qui se sont succédé après 1850 sont
tellement profonds qu’on aurait dû adopter une approche différente à chaque période
(1850-1900 ; 1900-1950 ; 1950-2000).
Nous avons décidé alors de nous concentrer sur l’époque où Balzac est vivant, et de
laisser de côté pour un futur projet l’étude des éditions suivantes. En conduisant quelques
recherches sur la bibliographie dévolue à ce sujet, la rareté des études consacrées à ce
thème nous a convaincue de poursuivre ce chemin peu fréquenté. De fait, dans l’univers de
la critique balzacienne les seuls qui se soient occupés de la question des œuvres illustrées de
Balzac sont Tim Farrant1 et Nathalie Preiss2, selon deux approches assez différentes.
1 T. Farrant, « La vue d'en face ? Balzac et l'illustration », AB 2011, pp. 249-271. 2 N. Preiss, Les Physiologies en France au XIXᵉ siècle. Étude historique, littéraire et stylistique, Mont-de-Marsan, Edition InterUniversitaires, 1999 ; et Id., « Balzac illustre(é) », Littera, n°3, 2018, pp. 37-65.
15
Dans son article « La vue d’en face ? Balzac et l’illustration », Tim Farrant soutient à
juste titre que Balzac et l’illustration est un vaste sujet ; il propose de conduire l’étude de cet
argument en distinguant ce qu’il appelle une illustration de type « exemplaire », composée
par les effets picturaux construits par l’écriture balzacienne, de l’illustration « proprement
dite », c’est-à-dire les images gravées telles que les vignettes, les planches et les couvertures.
En reprenant une assertion écrite par Balzac dans la Physiologie du mariage, où il affirmait que
la poésie, la musique et la peinture sont « les trois arts qui nous aident à chercher peut‑être
infructueusement la vérité par analogie »3, Tim Farrant réfléchit au lien que l’illustration
entretient avec le concept d’analogie :
Les concepts de l’analogie, de la correspondance recoupent celui de l’illustration, dans la
mesure où elles renvoient à cette essence, ou plutôt à cet idéal d’un être, d’un
personnage, d’une situation que l’on sent, que l’on désigne, mais qu’on ne peut pas
cerner ; dont on « cherche », pour reprendre les propres termes de Balzac, « peut‑être
infructueusement la vérité par analogie » ; c’est le portrait de Corsino, dont on trouve
les fils directeurs dans ses lectures philosophiques. Cet idéal est essentialiste, mais se
veut aussi transcendant, et comporte une notion d’exemplarité qui caractérise
l’illustration et qui en serait peut‑être même la raison d’être. L’illustration met en
lumière les moments et les personnages exemplaires d’un récit, comme la prédelle
d’un retable ; elle propose des exempla qui cernent les moments déterminants du livre.4
Selon Tim Farrant donc, l’illustration s’engage dans un rapport d’« analogie », de
« correspondance » avec le texte, en restituant l’« essence » d’un personnage ou d’un
moment saillant.
Nathalie Preiss, de son côté, met en lumière un problème qui concerne le statut de
l’illustration : à son avis, le manque d’études consacrées au sujet de l’illustration – à
caractère général, outre le cas spécifique de Balzac – s’explique par le fait que l’illustration
est envisagée comme « la ˝femme d’à côté˝, voire de côté »5. Ce préjugé porte à examiner
l’illustration comme une image toujours dépendant du texte écrit, alors que nombreux sont
les exemples qui démontent la richesse des enjeux d’« intericonotextualité »6, qui ne sont
pas forcément dépendants du texte.
3 H. de Balzac, Physiologie du mariage, Pl., t. XI, p. 957. 4 T. Farrant, « La vue d'en face ? Balzac et l'illustration », AB 2011, p. 252 ; c’est nous qui soulignons. 5 N. Preiss, « Balzac illustre(é) », Littera, n°3, 2018, p. 37. 6 Ibid., p. 53.
16
C’est à partir de ces deux positions que nous avons poursuivi notre démarche. On
pourrait dire que la question que nous nous sommes posée dans nos réflexions n’est pas
celle d’Alice, le personnage de Lewis Carroll qui au début du roman Alice’s Adventures in
Wonderland se demande « What is the use of a book […] without pictures or
conversations ? »7 ; nous nous sommes interrogées plutôt sur la question opposée : what is
the use of a book with pictures and conversations ? À quoi sert l’illustration ? Qu’est-ce qu’est
l’illustration ?
En comprenant que derrière le concept d’illustration se cache un mare magnum de
définitions et d’hypothèses différentes, nous avons essayé tout d’abord de construire une
bibliographie qui traite de l’illustration romantique, afin de maîtriser au mieux la question.
Là, la boîte de Pandore s’est ouverte complètement ; parmi les informations confuses et
contradictoires auxquelles nous sommes remontée, ce qui nous a étonnée le plus est
l’absence d’une histoire de l’illustration. Le seul qui a entrepris une enquête de ce genre en
France est Michel Melot, qui a publié en 1984 un livre entièrement dédié à l’histoire de
l’illustration des œuvres littéraires8. Michel Melot, comme Nathalie Preiss, a insisté sur le
fait que l’illustration est considérée comme un art « des marges », tandis qu’il invite à traiter
l’illustration « par rapport au milieu qui la définit en creux : l’écriture, non en termes de
traduction ou de transposition mais en termes de complémentarité et de concurrence »9.
Dans son étude L’illustration. Histoire d’un art, Michel Melot affirme que :
Discours écrit et discours figuré, puisqu’ils défendent chacun un type de connaissance,
ont été très sélectivement utilisés par les divers pouvoirs, religieux, politiques, scolaires
ou familiaux. Cette histoire est celle d’un combat constant, où l’on joue toujours à
donner mauvaise conscience à l’autre. Les histoires de la bibliophilie ont coutume de
considérer le livre illustré comme un lieu d’harmonie, mais ce fut plus souvent un
champ clos où se joue une rivalité.10
7 L. Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, Macmillan, 1865, p. 7. Le roman a paru illustré par John Tenniel, mais l’auteur lui-même avait illustré son propre manuscrit avant la publication. Sur les illustrations du roman de Lewis Carrol, voir notamment l’article de Jessica W. H. Lim, « ˝And What is the Use of a Book…without Pictures or Conversations˝ : the Text-Illustration Dynamic in Alice’s Adventures in Wonderland », Forum for World Literature Studies, vol. 8, N°3, september 2016. 8 M. Melot, L’Illustration : histoire d’un art, Genève, Skira, 1984. 9 Ibid., p. 13. 10 Ibid., p. 11.
17
Michel Melot a tout à fait raison : les seuls ouvrages qui traitent le sujet de l’illustrations ont
été écrits par les bibliomanes tels que Champfleury et les frères Goncourt11, qui présument
la parfaite harmonie entre le texte et l’image au point qu’ils n’analysent même pas le lien
effectif existant entre les deux médiums, mais se limitent à décrire les illustrations selon le
procédé avec lequel elles ont été réalisées (bois de bout, lithographie, etc.). C’est également
l’approche des bibliomanes de la fin du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle, parmi lesquels on
cite Pierre Gusman et Henry Bouchot12 : l’illustration est étudiée seulement d’après le
procédé de gravure.
À partir des années 1980, les études sur l’illustration sont plus fréquentes, grâce à
l’impulsion donnée par les visual studies : ce sont notamment Meyer Shapiro, avec sa
définition de l’illustration comme « word-bound image », et W. J. T. Mitchell, dont l’essai
Iconology. Image, Texte and Ideology13, qui ont révolutionné la sémiotique de l’image, en
reconnaissant à cette dernière le statut de langage14. Cependant, les études qui ont paru
après ce tournant non pas vraiment tiré parti de ces travaux : Jean Adhémar, Jean-Yves
Mollier et Frédéric Barbier restent ancrés à l’histoire du livre ; Philippe Kaenel se concentre
sur les rapports de forces existants entre illustrateurs, écrivains et éditeurs ; Ségolène Le
Men15 tente de petites incursions dans le commentaire de thèmes récurrents dans
l’illustration et la littérature romantiques ; mais personne ne remet vraiment en cause le
concept d’illustration, sur lequel l’étiquette genettienne de « paratexte iconique »16 semble
condamner l’illustration à être « la femme d’à côté », selon la formule très efficace de
Nathalie Preiss. Le seul qui a essayé d’ébranler le préjugé qui emprisonne l’illustration est
11 Champfleury, Les "Vignettes" romantiques. Histoire de la "Littérature" et de l'Art 1825-1840, Paris, Dentu, 1883 ; E. et J. de Goncourt, L’art du dix-huitième siècle et autres textes sur l’art, Paris, éd. Hermann, 1967 (1873-1874). 12 Voir notamment P. Gusman, La Gravure sur bois en France au XIXᵉ siècle, Paris, Albert Moracé Grand éditeur,
1929 ; et H. Bouchot, Les Livres à vignettes, XIXᵉ siècle, Paris, Rouveyre éditeur, 1891. Parmi les études plus récentes sur la gravure, nous signalons celle de R. Blachon, La gravure sur bois au XIXe siècle. L’âge du bois debout, Paris, Les Éditions de l'Amateur, 2001. 13 W. J. T. Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago and London, University of Chicago Press, 1987 (1986) ; M. Shapiro, Words, Script, and Pictures : Semiotics of Visual Language, New York, George Braziller, 1996. 14 Roland Barthes, également, dans son article « Rhétorique de l’image » (L’obvie et l’obtus. Essais critiques, t.III, Paris, Seuil, 1982, paru d’abord dans la revue Communications en 1964) étudie l’affiche l’image en cette perspective. 15 Voir notamment J. Adhémar, J.-P. Seguin, Le Livre romantique, Paris éditions du Chêne, 1968 ; F. Barbier, Histoire du livre en Occident, Paris, A. Colin, 2012 (2000) ; Id., « Les innovations technologiques » et « Les formes du livre » dans Histoire de l’édition française, vol. II, Henri-Jean Martin et Roger Chartier (dir.), Paris, Promodis, 1984, pp. 536-543 et pp. 570-585 ; J.-Y. Mollier, L'Argent et les lettres : histoire du capitalisme d'édition : 1880-1920, Paris, Fayard, 1988 ; Id., « L’imprimerie et la librairie en France dans les années 1825-1830 », Balzac imprimeur et défenseur du livre, Paris, Paris-Musées, Éditions des musées de la ville de Paris, Éditions des Cendres, 1995, pp. 17-38 ; P. Kaenel, Le métier d'illustrateur, 1830-1880. Rodolphe Töpffer, J.-J. Grandville, Gustave Doré, Paris, Messene, 1996 ; S. Le Men, La Cathédrale illustrée. De Hugo à Manet, Paris, Hazan, 2014 (1998). 16 G. Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987.
18
Michael Nerlich, qui propose d’appeler « iconotexte » l’objet hybride qui constitue « une
unité indissoluble de texte(s) et image(s) dans laquelle ni le texte ni l’image n’ont de
fonction illustrative et qui — normalement, mais non nécessairement — a la forme d’un
“livre ” »17.
Le débat en cours sur le concept d’illustration nous a intéressée énormément : il était
clair que tout discours autour de Balzac et l’illustration aurait été vide et superficiel sans une
investigation parallèle sur le statut de l’illustration à l’époque romantique. Le sujet de la
thèse s’est affiné ultérieurement : en sacrifiant la piste tracée par Tim Farrant sur l’existence
d’illustrations évoquées par le récit même de Balzac, les « illustrations exemplaires », dont le
dialogue avec les illustrations proprement dites serait une autre étude très stimulante à
entreprendre18, nous avons préféré consacrer notre thèse à une analyse de caractère plus
historique et philologique, qui se focalise sur les variations du rapport entre le texte et
l’image selon les changements de statut accomplis par l’illustration dans la trentaine
d’années comprises entre 1820 et 1850, c’est-à-dire dans la période d’activité de Balzac.
Notamment, c’est le rapport présumé d’analogie que le préjugé commun a attribué à
l’illustration le point de départ de notre analyse des images : est-il toujours vrai que les
illustrations ne sont qu’une sorte de traduction, plus ou moins fidèle, d’un personnage idéal
ou d’une scène particulière ?
En ce contexte, adopter une division de la matière par ordre chronologique semblait
la seule organisation possible. Nous avons donc reparti la thèse en trois sections, qui
recoupent les décennies prises en analyse dans la partie en question.
Pour la première section, « Balzac et les débuts du livre romantique », nous nous
sommes occupée de la période 1820-1830 ; c’est une décennie de grands événements, et
dans l’histoire de la gravure et dans la vie personnelle de Balzac. L’année 1820 voit
l’introduction en France de deux procédés nouveaux de gravure, la lithographie et le bois
de bout ; nous nous sommes arrêtée sur les conséquences de l’arrivée de ces procédés dans
le monde de l’illustration, en nous interrogeant surtout sur les influences et les points de
contact que cette révolution a pu avoir sur la littérature. Là, nous avons étudié dans le détail
17 M. Nerlich, « Qu’est-ce qu’un iconotexte ? Réflexions sur le rapport texte-image photographique dans La Femme se découvre d’Evelyne Sinnassamy » dans, Iconotextes, Alain Montandon (éd.), Paris, Ophrys, 1990, p. 268. 18 Certainement la suggestion de Baudelaire, selon lequel « La véritable gloire et la vraie mission de Gavarni et de Daumier a été de compléter Balzac, qui d’ailleurs le savait bien et les estimait comme des auxiliaires et des commentateurs » (« Quelques caricaturistes français », Œuvres complètes, Pl., t.II, p. 560), serait à exploiter à fond.
19
le cas spécifique de Balzac, en analysant d’un côté les Œuvres de jeunesse, groupe d’écrits que
le romancier ne fera pas entrer dans La Comédie humaine mais qui constituent les premiers
exemples d’ouvrages balzaciens illustrés ; de l’autre côté, l’expérience de Balzac comme
imprimeur et fondeur de caractères, et, comme tel, pionnier de la gravure sur bois de bout,
procédé qui commençait à se diffuser en France dans ces années-là, soulève de nombreuses
questions à l’égard de cette épreuve balzacienne dans le monde de l’illustration : pourquoi
Balzac a-t-il publié des œuvres illustrées ? À qui s’est-il adressé pour les gravures ? Quel
type d’ouvrage a bénéficié de ces illustrations ? Qu’est-ce qu’il a gardé, en tant qu’écrivain,
de cette expérience ? Ce qui est certain, c’est le fait que c’est grâce à son travail dans
l’imprimerie que Balzac a connu certains des illustrateurs les plus célèbres de la première
génération romantique, tels que Henry Monnier et Devéria. Connaissances qu’il retrouve
dans le cadre de son travail comme journaliste au seuil de 1830. À cette date, Balzac
reprend son activité de romancier, et publie sous forme anonyme la Physiologie du mariage et,
un an après, La Peau de chagrin. Son style d’écriture a évolué considérablement, surtout la
technique descriptive des personnages ; dans ce cas, nous avons accueilli les hypothèses de
Roland Chollet et d’Olivier Bonard, qui soutiennent l’existence d’une influence de la
caricature de la presse illustrée de l’époque, et nous avons approfondi la question.
La date de 1830 inaugure une nouvelle période pour le livre illustré : c’est le moment
où l’illustration commence à s’affirmer dans les œuvres de la littérature contemporaine à
travers le frontispice. C’est bien ce seuil que nous avons fixé pour la deuxième partie de
notre étude. D’abord, nous avons consacré un chapitre à la construction d’un cadre général
sur la littérature illustrée de cette décennie, où à côté d’une réflexion sur la valeur de seuil
du frontispice nous avons construit un petit panorama des contemporains de Balzac
illustré. Grâce à ces prémices, nous avons pu remarquer comment Balzac ne profite pas
vraiment de l’illustration dans cette période : nous n’avons trouvé que quelques frontispices
et une vignette publiés entre 1830 et 1838 ; de toute façon, c’est à travers ces frontispices
que nous avons commencé à entrer au cœur du sujet, l’analyse du rapport entre le texte et
l’illustration. Finalement, c’est avec l’édition Delloye et Lecou de La Peau de chagrin (1838),
premier ouvrage balzacien complètement illustré, que le statut de l’illustration comme
« paratexte iconotextuel » démontre toute son instabilité : l’image se révèle tellement
invasive vis-à-vis du texte que sa définition comme « art des marges » échoue, en n’arrivant
pas à restituer une description véritable de la richesse du rapport entre le texte et l’image.
Le rapport d’analogie n’est pas assuré : en certains cas, le sens de l’illustration se révèle
20
assez difficile à détecter, et la relation entre le texte et l’image se pose comme une énigme
qui demande à être déchiffrée par le lecteur. Nous avons essayé alors de créer un lexique
nouveau qui peut décrire les différents types de rapport que l’image entretient avec le texte ;
à partir du vocabulaire genettien, nous avons conjugué trois mots pour les trois relations
possibles, et nous avons commencé à les mettre à l’épreuve dans notre analyse sur trois
textes balzaciens complètement illustrés : l’Histoire de l’Empereur racontée dans une grange par un
vieux soldat, la Physiologie du rentier, et la Physiologie de l’employé.
Enfin, nous avons poursuivi notre enquête dans la troisième et dernière section de la
thèse, où nous avons analysé les ouvrages balzaciens des années 1840, à savoir les articles
que Balzac a fournis pour les œuvres collectives que Walter Benjamin a nommées
« littérature panoramique », La Comédie humaine publiée chez Furne, et les Petites misères de la
vie conjugale. Les illustrations pour la littérature panoramique sont un champ très vaste et
riche : les projets que les éditeurs élaborent pour ces ouvrages comprennent la
collaboration avec les illustrateurs les plus célèbres de l’époque et une organisation très
ponctuelle de l’enchainement texte-image, ce qui est une nouveauté absolue. Cependant,
l’illustration refuse encore, souvent, le rapport d’analogie vis-à-vis du texte que les éditeurs
et les écrivains souhaitent : la lecture du texte narratif à la lumière de l’image, et viceversa, se
présente, en certains cas, comme un « récit à énigme », comme le définirait Chantal
Massol19, c’est-à-dire comme un récit basé sur un secret, caché dans ce cas-là soit dans le
texte soit dans l’image. L’illustration se fait le détail d’un paradigme indiciaire qui dénonce
la tyrannie de la plume sur le crayon, et la rébellion de ce dernier, qui réclame son
indépendance. Balzac, qui comprend la situation, cherche à s’imposer dans le contrôle des
illustrations de La Comédie humaine ; néanmoins, si l’image retourne effectivement à son rôle
de traducteur du texte, cela ne sera que temporaire, et les personnages illustrés paraissent
des statues médusées. Avec la dernière œuvre balzacienne intégralement illustrée, les Petites
misères de la vie conjugale, nous verrons finalement comment Balzac n’arrive plus à tenir sous
son contrôle les illustrations créées pour son texte, et l’image rompt encore une fois les
limites imposées par l’analogie.
C’est bien donc cette capacité de l’image à entretenir des relations différentes avec le
texte qui constitue le cœur de notre étude ; l’illustration a la capacité d’influencer
énormément la lecture d’un texte, en mettant en lumière, ou, au contraire, en obscurcissant,
19 C. Massol, Une poétique de l’énigme. Le Récit herméneutique balzacien, Genève, Droz, 2006, p. 26.
21
certains éléments du mot écrit. Un jeu intertextuel est engagé, et le lecteur est appelé à lire
tant le texte que l’image pour interpréter l’œuvre dans son ensemble. Ainsi, l’illustration
démontre clairement que son rôle de traducteur n’est qu’un préjugé qu’il est temps de
remettre en question. Le cas de Balzac était le meilleur moyen pour le démontrer.
Certes, de son côté, Balzac n’a pas certainement facilité notre recherche : bien que les
œuvres illustrées de son vivant soient nombreuses, les commentaires qu’il a laissés dans la
correspondance ou dans ses œuvres sont très pauvres et ambigus. Néanmoins, les récits et
les images ont parlé pour eux-mêmes, en nous ouvrant à un monde qu’il est temps de voir
de plus près.
25
CHAPITRE 1
DES PRÉMICES ESSENTIELLES :
L’ILLUSTRATION AU SEUIL DE LA DÉCENNIE 1820-1830
Si les livres de chevalerie qui emplissaient la bibliothèque de Don
Quichotte avaient été ornés de tels frontispices, nul doute que le
curé qui les condamnait, comme troublant la cervelle du brave
hidalgo de la Manche, n’eût détaché les images de ces bouquins
avant de les jeter au feu.
Champfleury, Les Vignettes romantiques : histoire de la
littérature et de l’art, 1825-1840.
Entre 1820 et 1830, deux parcours de formation s’accomplissent : d’un côté, comme nous
le verrons dans le cours du présent chapitre, l’imprimerie française est bouleversée par
l’arrivée de deux procédés de gravure qui révolutionneront le monde de l’illustration ; de
l’autre, le jeune Honoré de Balzac s’installe à Paris, avec l’intention de vivre de sa plume.
Leurs chemins se croisent souvent : certaines œuvres de jeunesse de Balzac sont enrichies
par des frontispices, et, lorsque le jeune écrivain décide de devenir « homme de plombs », il
devient l’un des premiers pionniers de la gravure sur bois de bout. Or, si la production
littéraire de jeunesse de Balzac est connue, si sa courte carrière dans l’imprimerie a été
racontée par sa sœur, Laure, et par quelques-uns de ses contemporains tels que
Champfleury et Léon Gozlan20, on n’a jamais étudié cette partie de la vie de Balzac en
relation avec les développements que l’illustration accomplit en à moment-là, ni suivi les
traces de cette évolution dont Balzac témoigne, bien qu’en petite part. C’est en vue de cela
que nous consacrons la première partie de notre étude à cette décennie d’apprentissages, de
Balzac et de l’illustration, qui amènent à une date cruciale : l’année 1830.
C’est une date très significative pour Balzac, qui est au seuil de ses premiers succès
littéraire : c’est le moment où il prend conscience de l’émergence d’un nouveau goût, d’une
différente façon d’écrire. Balzac nous en donne la démonstration dans les Lettres sur Paris :
dans la Lettre XI, écrite le 9 janvier 1831, Balzac non seulement défend l’Hernani21 de Victor
20 L. Gozlan, Balzac en pantoufles, Paris, Michel Lévy, frères, J. Hetzel et Ce, 1856. 21 L’Hernani de Victor Hugo, représenté le 25 février au Théâtre Français, avait subi plusieurs critiques, il fut considéré un échec.
26
Hugo, très jeune et célèbre depuis peu de temps grâce à ses Odes, mais il cite aussi les
nouvelles promesses de la littérature, parmi lesquelles Eugène Sue, qui venait de publier
Kernok-le-pirate dans La Mode, successivement publié en volume sous le titre de Plik et Plok,
et Alfred de Musset, auteur de Contes d’Espagne et d’Italie. Quatre livres, en particulier, et avec
eux leurs quatre auteurs, se distinguent parmi les autres :
Charles Nodier a publié son Histoire du Roi de Bohême, délicieuse plaisanterie littéraire,
pleine de dédain, moqueuse ; c’est la satire d’un vieillard blasé, qui s’aperçoit à la fin de
ses jours du vide affreux caché sous les sciences, sous les littératures. Ce livre
appartient à l’École du désenchantement. C’est une déduction plaisante de L’Âne mort,
singulière coïncidence d’ouvrage ! Cette année, commencée par la Physiologie du mariage,
dont vous me permettrez de ne pas vous parler beaucoup, a fini par Le Rouge et le Noir,
conception d’une sinistre et froide philosophie : ce sont de ces tableaux que tout le
monde accuse de fausseté, par pudeur, par intérêt peut-être. Il y a dans ces quatre
conceptions littéraires le génie de l’époque, la senteur cadavéreuse d’une société qui
s’éteint. 22
Jules Janin, Charles Nodier, Stendhal et Balzac lui-même sont les romanciers qui, en
déchirant le rideau d’apparences sur lequel la société contemporaine se fonde, représentent
la nouvelle école littéraire du « désenchantement », dont les quatre œuvres citées par Balzac
constituent en quelque façon le manifeste : elles « sont les traductions de la pensée intime
d’un vieux peuple qui attend une jeune organisation ; ce sont de poignantes moqueries ; et
la dernière [Le Rouge et le Noir] est un rire de démon, heureux de découvrir en chaque
homme un abîme de personnalité où vont se perdre tous les bienfaits »23. Ces quatre
œuvres touchent le mariage, la religion, la science, et toutes les valeurs qui jusqu’à cette
époque-là avaient dominé la société – la reconnaissance, l’amour, Dieu, la monarchie,
quatre choses qui chez Stendhal notamment ne sont plus que de mots. Ce sont ça les
thèmes choisis par la génération nouvelle d’artistes : porter l’actualité, et plus précisément le
déclin social en cours dès la défaite de Napoléon, dans la littérature, pour montrer les
ruines qui se cachent sous les richesses illusoires du beau monde, à travers un style
moqueur.
À bien voir, ce « mal du siècle », comme l’a défini Pierre Barbéris, qui rapproche tous
les écrivains de la génération 1830, n’a pas une seule façon de s’exprimer. Il existe au moins
22 H. de Balzac, Lettres sur Paris, OD, Pl, t.II, p. 937. 23 Ibid., pp. 937-938.
27
deux écoles du désenchantement. D’un côté, le romantisme révolutionnaire de Hugo et
Michelet, qui « refuse et condamne la réalité issue de la révolution bourgeoise, mais lui
oppose des notions morales, des visions exaltantes de l’avenir, au lieu d’en faire l’analyse »,
et qui « a contre lui le verbalisme, l’imprécision une connaissance insuffisante du réel
immédiat, une incapacité congénitale à faire voir les problèmes concrets de la bourgeoisie
dans laquelle il est né »24. De l’autre côté, le réalisme critique de Balzac et Stendhal :
Le réalisme critique, au contraire, tout en refusant, lui aussi, la réalité bourgeoise, en
fait l’analyse concrète, précise, de l’intérieur, sans se référer nécessairement à quelque
vision compensatrice. Il démonte les mécanismes, voit et fait voir les problèmes,
exprime les contradictions. Et ce non tant par des analyses que par des constructions, des
créations artistiques. Ses héros sont paradoxaux et contradictoires, comme la réalité dont
ils sont issus, ils ne sont pas ombre ou lumière, mais tensions. Ils ne sont pas antithèses
vivantes, mais complexes dynamiques.25
La Lettre XI sur Paris de Balzac se montre significative pour notre sujet dans le fait
qu’elle indique, parmi les gloires de la littérature contemporaine, certains ouvrages qui,
outre leur valeur artistique, occupent une place importante aussi dans l’histoire du livre. Les
Chansons de Béranger, par exemple, est l’un des volumes qui marqueront l’histoire du livre
dans les années 1820, en tant qu’exemple précoce de littérature contemporaine illustrée par
la technique du bois de bout. L’Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux, surtout, est
considéré comme le véritable premier livre « romantique », et il signe le début de la période
1830-1850. Notre-Dame de Paris aussi, qui sera illustré dès sa première édition, est déjà
évoqué, bien que Hugo n’eût pas encore terminé de l’écrire. Nous sommes persuadés que
Balzac ne s’était pas limité à considérer seulement la portée littéraire des ouvrages qu’il a
cités dans la lettre, mais qu’il avait également remarqué l’évolution physique que le livre
était en train d’opérer, même si cet aspect semble rester implicite, dans ce texte. Son
expérience d’éditeur et imprimeur, déjà achevée en 1830, lui a permis d’acquérir une
certaine expérience dans le domaine de la librairie, et les lettres qu’il écrira après La Peau de
chagrin nous montrent clairement combien il était toujours très attentif à l’aspect
24 P. Barbéris, Balzac et le mal du siècle. Contribution à une physiologie du monde moderne, Paris, Gallimard, 1970, vol. I, p. 14. 25 Ibid., p. 16.
28
typographique de ses œuvres26. Ainsi, Balzac nous donne un petit témoignage de l’évolution
du livre, et notamment du pouvoir grandissant de l’illustration, visible à cette date.
Ce qu’il est intéressant de voir est la synergie qui se crée entre la littérature et
l’illustration, réunies sous le thème transversal du « mal du siècle » : c’est en ce moment que
la nouvelle génération d’écrivains, dont Balzac, et celle des illustrateurs romantiques
travaillent ensemble dans la presse périodique à caractère politique, en exprimant soit à
travers le crayon soit à travers la plume la déception du monde intellectuel. Par-là, lettre et
image se croiseront étroitement, en donnant naissance au livre romantique.
La Lettre XI porte déjà une petite trace de cette nouvelle alliance entre texte et image,
lorsque Balzac commente l’étendard de l’École du désenchantement, à savoir une vignette
de l’Histoire du roi de Bohême de Nodier dessinée par Tony Johannot, l’un des plus célèbres
illustrateurs romantiques. L’image représente une vieille jument, nommée Patricia :
Nodier arrive, jette un regard sur notre ville, sur nos lois, sur nos sciences ; et, par l’organe de
don Pic de Fanferluchio et de Breloque, il nous dit, en poussant un rire éclatant : « Science ?...
Niaiserie ! À quoi bon ? Qu’est-ce que cela me fait ? » Il envoie des Bourbons mourir à l’écurie
sous forme de vieille jument aristocratique ; et Tony Johannot dessinait, par avance, Holyrood
dans la vignette de Patricia.27
Holyrood, mieux connu sous le nom de Holyrood Palace, a été dès le XVIᵉ siècle la
résidence des rois d’Écosse et, après Marie Stuart, des rois d’Angleterre ; situé à
Édimbourg, dans le bas du Royal Mile, le palais est aujourd’hui la résidence officielle en
Écosse de la reine Elizabeth II. Mais après la Révolution française, le roi George III avait
permis au comte d’Artois, le plus jeune frère de Louis XVI, de vivre à Holyrood ; même au
cours de son second exil, la famille royale y avait séjourné de 1830 à 1832, avant de se
transférer en Autriche28. C’est probablement à ce dernier séjour que Balzac fait référence,
imaginant la honte de la famille royale en exil à l’étranger.
La démarche qui constitue la description de la jument Patricia est soulignée par les
deux vignettes qui figurent au chapitre « Equitation », Au début du chapitre, on annonce la
mort de Patricia, « une jument de si riche encolûre et de si beau pelage, une jument de race,
26 Voir la lettre envoyée par Balzac à Charles de Montalembert en octobre 1831, jointe aux trois volumes de la nouvelle édition des Romans et contes philosophiques, où Balzac déclare que ces volumes « sont beaucoup plus présentables maintenant comme typographie », Corr., t.I, p. 594. 27 Ibid., p. 937. 28 https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Holyrood
29
une jument de château, une jument titrée, une très noble jument ; la jument de fous en titre
d’office et du Prince des sots »29. « Grande, belle, énergique et vigoureuse », Patricia
participe aux batailles, se faisant remarquer par son courage. Ariosto, Tasso, Shakespeare,
chantent tous la gloire de la jument. La vignette de Johannot saisit pleinement l’ironie des
mots de Nodier, et représente la jument, dans une pose héroïque, entourée et suivie par des
fous.
Mais Patricia finit de vieillir. – Et Patricia, je dois le dire, ne s’étoit jamais fait
remarquer par son esprit. L’habitude de la cour acheva de la perdre, et depuis qu’il lui
fut permis de remplacer par des talons de maroquin ses fers brûlants et poudreux, elle
devint ce que vous l’avez vue, bégueule, bigote, précieuse, pecque, pimbêche et
pimpesonée, comme une bête de jument. Elle se mit à employer son temps en passes,
en pétardes, en mascarades et en fanfares ; […] à poursuivre, à l’opposé du soleil, la
sotte bête ! l’ombre de ses grands plumets. Elle couroit, elle trottoit, elle galopoit, elle
voloit, elle frivoloit, elle caracoloit, et c’est bonheur si elle n’a pas cassé le cou à
Triboulet.30
Voilà la vignette mentionnée par Balzac. La vie de la jument Patricia est évidemment la
métaphore de l’histoire de la famille royale : chevaliers au début, les rois de France sont
progressivement déchus, en arrivant à se comporter comme des frivoles courtisans.
La mort de la jument est annoncée à travers une sorte de comptine : « Patricia butte.
Patricia est borgne. Patricia est boiteuse. Patricia est fourbue. Patricia est poussive. Patricia
est brèche-dent comme Popcambou. Patricia ne sert plus à rien. Patricia a fait son temps.
Patricia a vécu »31. Et la reine commente : « qu’il est cruel de se voir abandonnée du monde
et de Triboulet, quand on descend du cheval de Job et de la jument de Gargantua »32. Une
autre allusion aux illustres ancêtres de Patricia, qui s’ajoutent à la liste initiale des auteurs
célèbres qui ont chanté la gloire de la jument. Une liste qui ressemble au catalogue des
femmes aimées par don Juan ; mais ici la technique de l’énumération vise à créer l’effet
comique, ironique, plutôt que tragique, et Patricia, continuellement rapportée au mythe de
la Grande Jument, devient par contraste de plus en plus insignifiante, petite, plus proche de
Rossinante, le cheval de don Quichotte que de la Grande Jument de Rabelais ou du noble
29 C. Nodier, Histoire du roi de Bohème et des septs chateaux, Paris, Delangle, 1830, p. 513 ; consulté sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108013v/f317.item 30 Ibid., pp. 517-518. 31 Ibidem. 32 Ibid., p. 519.
30
et fort cheval de Job. Même le signifié du nom Patricia est antithétique : « Patricia » dérive
du latin « patricius », adjectif qui indiquait un membre de la noblesse ; caractère que la
jument de Nodier a évidemment perdu, comme l’illustre la vignette de Johannot. Ainsi, les
vignettes de Johannot représentant la chute de la royauté, et celle de la société qui se
fondait sur la monarchie, dans l’image d’une jument entourée par des fous, vieille et laide,
caricature de ses ancêtres mythiques, est prise comme le paradigme du style moqueur
inauguré par Nodier.
Si la littérature accueille souvent le concours de l’illustration pour soutenir ses
réflexions, l’image aussi influence à sa manière les éléments narratifs du texte. Dans le cas
de Balzac, l’élément qui profitera le plus de cette rencontre entre les arts est le personnage.
Mais, avant d’analyser la démarche accomplie par le personnage balzacien dans ces
années, il faudra d’abord examiner les prémices qui ont conduit à la naissance du livre
romantique. Un petit résumé, qui n’a aucune prétention d’être exhaustif, de l’histoire de
l’illustration, envisageant les étapes fondamentales parcourues par le livre illustré avant
1830, sera très utile afin de pouvoir comprendre pleinement l’impact des nouveautés,
littéraires et éditoriales, développées dans la décennie 1820-1830 sur la période suivante. Le
personnage littéraire, notamment, ressentira visiblement l’influence des mécanismes mis en
place dans le livre illustré, alors que l’histoire de cet élément narratif sera contaminée par
celle du personnage iconique. Balzac, nous le verrons dans le troisième chapitre, profitera
de cette fusion entre les deux pour donner naissance à ses caractères.
31
Figure 1 : La jument du Prince des sots, vignette par Johannot pour l’Histoire du Roi de Bohème de Nodier
Figure 2 : La jument Patricia, vieille et laide, vignette par Johannot pour l’Histoire du Roi de Bohème de Nodier
32
1.1. Petite histoire de l’illustration jusqu’au XVIIIᵉ siècle : la valeur didactique et
ornementale de l’image
La gestation du livre romantique est longue et laborieuse. Comme nous l’avons écrit dans
l’introduction, « livre romantique » est une appellation donnée aux livres illustrés de la
période 1830-1850. Le besoin d’une différenciation avec le « livre illustré », étiquette qui
peut désigner tout livre contenant des illustrations, de tout genre et de toute époque,
s’explique par les conséquences socio-économiques liées au processus d’impression, de
fabrication et de conception même du livre.
Tout d’abord, il convient de rappeler que l’illustration a subi, au fil du temps,
plusieurs variations, intimement liées à l’histoire du livre : le rapport entre texte et
illustration se transforme selon les exigences du système culturel du moment, secondant les
changements liés au concept du livre pensé comme support, comme produit ou comme
objet d’art. Ainsi, s’il est possible d’affirmer que les illustrations existent depuis les premiers
traits dessinés par les hommes des cavernes33, c’est vrai aussi qu’on identifie au moins
quatre éléments qui déterminent la nature du lien entre image et texte, et qui en manifestent
l’évolution. Les trois premiers correspondent aux critères établis par Ségolène Le Men,
lesquels déterminent la nature de l’illustration : la localisation (l’emplacement de l’image
dans un volume, considéré dans son ensemble ou dans ses parties textuelles) ; la forme
iconique (qui se résume dans l’opposition tableau-vignette) ; et le genre (scène, site, type)34.
À ces critères nous en ajoutons un quatrième, intimement lié aux trois premiers, à savoir
l’intention qui anime l’insertion de l’illustration.
Jusqu’au XIXᵉ siècle, la finalité de l’illustration a été grosso modo la même : l’illustration
est premièrement un ornement qui rend plus précieux le livre, soit pour la beauté des
images représentées soit pour le travail à la fois artistique et technique qu’elle requiert ; en
deuxième lieu, l’illustration s’attache au pouvoir didactique propre à l’image. Ce n’est qu’à
partir du XVIᵉ siècle, avec la naissance du livre imprimé, que l’illustration se charge aussi
d’une valeur « paratextuelle », comme le démontre Trung Tang. En fait, Trung Tang, en
affirmant le rôle que l’image joue dans la définition de l’espace du texte, remarque que
l’illustration de l’âge humaniste, outre le fait de détenir « une fonction dramatique,
33 Voir M. Melot, op.cit. 34 S. Le Men, « Iconographie et illustration », dans L’illustration. Essais d’iconographie, Actes du Séminaire CNRS (GDR 712), études réunies par Maria Teresa Caracciolo et Ségolène Le Men, Paris, Klincksieck, 1999, p. 9.
33
anticipatrice et synthétique »35, occupe des sections à l’intérieur du livre et de la page bien
précis. Ainsi, « artifices typographiques et illustrations apparaissent donc comme des
marqueurs visuels formant tout un dispositif matériel permettant d’aérer la mise en page et
d’assurer la lisibilité du texte, mais aussi la rigueur de sa construction narrative : isolant des
blocs textuels, ils invitent, de fait, à délimiter les unités narratives ou discursives du
roman »36. Le XVIIIᵉ siècle montre à son tour un deuxième grand changement dans le
rapport entre texte et illustration. Bien que celle-ci ait toujours une position réglée, qui
assure la coïncidence du texte et de l’image37, pour la première fois l’illustration sort des
marges de la page, en l’envahissant. Tout type d’espace blanc – bords de pages, feuilles
blanches qui séparent les parties ou les chapitres du texte, etc. – est rempli par une variété
impressionnante d’images. Les frères Goncourt, parmi les premiers qui ont eu le mérite de
redécouvrir la valeur des illustrations de cette époque, soulignent cet aspect, en remarquant
que la vignette est devenue la protagoniste du livre illustré :
Le XVIIIᵉ siècle est le siècle de la vignette. Ce temps, qui orna tout de l’amabilité de
l’art, qui éleva le joli au style et répandit ce style dans les plus petites choses de ses
entours, de ses usages, de ses habitudes ; ce temps, qui appliqua le talent du
dessinateur et du graveur jusqu’au décor du moindre bout de papier, de ces mille
petites feuilles volantes qu’une société se passe de main en main : adresses, cartes,
invitations, billets de faire-part, factures de marchands, passeports, contre-marques de
théâtre ; ce temps, qui ne voulait pas un seul imprimé sans y trouver un plaisir pour
l’œil ; le XVIIIᵉ siècle devait naturellement dépenser, pour l’embellissement et
l’égayement du livre, un génie, une imagination, un goût nouveau et sans exemple.
Aussi le règne de Louis XV est-il le triomphe de ce qu’on appellera plus tard
« l’illustration ». L’image remplit le livre, déborde dans la page, l’encadre, fait sa tête et
sa fin, dévore partout le blanc : ce ne sont que frontispices, fleurons, lettres grises,
culs-de-lampe, cartouches, attributs, bordures symboliques.38
Ce passage du livre L’art du XVIIIᵉ siècle témoigne du l’enthousiasme des frères Goncourt
pour l’illustration des « grands maîtres », tels Eisen, Prudhon, Debucourt, Fragonard et
35 T. Tran, « L’image dans l’espace visuel et textuel des narrations illustrées de la Renaissance : morphologie du livre, topographie du texte et parcours de lecture », dans Le livre et ses espaces, sous la direction d’Alain Milon et de Marc Perelman, Paris, Presses universitaires de Paris 10, 2007, p. 97. 36 Ibid., p. 99. 37 C. Martin, « Dangereux suppléments ». L’illustration du roman en France au dix-huitième siècle, Louvain-Paris, éditions Peeters, 2005, pp. 1-2. 38 E. et J. de Goncourt, op. cit., pp. 135-136.
34
Moreau le Jeune, auxquels les Goncourt dédient un chapitre dans leur ouvrage. Cependant,
aujourd’hui nous pouvons grâce à plusieurs études qui ont été conduites, nuancer certaines
affirmations des frères Goncourt.
Il faut avant tout rappeler l’évolution subie par le mot « vignette » au cours du
temps : « vignette » dérive du latin vinea, vigne ; en effet, originairement la vignette était un
« ornement représentant un entrelacs de branches et de feuilles de vigne, d’un usage
fréquent dans les manuscrits médiévaux »39. Dès le XVIIᵉ siècle, vignette « désigne d’une
manière générale les motifs qui ornent les têtes de page, les chapitres, les culs-de-lampe ou
les bordures » ; elles peuvent être gravées sur bois ou, à partir du XVIᵉ siècle, en taille-
douce40. À partir du XVIIIᵉ siècle, sous l’influence anglaise, les vignettes deviennent
graduellement plus illustratives, et non seulement décoratives : à l’époque de Louis XV, les
vignettes sont des illustrations de petite taille, placées en tête ou en bas de page, ou dans les
pages vides qui séparaient les chapitres, représentant un homme, un animal, une chose ou
un paysage ; elles sont douées de leur propre valeur iconique, c’est-à-dire qu’elles sont
pourvues du statut d’icône41, en se distinguant ainsi des illustrations purement graphiques
comme les culs-de-lampe et les fleurons42. En plus, il faut souligner que l’image de la
vignette n’était pas faite toujours exprès pour l’œuvre où elle se trouve. Souvent, le libraire-
imprimeur, chargé de prendre toute décision regardant la « mise en livre »43, réutilisait pour
des livres différents les mêmes planches. Ce choix s’explique par le coût très élevé de la
production d’un livre illustré, pour lequel il fallait payer les matériaux pour la gravure et le
travail du graveur et du dessinateur, qui obtenaient en ce temps-là un salaire assez
substantiel. Réutiliser les formes déjà possédées était plus simple et plus économique. La
conséquence la plus évidente de ce geste est l’arbitraire du rapport entre texte et image : la
scène représentée est caractérisée par une ouverture au pluriel, par le sens
d’indétermination qui amène l’image à être exploitée dans des contextes différents.
39 S. Corsini, P.-M. Grinevald, « Vignette », dans Dictionnaire encyclopédique du Livre, Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer (dir.), Electre, éditions du Cercle de la Librairie, 2011, t. [3] N-Z, p. 980. 40 Ibidem. 41 Dans la définition que C. S. Peirce en a donné : « Une icône est un signe qui posséderait le caractère qui le rend signifiant, même si son objet n’existait pas. […] Une icône est un signe qui renvoie à l’objet qu’il dénote simplement en vertu des caractères qu’il possède, que cet objet existe réellement ou pas ». C. S. Peirce, Écrits sur le signe, Paris, Seuil, 1978, pp. 139-140. 42 Voir G. Mirandola, Libro e illustrazione nell’Ottocento. Parte prima: Le tecniche manuali. Volume primo: i procedimenti, Bergamo, Università di Bergamo, 2008, p. 79. 43 Définition de R. Chartier, « Du livre au livre », dans Pratiques de la lecture, Roger Chartier (dir.), Paris, Petite bibliothèque Payot, 1985, 2ème éd. 1993, pp. 79-114, cité dans T. Tran, op. cit., p. 85.
35
Ce caractère d’universalité de l’illustration est créé par le manque de traits spécifiques
des personnages, qui pourraient les rendre uniques et reconnaissables. Il n’existe pas encore
ce qu’on pourrait définir comme l’« iconographie des personnages ». Le lecteur, comme on
le voit à travers l’exemple des frères Goncourt, est attiré par la beauté du corps, par
l’habileté avec laquelle l’artiste a su rendre l’anatomie humaine, mais il n’a aucun intérêt à
identifier son héros dans l’image. Le goût classique domine les figures et les paysages. La
scène, la représentation d’une action, d’une situation, est le véritable sujet des illustrations
de l’époque. L’illustration finalement doit se caractériser par « une série de topoï
iconiques », comme la « scène galante » ou la « scène pathétique », qui rendent les gravures
adaptables à plusieurs textes, en n’ayant pas un lien évident et marquant avec la première
narration qu’elles ont servie. C’est le spectacle de la vie-théâtre de la cour de Louis XV, où
les personnages n’ont pas encore le droit de s’émanciper, de devenir les protagonistes.
Le libraire-imprimeur commandait des illustrations seulement quand il était sûr de
vendre un grand nombre d’exemplaires de l’œuvre. C’est le cas des classiques, qui ont
connu une série de rééditions souvent très proches dans le temps. Les Fables et Contes de La
Fontaine, notamment, ont été illustrés maintes fois tout au long du XVIIIᵉ siècle, en
devenant un sujet d’inspiration pour les illustrateurs des siècles suivants, comme on verra
dans les chapitres suivants. Parmi les ouvrages rédigés et illustrés au XVIIIᵉ siècle, on peut
citer comme exemple le Manon Lescaut de Prévost, dont le succès littéraire a porté l’éditeur
François Didot à commanditer des illustrations à Gravelot (mais seulement vingt ans après
la publication du roman, en 1753, quand le succès de l’œuvre paraissait désormais stable et
viable). Vers 1750-1775, la littérature illustrée est très à la mode : non seulement la
littérature « galante » mise en évidence par les frères Goncourt, mais aussi les éditions
« populaires », comme les anciens romans de chevalerie, les best-sellers de la Bibliothèque-
bleue et les contes de fées « attestent le goût d’un lectorat populaire et rural pour une
illustration romanesque moins assujettie aux modes de la haute société parisienne »44.
Christophe Martin souligne en outre que ces éditions remployaient généralement des
anciennes illustrations, déjà parues dans des éditions non populaires, gravées cette fois en
bois en non plus en taille-douce45.
44 C. Martin, op. cit., p.11. 45 Ibidem.
36
Dès 1780 l’ère des grands maîtres s’achève définitivement et le livre illustré fait face à
une période de rejet et d’oubli, due à la Révolution et à la crise économique qu’elle
comportait. L’Empire également ne fut pas un moment heureux pour le livre, à cause de la
censure qui touchait et la littérature contemporaine et la production même des librairies.
Seulement les ouvrages scientifiques et les guides de voyage continuent à être imprimés et
illustrés en grande quantité.
1.2. L’évolution de l’illustration grâce aux innovations techniques
Il n’est pas étonnant alors que le livre illustré reprenne sa place à partir de la littérature de
voyage en 1820. Mais avant d’arriver au Voyages pittoresques et romantiques dans l’Ancienne
France du baron Taylor et de Charles Nodier, le monde de l’imprimerie doit se mettre au
diapason. En fait, la librairie se trouve, sous l’Empire et en partie sous la Restauration, dans
une situation d’impasse, d’interrègne, où la tradition classique, représentée par le caractère
Didot, et la nouvelle esthétique romantique entrent en conflit.
Trois événements fondamentaux s’intercalent dans ce demi-siècle, en conditionnant
de façon définitive l’histoire du livre. D’abord, comme soutient Roger Chartier,
l’augmentation des lecteurs rendra évidentes les limites des anciennes technologies,
incapables de satisfaire la demande progressive d’imprimés qui s’accroît avec le
développement de l’alphabétisation46. De nombreuses innovations dans la méthode
d’imprimer sont proposées pour faire face à la situation : la stéréotypie, la presse métallique
à un coup et la presse à cylindres, notamment, apportent un progrès considérable au
monde de l’imprimerie, mais la diffusion de ces techniques sera lente : les premiers à les
accueillir seront les ateliers qui produisent des journaux ou formulaires administratifs, alors
que « ce n’est qu’après 1830 qu’elles bouleverseront en France les techniques d’imprimerie,
lorsque la machine à papier continu se substituera à l’ancien mode de fabrication à la cuve
et à la forme, lorsque la presse mécanique à cylindres et à vapeur fera disparaître les gestes
anciens des pressiers »47. Encore, cette révolution technologique aura lieu premièrement à
Paris, pendant que la province, comme le signale Balzac, mettra du temps à suivre. Le
célèbre personnage du père Séchard dans Illusions perdues, propriétaire de l’imprimerie
Séchard, en est le symbole :
46 R. Chartier, « Le livre au temps de Didot », dans Histoire de l’édition française, Henri-Jean Martin et Roger Chartier (dir.), Paris, Promodis, 1984, vol.II, p. 542. 47 Ibidem.
37
À l’époque où commence cette histoire, la presse de Stanhope et les rouleaux à distribuer
l’encre ne fonctionnaient pas encore dans les petites imprimeries de province. Malgré la
spécialité qui la met en rapport avec la typographie parisienne, Angoulême se servait toujours
des presses en bois, auxquelles la langue est redevable du mot faire gémir la presse, maintenant
sans application. L’imprimerie arriérée y employait encore les balles en cuir frottées d’encre,
avec lesquelles l’un des pressiers tamponnait les caractères. Le plateau mobile où se place la
forme pleine de lettres sur laquelle s’applique la feuille de papier était encore en pierre et
justifiait son nom de marbre. Les dévorantes presses mécaniques ont aujourd’hui si bien fait
oublier ce mécanisme, auquel nous devons, malgré ses imperfections, les beaux livres des
Elzevier, des Plantin, des Alde et des Didot, qu’il est nécessaire de mentionner les vieux outils
auxquels Jérôme-Nicolas Séchard portait une superstitieuse affection ; car ils jouent leur rôle
dans cette grande petite histoire.48
Un deuxième événement, c’est l’invention de deux nouvelles méthodes pour
graver les images : le bois de bout et la lithographie.
Le bois de bout est une technique de gravure dérivant d’un vieux procédé,
abandonné depuis la Renaissance : la gravure sur bois de fil. Dans la gravure sur bois de fil,
le graveur était obligé de suivre, en dessinant, la direction des fibres du bois, la planche
étant employée dans le sens des fibres ; avec le bois de bout, la planche est coupée
perpendiculairement sur la tranche, en permettant au dessinateur de graver librement celui-
ci au burin avec aisance. Même s’il existait des précédents à Lyon vers 1760, qui attestaient
les premières expériences de travail au burin fait perpendiculairement, et non parallèlement,
par rapport au fil49, la gravure sur bois de bout naît formellement en Angleterre à la fin du
XVIIIᵉ siècle avec Thomas Bewick. Bewick avait publié entre 1799 et 1803 The History of
British Birds, un livre d’histoire naturelle qui fut particulièrement apprécié pour la beauté des
gravures. Son élève, Charles Thompson, apporta le bois de bout en France, et forma une
nouvelle génération de graveurs : Porret et Brévière. À partir de 1820, à commencer par le
Rabelais de l’édition Desoer, où Thompson grave le frontispice créé par Desenne et les
vignettes dessinées par Victor Adam, la gravure sur bois connaît un progressif
renouvellement50. Le bois de bout s’imposera à partir de 1824, lorsque les avantages liés à
cette technique furent compris pleinement par les éditeurs : le bois de bout suit au plus près
l’inspiration de l’artiste, et il pouvait être préparé directement par le dessinateur lui-même,
qui livrait ensuite son dessin au graveur. En plus, ce procédé avait l’avantage de permettre
48 H. de Balzac, Illusions perdues, Pl, t.V, pp. 123-124. 49 F. Barber, « Les formes du livre », op.cit., p. 557 et aussi P. Gusman, op.cit., pp. 9-10. 50 Ibid., p. 583.
38
d’imprimer les images en même temps que le texte, en faisant faire aux éditeurs l’économie
d’un tirage51. Georges Duplessis, directeur du Cabinet des estampes de la Bibliothèque
nationale de 1885 à 1899, raconte dans son Histoire de la gravure que le bois de bout fut un
procédé particulièrement apprécié par les illustrateurs romantiques :
On n’avait guère songé avant 1830 à illustrer les livres ; quelques vignettes
commandées par un éditeur économe à un graveur au burin faisaient le plus bel
ornement des livres, et souvent une seule, vu son prix élevé, mettait sous les yeux du
lecteur, une seule scène du roman ou un seul événement de l’histoire. On songea à
utiliser la gravure sur bois, et les artistes rangés du côté de l’école romantique
trouvèrent mille occasions d’exercer leur talent et d’imprimer la pensée de l’auteur
qu’ils voulaient interpréter. Les artistes surent profiter de la nouvelle voie qui s’offrait
à eux, et quelques-uns se livrèrent presque exclusivement au dessin sur bois.52
La lithographie, par contre, est une véritable nouveauté : inventée en 1796 par
l’allemand Aloys Senefelder, elle est un procédé simple et pas trop coûteux, qui permet à
l’illustrateur de dessiner, à la plume ou crayon gras, directement sur la pierre qui sert à
l’impression, en laissant l’artiste libre de suivre l’inspiration du moment, sans aucune limite
à son imagination. C’est pour cette qualité que la lithographie eut bientôt un grand succès.
Les peintres, surtout, avaient de nouveau la possibilité de devenir illustrateurs, après le
groupe des peintre-illustrateurs de la première moitié du XVIIIᵉ siècle ; ainsi, « la
lithographie devient par excellence le procédé d’illustration des albums pittoresques et la
technique favorite des caricaturistes politiques »53. La technique découverte par Senefelder
arriva rapidement en France, grâce à Pierre-Frédéric André, qui en obtint le brevet
d’importation en 1802 ; quelques années après, le comte de Lasteyrie, Engelmann et
Senefelder lui-même ouvrirent des ateliers à Paris. À travers la lithographie, l’image envahit
la vie quotidienne de toutes les classes sociales :
L’iconographie du XIXᵉ siècle nous montre volontiers des enfants ou des femmes
contemplant des albums d’images. Ces albums lithographiques reprennent des thèmes
en vogue à l’époque : paysages romantiques, portraits ou suites de scènes de genre
dont la seule phrase de légende fait une histoire. Chez les bourgeois comme chez
l’ouvrier du XIXᵉ, la lithographie va décorer les murs et remplacer la peinture,
51 R. Brun, Le livre français, Paris, Presses Universitaires de France, 1969, p. 119. 52 G. Duplessis, citation contenue dans P. Gusman, op. cit., p.5. 53 F. Barbier, « Les innovations technologiques », op. cit., p. 549.
39
inabordable […]. Dans la vie quotidienne, la lithographie est utilisée pour présenter
des modèles de vêtements, de coiffures, etc. Souvent organisées sous la forme de
catalogues, avec mention de la nature du tissu, du prix au mètre, les lithographies
permettent la diffusion du savoir-faire de l’artisan-tailleur. Elles se retrouvent
également sous forme d’affiches de publicité pour tel magasin des nouveautés (Au Bon
Marché, par exemple). La mode du portrait se développe au XIXᵉ siècle, dans un
premier temps avec la lithographie puis grâce à la photographie […]. La lithographie a
permis également une large diffusion des modèles d’alphabets, de dessins ou de
supports pédagogiques […]. Enfin, il ne faut pas oublier qu’une des grandes
utilisations de la lithographie a porté sur les travaux de ville et les travaux
commerciaux : faire-part, étiquettes, calendriers, ouvrages pour dames, menus,
bulletins, diplômes, modèles d’abat-jour et d’éventails, etc.54
L’accroissement de la taille du public, qui demande de plus un plus d’imprimés et
d’images, amène un troisième grand changement. Alors que jusqu’au XVIIIᵉ siècle tout le
procédé de fabrication et conception du livre était confié aux libraires, à partir du XIXᵉ
siècle il devient nécessaire de séparer les deux travaux : à côté du libraire, qui continue à
s’occuper de la production physique du livre, naît la figure de l’éditeur, en charge de l’aspect
commercial et légal des ouvrages. En plus, ce sera à l’éditeur de s’occuper des rapports avec
les écrivains, avec les illustrateurs, et il gérera aussi la relation entre les deux artistes.
L’éditeur sera donc évidemment la clé pour connaître les rapports de force entre auteurs et
illustrateurs, baromètre de la querelle qui se développera après l’invasion massive de l’image
dans la littérature. Le livre se transforme : il n’est plus un support du texte écrit, un
instrument didactique, mais un objet doué d’une valeur commerciale. Beaucoup des grands
projets éditoriaux comme Les Français peints par eux-mêmes ou les Scènes de la vie privée et
publique des animaux n’auraient pu être entrepris sans la coordination des grands éditeurs, tels
Hetzel et Curmer. La période des grands éditeurs débutera sous le règne de Louis-Philippe ;
pendant la Restauration, le libraire-éditeur était gêné par la faiblesse du système bancaire,
« qui n’assure pas aux entrepreneurs un crédit solide et sûr »55. Par conséquent, les débuts
du livre romantique sont lents et hésitants.
54 C. Bouquin, « Lithographie », dans Dictionnaire encyclopédique du livre, Pascal Fouché, Daniel Péchoin et Philippe Schuwer (dir.), Paris, Éd. Du Cercle de la librairie, 2005, t. [2] E-M, p. 782. 55 R. Chartier, op. cit., p. 543.
40
1.3. Les trois ancêtres du livre romantique. Vers le règne du personnage
Ce sont trois œuvres qui, notamment, annoncent l’esthétique romantique qui s’affirmera
dans les livres de la décennie suivante : les Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne
France du baron Taylor et de Charles Nodier, dont les trois premiers volumes, dédiés à
l’Ancienne Normandie et à la Franche Comté, ont été publiés en 1820 et en 1825 ; les
Chansons de Béranger en 1828 ; et, de la même année, la traduction française du Faust de
Goethe, édité par Motte, et illustré par Delacroix.
Il est certain que Balzac connaissait les trois ouvrages en question. Béranger,
notamment, « chantre gracieux et philosophe »56, est cité dans la Lettre XI sur Paris, modèle
par excellence du chanteur visant au cynisme. Bien que Balzac ne fasse pas de référence
directe ni à la première édition illustrée des Chansons publiée en 1828 chez Baudouin frères,
enrichie de 40 lithographies coloriées de Henri Monnier et des culs-de-lampe gravés sur
bois par Devéria, ni à la deuxième version éditée en 1829 chez Perrotin, qui contenait des
vignettes gravées en taille douce par plusieurs artistes, il est fort probable qu’il avait eu dans
les mains un exemplaire au moins de l’une de ces deux éditions57. Les dessins de Monnier et
Devéria représentent l’un des premiers exemples de littérature contemporaine illustrée par
l’association entre le bois de bout et la lithographie. La composition du livre démontre un
lien avec la tradition Didot encore très forte, dans le but purement ornemental de l’image,
mais elle se distingue par la « touche spirituelle et légère » des images58.
Le véritable tournant esthétique arrive avec les deux autres ouvrages que nous avons
mentionnés. On comprend l’importance des Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne
France dès l’« Introduction » élaborée par Charles Nodier, qui présente le premier volume
d’un projet éditorial qui comptera, à la fin, 24 tomes, le dernier étant publié en 1878. Les
illustrations sont exécutées par Horace Vernet, Isabey, Fragonard le Fils et Bonington,
lorsque l’ornementation des titres est confiée à Célestin Nanteuil. La présentation de
56 H. de Balzac, Lettres sur Paris, OD, Pl., t.II, p. 936. 57 Voir G. Vicaire, Manuel de l’amateur de Livres du XIXᵉ siècle (1801-1893), pp. 403-406 : l’édition Baudouin frères, parue d’abord en livraisons, se compose de deux volumes in-8° ; l’édition Perrotin avait paru elle aussi en livraisons avant d’être recueillie en trois volumes in-18. Nous soulignons un fait significatif : Vicaire reporte la notice de plusieurs albums dessinés par Monnier et Johannot inspirés des Chansons de Béranger, qui démontrent combien cette œuvre de Béranger fut un sujet très inspirant pour les artistes du moment (Collection de quinze vignettes destinées à orner les chansons de Bèranger, une suite de 15 dessins coloriés par Monnier, 1827 ; Album de 24 lithographies coloriées in-4 par Monnier, 1884 ; une suite de 8 vignettes libres non signées gravées sur arcier, dont il existe aussi des eaux-fortes, que Vicaire attribue à Tony Johannot, lorsque Béraldi les attribue à Devéria comme épreuves pour les Chansons érotiques). 58 R. Brun, op. cit., pp. 119-120.
41
Nodier fait assister à la naissance du nouveau goût romantique, lié à l’esthétique de la
ruine : Nodier affirme que le « penchant » de ce voyage est dû à :
Quelque disposition mélancolique dans les pensées, quelque prédilection involontaire
pour les mœurs poétiques et les arts de nos aïeux, le sentiment de je ne sais quelle
communauté de décadence et d’infortune entre ces vieux édifices et la génération qui
s’achève ; le besoin, peut-être assez général d’ailleurs à tous les hommes, de jouir de
l’aspect fugitif d’un tableau que le temps va effacer.59
Un « voyage d’impressions »60, donc, plutôt que de découverte, où la fidélité à l’histoire est
surclassée par les émotions ; c’est le sentiment nostalgique lié aux traces du passé médiéval
qui conduit à observer les monuments. Quelques pages plus loin, Nodier dédie une
réflexion particulière à la technique choisie pour les nombreuses illustrations du livre, c’est-
à-dire la lithographie :
Le nouveau procédé connu sous le nom de Lithographie n’a pas obtenu l’approbation
unanime des gens de goût ; et le tort en est peut-être au mauvais usage qui a été fait de
cette invention, comme de toutes les inventions nouvelles que l’ignorance dénature, et
que le cynisme déshonore. Il ne nous appartient pas de décider ce que cet art peut
produire, et de fixer le terme de ses perfectionnements : mais il nous est permis de
penser qu’il présente pour un ouvrage du genre de celui-ci d’incontestables avantages.
Plus libre, plus original, plus rapide que le burin, le crayon hardi du lithographe semble
avoir été inventé pour fixer les inspirations libres, originales et rapides du voyageur qui
se rend compte de ses sensations.61
Ce témoignage sur les difficultés que la lithographie a dû relever avant de s’affirmer est bien
précieux, non seulement pour la bibliothéconomie mais aussi pour la littérature. En fait, il
est significatif que la défense de la nouvelle technique de gravure soit confiée à un écrivain,
et non à l’éditeur de l’ouvrage. Il nous donne des informations significatives sur les
rapports de force qui commencent à s’établir entre auteur et dessinateur, entre texte et
image. D’abord, l’éditeur semble rester, pour le moment, au deuxième plan, laissant libres
écrivains et illustrateurs d’organiser la matière du livre à leur discrétion. Deuxièmement, le
Voyage est construit sur une alternance entre texte et illustration qui ne suit pas de règles
précises, l’inspiration du moment étant la raison de la disposition de ces deux éléments.
59 C. Nodier, J. Taylor, et A. de Cailleux, Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, Paris, imprimerie Didot frères, 1820, t.I, p. 4. 60 Ibid., p. 5. 61 Ibid., p. 10.
42
Démarche qui sera prise comme modèle, presque vingt ans après, par Musset, Stahl et
Johannot pour leurs Voyages où il vous plaira.
Que ce soit Nodier chargé de cette défense de la lithographie est d’autant plus
significatif, alors qu’il est reconnu universellement comme le fondateur de l’école
romantique française grâce à sa production littéraire et à ses soirées qu’il donnait au salon
de l’Arsenal, où les écrivains tel que Victor Hugo et Balzac même se réunissaient avec des
peintres et illustrateurs comme Delacroix et Devéria. C’est Nodier qui, à partir de 1824, en
ouvrant les portes de son salon permit le dialogue entre artistes de disciplines et d’opinions
politiques différentes, et qui rendit possible l’ouverture vers l’échange des arts qui servira le
culte de l’image qui éclate dès la décennie suivante. Les Voyages sont déjà eux-mêmes un
signe de cette volonté de rencontre entre les arts, où le caractère envahissant des
illustrations, qui sont vraiment nombreuses, tout comme la présence de la figure de
l’écrivain-peintre, est le véritable leitmotiv de la période 1830-1850 :
Des motifs qui me sont plus personnels sembloient m’interdire une coopération
téméraire à ce livre des monuments qui peut devenir un monument. Qui suis-je en
effet pour me trouver uni aux talents éminents qui contribuent à sa publication ? De
quel droit oserai-je marier les froides descriptions de ma plume aux descriptions
animées de leurs pinceaux ? Pour participer à leur entreprise, il falloit pouvoir s’écrier
comme le Corrège : Et moi aussi, je suis peintre !62
Les Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France deviennent ainsi un point de départ
pour la nouvelle école littéraire, en établissant trois thèmes et réflexions essentiels à la
génération romantique : le voyage sentimental ; l’accueil de l’illustration dans le livre,
notamment de la nouvelle technique lithographique ; et le mélange entre les arts. Balzac,
qui sans doute connaissait le livre de Nodier, semble avoir accueilli les deux derniers
thèmes, en négligeant pourtant le premier : Jeannine Guichardet a remarqué comme Balzac
prend ses distances par rapport à l’image-document des Voyages, alors qu’il préfère
concentrer son observation sur les édifices encore « vivants », voir qu’ils font partie –
encore – de la vie quotidienne, plutôt que sur des ruines abandonnées63.
62 Ibid., p. 12. 63 J. Guichardet, Balzac archéologue de Paris, Genève, Slatkine, 1986, pp. 410-411.
43
Figure 3, 4 et 5 : Illustrations pour les Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France de Nodier et Taylor, 1824
44
Une décision qui répond à la progressive nécessité ressentie par les écrivains comme
Balzac de donner une voix au mal du siècle, de narrer le contemporain. Par conséquent, les
illustrations crées pour Balzac seront assez différentes de celles faites pour Hugo, par
exemple. Nous approfondirons cette comparaison dans les chapitres suivants ; pour le
moment, il est suffisant de rappeler, comme exemple, que l’un de premiers romans illustrés
après le tournant de 1830 fut Notre-Dame de Paris, qui lança le modèle du frontispice « à la
cathédrale »64, et qui démontrait sa volonté de poursuivre l’esthétique romantique de la
ruine inaugurée par Nodier, en érigeant comme protagoniste soit du livre soit de ses
illustrations l’édifice de la cathédrale plutôt que les personnages. Balzac, qui dans un
premier temps avait cherché à suivre le modèle hugolien en écrivant Les Proscrits, ne réussira
pas à avoir la même puissance que Notre-Dame de Paris, le personnage étant déjà le centre de
la narration. L’univers balzacien, bien qu’il soit souvent comparé à une cathédrale
inachevée, se fonde sur le système du personnage reparaissant ; les illustrations de La
Comédie humaine seront la confirmation de sa suprématie sur tous les autres éléments du
roman.
64 Voir S. Le Men, La Cathédrale illustrée. De Hugo à Manet, op. cit., p. 105 : « Les frontispices de Nanteuil reposent, dans leur structure « à la cathédrale », sur une équivalence entre la façade de la cathédrale et le frontispice du livre […] ».
Figure 6 : Frontispice par Nanteuil pour Notre-Dame de Paris de Hugo
45
Dans cette perspective, les illustrations de Delacroix pour le Faust de Goethe
assument une importance assez considérable. Si les Voyages pittoresques et romantiques dans
l’ancienne France représentent un modèle pour les illustrations du site, le Faust illustré par
Delacroix constitue un point de bascule pour les illustrations du personnage. L’histoire du
mythe de Faust est résumée par le traducteur Albert Stapfer dans la préface au texte : Faust,
« espèce de don Juan du nord », est un docteur qui a vécu au XVIᵉ siècle, et ses aventures
ont inspiré en premier lieu l’anglais Christopher Marlowe. En Allemagne, Faust a été un
sujet pour le théâtre des marionnettes jusqu’à la fin du XVIIIᵉ siècle, lorsque Lessing et
Klinger ont commencé à le traiter de manière sérieuse dans le roman. « Puis enfin M. de
Goethe, leur maître à tous, sur les brisées duquel il n’y a point d’apparence que personne
s’aventure, autrement que pour l’imiter »65 ; Goethe sera le seul, selon Stapfer, à réussir
l’entreprise de restituer l’essence de cette légende : « pour être goûtées de nos jours, les
absurdes légendes du moyen âge ont grand besoin de toute l’imagination et de tout l’esprit
de M. de Goethe ; aussi ne s’en est-il servi que comme on se sert d’un canevas, sur lequel
on brode absolument ce que l’on veut »66.
Mais Goethe n’avait pas besoin de l’éloge de Motte : son Faust avait reçu
l’acclamation de l’Europe entière, et l’édition Motte n’avait pas besoin d’introduire l’auteur
pour le public, alors qu’elle n’était pas la première traduction française de l’ouvrage. Un fait
d’autant plus évident par la position de ces lignes dans la préface : l’éloge de Goethe
n’arrive que dans la deuxième partie de l’écrit, après la présentation de composition du
texte traduit et, surtout, après le commentaire sur la haute « figurabilité » de l’œuvre, voire
l’ouverture du texte à sa mise en image. À vrai dire, la célébrité du Faust était liée aux
gravures « au trait » dessinées par Moritz Retzsch, plutôt qu’au texte de Goethe. Évanghélia
Stead a bien démontré que les 26 illustrations de Retzsch, devenues « une narration
picturale continue qui narrativise le premier Faust dont elle devient le succédané
synoptique »67, influaient énormément sur la réception du texte. La diffusion et le succès
que ce dernier connut en Angleterre furent répandus par les traductions en anglais qui
souvent prenaient la forme de l’album lithographié ou vade-mecum regravés pourvus de
65 A. Stapfer, « Préface », dans J.W. Goethe, Faust, trad. en français par Albert Stapfer, illustrations par Eugène Delacroix, Paris, Motte éditeur, 1828, p. III. 66 Ibidem. 67 É. Stead, « Le voyage de l’image de Faust I de Goethe. Lecture, réception et iconographie extensive et
intensive au XIXᵉ siècle », dans L’image à la lettre, Nathalie Preiss et Joëlle Raineau (dir.), Paris, éditons Paris-Musées/des Cendres, 2005, p. 139.
46
légendes, le résumé iconographique tendant à remplacer le texte : « Les gravures ont
acclimaté le texte, aidé à sa compréhension et encouragé de façon tangible sa traduction »68.
Les gravures de Retzsch furent employées aussi dans les nombreuses productions théâtrales
qui se jouaient en Angleterre et en Allemagne. Delacroix lui-même assistait à une des
premières représentations en avril 1825 à Drury-Lane, pendant son séjour en Angleterre :
J’ai vu ici une pièce de Faust qui est la plus diabolique qu’on puisse imaginer. Le
Méphistophélès est un chef-d’œuvre de caractère et d’intelligence. C’est le Faust de
Goethe, mais arrangé : le principal est conservé. Ils en ont fait un opéra mêlé de
comique et de tout ce qu’il y a de plus noir. On voit la scène de l’église avec le chant
du prêtre et l’orgue dans le lointain. L’effet ne peut aller plus loin sur le théâtre.69
Au début de sa préface, Stapfer ne nomme pas Retzsch, mais il parle des chefs-d’œuvre qui
ont inspiré des peintres :
Il est certains poèmes qui ont eu de tout temps le privilége [sic.], pour ainsi dire
exclusif, d’éveiller l’imagination des peintres ; tels sont, entre autres et par excellence,
l’Iliade et l’Odyssée d’Homère, le Paradis perdu de Milton, le Roland furieux du divin
Arioste ; on ferait un volume avec la simple énumération des tableaux ou dessins
remarquables qu’ils ont inspirés depuis leur apparition jusqu’à nos jours. Parmi les
compositions poétiques tout-à-fait modernes, qui, sous ce rapport, méritent de lutter
avec celles que nous venons de nommer, le Faust de M. de Goethe doit être mis au
premier rang70.
Ce qui devrait assurer à Goethe la première place dans ce panthéon littéraire-artistique est
bien le personnage ; mais, alors que les antécédents évoqués par le préfacier sont tous des
personnages mythiques qui sont devenus très connus pour leurs actions, pour leurs quêtes,
Faust se distingue par d’autres raisons :
Ce grand homme a su donner tant de vie aux personnages fantastiques qui abondent
dans cette tragédie, qu’on est obligé d’y croire comme à des personnages réels, et de
leur prêter une figure, un geste, un accent particulier ; on les voit agir, on les entend
parler ; pour chaque scène nouvelle, le lecteur, involontairement, compose en idée un
nouveau tableau.71
68 Ibid, pp. 140-141. 69 E. Delacroix, Correspondance, Paris, édition Plon, 1936, t.I, p. 160. 70 A. Stapfer, op. cit., p.I. 71 Ibidem ; c’est nous qui soulignons.
47
Les personnages de Goethe semblent tellement pleins de vie qu’il devient impératif de leur
donner une figure, une représentation iconique. Il n’est plus donc question de l’action
achevée par le personnage, mais de la description de son caractère, du degré
d’approfondissement de son intériorité.
Si nous savons que les personnages de la tragédie de Goethe s’inscrivent dans un
procès de modification de la construction du character72, qui tend de plus en plus à
privilégier le développement de l’aspect moral du personnage, le caractère devenant
presque la cause, la justification de ses actions ; le traitement du personnage dans
l’illustration a une histoire bien différente. Comme nous avons affirmé tout à l’heure,
jusqu’à la fin du XVIIIᵉ siècle le personnage était représenté de façon générique, la beauté du
corps étant plus importante que l’identification des protagonistes. Delacroix marque alors,
en cette perspective, une nouvelle étape : chaque personnage du Faust est bien
reconnaissable, le visage bien détaillé dans les traits. Pour le démontrer il est suffisant de
comparer, comme l’a fait Stapfer, les illustrations de Delacroix à celles de Retzsch, qui avait
créé les illustrations de Faust les plus appréciées à l’époque. Les dessins de M. Retzsch, bien
que dotés de finesse et d’esprit, manquent de quelque chose : « malheureusement ce sont
de simples croquis au trait, en général un peu froid, et qui même ne sont pas toujours
exempts de la roideur tant reprochée aux dessins semblables, que naguère Flaxman exécuta
pour Eschyle, Homère, Hésiode et le Dante »73. Ce reproche n’appartient certes pas aux
illustrations de cette édition :
Mais, s’il nous est permis d’anticiper sur le jugement du public, nous ne doutons pas
que chacun n’y admire la hardiesse avec laquelle le dessinateur s’est élancé, sur les pas
de M. de Goethe, hors des chemins battus ; toute la verve créatrice du poète, quelque
chose même de ce que les esprits exacts se plaisent à appeler son dévergondage
72 Ici, nous utilisons le terme anglais « character » puisqu’il rend très bien, à la différence du mot français « personnage » ou de celui italien « personaggio », le fait que le personnage commence à exister en raison de son caractère, de sa physionomie physique et morale, et non plus de ses actions. Le terme anglais en fait condense en soi cet aspect, alors que le français et l’italien dérivent du latin « persona », « masque », qui indique un rôle joué par un acteur. Voir M. Forster, Aspects of the novel, London, Sydney, Auckland, Hodder & Stoughton in association with Edward Arnold, 1993 (1927), p. 58 : « « Character », says Aristotle, « gives us qualities, but it is in actions – what we do – that we are happy or the reverse. » We have already decided that Aristotle is wrong, and now we must face the consequences of disagreeing with him. « All human happiness and mystery », says Aristotle, « take the form of action. » We know better. We believe that happiness and misery exist in the secret life, which each of us leads privately and to which (in his characters) the novelist has access. And by the secret life we mean the life for which there is no external evidence, not, as is vulgarly supposed, that which is revealed by a chance word or a sigh. A chance word or sigh are just as much evidence as a speech or a murder : the life they reveal ceases to be secret and enters the realm of action ». 73 J. W. Goethe, Faust, op. cit., p. I.
48
d’imagination, nous pensons que chacun l’y retrouvera du premier coup-d’œil. Ainsi,
pour les personnages qui n’avaient pu faire connaissance avec Faust que par
l’intermédiaire de notre faible traduction, cet ouvrage va, grâce à M. Delacroix,
reprendre la physionomie franche et originale qui lui appartient, et dont nous l’avions
dépouillé à leurs yeux74.
Exécutés avec la lithographie, les dessins de Delacroix traduisent beaucoup mieux le texte
de Goethe, en devenant en quelque sorte une traduction plus fidèle même que celle de
Stapfer. Stapfer fait sûrement référence aux critiques qu’il avait reçues quelques années
avant, à la première publication de sa traduction ; mais ces lignes sont aussi prémonitoires,
en introduisant un problème qui sera capital dès 1830, c’est-à-dire le niveau de fidélité de
l’illustration par rapport au texte.
On verra, dans la deuxième et la troisième partie de cette étude, comment dans la
période suivante la méfiance de plusieurs auteurs envers l’illustration sera liée précisément à
la loyauté de l’image vers le texte, l’illustration cherchant parfois à s’évader des limites
posées par les mots. Delacroix représente, dans ce cas, l’exemple d’une relation fructueuse
entre illustration et texte originaire ; Goethe lui-même avait déclaré sa satisfaction pour le
travail du jeune peintre, comme rapporte Eckermann, lors d’une rencontre avec l’écrivain
en 1828, quand il lui amena de Paris les épreuves des premières gravures :
Je vis représentée la scène sauvage des buveurs dans la taverne d’Auerbach, ou plutôt
la quintessence de cette scène, à son moment le plus dramatique, celui où le vin
répandu jaillit en flammes et où la bestialité des buveurs se donne libre cours. Tout est
passion et mouvement, seul Méphistophélès conserve sa sereine impassibilité…Les
blasphèmes forcenés, les cris, les imprécations, le couteau que son voisin a dégainé, le
laissent indifférent. Assis sur un coin de la table, il balance ses pieds dans le vide. Il
suffit de son doigt levé pour éteindre la flamme et calmer les passions. Plus nous
regardions cette magnifique image et plus nous apparaissait grande l’intelligence de
l’artiste qui n’a pas fait deux figures semblables, mais exprime dans chacune un aspect
différent de l’action commun. « M. Delacroix, dit Goethe, est un artiste d’un talent
d’élite, qui a précisément trouvé dans Faust la pâture qui lui convient. Les Français lui
reprochent sa fougue ; mais ici elle est parfaitement à sa place… ». Je fis observer que
de telles illustrations contribueraient beaucoup à l’intelligence du poème. « La question
ne se pose même pas, dit Goethe, car la puissante imagination de cet artiste nous
74 Ibid., p. I-II.
49
oblige à repenser les situations aussi parfaitement qu’il les a pensées lui-même…Je
dois avouer que, dans ces scènes, M. Delacroix a surpassé ma propre vision… »75.
Il est clair alors que l’illustration, avec Delacroix, ne se limite plus à être un simple décor du
livre : elle commence vraiment à participer à la construction de la narration, comme
« traduction » mais aussi comme passeport vers l’ouverture de l’imagination, du lecteur
aussi bien que de l’auteur lui-même, comme le démontre le cas de Goethe. Ce changement
est visible déjà dans la différence entre les illustrations de Retzsch et celles de Delacroix :
Retzsch inspire cependant Delacroix de façon très libre en tant que matrice
iconographique […]. Or, si cette influence ne frappe pas d’emblée, c’est que Delacroix
extrait le plus souvent de la scène retzschienne inspiratrice son potentiel dramatique
pour l’intensifier. […] Réinvestie par Delacroix, l’action explicitée par Retzsch acquiert
une dimension symbolique et métaphorique qui rejoint la profondeur du texte.76
Prenons en analyse quelques illustrations, en commençant par la première image du livre
proposée par Retzsch, en la comparant avec la première de Delacroix. Tous les dessins de
Retzsch seront caractérisés par la couleur blanche, comme celui-ci : le noir délimite le
contour des figures, alors que le blanc crée une sorte de miroir opaque qui refroidit et
aplatit les personnages, en les privant de solidité, de volume, de caractère. L’image présentée
par Retzsch devrait représenter Dieu, entouré par un groupe des anges, en contemplation
du monde. Puisque Dieu, comme dira Faust dans les pages suivantes, est pure Activité77, il
ne peut être représente sous aucune forme, le mouvement n’ayant pas une figure, la place
que devrait occuper Dieu dans l’illustration est vide, pur blanc. Le Personnage par
excellence est absent de la scène, en laissant deviner sa présence au lecteur-spectateur ; il est
le symbole d’une époque qui n’a pas encore vraiment accepté la suprématie du personnage,
même si le roman de Goethe marquera une étape significative dans ce sens. L’illustration
de Delacroix paraît vigoureusement en contraste avec celle de Retzsch : dominée par le
noir, l’image montre une créature infernale survolant une ville, avec un visage de bête
tourné vers un ciel menaçant, où on ne trouve aucune trace ni de Dieu ni de ses anges.
75 Citation d’Eckermann reportée dans : J. W. Goethe, Faust, traduit en français par Albert Stapfer et illustré par Eugène Delacroix, Paris, éditions Marchal, 1982, pp. 224-225. 76 É. Stead, op. cit., pp. 152-153. 77 Avant que Méphistophélès se métamorphose de chien â être humain, Faust est dans son bureau à s’interroger sur la nature divine. Il ouvre la version en grec du Nouveau Testament, et il cherche à traduire le vers « Au commencement était la Parole ». Éclairé par un esprit, finalement il le traduit ainsi : « Au commencement était l’Activité ». J. W. Goethe, Faust, op. cit., p. 36.
50
Figure 7 : Méphistophélès dans la taverne. Lithographie par Delacroix
Figure 8 : Deesin Le Ciel par Retzsch Figure 9 : Lithographie Méphistophélès par Delacroix
51
L’atmosphère est bien plus sombre, tendant au style gothique. Les contours de
l’image même ne sont pas bien définis – contrairement à la tradition classique qui veut
l’illustration bien enfermée dans un cadre. Non plus le Ciel mais l’Enfer ouvre la narration,
et le personnage de Méphistophélès s’incarne en une image sublime, triomphale grâce au
grand format du livre.
En plus, les personnages principaux du drame sont toujours bien identifiables.
Méphistophélès, Faust et Marguerite ont des visages « personnalisés » :
Figure 10 : Les visages de Faust. Détails de trois lithographies de Delacroix
Les personnages sont toujours au premier plan, alors que l’ambiance et les objets sont en
arrière ; la perspective entre finalement dans les illustrations, en créant l’illusion d’une scène
de théâtre, le personnage émergeant du décor qui l’entoure. Particulière est la scène où
Faust rencontre pour la première fois Marguerite : Méphistophélès semble prêter ses traits
à Faust, comme s’il fallait dans cet instant que le destin malheureux de Faust – mais surtout
de Marguerite – s’accomplisse, en laissant une marque infernale sur le visage du
protagoniste.
Le mérite de Delacroix est donc d’avoir réussi à comprendre que la force du texte de
Goethe résidait dans les personnages – comme on le voit clairement dans le passage de la
lettre de 1825 que nous avons citée à haut. À propos du Faust de Goethe, Mme de Staël
écrivait que :
Milton a fait Satan plus grand que l’homme ; Michel-Ange et le Dante lui ont donné
les traits hideux de l’animal, combinés avec la figure humaine. Le Méphistophélès de
Goethe est un diable civilisé. Il manie avec art cette moquerie, légère en apparence, qui
peut si bien s’accorder avec une grande profondeur de perversité ; il traite de niaiserie
ou d’affectation tout ce qui est sensible ; sa figure est méchante, basse et fausse ; il a de
la gaucherie sans timidité, du dédain sans fierté, quelque chose de doucereux auprès
des femmes, parce que, dans cette seule circonstance, il a besoin de tromper pour
séduire : et ce qu’il entend par séduire, c’est servir les passions d’un autre ; car il ne
52
peut même faire semblant d’aimer. C’est la seule dissimulation qui lui soit possible. Le
caractère de Méphistophélès suppose une inépuisable connaissance de la société, de la
nature et du merveilleux.78
On pourrait donc dire avec Max Milner que « Goethe révèle peu à peu au public français
une nouvelle manière, effrontée et sarcastique, d’être diable »79, il est vrai aussi que
Delacroix a commencé une nouvelle manière de traduire le texte en image, en secondant le
développement du personnage littéraire et en l’introduisant dans l’art.
En réalité, l’édition Motte ne fut pas si bien accueille par le public, qui n’apprécia ni la
traduction de Stapfer – fidèle, mais peu plaisante – ni les dessins de Delacroix. Balzac, de
son côté, en fut certainement un admirateur ; on en trouve plusieurs références dans ses
œuvres. Barthélémy Jobert note que :
Soulignons pour l’instant cette permanence de Méphistophélès et du Faust,
probablement l’œuvre de Delacroix que Balzac connaissait le mieux, très
probablement parce qu’il en possédait un exemplaire (c’est comme cela qu’il faut sans
doute comprendre l’allusion des Petites misères de la vie conjugale : « que j’ai sur ma table
»). En effet, n’oublions pas que Balzac occupait, au début 1828, l’atelier d’imprimerie
de la rue Visconti (où d’ailleurs Delacroix résida une petite dizaine d’années plus tard).
Mais un peu plus loin dans la rue, il y avait Motte, l’imprimeur lithographe à l’origine
même de l’exécution du Faust par Delacroix, à qui il avait proposé le projet. On peut
facilement imaginer que Balzac et Motte, habitant la même rue, ayant des occupations
analogues, se soient liés. Et que Balzac ait bénéficié sinon d’un exemplaire du Faust,
au moins de quelques feuilles, qu’il en ait vu les épreuves d’essai, bref que ce soit
l’œuvre de Delacroix qu’il ait la mieux connue, par les circonstances, par le fait aussi
qu’en 1828, il se formait son goût artistique.80
Le Faust de l’édition Motte fut sans doute important dans la formation de Balzac, non
seulement dans son éducation artistique mais aussi dans sa connaissance du livre, comme
dans le développement de sa conception du personnage.
78 Mme de Staël, De l’Allemagne, Paris, H. Nicolle, 1810, t. II, p. 177. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31397144g 79 M. Milner, Le Diable dans la littérature française. De Cazotte à Baudelaire (1772-1861), Paris, José Corti, 2007, p. 372. 80 B. Jobert, « Delacroix chez Balzac », AB 2011, p. 71.
54
La Peau de chagrin, notamment, roman à l’enseigne d’un climat pareillement gothique, bien
que joué à l’époque contemporaine, aura une grande dette envers Goethe et Delacroix, en
réinventant le personnage de Méphistophélès dans la figure du vieil antiquaire.
Quant aux illustrations, celles de Delacroix arrivaient trop tard pour influencer le
travail de Balzac comme éditeur et imprimeur. En 1828, Balzac, en faillite, se préparait à
faire une nouvelle tentative avec la littérature. Pourtant, nous sommes convaincus que
l’exaltation du personnage dans l’illustration mise en acte par Delacroix trouvera une
continuation non seulement chez Balzac, mais chez toute la deuxième génération
d’illustrateurs romantiques dont nous parlerons dans le troisième chapitre.
Maintenant que les antécédents les plus significatifs de l’histoire de l’illustration ont
été expliqués, nous pouvons accorder toute notre attention au cas spécifique d’Honoré de
Balzac : dans le chapitre suivant, nous décrirons le parcours suivi par Balzac éditeur et
imprimeur, en mettant en évidence son soin et son implication dans la question de
l’illustration. Dans le chapitre 3, nous montrerons en suite comment Balzac s’est encore
plus approché de l’illustration, vers 1830-1831, grâce à sa participation à la presse illustrée,
collaboration qui lui avait permis de faire la connaissance des grands caricaturistes de
l’époque, parmi lesquels nous trouvons Daumier, Gavarni, Grandville et Monnier.
55
CHAPITRE 2
BALZAC ROMANCIER ET ÉDITEUR AVANT 1830 :
LES DÉBUTS DE L’ILLUSTRATION
Balzac n’est plus capable de penser à une petite échelle, de
travailler ou de vivre à une petite échelle. Le jeune étudiant
économe et ménager de chaque sou qu’il était est devenu
l’impatient, l’effréné, l’insatiable, qu’il restera toute sa vie. Donc
vite le Molière après le La Fontaine ! Il est plus facile de placer
deux livre qu’un seul. Au diable le petit commerce !
Stefan Zweig, Balzac. Le Roman de sa vie, 1946
Quand Balzac arrive à Paris en 1819 avec l’intention de devenir un grand écrivain, il porte
avec lui, dans sa petite mansarde du 9, rue Lesdiguières, un grand enthousiasme pour tout
ce qui concerne l’art. De fait, son premier acte de liberté sera l’achat d’une gravure qui
ornera sa chambre :
Je me faisais une fête de t’écrire, Rue Lesdiguières, Mon bon Honoré, ne voilà-t-il pas
que je vais croire que le n°9 n’est pas un bon numéro, - puisque maman me charge de
quelques reproches pour toi ; papa nous a dit que tes premières actions de liberté
avaient été d’acheter une glace carrée et dorée, une gravure pour orner ta chambre,
maman ni papa ne sont contents ; mon bon frère ; tu es maître de ton argent, aussi
devais-tu le bien employer au loyer blanchissage et nourriture, quand nous pensons à
ce que [sont] 8f. de dépense sur ce que dans ce moment de gêne, papa et maman ont
pu donner […].81
Quel est l’artiste ou quel est le sujet de cette gravure, nous l’ignorons. Ni Laure Balzac ni
d’autres contemporaines de Balzac qui ont écrit sur la jeunesse du romancier ne donnent
des informations plus précises sur cette image, destinée peut-être à rester l’un des mystères
qui entourent le créateur de La Comédie humaine.
81 H. de Balzac, Corr., Pl, t.I, p. 11. Le 1er avril le père de Balzac avait cessé ses fonctions de directeur des vivres, il passait donc de 7800f. de revenus à une maigre retraite de 1695f. dont la liquidation contestée se faisait attendre ; c’est nous qui soulignons.
56
Cette gravure marque, quand même, les débuts du Balzac collectionneur de livres,
d’estampes, de tableaux et d’objets précieux. Aidé et encouragé par Théodore Dablin82,
Balzac commence à développer son goût pour l’art et pour le bric-à-brac. La gravure est
certainement au centre de l’éducation artistique de Balzac : même si nous savons peu de
choses des estampes qu’il a possédées ou vues dans ces années de formation, on trouve
parfois dans la correspondance des allusions à certaines gravures qu’il avait vues ou
achetées. Le 1er septembre 1828, par exemple, dans une lettre au général baron de
Pommereul, il parle de sa tentative de vendre des estampes du graveur François Piranesi,
dont le fond de gravures fut mis en vente précisément en 1828, cette coïncidence n’aidant
pas Balzac, à la recherche d’argent pour payer ses dettes : « malgré mes efforts, et après
avoir vu bien des étrangers, russes et anglais, le Piranesi et les livres sont encore là. Il y a eu
un événement qui met le Piranesi à terre. C’est la vente des cuivres originaux qui a eu lieu à
Paris il y a trois mois »83.
« Collectionnisme » à part, la décennie 1820-1830 représente pour Balzac un
apprentissage, une formation technique sur l’art de la gravure. À partir des frontispices de
ses œuvres de jeunesse, jusqu’à son expérience d’éditeur, d’imprimeur et de fondeur de
caractères, Balzac approche l’illustration de façon plus technique que d’autres écrivains. Ce
chapitre entreprend d’un côté l’analyse des deux frontispices des romans de jeunesse que
Balzac avait publiés, sous pseudonyme, dans les années 1820. De l’autre, nous allons
parcourir à nouveau la carrière de Balzac imprimeur pour comprendre à quel point il a été
engagé dans le processus de révolution technique dont nous avons parlé dans le premier
chapitre, en analysant les ouvrages illustrés imprimés par Balzac.
2.1. Les frontispices des Œuvres de jeunesse
Les Œuvres de jeunesse de Balzac ont constitué, et constituent parfois encore aujourd’hui, un
trésor pour les spécialistes de l’auteur. Cette partie de la production balzacienne soulève de
graves problèmes sur la réelle paternité de l’auteur de La Comédie humaine de ces ouvrages :
entre 1820 et 1830, Balzac a signé ses livres de nombreux pseudonymes (Lord R’Hoone,
Viellerglé, Horace de Saint-Aubin, etc.), pseudonymes qui pouvaient cacher la collaboration
entre deux ou plusieurs écrivains dans la rédaction d’une œuvre, ou bien qui pouvaient être
82 Pour tout approfondissement du rapport entre Balzac et Dablin, voir : M. Fargeaud, « Le premier ami de Balzac : Dablin », AB 1964, pp. 3-24 ; A. Maës, « L’illustre ascendance de Théodore Dablin. Une famille de serruriers du roi à Rambouillet sous Louis XVI », AB 2017, pp. 41-66. 83 H. de Balzac, Corr., t.I, p. 338.
57
réutilisés par d’autres auteurs, ce qui empêche d’identifier avec certitude le vrai auteur du
livre en question.
Aujourd’hui on a progressé dans cette activité d’identification, grâce aux travaux qui
ont été conduits à partir des années 1950, époque qui a donné l’élan à ce type de recherche
en vue des grandes rééditions des Œuvres complètes de Balzac, parmi lesquelles nous
rappelons notamment l’édition établie par Jean A. Ducourneau, celle des éditions
Rencontre dirigée par Roland Chollet et la nouvelle édition Pléiade dirigée par Pierre-
Georges Castex. Ces énormes travaux de réédition ont posé de nombreuses questions par
rapport à la classification de ces ouvrages de jeunesse, reniés par Balzac. On a décidé de
nommer ce groupe d’œuvres appartenant à des genres différents – articles de presse, codes,
essais philosophiques, pièces de théâtre, récits – « Œuvres diverses ». L’édition Pléiade dirigée
par Pierre-Georges Castex représente la dernière mise à jour faite sur cette partie de la
production balzacienne : dans l’introduction, les éditeurs expliquent les choix qui ont été
faits sur les titres à insérer dans les Œuvres diverses, en soulignant le fait que cette édition a
impliqué un nouveau travail sur les textes traditionnellement attribués à Balzac qui a porté à
l’exclusion de certains d’eux. Les études de Bruce Tolley et de Roland Chollet84,
notamment, ont constitué un point fondamental en ce sens.
Parmi les Œuvres diverses, les « romans de jeunesse » constituent le groupe qui nous
intéresse. Ces romans ne sont pas recueillis dans l’édition Pléiade de Castex, comme le
projet originaire prévoyait de les regrouper dans un volume à part. Toutefois, les lecteurs de
Balzac intéressés par les romans de jeunesse ont à leur disposition deux autres éditions :
celle des Bibliophiles de l’originale, publiée dans les années 1960, qui dédie un volume à
chacun de ces romans, et l’édition Robert Laffont, composée par deux volumes titrés
Premiers romans (1999). Cette dernière se distingue par l’introduction et les notes d’André
Lorant, l’un des chercheurs qui a fait des romans de jeunesse balzaciens son sujet d’étude,
et qui a contribué le plus à mettre en lumière l’importance de ces ouvrages, sorte de
laboratoire du romancier en herbe.
Pour faire une étude complète, nous avons feuilleté les éditions originales des Œuvres
diverses à la recherche de frontispices, de vignettes, d’illustrations qui auraient pu orner ces
84 Voir notamment : R. Chollet, Balzac journaliste. Le tournant de 1830, Paris, Garnier, 2016 (1983) ; B. Tolley, Balzac avant La Comédie humaine, Paris, Courville, 1936 et Id., « Les Œuvres diverses de Balzac », AB 1963, pp. 46-51.
58
livres. Les images auxquelles nous sommes remontée appartiennent toutes les deux aux
romans de jeunesse. Mais, avant de présenter les deux frontispices que nous avons réussi à
retracer, il est nécessaire de rappeler que la recherche d’illustrations des ouvrages balzaciens
de cette période est un travail ardu à cause de la disparition de la majorité des exemplaires
originaux de ces romans, probablement détruits au moment où Balzac a été menacé par la
censure. Louis-Jules Arrigon en donne un témoignage précieux dans Les débuts littéraires
d’Honoré de Balzac, où il raconte que :
À son retour à Paris, Balzac n’en avait pas moins repris sa besogne de tâcheron
littéraire. Le 16 novembre 1823, il cédait pour mille francs à Joseph Buissot, libraire, 3,
rue Pastourelle, la première édition, tirée à mille exemplaires, d’Annette ou le criminel,
suite du Vicaire des Ardennes. Une partie des exemplaires de ce dernier roman, jugé
immoral et de tendances irréligieuses, avait été saisie par l’autorité judiciaire et
détruite.85
Le manque d’exemplaires originaux s’est révélé, pour notre étude, d’autant plus grave par le
fait que les ressources auxquelles nous avons fait appel pour localiser les illustrations de ces
romans se montrent souvent en désaccord ; la comparaison entre ces différentes
informations n’a pas été suffisante pour parvenir à des résultats plus précis dans la
compilation de notre catalogue. Les outils sur lesquels nous nous sommes appuyée pour la
recherche sont de trois types. D’abord, nous avons consulté les catalogues des ouvrages
illustrés de la période romantique déjà existants, parmi lesquels : le catalogue composé par
Champfleury dans Les « Vignettes » romantiques. Histoire de la « Littérature » et de l'Art 1825-
1840 [Paris, Dentu, 1883] ; le Manuel de l'amateur de livres du XIXᵉ siècle de Georges
Vicaire [Paris, Éditions du Vexin français, diffusion Coulet et Faure (1894), 1974, vol. I, A-
B] ; la Guide de l'amateur. Bibliographie des ouvrages illustrés du XIXᵉ siècle, principalement des livres à
gravures sur bois de Jules-Jean-Baptiste-Lucien Brivois [Paris, L. Conquet, 1883] ; et la
Bibliographie romantique. Catalogue anecdotique des éditions originales des œuvres de Victor Hugo, Alfred
de Vigny, Prosper Mérimée... etc. de Charles Asselineau [Paris, P. Rouquette, 1872]. Puis, nous
avons fait des recherches dans les catalogues en ligne des bibliothèques de France86, en
comparant les résultats obtenus avec les données recueillies par les autres catalogues que
85 L.-J. Arrigon, Les débuts littéraires d’Honoré de Balzac, Paris, Perrin et Cie, 1924, p. 160. 86 Nous avons consulté, notamment, le Catalogue collectif de France, le catalogue de la BNF, le catalogue de l’Institut de France, le catalogue de la Bibliothèque Sainte Geneviève, le catalogue des Bibliothèques spécialisées de la Ville.
59
nous avons cités. Un troisième instrument qui s’est révélé d’une importance fondamentale
pour la vérification des données obtenues est l’édition de l’œuvre complète de Balzac des
Bibliophiles de l’originale, qui reporte en fac-simile les illustrations originales des œuvres
balzaciennes.
Les frontispices dont nous avons trouvé des notices sont au nombre de trois.
Georges Vicaire et Champfleury signalent la présence d’une lithographie en tête au premier
volume de l’édition Pollet du Vicaire des Ardennes (1822). Puis, Champfleury indique aussi
une lithographie signée « Choquet » dans l’édition Buisson d’Annette et le criminel (1824),
dont Vicaire ne donne pas de références. Par contre, Vicaire est le seul qui a inséré, dans
son catalogue des ouvrages illustrés, l’édition Pollet du Centenaire (1822), qui, à son avis,
devrait présenter une lithographie signée « B. » en tête du premier volume.
Nous n’avons pas réussi à retrouver la lithographie du Centenaire mentionnée par Vicaire,
qui, malheureusement, n’a pas donné une description de cette image : étrangement, aucune
des notices relatives aux exemplaires de la première édition de ce roman qui paraissent dans
le catalogue de la Bibliothèque de l’Institut de France et de celui dans Catalogue Collectif
de France ne signale une illustration. En revanche, les deux autres frontispices sont déjà
connus par les lecteurs de Balzac grâce aux éditions des Bibliophiles de l’originale, qui les
reproduit dans les deux volumes en question : ce sont les frontispices du Vicaire des
Ardennes et d’Annette et le criminel.
Le Vicaire des Ardennes (1822) appartient à la série d’ouvrages que Pierre Barbéris a
surnommés « cycle Pollet »87, à savoir l’ensemble des deux romans que Balzac publia chez
le libraire Pollet : Le Vicaire des Ardennes et Le Centenaire. Par contre, au niveau thématique ce
roman appartient à une autre série, à une « trilogie passionnelle »88, où le Vicaire des Ardennes
est rapproché de Wann-Chlore (écrit en 1822 mais publié en 1825) et d’Annette et le criminel, la
suite du Vicaire (1824). Comme l’a bien démontré André Lorant, dans ces romans on
ressent l’influence de deux éléments différents. D’un côté, Balzac exploite la nouvelle
vogue du roman noir, qui en France connaît un deuxième moment de succès grâce aux
rééditions des romans d’Ann Radcliffe et du Moine de Lewis en 1819, et à la traduction
française de deux œuvres de Maturin en 1821, Melmoth ou l’homme errant et Bertram ou le
87 P. Barbéris, Aux sources de Balzac : les romans de jeunesse, Genève-Paris, Slatkine, 1985, p. 131. 88 Définition par A. Lorant dans « Un jeune romancier à l’écoute de son cœur », introduction à Annette et le criminel, Paris, Flammarion, 1982, p. 9.
60
château de Saint-Aldobrand. De l’autre côté, la rencontre avec Mme de Berny marque
profondément Balzac ; la liaison avec Mme de Berny « semble libérer son imagination
créatrice […]. Il devient le romancier des passions illicites, le créateur de personnages en
guerre avec les conventions »89. En effet, les trois romans ont tous une passion immorale au
centre de leur histoire : Le Vicaire des Ardennes raconte un double inceste ; Wann-Chlore met
en scène un ménage à trois ; et dans Annette et le criminel une jeune fille très dévote tombe
amoureuse d’un pirate, poursuivi par la justice pour meurtre. C’est à cause de cela que Le
Vicaire des Ardennes fut ciblé par la censure.
89 Ibidem.
61
Ce qu’il est intéressant de voir à l’égard de notre sujet est le rôle joué par les
frontispices dans la présentation de ces œuvres « immorales ». Dans les années 1820 deux
types d’images peuvent précéder l’incipit du texte proprement dit : la marque de la librairie
et le frontispice. La marque de la librairie se trouve dans la page de titre, au milieu ou au
fond de la page ; en général, elle est constituée par une vignette, dont le sujet commence à
varier dans cette période en raison de l’auteur de l’œuvre. Parmi les œuvres de jeunesse de
Balzac, ce sont Wann-Chlore et l’Album historique et anecdotique les seuls qui présentent
une vignette de titre.
Le frontispice est l’« illustration qui figure en regard d'un titre de livre »90, qui
représente normalement le portrait de l’auteur ou une scène de l’ouvrage, sorte d’annonce
de l’histoire que le lecteur lira. L’ancrage de cette image d’ouverture au texte est donc plus
évident. Dans le cas du Vicaire des Ardennes, le frontispice est tout de même étrange : au lieu
90 http://www.cnrtl.fr/definition/frontispice
Figure 11 et 13 : La vignette de titre de Wann Chlore et de l’Album historique et anecdotique
62
du portrait de l’auteur, cette image représente le portrait de l’un des personnages principaux
du roman, à savoir Mélanie de Saint-André. En analysant les romans de jeunesse, André
Lorant a remarqué que c’est vraiment à partir de ces récits que Balzac commence à
expérimenter le « pittoresque » et le « pictural » dans la narration, l’art constituant un
élément d’innovation pour le roman : « le concept d’être de son temps, tout en renouvelant
sa facture, le concerne de près. Dès le début de sa carrière, il s’inspire des sources
iconographiques, intègre des références à la peinture dans les récits qu’il invente afin de
réhabiliter l’art du roman et de le rendre moderne »91. Dans Le Vicaire des Ardennes, le
personnage de Mélanie est chargé d’au moins trois références picturales : elle est comparée
à une Vierge de Corrège, à une fille de l’air de Girodet et de Gérard dans leurs tableaux
d’Ossian, et à Sapho à Leucade de Gros. Le frontispice instaure un ancrage avec le premier
des trois : Mélanie de Saint-André est dessinée comme une Vierge en prière, le visage
illuminé par une expression de paix et de douceur.
91 A. Lorant, « Sources iconographiques des romans de jeunesse de Balzac », AB 1998, p. 66.
64
Le frontispice qui ouvre Annette et le criminel est complétement différent : cette fois-ci
le frontispice ne représente pas un portrait mais une scène. L’histoire est marquée par trois
prémonitions d’Annette. Après avoir rencontré un homme mystérieux (Argow le pirate) sur
la route vers Valence, la jeune fille revoit l’étranger pendant qu’elle est en prière, agenouillée
sur un tombeau ; Mlle Gérard croise le regard d’Argow alors qu’elle lit, sur son livre de
prière : « Ce sera ton époux de gloire ». La deuxième prémonition prend la forme d’un
songe : après son enlèvement, Annette est sauvée par Argow, qui décide d’accueillir la jeune
fille au château de Durantal pour la protéger. Pendant la nuit au château, Annette rêve de
cet homme mystérieux, qui apparaît dans sa chambre et pose sa tête sur son sein ; ainsi, elle
découvre une ligne rouge qui fait le tour du cou d’Argow, signe du destin qui attend le
criminel. La dernière prémonition arrive au moment du mariage entre Annette et Argow :
pendant la nuit les deux époux entrent dans une église tendue de noir, contenant encore les
ornements d’un enterrement qui venait d’être célébré. L’obscurité dans laquelle l’église est
plongée effraie Annette, qui tombe dans un état d’inconscience :
La chevelure abondante d’Annette étoit détachée, elle répandoit ses boucles sur la
poitrine du pirate : elle saisissoit son mari avec une force rendue naïve par l’abandon
qui régnoit dans sa pose ; ses lèvres étoient décolorées, et son haleine d’ambroisie
s’échappoit par intervalles inégaux, de manière qu’on pouvoit en quelque sorte la voir.
– Annette !...mon Annette, disoit Argow au désespoir, reviens à toi, reviens ?...Toutes
ces figures horribles ont disparu !...Ne soyez plus effrayée ! […] Annette r’ouvrit les
yeux ; mais elle n’avoit pas entendu, elle parla, mais comme un être en proie à une
aliénation terrible : « Quel présage !...Nous mourrons !...Oui, mais nous mourrons
ensemble !...Il y a de la mort dans notre union !...92
C’est ce dernier présage que fait le sujet de l’illustration du frontispice.
L’image est bien différente par rapport à celle du Vicaire des Ardennes : non seulement
cette fois-ci c’est une scène qui fait le sujet de l’illustration, mais le style même de la
lithographie a complètement changé. Le dessin de Mélanie, aux traits plus fins, est dominé
par les couleurs blanc et gris ; par contre, dans la scène d’Annette et le criminel c’est le noir qui
caractérise la scène. Dans la partie supérieure de cette dernière image, on voit clairement les
murs de l’église : à l’angle du côté gauche on distingue clairement le morceau d’un tableau,
dont le sujet semble être la Vierge avec l’Enfant Jésus, et la partie inférieure d’une voûte
92 H. de Balzac, Annette et le criminel, Paris, Buissot, 1824, t.II, pp. 230-231.
65
d'ogive de l’église. Au côté droit de l’illustration, on trouve deux autres éléments de décor
sacré : un étendard avec un symbole mariano93 et le Christ en croix porté comme un
étendard. Au premier plan de l’image deux personnages sont représentés : un homme qui
soutient une fille vêtue de blanc, sur le point de tomber, les yeux fixés vers le haut. À
l’arrière-plan, deux prêtres et un autre homme causent entre eux, indifférents au malheur de
la jeune fille. La didascalie qui accompagne le frontispice ancre l’image à la scène du
mariage entre Annette et Argow : « Il y a de la mort dans notre union ! ». La fonction de
cette image à frontispice est donc clairement d’être un résumé de l’histoire : même si le
lecteur n’a pas encore commencé à lire le roman, le frontispice lui apporte beaucoup
d’informations. On comprend que le livre de Lord R’Hoone raconte l’histoire de deux
amants qui, au moment de leur mariage, reçoivent un mauvais présage. Le frontispice
d’Annette et le criminel recouvre donc une fonction plus classique par rapport à celui du
Vicaire de l’Ardennes, l’illustration étant l’annonce du thème central de l’histoire.
93 « Mariano » est un adjectif d’origine latine qui indique toute chose dédiée à la Vierge. Dans ce cas, dans l’étendard la lettre A, capitale de « Ave » (« je salue » en latin), se croise avec la M de Marie, en créant un symbole qui signifie Ave Maria (« je te salue Marie »).
67
Les deux frontispices que nous venons d’analyser témoignent donc d’une période
encore liée à l’« Ancien Régime typographique »94, où le frontispice se concentre sur un seul
élément, qu’il soit un portrait ou une scène ; nous sommes encore loin des frontispices
richement décorés, qui représentent plusieurs éléments de l’intrigue dans une unique image,
comme dans le frontispice « à la cathédrale » de Nanteuil. On peut donc affirmer que les
frontispices des Œuvres de jeunesse de Balzac s’inscrivent dans une tradition classique, où
l’écrivain ne semble pas concerné par le choix de l’image de ses livres.
En effet, ce n’est qu’à partir du 1825 que Balzac commence à s’intéresser à la
méthode d’illustration des ouvrages. Cette fois-ci, il ne sera pas question des œuvres écrites
par Balzac, mais de celles qu’il avait éditées.
2.2. Balzac et l’édition des Œuvres complètes de Molière et de La Fontaine
Le 17 avril 1825, Balzac se lance dans les affaires : il signe un contrat avec Urbain Canel où
les deux hommes s’engagent à partager les risques et les bénéfices d’une édition des Œuvres
complètes de Molière. Après la signature du contrat, le projet s’élargit : Canel et Balzac visent
une édition compacte à deux colonnes, en volume unique in-8°, non seulement de Molière
mais aussi de La Fontaine, de Corneille et de Racine. Les deux éditeurs ne réussiront à
mener à bien que le projet de Molière et de La Fontaine : d’abord publié en livraisons avant
d’être recueilli en volume, l’ouvrage n’obtient pas le succès espéré : « une telle édition,
difficile à lire, à cause de la petitesse des caractères, n’aurait pu obtenir la faveur du public
que par son bon marché »95. De plus, le nom de Balzac ne paraît qu’à partir de la 6ème
livraison. Comme l’on verra, la participation de Balzac à cette entreprise commerciale laisse
encore de nombreuses incertitudes aux spécialistes de l’auteur : pourquoi le nom de Balzac
ne paraît qu’à partir de la 6ème livraison de l’édition du La Fontaine parmi les noms des
éditeurs de l’ouvrage ? est-ce vraiment Balzac l’auteur de la notice sur « La vie de Molière »
qui est insérée dans l’édition en volume ? quel rôle Balzac a joué dans la préparation de ces
deux volumes compacts, notamment dans le choix de leurs illustrations ?
Répondre à toutes ces questions n’est pas facile, surtout à cause de la disparition de
certains documents qui auraient pu donner des informations plus précises sur cette partie
de la vie de Balzac. Il est certain que Balzac traverse une crise artistique vers 1825 ; il
94 R. Chartier, « L’Ancien régime typographique » dans Annales E.S.C., 36° année, mars-avril 1981, pp. 191-209. 95 J.-L. Arrigon, op. cit., p. 194
68
commence à s’intéresser au monde de la librairie, et, enfin, il semble renoncer à la
littérature quand il signe le contrat avec Urbain Canel. D’un côté, comme le soutient Jean-
Yves Mollier, Balzac manifeste une précoce modernité en choisissant de commencer sa
carrière dans le monde de la librairie par un métier qui naissait en ce moment-là, à savoir le
métier d’éditeur96. De l’autre côté, il fait un pas en arrière quand il décide de rééditer des
classiques :
Toutefois, en privilégiant les auteurs tombés dans le domaine public, Molière et La
Fontaine, le néophyte cède à la facilité qui consiste à rééditer les classiques préférés du
public, quitte à innover dans leur présentation en jouant sur le format, la typographie,
l’illustration, et en décidant de les publier en livraisons avant de réunir les fascicules en
un livre proprement dit. Archaïque et moderne quand il s’associe à Urbain Canel,
Balzac semble avoir compris la fonction nouvelle que l’éditeur est appelé à assumer,
mais en apportant à ses partenaires de l’association formée pour la circonstance des
capitaux qu’il a empruntés, l’homme d’affaires en herbe va prendre des risques
inconsidérés.97
En réalité, il faut être prudent en donnant à Balzac la responsabilité des choix pris
pour ces éditions. S’il est vrai que Balzac se jette dans le monde de la librairie sans avoir le
capital pour soutenir ses projets, il faut aussi considérer que, à ce moment-là, c’est
justement au pur aspect économique de l’entreprise qu’il semble s’intéresser. Balzac signe le
contrat avec Canel quand le projet du Molière était déjà en chantier, Urbain Canel étant
déjà associé avec Delongchamps et les frères Baudouin. On s’étonne alors que le contrat ne
soit signé qu’avec Canel. De plus, Anne Panchout a expliqué clairement le motif qui a
amène à l’exclusion du nom de Balzac dans les pages de titre des livraisons : tout
simplement, Balzac n’a aucun brevet qui lui donne la permission légale de paraître parmi les
éditeurs de l’ouvrage, En fait, à l’époque, la profession de libraire et d’imprimeur est très
réglementée par la direction de l’Imprimerie et de la Librairie, créée par le décret du 5
février 1810, placée sous le contrôle du ministère de l’Intérieur. En 1814, il devient
obligatoire d’avoir le brevet pour être imprimeur ou libraire ; brevet que Balzac ne
demande qu’en 182698.
96 J.-Y. Mollier, « L’imprimerie et la librairie en France dans les années 1825-1830 », Balzac imprimeur et défenseur du livre, Paris, Paris-Musées, Éditions des musées de la ville de Paris, Éditions des Cendres, 1995, p. 17. 97 Ibidem. 98 A. Panchout, « Un imprimeur nommé Balzac » dans Le trois révolutions du livre, Alain Mercier (dir.), Paris, Imprimerie Nationale, 2002, p. 311.
69
Du coup, si l’idée d’une édition compacte ne semble pas venir de Balzac, c’est lui qui
prend en charge la question des illustrations : après la signature du contrat, il part pour
Alençon pour trouver un accord avec le graveur Pierre-François Godard fils – l’un des
seuls graveurs français à pratiquer le nouveau procédé du bois de bout – dont Balzac avait
fait la connaissance à travers l’éditeur Roret. Godard signe le contrat pour l’édition du La
Fontaine, et Balzac lui écrit des lettres pour l’inciter à travailler le plus vite possible :
Monsieur, Je viens de communiquer à M. Urbain Canel le traité que nous avons
souscrit ensemble dimanche dernier, et vous trouverez ci-joint sa ratification. J’ai fait
voir aujourd’hui même vos gravures à Devéria qui en a été très content, et il nous a
témoigné sa satisfaction d’avoir su trouver en vous un digne traducteur de ses dessins.
Il m’a dit qu’il lui était impossible de vous donner d’avis sur les gravures que je lui
soumettais parce qu’il n’en connaissait pas le dessin primitif mais il est persuadé qu’en
travaillant vous deviendrez au bout de deux ou trois de nos gravures le plus redoutable
adversaire de Tompson [sic] et des anglais. Aussitôt que vous nous retournerez les
bois du Molière que le sieur Delongchamps a dû vous remettre, Devéria s’empressera
de vous communiquer ses observations, car il adopte votre talent avec d’autant plus de
plaisir que vous êtes Français […]. Vous pouvez d’autant plus vous occuper de la
vignette du Molière, que Devéria ne pourra pas nous remettre de bois pour le Lafontane
qu’aujourd’hui en huit, et vous avez alors une dizaine de jours devant vous pour
travailler. Mais, à compter du vingt sept de ce mois, nous vous enverrons force
dessins.99
De cette lettre, la seule qui nous est parvenue, on retient plusieurs informations très
intéressantes. Premièrement, le choix de Devéria comme dessinateur remonte
probablement avant l’entrée de Balzac dans l’affaire : il y a trop peu jours de distances entre
la signature du contrat avec Canel et sa visite à Alençon chez Godard pour croire que
Balzac ait eu le temps de chercher un illustrateur et lui commander un dessin à montrer au
graveur. En outre, nous n’avons aucune trace d’une rencontre entre Balzac et Devéria avant
ces dates-là. Deuxièmement, on comprend que Balzac avait pris des accords non seulement
pour le La Fontaine, mais aussi pour l’édition Molière, sinon officiellement ou moins pour
en parler, comme le suggère Roger Pierrot dans la note 2 à cette lettre100. Troisièmement,
Balzac est tellement confiant en Godard qu’il le compare à Thompson, en célébrant le
graveur d’Alençon comme l’artiste capable de rivaliser avec le maître anglais dans la gravure
99 H. de Balzac, Corr, t.I, pp. 258-259. 100 Ibidem.
70
sur bois de bout. Ironie du sort : à la fin, ce ne sera pas le français Godard qui réalisera les
illustrations du Molière et du La Fontaine, mais précisément son adversaire anglais, Charles
Thompson !
Pourquoi ce changement improvisé ? qu’est-ce qu’il s’est passé avec Godard ?
Encore, un petit indice se cache dans les dernières lignes de la lettre. Le motif du
renoncement de Godard est lié à Delongchamps :
Vous pouvez préparer une vingtaine de bois exactement pareils à celui que
Delongchamps aura dû vous remettre, et nous les envoyer en même temps que la
vignette du Molière quand elle sera gravée. J’ignore comment vous aurez débrouillé la
fusée de Delongchamps, mais je l’ai laissé dans une grande anxiété quand je lui ai
appris notre traité. Vous sentez que M. Urbain et moi ne nous opposerons jamais à ce
que vous travailliez pour le Molière, puisque nous y sommes intéressés ; mais nous
voulons nous réserver le droit de faire passer telle ou telle vignette avant telle ou telle
autre, ainsi j’espère que Delongchamps ne vous aura pas effrayé.101
Dans ce paragraphe, le rôle joué par Delongchamps dans la question des vignettes n’est pas
clair. Si d’un côté ces lignes nous démontrent que Balzac n’était pas le seul à traiter avec
Godard, la réaction de Delongchamps décrite par Balzac au moment de la communication
du traité avec le graveur étonne : pourquoi semble-t-il anxieux après avoir appris la
nouvelle ? et pourquoi aura-t-il dû effrayer Godard ? On ne trouve pas de réponse dans la
correspondance balzacienne, comme il n’y a pas d’autres lettres échangées entre Balzac et
Godard qui nous soient parvenues. Mais on peut imaginer ce qu’il s’est passé : quelques
mois avant la publication du Molière d’Urbain Canel, la Bibliographie de la France annonce
la parution d’un Molière illustré chez l’éditeur Delongchamps, dessins par Desenne gravés
par Godard. Delongchamps et Godard ont joué l’agent double : pendant qu’ils participaient
à l’édition Canel, Delongchamps était en train de préparer sa propre édition des mêmes
classiques choisis par le collègue, et il s’était assuré la collaboration de Godard avant Balzac.
À la découverte de la trahison, Urbain Canel est obligé de changer ses plans, et de chercher
à toute vitesse un autre graveur. Voilà la raison pour laquelle c’est Charles Thompson le
graveur des illustrations du Molière et du La Fontaine.
La tentative de créer une édition moderne à travers l’expérimentation du bois de bout
ne semble donc pas en danger. Mais, même si Thompson était considéré comme le maître
101 Ibidem.
71
du bois de bout en France (élève de Bewick, c’est lui qui avait introduit le nouveau procédé
en France chez Didot), et Devéria était déjà un peintre assez célèbre, leur collaboration ne
donna pas de bons résultats. La technique est à l’avant-garde, mais le style du dessin
rappelle la classique illustration « à tableau » : les vignettes du Molière et du La Fontane,
placées en tête au début de chaque chapitre, sont rigidement limitées par un cadre très
épais, qui donne à l’image une sensation de lourdeur. De plus, le sujet des images est
toujours une scène. L’illustration de la comédie de Don Juan ou le festin de pierre, par
exemple, représente le diner de don Juan avec le Commandeur de pierre ; autour de la
table, Sganarelle tourne sa tête, effrayé, et, au côté droit de don Juan, une femme (Elvira ?)
crie, et un homme (Don Louis, le père de don Juan ?) cherche à se cacher derrière le siège
du séducteur.
Figure 16 : Vignette pour le Don Juan de Molière, Imprimerie Balzac
Les cadres des illustrations du La Fontaine paraissent moins massifs, mais les dessins du
corps humain ne sont pas du tout attrayants : ils manquent de finesse et d’harmonie dans la
proportion du corps.
72
Figure 17 : Vignette pour Clymène de La Fontaine, Imprimerie Balzac
La mauvaise qualité des illustrations n’a certainement pas contribué à la promotion
des ouvrages. Ces défauts mis à part, le marché du livre était tellement submergé par les
rééditions des classiques que le projet de Canel et Balzac n’était intéressant que pour le prix,
très avantageux, des volumes. Les livres se vendent mal, et Urbain Canel est obligé à
déclarer la faillite, dans l’impossibilité qu’il est d’achever la publication des livraisons du La
Fontane. Ce sera Balzac qui accomplira l’édition après être devenu lui-même imprimeur.
2.3. Balzac imprimeur : entre tradition et innovation
La faillite des éditions Molière et La Fontane ne décourage pas Balzac qui, sous l’influence
de son créancier, M. d’Assonvillez, s’intéresse à l’imprimerie :
Le bailleur de fonds, qui avait ainsi perdu le gage de sa créance, intéressé à voir
prendre à mon frère une profession qui lui donnât la chance de s’acquitter avec lui, le
conduisit chez un de ses parents qui faisait une belle fortune dans l’imprimerie.
Honoré questionne, s’informe, reçoit les meilleurs renseignements et s’enthousiasme
tellement de cette industrie, qu’il veut devenir aussi imprimeur. Les livres l’attiraient
toujours !102
Pour se jeter dans cette nouvelle entreprise, Balzac a d’abord besoin d’un technicien pour
faire fonctionner l’imprimerie. Ce sont les frères Baudouin qui lui présentent un ancien
102 L. Surville, Balzac, sa vie et ses œuvres d’après sa correspondance, Paris, éd. l’Harmattan, 2005 (1858), p. 79.
73
prote, André Barbier, qui devient son associé. Ce sont encore les Baudouin qui mettent les
deux associés sur la piste d’une imprimerie à acheter, à savoir l’imprimerie de Laurens aîné
(de Pérignac avant la révolution), situé au 17, rue des Marais-Saint-Germain. Le 16 mars
1826, Balzac, Barbier et Assonvillez stipulent un traité où Balzac et Barbier figurent comme
les propriétaires d’un fonds d’imprimerie ; toutefois, le matériel est cédé à M. d’Assonvillez
en vue de la dette que Balzac a vis-à-vis de lui. Le matériel de l’imprimerie est composé
par : sept presses de Stanhope, en fer ; une presse à satiner ; deux corps de fonte, un
caractère cicero, provenant du fonds de Laurens, et l’autre caractère « petit texte »,
provenant également de Laurens ; et onze cents livres de petit romain achetés à MM.
Didot, Lengrand et Cie.
Il ne manque que le brevet d’imprimeur, qui, comme nous avons déjà rappelé, à
l’époque était obligatoire pour exercer le métier. Le 12 avril 1826 Balzac demande le brevet
d’imprimeur et il l’obtient le 1er juin. Toute cette affaire est conduite grâce à la famille de
Balzac et à Mme de Berny, qui accordent à Honoré l’argent nécessaire à l’acquisition de
l’imprimerie et du brevet. Ce dernier, notamment, est obtenu grâce à l’intervention de M.
de Berny. En fait, recevoir le brevet n’est pas si simple : il ne suffit pas de faire la demande,
mais il faut passer le contrôle des inspecteurs., chargés de vérifier « la moralité et le
dispositions politiques » du candidat. Certainement M. de Berny, homme influent, est
intervenu en faveur de l’ami de sa femme. Le rapport sur Balzac est conservé aux Archives
nationales ; il est favorable, et il y est spécifié « que le Sr Balzac a fait ses études et son droit,
qu’il appartient à une famille estimable et aisée, que sa conduite est régulière et qu’il
professe de bons principes. Il n’a fait aucun apprentissage dans l’imprimerie, mais on
convient qu’il en connaît bien le mécanisme »103.
Balzac accepte tous les types de travaux qui lui sont proposés : son premier travail
s’inscrit dans le monde de la publicité, comme il imprime le prospectus du pharmacien
Curé, qui vante ses Pilules antiglaireuses de longue vie. Entre 1826-1828, Balzac dépose 282
livres au Bureau de la librairie : brochures d’actualité, concernant des procès, des pots-
pourris politiques de chansonniers, des petits volumes à la mode paraissant sous le titre
« Art de… », et des réimpressions d’ouvrages didactiques. Parmi les commandes de
l’imprimerie Balzac on trouve aussi quelques grands noms de la littérature romantique, tels
103 Cité dans A. Panchout, op. cit., p. 311.
74
que Mérimée et Vigny ; on imprime même des ouvrages condamnés, telles Scènes
contemporaines par la vicomtesse de Chamilly.
Certains ouvrages sont de grand intérêt, notamment des « Art de… » par Saint-
Hilaire, qui témoignent des premières illustrations d’Henri Monnier, artiste qui se liera
d’amitié avec Balzac dans les années 1830. Nous proposons les exemples de trois livres :
L’art de donner à diner et de découper les viandes, L’art de ne jamais déjeuner chez soi, et de dîner toujours
chez les autres ; enseigné en huit leçons, et L’art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers, sans
débourser un sou. Le premier ouvrage, L’art de donner à diner et de découper les viandes, se prête à
être illustré : en frontispice, le lecteur trouve un dessin colorié d’un homme, souriant avec
un petit clin d’œil, portant dans ses mains un plateau rempli de petits plats. Le style
moqueur de Monnier, caractérisé par un dessin à ligne fluide, douce, est déjà bien marqué
dans ce frontispice. Ensuite, le texte est accompagné par des images hors-texte qui
expliquent les indications données par le texte sur la manière de couper les viandes.
L’art de ne jamais déjeuner chez soi, et de dîner toujours chez les autres ; enseigné en huit leçons
présente lui aussi un frontispice colorié : un homme rondelet, en train de faire une
révérence, représente le modèle d’un gentleman qui accepte une invitation pour le déjeuner.
Les couleurs vives et le dessin comique, de Monnier confèrent au livre un élément agréable,
qui épouse bien le caractère ironique du texte de Saint-Hilaire.
Le troisième livre, L’art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers, sans débourser un sou,
surprend le lecteur avec un frontispice très original : la page, qui d’abord est remplie par un
petit dessin cadré colorié, cache une image plus grande, qui s’ouvre en tirant vers le côté
gauche le bord de la page.
La raison que nous a amenée à décrire ces petits livrets, et à faire le catalogue des
œuvres illustrées imprimées par Balzac, vient de la ferme conviction que, même si Balzac
n’a pas eu le contrôle de toutes les images produites (en tant qu’imprimeur il exécute
l’impression qui lui avait été commandée), ces images font toujours partie de sa formation
artistique. Être en contact, voir les ouvrages illustrés sortir de ses presses ont évidemment
représenté quelque chose de significatif pour Balzac, par exemple son admiration envers
Henri Monnier, explicitée, comme on le verra, dans les comptes rendus rédigés par le
romancier en 1831.
75
Figure 18 : Frontispice de L'art de donner à diner
Figure 19 et 20 : Planches pour L'art de donner à diner
76
Figure 21 et 22 : Frontispice pour L'art de payer ses dettes
Figure 23 : Frontispice pour L'art de ne jamais déjéuner chez soi
77
Le travail apparemment ne manque pas à Balzac. Toutefois, l’imprimerie est en
difficulté. D’un côté, la raison de cette faillite est due à des motifs indépendants de Balzac.
Même si l’imprimerie recevait régulièrement des commandes, les tirages demandés par les
éditeurs étaient très bas – entre 500 et 1200 exemplaires. De plus, non seulement les
affaires marchent mal à cause du marché en récession depuis 1826, mais le gouvernement
contribue à aggraver la situation : le 29 décembre 1826 le chancelier Peyronnet dépose à la
chambre une loi sur la presse, appelée par dérision « Loi de Justice et d’Amour », qui
augmentait le droit de timbre et rendait les imprimeurs responsables de tout ce qui sortait
de leurs officines. La colère des imprimeurs est unanime, et de nombreuses pétitions sont
signées pour son retrait. Balzac lui-même participe à ce mouvement en signant le 26 janvier
1827 la Pétition de 230 imprimeurs et libraires de Paris sur le projet de loi relatif à la police de la presse.
Finalement le projet de loi est rejeté par la Chambre des Pairs le 17 avril 1827.
On apprend, dans l’Oraison funèbre sur la loi de justice et d’amour, que « M. Balzac
réunissait ses employés dans un brillant repas, chez Diguet, en face de la Chambre des
Pairs, comme pour avoir devant ses yeux, durant cette fête, l’hôtel où siège cette vénérable
assemblée »104.
De l’autre côté, la mauvaise gestion de Balzac ne tarde pas à se faire ressentir :
Le travail ne manque pas, mais Balzac ne savait ni faire un devis ni se faire payer. […]
Et Barbier en tout cela ? Il faisait de son mieux. Si Balzac s’était contenté de trouver
des clients et avait laissé son associé s’occuper du reste – administration, comptabilité,
et travail – la débâcle eût peut-être été évitée. En dépit de ses appréhensions, Barbier
devait conserver foi en une possibilité de redressement. À moins qu’il ait succombé au
pouvoir de persuasion, probablement redoutable, de Balzac, puisqu’il accepta, le 15
juillet 1827, d’entrer dans la nouvelle combinaison de ce dernier, en vue de
l’exploitation d’une fonderie de caractères.105
C’est effectivement en juillet 1827 que Balzac décide de faire l’acquisition d’une partie de la
fonderie Gillé, spécialisée, depuis le XVIIIᵉ siècle, dans les lettres d’écriture, de fantaisie et
les ornements. Un détail singulier porte René Ponot à s’interroger sur cette acquisition : «
Est-ce une coïncidence si le syndic de la faillite fut justement le même Jean-François
Laurent, qui avant 1818 avait été contremaître chez Gillé ? est-ce une coïncidence, enfin, si
104 Cité dans A. Panchout, op. cit., p. 312. 105 R. Ponot, « Préface » au Specimen de Balzac, Paris, éds. Cendres, 1992, p. XIV.
78
Balzac avait choisi, moins de deux mois plus tôt, de s’associer à Laurent ? »106. Selon Anne
Panchout, outre le fonds Gillé la fonderie Balzac, Barbier et Laurent a acheté également les
procédés de « polytypage » et de « fontéréotypie » appartenant à Pierre Durouchail, ceux qui
permettent de reproduire à bon marché des effets de luxe typographique107. Ainsi, la
fonderie avait effectivement un riche patrimoine d’ornements typographiques à proposer à
sa clientèle.
Le Specimen des divers caractères, vignettes et ornements typographiques de la fonderie de Laurent et
de Berny est créé justement pour faire connaître ces nouveautés au public. Commencé en
décembre 1827, le Specimen est achevé en mai 1828, c’est-à-dire au moment où soit Barbier
soit Balzac avaient déjà quitté l’association. Barbier avait abandonné l’entreprise en
septembre 1827, et Mme de Berny était entrée à sa place ; Balzac avait été obligé de quitter
l’association en avril 1828, et il avait été remplacé par l’un de fils de la Dilecta, Alexandre.
C’est à cause de ça que le specimen ne porte pas le nom de Balzac, qui ne figure que comme
l’imprimeur du catalogue. Mais, nous le disons avec René Ponot, ce specimen doit beaucoup
à l’ingéniosité de Balzac, à tel point qu’on pourrait le renommer Specimen Balzac : c’était lui
qui non seulement en avait eu l’idée mais aussi en avait suivi la phase de composition et
impression.
Pour une analyse détaillée du contenu du Specimen, nous renvoyons à la « Préface » de
René Ponot, rédigée pour l’édition des Cendres de l’ouvrage, riche de remarques techniques
et d’observations très intéressantes dans la comparaison du fonde Gillé avec celui de
l’association Laurent et Berny. Dans le Specimen, « on peut [y] admirer notamment les
fameuses « lettres égyptiennes ornées », très en vogue dans les affiches publicitaires, et une
série de caractères et vignettes qui attestent la variété des produits proposés dans cette
période de grand bouleversement typographique »108. Nous attirons l’attention sur deux
éléments. Le premier, c’est la couverture, conservée seulement dans l’exemplaire de la
Maison de Balzac. Le titre de l’ouvrage est encadré par une guirlande de fleurs et de fruits ;
106 R. Ponot, op. cit, p. XV. 107 A. Panchout, op. cit., p. 313. 108 Ibidem.
79
au centre, une vignette par Henri Monnier, la n°1467 de la page 85109, qui constitue encore
un autre signe précieux des tout premiers rapports entre Balzac et le dessinateur110.
Figure 24 : Couverture du Specimen de la fonderie Laurent-Berny
Le deuxième, c’est la variété de vignettes recueillies dans le Specimen. Au niveau
thématique, les images appartiennent à une vaste gamme de sujets différents :
encadrements, lettrines, armes de la famille impériale, navires, icones religieuses, images
d’instruments musicaux, scènes mythologiques, tableaux à sujet zoologique, scènes de
mœurs de l’époque néoclassique, signes zodiacaux, figurines, le portrait de La Fontane paru
dans l’édition Balzac-Canel de l’auteur.
Cette variété des vignettes fait la joie de tous les amateurs et bibliophiles ; toutefois, il
reste que le trait d’union de ces images est le rôle purement ornemental joué par
l’illustration. Il n’est pas encore question de faire sortir l’illustration de son caractère
paratextuel, ce qui dénote une illustration de type « ancien régime typographique ». Ces
vignettes alors représentent le moment d’entre-deux qui domine non seulement
l’imprimerie-fonderie Balzac – qui renouvelle la technique mais non les sujets des
illustrations –, mais en général tout le monde de la librairie de cette décennie, qui
développera de manière plus complète l’évolution en acte vers la moitié du siècle.
109 Voir R. Ponot, op. cit., p. XVII. C’est René Ponot qui a réussir à identifier quelque signature des vignettes du Specimen. 110 Sur les rapports entre Henry Monnier et Balzac, voir notamment H. Monnier, Mémoires de Monsieur Joseph Prudhomme, Paris : Librairie Nouvelle, 1857, 2 vol ; A.-M. Meininger, « Balzac et Henry Monnier », AB 1966, p. 217-244.
80
Balzac abandonne le monde de la librairie après un déficit coûteux, à l’origine de ses
troubles financiers, comme la dette qu’il contracte dans ces années lui restera attachée
pendant toute sa vie. D’autre part, cette expérience laisse à Balzac l’acquisition d’une
connaissance qui se révélera très utile, non seulement comme matière narrative mais aussi
comme compréhension de la structure et du fonctionnement de l’univers qui, derrière les
rideaux, fait marcher concrètement le monde de la littérature. C’est grâce à cette expérience
que Balzac commence à prendre soin aussi de l’aspect typographique de ses livres, en
devenant dans une certaine mesure « éditeur de ses œuvres »111, et notamment de La
Comédie humaine. De plus, le travail d’imprimeur l’a mis en contact avec les illustrateurs qui,
à partir de 1830, seront très célèbres grâce à leurs illustrations pour la presse politique.
Nous avons déjà souligné l’importance des premiers contacts de Balzac avec Henri
Monnier. Dans le troisième chapitre, nous allons voir comment Balzac a approfondi cette
connaissance des illustrateurs contemporains par la collaboration du romancier avec la
presse politique illustrée.
111 Expression de R. Pierrot, « Balzac "éditeur" de ses œuvres », dans Balzac imprimeur et défenseur du livre, Paris, Paris-Musées, Éditions des musées de la ville de Paris, Éditions des Cendres, 1995, pp. 55-68.
83
CHAPITRE 3
BALZAC JOURNALISTE : LA NAISSANCE DU « TYPE ICONIQUE »
Comment plaire à la fois au poète, au philosophe et aux masses
qui veulent la poésie et la philosophie sous de saisissantes images ?
Balzac, « Avant-propos » à La Comédie humaine, 1842
Balzac sort de son expérience d’imprimeur plein de dettes. Il décide de faire une nouvelle
tentative avec la littérature. Mais, cette fois-ci, il s’éloigne de l’écriture romanesque : comme
l’a remarqué Roland Chollet dans son essai fondamental Balzac journaliste. Le tournant de
1830112, entre 1829 et 1831, c’est-à-dire dans la période circonscrite par la publication de la
Physiologie du mariage et de La Peau de chagrin, Balzac ne publie qu’un seul roman, Les Chouans.
La quasi-totalité de la production balzacienne de ces années se compose d’articles pour la
presse illustrée113 : La Silhouette et La Caricature, notamment, bénéficient énormément des
contributions de l’écrivain, qui donne parfois à lui seul les articles pour un numéro entier
des deux revues.
Les trois années passées à collaborer avec les journaux constituent, en quelque sorte,
une période d’apprentissage pour le jeune romancier : la différence de style entre les
romans de jeunesse, Les Chouans et La Peau de chagrin, rend évident le fait que des profondes
modifications sont intervenues dans l’écriture balzacienne. Les changements les plus
évidents concernent la construction du personnage, qui gagne dans l’approfondissement du
caractère, mais surtout de la figure : le personnage n’est plus limité à la passion qui le
caractérise et qui le porte à agir, mais il prend finalement corps, c’est-à-dire qu’il lui est
attribué une figure physique qui fonctionne, comme le dirait Carlo Ginzburg, comme un
paradigme indiciaire114.
La croissance du personnage balzacien s’inscrit en deux contextes différents. D’un
côté, il participe à la formation d’une nouvelle catégorie de personnage, défini « réaliste »,
qui sera développé par Balzac lui-même, par Stendhal, Gautier et Maupassant : de fait,
112 R. Chollet, Balzac journaliste. Le tournant de 1830, op. cit., p. 9. 113 Sur la presse illustrée de cette période, voir notamment J.-P. Bacot, La presse illustrée au XIXᵉ siècle : une histoire oubliée, Limoges, Presses universitaires Limoges, 2005. 114 C. Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Crisi della ragione, Aldo Gargani (dir.), Torino, Einaudi, 1979, pp. 57–106 ; trad. en français : « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire » dans Id., Mythes, emblèmes, traces ; morphologie et histoire, Paris, Flammarion, 1986, pp. 139-180.
84
comme nous allons le voir dans ce chapitre, le roman de mœurs fonde l’effet de réel de ses
personnages à travers la description de leurs silhouettes, le personnage étant un corps qui,
comme un texte, peut être lu, en ouvrant une porte sur l’intériorité du caractère. L’image
est bien l’outil par excellence de deux écoles modernes, celle de la « Littérature des Images »
et celle de l’« Éclectisme littéraire », comme le soutient Balzac lui-même115, où l’écrivain se
fait le peintre de la société. Le personnage se présente donc comme une image, une figure
qui, souvent, renvoie à un tableau pour trouver dans la peinture une image concrète116.
C’est la croissance de la technique descriptive balzacienne le détail qui marque la différence
entre Les Chouans et La Peau de chagrin : comme l’a remarqué Maurice Bardèche dans son
essai Balzac, romancier, c’est d’abord avec le Dictionnaire des Enseignes et les Codes que Balzac
démontre cette tendance stylistique, le milieu de Paris étant pourvu finalement d’une
description :
Ce Dictionnaire des Enseignes, c’est l’entrée dans son œuvre du monde extérieur. Il
témoigne d’un désir de peindre qui n’avait jamais pu parvenir à se manifester
entièrement. Cette nomenclature descriptive, ce manuel du flâneur nous permet de
voir naître chez Balzac une sorte d’amour pour ce personnage collectif et magnifique
qui n’avait pu trouver place dans aucun de ses romans, pour les visages multiples de la
ville. […] La première image par laquelle s’ouvre [La Comédie humaine] en 1830, les
Scènes de la Vie Privée n’est-elle pas l’enseigne de la « Maison du chat-qui-pelote » ?117
C’est donc la ville de Paris qui assume en premier un visage ; les personnages, à l’exception
de quelque cas particulier118, ne seront pas développés autant qu’avec La Peau de chagrin.
De l’autre côté, le style pictural balzacien se développe ultérieurement. Balzac
poursuit un parcours particulier, qui l’amène à intégrer des références picturales dans ses
115 H. de Balzac, « Études sur M. Beyle », dans S. Vachon, Balzac. Écrits sur le roman, Paris, Librairie Générale Française, 2000, p. 202. 116 La bibliographie existante sur l’influence de la peinture sur la littérature romantique est volumineuse. C’est pourquoi nous nous limitons ici à donner quelque référence, en renvoyant tout approfondissement concernant Balzac au catalogue disponible sur le site du GEB : http://www.balzac-etudes.paris-sorbonne.fr/balzac2/bibliographie-generale-selective.html Voir : D. Bergez, Littérature et peinture, Paris, A. Colin, 2004 ; W. Jung, « ˝L'effet des tableaux˝. Lecture picturale de La Maison du chat-qui-pelote », AB, 2004, pp. 211-228 ; P. Le Leyzur, D. Oger (dir.), Balzac et la
peinture, Tours, Muse ́e des Beaux-Arts de Tours, Farrago, 1999 ; A. Muhlstein, La Plume et le pinceau. L’empreinte
de la peinture sur le roman au XIXᵉ siècle, Paris, Odile Jacob, 2016 ; B. Vouilloux, La peinture dans le texte, XVIIIᵉ-
XXᵉ siècles, Paris, CNRS Éditions, 1994 ; Id., Tableaux d’auteurs. Après l’« ut pictura poesis », Saint-Denis, PUV,
2004. 117 M. Bardèche, Balzac, romancier. La formation de l’Art du Roman chez Balzac jusqu’à la publication du Père Goriot (1820-1835), Genève, Slatkine Reprints, 1967, p. 203. 118 Voir notamment M. Bertini, « Balarouth : Balzac portraitiste en 1822 », Cahiers de littérature française, I, Bergamo et Paris, Bergamo University Press et L’Harmattan, 2005, pp. 33-38.
85
descriptions : le musée imaginaire de La Comédie humaine est immense, galerie de tableaux
réellement existants – mais aussi imaginaires – qui crée un enjeu riche et complexe dans la
construction de l’identité du personnage balzacien119.
Cependant, si les effets d’un tel changement dans la poétique balzacienne sont
évidents, et ont fait le sujet de nombreuses études, certaines questions que cet argument
soulève restent encore sans réponse. On se demande, par exemple, quel est l’élément, la
cause qui a déterminé ce tournant dans l’écriture balzacien, intervenu au seul moment où
Balzac n’était engagé dans aucun genre narratif, mais dans l’écriture journalistique. Encore,
on ne sait pas vraiment comment Balzac a réussi à affiner sa technique descriptive en si peu
de temps, pendant lequel il n’a écrit qu’un seul roman.
La réponse réside, ce sera notre hypothèse, dans les rapports de plus en plus étroits
que Balzac entretient avec le monde de l’illustration et des illustrateurs à partir de 1828. Si
Alain Vaillant et Marie-Ève Thérenty ont consacré des études particulières aux effets des
mécanismes poétiques de la presse sur le style de l’auteur120, c’est Olivier Bonard qui a
reconnu et demontré l’influence de l’illustration dans les récits de La Comédie humaine, en
décrivant les exemples de « style caricatural » présents dans L’Illustre Gaudissart, Le Père
Goriot et La Fille aux yeux d’or :
[…] il nous semble que c’est bien ce style plus affirmé, plus rude, aux senteurs plus
fortes, celui que nous apercevions déjà dans Gobseck, qui tendit de plus en plus à
s’imposer à l’imagination du romancier. Avec le portrait de Poiret, par exemple, ou
celui de l’inoubliable « maman » Vauquer, avec Goriot aussi, mais sur un mode
combien plus grave encore et plus riche de force dramatique, se multiplient sous nos
yeux comme les produits du style le plus profond et le plus instinctif des
physionomies que l’on peut qualifier sans conteste de « chargées ». Ce nouveau visage
de Balzac et cette aggravation de son style, qui nous rendent par contraste plus
précieuses encore les pages où il est en quête d’une poésie plus chaleureuse et plus
intime, n’eussent sans doute par été possibles sans l’influence des dessinteurs et des
caricaturistes de son époque.121
119 Voir notamment F. Pitt-Rivers, Balzac et l’Art, Paris, éditions du Chêne, 1993 ; Y. Gagneux, Le musée imaginaire de Balzac : Les 100 chefs-d'œuvre au cœur de la Comédie humaine, Paris, Beaux-Arts Editions, 2012. 120 A. Vaillant, La crise de la littérature. Romantisme et modernité, Grenoble, ELLUG, 2005 ; M.-È. Thérenty, La
littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXᵉ siècle, Paris, Seuil, 2007. 121 O. Bonard, La Peinture dans la création balzacienne. Invention et vision picturales de La Maison du chat-qui-pelote au Père Goriot, Genève, Droz, 1969, pp. 124-125.
86
Nous allons alors reconstruire les passages qui ont contribué à la réforme du roman
balzacien, en analysant notamment le nouveau statut du personnage, dont la description
s’enrichit d’images qui en définissent la silhouette. Ces images sont en grande partie le fruit
de la rencontre avec les artistes romantiques, qui élargissent les connaissances de Balzac sur
l’art et, plus spécifiquement, sur les lithographies qui circulent à ce moment-là, lesquelles
constitueront le paradigme de la représentation du corps bourgeois. Mais avant de nous
engager dans cette analyse, il faut d’abord faire le point sur la catégorie du personnage qui
véhicule toutes ces réflexions : le personnage-type.
Si à première vue ces réflexions paraissent une petite digression par rapport au sujet
de la thèse, nous sommes convaincue que cette période de la vie de Balzac est un précieux
témoignage des premiers contacts de l’écrivain avec l’illustration (en ce cas-là, l’illustration
de la presse), qui nous aide à reconstruire son opinion et son jugement sur cet art mineur.
Par-là, nous visons l’ouverture sur une perspective peu fréquentée sur l’enjeu entre les mots
et les images que nous analyserons dans la deuxième et la troisième parties de la thèse. La
caricature inspirant l’écriture balzacienne, quelles conséquences dans le rapport entre
l’illustration et le texte, qui est généralement conçu comme une relation à sens unique, où
on ne s’interroge quasi exclusivement que sur la traduction du mot en image, et non vice
versa ? Bref, comment se modifie le rapport entre le texte et l’illustration, alors qu’une autre
image intervient avant la construction du texte pour inspirer la figure du personnage, où ce
dernier est à son tour retransformé en image, en illustration ? Pour répondre à ces
questions, il faut d’abord éclairer comment et en quoi la presse illustrée a influencé les idées
et le style de Balzac – ce que nous allons voir dans ce chapitre.
3.1. Le type balzacien : une mosaïque de perspectives
Dans l’Avant-propos à La Comédie humaine, Balzac affirme que son projet de faire une histoire
de mœurs contemporaines se fonde sur cinq éléments :
En dressant l’inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les principaux faits des
passions, en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la
Société, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères
homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l’histoire oubliée par tant d’historiens,
celle des mœurs.122
122 H. de Balzac, Avant-Propos à La Comédie humaine, Pl, t.I, p. 11 ; c’est nous qui soulignons.
87
Parmi ces cinq éléments, le « type » paraît comme une figure symbolique qui réunit « des
traits de plusieurs caractères homogènes » ; mais, quelques lignes plus loin, l’auteur revient à
ce concept en expliquant que :
Ce n’était pas une petite tâche que de peindre les deux ou trois mille figures saillantes
d’une époque, car telle est, en définitif, la somme des types que présente chaque
génération et que La Comédie humaine comportera. Ce nombre de figures, de caractères,
cette multitude d’existences exigeaient des cadres, et, qu’on me pardonne cette
expression, des galeries. De là, les divisions si naturelles, déjà connues, de mon
ouvrage en Scènes de la vie privée, de province, parisienne, politique, militaire et de campagne.
Dans ces six livres sont classées toutes les Études de mœurs qui forment l’histoire
générale de la Société, la collection de tous ses faits et gestes, eussent dit nos
ancêtres.123
Dans l’Avant-propos à La Comédie humaine Balzac fonde donc le concept sur l’incarnation de
l’Idée dans un personnage ; la même théorie est formulée dans la Préface à Une tenebreuse
affaire, où Balzac écrit qu’« un type, dans le sens qu’on doit attacher à ce mot, est un
personnage qui résume en lui-même les traits caractéristiques de tous ceux qui lui
ressemblent plus ou moins, il est le modèle du genre »124.
Toutefois, dans l’Introduction aux Études philosophiques rédigée par Félix Davin et dans
une lettre à Mme Hanska d’octobre 1834, Balzac et Davin affirment que les Études de moeurs
traitent des « individualités typisées » et les Études philosophiques des « types individualisés »125.
Or, ces deux expressions sont un véritable casse-tête qui accentue la complexité de la
notion de type : de fait, le type est l’incarnation d’une idée générale et, en même temps, un
personnage très particulier, qui se distingue des autres. De plus, si dans l’Avant-propos le type
se décline principalement en perspective sociale, en réalité les romans de Balzac
contiennent une variété infinie de types : sociaux, moraux, ethnographiques, etc. À côté de
la femme comme il faut de l’Étude de femme, par exemple, nous trouvons aussi la femme
vertueuse dans Mme Hulot de La Cousine Bette et la femme de province dans La Muse du
département.
123 Ibid., p. 18 ; c’est nous qui soulignons. 124 Honoré de Balzac, Une ténébreuse affaire, Pl, t. VIII ; p. 492-493.
125 Les deux expressions se trouvent dans LH, 26 octobre 1834, t.I, p.204, et dans l’Introduction aux Études
philosophiques redigée par Félix Davin en 1835. Voir « Introduction aux Études philosophiques par Félix Davin »
dans Stéphane Vachon, Balzac. Écrits sur le roman. Anthologie, Paris, Librairie Générale Française, 2000 ; p.104.
88
Également, la construction du personnage typique n’est pas facile à saisir, ce qui rend
encore plus difficile l’identification du personnage typique en le distinguant du héros ou du
personnage symbolique, ou encore du personnage saisissant126.
Les différentes positions assumées par les lecteurs de Balzac dans la question du type
ont fait le sujet récemment de l’étude de Jérôme David dans Balzac : une éthique de la
description127, où la notion de type chez Balzac est comparée à celle exploitée par Charles
Nodier et Victor Hugo. Nous renvoyons donc à cet ouvrage pour tout approfondissement
de l’argument. Nous rappelons néanmoins le cas de György Lukács128, qui a mis en lumière
l’importance de la figure typique à caractère social, laquelle démontre que la société est de
plus en plus dépendante et construite sur l’argent129, le nouveau moteur social aussi bien
que romanesque.
L’intérêt des spécialistes balzaciens à l’égard du concept de type est encore vif,
comme en témoigne le séminaire que le Groupe d’Études Balzaciennes a organisé pendant
l’année 2017-2018, « Balzac en perspective(s) ». Les titres des communications présentées
dans le cadre de ce séminaire démontrent la richesse de perspectives avec lesquelles le
concept de type peut être abordé : Nanine Charbonnel, « Métaphore, modèle, modernité :
de Rousseau à Balzac ? » ; Amélie de Chaisemartin, « Le type balzacien et la notion de
grand homme » ; Françoise Gaillard, « Configuration » ; Jérôme David, « Balzac et les
secondes Lumières » ; Willi Jung, « Réalisme et typification chez Balzac » ; Thomas Conrad,
« ‘Phases’: typiser les situations »130.
Si Nanine Charbonnel et Willy Jung se sont interrogés sur le problème de la
modélisation du type, Jérôme David et Françoise Gaillard ont réfléchi au type comme un
concept historique et philosophique, Jérôme David en le liant à ce qu’il a appelé une
véritable « imagination typique » qui exerce son influence pour toute la période romantique,
Françoise Gaillard aborde de son côté le type selon la philosophie de Nelson Goodman, de
Simmel, de Durkheim et de Weber, en définissant le type comme un « outil
d’intelligibilité », comme le « réalisme de l’idée » qui oscille entre le type-idéal et l’idéal-type.
126 Voir J.-D. Ebguy, op. cit. 127 J. David, Balzac : une éthique de la description, Paris, Honoré Champion, 2010. 128 G. Lukács, Balzac et le réalisme français, Paris, la Découverte, 1999 (1934-1935). 129 Sur l’imporance de l’argent dans la littérature romantique, voir F. Spandri (dir.), Littérature et économie. La représentation de l’argent dans le roman français du XIXe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2013. Sur le cas spécifique de Balzac, voir aussi A. Wurmser, La Comédie inhumaine, Paris, Gallimard, 1970. 130 Les actes du séminaire sont inédits, mais nous essayerons de résumer les positions exprimées par chacun des intervenants, que nous remercions vivement pour leurs communications très stimulantes.
89
Thomas Conrad, en revanche, exploite une assertion peu connue de l’Avant-propos de
Balzac, selon laquelle il existerait même des situations typisées, pour en construire une
grammaire ; c’est une intuition très intéressante, que nous aidera dans notre prochain
chapitre, où l’on verra effectivement une émergence de la scène dans les illustrations.
Mais c’est la communication d’Amélie de Chaisemartin qui nous a suggéré à une piste
particulièrement intéressante pour notre sujet : Amélie de Chaisemartin en fait affirme que
le type est le concept où s’élabore le lien entre littérature et histoire, fondé par
Chateaubriand et poursuivi, sous la Restauration, par Victor Hugo, Charles Nodier, Alfred
de Vigny et George Sand à travers la figure du « grand homme », l’homme symbole de son
époque ; dans le cas de Balzac, toutefois, les personnages tels que César Birotteau montrent
comment le héros risque de tomber dans un type comique par le traitement caricatural
réservé au personnage dans sa description. C’est bien alors le processus de « figuration » qui
construit le type, la caricature montrant là toute son influence sur la narration balzacienne.
Or, c’est exactement sur cette réflexion que nous avons élaboré notre théorie :
Amélie de Chaisemartin soutient, comme Olivier Bonard ou, comme l’on verra plus loin,
comme Ségolène Le Men, que la caricature a influencé énormément la construction des
personnages, des auteurs romantiques en général mais notamment de Balzac, comme le
révèlera le type de la littérature panoramique, que nous analyserons dans la troisième partie
de notre étude. Mais comment expliquer cette influence ? Comment Balzac a-t-il appris à
traiter la caricature dans la littérature ? Ce sont ces questions-là que nous posons dans ce
chapitre.
3.2. La naissance du corps du personnage littéraire : le « type iconique »
Le développement de l’écriture balzacienne repose sur trois problématiques.
D’abord, s’impose la question du sujet à observer. Jusqu’à 1830 Balzac s’inspire
principalement du modèle du roman historique de Walter Scott, en érigeant ainsi le passé
comme temps privilégié de l’action. Si le temps de l’action dans les romans de jeunesse,
comme par exemple dans Le Vicaire des Ardennes ou dans La dernière Fée, reste nébuleux,
indéterminé, la pièce de Cromwell et le projet de l’Histoire de France pittoresque font clairement
partie de cette période à l’enseigne du passé. Nous remarquons de manière différente de
90
Tim Farrant131 que l’Histoire de France pittoresque relève de l’influence des Voyages pittoresques et
romantiques dans l’Ancienne France de Nodier et Taylor, à partir du titre du projet balzacien,
témoignage précieux de l’intérêt de Balzac pour la question du pittoresque qui commence à
s’imposer dans la littérature romantique, comme l’on verra mieux tout à l’heure.
Si La Peau de chagrin poursuit l’exploitation de la technique picturale, elle représente
d’autre part le premier exemple du roman de mœurs balzacien, qui érige la vie quotidienne
du présent en digne sujet littéraire. Ce sont en fait Les Chouans qui ont marqué le pas en ce
qui concerne le roman historique d’inspiration scottienne, même si la rivalité de Balzac vis-
à-vis de Victor Hugo, lequel avait inauguré une nouvelle saison à l’enseigne du genre
historique avec Cromwell, tourne encore parfois l’auteur de La Comédie humaine vers la
matière historique : nous rappelons le cas des Proscrits, où l’action se joue au Moyen Âge de
Dante, écrits et publiés juste après le grand succès de Notre-Dame de Paris (1831).
À partir de La Peau de chagrin la période contemporaine prend donc la première place
dans l’œuvre balzacienne. C’est le premier pas de Balzac vers la grandeur : si Théophile
Gautier, Charles Baudelaire et Henry James pourront définir Balzac comme un « voyant »,
capable de s’incarner, de vivre ses personnages comme le dieu indien Vichnou – dans ce
don d’avatar résident la force et l’expression de ses personnages – il est vrai aussi que :
Cette faculté, Balzac ne la possédait d’ailleurs que pour le présent. Il pouvait
transporter sa pensée dans un marquis, dans un financier, dans un bourgeois, dans un
homme du peuple, dans une femme du monde, dans une courtisane, mais les ombres
du passé n’obéissaient pas à son appel […]. Sauf deux ou trois exceptions, toute son
œuvre est moderne ; il s’était assimilé les vivants, il ne ressuscitait pas les morts.132
Par-là, se pose le deuxième problème : que regarder dans le présent, pour le faire
devenir matière littéraire ? Et comment observer le nouveau sujet choisi ? À quelle auctoritas
s’adresser pour avoir de nouveaux modèles dont s’inspirer ?
131 Voir T. Farrant, « Du pittoresque au pictural », AB 2004, p. 118 : « C’est sous le signe de Scott, et des Waverley Novels plus que sous celui de Taylor ou de Nodier que s’inscrit le projet balzacien d’une Histoire de France pittoresque, conçu vers cette même année 1824. Si le Balzac de l’époque n’a guère de sympathie pour le royalisme de Taylor et de Nodier, le pittoresque royaliste et romantique d’un côté et le pittoresque balzacien de l’autre participent d’une aptitude comparable envers le passé. Perçu comme définitivement révolu, séparé du présent par le gouffre de la Révolution (ou, pour certains Écossais, l’Acte d’Union avec l’Angleterre), le passé est l’objet d’un désir inassouvissable, Éros et Thanatos à la fois. Voilà donc pourquoi le passé devient l’objet dans l’Histoire pittoresque de Balzac : seule la mémoire, l’imagination et la poésie permettent de le retrouver ». 132 T. Gautier, Portrait de Balzac, dans Portrait de Balzac, précédé de Portrait de Théophile Gautier par lui-même, Paris, L’Anabase, 1994 (1858), p. 48.
91
C’est peut-être d’après le travail pour la presse illustrée, qui à l’époque visait la
diffusion de la mode et du costume contemporain, que Balzac a choisi de se consacrer aux
études de mœurs dans ses récits. Mais comment transposer l’expérience acquise du monde
des journaux dans l’écriture ? Il est bien différent de narrer la vie élégante dans un article de
presse ou dans un code et dans une narration romanesque. De plus, la société se présente à
ce moment-là comme une immense nébuleuse, difficile à lire et à détecter :
Sous la Monarchie de Juillet, le temps n’est plus où des critères clairs et durables
suffisaient à désigner la position. Le théâtre social a perdu de sa simplicité depuis la
Révolution ; la complication des signes du vêtement et du comportement répond à
celle de la nouvelle découpe sociale. Dans la rue, à l’Opéra, comme au salon, s’ouvre le
règne de la nuance.133
Balzac ressent clairement cette confusion dans les mœurs, et il arrive à la formuler dans les
Complaintes satiriques sur les mœurs du temps présent :
Il règne donc bien certainement une maladie morale. Aussi, nous nous proposons de
rechercher si la triste situation de nos mœurs présentes, si l’absence de toute vérité, de
toute passion, de toute franchise, vient de la cour, de notre mode de gouvernement,
de l’esprit de famille et de la bourgeoisie, et où seraient alors les moyens de remédier à
l’ennui public ? Si cette société funéraire, si ces mœurs de catafalque sont produites
par l’incertitude de nos usages, de nos modes et de nos opinions ? Si le reste de tant de
révolutions, si le fumier humain qui pèse sur nos salons serait un obstacle à la
renaissance de la gaieté ? ou si les systèmes de littérature, de peinture, de philosophie,
et si les craintes ridicules du pouvoir, en fait de théâtre et de drame, n’influeraient pas
sur nos plaisirs ?134
Certes, le genre du « tableau de mœurs » avait ses ancêtres, qui représentent en
quelque sort un modèle dont s’inspirer : Le Tableau de Paris par Louis Sébastien Mercier
(1781-1788), L’Hermite de la Chaussée-d’Antin ou Observations sur les mœurs et sur les usages
parisiens au début du XIXᵉ siècle par Jouy (1813), Le Provincial à Paris. Esquisses de mœurs
parisiennes, publié par Ladvocat (1825). Ces œuvres avaient donné de nouveaux éléments de
base pour le récit : primo, la séparation de plus en plus perceptible entre Paris et la
province, où Paris devient un vrai personnage qui s’oppose à ses cousins provinciaux,
133 A. Corbin, « La mise en scène du pouvoir et de la dérision », dans Presse et Caricature, Cahiers de l’institut d’histoire de la presse et de l’opinion, n°7, 1983, p. II. 134 H. de Balzac, Complaintes satiriques sur les mœurs du temps présent, dans OD, Pl, t.II, p. 748 ; c’est nous qui soulignons.
92
antiques et pauvres135 ; deuxièmement, ils posent au centre de la narration la description des
personnages, leur objectif étant celui de réinterpréter Les Caractères de La Bruyère ; enfin, ils
proposent la formule de « tableau littéraire », qui sera au centre de la réflexion poétique de
tout écrivain romantique.
Mais ces modèles ne suffisent que partiellement : non seulement la structure du
personnage n’est pas encore mise au point, car elle semble osciller entre la sphère du
caractère et celle, toute neuve, du « type », mais il manque aussi une grille pour lire la réalité
dans laquelle les intellectuels sont plongés.
C’est entre 1825 et 1828 qu’émergent deux disciplines auxquelles recourt le genre
d’études de mœurs pour sortir de son impasse : la physiognomonie et la peinture. Bien que
de deux façons différentes, la physiognomonie et la peinture partagent dans cette période
un point commun, à savoir une attention particulière au corps humain. Si la
physiognomonie, aussi bien que la phrénologie, analyse les rides, les signes, les expressions
du visage pour définir la nature humaine, le caractère de la personne, la peinture poursuit
un chemin très proche de cela à partir de Delacroix. Ségolène Le Men, dans son étude Pour
rire ! Daumier, Gavarni, Rops, introduit l’hypothèse très intéressante selon laquelle c’est
vraiment La Liberté guidant le peuple, exposé au Salon de 1831, qui « relève de la nouvelle
peinture d’histoire de l’école de 1830 et présuppose un système sémiotique fondé sur le
langage des corps, celui de la représentation du peuple de Paris à travers une pluralité de
ʺtypesʺ, réunis autour du personnage féminin qui incarne l’idée de nation »136. C’est-à-dire
que le tableau de Delacroix témoigne d’une nouvelle grille de lecture – et de représentation
– du réel qui s’est déjà imposé auprès de son public, fondé sur le corps comme véritable
système sémiotique. On parle de « types », car il n’est plus possible de parler d’allégories, la
lisibilité des personnages étant minée : « l’homme au gibus qui porte un tablier de cuir est-il
un bourgeois ou un ouvrier ? La Liberté coiffée du bonnet phrygien […], a du poil aux
aisselles, ce qui ne convient ni à une allégorie, ni à l’éternel féminin… »137.
135 Thème fortement présent dans la narration balzacienne. Voir notamment F. Fiorentino, « Province, mondanité, cohabitation. Notes sur l’espace romanesque chez Balzac » dans Cahiers de Littérature française, I, 2005, pp. 71-82 ; A. Watts, Preserving the Provinces : Small Town and Countryside in the Work of Honoré de Balzac, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, Peter Lang, 2007 ; J. Guichardet, op. cit. ; N. Mozet, La ville de province dans l’œuvre de Balzac, Paris, C.D.U./SEDES, 1982. 136 S. Le Men, Pour Rire ! Daumier, Gavarni, Rops, Paris, Somogy éditions d'art, 2010, p. 21. 137 Ibidem.
93
La révolution la plus prégnante qu’accomplit l’art romantique à ce propos concerne
sans doute l’entrée du quotidien dans le champ des sujets susceptibles d’une représentation
artistique : si l’art classique avait choisi comme objet principal de la représentation la beauté
idéale, le Romantisme s’ouvre à toutes les nuances du beau mais surtout du laid qu’offre la
nature. Comme l’écrit Michel Melot, « la beauté idéale se veut universelle. Il ne peut y avoir
de ʺparticularité universelleʺ. Il ne peut donc pas exister de ʺlaideur idéaleʺ comme il
pourrait, croit-on, exister une Beauté idéale »138. La pluralité donc entre dans les arts grâce à
l’acceptation des nuances qui composent le monde réel ; cela rend possible la création de
personnages nouveaux, de protagonistes jamais vus auparavant, qui enrichissent la
représentation artistique de sujets et d’histoires très proches de la contemporanéité.
Dans la littérature aussi, à cette date, des auteurs comme Victor Hugo, Stendhal et
Balzac lui-même ont assimilé cette esthétique toute moderne. Selon Mikaël Bakhtine, le
personnage devient le point fort du roman grâce à cette poétique du temps présent :
Le cinquième et dernier type du roman de formation est le plus important. L’évolution
de l’homme y est indissoluble de l’évolution historique. La formation de l’homme se
fait dans le temps historique réel, nécessaire, avec son futur, avec sa profonde
chronotopicité. […] Dans des romans tels que Gargantua et Pantagruel, Simplicissimus,
Wilhelm Meister, la formation de l’homme se présente différemment. Ce n’est déjà plus
une affaire privée. L’homme se forme en même temps que le monde, il reflète en lui-
même la formation historique du monde. […] L’image de l’homme en devenir perd
son caractère privé (jusqu’à un certain point, bien entendu) et débouche sur une
sphère toute différente, sur la sphère spacieuse de l’existence historique. Tel est le type
ultime du roman de formation, le type réaliste.139
Mais, remarque Arrigo Stara en suivant la thèse de Bakhtine, que :
[…] come il romanzo nel suo insieme, anche le « singolarità empiriche » che ne erano
protagoniste nascevano sfruttando una serie di artifici fino ad allora poco utilizzati,
quando non del tutto sconosciuti ; le risorse di una retorica dell’autentico o del
verosimile che sapeva adattarsi benissimo alla domanda di realtà che proveniva dai
nuovi lettori dell’età illuminista, e doveva dunque cominciare con il nascondere per
quanto possibile le proprie tracce, negando alla finzione lo statuto di finzione. Così
138 M. Melot, « Conclusions » dans L’art de la caricature, sous la direction de Ségolène Le Men, Paris, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2011, p.327. 139 M. Bakhtine, Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard, 1984, pp. 229-230.
94
come il novel si presentava al giudizio di questi lettori quasi fosse una history of facts,
anche i personaggi erano chiamati a comparire sulla ribalta che esso gli offriva […].140
Parmi ces outils qui font du personnage le double de l’homme réel, il y a sans doute les topoï
qui donnent à l’homo fictus une figure, voire un corps à valeur sémiotique. Le « tableau
pathétique » balzacien, comme l’a défini Danielle Dupuis141, et la référence picturale font
partie de ces expédients rhétoriques, comme « le portrait est plus qu’un simple élément de
décor : il porte en lui la puissance d’un récit, rappelle une époque écoulée, un autre visage
de son modèle, il est un fragment arraché à des pages antérieures de l’histoire »142. Le
portrait, comme technique et comme référence esthétique, contribue à la création de la
figure, qui conditionne le paraître et l’être143 du personnage.
À titre d’exemple nous nous reportons à la description du personnage du vieil
antiquaire dans La Peau de chagrin, où la densité de la description frappe le lecteur avec ses
détails saisissants et son style pictural :
Figurez-vous un petit vieillard sec et maigre, vêtu d’une robe en velours noir, serrée
autour de ses reins par un gros cordon de soie. Sur sa tête, une calotte en velours
également noir laissait passer, de chaque côté de la figure, les longues mèches de ses
cheveux blancs et s’appliquait sur le crâne de manière à rigidement encadrer le front.
La robe ensevelissant le corps comme dans un vaste linceul, et ne permettait de voir
d’autre forme humaine qu’un visage étroit et pâle. Sans le bras décharné, qui
ressemblait à un bâton sur lequel on aurait posé une étoffe et que le vieillard tenait en
l’air pour faire porter sur le jeune homme toute la clarté de la lampe, ce visage aurait
paru suspendu dans les airs. Une barbe grise et taillée en pointe cachait le menton de
cet être bizarre, et lui donnait l’apparence de ces têtes judaïques qui servent de types
aux artistes quand ils veulent représenter Moïse. Les lèvres de cet homme étaient si
décolorées, si minces, qu’il fallait une attention particulière pour deviner la ligne tracée
par la bouche dans son blanc visage. Son large front ridé, ses joues blêmes et creuses,
la rigueur implacable de ses petits yeux verts dénués de cils et de sourcils, pouvaient
faire croire à l’inconnu que le Peseur d’or de Gérard Dow était sorti de son cadre […].
Un peintre aurait, avec deux expressions différentes et en deux coups de pinceau, fait
140 A. Stara, L’Avventura del personaggio, Verona, Le Monnier, 2004, p.95. 141 D. Dupuis, « Entre théâtre et peinture : le tableau pathétique balzacien », AB 2001, pp. 83-98. 142A. Goetz, « Une toile de Rembrandt, marchant silencieusement et sans cadre. L’esthétique du portrait peint dans La Comédie humaine », AB 2001, pp. 104. 143 Voire S. Baroni, Le apparenze sociali in Honoré de Balzac, Mémoire de master, sous la dir. de Daniele Giglioli, soutenu chez l’Université de Bergame, Italie, le 29 avril 2015.
95
de cette figure une belle image du Père Éternel ou le masque ricaneur du
Méphistophélès, car il se trouvait tout ensemble une suprême puissance dans le front
et de sinistres railleries sur la bouche.144
Les mots que nous avons soulignés mettent en lumière au moins deux aspects du style
balzacien au début des années 1830. D’un côté, la richesse des détails physiques de
l’antiquaire, « sec et maigre », connotent l’apparence fantasmagorique du vieillard de deux
couleurs, le blanc et le noir. D’autre part, le portrait de ce personnage est fondé sur des
renvois insistants à l’art figural et à son langage. « Figurez-vous », d’abord, une expression
dont Jacques Neefs a analysé l’importance dans le style de Balzac, c’est le mot magique qui
permet à la narration de représenter soi-même, de donner une figure à la scène :
La prose narrative balzacienne relève le défi d’être à la fois le mouvement et le regard,
la consistance et la vision, dans un mimétisme actif, dont la puissance est comme
« performative ». Cette prose narrative doit en effet conquérir une exceptionnelle
puissance « dramatique » et figurale (la démonstration se joue dans les « scènes », dans
leurs détours et leurs dénouement), pour faire de chaque récit l’effectuation modélisée
d’un canton de cette « nature sociale » qui est donnée à voir et à comprendre, mais
d’abord à vivre. Et simultanément, cette prose narrative doit en effet conquérir une
incomparable puissance « analytique », pour que ce qui est rendu visible reçoive un
nom, entre dans un ordre concevable, répertorié, pour que les lois de cette « nature
sociale » puissent être élaborées.145
Encore, dans le portrait rédigé par Balzac il y a au moins trois références picturales ; mais
c’est le tableau de Gérard Dow, Le Peseur d’or, qui devrait donner l’image la plus concrète du
personnage. Nous reviendrons sur ce passage dans le chapitre dédié à La Peau de chagrin de
l’édition Delloye et Lecou (1838), pour analyser l’enjeu qui se crée entre ces images et
l’illustration proprement dite de ce personnage. Mais nous remarquons tout de suite
l’ambiguïté qui tombe sur l’antiquaire du moment qu’au lieu d’une figure sèche et noire le
lecteur trouve dans le modèle de Dow un homme rondelet et vêtu de rouge !146
D’après l’étude conduite par Régine Borderie sur Balzac peintre de corps, il est
impossible de nier le rôle joué par Balzac dans le développement du portrait littéraire : « De
144 H. de Balzac, La Peau de chagrin, Pl, t. X, pp. 77-78. 145 J. Neefs, « Figurez-vous… » dans Balzac et le style, études réunies et présentées par Anne Herschberg-Pierrot, Paris, Sedes, 1998, p. 42. 146 Ces réflexions, nous les avons déjà partiallement formulé dans notre Mémoire de master et dans un article, publié dans une revue italienne, dédié à l’étude des rapports entre art et littérature: voir S. Baroni, « La comédie de la description. “Capricci” balzachiani », Poli-Femo, n°11-12, 2016.
96
fait, trouve-t-on dans la littérature française, des auteurs précédant Balzac aussi soucieux
que lui de rendre compte des caractéristiques physiques en les diversifiant, ou au moins en
produisant une impression de diversité ? »147. Le trait physique va compléter la structure du
personnage littéraire, qui devient finalement un véritable cousin de l’homo sacer, à savoir
l’homo fictus – en d’autres termes, le personnage « rond », comme l’a défini Edward Morgan
Forster.
Le détail du corps constitue la base pour la création du type. Nous pourrions dire
d’ailleurs que la représentation du corps conditionne déjà la modélisation du type : on est
habitué à considérer le personnage-type comme un monolithe, un bloc unique classifiable
comme type social, moral, etc. Mais le détail physique, à notre avis, rend le panorama
beaucoup plus complexe, dans le sens qu’il se présente comme une première barrière, une
première phase de modélisation qui détermine le caractère du personnage. Au niveau du
portrait physique, qui généralement accompagne l’apparition des protagonistes, le
personnage peut être considéré donc comme un « type iconique » : non seulement le
portrait donne des indices sur les particularités du personnage, mais il en conditionne l’être
moral et social.
Le type iconique est aussi le modèle pour les personnages qui appartiennent à l’une des
catégories formulées : Raphaël de Valentin, Lucien de Rubempré, Eugène de Rastignac, ils
147 R. Borderie, Balzac peintre de corps, Paris, Sedes, 2002, p. 12.
Description du personnage
Type social
Type moral
Type caractèrial
Corps: type iconique
Caractère
97
ont tous des corps qui se ressemblent, même s’ils gardent toujours des détails
personnalisés.
D’où vient cette nouvelle capacité de Balzac de décrire la figure humaine ? La
peinture a sans doute eu sa part dans cette reconsidération du corps humain, comme nous
l’avons affirmé par rapport à l’importance du tableau de Delacroix, La Liberté guidant le
peuple. L’entrée du pittoresque dans la narration n’est pas propre seulement à l’auteur de La
Comédie humaine. Certes, les travaux dédiés à Balzac et l’art ne se comptent plus : de Marc
Eigeldinger, Olivier Bonard et Pierre Laubriet, les spécialistes de l’écrivain ont parcouru les
différentes voies que la philosophie de l’art chez Balzac avait ouvertes. Mais, comme nous
l’avons déjà dit, il existe aussi de nombreuses études analysant le rapport entre plume et
pinceau qui ont mis en lumière comment le Romantisme déploie à une véritable culture de
l’image, qui s’impose chez les artistes mais aussi dans le public. Imageries par Philippe
Hamon, les nombreuses études de Bernard Vouilloux, jusqu’aux travaux plus récents
d’Anka Muhlstein et de Nicolas Valazza148, ont tous élargi la vision de la tension entre
littérature et peinture en faisant une comparaison entre plusieurs auteurs du XIXᵉ siècle. Il
reste pourtant évident que chaque auteur a interprété à sa manière cette obsession pour
l’image, et que Balzac semble se distinguer parmi les autres par la complexité et l’originalité
de son style pictural.
Le terrain commun à tous les artistes de cette période est, selon Ségolène Le Men, la
nouvelle façon de lire les images qui, bien qu’affirmée par Delacroix, ne vient pas de la
peinture :
La grille visuelle de lecture sociale et politique sur laquelle repose la peinture de
Delacroix, en connivence avec son public, et qu’il détourne déjà, a été lentement
élaborée au cours de la première moitié du XIXᵉ siècle. Elle s’est imposée au théâtre,
dans la peinture, dans la littérature, et d’une manière générale dans les mentalités,
selon une formule que les caricaturistes et les illustrateurs ont progressivement
instaurée dès les années 1820 en recourant à toutes sortes de métaphores optiques. La
seconde moitié du siècle l’exploite et la perpétue […].149
148 N. Valazza, Crise de plume et souveraineté du pinceau. Écrire la peinture de Diderot à Proust, Paris, Classiques Garnier, 2013. 149 S. Le Men, Pour rire ! Daumier, Gavarni, Rops, op. cit., p. 21.
98
La nouvelle esthétique des corps – et des types – vient des albums lithographiques et
des dessins des illustrateurs romantiques. Balzac, notamment, bénéficie énormément de
leur influence : Gautier, Baudelaire, les contemporains de l’écrivain ont souvent remarqué
comment derrière certains grands personnages balzaciens ils reconnaissaient les dessins de
Daumier ou de Monnier.
La presse illustrée fut le point concret de ce contact étroit entre Balzac et ceux qui, à
cette époque, étaient principalement des caricaturistes. Nous allons voir maintenant les
relations que Balzac avait tissées avec eux ; enfin, nous analyserons comment la caricature
dessinée a influencé l’écriture balzacienne, en marquant profondément le style des œuvres
de La Comédie humaine.
3.3. Balzac et la presse : les critiques des albums lithographiés
Les premiers contacts de Balzac avec les illustrateurs datent de 1828-1829. Il est certain que
ses premières connaissances furent celle de Devéria, avec lequel il avait travaillé pendant
son travail d’imprimeur, et celle d’Henry Monnier, dont Balzac avait imprimé plusieurs
illustrations (Béranger, Brillat-Savarin). Il n’y a pas de doute que Balzac a vu aussi le
premier album de celui-ci, les Mœurs administratives (1828), qui ont eu une grande influence
dans la création de romans tels que Les Employés et Les Petits Bourgeois. Mais il faut attendre
le tournant de 1830 pour avoir quelque trace de la rencontre de Balzac avec le monde des
illustrateurs. Plus précisément, il faut attendre la revue Le Voleur et la fondation du journal
La Silhouette d’Émile de Girardin respectivement en 1828 et en 1829 pour voir paraître des
articles par Balzac dédiés au monde artistique.
Ses contributions aux journaux témoignent de la confusion qui a dû entourer le
romancier en cette période-là : d’un côté, des articles tels que De l’état actuel de la librairie
(mars 1830), ou Des artistes (février- avril 1830) démontrent comment le jeune écrivain
cherche à comprendre le système double du réel, partagé entre Idée et Forme. Le trésor de
l’homme du génie, ce sont les idées, mais comment les transposer dans l’écriture ? Balzac
semble arriver à formuler la solution d’abord dans De l’état actuel de la littérature, où il soutient
que :
Un fait littéraire ressort de cette lecture, elle accuse en l’homme une tendance naturelle
vers les personnifications bizarres. Les peuples aiment les images. Ce goût pour les
figures exagérées explique le succès de Notre-Dame de Paris, aussi bien que celui des
99
fantaisies de Rabelais, de Swift et de Perrault. De là deux littérature : celle des idées et
celle des images ; à celle des images, la popularité, sauf les droits du génie, qui cache, à
l’exemple de Rabelais, un évangile humain sous de capricieuses arabesques ; à celle des
idées, un public d’élite, des approbations rares, le public de Spinoza, de Hobbes, de
Bacon, de Vico, de M. de Bonald, de Ballanche.150
Un dualisme que Balzac réussit à franchir en théorisant l’existence d’une troisième école,
celle de l’Éclectisme littéraire, dans l’Étude sur la Chartreuse de Parme de Monsieur Beyle :
Quant à moi, je me range sous la bannière de l’Éclectisme littéraire par la raison que
voici : je ne crois pas la peinture de la société moderne possible par le procédé sévère
de la littérature du dix-septième et du dix-huitième siècle, L’introduction de l’élément
dramatique, de l’image, du tableau, de la description, du dialogue me paraît
indispensable dans la littérature moderne. Avouons-le franchement ? Gil Blas est
fatigant comme forme : l’entassement des événements et des idées a je ne sais quoi de
stérile. L’Idée, devenue Personnage, est d’une plus belle intelligence.151
L’image, le tableau, représente la possibilité de rendre plus plaisant la forme, l’idée, mais
non seulement : dans La Femme de trente ans, le narrateur affirme que :
Les peintres ont des couleurs pour ces portraits, mais les idées et les paroles sont
impuissantes pour les traduire fidèlement ; il s’y rencontre, dans les tons du teint, dans
l’air de la figure, des phénomènes inexplicables que l’âme saisit par la vue, mais le récit
des événements auxquels sont dus de tels bouleversement [sic] de physionomie est la
seule ressource qui reste au poète pour se faire comprendre.152
L’image est donc la clé qui permet à Balzac de trouver l’unité entre le monde de l’absolu et
le monde empirique, le moyenne pour exprimer ce qu’on voit mais que l’écriture n’arrive
pas toujours à décrire. Il reste toutefois le problème de la transposition de l’image dans le
récit.
C’est à ce point-là que la leçon des illustrateurs intervient : entre 1830 et 1832, Balzac
rédige, sous différents pseudonymes, sept comptes rendus d’albums lithographiques et de
caricatures. À travers l’analyse de ces textes il est possible de retracer la parabole accomplie
par l’image dans le style balzacien et dans ses études de mœurs. Nous avons recueilli les
150 H. de Balzac, OD, Pl, t.II, pp. 1230-1231; c’est nous qui soulignons. 151 H. de Balzac, Étude sur la Chartreuse de Parme de Monsieur Beyle, Chemin des Pins, Castelnau-le-Lez, éditions Climats, 1989 (1840) ; c’est nous qui soulignons. 152 H. de Balzac, La Femme de trente ans, Pl, t.II, p. 1207.
100
comptes rendus en trois groupes, selon des affinités de thèmes et de style qui nous aident à
commenter les points fondamentaux de notre étude.
Le premier groupe compte deux articles : « Voyage pour l’éternité » et « Mœurs
aquatiques ». Ce sont les comptes rendus de deux œuvres par Grandville, l’album Voyage pour
l’éternité et la caricature Mœurs aquatiques. Les deux comptes rendus sont publiés
respectivement le 15 avril et le 20 mai 1830 dans La Silhouette, journal dirigé par Charles
Philipon ; à l’instar du Voleur, La Silhouette fonde son projet sur l’insertion d’images
saisissantes :
L’hebdomadaire, qui sortit à point pour les étrennes, le 24 décembre 1829, se
distinguait par plusieurs innovations importantes de tous les journaux à hors-texte
parus jusque-là en France. Comme le laissait entendre son sous-titre d’Album
lithographique, les lithographies en constituaient le texte véritable, tandis que les
paraphrases qui les accompagnaient faisaient figure d’illustrations littéraires […]. La
Silhouette s’adressait visiblement aux clients d’Aubert et de Martinet, grâce à cette
formule ambiguë dont l’inventeur nous paraît avoir été, non pas Philipon, mais Henry
Monnier.153
Les comptes rendus de Balzac sont donc bien justifiés dans le journal. Pourtant, les textes
de Balzac sont très particuliers : au lieu d’évoquer de façon explicite les planches de
l’album, il préfère construire une sorte de narration que les images lui ont inspirée, une
« fantaisie », pour reprendre une idée formulée par Bernard Vouilloux154 à l’égard de ces
textes. Prenons par exemple ce qui devrait être la description de la planche 8 :
Vous êtes en proie à une des douces rêveries dans lesquelles vous plonge le
mouvement voluptueusement oscillatoire d’une rapide voiture. Ce sont les plus frais
tableaux de votre existence que vous apparaissent. Ils fuient comme les ravissants
aspects d’un mirage, au moment où vous atteignez le but de votre voyage. Si vous
viviez dans le passé, ou peut-être dans votre avenir, toute cette fantasmagorie disparaît
devant le bonheur présent, vous arrivez…Mais il y a là une pierre, un fossé, le
postillon vous a mené au cercueil.155
153 R. Chollet, Balzac journaliste, op. cit. p. 184. 154 Voir B. Vouilloux, « Les fantaisies journalistiques de Balzac », AB 2012, pp. 5-24. 155 H. de Balzac, « Voyage pour l’éternité », OD, Pl, t.II, p.722
101
Figure 28 : Grandville, Voyage pour l'éternité, planche 8
Figure 29 : Grandville, Mœurs aquatiques
102
La planche de Grandville toutefois représente deux jeunes femmes, accueillies par deux
squelettes-grooms, scène qui peut-être inspirera Balzac pour la nouvelle Le Message.
Dans le commentaire à la caricature Mœurs aquatiques, Balzac utilise une autre stratégie
pour parler de l’image. Au lieu de la décrire, il demande à vingt-quatre personnes de donner
leur opinion sur le signifié de l’allégorie de Grandville, selon une construction narrative
typique du genre de la physiologie que l’écrivain exploite aussi dans Madame Firmiani156.
Par le dialogue qui s’ensuit, on comprend que dans la caricature de Grandville il est peint
un rat qui tient dans ses bras une grenouille, prise dans l’acte de sauter dans un étang.
L’auteur de l’article se garde bien de donner son avis ; ainsi, l’interprétation du dessin reste
ouverte, dans une sorte de respect pour la richesse des signifiés possibles évoqués par
l’image de Grandville157.
Le second groupe de comptes rendus que nous allons voir est composé par deux
trois textes, à savoir « Le dîner bourgeois, Scènes populaires dessinées à la plume par H. M. », paru le
15 mai 1830 dans Le Voleur ; « Gavarni », publié dans La Mode le 2 octobre 1830 ; et
Travestissements pour 1832, et Physionomie de la population de Paris », écrit pour L’Artiste le 4 mars
1832. Ces trois comptes rendus offrent de manière implicite une réflexion sur l’opposition
caractère-type, laquelle démontre l’hésitation de Balzac dans la terminologie qui concerne le
personnage, reflet de la confusion sur la poétique du récit, une impasse dont Balzac, nous
l’avons vu, ne se libèrera pas vraiment.
Le Dîner bourgeois est le titre de l’une des six planches coloriées qui composent les
Scènes populaires, volume in-8° de Monnier publié en 1830 chez Levavasseur et Urbain Canel.
Balzac ne se contente pas de donner des descriptions des lithographies du volume. Au
contraire, il ouvre le texte avec une réflexion sur le drame, qui doit trouver des outils
différents pour être représenté selon la forme artistique à laquelle il est destiné : le drame
d’une pièce théâtrale sera donc construit autrement que le drame d’un récit. La peinture, en
revanche, ne présente pas ce dilemme : « nous sommes heureux de pouvoir donner à nos
lecteurs un fragment inédit des Scènes populaires, dues au crayon de M. Henry Monnier ; car
même en écrivant, M. Monnier est toujours peintre, c’est la même touche, tantôt vive et
156 H. de Balzac, Madame Firmiani, Pl, t.II, pp. 142-147. 157 Sur l’interprétation de l’allégorie de Grandville de cette planche, voir P. Kaenel, « Allégories, rébus, hiéroglyphes : J.-J. Grandville et les ˝images ingénieuses˝ » dans World & Image Interaction, Bâle, Wiese Werlag, pp. 109-122 ; S. Le Men, « Mœurs aquatiques, une lithographie de Grandville ˝expliquée˝ par Balzac », Gazette des Beaux-Arts, février 1988, pp. 63-70.
103
légère, tantôt puissante et profonde, comme dans ses délicieux dessins, tout est vraie
nature »158. Balzac évoque alors deux types sociaux que Monnier a rendus célèbres, ceux de
la grisette et de la portière :
Sa grisette est fringante et preste ; le bas blanc, le pied furtif, la taille amoureuse, la
dentelle d’un blanc et frais bonnet qui voile deux yeux lascifs, un jargon comique et
gracieux, du rire et des pleurs, et voilà un type. Sa portière est méchante et hargneuse,
sale, cassée, bossue, et aussi despotique dans sa loge qu’une femme qui aurait le
pouvoir absolu du sultan.159
Voilà tracé le chemin pour la construction du type : les dessins de Monnier sont la
« peinture », la « création parfaite »160 de la petite bourgeoisie. Les lithographies de Monnier
sont l’exemple du processus de condensation et de synthèse du réel que Balzac doit
accomplir pour formuler le type dans le récit. Peindre la grisette et la portière en mots n’est
que le premier exercice du futur romancier de mœurs. Le modèle par excellence se fixe dès
maintenant sur le type de M. Prudhomme, « caractère unique »161 qui représente ce « type
individualisé » conçu par Balzac quelques années plus tard. Mais, encore, même si le
compte rendu du Dîner bourgeois donne des informations précieuses par rapport à la
conception du type, nous ne pouvons que remarquer l’absence d’une description effective
de l’image choisie pour présenter au public le volume de Monnier, la grisette et la portière
étant dessinées dans deux autres planches de l’ouvrage.
158 H. de Balzac, « Le Dîner bourgeois, Scènes populaires dessinées à la plume par H. M. », OD, Pl, t.II, p .657. 159 Ibidem. 160 Ibid., p. 658. 161 Ibidem.
104
Figure 30 : Monnier, Scènes populaires dessinées à la plume, « Le Diner bourgeois »
Article encore plus étrange que celui consacré à Paul Gavarni. Texte non signé, mais
qui est quasi certainement de Balzac, il devrait être une présentation élogieuse de l’un des
collaborateurs le plus talentueux de la rédaction de La Mode, que Girardin avait réussi à
voler à son principal concurrent, le Journal des dames et des modes. Cependant, la moitié de
l’article semble un hymne à Charlet et à Monnier plutôt qu’à Gavarni, dont la place dans le
texte est assez réduite. Les éditeurs scientifiques de l’article pour l’édition des Œuvres diverses
de Balzac ont vu dans ce comportement le témoignage de la faible considération que le
romancier avait pour cet artiste, banni d’ailleurs de La Comédie humaine. Effectivement,
Henry Monnier et Champfleury aussi ne lui donnent pas le même relief qu’à Daumier ou
Traviès. L’impression est que Gavarni n’arrive vraiment pas à compléter la modélisation en
type de ses personnages. Dans l’article paru dans La Mode, l’auteur n’utilise jamais le mot
« type », employé d’ailleurs dans le compte rendu sur Monnier paru cinq jours avant. Les
personnages de Monnier sont des « êtres vivants », des « nature » ; Prudhomme seul reste
« le type le plus complet »162. Ainsi, les figures de Gavarni se distinguent des dessins de
mode par leur vitalité : Gavarni a réussi à « rendre le caractère de la classe élégante », en
donnant du luxe à l’album du journal. Mais le jugement final n’est pas si chaleureux, et les
162 H. de Balzac, « Gavarni », OD, Pl, t.II, p. 778.
105
dessins de l’artiste sont déclassés en estampes de mode : « Devenant ainsi une sorte de
spécialité toute nouvelle, L’Album de la mode, satisfaisant à la fois aux exigences de l’artiste,
au goût de la haute société, et se produisant comme une chose d’art et de mode, tout ensemble un
besoin et un luxe, nous permettra de ne pas la restreindre à des esquisses légères et
conventionnelles »163.
Les albums Travestissements pour 1832 et Physionomie de la population de Paris semblent
plaire un peu plus au romancier, qui retrace finalement des types dans les figures de
Gavarni. Comme pour le cas de Grandville, la description des six planches des
Travestissements se mêle à la fantaisie, et les dessins de l’artiste donnent lieu à de micro-
narrations : « La Señorita tire les rideaux de l’alcôve d’un air si voluptueux que le Diable a
donné lui-même au peintre la chaleur rouge qui embrase le dessin ! Avec la certitude d’être
damné, de sentir le fer du poignard au milieu d’un imprudent sommeil il est impossible à
un homme de ne pas vouloir suivre la Señorita qui dit : ʺAllons ! ...ʺ »164.
Figure 31 : Gavarni, Travestissements pour 1832, « La Señorita »
Les travestissements sont faits pour le plaisir, « tandis que les personnages parisiens
font penser » : « la plupart d’entre eux sont des chapitres d’un nouveau tableau de Paris,
écrit par un Mercier qui a plus de talent que son prédécesseur. Gavarni fait un livre à son
163 Ibid., p. 781 ; c’est nous qui soulignons. 164 H. de Balzac, « Travestissements pour 1832 et Physionomie de la population de Paris », OD, Pl, t.II, pp. 1195-1196.
106
insu, il vole les écrivains du jour »165. Et Balzac exprime son admiration pour la femme
vêtue d’une robe de soie verte, portant des gants de Suède. Le Colleur de papier « est un petit
chef-d’œuvre », comme ces types « sont les personnages les plus admirablement comiques
que puisse fournir le peuple de Paris » ; Gavarni a le mérite de prendre la nature sur le fait,
de peindre la vérité telle qu’elle est. Pourtant, Balzac n’est pas complètement satisfait : non
seulement il conseille à l’artiste trois types sur lesquels travailler – le Gamin, le Sous-chef,
l’Acteur – mais il affirme son mécontentement par rapport à trois personnages, la
Cuisinière, le Garde national et l’Avocat :
Ces trois figures n’ont rien de typique ; elles n’expriment aucune idée ; si Gavarni les a
vues, il a eu tort de les choisir. À deux lieues de Paris elles pourront paraître
excellentes ; mais pour l’observateur, pour un Parisien qui connaît bien son pavé, pour
le flâneur idolâtre du farniente savouré sub dio dans les rues, il manque à ces trois figures
le je-ne-sais-quoi que l’artiste a si bien saisi pour toutes les autres.166
La conclusion du compte rendu sur les albums de Gavarni témoigne donc de l’affirmation
d’une pensée « par typisation » chez Balzac désormais bien consolidée. L’apprentissage est
presque achevé, et le romancier s’apprête à créer son univers de types, dans lesquels
l’empreinte originale des lithographies de cette période se ressentira toujours.
Figure 32 : Gavarni, Physionomie de la population de Paris, « La Cuisinière »
165 Ibid., pp. 1196-1197. 166 Ibid., p. 1198 ; c’est nous qui soulignons.
107
Le dernier groupe de comptes rendus que nous allons analyser est composé par deux
textes qui ont été publiés dans La Caricature. Fondée par Philipon selon le modèle de La
Silhouette, La Caricature base son projet sur les dessins d’artistes déjà connus par le public,
comme Monnier, Grandville et Charlet. Dans le Prospectus du journal, rédigé par Balzac lui-
même, on remarque avec quelle insistance l’auteur souligne la présence d’images plaisantes
et comiques dans l’hebdomadaire :
Ces observations disent énergiquement que nous n’offrirons pas ces dessins
énigmatiques dont l’auteur seul a le mot, ou de détestables productions qui souvent
convertissent en dégoût un plaisir attendu. La position des éditeurs et leurs
arrangements avec la maison qui, la première, a compris la nécessité de créer un
magasin de caricatures et de lithographies, permettent de choisir pour ce journal l’élite des
idées si puissantes et si originales des Victor Adam, Bellangé, Charlet, Decamp,
Grandville, Grenier, Henri Monnier, Pigal, etc.167
C’est sans doute le procédé de la lithographie qui permet la réalisation de ce journal illustré
à bas prix :
Maintenant, intelligemment exploité, le procédé de la lithographie apporte au
problème de la vente à bas prix la solution révolutionnaire que les fabricants de
romans désespèrent de rencontrer, et la formule journalistique permet d’atteindre
aisément les amateurs éloignés de la capitale. Pour 46 francs par an, La Caricature offre,
en plus d’un hebdomadaire littéraire, cent quatre planches hors commerce exécutées
par les plus grands artistes : pas même 50 centimes la pièce, moins que le prix auquel
Aubert diffuse au profit des victimes de Juillet son Charles X en Jésuite, quand une
lithographie de série est mise en vente à 3 francs, souvent davantage lorsqu’elle est
retouchée à la gouache.168
Si la collaboration de Balzac au Voleur et à La Silhouette lui avait appris à traiter l’étude
de mœurs de façon nouvelle, révolutionnant le personnage littéraire, la participation de
Balzac à La Caricature marque plutôt le style du romancier. La relation entre mot et image
trouve la formule cette fois dans la caricature d’inspiration anglaise. Mais « Balzac met
aussitôt l’accent sur la forme plus que sur l’objet de la satire ; à ses yeux la caricature n’est
pas prisonnière de son rôle politique, l’imagination de l’artiste en fera surgir des ʺfoliesʺ,
des ʺfantaisies ʺ, des ʺcapricesʺ où, comme dans l’épilogue de Zéro, le saugrenu cohabitera
167 H. de Balzac, Prospectus du journal La Caricature, dans OD, Pl, t.II, p. 796. 168 R. Chollet, Balzac journaliste, op. cit., p. 409.
108
avec le fantastique »169. Roland Chollet n’a pas été le premier à souligner le fait que la
caricature devient dans La Comédie humaine une technique d’écriture : Lucien Refort, qui a
consacré un ouvrage à La Caricature littéraire, note combien Balzac avait les dons essentiels
du caricaturiste, grâce à son excellente capacité d’observation170 ; Olivier Bonnard lui aussi a
consacré toute la troisième partie de son étude au « style caricatural balzacien »171 ; plus
récemment, Nathalie Preiss a démontré la parenté existante entre la caricature, la charge et
la blague dans son essai Pour de rire ! La blague au XIXᵉ siècle, en allant à identifier les
personnages « blagueurs » de La Comédie humaine172.
À bien voir, Balzac n’aboutit pas souvent à la caricature littéraire : il ne semble pas
viser l’effet comique, lorsqu’il exagère l’accumulation de détails qui rendent très complexe
le portrait. Mais le geste, l’inspiration initiale est certainement la caricature. De fait, la
caricature est d’une importance immense pour Balzac : puisque l’étude de mœurs et la
typisation comportent le risque de s’éloigner de la réalité particulière, la vision caricaturale
permet à l’auteur de percevoir la singularité du personnage :
[…] cette analyse subtile de la charge révèle bien au contraire une profondeur de
psychologue et une finesse dans le choix des caractères évocateurs, à quoi ne
parviendrait jamais peut-être une synthèse généralisée. Ne faut-il pas, pour démêler le
détail le plus significatif dans la multiplicité de tous les aspects, connaître d’abord cette
multiplicité, sans en rien oublier ? Le choix reste impossible, ou arbitraire, s’il ne
procède pas d’un examen complet du tout. C’est là le premier argument en faveur du
croquis-charge : il traduit à sa manière le particularisme de la nature.173
Le caricaturiste gardant l’âge du siècle qu’il a stigmatisé ou ridiculisé fonctionne comme un
viseur, qui permet de voir les détails les plus significatifs de son époque.
Ce n’est pas par hasard que la description effective de la planche prise en étude dans
le compte rendu arrive finalement dans le numéro 16 de La Caricature, le 17 février 1831,
quasi en concomitance avec la publication de La Peau de chagrin. Tous les seize personnages
de la planche Bacchanales de 1831 de Grandville sont mentionnés par Balzac avec une petite
description, qui vise la création d’une chaîne de figures :
169 Ibid., p. 411. 170 L. Refort, La Caricature littéraire, Paris, Librairie Armand Colin, 1932, p. 18. 171 O. Bonard, La peinture dans la création balzacienne, op. cit. 172 N. Preiss, Pour de rire ! La blague au xixᵉ siècle, Paris, PUF, 2002. 173 L. Refort, op. cit, pp.4-5.
109
La liberté sort de l’hôpital, soutenue par L’Avenir en charlatan, et par un vétéran dont
la dégaine historique est si admirablement bien rendue, qu’il y a dans cette figure toute
une biographie inexorable. Ne rend-elle pas le dévouement sénile d’un amant fidèle
jusqu’au tombeau ! Le pape et la papesse dansant une valse, sont de ces figures que
rien ne saurait payer. La ravissante papesse ayant un vieux pape qui défaille entre ses
bras et se retient de galoper…est peut-être une double épigramme. Est-ce Rome qui
chancelle devant un nouveau culte étourdi ?174
Nous n’analyserons pas le dernier compte rendu sur les Récréations de Monnier, car le
texte n’est qu’un éloge de l’artiste. À ce point, après ce bref panorama sur l’apprentissage de
Balzac dans le monde de l’illustration, nous pouvons nous plonger dans le champ propre à
l’illustration en librairie : dans les chapitres suivants de la thèse nous allons étudier
finalement les illustrations qui ont été créées pour les œuvres balzaciennes, en tenant
compte de cet engouement pour le style pictural et caricatural que nous venons de décrire.
Figure 33 : Grandville, Bacchanales de 1831
174 H. de Balzac, « Bacchanales de 1831 », OD, Pl, t.II, p. 848.
113
CHAPITRE 4
LE REGNE DU FRONTISPICE ET DE LA VIGNETTE DE TITRE ENTRE
1830 ET 1838
Tandis qu’à chaque livre Johannot, d’amour ivre, Prête un rêve nouveau De son cerveau. Pour Boulanger qui l’aime, Facile, et venant même Baiser au front Nanteuil Dans son fauteuil, […] Daumier trouve l’étrange Crayon de Michel-Ange, –Noble vol impuni!– Et Garvani Court, sans qu’on le dépasse, Vers l’amoureuse Grâce Qu’à l’Esprit maria Devéria!
T. de Banville, L’Aube romantique, dans Rimes dorées, 1866.
Dans la première partie de notre étude, nous avons analysé les prémices de l’intérêt de
Balzac pour l’illustration. D’abord, nous avons commenté les premiers frontispices de ses
ouvrages, notamment dans ses romans de jeunesse ; deuxièmement, nous avons retracé la
démarche de Balzac imprimeur et fondeur de caractères, en nous penchant sur
l’exploitation du procédé nouveau du bois de bout par son imprimerie. Ensuite, nous avons
approfondi les rapports que Balzac a entretenus avec les illustrateurs romantiques, en
analysant les comptes-rendus qu’il avait faits des albums lithographiques de Monnier,
Gavarni et Grandville pour la presse autour de 1830.
Dans le chapitre 1, nous avons souligné que les premiers pas de l’écrivain dans le
monde de l’illustration devaient être considérés dans le contexte qui entoure cet art mineur
dans la décennie entre 1820 et 1830 : Balzac fait figure de pionnier en utilisant le bois de
bout pour les gravures du Molière et du La Fontaine, mais il reste toutefois attaché à la
tradition ancienne dans le traitement du sujet de l’image, car les illustrations commandées
ne répondent pas au changement qui entoure la figure humaine dans le Romantisme. De
même, les frontispices pour Le Vicaire des Ardennes et Annette et le criminel présentent des
éléments novateurs et, à la fois, traditionnels : le portrait de Mélanie, à la place de celui de
114
l’auteur, donne un relief particulier au personnage féminin, tandis que la scène esquissée
pour Annette s’inscrit dans le traitement « classique » du frontispice. La nouvelle grille de
lecture du personnage, inauguré par les illustrateurs de la première génération romantique,
parmi lesquels nous rappelons le rôle fondamental d’Eugène Delacroix avec son
interprétation du Faust, s’affirme aussi lentement chez Balzac : avant que le personnage
balzacien parvienne à sa maturité, il a fallu d’abord de la part de l’écrivain l’étude des
lithographies de l’époque et l’expérience comme journaliste dans la presse pour élaborer la
nouvelle technique de description liée au « type iconique ». L’influence que l’illustration a
exercée sur Balzac est donc, dans ces premières années de formation du romancier, subtile
mais forte, évidente.
Maintenant, nous sommes arrivée aux années cruciales de la production balzacienne :
1831 marque les débuts de Balzac romancier de mœurs, où, à partir de La Peau de chagrin, les
personnages gagnent de plus en plus d’importance dans la description de leur figure et de
leur caractère. Les références picturales enrichissent leur tableau, qui devient plus complexe
grâce à cet enjeu entre le texte et l’image.
Cette deuxième partie de notre étude sera consacrée à l’analyse des illustrations qui
sont placées dans les volumes que Balzac a publiés entre 1831 et 1842, c’est-à-dire avant le
commencement de la publication de l’édition Furne de La Comédie humaine. Parmi les
ouvrages qui composent le corpus balzacien des années 1840, nous ne prenons en compte,
pour cette section, que des œuvres écrites entièrement par l’écrivain, comme l’Histoire de
l’Empereur racontée dans une grange par un vieux soldat (1842)175. Nous avons retenu, dans la
période temporelle indiquée par la section courante, la Physiologie du rentier : de fait, bien
qu’elle ait été rédigée avec la collaboration d’Arnould Frémy, cette physiologie, publiée en
1841, est généralement considérée comme une œuvre balzacienne tout court. Par contre,
nous traiterons les textes illustrés de Balzac à l’intérieur de volumes de la littérature
panoramique dans la troisième partie de la thèse, en raison de liens très étroits que les
illustrations de La Comédie humaine présentent avec celles des Français peints par eux-mêmes.
Dans ce chapitre particulier, nous nous interrogeons sur les illustrations qui
participent à la construction du récit analysant d’un côté le contexte du livre romantique de
175 La première publication de ce fragment, qui fera enfin partie du Médecin de campagne, date 1833 : elle a été rédigée pour L’Europe littéraire, qui l’a fait paraître le 19 juin. Une édition illustrée du récit fut publiée chez Hetzel en 1842.
115
cette période, afin d’établir une comparaison entre Balzac et les autres écrivains, et de
l’autre le corpus d’ouvrages illustrés publiés entre 1831 et 1838. Le choix de la date de 1838
n’est pas arbitraire : nous l’avons adoptée en raison de la première édition balzacienne
intégralement illustrée, La Peau de chagrin de Delloye et Lecou, à laquelle nous allons
consacrer le chapitre 5 de la thèse. Cette publication, par ailleurs, ne suit que de trois ans le
Gil Blas de l’édition Paulin illustrée par Jean Gigoux, qui marque une étape essentielle dans
l’histoire du livre romantique, et ne précède que d’autant l’époque de la littérature
panoramique, laquelle donnera une forme nouvelle au personnage-type. C’est encore en
1838 que l’éditeur Curmer publie une version illustrée de Paul et Virginie assez significative
dans l’histoire du livre romantique. Ainsi, l’année 1838 peut être considérée comme un
tournant pour l’iconographie balzacienne, qui nous permet de mettre en lumière comment
l’image réagit non seulement devant le texte, mais aussi selon les évolutions propres à l’art
de l’illustration.
4.1. En dehors de l’œuvre littéraire : le frontispice comme façade de la cathédrale en
papier
Le titre que nous avons choisi pour ce sous-chapitre peut sembler, à première vue, la
reprise d’un leitmotiv désormais très connu et exploité chez les amateurs de la littérature
romantique. L’expression « cathédrale de papier »176 renvoie bien évidemment à une
métaphore élaborée par les romanciers romantiques eux-mêmes, qui comparaient leurs
œuvres à une cathédrale, d’après le succès de Notre-Dame de Paris – et Balzac était bien l’un
d’eux177. Comme l’explique Susi Pietri :
En particulier, le rôle de la conception architecturale apparaît décisif dans la
construction de grandes unités textuelles englobant plusieurs œuvres (œuvre-monde,
romans fleuve, cycles, séries), où l’agencement global des textes peut configurer des
paradigmes multiples de liaison et d’organisation, leur visée unificatrice ou leur
176 Pour tout approfondissement de cet argument, nous renvoyons au volume dirigé par P. Oppici et S. Pietri, L’Architecture du texte, l’architecture dans le texte, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2018 ; sur l’évolution de la métaphore du rapport entre la littérature et l’architecture, voir notamment Architecture, littérature et espace, Pierre Hyppolite (dir.), Limoges, PULIM, Collection Espaces Humains, 2006. 177 Même si Roland Chollet a démontré comment la métaphore, dans le cas de Balzac, est très fragile. Voir R. Chollet, « Ci-gît Balzac » dans Balzac, oeuvres complètes : Le moment de « La Comédie humaine », Claude Duchet et Isabelle Tournier (dir.), Vincennes, PU Vincennes, 1995, p. 283 : « Avec cette édification constamment fantasmée, le faux architecte rassure le vrai constructeur, l’escortant de formules tutélaires qui ont en commun de dénoncer, avant le moment de La Comédie humaine, le caractère accidentel, provisoire de tout ce qui dans l’œuvre apparaît à l’auteur ou au lecteur comme hésitation, incohérence, division, dispersion ».
116
déstructuration – tout en reflétant la place qu’occupe le processus d’invention et de
vision dans le « projet » architectural-littéraire.178
Les études de Philippe Hamon et de Ségolène Le Men ont examiné la récurrence de cette
métaphore dans la littérature et dans l’illustration179, et c’est donc grâce à leurs travaux que
nous en avons une vision d’ensemble. Cependant, la métaphore se complique lorsqu’il
s’agit de considérer l’illustration vis-à-vis de cette cathédrale de papier. Nous nous
appuyons sur un paragraphe extrait d’Imageries de Philippe Hamon, qui a fait le bilan sur la
conception qu’on a aujourd’hui de l’illustration romantique, où c’est le frontispice qui
prend le relief :
Parmi les images particulièrement liées au livre et à la littérature, certaines méritent
sans doute, […] un examen particulier. Ces sont les « images « d’exposition » de livres,
celles qui les présentent, les résument, leur servent d’enseignes ou de quasi « génériques »
sur le seuil même du texte, les frontispices. Ces images-enseignes d’appel destinées à
« séduire » le lecteur qui commence sa lecture (ce serait donc une image typiquement
féminine, dans le système de valeurs de Pelletan), qui font en quelque sorte « la fenêtre »
comme des vulgaires prostituées, servent de « réclame » au texte qui va suivre, sont à la
fois des images « autoritaires » (elles présentent souvent le portrait de l’auteur en en
donnant une image flatteuse), et des images symboliques ou syncrétiques qui, comme la carte
ou le dessin d’un plan ouvre le guide pour le touriste, ouvrent pour le lecteur l’horizon
d’attente imaginaire du texte qui va suivre. L’acte de lecture s’inaugure par un acte de
regard qui construit, via le frontispice, une image virtuelle et prospective du texte à
découvrir.180
Le frontispice, en effet, est une image souvent présente dans les volumes de l’époque
romantique, comme l’un des signes indéniables du caractère de plus en plus envahissant de
l’image par rapport au texte littéraire, mais aussi par rapport à l’imaginaire commun. C’est
bien ce type d’image qui domine les textes littéraires entre 1831 et 1838 : nous allons voir
que ce ne sont que les auteurs « classiques », et seulement Victor Hugo parmi les
contemporains, qui profitent d’une série d’éditions illustrées de leurs œuvres dans ces
178 S. Pietri, « Les mots et les pierres. Enjeux d’une rencontre » dans L’Architecture du texte, l’architecture dans le texte, Patrizia Oppici et Susi Pietri dir., Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2018, p. 10. 179 Voir notamment P. Hamon, Exposition : littérature et architecture au XIXᵉ siècle, Paris, José Corti, 1989 ; et S. Le Men, La Cathédrale illustrée. De Hugo à Monet, op. cit. 180 P. Hamon, Imageries. Littérature et image au XIXᵉ siècle, Paris, José Corti, 2001, p. 247 ; c’est nous qui soulignons.
117
années-là, pendant que les autres doivent se contenter du frontispice ou d’une vignette de
titre.
Nous y reviendrons plus loin. Maintenant, concentrons-nous sur les définitions que
Philippe Hamon donne du frontispice, image « d’exposition » qui est associée à quatre
objets spécifiques : l’enseigne, le générique, la fenêtre et la réclame. Le générique appartient
au vocabulaire moderne. Même si Philippe Hamon s’en sert pour évoquer la dimension
industrielle que ces images vont acquérir, nous ne sommes pas convaincue de l’efficacité de
ce mot, fondé d’ailleurs sur une sorte de circularité : le générique, qui devrait résumer les
noms des acteurs qui ont joué dans le film, suppose un caractère de totalité que le
frontispice ne possède pas – c’est-à-dire, il ne présente pas tous les personnages que le
lecteur rencontre dans le texte. La valeur syncrétique de l’image en frontispice n’est pas du
tout assurée, tandis qu’elle devient effectivement une sorte d’affiche, de réclame, de symbole
du texte : la fonction du frontispice n’est pas de résumer, mais de trouver une scène-clé qui
peut être l’enseigne, le drapeau de la narration, en mettant l’accent sur un thème ou bien sur
un groupe de personnages. Il pourrait être donc comparé plutôt à la bande-annonce.
La métaphore de la fenêtre est fascinante, mais elle seule ne suffit pas à décrire
l’impression que cette image au seuil du texte évoque chez le lecteur ; il veut mieux utiliser
celle du « tableau-fenêtre ». Parmi les quatre fonctions de la fenêtre dans la représentation
littéraire identifiées par Andrea del Lungo, la troisième nous semble la plus prégnante par
rapport à notre argument. Non seulement la fenêtre comme « dispositif de cadrage et de
délimitation de l’espace » peut devenir le symbole d’un obstacle impossible à franchir,
séparation qui délimite « la mise en scène de la condition humaine », mais elle est pourvue
aussi d’une fonction « de connaissance indiciaire »181 :
La fenêtre définit un espace de vision et de perception permettant la mise en place
d’un paradigme de connaissance : qu’elle soit vue de l’extérieur, par une pénétration du
regard dans l’espace intime, ou qu’elle soit ouverte sur le monde, la fenêtre encadre un
espace visuel qu’il est possible de concevoir en termes de représentation. Elle donne à
voir un « morceau » de réel à partir duquel l’observateur essaie de reconstruire une
totalité – selon un paradigme analogique qui fonde la littérature panoramique du début
du XIXᵉ siècle, ainsi que le roman balzacien – qui montre le plus souvent, précisément
par l’image centrale de la fenêtre, le caractère illusoire, voire trompeur, d’une telle
181 A. Del Lungo, La fenêtre. Sémiologie et histoire de la représentation littéraire, Paris, Seuil, 2014, pp. 25 et 28.
118
démarche herméneutique. Cependant, la fenêtre figure aussi un signe de la
représentation du réel susceptible de fonctionner comme indice […].182
La fenêtre encadre : elle sépare un intérieur d’un extérieur, ou vice versa ; encore, la fenêtre
restitue un morceau du réel qui peut devenir un indice.
Le frontispice romantique n’a pas ces fonctions. Premièrement, il lui manque cette
ligne physique de démarcation de l’espace réservé à l’image : les lithographies encadrées des
deux romans de jeunesse balzaciens que nous avons étudiées dans le chapitre 2 font partie
de ce groupe d’ouvrages avec un frontispice encadré propre aux années 1820, auquel nous
pouvons ajouter, à titre d’exemple, le frontispice des Méditations de Lamartine de l’édition
Gosselin, 1828, ou ceux des deux volumes publiés par Delaunay en 1829 des Promenades
dans Rome de Stendhal, où de toute façon l’encadrement de l’image rend l’idée d’un tableau
plutôt que de la fenêtre.
182 Ibid., p. 27.
119
Figure 34 : Frontispice des Méditations de Lamartine, Gosselin éd., 1828
Figure 35 : Frontispice pour le tome I des Promenades dans Rome de Stendhal, Delaunay libraire, 1829
120
Rarement la fenêtre est représentée dans le frontispice, et dans les rares cas où elle
figure dans l’image elle ne se présente pas comme la métaphore de l’acte de la lecture. Par
exemple, dans le frontispice du deuxième volume de la troisième édition des Odes de Victor
Hugo, publiée chez Ladvocat en 1827, Devéria représente « Le Sylphe », le génie de l’air
chargé de protéger les jeunes filles ; en ce cas-là, la fenêtre devient le symbole du seuil entre
le monde terrestre de la jeune fille, représentée derrière les vitres, et le sylphe, qui la regarde
en dehors de la maison. Encore, dans l’édition de 1829 des Œuvres de Hugo, Charles
Cousin dessine au frontispice du troisième tome une fille arabe, assise à la fenêtre d’une
maison, qui regarde la lune ; cette scène pourrait être l’allégorie de l’inspiration poétique,
qui touche avec sa lumière l’âme du poète. La fonction de tableau du frontispice encadré
est d’autant plus évidente dans les Odes et Ballades de Victor Hugo, dont la troisième édition
fut publiée par Ladvocat en 1826.
Figure 36 : Frontispice du vol. II des Odes de Hugo, Ladvocat éd., 1827
121
Figure 37 : Frontispice au tome III des Œuvres de Hugo, Gosselin et Bossange éds., 1829
Figure 38 : Frontispice pour les Odes et Ballades de Hugo, Ladvocat éd., 1826
122
À partir des années 1830, le frontispice encadré n’est plus à la mode, la gravure en
bois de bout ayant marqué le pas en ce sens : l’image n’a pas de limites bien définies, et elle
sort de la page comme une nuage, un songe. Pourtant, même sans encadrement l’image en
frontispice paraît un tableau, un scénario théâtral. Le frontispice des Rhapsodies de Petrus
Borel, par exemple, représente un homme assis à une table, un poignard à la main, le visage
résigné ; le rideau qui couvre le côté gauche de l’image renforce l’impression d’être devant
une scène de théâtre.
Figure 39 : Frontispice des Rhapsodies de Borel, Levavasseur éd., 1832
Enfin, nous rappelons le cas de Célestin Nanteuil, qui, avec ses frontispices « à la
cathédrale », a inauguré un type nouveau de cadre pour le tableau-frontispice ; un cadre qui
ressemble effectivement à la façade d’une cathédrale, où la scène choisie comme image
principale est entourée par une série d’autres images, généralement plus petites, lesquelles
composent une sorte de montage narratif iconique des moments saisissants de l’œuvre.
Nous proposons le cas du frontispice dessiné par Nanteuil pour le tome VI des Œuvres
complètes : drames de Hugo, parues chez Renduel en 1833, et celui gravé pour Les Jeunes France
de Théophile Gautier, publiés chez le même éditeur la même année.
123
Figure 40 : Frontispice au t.VI des Œuvres complètes de Hugo, Renduel éd., 1833
Figure 41 : Frontispice pour Les Jeunes Frances de Gautier, Renduel éd., 1833
124
Le frontispice n’est donc pas une image transparente, comme la vitre d’une fenêtre :
il ne montre pas de manière claire l’essence du texte qu’il ouvre. Il se présente plutôt
comme un tableau, comme une scène de théâtre, où il reste à identifier qui est l’auteur du
choix du morceau du texte à illustrer. Le frontispice se fonde sur un élément foncé,
opaque : l’image n’est qu’une première, petite trace qui émerge par le blanc de la page,
comme le seuil d’une cathédrale, dont on ne voit que la façade.
4.2. Le livre romantique à vol d’oiseau : petit panorama en guise de contexte
Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 1, l’année 1830 est considérée comme une
date significative dans l’évolution du livre illustré par la publication de l’Histoire du Roi de
Bohème et de sept châteaux de Nodier : le volume représente l’un des premiers exemples
d’exploitation du procédé du bois de bout, qui permet à l’image de circuler librement dans
la page, en l’envahissant. Même si l’œuvre de Nodier ne fut appréciée que par Balzac et
quelques autres amis, la nouvelle forme du livre illustré est lancée ; mais les premiers
ouvrages qui bénéficieront de la présence d’images dans le texte n’appartiennent pas aux
auteurs français de l’époque. Ce sont surtout les classiques français et les auteurs étrangers
tels que La Fontaine, Molière, Cervantes, Byron et Walter Scott, auxquels les éditeurs
réservent une édition luxueusement illustrée, alors que les écrivains français en herbe se
contentent d’une vignette de titre :
Cette première étape du livre illustré romantique, entre 1830 et 1835, est celle de la
vignette de titre, gravée sur bois de bout qui utilise une technique mise au point par le
graveur Bewick, importée en France de l’Angleterre, grâce à Didot, par le graveur
Thompson à l’issue du blocus continental ; la technique est désormais totalement
maîtrisée par le couple formé par Johannot, dessinateur, et Porret, graveur. Le dessin
ressemble à un croquis, finement gravé en fac-similé, qui s’intègre à la typographie et
flotte sur la page. La vignette, ici gravée sur bois (mais ailleurs lithographiée ou gravée
sur acier) est circulaire et non délimitée sur ses contours […].183
Parmi les études consacrées à l’illustration romantique, le frontispice et la vignette de
titre sont des arguments traités selon les procédés de gravure : on distingue entre les
vignettes en bois et les vignettes lithographiées, qui font le sujet d’essai conçu sur l’un
d’eux, et sur les artistes qui ont exploité la technique prise en considération. Une telle
organisation de la matière rend difficile la construction d’un panorama sur les illustrations
183 S. le Men, La Cathédrale illustrée, op. cit., p. 102.
125
par auteur : on n’arrive pas vraiment à extraire le contexte des écrivains les plus célèbres du
Romantisme. Un panorama qui, pourtant, serait bien utile à examiner en vue d’une
comparaison avec le cas de Balzac, mais aussi pour démontrer ce que nous venons
d’affirmer dans le sous-chapitre précédent : l’illustration est, à ce moment-là, le seuil de
l’œuvre littéraire ; elle a le devoir de susciter la curiosité du lecteur, et pour l’obtenir elle se
fonde sur la théâtralisation de l’image, c’est-à-dire sur l’effet dramatique qu’elle peut
engendrer. Sans aucune prétention d’être exhaustive, nous avons alors interrogé les archives
de la Bibliothèque Nationale, en établissant un petit répertoire sur les illustrations qui
furent dédiées, entre 1830 et 1840, à Petrus Borel, Théophile Gautier, Victor Hugo, Jules
Janin, Alphonse de Lamartine, George Sand, Stendhal, Eugène Sue et Alfred de Vigny.
Nous avons déjà montré quelques frontispices, notamment ceux de Nanteuil, qui
inaugurent le frontispice « à la cathédrale », construit comme un tableau encadré par une
série de scènes, entourées par des décorations de style gothique, comme celles d’une
cathédrale. Le style de Nanteuil est imité par d’autres illustrateurs tel qu’Edouard May, qui
fournit une lithographie pour le frontispice du Chatterton d’Alfred de Vigny en 1835 : un
cadre en style gothique entoure une scène du récit, surmontée par le portrait de l’auteur.
Cependant, le frontispice « à la cathédrale » est seulement l’un des types de
frontispice de la période romantique. On trouve aussi des scènes sans aucun encadrement,
comme celui du recueil de poèmes La Comédie de la mort du jeune Théophile Gautier, publié
chez Desessart en 1838 : le frontispice s’inspire du poème Le Sphynx, et représente un
homme vêtu de noir, derrière lequel on entrevoit une femme nue, devant un sphynx assis
sur un rocher. De même, on trouve parfois des frontispices représentant le seul portrait de
l’auteur : c’est le cas du frontispice de l’édition Bonnaire de Mauprat en 1837 ; paraît en
frontispice un portrait de George Sand gravé par son ami italien Luigi Calamatta.
126
Dans les vignettes en page de titre, en revanche, c’est la représentation de la scène qui
prend la relève de ce type d’illustration. Nous en trouvons de nombreux exemples. Par
exemple, Champavert, recueil de « contes immoraux » de Petrus Borel, écrivain moins connu
aujourd’hui mais qui à l’époque était l’un des auteurs romantiques le plus à la mode, est
illustré avec une scène très dramatique : inspirée du récit de Don Andréa Vésalius, l'anatomiste,
l’image représente un vieil homme qui tient par les cheveux une femme, agenouillée à ses
pieds. Tous deux se trouvent dans un laboratoire d’alchimie : il y a des squelettes et des
crânes partout, des pots, des flacons, des livres. En lisant l’histoire, le lecteur s’aperçoit que
la scène dessinée à la page de titre restitue le moment le plus dramatique du conte : Maria,
tombe malade après son mariage avec Don Vésalius, anatomiste vieux et jaloux ; la jeune
femme s’est vue quittée par ses amants, et cet abandon lui est insupportable. Après avoir
avoué à son mari sa maladie et son infidélité, Maria est traînée par ce dernier à son
laboratoire, où il lui montre les corps disséqués de ses amants. Maria, à cette vue, tombe
morte, et le vieillard utilise son cadavre pour ses expériences.
Deux des œuvres citées dans la Lettre XI sur Paris de Balzac contiennent une vignette
dans la page de titre. Les vignettes de titre des deux tomes du Rouge et le Noir de Stendhal,
dessinées par Henri Monnier et gravée par Porret, sont la représentation de deux scènes
très fortes du roman : dans la vignette du premier volume, Julien Sorel, caché derrière une
la colonne d’une église, est prêt à tuer Madame de Rênal, alors que, dans la page de titre du
deuxième, Mathilde de la Mole pleure devant la tête décapitée de son amant, posée sur la
Figure 42 : Frontispice pour Chatterton de Vigny, Souverain éd., 1838
Figure 43 : Frontispice pour La Comédie de la mort de Gautier, Desessart éd., 1838
127
table de sa chambre, scène qui dans le roman de Stendhal est jouée dans une grotte. Une
incongruité similaire se retrouve dans le frontispice du deuxième tome de Sous les tilleuls
d’Alphonse Karr ; Alex Lascar souligne justement que :
Celui qui lit le texte du roman est amené à se représenter un lieu assez vaste et, « sauf
quelques sentiers étroits » (p. 487), envahit par de hautes herbes. Les seuls arbres
mentionnés sont les peupliers (ils paraissent des « fantômes noirs – ibid.). Certes on ne
saurait les situer (mais ils paraissent cerner le lieu). Ici en tout cas, des arbres ronds et
trapus, en file, dans le lointain, au-delà d’un petit muret. Le lecteur n’a pas l’impression
que la tombe de Magdeleine est isolée. Ici, l’espace autour des amants est dégagé ;
partout on voit le sol à nu. La solitude, radicale, de Stephen est comme spatialisée (et
l’impression de vide accrue peut-être encore par la mis en page, tout ce blanc autour
de l’image). L’angle choisi nous fait à peine voir le corps de Magdeleine. Sa
dégradation, sa nudité mêmes sont occultées.184
L’âne mort et la Femme guillotinée de Jules Janin, livre qui a connu un bon succès, donne
lieu à plusieurs interprétations graphiques ; par exemple il est publié chez Baudouin en
1829 avec une figure gravée au titre, et l’année d’après, Delangle dote son édition d’un
frontispice.
184 A. Lascar, « Annexe I. Les vignettes de 1832 » dans A. Karr, Sous le tilleul (1832), Paris, Société des textes français modernes, 2018, pp. 523-524.
128
Figure 44 et 45 : Pages de titre pour Le Rouge et le Noir de Stendhal, Levavasseur éd., 1830
Figure 46 : Page de titre pour Champavert de Borel, Renduel éd., 1833
Figure 47 : Page de titre pour L'âne mort de Janin, Badouin éd., 1829
129
Nous avons relevé une tendance complètement différente dans les ouvrages
d’Eugène Sue : bien avant la fortune des Mystères de Paris, qui deviendra l’objet de
nombreuses éditions illustrées à partir des années 1840, les romans à thème maritime ou
exotique qu’il écrit dans les années 1830 paraissent souvent avec une vignette au titre : Atar-
Gull (Vimont, 1831), Plik et Plok (Renduel, 1831), La Salamandre (Renduel, 1832), La Vigie
de Koat-vën, ont tous des vignettes de titre ou des planches en frontispice, et l’Histoire de la
marine française, publiée entre 1835 et 1837 chez Bonnaire, est illustrée par Isabey, Raffet,
Perrot, et T. Johannot. Encore, en 1838 l’édition Gosselin de Lautréamont contient un
frontispice signé Marckl et Porret dans les deux tomes, centré le premier sur un homme et
une femme qui prêtent secours à un jeune dans une forêt, et le deuxième sur la scène d’un
duel.
Figure 48 et 49 : Vignettes de titre pour Plik et Plok, Renduel éd., 1831, et Lautrémont de Sue, Gosselin éd., 1838
Nous remarquons que même dans les vignettes dédiées aux poèmes les illustrateurs
cherchent toujours un effet dramatique dans l’image. Prenons l’exemple d’Alphonse de
Lamartine, de Victor Hugo et d’Alfred Vigny.
Les Méditations poétiques ont été réimprimées – et réillustrées : on compte plusieurs
éditions avec frontispices et vignettes de titres originaux – maintes fois tout au long des
années 1820 ; Lamartine poursuit sa fortune en publiant les Harmonies poétiques et religieuses
chez Gosselin en 1830. Les deux tomes contiennent des frontispices, signés par les frères
Johannot et Porret, où celui du tome II sera repris pour l’édition Furne-Gosselin de Jocelyn
en 1836. Ainsi, dans le frontispice du tome I Alfred Johannot dessine un jeune homme
assis devant un tombeau, le visage couvert par sa main gauche, lorsque le fantôme d’une
fille sort d’un trou noir pour le consoler ; au tome II, un ange blanc, avec les bras levés au
ciel, survole une planète noire. Entre 1836 et 1840, treize volumes d’Œuvres complètes de
130
Lamartine sont publiés par Gosselin et Furne, lesquels placent en tête de chaque tome un
frontispice qui représente toujours une scène.
Figure 50 et 51 : Frontispice pour les Harmonies poétiques et religieuses de Lamartine, Gosselin éd., 1830
Également, la deuxième et troisième éditions des Poèmes d’Alfred de Vigny sont
publiées chez Gosselin en 1829 avec une vignette de titre par Tony Johannot et Charles
Cousin représentant un homme sur un radeau à la merci de la mer déchaîné.
Figure 52 : Vignette de titre pour les Poèmes de Vigny, Gosselin éd., 1829
Les œuvres illustrées de Victor Hugo sont en revanche un cas particulier, comme
nous l’avons déjà annoncé. Aucun des autres contemporains ne soutient et ne contribue à
131
l’évolution du livre romantique plus que lui. Et c’est peut-être en son hommage que les
illustrations de cette période sont inspirées des événements les plus fulgurants des textes,
alors que Hugo sera reconnu comme le fondateur du drame romantique. Poète dans les
années 1820, les nombreuses réimpressions de ses Odes qui se succèdent dans cette
décennie sont souvent ornées par des vignettes de titre et des frontispices, comme par
exemple dans l’édition Bossange de 1828 des Odes et Ballades. Même son premier roman,
Bug-Jargal, a un frontispice par Adam dans l’édition Urbain Canel de 1826. De même, nous
avons relevé des frontispice dans l’édition de 1829 des Orientales, par Louis Boulanger et
Cousin ; dans celle de 1830 d’Hernani ; dans celle de 1832 des Feuilles d’automne ; dans celle
de 1832 du Roi s’amuse ; dans celle de Lucrèce Borgia en 1833, par Célestin Nanteuil ; et dans
celle des Œuvres complètes publiées par Renduel en 1833 et par Gosselin dans la même année.
Hugo est le seul auteur parmi les écrivains romantiques qui compte aussi des œuvres
intégralement illustrées. Notre-Dame de Paris a été illustrée plusieurs fois au cours de la
décennie de 1830 : en 1831 dans l’édition Gosselin et en 1836 dans l’édition Renduel ; mais
aussi Marion de Lorme, édité par Barthélemy en 1832, illustrée par Boulanger ; et Hernani
chez Hetzel en 1836, avec douze dessins de Valentin Foulquier et Édmond Riou.
Dans ce petit panorama sur le livre illustré, nombreuses images partagent un détail :
les vignettes de titre et les frontispices de cette période représentent principalement des
tableaux, des scènes dramatiques. L’illustration semble alors traduire ce goût pour le
théâtre, et notamment pour le mélodrame, que Peter Brooks a expliqué dans son étude The
Melodramatic Imagination :
This [Romantic mode as a Dramatisation] is first of all true in the literal sense that the
Romantics, especially in France but in Germanyand England as well, constantly
sought to realize their vision on the stage, in a theatre reborn. It is even more
pertinent in that, as we have been attempting to illustrate in the domain of melodrama,
a central impulse of the Romantic imagination strives toward making of life the scene
of dramatic conflict and clash, of grandiose struggle represented in hyperbolic
gestures.185
185 P. Brooks, The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess, New Haven and London, Yale university Press, 1976, p.81.
132
Figure 53 et 54 : Vignettes de titre pour Odes et Ballades de Hugo, Bossange éd., 1828
Figure 55 et 56 : Vignettes de titre pour Les Feuilles d'automne et pour Le Roi s'amuse de Hugo, Renduel éd, 1832
Figure 57 et 58 : Vignettes de titre pour Notre Dame de Paris, de Hugo, Gosselin éd., 1831
133
4.3. Les frontispices balzaciens : à la recherche de la scène dramatique
Dans ce contexte, Balzac ne semble pas vraiment participer à la croissance du livre illustré.
De fait, le répertoire des illustrations balzaciennes de la période 1830-1838 se compose
principalement de frontispices, datant entre 1831 et 1833, qui restent d’ailleurs en nombre
assez restreint par rapport à la production balzacienne de ce moment-là : quatre seulement
sont introduits par un frontispice, et une seule œuvre a été complètement illustrée. Ce n’est
qu’à partir de l’édition Delloye et Lecou de La Peau de chagrin (1838) que Balzac montrera
un intérêt majeur vers l’illustration de ses œuvres. Et c’est toujours La Peau de chagrin qui
marque le premier pas dans le monde de l’illustration en attestant le premier frontispice des
œuvres signées H. de Balzac.
Figure 59 : Frontispice et vignette de titre pour le t.II de La Peau de chagrin de Balzac, Gosselin éd., 1831
Le volume présente un frontispice différent dans chacun de ses deux tomes : au tome I,
c’est la scène où l’antiquaire montre à Raphaël la peau magique qui est dessinée par
Johannot et Porret, pendant qu’au tome II il représente le moment final du roman, quand
le protagoniste s’attache à Pauline avant de mourir. La ligne serpentine, symbole du
parcours de la vie humaine, inspiré du chapitre CCCXXII du Tristram Shandy par Sterne,
figure comme vignette de titre dans les deux tomes.
134
Figure 60 et 61 : Frontispices de La Peau de chagrin de Balzac, Gosselin éd. 1831
Examinons le premier frontispice du point de vue d’un lecteur qui s’apprête à lire le roman.
Deux personnages, un vieux vêtu de noir et un jeune homme, fixent le regard à leur
gauche ; le vieillard indique un objet accroché sur le mur. C’est bien la peau d’un animal qui
l’intéresse : de dimension contenue, la peau est entourée par la lumière, qui l’encadre
comme un tableau. Tout autour des deux hommes, d’autres objets sont éparpillés dans la
salle : aux pieds d’une petite table couverte par une nappe, sur laquelle sont posés des
coffrets, figurent des pièces d’une armure ; à côté du jeune, un tableau dont le sujet n’est
pas dessiné. Derrière les personnages, une autre série d’objets est esquissée : on distingue
des coffrets placés sur une étagère et, au-dessous, un autre tableau ; à l’angle haut du côté
droit de l’image, une lampe brûle, en éclairant la scène, et en dessous de celle-ci un
squelette adossé à un sarcophage. Les signatures de Tony Johannot et de Porret sont bien
visibles au bas de l’image. Si le petit vieillard a effectivement l’apparence d’une « tête
judaïque », l’excessive maigreur de son physique, la tunique noire, la barbe et les cheveux
longs et négligés lui accordent un air mystérieux, énigmatique, féerique. Le jeune homme
par contre est beaucoup plus difficile à lire : son habillement n’a rien de particulier, il
ressemble à un dandy quelconque. Il est véritablement un inconnu.
Le frontispice du tome I de La Peau de chagrin se pose donc comme une énigme à
l’enseigne du fantastique, qui correspond parfaitement au style des premières pages du
roman : le lecteur ne découvrira qu’à la sortie du bazar de l’antiquaire le nom du jeune
homme qu’il a suivi de la maison de jeu à la boutique du quai Voltaire ; le petit vieillard
135
reste une figure ambiguë, image du « Père Éternel » et de « Méphistophélès » en même
temps ; et la peau de chagrin, cet objet mystérieux qui « projetait dans le magasin au sein de
la profonde obscurité qui régnait dans le magasin des rayons si lumineux que vous eussiez
dit d’une petite comète »186, garde son pouvoir de talisman jusqu’à la fin du récit.
Au seuil du tome II, le dessin qui se présente devant le lecteur change du style
féerique de la première image, en adoptant en revanche un langage dramatique : un
homme, dont le visage ressemble un peu à celui du jeune du premier frontispice, est
agenouillé aux pieds d’une femme assise sur un fauteuil, les épaules dénudées et les cheveux
décoiffés. L’homme, que le lecteur peut désormais deviner être Raphaël de Valentin,
semble implorer la jeune femme, qui regarde ailleurs, impuissante et désespérée. Comme
dans le frontispice du tome I, dans cette image le scénario derrière les personnages est aussi
seulement esquissé : on y reconnaît l’intérieur d’un appartement, où se trouvent une toile
encadrée, accrochée sur le mur, et un bouquet de fleurs posé sur une petite commode. Le
contraste entre les couleurs des vêtements est frappant : le personnage féminin porte une
robe sombre, à demi-manches blanches, alors que Raphaël est complètement en blanc, et la
couleur très claire de sa peau se confond avec celle de ses vêtements. Il paraît un fantôme.
De plus, le jeune semble vraiment maigre : il est devenu lui-même le squelette du
frontispice du tome I qui, dans la boutique de l’antiquaire, avait penché « dubitativement
son crâne de droit à gauche, comme pour lui dire : ʺLes morts ne veulent pas encore de
toi !ʺ »187. Si le thème de la devise latine memento mori est très remarquée dans les deux
frontispices, grâce à la présence du squelette dans le premier et à l’aspect squelettique de
Raphaël dans le deuxième, les personnages semblent passer à l’arrière-plan : ils ne sont que
les acteurs de l’histoire, la personnification du drame.
On reçoit la même impression de la planche lithographiée par Frey publiée dans la
revue L’Artiste, à l’intérieur d’un compte-rendu sur La Peau de chagrin. Dans cette
lithographie, titrée Le Docteur Planchette explique à Raphaël la théorie de la Presse hydraulique,
dessinée par Gavarni188, deux hommes, représentés au centre de l’image, se trouvent dans le
186 H. de Balzac, La Peau de chagrin, Pl, t.X, p. 82. 187 Ibid., p. 76. 188 Même si la signature au bas de la lithographie n’est pas lisible, nous pouvons attribuer ce dessin à Gavarni en raison des lettres de Balzac a échangées avec l’illustrateur en septembre 1831, où il est question de cette lithographie à faire pour le compte-rendu de L’Artiste ; Balzac demande aussi à Gosselin d’envoyer une copie de La Peau de chagrin à Gavarni, pour qu’il puisse lire l’épisode à dessiner. Nous soulignons que, dans une deuxième lettre à l’artiste, Balzac suggère d’illustrer la scène des « canards », c’est-à-dire la visite du naturaliste
136
jardin d’une maison ; le docteur Planchette, debout devant une table encombrée d’un vase,
sollicite Raphaël, tenant la peau dans la main gauche, assis en face à lui, le décor urbain bien
dessiné autour d’eux. Là, encore, c’est la scène, plutôt que les personnages, qui prend le
relief de la planche.
Figure 62 : Lithographie parue dans L'artiste sur La Peau de chagrin de Balzac
Dans cette perspective, les deux planches parues dans L’Artiste sur La Transaction,
titre primitif du Colonel Chabert, sont encore plus significatives. Dans la première
lithographie, dessinée par Alophe Menut et gravée par Bichebois aîné, publiée dans la
quatrième livraison du tome III, le 26 février 1832, la scène choisie pour l’image
correspond au moment le plus dramatique du texte de Balzac : l’avocat Derville reçoit la
visite d’un inconnu, qui déclare être le Colonel Chabert, soldat de Napoléon réputé mort
dans la bataille d’Eylau. C’est donc sur ce coup de théâtre que l’illustration est créée :
l’inconnu soulève le chapeau, à la lumière d’une chandelle, et le jeu de blanc et noir donne
du volume au prétendu fantôme, lequel occupe le centre de la scène.
Lavrille, mais il lui laisse le choix – qui évidemment n’est pas tombé sur la scène indiquée par l’écrivain. Voir H. de Balzac, Corr., t.I, pp. 580-581.
137
Figure 63 : Lithographie pour La Transaction, dans la revue L'artiste, 1832.
La deuxième lithographie, parue dans la sixième livraison du tome III, le 11 mars
1832, représente un autre instant fortement dramatique : le colonel Chabert s’est rendu
chez sa femme, la comtesse Ferraud, en vue d’une transaction qui puisse restituer l’identité
à l’ex-soldat. Toutefois, le colonel Chabert hésite lorsque les enfants de la comtesse
interrompent leur dialogue ; devant sa femme en larmes, entourée par les deux petits, le
colonel décide de renoncer à sa transaction, en ne demandant que d’être accueilli dans la
nouvelle famille de Mme Ferraud.
138
Figure 64 : Lithographie pour La Transaction, dans la revue L'Artiste, 1832
Les deux mêmes frontispices trouvés par le lecteur en tête de La Peau de chagrin de
l’édition Gosselin paraissent aussi dans la deuxième et troisième éditions en trois tomes des
Romans et contes philosophiques, qui recueillent La Peau de chagrin, Sarrasine, La Comédie du diable,
El Verdugo, L’Enfant maudit, L’Elixir de longue vie, Les Proscrits, Le chef-d’œuvre inconnu, Le
Réquisitionnaire, Étude de femme, Les Deux rêves, Jésus-Christ en Flandre, L’église. Les frontispices
des deux premiers tomes sont ceux de l’édition de La Peau de chagrin, comme le tome I est
entièrement dédié à la première partie du roman, et le tome II débute avec la fin du même
texte. Le troisième tome commence avec L’Enfant maudit, qui fait le sujet du troisième
frontispice. Le lecteur reconnaît le style de Tony Johannot, qui poursuit le style à l’enseigne
de la scène théâtrale inauguré dans La Peau de chagrin. Encore, outre le scénario esquissé
derrière les personnages – de grandes vitres d’un manoir –, c’est la couleur qui véhicule le
message de l’image.
139
Figure 65 : Frontispice du tome III des Romans et contes philosophiques, Gosselin éd., 1831
Sur le côté gauche de la gravure, un homme portant une armure, l’épée au flanc droit, la
canne pointée au sol, regarde avec un air menaçant une femme, assise sur un siège, qui
prend dans ses bras un enfant, pour le protéger. L’armure et la fraise donnent un indice sur
l’époque du récit, étant donné que la fraise était portée en France pendant les guerres de
religion. Le thème de la violence, paternelle évidemment, transparaît clairement de l’image,
où les personnages jouent des rôles assez stéréotypés par le théâtre.
Du coup, le thème du frontispice des Nouveau contes philosophiques est moins manifeste.
Ce recueil, publié par Gosselin en 1833, est formé par quatre récits brefs : Maître Cornelius,
Madame Firmiani, L’Auberge rouge, Louis Lambert. Le frontispice, nouveau fruit de la
collaboration entre Tony Johannot et Porret, représente trois personnages, assis autour
d’une table carrée ; deux vieux sont en train de manger un œuf avec du pain, pendant que le
jeune à gauche les regarde. Cette scène conviviale se situe à la moitié du récit : c’est la
rencontre entre le noble Philippe, qui se prétend un apprenti, et son nouveau maître,
Cornelius, argentier du roi Louis XI. Le souper de maître Cornelius et de sa sœur dénote
140
l’avarice des deux flamands ; cependant, la scène n’est pas l’un des instants les plus
saisissants du conte, qui est d’ailleurs plein de péripéties.
Figure 66 : Frontispice pour Nouveaux contes philosophiques de Balzac, Gosselin éd., 1833
Les exemples de frontispices balzaciens s’arrêtent là. À partir de 1832, jusqu’à 1838,
les seules images créées pour les œuvres de l’écrivain sont deux vignettes de titre : une pour
Le Médecin de campagne, édition Mame-Delaunay, en 1833 ; la deuxième pour le recueil de La
Femme supérieure, La Maison Nucingen, La Torpille, publié chez Werdet en 1838.
La vignette de titre du Médecin de campagne, laquelle sera conservée dans la deuxième et
troisième éditions parues chez Werdet en 1834 et n 1836, n’a pas été faite exprès pour cette
édition : comme l’ont remarqué les éditeurs de l’édition Pléiade de La Comédie humaine189, la
gravure d’Henry Monnier, représentant le Christ ployé sous le poids de la croix, figurait
189 « Le Médecin de campagne. Histoire du texte » dans H. de Balzac, Le Médecin de campagne, Pl, t.IX, pp. 1414-1415.
141
déjà à l’intérieur du Spécimen de la fonderie Balzac, vignette n°1486. C’est un détail très
intéressant : le fait que Balzac a réutilisé l’une des vignettes du Spécimen nous donne deux
informations précieuses. D’abord, il faut s’interroger sur le droit que Balzac avait d’utiliser
une vignette qui, formellement, ne lui appartenait plus. Toutefois, à ce moment-là le droit
d’auteur des illustrateurs n’existait pas ; la gravure était généralement considérée comme la
propriété de l’éditeur qui l’avait commandée, donc elle pouvait être employée pour
plusieurs textes différents. Nous citons, à titre d’exemple, la vignette de la jument Patricia
montée par les fous, que nous avons analysée dans le chapitre 1 : elle parait aussi à la fin
d’un compte rendu d’un ouvrage qui n’est pas celui de Nodier, dans la revue L’Artiste190.
Dans le cas de la vignette du Christ par Monnier, le fait que la fonderie était maintenant
dans les mains du fils de Mme de Berny permettait peut-être à Balzac d’avoir encore accès
aux clichés du Spécimen. En tout cas, cela est la preuve que Balzac lui-même avait choisi la
gravure à mettre dans la page de titre du roman. L’image, qui suit l’épigraphe « Aux cœurs
blessés, l’ombre et le silence », acquiert alors un sens particulier : le Christ ployé sous le
poids de la croix représente l’allégorie de la souffrance humaine, qui est le véritable thème
du Médecin de campagne. Dans ce cas-là donc, ce ne sont pas les personnages du récit qui
annoncent le sujet de la narration, mais la représentation du thème à travers une figure
allégorique.
190 Nous nous sommes aperçues de cette récurrence en feuilletant la revue via le site de Gallica, qui met à disposition le fac-similé de l’édition Droz, 1972, 1ère série, t.II, p. 168 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k19956f/f232.image
142
Figure 67 : Page de titre du Médecin de campagne, Mame-Delaunay éds., 1833
Dans la page de titre de La Femme supérieure, La Maison Nucingen, La Torpille de
l’édition Werdet, la vignette qui y figure semble avoir une fonction purement ornementale :
elle représente un phare au milieu de la mer en tempête.
Figure 68 : Page de titre de La Femme supérieure, la Maison Nucingen, La Torpille, Werdet éd., 1838
143
Plus intéressante est la présence de la vignette « Exécution administrative », dessinée par
Honoré Daumier et généralement attribuée à l’édition Furne, pour La Femme supérieure. Ce
texte, dont le titre définitif sera Les Employés ou La Femme supérieure, est une scène de la vie
bureaucratique : Rabourdin et Baudoyer, employés au Ministère, vont lutter pour prendre la
place de Chef du bureau. Dutocq, un troisième employé, conspire à son tour contre les
deux, et il promet à Bixiou la place de Sous-chef s’il l’aidera : il lui demande de dessiner un
croquis mordant qui ridiculise Rabourdin :
Il faudrait représenter Rabourdin habillé en boucher, mais bien ressemblant, chercher
des analogies entre un bureau et une cuisine, lui mettre à la main un tranche-lard,
peindre les principaux employés des ministères en volailles, les encager dans une
immense souricière sur laquelle on écrirait : Exécutions administratives, et il serait
censé leur couper le cou un à un. Il y aurait des oies, des canards à têtes conformées
comme les nôtres, des portraits vagues, vous comprenez ! il tiendrait un volatile à la
main, Baudoyer, par exemple, fait en dindon.
Bixiou exécute le dessin quand la ruine de Rabourdin est désormais accomplie. L’ex-
employé, qui vient de remettre sa démission, demande à voir la caricature.
La vignette de Daumier illustre à la lettre les mots de Dutocq. Il aurait été intéressant
de savoir comment Balzac s’est assuré la collaboration de Daumier pour ce dessin, mais la
correspondance de l’écrivain est muette à ce sujet, et Edmond Werdet dans son Portrait
intime de Balzac191 ne revient pas sur ce point. De fait, Werdet avait reçu les volumes quand
ils avaient été déjà composés : dans un premier temps, ce sont les éditeurs Delloye et Lecou
qui possédaient le recueil de Balzac, acheté ensuite par Werdet. C’est peut-être l’une des
dernières collaborations entre cet éditeur et Balzac : Werdet, désespéré par les difficultés
économiques que Balzac lui causés avec ses emprunts d’argent et ses projets jamais
achevés, décide de rompre tout rapport avec le romancier.
191 E. Werdet, Portrait intime de Balzac : sa vie, son humeur et son caractère, Paris, A. Silvestre, 1859 ; link : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15135254.image Voir aussi : N. Felkay, Balzac et ses éditeurs, 1822-1837. Essai sur la librairie romantique, Paris, Promodis, 1987.
144
Figure 69 : Vignette de Daumier pour Le Femme supérieure de Balzac, Werdet éd., 1838
Sauf cet exemple particulier de la vignette de Daumier, il est clair donc que les
illustrations des œuvres de Balzac dans les années 1830 s’inscrivent à l’intérieur d’un
contexte commun à tous les écrivains romantiques : les éditeurs préfèrent limiter les images
du texte au frontispice et à la vignette de titre, comme le succès de ces auteurs n’est pas
toujours garanti ; l’illustration s’inspire du langage dramatique du théâtre pour représenter
les moments saisissants des ouvrages, sort de la façade de la cathédrale en papier qui fait un
clin d’œil au lecteur pour susciter sa curiosité. Balzac, dans le peu d’exemplaires que nous
pouvons consulter, n’échappe pas à cette règle. La question que nous nous allons poser
dans les deux prochains chapitres concernera alors le traitement réservé à l’image
lorsqu’elle commence à envahir le texte : le style du tableau de scène sera-t-il encore
exploitable par le livre illustré ? Le personnage garde-t-il le masque théâtral que l’image lui a
accordé dans cette période ? C’est ce que nous allons voir à partir de l’édition illustrée
Delloye et Lecou de La Peau de chagrin de 1838.
145
CHAPITRE 5
FIGUREZ-VOUS UN LIVRE DE BALZAC ILLUSTRÉ : LA PEAU DE
CHAGRIN DELLOYE ET LECOU DE 1838
Rien de bien nouveau à Paris ; il y a un roman de Balzac, La
Peau de chagrin, fétide et putride, spirituel, pourri, enluminé,
papilloté et merveilleux par la manière de saisir et de faire briller
les moindres petites choses, d’enfiler des perles imperceptibles et de
les faire sonner d’un cliquetis d’atomes.
Sainte-Beuve, Correspondance générale, t.I, Stock éd., 1935.
Après la dizaine d’années que nous venons d’analyser, où les rapports entre Balzac et
l’illustration ne présentent pas encore beaucoup d’exemples, nous sommes arrivée
finalement à la date du tournant de cette relation : 1838. C’est à ce moment-là que les
éditeurs Delloye et Lecou publient une édition illustrée de La Peau de chagrin. Toutefois, cet
ouvrage était censé s’inscrire dans un projet plus vaste ; le 8 juillet 1837, Balzac écrit à Mme
Hanska que :
Il se prépare une grande affaire pour moi dans une impression complète de mon
œuvre, avec vignettes, etc., et appuyée sur une combinaison piquante et attrayante
pour le public, c’est de donner un intérêt dans une tontine créée avec une portion des
bénéfices au profit des souscripteurs, divisés en classes par âges : 1-10 (10-20) – (20-
30) – (30-40) (40-50) (50-60) (60-70) (70-80). Ainsi l’on aurait un magnifique ouvrage
comme exécution typographique et la chance de 30 000 fr. de rentes pour avoir
souscrit. Encore le capital de la rente restera-t-il acquis aux familles. Cela est bien
beau, mais il faut 5 000 souscripteurs pour que cela se fasse. Figurez-vous que, malgré
l’ardeur de mon imagination j’ai reçu tant de coups que je vais voir jouer cette partie
d’un œil indifférent. Il faut une somme énorme rien que pour les annonces, et 400 000
fr. pour les vignettes seulement. L’œuvre aura 50 volumes publiés par 1/2 volumes.
Elle comprendra les Études de mœurs complètes, les Études philosophiques complètes, et
les Études analytiques complètes, sous le titre général des Études sociales. En 4 ans tout
sera publié ; la vignette sera dans le texte même, et il y en aura 75 par volume, ce qui
empêche toute contrefaçon à l’étranger.192
192 H. de Balzac, LH, t.I, p. 391.
146
Le projet des œuvres complètes recueillies dans un seul ouvrage, auquel Balzac songeait
depuis quelque temps, semble finalement aboutir. Les Études sociales, composées par 50
volumes, seront publiées, même si Balzac ne donne aucun indice sur l’éditeur qui a pris en
charge cette composition colossale.
Les difficultés économiques sont évidentes : une publication d’une telle importance
demande des financements consistants, auxquels on espère parvenir à travers une tontine.
Mais l’écrivain doute de la réussite de l’édition, et les critiques qu’il reçoit des journaux,
ainsi que la rupture avec l’éditeur Werdet, le laissent dans un état de prostration bien
ressenti dans la lettre qu’il envoie à Mme Hanska le 25 août : « La grande affaire marche, on
grave, on dessine et on imprime à force, mais s’il y a succès, le succès arrivera trop tard, je
me sens décidément mal à mon aise. J’aurais mieux fait d’aller passer six mois à
Wierzchownia que de rester au milieu de ce champ de bataille où je finirai par être
renversé »193.
De même, les 75 vignettes prévues pour chaque volume des Études sociales sont
regardées par l’écrivain de manière ambiguë : elles représentent à la fois un enrichissement
pour « l’exécution typographique » du texte, une dépense considérable, dont Balzac ne
semble point content, et une stratégie pour combattre la contrefaçon belge.
Dans la correspondance que le romancier entretient avec l’Étrangère, il n’y a pas une
lettre qui ne contienne de chiffres : Balzac reporte toujours le coût de ses achats, ses
dépenses, les pertes prévues, les entrées espérées ; il n’est pas étrange donc qu’il soit
question du prix des vignettes. Il ne faut qu’aller à la lettre écrite de Frapesle le 10 février
1838 pour lire un Balzac très excité à l’idée, trompeuse, du succès financier de son édition
illustrée : « Je ne sais si l’on m’a dit vrai, ou si l’on a dit vrai à qui me l’a redit, mais mes
éditeurs se vantent de 5 000 fr de vente du Balzac illustré, ce qui ferait croire que, le temps et
les amis aidant, nous aurions bientôt dix mille. Alors toutes mes infortunes financières
cesseraient en 1839 »194.
Or, les autres deux considérations qui apparaissant sont plus intéressantes. Nous
avons déjà parlé dans le chapitre 2 des vignettes en couverture du livre utilisées comme
marques des éditeurs : c’était effectivement une tentative pour combattre la contrefaçon
belge, grande plaie des éditeurs à ce moment-là, dont Balzac lui-même avait été victime à
193 Ibid., p. 400. 194 Ibid, p. 439.
147
plusieurs reprises. Mais limiter une édition illustrée au désir d’éviter la contrefaçon paraît
tout de même une affirmation étrange.
Également, il nous semble que la volonté d’inscrire l’illustration dans la sphère de
l’« exécution typographique » ne soit pas aussi évidente qu’on pourrait le croire. De fait,
qu’est-ce que cela veut dire, exactement, que l’illustration fait partie de l’« exécution
typographique » ?
5.1. L’illustration comme « paratexte » versus l’illustration comme « iconotexte »195
Pour comprendre pleinement le problème que nous venons de poser, nous renvoyons à
deux autres passages extraits des Lettres à Mme Hanska. Le premier est placé dans la lettre
écrite de Paris le 20 janvier 1838 :
Le texte de l’édition illustrée est revu avec tant de soin, qu’il faut regarder comme le seul
existant, tant il diffère des éditions précédentes, cette solennité typographique a réagi
sur la phrase, et j’ai découvert bien des fautes et des sottises, en sorte que je désire
bien vivement que le nombre des souscripteurs permette de continuer cette
publication, qui me donnera l’occasion d’arriver à ce que je puis de mieux pour mon
ouvrage comme pureté de langage.196
C’est un passage très connu de la correspondance balzacienne, qui a été repris plusieurs fois
dans le cadre des études sur Balzac et la typographie, ou Balzac et l’image, la « solennité
typographique » ayant été interprétée comme une référence aux vignettes du texte.
Pourtant, le contexte où ce passage est plongé n’amène pas forcement vers cette lecture : il
n’y a pas une référence explicite aux illustrations, et la « solennité typographique » dont
l’écrivain parle ne trouve pas de spécification. Certes, la parenté qui existe entre les deux
expressions, « exécution typographique » et « solennité typographique », légitime cette
hypothèse ; néanmoins, il pourrait bien être question aussi de la solennité réservée à la
composition de cette édition d’œuvres complètes, ce qui expliquerait le soin que Balzac
consacre à la correction stylistique de son texte. De fait, comme nous allons le voir, le type
de relation qui vient s’instaurer entre le texte balzacien et les illustrations n’explique pas les
mots de la lettre de Balzac à Mme Hanska : par le peu d’informations que nous avons sur la
195 Ce sous-chapitre est, en partie, une version remaniée d’une communication, intitulée « Du paratexte au contre-texte. Les illustrations de La Comédie humaine », que nous avons présentée à l’Université de Bologne (Italie) le 15 et 16 février 2018, en occasion du Colloque « Attention au paratexte ! Seuils 30 anni dopo », organisé par Federico Bertoni, Guido Mattia Gallerani, Maria Chiara Gnocchi, Donata Meneghelli, Paolo Tinti, dont les actes seront publiés en 2019 par la revue Interférences littéraires. 196 H. de Balzac, LH, t.I, p. 434 ; c’est nous qui soulignons.
148
rédaction et publication du Balzac illustré, il paraît que le romancier a commencé la
correction du texte avant, ou en même temps, que les illustrateurs s’occupaient du dessin et
de la gravure des images ; cela veut dire que Balzac n’attendait pas de voir les images pour
procéder à la correction du texte, ni qu’il révisait son texte d’après les illustrations. De plus,
dans la Correspondance générale il n’y a pas de lettres entre Balzac et les dessinateurs qui
puissent témoigner d’une collaboration étroite entre eux pendant l’impression de l’ouvrage.
Il nous semble donc improbable que Balzac voulût se référer aux illustrations dans ce
passage. Certes, il est vrai que nous ne connaissons pas le contenu de la lettre de Mme
Hanska à laquelle l’écrivain répondait, qui aurait pu montrer des allusions plus explicites
aux dessins de l’édition illustrée. Dubium manet.
En tout cas, même si la locution « solennité typographique » se réfère aux
illustrations, il reste à en détecter le signifié spécifique. C’est le deuxième passage que nous
allons analyser, contenu dans une lettre qui date du 1er septembre 1837, qui se révèle très
éclairante à ce propos :
Je viens de voir les dessins pour l’illustration de La Peau de chagrin. C’est merveilleux,
cette entreprise est gigantesque, 4 000 gravures sur acier tirées en taille douce à même
le texte ! Cent par volume. Enfin, si cette affaire réussit, les Études sociales se produiront
dans leur entier, et sous un magnifique costume, avec des atours royaux. Avouez que
si dans quelque mois, la fortune vient visiter mon seuil, je l’aurai bien gagnée, et soyez
sûre que je me cramponnerai à ce qu’elle daignera me jeter.197
C’est la première fois que Balzac s’exprime avec un tel enthousiasme sur les illustrations.
Cependant, il n’est pas vraiment question des images en tant que telles, mais plutôt de la
grandeur de l’entreprise. De fait, les images sont « un magnifique costume », « des atours
royaux » du texte : Balzac ne problématise pas le rapport que l’image devrait instaurer avec
le texte, car ce rapport se configure dans ses mots selon la relation que Gérard Genette a
définie comme « paratextuelle », d’abord dans Palimpsestes :
Le second type [de relation transtextuelle] est constitué par la relation, moins explicite
et plus distante, que, dans l’ensemble formé par une œuvre littéraire, le texte
proprement dit entretient avec ce que l’on ne peut guère nommer que son paratexte :
titre, sous-titre, intertitres ; préfaces, postfaces, avertissements, avant-propos, etc. ;
notes marginales, infrapaginales, terminales ; épigraphes ; illustrations ; prières
197 Ibid., p. 404 ; c’est nous qui soulignons.
149
d’insérer, bande, jaquette, et bien d’autres types de signaux accessoires autographes ou
allographes, qui procurent au texte un entourage (variable) et parfois un commentaire,
officiel ou officieux, dont le lecteur le plus puriste et le moins porté à l’érudition
externe ne peut pas toujours disposer aussi facilement qu’il le voudrait et le prétend.198
Et ensuite en 1987 dans Seuils, où Genette précise que :
Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme
tel à ses lecteurs, et plus généralement au public. Plus que d’une limite ou une
frontière étanche, il s’agit ici d’un seuil, ou – mot de Borges à propos d’une préface –
d’un « vestibule » qui offre à tout un chacun la possibilité d’entrer, ou de rebrousser
chemin.199
En confinant l’illustration dans le champ de « l’exécution » ou de la « solennité »
typographique, Balzac crée une séparation nette entre le domaine du texte et celui de
l’’image, où l’illustration est l’un des éléments qui « procurent au texte un entourage »,
« vestibule » du texte proprement dit. L’illustration alors ne concerne pas vraiment le texte,
plutôt le livre en tant qu’objet, réduit désormais à un objet commercial, à une marchandise :
il est clair que Balzac considère l’illustration comme un ornement qui donne du luxe à ses
livres – et non pas à ses textes –, et qui fait ainsi monter leur prix de vente.
La volonté d’exiler l’illustration dans le champ paratextuel est très répandue chez les
écrivains du XIXᵉ siècle : au fur et à mesure que l’illustration assume un caractère
envahissant vis-à-vis du texte, les auteurs se montrent de plus en plus méfiants envers la
présence d’images dans leurs textes, lesquelles, à leur avis, dispersent l’attention du lecteur.
Les écrivains alors cherchent des moyens pour établir une séparation entre les deux :
Sainte-Beuve et Alfred de Musset, notamment, refusent nettement d’être illustrés ; Victor
Hugo lui-même, celui qui, nous l’avons montré dans le chapitre 4, a été l’un des écrivains le
plus illustré parmi ses contemporains, n’a jamais manifesté trop d’enthousiasme à l’égard
des édition illustrées de ses œuvres, comme si elles n’étaient pas douées d’importance ; et
Balzac, nous venons de le voir, s’exprime à ce propos de manière assez déroutante sur sa
première édition illustrée.
À première vue, cette situation pourrait sembler paradoxale : de fait, les romanciers
refusent la présence d’images proprement dites dans leurs livres lorsqu’ils célèbrent la
198 G. Genette, Palimpsestes, Paris, Seuil, 1984, p. 9 ; c’est nous qui soulignons. 199 G. Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987, pp. 7-8 ; c’est nous qui soulignons.
150
nouvelle « littérature des images », où le poète prétend se faire peintre. L’image écrite entre
en compétition avec l’image dessinée, mais l’envers n’est pas accepté. Cela cause
effectivement une rivalité, pas complètement cachée d’ailleurs, entre les représentants de la
plume, voir les écrivains, et ceux du crayon, les illustrateurs : la personnalité d’un Monnier,
d’un Daumier, d’un Johannot, d’un Gavarni est désormais trop forte pour être soumise à la
volonté de la plume. Selon cette perspective, Alain-Marie Bassy remarque que « chaque
illustrateur livre son propre message : ainsi s’élabore dans l’univers du livre un dialogue
contrasté entre ces génies de la plume. Mise en scène où s’affirme un débat d’individualités
plus qu’un esprit de système »200. Une situation qui sera représenté par Grandville dans les
premières pages d’Un Autre monde :
Nonchalamment étendus dans le double fond d’une vaste écritoire, une Plume, un
Crayon et un Canif, ces trois ennemis qui ne peuvent vivre séparés, se reposaient de
leurs fatigues passées. […] le Crayon s’avança vers sa compagne [la Plume], et lui tint à
peu près ce langage : - Dormez tant qu’il vous plaira, ma chère amie, ce n’est pas moi
qui vous réveillerai. Gardez vos idées, et taillez la besogne pour un autre. Vos
inspirations ne me suffisent plus, votre tyrannie me fatigue ; j’ai été trop modeste
jusqu’ici, il est temps que l’univers apprenne à me connaître. Dès aujourd’hui je prends
la clé des champs ; je veux aller où me conduira ma fantaisie ; je prétends moi-même
me servir de guide : Vive la liberté ! […] – O ciel ! s’écria la plume, les Crayons font du
style et de l’éloquence, dans quels temps vivons-nous ! […] A peine quelques années
te séparent de l’adolescence, et déjà tu renies ta mère. Qui a soutenu tes pas
chancelants dans la carrière ? Qui a écarté les ronces de tes pas ? Qui t’a montré ce
qu’il fallait laisser dans l’ombre et qu’il fallait éclairer ? Qui t’a introduit dans le
monde ? […] Moi ! Toujours moi ! Et c’est ainsi que tu me récompenses ! Pars donc,
jeune ingrat, et que la gomme élastique te soit légère !201
Mais le débat qui se développe sur le livre romantique ne reflète qu’une situation bien plus
macroscopique : il n’est pas question seulement de l’ut pictura poesis, ou du rôle de
l’illustration, mais du pouvoir même de l’image de construire de nouveaux imaginaires à
travers des objets modernes (les lanternes magiques, les panoramas, la photographie, la
figurine-charge, l’image d’Épinal, le timbre-poste, la caricature, la bande dessinée, l’affiche
200 A.-M. Bassy, « Le livre mis en pièce(s). Pensées détachées sur le livre romantique », Romantisme, 1984, p. 25. 201 J.-J. Grandville et D. Taxile, Un Autre monde, Paris, H. Fournier, 1844, p. 1-3. Consulté sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3120537/f29.image
151
commerciale, la carte postale et le livre illustrée lui-même) qui définissent son caractère
envahissant. Cette « pulsion vers l’image » détermine un imaginaire par images :
Le XIXᵉ siècle n’a certes pas inventé l’image, comme il n’a pas inventé la littérature,
comme il n’a pas inventé la relation de l’image à la littérature […]. Mais il a modifié
profondément et radicalement cette relation en inventant, ou en mettant au point, ou
en industrialisant, ou faisant circuler, ou en généralisant dans des proportions
radicalement nouvelles une nouvelle imagerie – le terme se généralise au XIXᵉ siècle –
faite de nouveaux objets et de nouvelles pratiques.202
L’imagerie du XIXᵉ siècle couvre la ville entière :
La ville, ce nouvel actant collectif de toute la littérature du siècle, ne semble plus être
que le lieu où se mettent en scène de nombreux rituels processionnaires porteurs de
signes, d’icônes et d’emblèmes politiques ou religieux (voir la Fête-Dieu d’Un cœur
simple) ou le lieu des cycles successifs d’expositions (la mode journalière et saisonnière
dans la rue et dans les vitrines des magasins, le Salon tous les ans, l’Exposition
universelle tous les dix ans). Ce qui ne va peut-être pas sans risques. Ce sont en effet
les facultés mêmes de l’homme, physiques et psychologiques, et surtout celles que
sollicite la littérature, qui semblent être menacées soit d’hypertrophie, soit de
dépérissement. Comme si – là se trouve la hantise du siècle – trop d’images tuait
l’imagination, paralysait l’imaginaire.203
C’est exactement ça le reproche que les écrivains font à l’illustration : l’image coupe les ailes
de l’imagination, en bornant le mot à une vision concrète, unique, limitée. Dans la
littérature donc, bien avant la menace qui, selon Philippe Hamon, tombe sur le personnage
autour de 1850, lequel ne devient « qu’un ʺréflecteurʺ dans un monde d’images et de
reflets »204, c’est la lecture qui subit des conséquences assez considérables.
Dans cette perspective, la condamnation de l’illustration arrive sous la plume
d’Eugène Pelletan, qui en février 1843 rédige, sous le pseudonyme de F. de Lagenevais, un
article pour la Revue des deux mondes titré « La littérature illustrée ». L’article de Pelletan est
long et complexe ; mais c’est dans la première partie du texte que se concentre la critique de
Pelletan envers la littérature illustrée. Pelletan adopte un lexique particulier, calqué sur celui
de l’article « De la littérature industrielle » rédigé par Sainte-Beuve en 1839 pour la même
202 P. Hamon, Imageries. Littérature et images au XIXᵉ siècle, op. cit., p. 11. 203 Ibid., p. 21 ; c’est nous qui soulignons. 204 Ibid., p. 24.
152
revue, auquel « La littérature illustrée » semble faire pendant. D’abord, Pelletan souligne
que « désormais, les peuples devront surtout leur supériorité historique à des innovations
d’idées »205, et que la gloire de la France est due au XVIIIᵉ siècle par la littérature. Mais « les
peuples, comme les individus, n’obtiennent cette supériorité de l’esprit qu’à la condition
d’accomplir des œuvres sérieuses »206. Pelletan dénonce tout de suite la décadence de la
littérature française contemporaine, causée par la perte de « l’initiative » des écrivains, qui
subissent maintenant la pensée publique. De plus, les écrivains :
[Ils] s’étonnent de ce qu’on ne veut plus acheter de livres nouveaux, et, au lieu d’éditer
des livres sérieux, de former ainsi le goût public, ils cherchent au contraire à le
tromper en exploitant d’inintelligentes et passagères fantaisies. C’est ainsi que nous
avons vu s’accroître, dans une proportion vraiment prodigieuse, cette littérature qu’on
ne peut nommer d’aucun nom, qui est aux trois quarts faite par les dessinateurs.
L’industrie ne relève pas de la critique ; il lui est loisible de porter ses capitaux où elle
l’entend, de mettre dans la circulation les œuvres qu’il lui plait d’y jeter. Si la librairie
française trouve son intérêt à se transformer en magasin d’estampes et de gravures,
nous aurons sans doute le droit de nous plaindre de voir la littérature déposer la
première de toutes les souverainetés et marcher à reculons vers la civilisation
mercantile de l’Amérique.207
Bien évidemment le discours de Pelletan, qui arrive quatre ans après l’édition illustrée de La
Peau de chagrin, concerne principalement la foule de romanciers qui sont aujourd’hui, et
peut-être déjà peu de temps après leur mort, oubliés ; néanmoins, dans la sphère des
auteurs qui étaient considérés comme producteurs de la « littérature industrielle », des
écrivains tels que Balzac, Dumas et Sue, ne sont pas à l’abri de cette dénonciation. En 1843
les physiologies et la littérature panoramique avaient fait éclater la puissance pervasive de
l’image, qui en 1838 n’était pas encore si évidente. C’est pour cela que la lithographie et la
gravure sur bois sont au cœur de la querelle :
L’illustration est devenue un prétexte pour écouler d’anciennes éditions ou pour en
faire de nouvelles ; les livres sérieux, qui s’adressent surtout aux hommes d’étude, se
sont vus contraints d’entrer dans cette mascarade universelle et de subir les culs-de-
205 E. Pelletan, « La littérature illustrée », dans La Revue des deux mondes, février 1843, p. 645. Consulté sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k355423/f644.item.r=litt%C3%A9rature%20illustr%C3%A9e 206 Ibidem ; c’est nous qui soulignons. 207 Ibid., p. 646 ; c’est nous qui soulignons.
153
lampe et les vignettes. Jamais aucun siècle n’avait poussé aussi loin que le nôtre cette
débauche d’illustrations mercantilement conçues, qui ne profitent pas même à l’art de
la typographie.208
L’illustration amènerait, selon Pelletan, à la marchandisation du livre, lequel acquiert un «
rang parmi les coquillages transatlantiques et les vases de Chine », mais elle serait aussi « la
naïve éloquence » qui doit être réservée exclusivement aux basses classes de la société, car
s’« il faut des représentations figurées aux populations primitives », l’illustration n’ajoute
rien à la compréhension des œuvres de la littérature209. Non seulement l’illustration est
inutile, mais aussi :
Il y a une impression particulière dans la vague de la peinture par la parole. Par cela
même que rien n’est précisé, que l’esprit du lecteur est continuellement obligé d’en
appeler à ses réminiscences et à ses émotions personnelles, d’interpréter en quelque
sorte l’idée du poète, il arrive que chacun croit retrouver dans sa lecture ce qu’il a
éprouvé lui-même et qu’il pourrait y revendiquer sa part de poésie ; car il ne faut pas
oublier que le poète complet est non seulement un homme, mais encore une foule,
qu’il est la personnification sympathique des sentiments existants à la fois en lui et
autour de lui.210
En somme, au lecteur est demandé le processus contraire à celui fait par le romancier : ce
dernier s’exalte dans le « coup d’œil », où il condense son pouvoir de lire la société, alors
que du lecteur on exige de respecter la durée du temps nécessaire à créer des effets :
Le talent du poète et du narrateur est de s’emparer de notre esprit, de l’entraîner à sa
suite, insensiblement, sans qu’il s’en aperçoive, de le mettre sous l’influence
magnétique de sa volonté propre ; il ne peut y parvenir qu’avec de long
développemens [sic], des illusions produites, que la gravure vient détruire en
représentant un moment unique de l’action à chaque pas, au lieu de laisser le lecteur
continuer paisiblement sa route et assister sans témoin ni interrupteur au spectacle qui
se joue successivement dans son esprit. La grande ressource de la parole écrite est de
contraindre, par son côté mystérieux et infini, l’esprit de celui qui lit à travailler lui-
même, à être poète avec le poète, penseur avec le savant. Nos ames [sic] ne sont pas
uniquement passives dans nos lectures ; elles sont, beaucoup plus qu’on ne croit,
parties actives. Lorsque le dessinateur vient donner des formes précises tantôt aux
208 Ibid., p. 648. 209 Ibid., p. 650. 210 Ibidem.
154
rêveries, tantôt aux récits de l’écrivain, il arrive nécessairement que l’esprit ne
s’habitude plus à comprendre ces récits et ces rêveries que sous les figures dont le
peintre les a revêtues. Le dessinateur se substitue ainsi au poète, il impose son
interprétation personnelle au lieu de cette interprétation multiple et vivante que
chacun pouvait faire selon sa fantaisie ou selon son caractère.211
Pelletan s’adresse directement aux écrivains, en leur posant une série de questions :
Comment n’ont-ils pas compris que l’attrait de la curiosité, que le plaisir des yeux
l’emporterait infailliblement sur la volupté laborieuse, patiente et réfléchie de la
lecture ? Comment n’ont-ils pas compris que leurs œuvres illustrées ne s’adressaient
plus qu’aux femmes et aux enfants, qui ne lisent qu’en feuilletant et qui traitent les
livres comme des chiffons ? L’illustration est un symptôme de décadence littéraire.
[…] Les gravures d’ailleurs ne nuiraient pas au texte, ne rompraient pas l’unité
d’impression nécessaire à toute lecture, que pour le seul effet matériel il faudrait les
proscrire ; elles ne font que jeter le désordre dans les pages, elles dérangent cette
harmonie régulière des lignes, à laquelle l’œil est habitué, qui fait disparaître à la lecture
le souvenir du livre, qui nous laisse seuls face à face avec les personnages, les scènes
décrits, et qui contribue beaucoup à la compréhension rapide des choses qu’on lit.
Dans les éditions illustrées, au contraire, le regard est perpétuellement inquiété, excédé
par cette multitude de figures qui se déroulent et qui renaissent les unes des autres ; on
oublie, pour les regarder ou pour les éviter, la page précédente. Autant vaudrait rêver
au milieu des cris et des mouvements de la foule.212
Les accusations les plus lapidaires que Pelletan présente contre la littérature illustrée
concernent dès lors les profondes modifications que les gravures apporteraient à la lecture,
de trois façons. Premièrement, le public traditionnel des œuvres illustrées est composé par
les femmes et les enfants, qui font déchoir le livre au statut de chiffon, par la méthode
ludique de leur lecture « en feuilletant » ; il en résulte que les ouvrages sérieux deviennent
maintenant le nouveau jeu des enfants. Deuxièmement, la lecture se trouve
irrémédiablement compromise par la diversion causée par les images, où « les plaisirs des
yeux » prennent le dessus sur la « volupté laborieuse » de la lecture213. Troisièmement, non
seulement les gravures sont les sirènes du lecteur moderne, mais même ceux qui sont assez
211 Ibid., p. 651. 212 Ibid., p. 653 ; c’est nous qui soulignons. 213 À ce propos, voir C. Devès, « Le lecteur et son regard sur la littérature illustrée au xixᵉ siècle en France :
entre choix, attentes et imaginaire collectif » dans L’esthétique du livre, Alain Milon et Marc Perelman (dir.), Paris, Presses Universitaires de Paris 10, pp. 375- 393.
155
forts pour résister à leur charme se trouvent dérangés dans leur lecture par le désordre que
la vignette impose dans la page. Encore, l’illustration n’est pas comparée au chant des
sirènes, comme nous l’avons proposé dans notre commentaire, mais au bruit assourdissant
de la foule, comparaison décidément moins prestigieuse, la vignette n’étant douée d’aucun
caractère de noblesse.
L’analyse de Pelletan de la littérature illustrée est injuste dans le jugement exprimé sur
la valeur artistique des gravures romantiques, qu’il considère comme une « curiosité
banale » et stérile. Mais les extraits que nous avons proposés, nous le répétons encore,
mettent bien en évidence les fondements de la méfiance que les écrivains partagent à
l’égard de l’illustration depuis son arrivée dans les livres dans les années 1830.
S’il est vrai que Balzac n’a jamais formulé des affirmations aussi hostiles sur
l’illustration, on ne trouve néanmoins aucun jugement réellement positif ou enthousiaste
sur cet art dans ses écrits.
Les raisons du jugement négatif à l’égard de l’illustration se trouvent en réalité dans le
changement du statut que cet art mineur accomplit à ce moment-là. D’ailleurs, il serait plus
correct de dire que ce n’est pas le statut de l’illustration qui change, mais plutôt la
perception que la société en a, c’est-à-dire : ce n’est pas tant l’art de l’illustration qui se
trouve modifié dans son essence, dans sa nature, que sa réputation214. La personnalité forte
et imposante des illustrateurs romantiques, qui a rencontré le nouveau goût du public, n’a
fait qu’accroire le caractère autonome de l’image, qui se pose maintenant, de façon
explicite, comme un « iconotexte », selon l’expression forgée par Michael Nerlich et Alain
Montandon215, à savoir comme un texte à langage iconique qui forme dans sa rencontre
avec un texte écrit une unité indissoluble.
À la lumière de ce qu’on vient d’affirmer, il nous paraît clair que la notion de
« paratexte » élaborée par Genette s’adapte mal à l’illustration : celle-ci ne peut pas être
considérée comme un élément paratextuel, car non seulement elle a aussi le statut du
« texte » - à langage non verbal, certes, mais toujours un texte –, mais ce texte iconique
détermine un changement dans la compréhension du récit écrit d’une telle façon que les
deux textes ne peuvent pas être séparés au moment de l’analyse de l’œuvre sans courir le
214 Le livre de Michel Melot, L’illustration. Histoire d’un art est, dans ce sens, éclairant : dans son étude, Melot décrit le parcours accompli par l’illustration au fil du temps, en soulignant les moments où cet art a été rélegué dans les marges à cause du contrôle exercé par les institutions sur toute image produite dans leur territoire. 215 Voir A. Montandon et M. Nehrlich (éds.), Iconotextes, Paris, Ophrys, 1990.
156
risque de manquer certaines interprétations, visibles seulement dans l’ensemble de
l’iconotexte. L’illustration est véritablement un « word-bound image », comme l’a définie
Meyer Schapiro216.
Pour cela, nous proposons ici l’expression « iconotexte »217, qui entretient avec le
texte écrit un système de relations complexes. Nous avons identifié trois façons selon
lesquelles l’illustration se rapporte au texte : comme protexte, comme altertexte, et comme
contre-texte.
Paratexte iconographique vs Iconotexte
Protexte Altertexte Contre-texte
Ill. « Littéraire » Ill. « Interprétative »
Le protexte implique un rapport d’analogie entre le texte écrit et l’iconotexte, qui
s’exprime soit selon une traduction « littéraire » soit selon un réélaboration
« interprétative »218 du mot en image.
L’altertexte est une illustration qui n’a rien à voir avec le texte écrit.
Le « contre-texte » décrit la relation éminemment conflictuelle entre l’écriture et
l’image dont le XIXᵉ siècle est riche d’exemples. Le préfixe « contre- », dérivant de la
préposition latine « contra », exprime « un mouvement de sens inverse » aussi bien que « le
contact étroit ou le choc au terme d’un déplacement »219 : il réussit a véhiculer le sens aussi
politique de cette contraposition entre le texte et l’image, où il n’est pas question seulement
d’une opposition entre les deux textes mais aussi de leurs auteurs, qui se disputent sur la
suprématie de leur médium.
216 M. Schapiro, Words, Script, and Pictures : Semiotics of Visual Language, New York, George Braziller, 1996, p.25. 217 Le terme a été forgé par Michael Nerlich, « Qu’est-ce qu’un iconotexte ? Réflexions sur le rapport texte-image photographique dans La Femme se découvre d’Evelyne Sinnassamy » dans, Iconotextes, Alain Montandon (éd.), Paris, Ophrys, 1990, pp. 255-302 ; mais si Michael Nerlich l’utilise pour indiquer l’objet hybride qui constitue « une unité indissoluble de texte(s) et image(s) dans laquelle ni le texte ni l’image n’ont de fonction illustrative et qui — normalement, mais non nécessairement — a la forme d’un “livre ” » (p. 268), nous l’entendons plutôt comme un synonyme d’ « illustration ». 218 Nous reprenons ici la distinction élaborée par Ségolène Le Men entre illustration « littéraire » et illustration « interprétative », même si elle n’en théorise pas vraiment une définition spécifique. Nous suivons ici la piste qu’elle a tracée, en prolongeant sa pensée à l’intérieur du cadre théorique que nous venons d’élaborer. 219 http://www.cnrtl.fr/definition/contre
157
La préposition « contre » suggère donc une dynamique qu’on retrouve aussi dans la
définition d’iconotexte : la word-bound image est d’abord, en tant que langage qui diffère du
langage verbal, un mouvement vers un type de connaissance autre, ouvrant sur une
perspective nouvelle par rapport à celle choisie par l’écriture. À l’issue de ce mouvement, il
y aura ou bien un « contact étroit », une proximité des thèmes, des positions exprimés par
les deux textes, ou bien « un choc », un affrontement. L’illustration peut donc faire l’effort
de traduire en image l’histoire écrite (en tant que protexte), ou bien elle peut prendre ses
distances (en tant qu’altertexte), ou bien suivre un chemin contraire, opposé à celui du texte
écrit (en tant que contre-texte). De plus, « contre » exprime un mouvement qui met en jeu
deux éléments ayant le même statut, dans ce cas le même statut sémiotique : « contre-
texte » postule que l’illustration puisse être considérée comme un texte, un iconotexte, qui
s’oppose – en tant que langage autre –, au texte écrit et se distingue de ce dernier, ainsi de la
connaissance qu’il transmet.
La Peau de chagrin illustrée de 1838 restitue cet enjeu transtextuel. Considérée comme
l’un des plus beaux livres romantiques, La Peau de chagrin édité par Delloye et Lecou est un
exemple non seulement de la perfection technique que la taille douce atteint à ce moment-
là, mais aussi de l’intelligence fine et perspicace avec laquelle les illustrateurs savent
enluminer le texte balzacien. Les 106 vignettes dessinées par Baron, Gavarni, Français,
Janet Lange, Marckl, Napoléon Thomas et Dorlet créent d’abord une sorte de résumé du
récit, comme elles représentent les moments saisissants de la narration. En second lieu, les
illustrations acquièrent une valeur différente selon leur position dans le texte et selon le
sujet représenté.
Nous avons distingué trois groupes d’illustrations : le premier est composé par les
vignettes qui servent de vestibule au récit, c’est-à-dire la couverture, la vignette en page de
titre, les vignettes en tête de chapitre et les lettrines ; le deuxième regroupe les illustrations
qui représentent les personnages, dans un portrait ou une scène ; enfin, le troisième compte
des vignettes particulières, à savoir celles représentant le décor, les natures mortes.
Nous allons maintenant analyser comment ces trois groupes d’images changent la
perception du récit balzacien, en nous interrogeant notamment sur l’influence qu’elles
exercent dans la construction du personnage.
158
5.2. Vestibules
Le premier groupe d’illustrations que nous allons analyser est celui des images à
« vestibule ». L’édition Delloye et Lecou contient dix illustrations qui fonctionnent comme
des seuils à la porte du texte : la couverture illustrée, la vignette de titre, quatre vignettes en
tête de chapitre et quatre lettrines. Ces images-vestibule sont douées d’un caractère
anticipatoire par rapport aux thèmes traités par le récit balzacien : la dimension onirique et
fantasmagorique des vignettes, par exemple, fait le pendant à la sensation de cauchemar
ressentie par Raphaël au cours de tout le roman : nous sommes dans le cas d’un protexte de
type interprétatif. En effet, les choix du protagoniste sont pris selon un seul critère : croire,
ou pas, au pouvoir de la peau de chagrin. L’ambiguïté du statut de cet objet magique
perdure jusqu’à la fin du récit : le narrateur ne résout pas l’énigme, et la peau disparaît avec
son possesseur. Cependant, l’objet-clé du roman n’est représenté qu’une seule fois dans les
vignettes-vestibule. Cette absence, assez étrange d’ailleurs, confère au talisman la qualité
d’objet-fantôme, qui paraît et disparaît selon les événements, dans les moments à plus haute
tension narrative. Encore, le décor prend dès ces premières illustrations une place
essentielle dans l’interprétation de l’histoire : les objets, omniprésents dans les images,
doués d’une forte valeur symbolique, remplissent le manque de la peau, en faisant
contrepoint au caractère aléatoire de cette dernière grâce à leur statut d’objets quotidiens,
comme nous le verrons en détail dans le quatrième sous-chapitre.
La première de couverture de La Peau de chagrin se présente sous forme d’une
couverture gravée. Un cadre à thème liberty, qui rappelle les décorations des Voyages
pittoresques et romantiques des années 1830, relie six figures : en haut, un putto lit un livre, à ses
côtés deux châteaux différents ; à côté du titre « Balzac illustré », un moine, debout, et un
vieil homme assis à un écritoire. Juste au-dessous, deux figurines de femme, l’une nue et
l’autre en vêtements d’époque moderne ; en bas de page, un chevalier et un soldat se
regardent alors qu’au milieu, entre eux, se trouve la marque de l’éditeur Delloye. La même
gravure est reprise pour la quatrième de couverture, mais à la place du nom de l’éditeur
figure le nom de l’imprimerie, Béthune et Plon. La disposition spatiale des personnages
semble établir une séparation de type chronologique : du côté gauche, le lecteur-spectateur
trouve les quatre figures associées au Moyen-Âge – le château-fort, le moine, une allégorie
féminine et le chevalier –, alors que sur le côté droit il voit les représentants de l’époque
moderne – le palais, l’intellectuel, la femme comme il faut, et le soldat. La couverture
159
suggère-t-elle une transposition de valeurs entre les deux périodes ? De l’épopée médiévale,
il est question maintenant de l’épopée moderne, d’une quête qui est entreprise non plus par
le noble chevalier mais par le bourgeois, en recherche non pas d’une révélation mystique
mais d’une élévation sociale, laquelle passe d’ailleurs toujours par la femme, à travers le
mariage. La femme n’est plus une allégorie de la valeur spirituelle dont le chevalier est en
quête : elle met au contraire bien en exposition les signes sociaux qui la distinguent parmi
ses rivaux, à savoir les vêtements. La gravure de la couverture pose la question de la
spiritualité, peut-être perdue dans le passage vers l’époque moderne. En effet, Raphaël de
Valentin, le protagoniste de La Peau de chagrin, à bien y voir s’engage dans une quête, mais à
l’envers : la peau de chagrin, talisman qui se substitue à la relique, est donné au héros au
début du roman, et non à la fin ; l’objet magique ne porte pas Raphaël vers une formation,
une construction de sa personne, mais vers sa déconstruction, vers la défaite de toute
valeur et science qu’il avait acquise pendant sa jeunesse.
C’est la vignette de titre qui introduit le cœur de l’histoire : sur le fond d’une société
indifférente et vouée au luxe et aux fêtes, un jeune homme est pris par les cheveux par un
squelette, qui l’amène vers un tombeau. Si le beau monde se présente comme une esquisse
d’hommes et de danseuses, devisant quelque part, à l’extérieur comme à l’intérieur, c’est le
jeune homme et le squelette qui prennent la relève de la scène. Néanmoins, deux faits
particuliers sautent aux yeux : d’abord, l’absence de l’objet éponyme du roman, la peau de
chagrin, qui n’est pas représenté dans l’image d’ouverture ; et pourtant, c’est la deuxième
remarque, le décor est dessiné en détail. Plusieurs sortes d’objets animent la scène, en
délimitant une trace subtile mais évidente sur l’importance des objets dans le roman. Il ne
manque que le talisman, dont l’absence soulève le doute sur sa réelle existence.
160
Figure 70 et 71 : Couverture et vignette de titre de La Peau de chagrin, Delloye et Lecou éd., 1838
Encore plus intéressantes sont les autres vignettes-vestibule qu’on trouve dans chacun
des trois chapitres et l’épilogue du roman en tête de page, qui précèdent le titre du chapitre,
et les lettrines. Du point de vue bibliophilique, la vignette en tête de page et la lettrine font
partie d’un schéma typographique ancien, que nous avons retrouvé également dans les
éditions illustrées des Œuvres de Molière et de La Fontaine imprimées par Balzac. Mais,
cette fois-ci, la vignette en tête de page acquiert une importance spécifique : elle ne
représente plus l’une des scènes-clé de l’ouvrage, mais elle se charge d’une valeur
allégorique.
Prenons la vignette du chapitre Le Talisman. La gravure est composée par deux
images centrales, de dimensions majeures par rapport aux dix autre disposées sur leur côté
droit et sur celui de gauche. Instantanément, le lecteur-spectateur s’aperçoit d’une
dichotomie dans les deux images centrales : en haut, deux êtres surnaturels, à queue de
serpent, tiennent le cadre où est étendue la peau de chagrin, laquelle semble émaner de
rayons de lumière, alors que la scène juste en bas représente un homme assis sur un siège,
en train de lire un livre, protégé par deux anges placés derrière lui. Il s’instaure donc une
connotation très forte autour de la valeur de la peau, introduite par les deux êtres serpentins
161
qui la détiennent, signe d’un lien très fort avec la ligne serpentine inspirée de Tristram
Shandy, et, en même temps, d’une connexion avec la sphère du diabolique, toujours
associée au serpent. Le tableau entier alors semble être la construction d’une fantasmagorie
produite par la peau elle-même, qui est susceptible d’offusquer la rationalité du lecteur –
qui nécessite donc de sa part la protection des anges. Encore, la dichotomie se poursuit
dans les dix petites scènes : celles du côté gauche sont toutes associées par le thème
convivial, alors que celles de droite représentent toutes le malheur ou la violence. Ces
scènes ne sont pas un résumé de l’histoire – bien qu’à première vue il pourrait le sembler :
le baiser entre les deux amants et le banquet sont présents dans le roman, mais le duel entre
Raphaël et Charles sera au pistolet et non à l’épée, personne n’ira en prison et personne ne
sera pendu. Il nous semble qu’il n’y a pas d’intention synthétique dans ces images, mais
plutôt une vision fantasmagorique de la dualité de la vie : chaque scène a son contraire, les
deux sont les deux faces de la même médaille. Le parcours dual de la vie, leitmotif du
roman entier, est représenté dans des scènes d’amour et de convivialité opposées à des
tableaux de violence et de mort. Par contre, la lettrine anticipe l’épisode de Raphaël qui
pense à se noyer, dans le dessin d’une table où il est écrit « Secours aux asphixiés ».
162
Figure 72, 73, 74 et 75 : Vignette du chapitre 1 et 2 et leurs lettrines, La Peau de chagrin, Delloye et Lecou éd., 1838
163
La vignette qui ouvre le chapitre « La Femme sans cœur » est certainement la plus
énigmatique parmi les quatre : elle est divisée en trois scènes, où, cette fois-ci, ce sont les
deux latérales qui détiennent les dimensions les plus grandes. Au centre de la vignette, une
femme torse-nu, un obélisque au lieu des jambes, se tient debout dans une attitude de
statue ; à ses pieds, une table pleine d’objets – parmi lesquels on reconnaît un bouquet de
fleurs, une brosse à cheveux, un petit miroir, un coffret contenant un collier, des rubans et
un flacon de parfum – prend la place d’une offrande pour la Vanité. C’est une
représentation dense de signifié dans l’interprétation du mythe de la femme moderne, rôle
joué par la cruelle Foedora. C’est encore Foedora qui prend la relève de la scène de gauche :
une femme est couchée sur une ottomane, entourée d’admirateurs ; la situation facilement
imputable au salon de Foedora. La scène à droite, en revanche, n’est liée à aucun passage
du récit balzacien : une jeune fille fouille dans un panier pendant qu’un chien aboie contre
elle et qu’un homme regarde au dehors de la porte ; derrière elle, une femme mourante
dans son lit. Cela semble la représentation d’un vol, qui n’est pas du tout présent dans le
roman. La lettrine de ce chapitre montre un lecteur assis derrière la lettre A.
La vignette en tête de page du chapitre « L’Agonie » se présente comme un véritable
rêve prophétique : la mort, représentée comme un squelette montant un cheval squelettique
émergeant d’une ville infernale, suivie par d’autres âmes, pointe sur un homme assis sur un
fauteuil une longue lance aiguisée. Devant la jeune victime, un groupe de personnages
cherche à le protéger en montrant à la mort qui avance une série d’objets : un sac plein
d’argent, un fusil, un goupillon, un livre et une lanterne. Mais les deux femmes pleurant aux
deux côtés de la victime semblent suggérer l’inutilité de cette défense : toute la science de
l’homme ne suffit pas à éviter l’inévitable. La lettrine aussi ne laisse pas d’espoir : un ange
pleure au chevet d’un homme.
La vignette en tête de l’« Épilogue », en revanche, se positionne sur le plan
métalittéraire et, en même temps, du protexte illustratif : un homme, qui pourrait être le
lecteur, se réveille, et se touche le front comme s’il cherchait à effacer un cauchemar de sa
tête. La Peau de chagrin, ne serait-elle qu’une immense hallucination ?
164
Figure 76, 77, 78 et 79 : Vignette de chapitre 3 et Epilogue et leurs lettrines, La Peau de chagrin, Delloye et Lecou éd., 1838
165
Dès lors, les vignettes-vestibule nous ont fait apercevoir les thèmes principaux du
roman. Maintenant, nous nous avançons à l’intérieur du texte, pour voir comment les
illustrations des autres deux groupes – celui de la représentation des personnages et celui
des objets – réagissent à, et sur, l’écriture de Balzac.
5.3. Splendeurs et misères du personnage illustré : le héros comme archétype
Les illustrations qui représentent les personnages se partagent en deux catégories : le
portrait et la scène. Aucune des images n’est suivie par une légende ; en revanche, les lignes
parmi lesquelles la vignette est plongée suffisent à la contextualiser et à en interpréter le
sujet. Cela veut dire que même si Raphaël n’a pas souvent le même visage d’une vignette à
l’autre, le lecteur peut reconnaître le personnage grâce au contenu du texte qui précède
l’illustration.
Les scènes constituent la majorité des illustrations : La Peau de chagrin illustrée est un
véritable résumé des événements saisissants du roman, qui reproduit fidèlement les points
principaux de la narration. L’entrée de Raphaël dans la maison de jeu du Palais royal, la
découverte de la boutique de l’antiquaire et de la peau de chagrin, les saturnales de Taillefer,
sa passion pour Foedora, son logement chez Pauline et sa mère, le déclin physique qu’il
attribue à la malédiction de la peau, tous ces épisodes trouvent un équivalent iconique. Les
scènes de cette édition illustrée oscillent entre une scène « de genre », d’inspiration
picturale, et une scène « dramatique », dans le sens que les gestes des personnages dessinés
sont exaspérés, théâtralisés, à la recherche d’un effet de mouvement que donne
l’impression d’une image douée d’un temps, non seulement chronologique (par rapport à
l’histoire) mais aussi de durée temporelle.
L’alternance de ces deux types de scène suit la démarche de la narration : le début du
roman, marqué par la description de la salle de la maison de jeu, est traduit en image dans la
représentation d’une table de joueurs, où pas un n’a encore un nom propre – détail qui
contribue à la formation de la « scène de genre ». De même, les deux moments de
bacchanale du festin de Taillefer sont représentés comme un salon plein de monde qui
danse, qui mange, qui boit et qui fume, où les identités de chacun des individus se fondent
dans un corps unique, indivisible. Autres scènes associées à la vie quotidienne, mais qui ne
peuvent pas être classées comme scènes de genre, ce sont les illustrations qui montrent
Raphaël dînant avec Foedora, ou Pauline causant avec sa mère devant le feu : dans ce type
166
de scène, la scène « quotidienne », les protagonistes de l’images sont facilement
identifiables, et l’image ne relève pas de l’anecdote, plutôt de la particularité de ce moment
dans l’histoire racontée. En revanche, les scènes dramatiques paraissent dans les passages
les plus critiques du roman : la rupture du protagoniste avec Foedora, Raphaël qui brandit
la peau comme un drapeau à la fin de la bacchanale, Raphaël qui chasse de sa maison son
ancien précepteur, sont toutes des scènes à haute tension dramatique que l’image traduit
pleinement. Deux illustrations particulièrement intéressantes se trouvent dans le passage de
« L’Agonie » où Raphaël confie à Pauline son chagrin, et sa peur d’être proche à la mort.
Les deux images qui illustrent ce moment représentent Pauline, à côté du jeune homme,
assis sur un siège de leur chambre, et, derrière eux, un squelette qui fait signe de les saluer.
Ce sont les pendants non seulement à la vignette de titre et à la vignette en tête de ce
chapitre, où le squelette avait déjà été choisi comme la représentation iconique de la morte,
mais aussi à la scène du « Talisman » où Raphaël, en attendant l’arrivée de l’antiquaire, se
trouve vis-à-vis d’un squelette dont la tête fait un signe de négation. C’est un type de scène
qu’on pourrait définir « fantastique », dans la mesure qu’elle montre une action ou un être
irréel.
La Peau de chagrin illustrée exhibe donc ce qu’on pourrait appeler un répertoire de
« scènes typisées », c’est-à-dire de différents groupes de scènes qui appartiennent à une
seule catégorie X ou Y, selon l’utilisation des codes qui la définit : la scène de genre, la
scène quotidienne, la scène dramatique et la scène fantastique.
Les portraits aussi sont assez nombreux : ils sont trente-quatre – onze pour le
chapitre « Le Talisman », neuf pour « La Femme sans cœur », et quatorze pour
« L’Agonie ». Ils ont, semble-t-il, une fonction particulière : les portraits, au contraire de la
scène dramatique, interviennent pour immobiliser le personnage dans un instant spécifique,
pour donner du relief à la caractérisation de son expression en ce moment précis. Dans
l’analyse de ces portraits, détecter le choix du personnage illustré se démontre
fondamental : grâce à l’Annexe 4 du tome II de la présente étude, nous pouvons faire le
bilan des personnages illustrés, et le cadre sortant n’est pas dépourvu de surprise.
D’abord, la première remarque qui se pose en comparaison de ce qui est ressort de
l’étude des scènes est l’absence de la typification du personnage principal, dans le texte
aussi bien que dans les illustrations. Raphaël de Valentin est sans doute le personnage le
plus représenté dans les vignettes : huit portraits lui sont dédiés, et il est présent dans la
167
plupart des scènes. Ses portraits interviennent à chaque fois que la narration a subi un arrêt
(par exemple vers la fin du chapitre « La Femme sans cœur », où le protagoniste est
représenté allongé sur un canapé, ivre et désespéré), ou bien quand la situation du
personnage a changé (comme au début de « L’Agonie », où le jeune homme est installé
dans son nouvel hôtel, entouré par le luxe ; là le lecteur trouve Raphaël, vêtu d’une robe de
chambre en soie, lisant un journal). C’est-à-dire que l’image illustre chaque nouvelle
tournure que la vie du protagoniste accomplit ; de cette façon, le personnage principal se
trouve fortement caractérisé dans son être une singularité. Ou bien, si Raphaël est présenté,
au début du roman, comme le type du jeune homme de génie dans la misère – typologie
qui sera justifiée par l’histoire de sa vie, que le protagoniste raconte à Émile dans le chapitre
« La Femme sans cœur », où on reconnaît un certain nombre de situations typiques, telles
que la mort du père et la chute du jeune héros, ou encore la passion pour une femme belle
et inaccessible, qui culmine dans la description physique faite par le narrateur à l’incipit du
récit –, à partir de l’événement extraordinaire qui est l’irruption de la Peau de chagrin dans
sa vie Raphaël perd toute typologisation. Il devient véritablement le héros, et, en même
temps, l’anti-héros du roman, selon la définition que Jacques-David Ebguy a élaborée
autour du personnage balzacien :
Qu’il soit « marginal », « mobile » ou « revenant », le héros fait écart et met en
mouvement. Cela peut se lire et se dire de multiples façons : le héros interrompt,
perturbe les fonctionnements codifiés et établis, défait la naturalité du fonctionnement
social (axe narratif), introduit une tension éthique et politique dans le système de
valeurs et de partage du sensible de la Société (axe axiologique), éveille et interroge le
lecteur (axe affectif). Il inquiète, puisqu’il fait percevoir l’absence de nécessité et du
fondement du mouvement social, et reconfigure, puisqu’il brouille les frontières, déplace
les lignes de partage et rétablit la communication. Aussi a-t-il été possible de le situer
par rapport aux catégories fondamentales d’appréhension du héros : le Temps, l’Acte
et le Dire. S’extrayant du présent aliénant, il n’est pas pour autant transporté dans
l’éternité tranquille de la légende et de la mémoire des hommes : son efficience est
ailleurs, dans sa manière de mettre en texte des formes de perturbation de la réalité.220
Le mode d’être du héros moderne non seulement se fonde « sur les notions d’écart et de
mouvement », mais englobe aussi, parfois, son contraire, l’anti-héros : « Balzac, en réponse
220 J.-D. Ebguy, Le héros balzacien. Balzac et la question de l’héroïsme, Saint-Cyr-sur-Loire, Christian Pirot, 2010, p. 242.
168
à un certain état du social, complique la représentation et dote ses personnages, Chabert,
Vautrin, ou Rastignac, de traits d’ʺanti-héroïsmeʺ »221. Raphaël partage cette ambivalence : il
est, en quelque sort, un héros, quand il s’éloigne de la Société lorsqu’il arrive finalement à la
richesse, n’obtenant aucune jouissance par le luxe qui l’entoure, et quand il pose la
question, chère à Balzac, de l’énergie et de la consommation de la force vitale ; en même
temps, Valentin relève de l’anti-héroïsme lorsque cet écart de la Société ne produit aucun
mouvement. Sa vie se cristallise dans la routine qu’il impose dans sa maison, glacée dans un
temps indéfini, statique, pétrifié par la terreur de la mort. Au lieu de se jeter dans une
entreprise mythique, Raphaël se cache dans sa coquille, plus inquiet pour sa vie que par les
injustices perpétrées quotidiennement par la Société au reste du monde.
221 Ibid., p. 241.
170
Différents sont les portraits des personnages féminins principaux et des personnages
mineurs. En effet, ce n’est qu’avec ces groupes de personnages qu’on commence à
apercevoir le type, dans le texte mais surtout dans les illustrations. D’abord, la première
catégorie de personnage féminin que le roman propose est celle de la courtisane. Au festin
de Taillefer, à moment donné des femmes entrent dans le salon, et marquent le début d’une
nouvelle orgie. La catégorie sociale des jeunes filles n’est pas spécifiée dans le récit, qui les
définit comme « des beautés de Versailles convoquées par Lebel, ayant dès le matin dressé
tous leurs pièges, arrivant comme une troupe d’esclaves orientales réveillées par la voix du
marchand pour partir à l’aurore »222. Parmi ces « abeilles », deux femmes s’approchent du
Raphaël et d’Émile : Aquilina, « une grande fille bien proportionnée, superbe en son
maintien, de physionomie assez irrégulière, mais perçante, mais impétueuse, et qui saisissait
l’âme par de vigoureux contrastes », avec une chevelure noire ; et Euphrasie, « la plus jolie
et la plus gentille petite créature qui sous la baguette d’une fée fût jamais sortie d’une œuf
enchanté »223. Aquilina et Euphrasie sont les deux faces de la même médaille : « l’une était
l’âme du vice, l’autre le vice sans âme »224.
222 La Peau de chagrin, p. 86. Dans ce chapitre, toute référence à ce roman est extraite de l’édition Delloye et Lecou du 1838. 223 Ibid. p. 88. 224 Ibid., p. 91.
171
Figure 90-93 : Aquilina et Euphrasie
Au contraire, elles contrastent avec le modèle de la femme idéale, de la femme pure à
laquelle songe Raphaël, et que Foedora et Pauline devraient incarner. Le type de la femme
des rêves du protagoniste, juste esquissé dans le texte, résumable dans la formule « pure,
belle et riche », trouve une traduction en image à la page 118 et à la page 252, à laquelle tout
personnage féminin doit se mesurer. Si on confronte les portraits de Foedora et de Pauline
avec ces deux modèles idéaux, il est évident que l’image de Foedora se rapproche le plus du
type de « la femme des rêves » : sinueusement assise sur le canapé, richement vêtue,
l’éventail à la main et la pointe du pied qui ressort de la robe, la comtesse porte dans son
nom le vrai objet d’amour du jeune homme, l’or – Foedora est composé par le mot latin
foedus, pacte, et or, « pacte d’or ». Image primordiale de « la femme comme il faut », type
inspiré des femmes de la société française du XIXᵉ siècle que Balzac conjuguera dans Les
Français peints par eux-mêmes et dans Autre étude de femme, Foedora reste toutefois le type de
« la femme sans cœur », dont Valérie Marneffe sera la dernière incarnation.
172
Figure 94 et 95 : Foedora
Figure 96 et 97 : La Femme des rêves et Une Jeune fille pure et innocente
L’iconographie qui entoure Pauline amène par contre vers d’autres considérations.
Premièrement, bien qu’elle aussi trouve son modèle dans un idéal, Pauline ne s’approche de
l’image de « la femme des rêves » que dans le chapitre « L’Agonie », quand Raphaël la
rencontre par hasard au théâtre et la voit transformée en riche héritière. Ce n’est qu’à ce
moment-là que nous trouvons le portrait illustré de Pauline, qui auparavant n’avait été
représentée que dans une scène, jamais toute seule et en première plan. C’est un fait assez
significatif : Pauline ne trouve son image qu’au moment où elle devient le modèle idéal de
Raphaël – « belle et riche » –, mais, en même temps, elle s’éloigne de ce simulacre en
refusant les poses canoniques de la femme comme il faut : pas de riches parures, pas
d’éventail dans la main, pas de fausses postures ; seulement le petit pied reste, parmi ces
173
détails du catalogue de la beauté, pour souligner la charmante figure de la jeune fille.
Pauline est pourvue d’un charme naturel, simple et authentique, qui est représenté dans la
scène du petit déjeuner des deux amants.
Figure 98 et 99 : Première apparition de Pauline et Le Dejeuner des deux amants
Encore, le modèle dont Pauline s’inspire est trop idéal, et culmine dans l’image fantastique
de « la Reine des illusions », « éclair » qui vêt le corps de la femme de flammes. Ainsi, les
illustrations de l’« Épilogue » restituent la silhouette de Pauline sous la forme d’un ange et
de fantôme blanc.
Figure 100 et 101 : Pauline comme ange et fantôme
174
Le processus de typisation advient aussi dans les figures mineures tels que les
médecins. Dans le chapitre « L’Agonie », Raphaël demande l’aide des médecins les plus
réputés de Paris, qui se réunissent en consultation dans le salon du jeune homme. Quatre
médecins sont présentés par le narrateur : Horace Bianchon, personnage reparaissant de La
Comédie humaine, « homme plein d’avenir et de science, le plus distingué peut-être des
nouveaux médecins » ; le docteur Brisset, « le chef des organistes » ; le docteur Caméristus,
« chef des vitalistes » ; et le docteur Maugredie, « l’homme des tentatives désespérées ».
Figure 102-104 : Le docteur Brisset, Le docteur Caméristus et le docteur Maugredie
175
Parmi les quatre docteurs, Bianchon est le seul auquel aucune illustration s’est consacrée,
alors qu’il est le seul dont le portrait témoigne d’une admiration sincère : la description des
trois médecins n’est pas exempte d’une ironie subtile et molièresque qui répond à la cruauté
démontrée par les illustres docteurs vis-à-vis de leur malade. En tant que chef de trois
approches médicales différentes, Brisset, Caméristus et Maugredie sont le personnage-type
de l’École médicale qu’ils représentent. L’image rend en détail les traits des trois
personnages, en pose sérieuse, sorte de portrait à médaillon à caractère officiel.
La caricature n’intervient qu’en deux ou trois gravures, en présence de personnages
ridicules, tel que le vieil admirateur de Foedora, qui soupire devant son lit, ou l’ancien
précepteur de Valentin. Mais en général tout personnage est dessiné selon les canons du
style réaliste – ce qui détermine en effet la prédominance de l’individu plutôt que du type.
Figure 105 et 106 : Le vieil admirateur de Foedora et Le précepteur de Valentin
Enfin, le personnage sans doute le plus complexe et fascinant du roman, le vieil
antiquaire du quai Voltaire, reste enveloppé de mystère, les illustrations n’amenant pas à la
résolution de l’énigme qui l’entoure. L’antiquaire fait le sujet de deux illustration façon
portrait et de deux scènes. Le premier portrait paraît lorsqu’il avance dans le couloir de sa
boutique vers le jeune inconnu qui demande de voir le tableau de Raphaël, à la fin de la
description que le narrateur donne de cet étrange vieillard. Le portrait, à trois-quart, montre
un visage méphistophélique, avec une barbe longue et pointue, les yeux grands et perçants.
176
Figure 107 : Portrait du vieil antiquaire
Comme nous l’avons déjà annoncé dans les chapitres précédents, l’ambiguïté de ce
personnage dérive de la chaine de figures antinomiques avec lesquelles le narrateur le
compare : Moïse et le Peseur d’or à la fois, image de Méphistophélès et du Père Éternel au
même temps, l’antiquaire est partagé entre la couleur rouge et le noir, entre modèles du
Bien – en sens religieux – à l’instar des simulacres du Mal et du Vice. Ne pouvant pas
rendre la dichotomie du personnage à travers la couleur, le dessin exprime le caractère
double de l’antiquaire dans l’expression de son visage, qui oscille entre un regard maléfique,
tel celui dans le premier portrait qu’on vient de commenter, et une expression angélique
qu’il montre quand il indique à Valentin la peau accrochée sur le mur. Expression qui
redevient diabolique lorsque Raphaël essaie de trancher la peau avec un poignard.
Figure 108 et 109 : L'antiquaire indiquant la peau à Valentin
177
La silhouette de l’antiquaire, aussi, instaure une comparaison implicite avec celle du Peseur
d’or par Dou, tableau assez populaire à ce moment-là, en exposition au Louvre. Le Peseur
d’or, allégorie de l’avarice et de la cupidité225, est un homme gros et vêtu de rouge. Le
Peseur et l’antiquaire n’ont en commun que la couleur verte des yeux.
Figure 110 : Le Peseur d'or de Dou
La valeur symbolique que les deux êtres véhiculent semble, à première vue, assez
différente, mais le sillage d’indices composé par les objets qui entourent l’antiquaire et le
Peseur d’or démontre le contraire : de fait, les deux figures sont, exactement comme
Aquilina et Euphrasie, les deux faces de la même médaille.
L’arrivée du vieil antiquaire, propriétaire du magasin, est anticipée par le catalogue de
merveilles que le jeune inconnu admire dans la boutique ; ces tableaux, statues, vases,
armures et animaux empaillés se fondent dans un tourbillon chaotique, une fantasmagorie :
« Ce fut un mystérieux sabbat digne des fantaisies entrevues par le docteur Faust sur le
Brocken »226, d’où, à la fin, sort la version balzacienne de Méphistophélès.
225 Voir la notice élaborée par le site du Louvre : http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=25721 226 La Peau de chagrin, p. 33.
178
Figure 111 : Un sabbat digne de celui de Faust
Ainsi, les objets mis en cause dans les pages précédentes, au lieu d’être une vraie
« renaissance », comme le garçon l’avait promis au jeune visitateur, sont plutôt le magma
d’une civilisation qui s’éteint. L’aura de l’œuvre d’art est déjà fissurée, non seulement pour
la question de sa reproductibilité, comme le soutient Walter Benjamin, mais aussi par la
faillite da sa mission civilisatrice : l’œuvre d’art n’est plus le signe de l’intellect de l’homme,
elle est une marchandise, emballage d’une mine d’or qui se cache derrière sa
commercialisation, ce qui est évidemment déjà au cœur de la réflexion balzacienne et qui
sera traité de façon plus explicite dans Pierre Grassou et dans Le Cousin Pons. Ainsi, le choix
de comparer l’antiquaire au Peseur d’or rend plus évident le thème de la maladie de l’or qui
caractérise non seulement Raphaël de Valentin, mais la Société entière. Rouge ou Noir, le
destin de Raphaël est écrit depuis la première page du roman, lorsque le narrateur lui
attribue un air maladif, auquel Pauline donnera le nom de phtisie, mais qui en réalité est la
monomanie de l’or, incarnée par l’objet magique de la peau de chagrin, qui consume
l’énergie vitale de l’homme.
Le vieil antiquaire sort de scène, après la signature du pacte, accompagné par la
malédiction jetée par Raphaël :
Je verrais bien, monsieur, si ma fortune changera pendant le temps que je vais mettre à
franchir la largeur du quai. Mais, si vous ne vous moquez pas d’un malheureux, je
désire, pour me venger d’un si fatal service, que vous tombiez amoureux d’une
danseuse ! Vous comprendrez alors le bonheur d’une débauche, et peut-être
179
deviendrez-vous prodigue de tous les biens que vous avez si philosophiquement
ménagés.227
La malédiction s’accomplit : dans le chapitre « L’Agonie », Raphaël rencontre le vieil
antiquaire à théâtre, en compagnie d’Euphrasie. L’antiquaire, dans le rôle d’un vieil Adonis,
espèce de « poupée » comparable à « un vieux Rembrandt enfumé, récemment restauré,
verni, mis dans un cadre neuf », montre à Raphaël « de frappantes ressemblances avec la
tête idéale que les peintres ont donné au Méphistophélès de Goethe »228.
Figure 112 et 113 : Le vieil antiquaire en dandy
L’illustration représente le visage pointu de l’antiquaire comme décrit dans le texte
balzacien, mais elle ne rappelle pas vraiment le modèle de Méphistophélès crée par
Delacroix – il est fort probable que l’allusion aux « grands peintres » qui ont dessiné le
visage de cet être surnaturel est en réalité Delacroix, vu que la première édition de La Peau
de chagrin a été publiée deux ans après l’édition illustrée du Faust de Delacroix. La gravure
tend plutôt à se focaliser sur l’apparence nouvelle de l’antiquaire, en dessinant avec
précision les vêtements en style dandy du vieillard, qui porte l’objet signe de cette catégorie
sociale : la canne.
5.4. « Faire briller les moindres petites choses » : les objets, personnages saisissants
de La Peau de chagrin
La représentation des objets ne se limite pas au cabinet de l’antiquaire. Par les illustrations
concernant Raphaël, Foedora et Pauline, il est clair que les personnages sont souvent
plongés dans le décor qui caractérise leur milieu. À première vue, la présence de ces objets
dans les illustrations pourrait être interprétée soit comme une volonté de la partie des
227 Ibid., p. 53. 228 Ibid., pp. 279-280.
180
illustrateurs d’être fidèles au texte, lequel est dense de descriptions, soit, dirait Roland
Barthes, pour créer cet « effet de réel » auquel Balzac vise de plus en plus dans sa narration,
et que l’image doit également poursuivre.
Une analyse plus approfondie des objets représentés dans les dessins suggère
cependant d’autres interprétations, qui s’ajoutent à ces deux premières. De fait, dans le récit
balzacien et dans ses illustrations deux types d’objets figurent : les objets doués d’un
pouvoir magique et les éléments propres au décor, à savoir les objets de la vie quotidienne.
Cette distinction traduit au niveau microscopique le dualisme du monde fictif des
personnages, partagé entre un plan fantastique et un plan réel, que le texte met en scène.
C’est le basculement propre au fantastique, si l’on accepte la première condition que
Todorov a formulée pour la décodification du genre : « D’abord, il faut que le texte oblige
le lecteur à considérer le monde des personnages comme un monde de personnes vivantes
et à hésiter entre une explication naturelle et une explication surnaturelle des événements
évoqués »229.
L’appartenance de La Peau de chagrin au genre fantastique a fait le sujet d’un débat
encore ouvert. Bien que la veine fantastique soit fortement présente dans le roman, selon
les tenants de l’argument, tels que Claude Duchet, elle n’arrive pas vraiment à typiser le
genre du récit, qui est d’ailleurs considéré par Balzac lui-même comme un « roman
philosophique », dans la définition que Claude Duchet en a donnée a posteriori, en retraçant
le signifié que ce genre avait à l’époque :
Roman des pulsions et de la névrose, roman du savoir et de l’imaginaire, La Peau de
chagrin atteint par là cette dimension « philosophique » qui, dans le vocabulaire de
l’époque, implique aussi une vision de l’Histoire et une visée du social. La fiction
balzacienne s’installe dans « le oui et non humain », sur cette « ligne qui sépare le fait de
la parole, la matière de l’esprit », et profile l’ambition du romancier-poète de
recomposer, comme Cuvier, une unité à partir de fragments.230
Les objets de la vie quotidienne s’inscrivent sans doute à l’intérieur de cette réflexion sur la
vie et sur l’histoire. Extension métonymique des personnages qui le possèdent, l’objet
quotidien est le nouveau bouclier d’Achille : sa fonction est celle de compléter la
229 T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, « Points », 1970, p. 37. 230 C. Duchet, « Présentation » dans Balzac et La Peau de chagrin, Claude Duchet dir., Paris, C.D.U et SEDES réunis, 1979, p. 8.
181
caractérisation et la mythification du personnage à travers un symbole matériel qui puisse
l’incarner.
L’exemple le plus paradigmatique pour La Peau de chagrin n’est pas autant la Peau que
le lit de Foedora. Au cours de la première soirée de Raphaël chez Foedora, Rastignac, qui
l’a introduit chez la grande dame, lui montre le salon et la chambre à coucher de la
comtesse :
Tout-à-coup il se leva, me prit la main, me conduisit à la chambre à coucher, et me
montra sous un dais de mousseline et de moire blanches un lit voluptueux doucement
éclairé, le vrai lit d’une jeune fée fiancée à un génie. « N’y a-t-il pas, s’écria-t-il à voix
basse, de l’impudeur, de l’insolence et de la coquetterie outre mesure, à nous laisser
contempler ce trône d’amour ? Ne se donner à personne, et permettre à tout le monde
de mettre là sa carte ! si j’étais libre, je voudrais voir cette femme soumise et pleurant à
ma porte ».231
La chambre à coucher de la comtesse, nouvelle « dernière fée », se pose comme un entre-
deux, entre espace public et espace privé, entre réel et féerique, entre métonymie et
symbole. Le songe, l’illusion est tout ce qui restera à ceux qui vont en quête de son amour :
le lit de la grande dame est toujours un immense, élégant vide, impossible à remplir. Ainsi,
le lit s’installe sur le seuil entre le monde réel et le monde fantastique, extension et, au
même temps, substitut de cette « jeune fée fiancée à un génie », où ce dernier n’est
évidemment pas l’intellectuel, l’homme de génie, mais la créature magique qui sort de la
lampe d’Aladin. Foedora est étroitement liée à la sphère du féerique, et pourtant elle est le
personnage le plus « réel », le plus « concret » du roman : toujours représentée au milieu de
son mobilier, la comtesse est entourée par un univers d’objets qui constitue le catalogue du
monde quotidien, à partir de ses vêtements.
Si Foedora est plongée dans un milieu d’objets de luxe qui évoquent le marché et la
bourse, sans que ces derniers ne soient évoqués directement qu’au moment de la rupture de
Raphaël avec la comtesse, Pauline, en revanche, est souvent dessinée en compagnie des
objets qui représentent les échanges – matériels et idéals – qu’elle entretient avec Raphaël :
le piano, alors qu’elle apprend à en jouer, par exemple, ou la tasse de crème qu’elle offre au
jeune homme de retour après une soirée passée chez Foedora, en devinant qu’il était à jeun.
231 La Peau de chagrin, pp. 151-152 ; c’est nous qui soulignons.
182
Le lecteur trouve encore Pauline assise devant le feu pendant qu’elle peint, en sachant que
c’est grâce à ces petits travaux qu’elle gagne de l’argent à donner à Raphaël.
Outre les objets de la vie quotidienne qui entourent la figure des personnages
illustrés, les gravures de La Peau de chagrin présentent aussi de véritables natures mortes : la
table couverte d’antiquailles dans la boutique du quai Voltaire et celle du dessert au festin
de Taillefer dans « Le Talisman », le lit de Foedora, dont nous avons déjà parlé, et le chaos
d’objets qui symbolise l’orgie finale du festin dans « La Femme sans cœur ». Dans ces
illustrations, la valeur métonymique et symbolique des objets, extensions et en même temps
medius non tant d’un personnage que d’une scène, d’une situation, se croise avec la
dimension féerique du roman. De fait, ce sont les armures, les armes, les vases, et les
tableaux que Raphaël voit dans la boutique qui causent la fantasmagorie qu’il vit jusqu’à la
sortie du magasin, éléments annonçant le vrai objet magique, la peau. Encore, la table
pleine de gâteaux, de fruits et de bouteilles de vins et liqueurs qui représente le dessert
offert par Taillefer à son festin symbolise la gourmandise, la voracité qui domine les invités,
non seulement vis-à-vis de la nourriture mais aussi de l’or et du plaisir. Cette image trouve
son corrélatif dans la nature morte qui se trouve à la fin du deuxième chapitre, où, cette
fois-ci, les desserts ne sont plus bien disposés sur la table en ordre impeccable, mais au
contraire ils semblent sauter dans l’air, dans le désordre qui domine le festin à ce moment-
là.
184
Les objets alors acquièrent une importance de plus en plus grande dans la
caractérisation de l’image, dans le récit aussi bien que dans les illustrations, lesquelles
interprètent fidèlement la présence de ce nouveau type de personnage.
Cependant, l’objet central du roman, la peau de chagrin, que le lecteur s’attend à voir
dans les illustrations, ne figure qu’en cinq gravures. La première image de la Peau paraît au
moment où l’antiquaire la montre pour la première fois à Raphaël, mais dans le dessin le
talisman occupe une place vraiment marginale : il est en haut du côté droit, la silhouette
bien détectable mais de couleur trop claire. L’attention du lecteur se focalise inévitablement
sur les deux personnages qui occupent le centre de la scène, et sur les autres objets qui les
entourent, bien plus définis, plutôt que sur la peau. La deuxième gravure met encore
l’accent sur le geste de Raphaël tranchant la peau avec un poignard, sous le regard
méphistophélique de l’antiquaire.
Figure 118 et 119 : Illustrations de l'objet Peau, La Peau de chagrin, Delloye et Lecou éd., 1838
L’objet Peau reparaît justement dans les illustrations seulement après le récit du
protagoniste, à la fin de la bacchanale, quand Raphaël, ivre, se lève en criant sa volonté de
185
vendetta contre Foedora, et brandit la peau comme un drapeau. Le talisman se déforme,
difficilement identifiable sans l’aide du texte écrit.
Figure 120 : De Valentin ivre agitant la Peau comme un drapeau, La Peau de chagrin, Delloye et Lecou éd., 1838
La quatrième image aussi saisit le geste violent de Raphaël qui jette le talisman dans un
puits, dans la tentative d’échapper à sa malédiction. L’objet, informe dans la main du
personnage, retourne à son propriétaire quelque temps après, repêché par le jardinier
Vanière.
Figure 121 et 122 : Tentative de Raphael de se débarrasser de la Peau, La Peau de chagrin, Delloye et Lecou éd., 1838
Enfin, la dernière illustration qui met en image la peau concerne l’épisode de Raphaël
s’adressant à Planchette pour résoudre l’énigme de l’objet mystérieux ; ils demandent tous
les deux l’aide de la science mécanique, et posent la peau sous le puissant marteau de maître
Spieghalter, sans aucun résultat. La peau reste intègre, sans même une griffe.
186
Figure 123 : Valentin, Planchette et Spieghalter essaient de trancher la Peau
Les illustrations ne montrent jamais Raphaël regardant la peau et mesurant son
rétrécissement, scène qui se répète plusieurs fois dans le roman. Également. Les images
montrent la peau qui garde toujours les mêmes dimensions, au lieu de rétrécir à chaque
désir exprimé par Raphaël.
C’est un détail très significatif : jusque là, les gravures que nous avons analysées
témoignent d’un certain degré de fidélité au récit balzacien qui vient à tomber dans le
moment où la traduction iconique de l’objet éponyme du roman est prise en considération.
La peau de chagrin constitue le cœur de l’énigme du texte : de fait, l’histoire se fonde sur un
événement de matrice fantastique – le don du talisman – qui pose essentiellement un
problème ontologique : croire ou non à son pouvoir magique. Raphaël est convaincu que la
série de coïncidences, comme les appellent les médecins, qui lient sa vie au pouvoir de la
peau est réelle et, par conséquent, à chaque désir formulé suit le contrôle du jeune homme
sur la dimension du talisman. En effaçant ces scènes dans les illustrations, il nous semble
que les images se posent du point de vue des amis qui taquinent Raphaël et son talisman, et
qui jettent le doute sur son pouvoir.
Certes, nous ne connaissons pas les motifs qui ont amené les illustrateurs à ce choix ;
on pourrait faire mille hypothèses à ce propos, qui seront condamnées à rester de nature
aléatoire. Ce que nous intéresse est l’effet que ce choix a sur le lecteur à la lumière de sa
lecture du récit et de la vision des images : il nous semble que réduire de telle manière la
présence de la peau dans les images contribue à atténuer la force de l’objet magique, en lui
187
niant de prendre une forme iconique, et à mettre en premier plan plutôt les actions de
Raphaël de Valentin. Cela est finalement la démonstration de la valeur contre-textuelle des
illustrations : les images influencent la perception du récit, en faisant pencher la balance en
faveur de la monomanie destructive de Raphaël, plutôt que seconder l’ambigüité
d’interprétation prévue par Balzac.
Cette première édition balzacienne complètement illustrée nous a donné donc les
points-clés sur lesquels l’étude des illustrations doit s’appuyer pour retracer la relation
complexe et dense que le récit entretient avec ses images. Relation qui ne peut pas être
définie à travers le mot genettien de paratexte ; c’est pourquoi nous avons proposé la
définiton d’illustration comme iconotexte, avec les trois types de relations qu’elle entretient
avec le texte – de protexte, d’altertexxte, et de contre-texte. Les gravures que nous venons
de commenter démontrent que la démarche générale des illustrateurs du texte balzacien a
été celle de traduire fidèlement les mots de l’écrivains sans toutefois renoncer à leur
personnalité, c’est-à-dire d’instaurer une relation de type protextuelle. Ainsi, les choix faits
par les dessinateurs ont comporté trois conséquences principales.
Premièrement, la typisation de la scène, qui est catégorisable, selon certaines
caractéristiques de sujet et de modalité de représentation, en quatre groupes : la scène de
genre, la scène quotidienne, la scène dramatique et la scène fantastique.
Deuxièmement, la centralisation des personnages traités non comme types mais
comme individus : surtout Raphaël, héros et anti-héros du roman, témoigne de
l’incomplétude du processus de typisation des personnages dans l’écriture balzacienne en
1831 ; la catégorie des « égoistes », sous laquelle Balzac insère Valentin et Foedora dans sa
Préface à l’édition 1831, reste trop générique pour donner lieu à une véritable typisation du
personnage, qui paraît d’ailleurs accomplir un parcours fortement personnel. Dans cette
perspective, Foedora est sans doute un type plus réussi, les illustrations le rendent
clairement. De même, la typisation des personnages mineurs témoigne de ses prémices
seulement avec le type du médecin.
Troisièmement, la croissance de l’importance du décor, qui constitue un véritable
paradigme indiciaire qui non seulement renforce la caractérisation et la valeur symbolique
des personnages, mais enlève aussi l’énigme du talisman.
188
Maintenant, nous allons étudier comment ces trois points seront bouleversés dans les
éditions illustrées successives : à partir de 1840, grâce à l’influence de la littérature
panoramique, le type prend progressivement la place à l’intérieur de l’image, au détriment
de la scène, et influence énormément l’écriture des grands romanciers tels que Balzac. Non
seulement le personnage devient l’élément principe du livre, mais les objets aussi restent au
centre de l’attention des artistes, outils indispensables dans le processus de typification.
189
CHAPITRE 6
DU MYTHE AU TYPE : DE L’HISTOIRE DE L’EMPEREUR AUX
PHYSIOLOGIES
Le Napoléon des Lettres pose pour un daguerréotype, une main
sur la poitrine, dans l’échancrure de la chemise largement ouverte,
comme l’Autre la glissait dans son gilet, sur l’estomac. Le XIXᵉ
siècle a trouvé son secrétaire au regard aquilin.
Gengembre Balzac, Le Napoléon des Lettres, 1999
La Peau de chagrin publiée par Delloye et Lecou, bien que désigné par les bibliomanes tels
que Champfleury, Vicaire ou Brivois comme l’un des plus beaux exemples du livre
romantique, fut un échec retentissant. Selon Brivois, mais l’information suscite des doutes,
en 1839 les deux éditeurs décident de céder les copies invendues à Houdaille, lequel, pour
différencier son édition de la précédente, change légèrement la vignette de titre : au lieu du
squelette qui entraîne le jeune homme dans la tombe, il ne figure qu’une main squelettique
sortant de la vapeur infernale et tenant l’homme par les cheveux. S’il est vrai que cette
vignette sans squelette existe, on n’a aucune certitude qu’elle soit liée à Houdaille, comme
les noms des éditeurs précédentes, Delloye et Lecou, figurent encore dans la page de titre,
au-dessous de la vignette.
De plus Balzac, dans ses lettres à l’Etrangère, ne donne aucune notice de cette
transaction forcée. Les chiffres et les contrats paraissent désordonnés, Balzac se répète ou
oublie de donner à Mme Hanska certains détails de ces affaires. Les trois livres que nous
allons analyser dans ce chapitre témoignent de cette distraction : on ne trouve
presqu’aucune allusion aux deux physiologies, et il n’y a qu’une toute petite référence à
l’Histoire de l’Empereur. De la même façon, la correspondance générale ne contient pas
d’échanges entre Balzac et ses éditeurs ou illustrateurs qui peuvent nous renseigner sur ces
projets. Il est regrettable de n’avoir pas de témoignages sur la construction de ces éditions
illustrées, qui marquent d’ailleurs un tournant fondamental dans la production balzacienne
et dans l’histoire du livre : il est impossible de savoir à quel point l’écrivain a été impliqué
dans le choix des illustrations, et quel type de rapport il a instauré avec les dessinateurs.
Néanmoins, nous pouvons faire quelques hypothèses.
190
L’Histoire de l’Empereur racontée dans une grange par un vieux soldat, La Physiologie du rentier
de Paris et de province et la Physiologie de l’employé ont été publiés entre 1840 et 1842, c’est-à-dire
pendant la publication de l’œuvre capitale, Les Français peints par eux-mêmes, que nous
traiterons de manière approfondie dans le chapitre 7. Mais, puisque les trois livres de Balzac
sont publiés en même temps que les Français, il est clair qu’ils ne peuvent pas être
influencés par cet ouvrage de la même façon que La Comédie humaine éditée par Furne,
publié à partir de 1842, c’est-à-dire après Les Français peints par eux-mêmes. C’est le motif qui
nous amène à traiter l’Histoire de l’Empereur et les deux physiologies avant le chapitre dédié à
la littérature panoramique.
Néanmoins, L’Histoire de l’empereur et les deux physiologies représentent de leur côté
une évolution ultérieure par rapport à La Peau de chagrin Delloye et Lecou, par la qualité des
illustrations, qui les met dans un état intermédiaire entre le livre romantique de la fin des
années 1830 et celui des années 1840, annonçant ainsi les changements qui sont en cours et
qui se manifesteront dans les éditions collectives éditées par Curmer.
Si, comme nous l’avons affirmé en conclusion du chapitre 5, La Peau de chagrin 1838
semble construire le type comme un individu derrière lequel on entrevoit une idée –
l’égoïsme qui se cache dans les personnages de Raphaël et de Foedora –, auquel correspond
une illustration à son tour individualisante, qui vise à créer une iconographie spécifique de
ce personnage particulier, auquel on attribuera toujours un nom propre plutôt que son type
– Raphaël plutôt que « l’égoïste » -, les deux physiologies témoignent du contraire : le texte,
aussi bien que l’illustration, tend à représenter les personnages comme la personnification
d’une idée, soit morale soit sociale soit ethnologique, qui est non seulement l’essence, mais
véritablement le personnage tout court, qui témoigne de cette inversion dans la perte du
nom propre. Autrement dit : le personnage des physiologies est une entité générale,
manifestation physique d’une idée ou d’une valeur sociale ; comme tel, il s’éloigne de son
individualité, au point qu’il n’est plus nommé à travers un nom propre, mais à travers un
nom commun précédé d’un article défini, comme « l’employé » ou « le rentier ». Si quelque
personnage détient encore un nom propre, celui-ci est un nom parlant ou un nom qui
pourrait être substitué par un autre sans aucune difficulté, puisque l’individu a cédé la place
à l’idée. Certes, le genre de la physiologie se prête bien à cette « généralisation » du
personnage, son propos étant très différent de celui du roman, mais les éditions illustrées
de cette période rendent évident le fait que le succès atteint par les physiologies influence
191
inévitablement le marché de la littérature, et donc les autres genres, qui doivent suivre ce
nouveau goût.
L’Histoire de l’Empereur, de son côté, se pose comme un projet particulier. Publié pour
la première fois en 1833, elle est insérée ensuite dans Le Médecin de campagne lors de l’édition
Furne. En 1841, Charpentier achète le droit de publication de ce récit bref avec l’intention
de l’illustrer, mais finalement le projet sera réalisé par Hetzel. Le texte, sorte de recueil des
épisodes anecdotiques de la vie de Napoléon, construit le mythe de l’Empereur, figure
tutélaire du roman de formation balzacien, à travers un processus d’idéalisation du
personnage232. Cependant, cette mythification de Napoléon n’est pas aussi naïve qu’on
pourrait le croire : le récit crée une sorte de dualisme, où on trouve d’un côté le mythe
nourri de la légende dorée, et de l’autre la distance par rapport à cette idéalisation que les
deux anciens soldats, Goguelat et Gondrin, semblent demander à leur public. L’illustration
intervient dans cette perspective pour souligner le caractère exagéré, quasi fantastique de ce
mythe, qui pourtant relève d’un personnage historique.
6.1. Le personnage mythique dans l’Histoire de l’Empereur
La dichotomie entre récit historique et récit mythique qui caractérise ce texte de Balzac se
manifeste premièrement dans le titre de l’œuvre, Histoire de l’Empereur racontée dans une grange
par un vieux soldat et recueillie par M. de Balzac, où l’écrivain exploite le topos du témoignage
recueilli par une troisième personne externe, et donne ainsi une patine de réel très forte à
son conte. Dans cette perspective, les vignettes de Lorentz, gravées par Brevière et Novion,
sont apparemment censées illustrer le texte en secondant l’allure du reportage. Ce livre
montre une évolution de remarquable importance : les illustrations sont douées d’une
légende, qu’elle soit un morceau de phrase réécrit au-dessous de la planche hors-texte ou
des mots du texte soulignés avec l’italique. Ainsi, l’image est véritablement ancrée au mot
écrit, ce que nous permet une analyse très précise de la relation instaurée entre les deux
médiums.
Depuis la première page, il semble clair que l’implantation du texte ne correspond
pas au genre du reportage annoncé par Balzac : le lecteur ne trouve aucune trace de Balzac
réunissant les expériences des deux soldats. Au contraire, dans le premier chapitre du
232 Sur l’élection de certaines figures telles que Napoléon ou don Quichotte comme pères tutelaires du roman moderne, voir notamment M. Robert, Roman des origines, origines du roman, Paris, Grasset, 1972 ; F. Moretti, Il romanzo di formazione, Torino, Einaudi, 1999.
192
conte, « Les deux soldats », le début du texte introduit deux personnages assez inattendus,
suivis par un narrateur en focalisation externe :
Je vais vous montrer, dit le médecin à l’officier, en arrivant dans une petite gorge par
laquelle les deux cavaliers débouchèrent dans la grande vallée, un des deux soldats qui
sont revenus dans ce pays après la chute de Napoléon. Si je ne me trompe, nous allons
le trouver à quelque pas d’ici recreusant une espèce de réservoir naturel où s’amassent
les eaux de la montagne, et que les atterrissements ont comblé. Mais pour vous rendre
cet homme intéressant, il faut vous raconter sa vie.233
Ce n’est qu’à page 11 que le nom du docteur Benassis est révélé, et que le lecteur peut donc
associer ce récit à celui du Médecin de campagne.
Le conte met dès lors en jeu cinq personnages principaux : le commandant Genestas
et le docteur Benassis, qui donnent lieu à la première micro-narration sur la vie des « deux
soldats », Gondrin et Goguelat, ce dernier étant le narrateur de l’histoire de l’Empereur ; et
Napoléon lui-même, héros du récit de Goguelat. Le commandant Genestas et le docteur
Benassis ne font l’objet d’aucune illustration : on n’en voit que les silhouettes dans
l’illustration qui s’étend sur le côté gauche de la première page du conte.
Gondrin et Goguelat, au contraire, en tant qu’anciens soldats de Napoléon,
participent à la construction de l’iconographie napoléonienne : ils sont représentés dans
trois images du premier chapitre, deux pour Gondrin et une pour Goguelat. Goguelat, ex-
fantassin de la Garde impériale, est dessiné non dans ses habits militaires mais dans les
vêtements de son nouveau travail civil, pieton de la poste, avec la boîte à lettre sous son
bras.
233 H. de Balzac, Histoire de l’Empereur racontée dans une grange par un vieux soldat, Hetzel, Paulin et Dubochet éditeurs, 1842, pp. 3-4 ; c’est à cette édition que nous ferons référence.
193
Figure 124 : « Goguelat est ici le piéton de la poste »
Gondrin, en revanche, le seul pontonnier qui a survécu au désastre de la Bérézina, est
représenté non seulement dans son état actuel de malheur mais aussi dans la condition de
misère dans laquelle il se trouvait lors de son retour en France. Le double portrait de
Gondrin soulève donc le grand problème de l’injustice subie par les soldats napoléoniens
qui, comme le personnage balzacien, sont tombés dans la misère après la mort de
l’Empereur, leurs droits n’ayant pas été reconnus par le nouveau système politique.
Figure 125 et 126 : Les deux portraits de Gondrin, titrés « Il est arrivé à Paris en mendiant son pain » et « Gondrin »
Si l’image de Gondrin comme mendiant, caractérisé par un bâton à la main et des
guenilles attachées avec des ficelles aux pieds au lieu d’une paire de chaussures, relève d’une
illustration protextuelle, le deuxième portrait du pontonnier présente de nombreuses
incohérences vis-à-vis du texte. D’abord, la description que Benassis fait de Gondrin
désigne un homme qui « avait à peine cinq pieds » de hauteur, dont le buste et les épaules
« s’étaient prodigieusement élargis » et dont la figure « tannée, sillonnée des rides, creusée,
194
mais musculeuse, conservait encore quelques vestiges de martialité »234 ; mais dans
l’illustration le portrait de trois quarts de Gondrin rend impossible de déterminer la taille du
pontonnier. D’autres détails que le texte de Balzac fournit ne retrouvent pas un équivalent
iconique ; lisons la description que Balzac fait de Gondrin :
Le médecin et le commandant regardèrent attentivement autour d’eux ; ils ne virent
que la pelle, la pioche, la brouette, la veste militaire de Gondrin auprès d’un tas de
boue noire ; mais nul vestige de l’homme […]. Le militaire aperçut alors la fumée
d’une pipe entre les feuillages d’un éboulis, et la montra du doigt au médecin, qui
répéta son cri. Bientôt le vieux pontonnier avança la tête, reconnut le médecin et
descendit par un petit sentier. […] Tout en lui avait un caractère de rudesse ; son front
semblait un quartier de pierre, ses cheveux rares et gris retombaient faibles comme si
déjà la vie manquait à sa tête fatiguée ; ses bras, couverts de poils aussi bien que sa
poitrine, dont une partie se voyait par l’ouverture de sa chemise grossière, annonçaient
une force extraordinaire ; enfin, il était campé sur ses jambes presque torses comme
sur une base inébranlable.235
Les éléments clés sur lesquels le romancier fonde la description de Gondrin sont
totalement absents du portrait : le front et les cheveux sont cachés par une coiffure ; les
bras et les jambes sont coupés par le champ de vision limité du portrait ; la poitrine, dont
on devrait voir un morceau, est complètement couverte par la veste du militaire, laquelle,
dans la description textuelle, est abandonnée auprès d’un tas de boue noire. Ainsi, il est créé
un cas très intéressant d’illustration comme altertexte dans le sens contrastif de la
préposition « alter » : dans cette image particulière, l’illustration représente la véritable
antithèse du mot écrit. Inévitablement nous nous sommes demandée pourquoi cette
trahison à l’égard du récit, et, comme nous l’avons affirmé au début du chapitre, bien que
dépourvu de témoignages directs nous pouvons quand même risquer une interprétation.
En effet, si le tableau balzacien peint Gondrin dans la misère dans laquelle il vit après la
défaite de Napoléon, situation allégorisée par l’uniforme militaire laissé à côté de la boue
noire, l’illustration de Lorentz restitue au lecteur l’image de la splendeur dont le pontonnier
jouissait sous l’Empire et dont il aurait pu vivre encore si le nouveau gouvernement eût
rendu justice à l’ex soldat. De telle façon, l’illustration ouvre un monde pluridimensionnel,
où le présent se confronte virtuellement avec le passé et le futur qui aurait dû exister.
234 Ibid. pp. 14-15. 235 Ibid., pp. 11,12 et 15 ; c’est nous qui soulignons.
195
Gondrin rejoint Benassis et le commandant, et ensemble ils s’acheminent tous les
trois vers la grange où Goguelat contera « la véritable histoire de Napoléon, celle qui se
conte au peuple »236. L’affirmation de Benassis arrive juste avant son explication de la raison
qui a porté Goguelat, à être choisi comme conteur de la ville : le fantassin de la Garde
impériale, jugé par le pontonnier comme un « bel esprit comme un malin »237, en tant que
piéton de la poste est aussi « le diseur de nouvelles du canton ; l’habitude de les raconter en
a fait l’orateur des veillées, le conteur en titre »238. Les expressions que nous avons
soulignées sont les éléments qui amènent à une ambiguïté liée au type d’histoire racontée et
à son conteur. Premièrement, que la « véritable histoire » de l’Empereur soit « celle qui se
conte au peuple » est une contradiction : dans le monde occidental, la tradition veut que la
vérité soit révélée à un nombre restreint d’élus, et non au peuple. Deuxièmement la façon
dont Benassis décrit Goguelat entraîne le lecteur à se méfier du fantassin comme narrateur :
il est « malin », ce qui peut vouloir dire qu’il est intelligent mais aussi qu’il peut être
malveillant ou que son ingéniosité est liée à une astuce, à un artifice. En tant qu’orateur il
est persuasif, il sait parler au public, mais il n’y a aucune garantie qu’il dit la vérité – dans ce
cas-là, la vérité historique, car Napoléon est un personnage historique. Le contexte du récit,
à savoir le conte oral dans un espace commun tel que la grange, et la comparaison de
l’orateur-malin qui produira la « véritable » histoire de l’Empereur, rappelle de fait les
circonstances qui aménent à la création du mythe :
Même si, pour les critiques du mythe littéraire des années 1980 et suivantes, le mythe
littéraire se distingue du mythe ethno-religieux par le fait qu’il n’est pas tenu pour vrai,
la mythification littéraire d’une personne historique cherche tout de même à réunir
deux discours qui, pour leur part, touchent explicitement au vrai : d’un côté, le
discours du récit historique (qui prétend à une certaine véracité) et, de l’autre, celui du
mythe (un mythe étant accepté par définition comme « une histoire vraie » selon des
mythologues tels que Mircea Eliade [1957, p. 22]). Cependant, la réalité urgente
imposée par le récit historique et celle imposée par le récit mythique ne sont pas
semblables ; pour reprendre le vocabulaire des mythologues, l’une existe dans le temps
« profane » des circonstances temporelles, tandis que l’autre a lieu dans un temps «
sacré », le illud tempus qui n’a aucun rapport avec les événements concrets de l’histoire.
[…] En cheminant entre deux réalités déjà très disjointes, le mythe littéraire ne
236 Ibid., p. 11 ; c’est nous qui soulignons. 237 Ibidem ; c’est nous qui soulignons. 238 Ibidem ; c’est nous qui soulignons.
196
transporte pas l’auditeur (ou plutôt le lecteur) dans le temps sacré du mythe, mais
l’invite néanmoins à s’éloigner de toute restriction historique.239
Cela est le défi de Balzac : « témoigner d’une croyance quasi sacrée dans le statut mythique
de cet individu, sans pour autant oublier l’importance des récits historiques profanes qui
l’entouraient, même les faits les plus incroyables (par exemple, les récits des atrocités de la
guerre) »240. Si dans l’Histoire de l’Empereur le récit de Balzac se construit comme le tableau
mythique de Napoléon et de ses entreprises, où l’histoire personnelle de l’Empereur se
mêle aux légendes sur les origines divines de sa mission, les événements historiques passent
totalement à l’arrière-plan, altérés pour exalter le mythe napoléonien.
L’illustration participe à cet enjeu en faisant un clin d’œil au récit « profane » : l’image
prend en charge la représentation « légendaire » de Napoléon au sein de son Armée, en
illustrant les scènes à caractère magique et fantastique, et en s’inspirant de la tradition
iconologique qui entoure l’Empereur. Ainsi, les objets détiennent un rôle significatif dans la
représentation de l’Empereur, sorte de fil rouge qui se pose au croisement du récit
historique et du récit mythique, comme le démontre la vignette en tête du chapitre « Les
deux soldats ».
Figure 127 : Première page du chapitre « Les deux soldats »
239 B. Gerwin, « Révision et subversion : Balzac et le mythe de Napoléon », @nalyses, revue numérique, vol.8, n.3, automne 2013, p. 52 ; c’est nous qui soulignons. 240 Ibid., p. 53.
197
Sur un coussin, différents objets sont posés l’un sur l’autre : le Code napoléonien ; certains
des regalia parmi lesquels la couronne de Charlemagne et la main de justice, utilisées par
l’Ancien Régime mais aussi pendant le sacre de Napoléon ; une couronne « à l’antique »,
c’est-à-dire à pointes, que par contre l’Empereur n’a jamais portée ; le « Petit chapeau », à
savoir le bicorne noir de Napoléon ; les parements militaires tels que l’épée, les épaulettes et
le collier de grand maître de l’ordre de la Légion d’honneur. Tous ces ornements sont
l’extension métonymique de l’Empereur, symboles qui le matérialisent même pendant son
absence physique de la scène. De même, la mort de l’Empereur est esquissée à travers des
objets, à savoir la pierre tombale qui donne sur la mer, avec le dessin de l’aigle couronnée.
Figure 128 : Le tombeau de Napoléon
Une autre icone impériale très présente dans le livre est l’Aigle d’or, allégorie de
l’Empereur et, au même temps, de la France, référence au « vol » pendant les Cent jours.
Durant la campagne de Russie, l’Armée française, vaincue par le froid, est obligée de se
retirer, mais « les plus courageux gardaient les aigles, parce que les aigles, voyez-vous, c’était la
France »241. Encore, quand Napoléon revient à Paris après son exil, les Cent jours242
commencent ; son retour est annoncé à travers l’image d’un aigle qui s’envole au-dessus
d’une ville : « Alors [il] s’embarque sur la même coquille de noix d’Égypte, passe à la barbe
des vaisseaux anglais, met pied sur la France, la France le reconnaît, le sacré coucou s’envole
de clocher en clocher, toute la France crie : Vive l’Empereur ! »243. Enfin, les aigles sont détruites
après la bataille de Waterloo, symbole de la destruction du songe impérial de Napoléon.
241 H. de Balzac, Histoire de l’Empereur, p. 84. 242 Voir B. Gendrel et M. Labouret (dir.), Les Cent-Jours vus de la littérature : Suivi d'un inédit de Charles de Rémusat, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2017. 243 H. de Balzac, Histoire de l’Empereur, pp. 94-95.
198
Figure 129-131 : Les aigles
Mais venons-en à l’analyse des illustrations des personnages. On distingue trois groupes de
personnages représentés : Napoléon bien évidemment, la Grande armée et les armées
ennemies. La façon de dessiner les composantes de ces trois groupes est différente. Aux
armées ennemies, par exemple, auxquelles sont dédiées cinq vignettes et une planche hors-
texte, est réservé un dessin de style caricatural, qui fait parfois explicitement recours à la
tradition de la grimace : c’est le cas du dessin des grimaces des égyptiens pendant la
campagne d’Égypte, ou encore de la caricature de deux anglais devant les navires incendiés
à Aboukir. Le dessin le plus caricatural toutefois est certainement celui de la page 56 : lors
de son retour à Paris après la campagne d’Égypte, Napoléon chasse le Directoire et amorce
plusieurs réformes, mais il « ne s’endort pas sur la gamelle », puisque l’Autriche attaque
199
l’Italie, « il y avait des ennemis à balayer ». L’illustration prend cette phrase à la lettre : on y
voit une dizaine de balais animés poursuivre des soldats à cheval.
Figure 132-134 : Les armées ennemies
Le geste caricatural, dans ces exemples, se traduit dans l’exagération des dimensions des
personnages : les deux anglais de la même taille que le navire, les balais de la même
grandeur que le cavalier. C’est une tendance très répandue dans le livre : L’image redouble
l’hyperbole du exte. Ainsi, les ennemis sont souvent beaucoup plus grands que les soldats
français, comme dans la vignette qui illustre le retour des français au Caire, où un
mameluck gigantesque entrave le passage de l’Armée.
200
Figure 135 et 136 : Le mameluck gigantesque et Napoléon-géant
La dimension démesurée du mameluck est pourvue d’une valeur métonymique, comme le
soldat supplée l’armée entière ; en même temps, cette image rappelle l’épisode biblique de
David et Goliath, où David, au contraire, est fragmenté dans les militaires français
minuscules qui escaladent le géant tombé. De façon inverse, Napoléon attaquant l’armée
autrichienne en Italie assume des proportions énormes par rapport à ses ennemis, réduits à
des fourmis, l’image secondant les hyperboles qui entourent la figure de l’Empereur.
De fait, le mythe napoléonien se construit sur l’exagération des entreprises du
général, portées à l’hyperbole à travers les illustrations, qui, en illustrant « à la lettre » c’est-
à-dire en se proposant comme un protexte de type littéraire, soulignent l’aspect fantastique
du récit, et font de la narration balzacienne un conte plutôt qu’un récit historique.
L’ensemble des illustrations dédiées à Napoléon relève de cette veine : de l’origine
divine que Madame Bonaparte attribue à la mission de son fils aux légendes qui se
transmettent sur son immortalité, les vignettes du texte reproduisent ces épisodes à la lettre.
Ainsi, quand Goguelat affirme que : « il est sûr et certain qu’un homme qui avait eu
l’imagination de faire un pacte secret pouvait seul être susceptible de passer à travers les
lignes des autres, à travers les balles, les décharges de mitraille qui nous emportaient
comme des mouches, et qui avaient du respect pour sa tête »244, la vignette montre des soldats
avec un canon et des balles au lieu de la tête qui s’incline devant le buste du jeune
Napoléon.
244 Ibid., pp. 29-30.
201
Figure 137 : Les balles ont du respect pour Napoléon
De même, à la page 38 on trouve une scène similaire : après le succès de la campagne
en Italie, « les autres à Paris, voyant cela, se disent : ʺVoilà un pèlerin qui paraît prendre ses
mots d’ordre dans le ciel […]ʺ »245, et voilà le Père éternel représenté dans la vignette, avec
Napoléon, de taille beaucoup plus petite, bâton de pèlerin et épée à la main en attendant ses
ordres sur une nuages.
Figure 138 : Dieu donnant ses ordres à Napoléon
L’hyperbole graphique se traduit non seulement dans la démesure des corps ou dans la
représentation d’êtres surnaturels, mais aussi dans le dessin d’objets animés ou utilisés en
245 Ibid., p. 38.
202
manière impropre et dans la métamorphose des hommes en animal, comme l’on a déjà
partiellement vu dans le cas des balais et de l’aigle.
C’est le cas de la page 53, quand le narrateur raconte le retour de Napoléon en France
après la campagne d’Égypte : « Napoléon met le pied sur une coquille de noix, un petit navire
de rien du tout qui s’appelait la Fortune, et, en un clin d’œil, à la barbe de l’Angleterre qui le
bloquait avec des vaisseaux de ligne, frégates et tout ce qui faisait voile, il débarque en
France, car il a toujours eu le don de passer les mers en une enjambée », le passage est
illustré par une vignette esquissant le général à bord d’une véritable coquille de noix,
regardé tristement par un soldat français caricaturé.
Figure 139 : Napoléon sur la coquille de noix
Une autre image intéressante qui représente une scène surréelle est celle de page 57 : après
les campagnes d’Italie et d’Égypte survient une « paix générale où les rois et les peuples
font mine de s’embrasser. C’est là que l’Empereur a inventé la Légion d’Honneur, une belle
bien chose, allez ! »246. La vignette montre Napoléon assis à côté d’un alambic d’où la
médaille de la Légion d’Honneur est en train de sortir.
246 Ibid., pp. 57-58.
203
Figure 140 : Napoléon crée la Légion d'Honneur
Les militaires français, en revanche, sont métamorphosés en lapins lorsqu’on donne ordre
au général Bonaparte « de faire faction en Égypte. Voilà sa ressemblance avec le fils de
Dieu. Ce n’est pas tout. Il rassemble ses meilleurs lapins, ceux qu’il avait particulièrement
endiablés »247 : le lecteur se retrouve devant à une scène à la Grandville, où Bonaparte
regarde au sommet d’une pyramide ses soldats-lapins marcher.
Figure 141 : Il rassemble ses meilleurs lapins
247 Ibid., p. 38.
204
Rarement les illustrations de Napoléon évoquent les tableaux officiels qu’il avait
commandés et que le public de Balzac avait bien présents dans son imaginaire : c’est la
silhouette, et non le portrait, de Napoléon qui relève du mythe. Ce n’est pas par hasard que
la vignette en page de titre représente la silhouette noire de l’Empereur à cheval : la figure
de Napoléon doit rester plongée dans le mystère s’il veut devenir un mythe ; le portrait
officiel traduit le personnage historique, tandis que la silhouette esquisse la légende, grâce à
la stylisation de la figure, qui fait échapper le personnage à l’exactitude historique, à la
faveur d’une généralisation des traits qui demande à être définis par l’imaginaire commun.
De fait, c’est le même processus qui amène à la création du mythe littéraire, mais traduit en
image : Balzac ne peut pas de fait donner la « vraie » histoire de l’Empereur, sous peine de
manquer la réalisation de la légende dorée ; également, le dessin se limite à une
représentation stylisée de Napoléon afin de l’arracher à la réalité historique et l’élever au
pouvoir de l’imaginaire.
205
Figure 142 et 143 : Vignette de titre et Napoléon exilé
De celle façon, la figure de l’empereur-Prométhée248 reste en quelque sorte insaisissable,
comme un véritable être divin : même représentée de dos, la figure de Napoléon est
inimitable bien que partiellement cachée.
Les illustrations de la Grande Armée relèvent de la même ambiguïté, les images
oscillant entre des dessins à caractère fantastique, comme par exemple celui de la conquête
de la lune, et des esquisses conformes aux normes de la vraisemblance, qui restituent les
costumes militaires et certains objets utilisés par les soldats, comme la gourde.
248 Voir W. Jung (Hg.), Napoléon Bonaparte oder der entfesselte Prometheus, Bonn, Bonn University Press, 2015.
207
6.2. Le type « en miettes »249 : les physiologies balzaciennes
D’après l’analyse que nous venons de faire de l’ouvrage, il est évident donc que l’Histoire de
l’Empereur constitue une narration à caractère mythique, qui vise la construction d’une
image immortelle et héroïque de Napoléon. L’illustration souligne les aspects légendaires
qui entourent l’Empereur et la Grande Armée, en intervenant avec des vignettes et des
planches hors-texte qui représentent des scènes souvent fantastiques, lesquelles exploitent
les suggestions fournies par le texte lui-même.
Ce livre démontre un certain ordre dans l’organisation de l’espace réservé aux
illustrations : la présence de la vignette en page de titre, d’abord, et le schèma vignette en
tête de chapitre, lettrine et vignette à côté ou dans le texte est un système typographique qui
s’affirme de façon assez uniforme dans cette période-là, sur le modèle des Français peints par
eux-mêmes. L’image s’ancre au texte grâce aux mots soulignés en italique, et, dans le cas des
planches hors-texte, à travers la répétition de la phrase en question au-dessous de la
gravure. Le livre présente toutefois des imprécisions dans la disposition de certaines
images, placées avant ou bien après les mots auxquels elles se référent, et quelques italiques
ne sont pas dès lors suivies par une illustration.
Il s’agit maintenant d’examiner les deux autres ouvrages qui ont été publiés en 1841,
et qui se posent comme la pierre de touche en ce qui concerne la traduction du personnage
par l’image et l’évolution du livre romantique dans les années cruciales 1840 : la Physiologie de
l’Employé et la Physiologie du rentier de Paris et de province.
Avant tout il faut considérer le genre de ces deux livres : si l’Histoire de l’Empereur est
un conte légendaire de la démarche napoléonienne, nous nous trouvons actuellement
devant deux œuvres appartenant du genre le plus à la mode en la période analysée : la
physiologie. Terme scientifique qui désigne une partie de la médecine qui étude la nature et
ses phénomènes, comme la physiognomonie de Lavater et la phrénologie de Gall, le terme
subit dans les années 1820-1830 une « mystification lexicale », selon une expression de
Nathalie Preiss250, destinée à perdurer jusqu’à la décennie suivante : certains écrivains
commencent à nommer leurs ouvrages « Physiologie » – comme la Physiologie du goût de
Brillat-Savarin et la Physiologie du mariage de Balzac –, qui usurpent ainsi le mot scientifique et 249 Expression de N. Preiss Basset, « Le type dans les Physiologies » dans L’Illustration. Essais d’iconographie, Actes du séminaire du CNRS (GDR 712), études réunies par Maria Teresa Caracciolo et Ségolène Le Men, Paris, Klincksieck, 1999, p. 336. 250 N. Preiss, Les Physiologies en France au XIXᵉ siècle, op. cit., p. 211.
208
parodient ces traités médicaux dans l’étude des caractères. De plus, les physiologies
littéraires relèvent aussi de l’histoire zoologique de Buffon et de la caricature politique des
années 1830.
L’élément qui nous intéresse le plus toutefois est le personnage : la physiologie se
fonde sur le type ; or la définition de ce dernier reste en ce moment-là assez problématique,
à cause de l’interférence que l’illustration exerce sur sa construction. De fait, la notion de
type oscille entre celle d’un personnage « qui résume en lui-même les traits caractéristiques
de tous ceux qui lui ressemblent plus ou moins », le type donc comme « modèle du genre »,
et celle d’une « personne originale, synonyme d’ʺindividualitéʺ, de ʺphysionomieʺ » :
Étudier la notion de « type » dans les physiologies, c’est donc bien rendre compte du
statut ambigu de ce genre « en tension ». Proches des moralistes des XVIIᵉ et XVIIIᵉ
siècles par l’art de la « typisation », les physiologistes suivent aussi la tendance inverse,
« particularisante », qui les fait passer du type à la personnalité et donne à leurs
ouvrages, dans le domaine politique, une portée critique indéniable. Mais, aussi
critiques soient-ils politiquement, ils n’ébranlent pas véritablement les fondements de
la Monarchie de Juillet ; à user de la méthode de la zoologie contre celle de la
physiologie, les physiologistes, en effet, s’interdisent toute vision unitaire de la société et
du réel et renvoient à la société d’alors sa propre image : dans les physiologies, le corps
social ne se dissout pas dans les stéréotypes, il se fracture par une écriture de l’
« individualité », du fait détaché.251
Tendance complétement contraire à celle des Français peints par eux-mêmes, caractérisés par la
recherche de la totalité, de l’exhaustivité propre à l’encyclopédie.
Néanmoins, nous nous trouvons devant une contradiction importante lorsque
l’éditeur Martinon publie l’article « Monographie du rentier », que Balzac avait écrit pour
Les Français, en volume illustré à part, sous le titre de « Physiologie » du rentier, où le texte ne
diffère point de l’article – à part pour l’insertion du texte d’Arnould Frémy, qui décrit le
rentier de province – mais les illustrations sont originales. Pourquoi alors dans Les Français
Balzac utilise le mot « monographie », et dans le livre autonome « physiologie », si le texte
reste le même ?
En effet, si le texte est inchangé sa lecture subit forcement une altération : la
perception du texte change parce que les illustrations ne sont pas les mêmes. Dans Les
251 N. Preiss Basset, « Le type dans les Physiologies » op.cit., p. 336.
209
Français, l’article de Balzac est illustré par sept dessins de Grandville : une planche, en façon
frontispice, dédiée au rentier et sa femme se promenant dans la rue ; une deuxième planche
au type rentier ; une lettrine représentant la tête d’un homme contenu dans une huître ; une
vignette en tête de chapitre où figure l’intérieur d’un musée, avec des squelettes, d’animaux
et d’hommes, en exposition ; deux vignettes in-texte, la première représentant un groupe de
savants étudiant le rentier, et la deuxième un groupe de huit types de rentier. Les gravures
pour la Physiologie du rentier en revanche sont quarante-six, dont quarante-trois seulement
pour le texte de Balzac ; l’image donc est beaucoup plus exploitée que dans la
« Monographie du rentier ». L’illustration est, dans la Physiologie du rentier, une présence
constante, quasi invasive vis-à-vis du texte : leur relation est beaucoup plus étroite, et, en
même temps, le texte et l’image n’ont jamais été aussi éloignés que cela. La Physiologie du
rentier, aussi bien que la Physiologie de l’Employé, démontrent l’envergure de ce que nous avons
défini dans le chapitre 5 comme la valeur protextuelle et altertextuelle de l’illustration :
l’image n’illustre plus le récit « à la lettre », dans ces cas-là elle tend plutôt à créer un texte
alternatif, elle est sur la même ligne du texte écrit quoique présentant sa version de
l’histoire, notamment du type. Comme nous le verrons mieux dans le chapitre 7, les
illustrations des Français peints par eux-mêmes montrent elles aussi un enjeu avec le texte qui
n’est pas du tout exempt de cette force contre-textuelle, même si c’est différent de
physiologies.
Concentrons-nous donc sur la Physiologie du rentier et sur la Physiologie de l’employé. Les
deux physiologies balzaciennes disposent d’une structure assez similaire. D’abord, il faut
trouver une définition du type rentier et du type employé Le rentier est :
Anthropomorphe selon Linné, Mammifère selon Cuvier, Genre de l’Ordre des
Parisiens, Famille des Actionnaires, Tribu des Ganaches, le Civis inermis des anciens,
découvert par l’abbé Terray, observé par Silhouette, maintenu par Turgot et Necker,
définitivement établi aux dépens des Producteurs de Saint-Simon par le Grand -Livre.
Voici les caractères de cette Tribu remarquable, adoptée aujourd’hui par les
micrographes les plus distingués de France et de l’Étranger.252
252 H. de Balzac et A. Frémy, Physiologie du rentier de Paris et de Province, Paris, P. Martinon, 1841, pp. 5-6.
210
Figure 148 : Première page de la Physiologie du rentier
Alors que la définition de l’employé n’est pas facile à trouver :
Qu’est-ce qu’un employé ? A quel rang commence, où finit l’employé ? S’il fallait
adopter les idées politiques de 1830, la classe des employés comprendrait le concierge
d’un ministère et ne s’arrêterait pas au ministre. M. de Cormenin, que la Liste Civile
bénisse ! semble affirmer que le roi des Français est un employé à douze millions
d’appointements, destituable à coups de pavé dans la rue par le Peuple, et à coups de
vote par la Chambre.253
Figure 149 : Vignette en tête du premier chapitre de la Physiologie de l'employé
253 H. de Balzac, Physiologie de l’Employé, Paris, Aubert et Lavigne, 1841, p. 5.
211
L’incipit des deux physiologies est paradigmatique : si la Physiologie du rentier répond à
la velléité de classification basée sur les sciences naturelles, notamment celle de Cuvier, qui
est cité dans le texte, mais aussi celle de Buffon, la Physiologie de l’employé est imprégnée de la
satire politique, à laquelle s’ajoute, dans la deuxième section du texte, la méthode de
classification scientifique. Cependant, les gravures associées à ces premières lignes
n’illustrent pas vraiment le contenu de l’écriture.
Dans la Physiologie du rentier, en tête du chapitre on trouve une vignette représentant
trois hommes de trois quarts ; ils pourraient être les médecins qui ont étudié le rentier,
néanmoins dans le texte seulement deux experts sont cités, Linné et Cuvier ; qui est alors le
troisième homme ? Certainement pas l’auteur de la physiologie, certainement pas Balzac.
Encore, la vignette dessinée au côté gauche du texte est également mystérieuse : un homme
avec une canne sous le bras joue avec un petit objet qu’il a dans les mains, pendant qu’une
femme le regarde. Dans le texte, cette scène n’existe pas ; non seulement alors le lecteur
ignore si l’homme est effectivement un type de rentier ou pas, mais la dame qui
l’accompagne reste une inconnue totale : serait-elle sa femme, ou tout simplement une
passante ?
La vignette en tête du premier chapitre de la Physiologie de l’employé montre une
ambiguïté similaire : si le texte écrit procède à travers une série de questions que l’auteur se
pose pour arriver à la définition de l’employé, la gravure dessine un homme assis devant
une table couverte de bocaux remplis d’esprit de vie ; il en a un dans la main gauche, tandis
que dans la main droite il tient une plume. Même si la scène dispose évidemment d’un sens
allégorique, qui typise en quelque sorte la figure de l’homme de science, cette image
s’éloigne beaucoup du contexte peint par l’écriture, et constitue un exemple de ce que nous
avons appelé un « protexte de type interprétatif ».
Voyons d’autres exemples. Dans la Physiologie du rentier, ce dernier est représenté
comme un homme qui s’intéresse de la peinture : « En peinture, il tient pour Vigneron,
auteur du Convoi du pauvre »254 ; à la page précédente, on trouve une illustration qui montre
effectivement la caricature d’un homme, doué d’une tête énorme, qui regarde un tableau
qu’il tient dans les mains, pendant que son chien fait pipi sur les autres toiles disposés le
long le mur. Bien évidemment l’illustration est une caricature des mots qui la suivent ;
néanmoins, l’image est légèrement éloignée par rapport au texte auquel elle devrait se
254 Ibid. p. 34.
212
référer, et la scène esquissée dépasse la suggestion crée par la description balzacienne, à la
faveur d’une véritable caricature du rentier-collectionneur d’art ; en ce cas-là, la limite entre
une illustration protextuelle interprétative et une illustration de type altertextuelle est très
subtile.
Figure 150 : Le rentier et l'art
Les cas d’un manque de connexion entre le texte et l’image ne sont pas plus absents
dans la Physiologie de l’employé. Même si dans cette dernière la première partie du livre est
dominée par les images d’employés adonnés à leur geste typique, à savoir « paperasser », les
exemples d’illustrations « indépendantes » ne manquent pas.
Figure 151 : Cinq hommes qui « paperassent »
À la page 30, Balzac se lance dans une dénonciation de l’égoïsme de l’époque moderne :
Aujourd’hui l’Etat, c’est tout le monde, et tout le monde ne s’inquiète de personne,
Servir tout le monde, c’est ne servir personne. Personne ne s’intéresse à personne : un
employé vit entre deux négations ! Le monde n’a pas de pitié, n’a pas d’égard, n’a ni
cœur, ni ami ; tout le monde est égoïste, oublie demain les services d’hier. Tout le
213
monde est aveugle : il donne quatre mille francs de rentes à l’homme qui taraude la
terre, et n’offre pas deux liards au savant qui invente la tarière !255
Au-dessous de ce paragraphe est dessinée une vignette représentante la sortie d’un édifice,
où le concierge lève son chapeau au passage de quatre hommes en haut de forme, le
parapluie à la main.
Figure 152 : Employés sortant d'un édifice
Il n’y a vraiment aucun rapport entre cette vignette et le texte qui la précède : nous sommes
devant un exemple d’illustration en rapport altertextuelle avec le récit.
Il nous semble que cette tendance altertextuelle de l’image trouve une explication
dans le but visé par les deux médiums : si Balzac utilise un style ironique pour présenter la
définition du rentier et de l’employé, l’image s’appuie sur la tradition de l’album et de la
presse caricaturale pour restituer sa version des deux types. Autrement dit, l’illustration se
propose dans ces physiologies à travers le même schéma des albums lithographiques, c’est-
à-dire comme un catalogue de gravures qui recueillie à l’intérieur une collection d’images.
Les physiologies de Balzac sont l’équivalent d’un album fragmenté par l’écriture.
Contrairement à l’Histoire de l’Empereur donc, aucun mot en italique ne surgit dans le
texte pour aider le lecteur, qui est laissé seul devant ce casse-tête, où le manque de nom
propre creuse cette discontinuité ; mais, heureusement pour le public, cette dualité perdure
seulement dans la première partie de la physiologie : à un moment donné, le texte énonce
les catégories de types de rentier et d’employé, et l’image s’inspire suffisamment de la
description pour faire reconnaître le type qu’on a choisi d’illustrer.
255 Ibid. p. 30.
214
Dans la Physiologie de l’employé, les variétés d’employés trouvent presque toutes une
traduction en image, à l’exception du type « commis-cumulard » et celui du « commis-
flatteur ». C’est qui est intéressant de souligner est l’absence d’un modèle de représentation
canonique, stable : le croquis du type se présente sous la forme d’un portrait, comme celui
de l’architecte, ou bien d’un portrait-scène, comme celui du surnuméraire, ou d’une scène,
comme celui du caissier. C’est une différence considérable par rapport au système iconique
que, nous le verrons dans le chapitre 7, Curmer a imposé à ses illustrateurs. Mais le fait que
chaque type dispose d’une représentation particulière souligne l’impression d’une vision «
en miettes » de la société : on n’est même pas dans une mosaïque ou dans un panorama –
comparaison que Walter Benjamin a formulée pour Les Français peints par eux-mêmes –, car la
vision d’ensemble manque totalement, au profit d’une mise en lumière du type spécifique
du moment.
216
Dans la Physiologie du rentier, les douze types décrits par Balzac sont tous illustrés : le
Célibataire, le Chapolardé, le Taciturne, le Militaire, le Collectionneur, le Philanthrope, le
Pensionné, le Campagnard, l’Escompteur, le Dameret, le Rentier de faubourg. Dans la
plupart des cas, les illustrations pour chaque type sont au nombre de deux. Prenons
l’exemple du type Dameret, qui présente exceptionnellement trois gravures. La première
paraît dans le chapitre dédié au type Célibataire, parmi lequel figure le personnage
interprété par Henry Monnier, c’est-à-dire Prudhomme : le Célibataire se distingue du
Dameret dans le fait que « le Célibataire veut rester garçon, le Dameret veut se marier »256.
Cette variété devient rare :
Elle se reconnaît à ses gilets, qu’elle porte doubles ou triples, et de couleurs éclatantes,
à un air propret, à une badine au lieu de la canne, à une allure de papillon, à une taille
de guêpe, à des bottes, à une épingle montée d’un énorme médaillon, à cheveux
ouvragés par le Benvenuto Cellini des perruques, et qui perpétue de blonds souvenirs.
Son menton plonge dans une cravate prétentieuse. Ce Rentier, qui a du coton dans les
oreilles et aux mains de vieux gants nettoyés, prend des poses anacréontiques, se gratte
la tête par un mouvement délicat, fréquente les lieux publics, veut se marier
avantageusement, fait le tour des nefs à Saint-Roch pendant la messe des belles, passe
la soirée aux concerts de Valentino, suit la mode de très-loin, dit belle Dame ! flûte sa
voix et danse.257
Les phrases que nous avons soulignées sont certains des éléments qui caractérisent le
Rentier-Dameret de Balzac que l’illustration ne montre pas : les illustrations ne représentent
pas la badine du Dameret – sinon dans la troisième gravure, laquelle cependant devrait se
référer au Dameret redevenu Rentier simple – ni ses bottes, ou son médaillon, ses gants, ou
ses gestes typiques. En revanche, les gravures dessinent le Dameret qui se regarde dans un
miroir, ou qui fait la cour à une dame. Le geste de se regarder dans le miroir n’est pas décrit
dans le texte, mais certainement il est une action typique de cette catégorie de rentier, aussi
bien que la tentative de séduire la femme. L’image alors, dans ce sens, se pose devant le
texte comme un achèvement de la description, comme un prolongement original de cette
dernière.
256 H. de Bazc, Physiologie du rentier, p. 62. 257 Ibid., pp. 90-91 ; c’est nous qui soulignons.
217
Figure 156 et 157 : Le rentier Célibataire et Prudhomme
Figure 158 et 159 : Le Chapolardé
Figure 160-162 : Le Dameret
218
Ce que l’étude de la Physiologie du rentier et de la Physiologie de l’employé a mis en lumière
est fondamental à l’égard des chapitres suivants : finalement nous avons assisté à
l’émergence du type dans les physiologies, où l’illustration est une composant essentielle à
ce genre. En exploitant l’idée que les physiologies restituent une image « en miettes » de la
Société, nous avons étudié le rapport instauré entre le texte et l’image à travers la
représentation littéraire et iconique du type Rentier et du type Employé. Nous avons
remarqué comment l’illustration semble prendre vraiment la clé des champs, du moment
qu’elle s’éloigne d’une illustration « à la lettre » du mot écrit, en révélant ainsi sa valeur
protextuelle interprétatve et altertextuelle. Néanmoins, la portée de cette évolution dans le
livre romantique ne peut pas être pleinement saisie sans la comparaison avec le livre qui a
dicté les règles formelles de la construction du type, pour le texte aussi bien que pour les
images. Il est donc arrivé le moment de se plonger dans les volumes qui composent la
« littérature panoramique » : Les Français peints par eux-mêmes, Le Diable à Paris, les Scènes de la
vie privée et publique des animaux, La Grande Ville ; ce sont des ouvrages fondamentaux qui ont
influence l’organisation de l’édition Furne, et qui à leur tour ont bénéficié énormément de
la plume de Balzac.
Nous allons alors maintenant nous interroger sur les caractéristiques que le type
assume d’après Les Français peints par eux-mêmes, et comment cette formule nouvelle
témoigne la croissance de l’autonomie de l’illustration vis-à-vis du texte littéraire : le type
est de fait le résultat d’un travail synergique, complémentaire entre le dessin et le mot écrit.
Certes, la réaction des écrivains devant la croissance de l’image compliquera la relation
entre les deux médiums, comme nous le verrons avec le cas des Petites misères de la vie
conjugale ; mais jamais le livre illustré ne donnera d’autres exemples d’une telle coopération
entre le texte et l’image.
221
CHAPITRE 7
DES FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES AU DIABLE A PARIS : LE TYPE
« PANORAMIQUE »
Nous décrirons ce que nous avons vu, c’est le meilleur moyen d’être
vrai ; quant à de l’esprit, du comique, de l’observation ou de la
finesse, à quoi bon en promettre ? le lecteur pourrait nous répondre
comme Alceste « Nous verrons bien ! »
Paul de Kock, « Quelques mots avant d’entrer en
matière », La Grande Ville
Dans les deux premières parties de la thèse nous avons étudié les étapes fondamentales qui
ont marqué l’histoire du livre romantique. Dans la première section, « Balzac et les débuts
des illustrations romantiques », nous avons analysé le contexte technique, littéraire et
artistique qui fait le cadre des prémices du livre romantique ; à l’intérieur de ce cadre
éminemment historique, Balzac se distingue comme l’un des pionniers de la gravure en bois
de bout dans son expérience comme éditeur et imprimeur, ainsi que comme l’un des
premiers écrivains qui, à travers la formule du « type », ont pris de l’art pictural un
paradigme essentiel à la construction du personnage romanesque réaliste.
La deuxième partie de l’étude, en revanche, a démontré que la première période du
livre romantique s’attache à illustrer la scène plutôt que le personnage : fortement
influencés par le théâtre, les illustrateurs déclinent la formule du frontispice-scène et du
frontispice-portrait pathétique. L’édition illustrée Delloye et Lecou de La Peau de chagrin
relève de cette tendance : c’est l’illustration de la scène qui domine le livre, tandis que les
portraits jouent entre la représentation du type idéal et celle du véritable personnage de
roman, d’ailleurs pas aussi typique qu’on pourrait le croire. L’étude de La Peau de chagrin
illustrée a mis en évidence, grâce aussi au péritexte qui l’entoure, que la querelle entre les
écrivains et les illustrateurs, qui éclate dans les années 1840, possède des racines bien
antérieures : l’image connaît une croissance importante dans la valeur qui lui est attribuée,
en déterminant le succès ou l’échec d’un ouvrage ; la beauté des illustrations, qui
bénéficient des nouveaux procédés tels que le bois de bout et la lithographie, fascine les
lecteurs et les bibliomanes, et le texte semble passer à l’arrière-plan. Les romanciers comme
Balzac commencent à ressentir de la rivalité entre les deux mediums, et manifestent leur
222
contrariété dans les écrits privés, comme les lettres, ou, dans le cas de Pelletan, dans les
journaux.
À partir des observations contenues dans l’article de ce dernier, nous avons
approfondi la problématique qui entoure l’illustration : reléguée depuis longtemps au rôle
d’ornement typographique, l’illustration romantique revendique, comme le soutient Michel
Melot, un langage, un savoir, une connaissance différente de celle de l’écriture, qui
demande à être considéré en tant que tel.
Outre sa spécificité paratextuelle donc, nous retenons que l’illustration possède une
valeur iconotextuelle, où son rapport vis-à-vis du texte est décrit selon trois trois
perspectives : l’illustration est un contre-texte dans le cas d’une opposition au texte écrit ;
un alter-texte quand elle constitue un récit parallèle à celui de l’écrit, dépourvu de tout lien
avec ce dernier ; et un protexte lorsqu’elle semble traduire les mots en images, avec de
toutes petites variations visant à une prolongation ou à une ouverture du sens littéraire du
mot. Nous avons analysé ces trois valeurs à travers certains exemples extraits de La Peau de
chagrin mais aussi de l’Histoire de l’Empereur et des Physiologies balzaciennes, où la relation
instaurée entre le récit et l’illustration donne lieu à des situations complexes et intéressantes
pour le lecteur attentif.
Dans cette troisième partie, nous avançons dans la chronologie vers les années 1840,
décennie cruciale pour Balzac aussi bien que pour le livre romantique : les éditeurs
pionniers tels que Curmer et Hetzel favorisent la publication de livres collectifs que Walter
Benjamin258 a définis comme « littérature panoramique », laquelle s’impose à l’imaginaire du
lecteur grâce à l’idée de l’œuvre-musée, de l’œuvre-monde. C’est vraiment la construction
de l’œuvre totale et totalisante qui établit le lien entre la littérature panoramique et Balzac :
de fait le romancier exploite cette esthétique nouvelle dans l’invention de La Comédie
humaine, publiée entre 1842 et 1846 grâce à la synergie de quatre éditeurs, Furne, Paulin,
Dubochet et Hetzel. Enfin, nous verrons que l’aventure balzacienne dans le monde de
l’illustration s’achève avec les Petites Misères de la vie conjugale, version étendue d’un article de
l’auteur publié dans Le Diable à Paris. Le présent chapitre est donc dédié à l’étude des
contributions données par Balzac aux ouvrages qui composent la littérature panoramique :
Les Français peints par eux-mêmes, les Scènes de la vie privée et publique des animaux, La Grande
Ville, et Le Diable à Paris.
258 W. Benjamin, Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Paris, Payot, 1974, p. 55.
223
Plusieurs raisons nous ont poussée à consacrer un chapitre à cette partie de la
production balzacienne avant d’aborder l’édition Furne de La Comédie humaine.
D’un côté, nous sommes heureuse d’exploiter ce groupe d’ouvrage généralement peu
connus de Balzac, qui fournit néanmoins de nombreux points de réflexion, comme nous le
verrons au cours du chapitre. Les livres de la littérature panoramique sont d’autant plus
intéressants qu’ils démontrent, dans la plupart des cas, la présence d’un projet éditorial bien
défini qui coordonne la synergie du travail des écrivains et des illustrateurs rendant possible
une analyse plus précise de la relation entre les deux artistes, et des résultats obtenus. De
l’autre côté, nous voulons interroger l’hypothèse de Ségolène Le Men selon laquelle il
existerait une parenté entre le projet graphique des Français peints par eux-mêmes et celui de
La Comédie humaine dans la figure du personnage-type.
Les œuvres de la littérature panoramique peuvent être considérées à première vue
comme le lieu de la rencontre entre une illustration de type protextuelle et un récit qui
s’adresse explicitement aux images qui l’accompagnent ; pourtant, nous verrons que ce
n’est pas effectivement le cas, et que certains ouvrages entretiennent une relation très
compliquée avec l’illustration. Nous allons donc analyser en détail ce rapport, qui semble si
fécond, afin de détecter les éléments sur lesquels cette relation repose et qui pourraient
constituer un point de départ pour l’étude de La Comédie humaine illustrée.
7.1. Les Français peints par eux-mêmes et le paradigme du type « panoramique »
Les Français peints par eux-mêmes sont une œuvre collective recueillie en neuf volumes, parus
d’abord en livraison à partir de 1839 jusqu’à 1842. Balzac annonce à Mme Hanska sa
participation à l’ouvrage le lundi 15 juillet 1839 : « Je vous ne parle pas de L’Épicier, de La
Femme comme il faut, du Rentier, du Notaire, 4 figures que j’ai faites dans Les Français [peints
par eux-mêmes] de Curmer, vous lirez sans doute ces petites esquisses »259. La grande œuvre
de l’éditeur Léon Curmer est en chantier, mais Balzac, sûr que Mme Hanska lira cet
ouvrage, ne s’arrête pas à décrire le travail qu’il a fait pour rédiger ces articles.
C’est Jules Janin qui est chargé d’expliquer, dans l’« Introduction » au premier
volume, le projet qui a conduit à la réalisation de l’ouvrage :
Il faut bien toujours que les écrivains d’une époque rendent au public ce que le public
leur a prêté, et l’écrivain n’est jamais si heureux et si populaire lorsque le public lui a
259 H. de Balzac, LH, t.I, p. 491.
224
beaucoup demandé, et lorsqu’il a beaucoup rendu. […] Dans cette lanterne magique,
où nous nous passons en revue les uns et les autres, rien ne sera oublié, pas même
d’allumer la lanterne ; en un mot, rien ne manquera à cette œuvre complète, qui a pour
objet l’étude des mœurs contemporaines, et dont La Bruyère lui-même, notre maître à
tous et à bien d’autres, nous a en quelque sorte dicté le programme […].260
Cet extrait du texte de Janin donne beaucoup de points sur lesquels réfléchir.
Premièrement, la comparaison avec la lanterne magique, qui reviendra aussi dans Le Diable
à Paris, dont le frontispice représente le diable Flammèche avec une lanterne dans la main
gauche, nous rappelle la définition formulée par Walter Benjamin de « littérature
panoramique », dont la référence renvoie au procédé optique. Benjamin a décliné la
définition dans Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, où il explique que :
Quand l’écrivain s’était rendu au marché, il regardait autour de lui comme dans un
panorama. Un genre littéraire particulier a conservé ses premières tentatives pour
s’orienter. C’est une littérature panoramique. Ce n’est pas un hasard si Le Livre des
Cent-et-un, Les Français peint par eux-mêmes, Le Diable à Paris, La Grande Ville jouissent
des faveurs de la capitale en même temps que les panoramas. Ces livres sont faits
d’une série d’esquisses dont le revêtement anecdotique correspond aux figures
plastiques situées au premier plan des panoramas, tandis que la richesse de leur
information joue pour ainsi dire le rôle de la vaste perspective qui se déploie à
l’arrière-plan.261
Dans Paris, Capitale du XIXᵉ siècle, Benjamin revient sur cette suggestion et en poursuit la
définition : « Le premier plan élaboré visuellement, plus ou moins détaillé, du diorama
[variante du panorama] trouve son équivalent dans l’habillage feuilletonesque très profilé
qui est donné à l’étude sociale, laquelle donne ici un large arrière-plan analogue au
paysage »262.
Trois éléments font des livres indiqués par Benjamin une littérature panoramique : le
regard de l’écrivain, les esquisses de figures en série, et la présence d’un arrière-plan à la
façon d’un paysage.
260 Les Français peints par eux-mêmes, t.I, Paris, Curmer, 1840-1842, pp. I et XVI ; c’est nous qui soulignons. 261 W. Benjamin, Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Paris, Payot, 1974, p. 55 ; c’est nous qui soulignons. 262 W. Benjamin, Paris, Capitale du XIXᵉ siècle, Paris, Cerf, 1989, p. 547 ; c’est nous qui soulignons.
225
Le thème de la puissance du coup d’œil des artistes devient effectivement de plus en
plus prégnant dans ces ouvrages. C’est Balzac lui-même qui célèbre le pouvoir de cet
organe, quand il écrit dans Le Diable à Paris que la grandeur de Paris vient des trois faces du
même problème : « Savoir vendre, pouvoir vendre, et vendre » ; l’écrivain est vraiment,
comme le suggère Benjamin, au centre d’un immense marché, où le cœur de la vision est
l’art même du regard :
Il ne s’agit encore que de plaire à l’organe le plus avide et le plus blasé qui se soit
développé chez l’homme depuis la société romaine, et dont l’exigence est devenue
sans bornes, grâce aux efforts de la civilisation la plus raffinée. Cet organe, c’est l’œil
des Parisiens !... Cet œil consomme des feux d’artifice de cent mille francs, des palais
de deux kilomètres de longueur sur soixante pieds de hauteur en verres multicolores,
des féeries à quatre théâtres tous les soirs, des panoramas renaissants, des expositions
continuelles, des mondes de douleurs, des univers de joie en promenade sur les
boulevards ou errants par les rues ; des encyclopédies de guenilles au carnaval, vingt
ouvrages illustrés par an, mille caricatures, dix mille vignettes, lithographies et
gravures. Cet œil lampe pour quinze mille francs de gaz tous les soirs ; enfin, pour le
satisfaire, la Ville de Paris dépense annuellement quelques millions en points de vue et
en plantations.263
Cet organe, représenté comme un être qui dévore tout, à la manière de la ville-monstre de
La Fille aux yeux d’or, est la lampe magique, ce qui éclaire la vision des artistes qui dessinent
le panorama de la ville en exposition. La marchandise que l’œil de l’artiste cherche à
restituer est la figure humaine qui se campe devant lui : le type.
Le type est le véritable centre de la littérature panoramique, le sujet qui rend possible
l’unité de ces ouvrages fragmentés comme des feuilletons. Non seulement parce qu’il pose
la question de l’identité, nationale dans le cas des Français, mais aussi « la relation dialectique
du même et de l’autre » à travers laquelle « c’est le couple matriciel universel-individuel,
fondement de l’esprit des Lumières, qui est en cause : loin de s’opposer, ces termes se
supposent l’un l’autre ; c’est par l’universel et non malgré lui que peuvent se penser et se
définir les différences individuelles »264.
263 Le Diable à Paris, t. I, Paris, Hetzel, 1844-1845, pp. 289-290 ; c’est nous qui soulignons. 264 N. Preiss et V. Stiénon, « ʺCroqués par eux-mêmesʺ. Le panorama à l’épreuve du panoramique » dans Interférences littéraires/ Literaire interrferenties, n.8, « Croqués par eux-mêmes. La société à l’épreuve du
ʺpanoramiqueʺ », Nathalie Preiss et Valérie Stiénon dir., mai 2012, p. 9.
226
Autour de la figure typique se déroulent les projets qui relèvent de la tradition des
études de mœurs des années 1830, écrites ou illustrées par les albums lithographiques et la
caricature. Toutefois, le mérite spécifique des Français peints par eux-mêmes est celui d’avoir su
créer un cadre typographique, outre que textuel, bien défini et ordonné, capable de
construire l’immense musée des types français, de Paris et de Province, en recueillant toutes
les galeries qui le composent sous un seul édifice. Ces règles de construction sont
fondamentales, et c’est à partir d’elles que nous allons détecter une unité de mesure qui
nous permet d’identifier les constructions originelles que nous trouverons dans les autres
ouvrages panoramiques : nous tenterons de saisir le modèle imparti par Les Français peints
par eux-mêmes comme point d’arrivée de la tradition précédente et, en même temps, comme
point de départ pour la littérature illustrée de 1840.
Or, il suffit d’ouvrir Les Français à la table des matières pour reconnaître la nouveauté
que l’œuvre amène en soi : chaque article est organisé autour d’un type présenté à travers le
seul nom commun – L’Épicier, La Femme comme il faut, etc. – et développé selon la
méthode physiologique. Mais, contrairement à ce que nous avons vu dans le chapitre dédié
aux physiologies balzaciennes, les illustrations qui paraissent dans les textes trouvent elles
aussi un certain ordre dans le paratexte et dans l’espace de la page : dans la table des
matières toutes les illustrations contenues dans le livre sont cataloguées, avec le nom de leur
illustrateur et de leur graveur. De plus, à côté du nom du type éponyme de l’article on
trouve aussi, en petit format, l’illustration du type reproduite en forme de planche hors-
texte au début de chaque article. Non seulement donc on commence à reconnaître aux
illustrateurs et aux graveurs la valeur artistique de leurs dessins, qui ont le même statut que
les récits, mais la relation entre le texte et l’image est vraiment encouragée par cette
disposition de la table de matières, qui renforce le binôme mot-image : l’un ne peut pas être
pensé sans l’autre.
Pour que l’unité de composition tienne, il faut d’abord penser à un schéma fixe de
l’image : dans chaque article est insérée une planche hors-texte en façon de frontispice, qui
représente le type en question ; une vignette en tête de page, esquissant une scène ou un
site, comme la boutique de l’épicier de Balzac ; une lettrine ; un cul-de-lampe ; et des
vignettes in-texte de format variable. Mais ce qui complète de manière définitive la
cohésion de cette structure, ce qui permet le lien étroit entre texte et image est l’affirmation
227
d’une règle de composition pour ce que nous avons appelé dans notre chapitre 3 le « type
iconique », qui concerne le type illustré autant que le type décrit :
La réussite du livre tient à la simplicité de sa formule : une série calibrée de livraisons
confiées à une pluralité d’auteurs et d’illustrateurs, qui produisent une galerie dédiée
aux « types » français contemporains. Le terme désigne le personnage que dépeignent
simultanément la plume et le crayon et que nomme le titre de l’article. Mais il instaure
surtout une nouvelle forme d’image. Si le mot est apparu auparavant dans les titres des
séries de caricatures de Traviès, Grandville et Daumier, c’est le livre de Curmer qui
définit, dès les premières livraisons illustrées par Gavarni, la catégorie visuelle valorisée
par le portrait en pied, en renonçant d’emblée à la présentation « en tête » de Heads of
the People, comme l’annonce la préface de Janin […]. Planche à part, le « type » est aussi
une catégorie d’image, un « genre » propre au livre illustré, que mettent en évidence
tant le système des emplacements que l’effet de série, comme le rappellent les
vignettes superposées de la table des matières, qui ne sont pas sans évoquer les
silhouettes projetées tour à tour par le dispositif optique de la lanterne magique.265
Si le type en mots s’appuie sur tous les éléments du paraître – apparence physique,
vêtements, langage, comportement, habitudes – l’illustration ne peut qu’exploiter seulement
les deux premiers. D’où la nécessité d’établir un cadre de composition unitaire.
C’est Ségolène Le Men qui a consacré une étude rigoureuse à cette règle de
composition graphique, en mettant en lumière les aspects saisissants des types illustrés :
Chaque planche montre une figure isolée, en pied, masculine ou féminine,
particularisée par son costume et les accessoires qui peuvent le compléter. […] Le
motif surgit en silhouette au centre de la page blanche. Dans cet espace abstrait et
indéterminé, la figure flotte hors de tout lieu. La lumière lui apporte le seul élément
d’indication spatiale, par l’ombre portée, légère et ténue, que projette obliquement le
bas du personnage et qui permet de modeler l’espace par un artifice de gravure : le sol
est gravé en tailles parallèles horizontales, tandis que le mur du fond est suggéré par
des tailles verticales.266
Voilà donc les constantes qui créent l’effet de série, mais qui permettent en même temps
l’insertion des variables, comme l’originalité des costumes, qui respectent l’unicité du type.
265 S. Le Men, Pour rire! Daumier, Gavarni, Rops, op. cit., pp. 129-131. 266 Ibid., p. 132.
228
Cette coopération entre texte et image émerge clairement dans les articles de Balzac,
qui semblent se glisser aisément dans cette structure.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 3, Balzac commence à réfléchir au concept
de type très tôt : il cherche une définition et un paradigme de construction pour ses
personnages typiques. Or, nous avons remarqué comment la critique a souvent mis en
évidence tant les ambiguïtés que les points de force de ce concept. La définition de « type »
est essentiellement « ouverte », « fluide », dans le sens que même si elle présente des
imperfections du point de vue de la théorie, elle reste sur les personnages balzaciens une
étiquette efficace : le père Goriot, Vautrin, Rastignac, seront toujours les types-étendard de
leur catégorie typique, première chaine d’une série de personnages de même facture et, en
même temps, originaires. La critique essaie parfois de classer ces types, et les catégories des
Français peints par eux-mêmes sont très utiles pour ce travail : je pense notamment au
catalogue de l’exposition Balzac romancier des femmes267.
Effectivement, l’exemple que nous allons voir pour l’analyse des Français montre bien
que cette parenté avec La Comédie humaine existe. Parmi les cinq articles rédigés par Balzac
pour Les Français, les personnages de la Femme de province et de la Femme comme il faut
retiennent notre attention en raison du fait que ces articles seront portés presque
entièrement à l’intérieur de deux récits de La Comédie humaine : La Muse du département et
Autre étude de femme.
Le rapport entre La Muse du département et « La Femme de province » se défini comme
un rendez-vous manqué : l’édition Furne de La Comédie humaine ne contient pas
d’illustrations pour Dinah Piédefer, ce qui ne permet pas de faire une comparaison entre
l’ « individu-typisé », Dinah, et le type construit dans Les Français peints par eux-mêmes.
La relation entre l’article « La Femme comme il faut » des Français et la nouvelle Autre
étude de femme, au contraire, est plus complexe. « Puzzle » de contes d’origines différentes268,
Autre étude de femme paraît dans l’édition Furne, en 1842. La séquence sur la femme comme
267 Catalogue rédigé par É. Gaborit, M. Labouret, I. Lamy, à l’occasion de l’exposition du Musée de Saché, 3 octobre 2015 – 3 janvier 2016, Tours, Conseil départemental d’Indre-et-Loire, 2015. 268 Ce terme, que nous empruntons à Nicole Mozet, est prégnante : Autre étude de femme réunit plusieurs fragments provenant d’Une conversation entre onze heures et minuit, des Contes brunes et d’autres textes hétéroclites rédigés entre 1838 et 1842, parmi lequel le plus célèbres est La Grande Bretèche. Voir N. Mozet, « Introduction à Autre étude de femme », Pl, t.III, pp. 657-671. Voir aussi C. Massol, « Transfert d’écriture : le réemploi de La Grande Bretèche, dans Balzac, oeuvres complètes : Le moment de « La Comédie humaine », Claude Duchet et Isabelle Tournier (dir.), Vincennes, PU Vincennes, 1995, pp. 203-216 ; M. Lavagetto, La macchina dell’errore, Torino, Einaudi, 1996.
229
il faut constitue un intermezzo entre le premier et le deuxième récit, et reproduit
intégralement l’article des Français, inséré dans le cadre d’une situation mondaine : le salon
de Félicité des Touches, la « femme auteur » de La Comédie humaine, où un groupe restreint
d’intimes se réunit après le « raout ». Henry de Marsay, « nommé Premier Ministre depuis
six mois »269, prend la parole, et raconte son premier amour. À la fin de l’histoire, Lady
Dudley s’exclame : « Je connais la femme de qui M. de Marsay nous a conté l’histoire, et
c’est une de vos dernières grandes dames !... »270. De Marsay et Émile Blondet rebondissent
sur ce mot, en dénonçant la ruine de toute distinction sociale qui n’a pas épargné la
femme :
Quelque terrible que soient ces paroles, disons-le : les duchesses s’en vont, et les
marquises aussi ! […] Napoléon n’a pas deviné les effets de ce Code qui le rendait si
fier. Cet homme, en créant ses duchesses, engendrait nos femmes comme il faut
d’aujourd’hui, le produit médiat de sa législation. […] Cette femme, sortie des rangs de
la noblesse, ou poussée de la bourgeoisie, venue de tout terrain, même de la province,
est l’expression du temps actuel, une dernière image du bon goût, de l’esprit, de la
grâce, de la distinction réunis, mais amoindris. Nous ne verrons plus des grandes
dames en France, mail il y aura pendant longtemps des femmes comme il faut,
envoyées par l’opinion publique dans une haute chambre féminine, et qui seront pour
le beau sexe ce qu’est un gentleman en Angleterre.271
C’est à ce point qu’Émile Blondet se charge de la description de la femme comme il faut,
laquelle correspond à l’incipit de l’article des Français peints par eux-mêmes : « Par une jolie
matinée, vous flânez dans Paris. Il est plus de deux heures mais cinq heures ne sont pas
sonnées. Vous voyez venir à vous une femme, le premier coup d’œil jeté sur elle est comme
la préface d’un beau livre, il vous fait pressentir un monde de choses élégantes et fines »272.
Deux grandes différences existent donc entre les deux textes.
D’abord, un changement substantiel concerne le narrateur et, par conséquence, la
structure même du texte. Dans l’article des Français, la construction de la figure de la femme
comme il faut se construit à travers le récit du Balzac flâneur-narrateur ; l’écrivain y emploie
ses habilités physiognomoniques pour détecter le type de femme qu’il a croisé sur sa route.
269 H. de Balzac, Autre étude de femme, Pl, t.III, p. 676. 270 Ibid., p.689 ; c’est nous qui soulignons. 271 Ibid., pp. 689 et 691-692. 272 H. de Balzac, Autre étude de femme, p. 692 et Id., « La Femme comme il faut » dans Les Français peints par eux-mêmes, p. 25.
230
Dans la nouvelle Autre étude de femme, par contre, le même texte est transformé en dialogue
polyphonique : c’est Émile Blondet qui dresse l’inventaire des caractéristiques de la femme
comme il faut, mais toujours en formule de réponse aux questions posées par les amis
réunis avec lui chez Félicité des Touches.
Deuxièmement, l’incipit et la conclusion se trouvent inversés : le paragraphe
conclusif de « La Femme comme il faut » correspond, sauf de toutes petites variations
faites en raison de la modification de la voix narrante, à l’incipit du paragraphe consacré à
ce type féminin dans Autre étude de femme. C’est un détail essentiel, car cette inversion invite
à interpréter les deux textes de manière complètement différente : alors que « La Femme
comme il faut » s’ouvre sur la fascination suscitée par la belle inconnue, dernière lueur enfin
d’un monde qui s’éteint, le même personnage-type assume une connotation négative dans
Autre étude de femme, où la femme comme il faut est présentée comme la parente pauvre de
la grande dame, dernier signe d’un ordre social perdu ; « l’éventail de la grande dame est
brisé. La femme n’a plus à rougir, à médire, à chuchoter, à se cacher, à se montrer, l’éventail
ne sert plus qu’à s’éventer, et quand une chose n’est plus que ce qu’elle est, elle est trop
utile pour appartenir au luxe »273.
Voyons maintenant de plus près la description la figure de la Femme comme il faut :
Elle ne porte ni couleurs éclatantes, ni bas à jour, ni boucle de ceinture trop travaillée,
ni pantalons à manchette brodées bouillonnant autour de sa cheville. Vous remarquez
à ses pieds soit des souliers de prunelle à cothurnes croisés sur un bas de coton d’une
finesse excessive ou sur un bas de soie uni de couleur grise, soit des brodequins de la
plus grande exquise simplicité. Une étoffe assez jolie et d’un prix médiocre vous fait
distinguer sa robe dont la façon surprend plus d’une bourgeoise : c’est presque
toujours une redingote attachée par des nœuds et mignonnement bordée d’un ganse
ou d’un filet imperceptible. L’inconnue a une manière à elle de s’envelopper dans un
châle ou dans une mante, elle sait se prendre de la chute des reins au col, en dessinant
une sorte de carapace qui changerait une bourgeoise en tortue, mais sous laquelle elle
vous indique les plus belles formes, tout en les voilant. […] Doit-elle à un ange ou à
un diable cette ondulation gracieuse qui joue sous la longue chape de soie noire, en
agite la dentelle au bord, répand un baume aérien, et que je nommerais volontiers la
brise de la Parisienne ? Vous reconnaîtrez sur les bras, à la taille, autour du cou, une
science de plis qui drape la plus rétive étoffe, de manière à vous rappeler la
273 H. de Balzac, Autre étude de femme, p. 690 ; c’est nous qui soulignons.
231
Mnémosyne antique. Ah ! comme elle entend, passez-moi cette expression, la coupe de
la démarche ! Examinez cette façon d’avancer le pied en moulant la robe avec une si
décente précision, qu’elle excite chez le passant une admiration mêlée de désir, mais
comprimée par un profond respect.274
Le crayon de Gavarni, maître du dessin des femmes en tant qu’illustrateur pour La Mode
comme nous l’avons vu dans le chapitre 3 de notre étude, évoque bien l’image de la Femme
comme il faut esquissée par Balzac dans les Français : la description de l’écrivain, qui
commence par tout ce que la Femme comme il faut ne porte pas, souligne ce que le lecteur-
spectateur ne devrait pas voir dans l’illustration, à savoir des « couleurs éclatantes », « bas à
jour » ou « pantalons à manchettes brodées » ; et, en effet, rien de tout cela ne se retrouve
dans la gravure. La Femme comme il faut est saisie dans l’acte de marcher, avec la pointe
du pied droit qui ressort de la jupe. L’étoffe paraît simple, avec de tout petits motifs
floraux. Le châle, bordé de fourrure, enveloppe le buste de la femme, qui avance d’un air
impassible. L’idée du mouvement est donnée aussi par les mains, qui arrangent les manches
de la robe. Un chapeau très simple encadre enfin le visage de l’inconnue. Le « type
iconique », comme nous l’avons défini dans le chapitre 3 de notre étude, est ainsi créé.
Figure 162 : Planche pour « La Femme comme il faut », Les Français peints par eux-mêmes
Quelques lignes plus loin, le narrateur donne aussi des détails sur le comportement et
le langage de la femme comme il faut ; les comparaisons et les métaphores employées dans
274 H. de Balzac, « La Femme comme il faut » dans Les Français peints par eux-mêmes, t.I, pp. 25-26 ; c’est nous qui soulignons.
232
le récit relèvent de trois catégories : on y trouve des connexions avec le monde animal et
végétal – la femme comme il faut est une fleur rare, une rose, une belle-de-nuit, et elle
ressemble à une papillon dans sa toilette de bal ; des allusions au monde littéraire et
artistique, telles que les Vierges de Raphaël et la Béatrice de Dante ; enfin, un groupe
d’appellatifs qui définissent sa particularité, d’être une « adorable trompeuse », car la femme
comme il faut est une comédienne consommée275.
Or, ces expressions, qui se retrouvent également dans Autre étude de femme, suscitent
une impression bien différente quand on passe de l’article des Français à la nouvelle de La
Comédie humaine : dans le salon de Mlle des Touches, des femmes de la valeur de la marquise
d’Espard, de lady Dudley et de la princesse de Cadignan sont à l’écoute de Blondet et de
Marsay : dans le contexte de l’œuvre-monde de La Comédie humaine, où le mécanisme du
retour du personnage permet au lecteur de se souvenir des aventures racontées, ou qui vont
être narrées, dans les récits précédents ou suivants, l’histoire de ce trois femmes rend
encore plus concrète l’image de la femme comme comédienne.
Enfin, la princesse de Cadignan prend la parole et intervient dans le dialogue :
Sommes-nous donc si réellement diminuées que ces messieurs le pensent ? Dit la
princesse de Cadignan en adressant un sourire à la fois douteur et moqueur. Parce
qu’aujourd’hui, sous un régime qui rapetisse toutes choses, vous aimez les petits plat,
les petits appartements, les petits tableaux, les petits articles, les petits journaux, les
petits livres, est-ce à dire que les femmes seront aussi moins grandes ? Pourquoi le
cœur humain changerait-il parce que vous changez d’habit ? A toutes les époques les
passions seront les mêmes.276
Il s’ensuit une liste de noms, ou mieux de comparaisons :
Je sais d’admirables dévouements, de sublimes souffrances, auxquelles manque la
publicité, la gloire si vous voulez, qui jadis illustrait les fautes de quelques femmes.
Mais pour n’avoir pas sauvé un roi de France, on n’en est pas moins Agnès Sorel.
Croyez-vous que notre chère marquis d’Espard ne vaille pas Mme Doublet ou Mme
275 H. de Balzac, « La Femme comme il faut » dans Les Français peints par eux-mêmes, p. 27 : « L’adorable trompeuse use des petits artifices politiques de la femme avec un naturel qui exclut toute idée d’art et de préméditation ». 276 H. de Balzac, Autre étude de femme, pp. 701-702.
233
de Deffand, chez qui l’on disait et l’on faisait tant de mal ? Taglioni ne vaut-elle pas
Camargo ? Malibran n’est-elle pas égale à la Sainte-Huberti ?277
La réplique de la princesse de Cadignan, qui ne figure pas dans l’article des Français, est
poignante : elle remet en discussion tout ce que de Marsay et Blondet avaient soutenu
jusque-là, en répondant aussi à l’accuse implicite que le discours des gentilhommes
contenait à leur égard, et en apportant une série de comparaison à l’appui de sa thèse. Un
dernier coup : dans la citation précédente, nous avons souligné les comparants et les
comparées cités par la princesse de Cadignan ; toutefois, une femme, Agnès Sorel, la
première « favorite officielle » d’un roi français, et don la grande dame par antonomase,
reste sans comparé.
Notre hypothèse est que c’est la princesse de Cadignan elle-même qui recueille
l’héritage de cette première grande-dame. La princesse se pose comme le dernier
représentant de cette catégorie et, en même temps, comme le chef de file de la figure
« toute moderne » de la femme comme il faut, car elle détient les trois caractéristiques
essentielles de ces deux figures : elle appartient à la noblesse ; elle est l’une des femmes les
plus belles parmi les personnages féminins de Balzac ; et, surtout, la princesse de Cadignan
est la comédienne par excellence de l’univers balzacien278. Nous l’avons déjà développée
ailleurs cette hypothèse279, en en nous appuyant sur une analyse des comparaisons textuels
utilisées pour le personnage de Diane et pour celui de la femme comme il faut ; ce qu’il
nous intéresse ici, c’est de voir si et dans quelle mesure l’illustration confirme notre lecture.
Nous avons dit que l’édition Furne ne contient pas d’illustration pour Autre étude de
femme ; par contre, comme nous le verrons en détail dans le chapitre suivant, deux
illustrations ont été consacrées au personnage de Diane. Nous Nous avions d’abord cru
possible de mettre en regard les deux images au niveau du « type iconique », c’est-à-dire sur
la figure, la silhouette que l’image représente. Or, nos prévisions se brisent devant les deux
illustrations de Diane, qui ne reproduit absolument pas la silhouette de « La Femme
comme il faut » de Gavarni : la Diane de Bertall pour Le Cabinet des Antiques et celle de
277 Ibidem ; c’est nous qui soulignons. 278 Don Juan en jupe, la princesse de Cadignan est bien la Diane de Maufrigneuse qu’on retrouve, entre les autres, dans Le Cabinet des Antiques, Splendeurs et misères des courtisanes et Une Ténébreuse affaire. 279 Nous avons consacré la deuxième section de notre mémoire de master à l’étude de cette comparaison. Voir S. Baroni, Le apparenze sociali in Honoré de Balzac, mémoire de master sous la dir. de Daniele Giglioli et la co-direction d’Alberto Castoldi, soutenu chez l’Université de Bergame, Italie, le 29 avril 2015.
234
« CH »280 dans Les Secrets de la princesse de Cadignan sont, dans la première œuvre, assises
dans leur boudoir, et, dans la deuxième, debout, à trois-quarts, à côté d’un meuble. Elles ne
paraissent jamais à figure entière comme la femme comme il faut de Gavarni, ni en veste de
promeneuse. Ce sont tout à fait d’autres personnages balzaciens qui ont bénéficié de
l’influence du type iconique de la femme comme il faut : la duchesse de Langeais, par
exemple, qui présente la version mondaine du type dans sa toilette de bal, la point du pied
visible, la grâce et l’élégance émanant de sa figure.
Non, Diane n’hérite pas la figure de la femme comme il faut : elle revendique une
originalité que d’autres femmes balzaciennes ne possèdent pas ; de ce fait, son illustration
réponde à cette singularité, en refusant de la typiser dans les vêtements de la femme comme
il faut. De surcroît, dans l’illustration pour Les Secrets de la princesse de Cadignan s’y trouve un
détail très particulier, qui nous amène à formuler une suggestion étayant notre hypothèse :
c’est la seule illustration de La Comédie humaine du Furne où un personnage féminin tient
bien en vue, avec fierté, son éventail à la main. Objet de référence pour notre enquête
indiciaire, marchandise reparaissant dans La Comédie humaine comme signe d’un passé
glorieux perdu281, l’image illustrée de l’éventail, nous semble-t-il, consacre la princesse de
Cadignan dans son rôle de dernière grande dame du XIXᵉ siècle. Certes, nous n’avons
aucune épreuve que l’illustrateur ait mis volontairement un éventail dans les mains de la
princesse pour la distinguer des femmes comme il faut de La Comédie humaine ; toutefois, la
coïncidence est au moins curieuse : peut-être ne suffit-elle pas à soutenir notre hypothèse,
mais la légitimité de notre intuition prend indiscutablement de l’envergure. Là, l’illustration
démontre l’ampleur et la subtilité des jeux possibles entre le texte et l’illustration, mais aussi
entre les images eux-mêmes.
280 L’illustrateur des Secrets de la princesse de Cadignan reste aujourd’hui encore non-identifié, nous n’avons que sa signature, « CH CH ». 281 Image paradigmtique est l’éventail peint par Watteau que Pons offre à sa cousine, Mme de Marville ; voir H. de Balzac, Le Cousin Pons, Pl, t.VII.
235
Figure 163 et 164 : Bertall, La Duchesse de Langeais, et Ch.Ch (?), La Princesse de Cadignan, La Comédie humaine, t.IX et XI, éd. Furne, 1843 et 1844
Les Français peints par eux-mêmes établissent un modèle de référence essentiel à toute la
littérature panoramique, grâce à l’équilibre qu’y trouvent le texte et l’image. Pourtant, nous
avons vu comment ce modèle n’est pas universellement adopté : Diane de Maufrigneuse, et
avec elle quelques autres personnages illustrés de l’édition Furne de La Comédie humaine,
échappe au « type iconique » élaboré par Les Français peints par eux-mêmes. Nous allons voir
maintenant d’autres exemples de la littérature panoramique à laquelle Balzac a participé, et
nous montrerons, plus particulièrement, comment les illustrations contiennent des
éléments de continuité et, à la fois, de rupture avec l’esthétique des Français. Les Scènes de la
vie privée et publique des Animaux, La Grande Ville et Le Diable à Paris, tous publiés chez
Hetzel, éditeur-pionnier et écrivain lui-même, ne réussirent pas à mettre en pratique le
modèle de Curmer ; chacun de ces ouvrages montre des schèmes différents, qui n’arrivent
pas à établir le même équilibre entre auteur et illustrateur, avec des conséquences
considérables sur le plan de la relation entre texte et image.
236
7.2. Les métamorphoses du type panoramique dans les Scènes de la vie privée et
publique des animaux
Publiées entre 1840 et 1842, d’abord en livraisons et puis sous forme de livre en deux
volumes, les Scènes de la vie privée et publique des animaux sont filles des Français peints par eux-
mêmes tout d’abord pour leur système de construction « panoramique ». L’ouvrage est
composé par une chaîne de scènes de mœurs écrites par différents écrivains – Stahl, Balzac,
Sand, Nodier, Janin, Baude, de la Bédollierre et Bernard – et fondées sur la répétition de
certains éléments narratifs clés : le personnage principal est toujours un animal, qui raconte
son histoire à la première personne ; la comparaison entre l’Homme et l’Animal joue sur
l’effet miroir282. L’unité des scènes panoramiques est garantie d’un côté par le choix d’un
illustrateur unique, Grandville, qui assure une continuité graphique stable, et de l’autre côté
par le récit encadrant de l’éditeur, Pierre-Jules Hetzel, qui, sous le pseudonyme de P.-J.
Stahl, conte la révolution des animaux au Jardin des Plantes dans le récit introductif du
livre, et il intervient à chaque fois que la narration nécessite de rappeler la suprastructure de
l’œuvre. La réussite de la construction panoramique de l’ouvrage s’appuyant sur le
mécanisme de l’identification des écrivains avec leurs animaux est soulignée par Hetzel-
Stahl dans la petite préface qui précède le « Prologue – Résumé parlementaire », où il décrit
ce mécanisme comme une construction originale propre à cet ouvrage :
Nous avons cru bien faire, et nous avons bien fait, de partager notre tâche, et d’en
confier la partie la plus lourde et la plus difficile aux écrivains éminents qui ont bien
voulu donner à ce livre l’appui de leurs noms et de leur talent. […] Nous savons qu’en
s’associant à notre idée, ils ont trouvé le moyen de se l’approprier, chacun à sa façon,
et de la relever de toute la grandeur de leur talent : nous sommes heureux ici de le
reconnaître. […] Jusqu’à présent, en effet, dans la fable, dans l’apologue, dans la
comédie, l’Homme avait été toujours l’historien et le raconteur. Il s’était toujours chargé
de se faire à lui-même la leçon, et ne s’était point effacé complétement sous l’Animal
dont il empruntait le personnage. Il était toujours le principal, et la Bête l’accessoire et
comme la doublure ; c’était l’homme enfin qui s’occupait de l’Animal ; ici c’est
l’Animal qui s’inquiète de l’Homme, qui le juge en se jugeant lui-même. Le point de
vue, comme on voit, est changé. Nous avons différé enfin en ceci, que l’Homme ne
282 Je renvoie ici à l’excellente analyse de l’œuvre faite par B. Lyon-Caen et M.-E. Thérenty, « Balzac et la littérature zoologique. Sur les Scènes de la vie privée et publique des Animaux » dans La Comédie animale : le bestiaire balzacien, Aude Déruelle dir., Actes de la journée d’études de juin 2009, publiés sur le site internet du GIRB : http://balzac.cerilac.univ-paris-diderot.fr/bestiaire.html
237
prend jamais la parole de lui-même, qu’il la reçoit au contraire de l’Animal devenu à
son tour le juge, l’historien, le chroniqueur, et, si l’on veut, le chef d’emploi.283
C’est encore Stahl qui met au centre de ce projet Grandville, en affirmant que :
Notre pensée, en publiant ce livre, a été d’ajouter la parole aux merveilleux Animaux
de Grandville, et d’associer notre plume à son crayon, pour l’aider à critiquer les
travers de notre époque, et, de préférence parmi ces travers, ceux qui sont de tous les
temps et de tous les pays. Nous avons cru que, sous le couvert des Animaux, cette
critique à double sens, où l’Homme se trouve joint à l’Animal, sans perdre de sa
justesse, de sa clarté et de son à-propos, perdrait tout au moins de cette âpreté et de ce
fiel qui font de la plume du critique une arme si dangereuse et parfois si injuste dans
les mains du mieux intentionné.284
La préface de Hetzel-Stahl paraît donc l’étendard hissé au-dessus de l’œuvre-musée, où
tous les éléments structuraux de l’édifice semblent bien proportionnés et harmonisés.
Or, cela n’est pas complètement vrai. Les Scènes de la privée et publique des animaux sont
l’œuvre la plus complexe et la plus problématique dans l’ensemble du groupe de la
littérature panoramique que nous sommes en train d’analyser, du point de vue non
seulement de la relation entre le texte et l’image mais, surtout, des rapports de force entre
l’illustrateur, l’éditeur et les écrivains. Les Animaux cachent un champ de forces centrifuges
qui luttent pour s’affirmer les unes sur les autres ; c’est l’exemple paradigmatique d’une
illustration de type contre-textuelle, comme nous allons le voir dans l’analyse des articles de
Balzac.
Tout d’abord, il faut relire la préface de Hetzel à la lumière du péritexte qui gravite
autour des Animaux, par lequel une démarche complètement différente dans la
construction du livre émerge de celle décrite par l’éditeur. Si Hetzel présente le crayon de
Grandville comme le centre du projet, où les plumes des romanciers ne sont que des
associées, les lettres envoyées de l’éditeur aux écrivains participant à l’ouvrage témoignent
exactement du contraire. Dans une lettre à Alfred de Musset, Hetzel lui envoie une liste
d’animaux en l’invitant à choisir ses « bêtes » :
283 P.-J. Stahl, Préface aux Scènes de la vie privée et publique des animaux, Paris, Hetzel et Paulin éditeurs, 1842, non paginé. 284 Ibidem.
238
Ne croyez-vous pas qu’il serait possible de trouver parmi toutes ces bêtes une bête à
votre convenance ! Je vous donne la liste ici de celles qui me paraissent plus
particulièrement vous agréer. […] Pourriez-vous quand vous aurez arrêté votre choix,
ou tout au moins quand vous aurez prononcé vos exclusions, me renvoyer les noms
des bêtes dont vous ne voulez rien faire pour que je puisse les offrir au choix de M.
Nodier et de Balzac.285
En outre, le contrat entre Hetzel et Grandville retrouvé par Philippe Kaenel montre que la
quantité des illustrations à insérer dans le deuxième volume avait été préfixée avant la
rédaction de ce dernier : Grandville doit dessiner 50 vignettes représentant des scènes, et 50
vignettes pour les types métamorphosés. Ce n’est donc pas la plume qui a été soumise au
crayon mais l’inverse, comme d’habitude.
De même, la correspondance balzacienne témoigne de ce travail fondé sur le choix
de sujets, de personnages et de scène. Mais aussi, et c’est le point essentiel, elle témoigne du
fait que Grandville devait attendre l’article de l’écrivain avant de commencer à dessiner. Le
7 mai 1842, Hetzel écrit à Balzac :
Si vous avez fini votre article pour moi soyez assez bon pour l’envoyer à Grandville et
vous serez bien plus aimable encore si vous allez vous-même chez ce Chinois-là vous
l’endoctrineriez pour les vignettes. Vous lui diriez tout ce que vous savez dire aux gens
desquels vous obtenez ce qu’ils ne veulent pas donner.
À ce moment-là, Balzac devait rédiger le dernier article pour Les Animaux, « Les Amours de
deux Bêtes », paru au deuxième volume de l’œuvre dans la même année. L’extrait de la
lettre semble faire allusion à une querelle entre Balzac et Grandville, probablement pendant
la rédaction du premier volume des Animaux.
Balzac n’était sûrement pas tout à fait enthousiaste de cette collaboration avec Hetzel
et Grandville ; mais il avait quand même accepté d’en faire partie pour gagner de l’argent,
dont il avait fort besoin après l’insuccès de ses pièces théâtrales et avec la publication de La
Comédie humaine en vue. Mais au peu enthousiasme de l’auteur se joint un jugement
totalement négatif, quand le 22 janvier 1843 Balzac écrit à Mme Hanska que :
285 Dossier Hetzel au département des Manuscrits de la BNF. Correspondance Musset, NAF. 71. Cit. dans : B. Lyon-Caen et M.-E. Thérenty, « Balzac et la littérature zoologique. Sur les Scènes de la vie privée et publique des animaux », art. cit., p. 3.
239
Je vous sacrifie un billet de mille francs qu’on me donne pour 16 pages grandes comme
celles-ci et intitulées : Voyage de découverte exécuté dans la rue Richelieu, pour un de ces
ouvrages stupides comme La vie privée des Animaux, qui se vendent à 25 000
exempl[aires] à cause des vignettes, et où j’ai fait Les Peines de cœur d’une chatte anglaise,
une des plus charmantes bouffonneries qui soient sorties de la plume qui ne devrait
s’occuper qu’à vous exprimer non pas ce que pense, mais ce que sent celui qui la tient.
Le sacrifice se trouve dans l’horrible nécessité où je suis de ce susdit billet de mille
franc.286
Les Animaux sont une œuvre « stupide », qui ne se vend que pour les vignettes de
Grandville. D’un côté donc, nous notons le mécontentement de Balzac, qui ressent de
l’injustice à voir les illustrations préférées à ses « charmantes bouffonneries » telles qu’il
définit les Peines de cœur d’une Chatte anglaise.
De l’autre, Grandville lui-aussi, l’un des illustrateurs qui a affirmé avec grande
fermeté l’indépendance de l’illustration et de l’illustrateur vis-à-vis des écrivains, ne semble
pas du tout content d’être soumis aux ordres d’Hetzel et de ses Plumes. La Révolution des
Animaux annonce celle du Crayon, que nous avons déjà lue, dans le passage initial d’Un
Autre Monde, cité dans notre chapitre 5, le Crayon prenant la clé de champs. Là Grandville a
pu exprimer en toute liberté son art et sa pensée, libre de toute ingérence de l’éditeur ou de
quelque plume indiscrète. Nous n’avons pas dévoilé la fin du livre, qui est significative
autant que le début : après une nouvelle querelle entre la Plume et le Crayon, qui se
disputent sur la valeur artistique d’Un Autre Monde, le Canif intervient pour restaurer la paix.
Le cul-de-lampe, toutefois, représente le Crayon à la hauteur des initiales du nom de
Grandville, tandis que la Plume et le Canif le regardent du bas. La supériorité du Crayon est
ainsi affirmée.
286 H. de Balzac, LH, t.I, p. 639 ; c’est nous qui soulignons.
240
Figure 165 : Grandville, vignette pour Un Autre Monde
Or, dans le cas des Scènes de la vie privée et publique des Animaux Grandville ne semble
guère aimer la trahison du postulat formulé dans la préface d’Hetzel, et il trouve quand
même la manière de démontrer son autorité à travers trois systèmes : la mise en relief de
Grandville à travers des stratégies graphiques sur le paratexte de l’œuvre ; la vision satirique
des auteurs des Animaux, via leur métamorphose ; et l’effet contre-textuel de ses
illustrations, où les humains décrits par les écrivains sont toujours représentés en forme
zoomorphe.
C’est Keri Jousif qui a montré dans son étude Balzac, Grandville and the Rise of Book
Illustration287 comment Grandville exerce son contrôle sur le paratexte, notamment sur la
page de titre, et sur le frontispice. Dans le premier, le nom de Grandville est écrit en
caractères plus gros que celui des écrivains ; il est donc mis en évidence. La petite vignette
en forme d’insecte habillé de manteau, haut costume et canne, est aussi une façon de
souligner son nom dans une sorte d’extension métonymique288, les animaux
anthropomorphes étant le signe distinctif de Grandville, d’après Les Métamorphose du jour et
l’illustration des Fables de La Fontaine (1838). En revanche, dans le cas de la gravure qui
précède la première histoire – considérée comme le frontispice de l’ouvrage, même si le
frontispice n’est pas cette image-là – la planche est un véritable hymne aux animaux
anthropomorphes de Grandville, qui occupent toute la scène ; de même, le frontispice du
livre fait encadrer l’affiche contenant le titre de l’ouvrage par six animaux.
287 K. Yousif, Balzac, Grandville and the Rise of the Book Illustration, Farnham, Surrey, England, Burlington, Ashgate, 2012. 288 Voir K. Yousif, op. cit., p. 81.
241
Figure 166 et 167 : Grandville, Page de titre et frontispice pour Scènes de la vie privée et publique des animaux
Les noms des écrivains et de l’éditeur sont omis, ils seront représentés seulement dans l’une
des planches du « Prologue », à côté de la page 30, et dans la gravure finale du deuxième
volume. Dans la première, les Animaux font la publicité pour l’ouvrage avec de petites
affiches sur lesquelles sont imprimés le nom et l’adresse de l’éditeur, le titre de l’œuvre et le
nom de l’illustrateur. La deuxième en revanche, qui a été dessinée par Français et non par
Grandville, représente ce dernier assis au Jardin des Plantes esquissant les trois oiseaux qui
regardent Hetzel, Balzac et Janin incarcérés dans leurs cages ; à l’arrière-plan, d’autres
écrivains sont reclus, et George Sand joue le rôle de Raiponce de la hauteur d’une tour. Seul
Grandville a donc le droit d’être libre, au contraire de ses collègues écrivains.
De plus, le deuxième système de rébellion de Grandville prévoit que l’illustration
applique, comme une sorte de contrappasso dantesque, le même effet miroir entre l’Homme
et l’Animal que Grandville a appliqué aux personnages du livre : s’il est vrai que, comme le
soutiennent Boris Lyon-Caen et Marie-Eve Thérenty : « L’apport de l’illustration […] est
patent et déborde largement le dispositif mis en place par Hetzel », et que « Grandville rend
visibles, et se faisant radicalise, deux postulats du livre qui ne se recouvrent pas tout à fait :
l’indistinction homme-animal (être monstrueux) et la nature animale de l’homme
(métamorphoses) »,289 les écrivains, appelés à s’identifier avec leurs animaux, subissent le
même traitement. Ainsi, devant Hetzel, Balzac et Janin, le lecteur-spectateur trouve trois
289 B. Lyon-Caen et M.-E. Thérenty, art. cit., p. 6.
242
oiseaux : une autruche, un moineau, et un héron. Nous ne commentons pas les animaux
associés à Hetzel et à Janin, comme c’est une problématique très complexe, qui concerne le
riche bestiaire qui entoure Hetzel-Stahl dans cette œuvre, et dont l’étude nous emménerait
loin de notre sujet principal. Nous préférons passer directement à la comparaison entre
Balzac et le moineau, qui se révèle intéressante du moment qu’aucune histoire des Animaux
signée Balzac n’érige cet oiseau en protagoniste.
Figure 168 : Français, Vignette pour Scènes de la vie privée et publique des animaux
Pourquoi le moineau donc ? On pourrait suggérer quelques hypothèses. D’abord,
une référence à l’aspect physique de Balzac, petit et rond ; ou encore, un jeu de mots entre
« moineau » et « moine », avec une allusion évidente au célèbre portrait de Balzac en robe
de moine. Mais, surtout, ce jeu graphique dénonce que l’article « Histoire d’un Moineau de
Paris », qui dans le livre est signé George Sand, est en réalité sorti de la plume de Balzac.
Ainsi, Grandville dévoile l’un des mécanismes qui était resté en coulisses de l’ouvrage.
Dans la même perspective, le choix de mettre Balzac dans la cage avec l’éditeur-
auteur de l’ouvrage et Janin n’est pas anodin. Balzac est, après Hetzel, le contributeur
majeur des Scènes de la vie privée et publique des Animaux, avec ses cinq articles ; mais il est aussi
l’auteur qui a influencé le plus la structure de l’œuvre, car, selon Keri Yousif, Lyon-Caen et
Thérenty, Grandville décide de créer un système qui repose sur deux éléments typiquement
243
balzaciens : la scène et la comparaison Homme-Animal. En effet, le titre, Scènes de la vie
privée et publique des Animaux, est une claire référence aux Scènes que Balzac avait commencé
à publier depuis les années 1830 et à systématiser dans les Études de mœurs ; la comparaison
Homme-Animal dérivant de Lavater, en revanche, a été exploitée d’abord par Grandville, et
non par Balzac, contrairement à ce que Lyon-Caen et Thérenty soutiennent : la première
édition des Métamorphoses du jour date de 1828-1829 ; Balzac, à cette période-là, s’engageait
dans l’écriture de la Physiologie du mariage, œuvre pilote de la future Comédie humaine.
D’un côté, alors, le mécanisme des scènes balzaciennes, qui impliquent un système
sériel, notamment le retour du personnage ; de l’autre les métamorphoses de Grandville,
que Balzac lui-même avait transposées dans la construction de ses héros. La manière par
laquelle tout cela s’entrelace dans les articles de Balzac est tout à fait intéressante. Nous
avons choisi de commenter en détail le conte « Peines de cœur d’une Chatte Anglaise »,
puisque ce récit non seulement est le texte préféré par Balzac lui-même, mais il contient
aussi tous les points de réflexions que le parallèle entre Balzac et Grandville suscite, surtout
par rapport au mécanisme contre-textuel de l’illustration. De plus, cet article donne lieu à
un cycle interne aux Animaux : Hetzel en fait essaiera de reconstruire la vie de l’un des
protagonistes de Balzac, le chat Brisquet ; mais l’expérience ne réussit pas totalement,
Grandville refusant de participer à ce mécanisme et ne dessinant pas Brisquet dans
l’histoire de Stahl.
Les quatre autres contes de Balzac, dont les illustrations sont cataloguées à l’Annexe
n°8, ont une structure similaire, assimilable au récit de voyage, très proche aussi du modèle
des Comédiens sans le savoir.
Les « Peines de cœur d’une Chatte Anglaise » sont la narration de la vie de Beauty,
chatte anglaise échappée à la noyade grâce à la beauté de sa robe, complètement blanche.
Elle est adoptée par une vieille fille, qui, en voyant Beauty dormir sur la Bible, est
convaincue que la chatte appartient « à la secte des Animaux sacrés ». La dame, une dévote
du thé et de l’Église, apprend à Beauty la stricte éducation protestante, qui impose de
cacher tous les instincts et besoins primaires de l’homme sous un voile de pure grâce et
netteté. Après quelque temps, Beauty est adoptée par la nièce de la dame, Arabelle, qui
l’emmène avec elle à Londres ; là la chatte est présentée à l’Angora d’un ministre, Puff, qui
est censé devenir son mari. Mais la froideur de leurs rapports ennuie Beauty, qui se trouve
attirée par un vulgaire mais galant chat français, Brisquet. Surprise en public à prononcer un
244
mot d’amour en français qu’elle n’aurait même pas dû connaître, Beauty est jugée coupable
par le Tribunal, et Brisquet est tué par les parents de Puff, même si son homicide passe
pour un suicide, le souris-médecin de l’autopsie ayant trouvé des traces de poison dans
l’assiette du chat290.
Sept illustrations sont dédiées à cette histoire, dont trois sont des scènes, trois des
portraits, et le cul-de-lampe à scène reporté ci-dessus.
Dans les trois portraits, l’influence du modèle du type iconique élaboré par Les
Français peints par eux-mêmes est très visible : les personnages, c’est-à-dire la vieille fille
anglaise qui a adopté Beauty, la miss jouant du piano dans le salon de cette dernière, et le
médecin appelé pour guérir la Chatte du mal d’amour, sont tous représentés dans leur pose
typique, avec les objets qui les caractérisent.
La vieille fille, par exemple, est une dame chargée de bijoux, tels que les boucles
d’oreilles, la broche rectangulaire avec le dessin d’un chien, et un camée qui pend de la
ceinture. La main droite est levée en l’air en signe de désapprobation, pendant que la main
gauche tient les verges de bouleau avec lesquelles elle vient de fouetter Beauty, punie non
seulement pour avoir lapé la crème de la dame mais aussi pour avoir fait ses besoins sur le
tapis, en public. C’est l’intempérance que la dame n’admet pas, le terrible improper qui,
comme le savent bien les lecteurs de La Maison Nucingen, coupe les ailes à tout instinct
humain au nom du respect des strictes mœurs anglaises. La tasse de crème incriminée est
dessinée sur une petite table à côté de l’objet sacré de la vieille fille, la Bible ; les deux objets
sont ainsi le symbole des deux mondes opposés, celui des instincts – la crème – et celui du
proper de la religion protestante. Toutefois, le détail qui rompt l’harmonie que l’image a
jusqu’à là établie avec le texte est le visage de la vieille fille, qui montre une tête de chatte
avec des lunettes. C’est le destin de tous les Hommes qui trouvent une place dans les
illustrations de Grandville : être métamorphosés en Animaux. De fait, Grandville n’accepte
pas de laisser la comparaison Homme-Animal comme une suggestion implicite : lui, il vise
au contraire les conséquences extrêmes de ce binôme, de la logique inverse du monde
animal qui se fait humain. Ainsi, la vieille fille devient l’animal qu’elle possède, mais qu’elle
ne pourra jamais être, car elle est vieille, seule et sans sentiment, alors que Beauty est jeune,
290 La conclusion de l’article de Balzac et le choix du souris-médecin de Grandville semblent s’inspirer de l’histoire de Mme Lafarge : femme reconnue coulpable d’avoir tué son mari avec de l’arsenic, poison que le couple utilisé pour désinfecter leur maison. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Lafarge Nous remercions vivement Nathalie Preiss pour avoir partagé avec nous cette intuition.
245
belle et passionnée. Là, c’est véritablement la valeur d’échange du type théorisée par Walter
Benjamin qui relève de la métamorphose du dessin de Grandville.
Figure 169-170 : Planches pour « Peines de coeur d'une chatte anglaise »
Plus subtil est le signifié caché dans la comparaison entre la jeune fille jouant du
piano transformée en chienne et le médecin-oiseau. Bien que personnages mineurs de
l’histoire, la jeune fille au piano et le médecin condensent les deux moments de rébellion de
Beauty : le premier, quand elle découvre la joie de chanter, en unissant sa voix à celle de la
musicienne – et la chatte réagira à la tentative da la vieille fille de la punir pour cette
intempérance ; le deuxième, quand Beauty, amoureuse de Brisquet, est traitée comme une
malade. Cette fois-ci, la comparaison Homme-Animal semble être construite sur l’effet-
miroir. La jeune fille, qui obéit avec complaisance à l’invitation de jouer du piano, scène
typique des demoiselles bien élevées du XIXᵉ siècle, partage avec la figure du chien la
fidélité aveugle envers son propriétaire, en ce cas-là la Société, qui donne ses ordres et ses
lois en attendant une obéissance absolue. Le médecin, en revanche, prend l’aspect de l’objet
qui le distingue : la seringue, douée d’une aiguille longue et subtile, comme le bec du
médecin-cigogne.
Les scènes, de leur côté, mettent en jeu le mécanisme opposé à celui des portraits :
dans les scènes, ce sont les Animaux qui prennent l’aspect des Hommes, contrairement à ce
qui est narré dans le conte. La première scène illustrée proposée par Grandville est celle de
la rencontre entre Puff et Beauty, dans le salon d’Arabelle :
246
Puff, noir de robe, avait les plus magnifiques yeux, verts et jaunes, mais froids et fiers.
Sa queue, remarquable par des anneaux jaunâtres, balayait le tapis de ses poils longs et
soyeux. Peut-être venait-il de la maison impériale d’Autriche, car il en portait, comme
vous voyez, les couleurs. Ses manières étaient celles d’un Chat qui a vu la cour et le
beau monde. […] Moi, simple et naïve, je lui sautai au cou pour l’engager à jouer ;
mais il s’y refusa sous prétexte que nous étions devant tout le monde. Je m’aperçus
alors que le pair d’Angleterre devait à l’âge et à des excès de table cette gravité
postiche et forcée qu’on appelle en Angleterre respectability. Son embonpoint, que les
hommes admiraient, gênait ses mouvements. Telle était sa véritable raison pour ne pas
répondre à mes gentillesses : il resta calme et froid sur son innommable, agitant ses
barbes, me regardant et fermant parfois les yeux.291
L’illustration de cette scène par Grandville rend bien le geste d’opposition entre les deux
chats : debout sur les pattes postérieures comme les hommes, Beauty ouvre les bras en
signe de salutation, tandis que l’embonpoint de Puff s’interpose entre eux comme une
barrière. Puff et Beauty, contrairement à leur description, sont habillés comme leurs
propriétaires, selon le processus d’anthropomorphisation des Animaux, tandis que le salon
d’Arabelle montre la métamorphose du décor : sur la commode on distingue clairement un
tableau dont le sujet est un chien en rôle de chasseur, et sur la cheminée à droite deux
statuettes avec têtes d’animaux font écho aux célèbres statuettes de Dantan.
Figure 171 et 172 : Planches pour « Peines de coeur d'une chatte anglaise »
291 H. de Balzac, « Peines de coeur d’une Chatte Anglaise », Scènes de la vie privée et publique des animaux, t.I, pp. 98-99.
247
On se demande si la rencontre des deux chats n’est pas en effet celle de leurs propriétaires,
si Arabelle n’ouvrirait pas virtuellement à l’univers de La Comédie humaine : son nom rappelle
immédiatement au lecteur balzacien lady Arabelle Dudley, personnage du Lys dans la vallée.
L’histoire de Beauty serait-elle en réalité la narration de sa vie avant la rencontre de Félix de
Vandenesse ?
La deuxième scène illustrée par Grandville, en revanche, a lieu à l’extérieur, sur les
toits de Londres, où Brisquet apprend Beauty à l’appeler « Mon petit homme », le fatal mot
qui portera Beauty à être accusée d’adultère. Brisquet, de son côté, utilise un autre petit
nom pour Beauty, « Chère Minette », qui crée un double sens : en fait, « minette » est bien
un terme d’affection, dont use Balzac à l’égard de Mme Hanska, mais il est aussi le nom
choisi par Hetzel-Stahl pour la protagoniste de l’histoire qui aurait dû constituer le pendant
à l’article de Balzac, Peines de cœur d’une Chatte Française, où on conte la vie de Minette,
première amante de Brisquet.
Les deux scènes qui montrent Beauty en compagnie de Puff et de Brisquet sont
spéculaires : Grandville a choisi deux moments assez significatifs, qui éclairent la sensation
de vivre dans un monde sens dessous-dessus ressentie par Beauty. Dans le système
classique de l’être contre le paraître, le monde de l’intériorité est comparé à l’espace de plus
en plus privé du citoyen, la maison ; l’intériorité morale trouve donc une corrélation
physique. De la même façon, l’extériorité coïncide avec le paraître, du monde public. Dans
l’univers de Beauty, cette équation ne tient pas : le salon de sa maison est pour la chatte le
moment d’exposition maximale au jugement social, tandis que le toit représente le lieu de la
liberté et de la rencontre avec Brisquet. Le lieu de l’être alors devient le dehors, le plein air,
l’extérieur de l’édifice, pendant que le paraître s’impose à l’intérieur, dans la vie privée des
personnages.
Être Paraître
Intérieur-Espace privé Extérieur-Dehors
Cacher Exposer
C’est la dénonciation de Balzac, qui trouve cette fois-ci une bonne analogie dans les deux
dessins de Grandville.
248
7.3. La Grande Ville, ou la renaissance de la caricature
Entre 1842 et 1843 paraît chez le Bureau Central des publications nouvelles La Grande
Ville. Nouveau tableau de Paris comique, critique et philosophique, œuvre collective en deux
volumes recueillant les articles des écrivains les plus en vogue du moment, tels que Paul de
Kock, Alexandre Dumas père, Soulié, Gozlan, Briffault et Balzac. L’ouvrage est illustré
avec le procédé du bois de bout par les illustrateurs les plus célèbres de la deuxième
génération romantique : Gavarni, Victor Adam, Daumier, d’Aubigny, Emy, Travies,
Boulanger, Henri Monnier et Thenot. Le titre représente une allusion directe au Tableau de
Paris par Mercier, mais le sous-titre donne une redéfinition au genre, en annonçant la nature
« comique, critique et philosophique » de l’œuvre.
Publiée peu de temps après Les Français peints par eux-mêmes, La Grande Ville fait un
clin d’œil à son illustre prédécesseur sans pourtant suivre vraiment ses empreintes. Le
projet de La Grande Ville est certainement plus restreint par rapport à celui des Français, et
la discontinuité de style démontrée dans ses deux tomes instaure une discontinuité
inconnue à l’ouvrage publié par Curmer. De fait, le tome I de La Grande Ville a été écrit par
une seule personne, Paul de Kock, qui énonce les points sur lesquels le livre se fonde et qui
garantit ainsi la cohésion de ce premier tome à l’enseigne du comique en gérant entièrement
sa composition ; le deuxième tome par contre se compose d’articles de plusieurs écrivains,
qui prennent en charge un style critique plus sérieux, s’éloignant ainsi du modèle construit
par de Kock. Cette discordance est tellement évidente que le deuxième tome nécessite un
autre avertissement qui rétablit le plan de l’ouvrage.
Nous croyons qu’une comparaison entre les deux préfaces est non seulement
intéressante mais aussi indispensable à l’analyse de l’élément microscopique qui est l’article
rédigé par Balzac pour La Grande Ville, titré « Monographie de la presse parisienne », car la
reconstruction du projet collectif est fondamentale à l’identification des particularités du
texte du romancier. De même, sans ce regard panoramique sur le livre entier il serait
impossible d’analyser dans la juste perspective les illustrations de l’œuvre, lesquelles sont
appelées encore plus que les textes à maintenir la cohésion de l’ouvrage entier : il est
nécessaire de reconstruire le style qui caractérise l’illustration de ce livre avant de
commenter le rapport que l’image entretient avec l’article de Balzac. Nous proposons donc
d’abord l’étude des deux préfaces avant de procéder à l’analyse de la « Monographie de la
presse parisienne ».
249
La préface initiale rédigée par Paul de Kock pour le premier tome, laquelle ne se
présente pas comme une introduction, mais comme « Quelques mots avant d’entrer en
matière », tient à souligner les particularités de La Grande Ville, dont le modèle implicite
duquel il s’éloigne est bien évidemment celui des Français. Le texte de Paul de Kock se
distingue par sa concision : cinq pages sont suffisantes à l’énoncé du but visé par l’œuvre.
De plus, le terme « tableau » inséré dans le sous-titre trouve ici une explication qui ne
renvoie pas seulement au Tableau de Paris de Mercier, mais s’oppose aussi à la forme de
l’ « encyclopédie » poursuivie par Les Français :
On a fait beaucoup d’ouvrages sur Paris ; sans doute on en fera beaucoup encore ! Il y
a tant de choses à dire sur cette ville immense, devenue le centre des arts, des sciences,
des modes, des plaisirs, et on pourrait presque dire de la civilisation. Nous n’avons pas
la prétention de clore la discussion ; nous n’avons pas non plus celle d’écrire une
Histoire de Paris, et si dans nos tableaux on trouve parfois quelques souvenirs des temps
anciens, quelques mots sur les vieilles coutumes, les vieux usages, quelques chroniques
ou détails sur le Paris d’autrefois nous les avons mis là seulement pour en tirer une
comparaison avec l’époque actuelle, et nullement dans le but de faire de l’érudition.
Sans doute aussi, tout en cherchant à dépeindre la grande ville et ce qu’elle renferme
de curieux, d’amusant ou de remarquable, nous oublierons bien encore quelque
chose…mais si nous devons encourir un reproche, nous préférons que l’on se plaigne
de la brièveté de nos descriptions plutôt que de leur longueur.292
La Grande Ville ne relève pas donc de l’encyclopédie ou de la classification des espèces qui
habitent l’espace urbain : elle cherche plutôt à esquisser ce que la ville « renferme de
curieux, d’amusant ou de remarquable », sans aucune prétention de totalité ou
d’exhaustivité. L’ordre même des textes composant les deux tomes du livre est totalement
arbitraire :
Nous ne suivrons aucun ordre dans l’arrangement de nos chapitres ; nous laisserons
notre plume courir alternativement d’un sujet comique à un monument sévère, d’une
scène de mœurs à un souvenir de vieil âge. Nous pensons que cette manière est la plus
simple et la meilleure pour connaître cette ville immense, où l’observateur voit passer
tour à tour devant ses yeux le tableau du plaisir et celui de la souffrance ; le riche dans
son équipage, le pauvre honteux n’osant tendre la main ; l’ouvrier bambocheur qui
292 Paul de Kock, « Quelques mots avant d’entrer en matière » dans La Grande Ville, Paris, Au Bureau central des publications nouvelles, 1842, t. I, pp. 1-2 ; c’est nous qui soulignons.
250
mange en un jour le produit de sa semaine, et le petit savoyard qui travaille et amasse
pour sa mère.293
Le mécanisme du panorama est évident dans les mots que nous avons soulignés, lesquels
évoquent l’image du spectateur assis au centre d’une salle ronde regardant les tableaux qui
se succèdent devant lui. De même, c’est l’activité de la flânerie qui est mise en cause, dans la
figure de l’observateur de la ville-théâtre, où les écrivains prolongent l’espace de la scène
jusqu’à l’intérieur des maisons : « Promenons-nous donc au hasard dans Paris ; nous
n’aurons pas besoin de chercher des sujets, ils se présenteront d’eux-mêmes à nous : nous
visiterons tous les quartiers ; nous entrerons dans beaucoup de maisons, non pas par le toit,
comme dans le Diable boiteux, mais par la porte ; c’est moins original, mais c’est plus
naturel »294.
Les affirmations de Paul de Kock sont contradictoires : il soutient que les écrivains
n’ont pas besoin d’aller à la recherche de leurs sujets, puisqu’ils se présentent par eux-
mêmes à leur attention, mais tout de suite il décrit le geste contraire, celui de pénétrer dans
les maisons pour observer leurs habitants par les toits, comme dans Le Diable boiteux de
Lesage.
La Grande Ville présente alors deux types de regards bien différents : celui du flâneur,
qui se mêle aux promeneurs pour les observer, et celui du diable boiteux, personnage
invisible aux autres qui entre dans les maisons à la recherche d’une scène particulaire digne
d’un conte. Les deux illustrations ancrées au texte de Paul de Kock, la première en tête de
page et la deuxième en cul-de-lampe, soulignent ces changements du point de vue : si la
vignette en tête de page montre la foule de gens qui se promènent le long d’un boulevard,
vue fort probablement par l’œil du flâneur, le cul-de-lampe représente une scène d’intérieur,
où deux hommes sont observés pendant leur travail, inconscients d’être examinés par
quelqu’un d’autre. Mais le but visé par de Kock est clair : le lecteur doit avoir l’illusion
d’être le public d’un spectacle, et les acteurs doivent mettre en scène une pièce vraisemblable,
où il faut que la présence de l’auteur reste bien cachée : « car alors vous ressemblez à ces
gens qui, pendant la représentation d’une pièce, laissent voir leur tête dépassant un châssis
de jardin ou de palais, et auquel on est obligé de crier : ʺ A bas la coulisse ! ʺ »295.
293 Ibid., p. 5 ; c’est nous qui soulignons. 294 Ibid., p. 6 ; c’est nous qui soulignons. 295 Ibid., p. 4.
251
Les acteurs de la pièce donc ne ressemblent pas trop aux types bien encadrés et
modélisés des Français : les personnages, bien que toujours situés à l’intérieur d’une
catégorie sociale, sont cueillis dans leur particularité, dans les gestes qui rendent le
personnage typique dans le sens d’un individu original plutôt que dans une attitude typisant
et exemplaire, universelle.
L’article « Bains à domicile » peut être considéré comme un exemple paradigmatique
du style de Paul de Kock : l’article se configure comme une scène de matrice comique où la
narration se mêle aux dialogues entre les personnages. Dans l’article en question, le
narrateur décrit l’odyssée entreprise par les gens qui désirent prendre un bain chez eux mais
qui n’ont pas de baignoire et ne veulent pas recourir aux établissements de bains. Le texte
est organisé en deux séquences : dans la première, le narrateur décrit la situation exemplaire
d’une dame qui a demandé un bain à domicile et les inconvénients auxquels elle doit faire
face à l’arrivée des porteurs de la baignoire ; la deuxième, introduite par un bref paragraphe
qui unit les deux morceaux du texte, conte l’histoire d’une grisette qui s’est vengée de son
locataire en lui envoyant six bains à domicile dans la même matinée.
Figure 173 et 174 : Deux illustrations pour « Bains à domicile » de Paul de Kock, La Grande Ville, t.I
La veine comique de Paul de Kock, comme nous l’avons annoncé, n’est pas
prolongée dans le deuxième tome de La Grande Ville ; le comique cède la place à la critique,
traduite par la satire. Mais c’est le plan global du livre qui subit un changement
considérable : l’« Avertissement » signé M. F. (Marc Fournier) reprend la question du genre
du tableau de mœurs à la Mercier, sur laquelle Paul de Kock avait déjà réfléchi, pour
redéfinir le cadre de l’œuvre :
Le tableau que l’on trace d’une nation, comme le portrait d’un homme, sorti de la
main du peintre, demeure très peu de temps en état de ressemblance parfaite avec
l’original. Cela se conçoit : une nation ne se soustrait pas plus que les individus au
252
cours dévorant des passions et des idées ; elle vieillit vite, elle se transforme, et le
tableau qui la représentait jadis diffère bientôt de traits, de costume et de couleur avec
les choses actuelles. […] C’est dans cette pensée que les éditeurs, préoccupés de
réédifier pour le XIXᵉ siècle l’œuvre populaire de MERCIER, ont voulu que la Grande
Ville fût un livre complet. Il y avait deux conditions inhérentes à ce but : il fallait
d’abord embrasser une immense variété de matières, choisir ensuite pour chacune
d’elles un écrivain dont le genre put s’y approprier.296
« Un livre complet », cela est le nouveau but du deuxième tome, qui s’inscrit, au contraire
du premier, dans le sillage des Français : non seulement la vision encyclopédique de la ville
est rétablie, mais aussi l’identification des personnages en types sociaux :
Au surplus, la classification du travail se présentait d’elle-même. Il en est à peu près
des grandes agglomérations d’hommes comme de terrains pris sur une vaste échelle ;
ils apparaissent en couches superposées, et plus l’agglomération est considérable, plus
ces différentes zones se caractérisent à l’œil ou à l’esprit. Or la masse parisienne, sans
tenir compte des nuances intermédiaires, se compose de trois catégories qui sont pour
ainsi dire trois sociétés distinctes et indépendantes entre elles : c’est la classe populaire,
la petite bourgeoisie, et le monde élégant. Il a donc suffi de rechercher les types ou les
faits les plus saillants dans chaque série, pour arriver à une nomenclature aussi
satisfaisante que possible.297
« La masse parisienne » est à nouveau classée en types sociaux, regroupés dans trois
catégories : la classe populaire, la petite bourgeoisie, et le monde élégant. Cependant, le
schéma de ce tome diffère encore du modèle des Français peints par eux-mêmes : la table des
matières montre une toute autre nomenclature, qui fait allusion aux lieux plutôt qu’aux
types. Ainsi, Marc Fournier propose un article sur la « Rotonde du Temple », Frédéric
Soulié prend comme sujet la « Chambre des députés », tandis qu’Eugène de Mirecourt
décrit le « Boulevard du crime ». De fait, il semble que les « charmantes pochades » de la
petite bourgeoisie racontées par Paul de Kock ont exploité suffisamment cette partie du
sujet :
Ce cadre épuisé, ou pour mieux dire rempli, d’autres tableaux se présentaient. Le titre
de l’ouvrage, après le livre comique, annonçait une œuvre critique, et pour obéir à ce
programme, il fallait nécessairement toucher à des sujets plus vastes et plus palpitants.
296 M. Fournier, « Avertissement » dans La Grande Ville, op. cit., t. II, pp. 1-2 ; c’est nous qui soulignons. 297 Ibid., p.2 ; c’est nous qui soulignons.
253
Les peintures légères devaient bien encore se rencontrer çà et là : les restaurants, par
exemple, les petits théâtres, les marchands d’habits, les rivoyeurs, les banquistes, et d’autres
sujets semblables pouvaient se rattacher encore par quelque point au sens
général […].298
Le type commence à se confondre avec son habitat, avec son milieu : de cette façon, l’œil
des écrivains se focalise sur l’ensemble de la scène, c’est-à-dire que ce n’est pas seulement le
personnage qui est considéré dans le tableau mais aussi tout le cadre. L’exemple
paradigmatique, dans ce cas-là, est Balzac :
[…] mais nous avions devant nous le monde politique et littéraire dont l’examen
exigeait des allures presque militantes ; nous avions surtout à peindre cette reine
toujours debout quoiqu’incessamment frappée, qui craint la vérité plus que la
calomnie, et devant qui reculent les plus braves : la Presse Parisienne ! Il fallait, pour
saisir le géant corps à corps, un de ces robustes courages, un de ces hommes qui ont
pour habitude de marcher dans leur force et dans leur liberté…Nommer le champion,
c’est révéler combien la lutte sera chaude et passionnée, c’est exprimer d’avance tout
l’intérêt qu’excitera dans le public ce tournoi de l’esprit contre la critique. Disons donc
que M. de Balzac a bien voulu descendre dans cette redoutable arène.299
Balzac est le champion de ce deuxième volume de La Grande Ville, grâce à son article
consacré à « cette reine toujours debout quoiqu’incessamment frappée » qui est la Presse
Parisienne – nous remarquons la lettre majuscule, qui en indique clairement la
personnification.
Avant d’apprécier le mérite du texte balzacien, une dernière réflexion se présente
dans la conclusion de cet « Avertissement », à savoir un paragraphe concernant la
construction du livre matériel :
Un mot pour finir sur l’exécution matérielle. L’illustration est un luxe désormais
nécessaire. Elle a été doublée pour ce second volume, au moyen d’une gravure hors
texte qui accompagnera chaque chapitre, ou d’un haut de page qui formera un sujet de
grande dimension. En outre, le texte a été resserré, et le second volume, devenu
compact, présentera la matière de deux volumes in-8° ordinaires. Cette double mesure
aura pour effet de permettre aux écrivains comme aux artistes de passer en revue
298 Ibid., p. 3. 299 Ibid., pp. 3-4.
254
beaucoup plus de sujets, avec beaucoup plus de détails, sans que le prix de l’ouvrage
soit augmenté.300
L’illustration est vue comme un ornement de luxe « désormais nécessaire » à la réussite
économique du livre ; aucune valeur esthétique de cet art est mise en question. Et pourtant
les indications données par l’auteur de l’Avertissement sont erronées : l’illustration est
beaucoup plus exploitée que l’« Avertissement » ne le soutient, vu qu’il ne figure pas
seulement un hors-texte pour chaque article mais, comme dans le cas de Balzac, certains
d’eux ont même deux ou trois planches hors-texte, outre les vignettes in-texte que
l’« Avertissement » ne cite guère. Cela soulève des questions par rapport à la composition
de ce volume de La Grande Ville : le projet initial aura-t-il changé pendant la composition
du livre ? Nous ne croyons pas que cette hypothèse soit plausible, puisque le premier
volume avait été organisé plus au moins de même manière, avec de nombreuses vignettes.
L’affirmation « cette double mesure aura pour effet de permettre aux écrivains
comme aux artistes de passer en revue beaucoup plus de sujets, avec beaucoup plus de
détails », également, n’est pas vraiment clair, puisque nous sommes dans le cas d’une
illustration protextuelle : certainement l’image est pourvue d’une série de détails qui
resituent la scène ou le personnage illustré dans sa complexité, mais l’illustration n’est pas
autant présente que dans le premier volume ; encore, les sujets qu’elle représente sont
beaucoup moins nombreux que ceux traités dans le texte écrits. Ce paragraphe de la préface
semble alors une tentative assez maladroite de justifier la présence des illustrations.
Analysons maintenant le cas de Balzac. Son article, la « Monographie de la presse
parisienne. Extrait de l’Histoire naturelle du bimane en société », bénéficie particulièrement
des illustrations : on compte quatre planches hors-texte et trente vignettes, signées par
plusieurs dessinateurs différents tels que Victor Adam et Emy. Les questions que nous
nous sommes posées sur l’article de Balzac découlent d’ailleurs de la vue d’ensemble que
nous venons de faire sur les deux tomes de La Grande Ville : nous avons souligné que
l’« Avertissement » au deuxième tome de l’ouvrage établit un lien essentiel avec le
personnage et son milieu, mais aucun indice n’a été fourni sur la contribution que
l’illustration donne en ce sens-là ; pourtant, d’après les indications contenues dans
l’« Avertissement » l’on s’attend à une image qui traduit l’extension du personnage dans son
milieu, dans le décor qui le caractérise. Autrement ce serait comme dessiner Mme Vauquer
300 Ibid., p. 4 ; c’est nous qui soulignons.
255
sans sa pension, ou la petite bourgeoise de Paul de Kock sans ses porcelaines et ses
statuettes de Dantan cassées par les porteurs de la baignoire.
Figure 175 : Illustration pour « Bains à domicile » de Paul de Kock, La Grande Ville, t.I
Commençons par un petit commentaire du texte. L’article de Balzac se présente dès
le titre comme un texte à caractère scientifique : le terme « monographie », outre celui de
sous-titre « histoire naturelle », nous ramène au genre des physiologies, lesquelles, comme
nous l’avons vu dans le chapitre précédent, exploitent les théories de Buffon, Cuvier et
Lavater de façon caricaturale et ludique. En effet, comme l’a bien remarqué José-Luis Diaz
dans son article « Balzac analyste du journalisme, selon la ˝Monographie de la presse
parisienne˝ »301, le style de Balzac dans la ˝Monographie˝ oscille entre le « faire scientifique »
– traduit dans l’application du cadre taxinomique de la zoologie et dans la formulation de la
réalité par axiomes – et une analyse qui s’appuie sur le jeu, sur l’expression ludique qui se
croise avec la fantaisie. Ce style binaire est visible à partir des premières lignes, où l’auteur
se sert d’une citation paraphrasée de Victor Hugo, soutenant que la France est représentée
par deux objets, l’Épée et la Plume, pour décliner le nom de « Gendelettre », l’ordre des
bimanes munis de plume qui sont la contrepartie du Gendarme, les hommes d’armes.
Balzac procède à la description analytique de l’ordre Gendelettre, partagé en deux genres :
le genre Publiciste et le genre Critique, d’où se développent à leur tour les sous-genres et les
variétés de ces bimanes, dont une table synoptique est fournie avant le début de l’article.
301 J.-L. Diaz, « Balzac analyste du journalisme. Selon la ʺMonographie de la presse parisienneʺ », AB 2006, pp. 215-235.
256
Figure 176 : Table pour la « Monographie de la presse parisienne »
Avant de s’engager dans la description des sous-genres et variétés du Publiciste et du
Critique, Balzac souhaite que son œuvre soit appréciée par le public étranger : « Nous
espérons que les nations étrangères prendront quelque plaisir en lisant cette partie
d’Histoire Naturelle Sociale à laquelle une illustration vigoureuse donne tout le mérite de
l’iconographie »302. Le vœu est suivi par une illustration que nous restituons ci-dessous.
Figure 177 : Vignette pour la « Monograohie de la presse parisienne »
L’image est une claire citation des Scènes de la vie privée et publique des animaux : un peintre – il
n’est pas du tout exclu qu’il soit Grandville lui-même, le portrait est assez ressemblant –
dessine sur la toile, dans son atelier, et devant lui son modèle, une cigogne ; scène qui
rappelle la planche finale du livre illustré par Grandville, où ce dernier, assis au Jardin des
Plantes, dessine sur un carnet les hommes dans les cages et les animaux qui les regardent,
302 H. de Balzac, « Monographie de la Presse parisienne », La Grande Ville, t.II, pp. 130-131.
257
où parmi ceux-ci figure aussi une cigogne. La comparaison de l’homme comme animal se
fortifie donc grâce à la citation de l’ouvrage de Grandville : ce que Balzac présente est un
véritable catalogue zoologique extrait de l’observation de la Nature Sociale.
Cependant, à cet imaginaire zoomorphique s’oppose un filon descriptif
complètement différent. En fait, le paragraphe suivant, dédié aux « Caractères généraux »
du Publiciste et du Critique, affirme que : « le principal caractère de ces deux Genres est de
n’en jamais avoir aucun »303. Le caractère, c’est-à-dire l’élément sur lequel toute la littérature
panoramique a fondé son essence, puisqu’il est le point conducteur de la tradition littéraire
qu’elle a soutenue comme son ancêtre, de Théophraste à La Bruyère et Mercier, est
totalement refusé aux Gendelettres. Balzac est implacable, et l’article est une chaine de
petits portraits et scènes caricaturales qui culminent dans l’affirmation finale :
Tel est le dénombrement des forces de la Presse, le mot adopté pour exprimer tout ce
qui se publie périodiquement en politique et en littérature, et où l’on juge les œuvres
de ceux qui gouvernent, et de ceux qui écrivent, deux manières de mener les hommes.
Vous avez vu les rouages de la machine ; quant à la voir fonctionnant, ce spectacle est
un de ceux qui n’appartiennent qu’à Londres et à Paris : en dehors de Paris, on en sent
les effets, mais on n’en comprend plus les moyens. Paris est comme le soleil, il éclaire,
il échauffe, mais à distance.304
Les Gendelettres sont les « rouages de la machine », sont devenus une pièce de métal,
absorbé par la matière qu’ils poursuivent : l’argent. Si alors cette critique négative sur l’autre
dégradé de la littérature, la presse, tend à la fin à construire l’image de l’homme-machine,
l’illustration intervient pour donner l’effet contraire : les gravures montrent l’aspect le plus
humain de ces hommes-rouages, en leur dédiant une série de portraits et de scènes
satiriques qui font émerger la fragilité, la laideur même des hommes, qui restent ainsi
humains dans leurs grimaces. De fait, la seule caractéristique que tous les Gendelettres
partagent est le manque : « de beauté, quoiqu’il se fassent des têtes remarquables à l’aide de
la lithographie, du plâtre, des statuettes et du faux-toupet »305. C’est un climax descendant
très comique, où l’usance de la noblesse de se faire portraiter est converti en image
comique et caricaturale : comme dans Pierre Grassou les bourgeois qui engagent le peintre
pour leur portrait sont décrit en façon caricaturale, leurs silhouettes rappelant la forme des
303 Ibid., p. 131. 304 Ibid., p. 206 ; c’est nous qui soulignons. 305 Ibid., p. 132.
258
légumes306, ici les recours aux arts « mineurs », tel que la lithographie, et la référence au
« faux-toupet » fait crouler les Gendelettres dans les ridicules. La vignette de Polisch
représente scrupuleusement la grosse tête d’un homme qui tient sur le cœur un papier
enroulé, le front large dépouillé de cheveux, pendant qu’une abondant chevelure – le faux
toupet – figure aux deux côtés du visage.
Figure 178 : Le Gendelettre, illustration pour "Monographie de la Presse parisienne" de Balzac, La Grande Ville, t.II
Au fur et à mesure que le lecteur avance dans le texte de Balzac, deux remarques lui se
présentent. La première concerne le style de l’article de l’écrivain, pendant que la deuxième
est fait à l’égard de l’illustration. Si dans la préface Marc Fournier soutient que les articles
du deuxième volume sont rédigés en style comique-critique, le texte balzacien paraît bien
outre la limite de ces deux catégories. La veine polémique émerge derrière le style
caricatural, et on reconnaît dans certains types de Gendelettre des personnes réelles qui
avaient attaqué Balzac et ses œuvres à travers les journaux. Néanmoins, cette veine est
306 H. de Balzac, Pierre Grassou, Pl, t.VI, p. 1103 : « En entendant le bruit de plusieurs pas dans l’escalier, [Grassou de] Fougères se rehaussa le toupet, boutonna sa veste de velours vert bouteille, et ne fut pas médiocrement surpris de voir entrer une figure vulgairement appelée un melon dans les ateliers. Ce fruit surmontait une citrouille, vêtue de drap bleu, ornée d’un paquet de breloques tintinnabulant. Le melon soufflait comme un marsouin, la citrouille marchait sur des navets, improprement appelés des jambes. Un vrai peintre aurait fait ainsi la charge du petit marchand de bouteilles, et l’eût mis immédiatement à la porte en lui disant qu’il ne peignait pas les légumes. Fougères regarda la pratique sans rire, car M. Vervelle présentait un diamant de mille écus à sa chemise. […] Suivait une jeune asperge, verte et jaune pr sa robe, et qui montrait une petite tête couronnée d’une chevelure en bandeau, d’un jaune carotte qu’un Romain eût adoré, des bras filamenteux […] » ; c’est nous qui soulignons. Le toupet de Grassou et le mot « pratique » qu’il utilise pour indiquer son client nous font immédiatement penser à l’illustration du type Gendelettre, Grassou étant décrit comme l’employé-bourgeois du monde littéraire : il est un peintre-bourgeois, qui a accepté de faire le portrait à M. Vervelle, marchand devenu riche grâce à son commerce, figure ridicule qui n’aurait jamais été pris en considération par un vrai peintre, mais que Grassou seconde après avoir vu son diamant. L’argent donne ainsi le droit à être portraité, à immortaliser sa propre figure, mais il ne confère quand même pas la célébrité ni la gloire.
259
effectivement adoucie par les illustrations : celles-ci, bien qu’elles traduisent à la lettre le
texte de Balzac, exploitent les suggestions données par l’auteur selon trois façons
différentes.
Les illustrations se partagent donc en trois groupes. Le premier regroupe les
caricatures faites sur les types présentés par la narration, tel que le Gendelettre au faux
toupet. Un autre exemple très intéressant de cette catégorie est celui du Directeur-
rédacteur-en-chef, première variété du sous-genre de Publiciste, dessiné avec une plume
énorme dans la main droite, assis au bureau et écrivant ce qu’une femme lui dicte. La
vignette illustre la phrase suivante : « C’est ou un homme fort ou un homme habile qui se
résume par une danseuse, par une actrice ou par une cantatrice, quelque fois par sa femme
légitime, la vrai puissance occulte du Journal »307. Là encore, comme dans le cas du type
Gendelettre, on trouve un jeu fondé sur l’inversion : la plume géante du publiciste rappelle
la plume des poètes, et la présence du personnage féminin renvoie à la figure de la muse ; à
la lumière du texte écrit, toutefois, cette image acquis une valeur satirique alors que la
femme – laquelle n’est pas la femme auteur, mais tout simplement une actrice ou une
danseuse – ne se limite pas à inspirer l’auteur, mais elle dicte véritablement ce qu’il doit
écrire.
Or, la même ligne est illustrée par une planche hors-texte dans la page à côté,
représentant un vieil homme en robe de chambre assis dans un fauteuil, l’expression du
visage sérieuse et pensive ; derrière lui, un bureau encombré de livres et papiers, et une
femme sur un canapé avec une cigarette allumée. C’est le deuxième type d’illustration qui
paraît dans l’article de Balzac, beaucoup plu proche au modèle énoncé par Fournier dans la
préface – de fait, c’est le modèle d’illustration prédominante de tout le deuxième tome de
La Grande Ville, alors que dans l’article de Balzac il est exploité plutôt dans la deuxième part
du texte, au moment de la description des sous-genres du genre Critique. Le « Directeur-
Rédacteur-en-chef-propriétaire-gérant » est esquissé dans son milieu quotidien dans une
représentation semi-sérieuse. La lecture d’ensemble est donc le résultat de trois éléments :
le texte balzacien, la vignette et la planche hors-texte. Bien que les illustrations soient
classifiables les deux dans la catégorie d’illustration protextuelle, les dessins présentent deux
styles différents pour la tractation du même sujet, et c’est véritablement grâce à cet enjeu
qu’on obtient la complexité d’un personnage à première vue plat :
307 Ibid., p. 134.
260
Figure 179 : Vignette Le Directeur-Rédactur-en-chef, "Monographie de la Presse parisenne", La Grande Ville, t.II
Figure 180 : Planche hors-texte avec didascalie, Le Directeur-rédacteur-en-chef, « Monographie de la Presse parisienne », La Grande Ville, t.II
261
une figure héroïque-comique à la Don Quichotte, grotesque aussi, est ainsi esquissée,
partagée entre des traits ridiculisant de la vignette et la solennité de la pose que ce nouveau
acteur de la vie moderne présente dans la planche.
Nous donnons encore quelque exemple de ces deux catégories d’illustration. Nous
citons comme exemplaires de l’illustration-caricature l’image de la variété Guérrillero : Balzac
explique que cette variété les auteurs de petites anecdotes qui remplissent les journaux
mensuels, nouvelle forme de publication « dont l’invention consistait à tâcher d’avoir de
l’esprit tous les mois, comme les petits journaux en ont tous les jours »308. Suit l’extrait de
l’un de ce texte, où toutefois le récit est fragmenté par l’insertion de huit petites vignettes
représentant une guêpe avec un visage d’homme à moustache. L’illustration, un protexte de
type interprétatif qui exploite le mécanisme de la métamorphose pour construire le jeu
caricatural, restitue ainsi l’impression que ce type de publication est comparé à un petit
animal qui fait du bruit et qui pique ; comme le lecteur est dérangé pendant sa lecture du
texte reporté par Balzac par la comparse de l’insecte dessiné qui l’interrompe, de la même
façon ces textes sont une piqure de mauvais esprit pour le lecteur du journal.
Figure 181 : Vignette pour Le Guérrillero, « Monographie de la Presse parisienne », La Grande Ville, t.II
308 Ibid., p. 203.
262
Un style caricatural que dans le deuxième type d’illustration, la scène « réaliste », s’amoindrit
énormément : dans la vignette illustrant le type de la variété Négateur du sous-genre Jeune
Critique Blond, le critique « logé dans quelque quatrième étage avec une fille »309, représente
le type immergé dans son milieu, allongé sur un canapé avec une fille lisant à ses pieds.
Figure 182 : Vignette Le Négateur, « Monographie de la Presse parisienne », La Grande Ville, t.II
Enfin, le troisième groupe d’illustration recueillit les images qui présentent des
éléments fantastiques ou des situations irréelles. À page 152, par exemple, Balzac décrit
l’Homme politique en disant que : « s’il voyage, les populations l’admirent sur son passage,
même dans les villes où il passe de nuit ; s’il paraît à l’étranger, il y produit une grande
sensation qui fait honneur à la Prusse, à l’Italie, à l’Espagne, à la Russie, et qui prouve que
ces pays goûtent les idées de l’homme politique et l’envient à la France. S’il voit le Rhin,
c’est le Rhin qui le voit »310.
Figure 183 : Vignette L'Homme politique, « Monographie de la Presse parisienne », La Grande Ville, t.II
309 Ibid., p. 173. 310 Ibid., p. 152.
263
La personnification du fleuve Rhin en veste de Bacchus renvoyant à la mythologie
classique, l’illustration, secondant les mots de Balzac, semble donc juxtaposer le mythe
grecque au mythe moderne ; néanmoins, la comparaison exprime une ironie très forte à
l’égard de l’Homme politique, confronté au dieu de l’ivresse.
Outre la présence de Bacchus, on remarque aussi un certain nombre d’animaux et
créatures appartenant au monde fantastique. L’Attaché est représenté en forme de diablotin
qui « trouble le sommeil des ministres en les taquinant »311, parodie du tableau The Nightmare
de l’anglais Henry Fuseli.
Dans la description du genre Critique, par contre, Balzac évoque une scène
particulière : « Le publique aime à ce qu’on lui serve chaque matin une foule d’auteurs
embrochés comme des perdrix et bardés de ridicule »312. La planche hors-texte qui illustre
cette phrase montre un lecteur-ogre assis à table avec une grande serviette sur le ventre, la
bouche ouverte prête à avaler des hommes minuscules ficelés à la broche que le critique-
boucher lui offre. Le passage du texte d’où la citation de Balzac est extrait est l’un des
moments qui expriment la situation personnelle de l’auteur : Balzac, attaqué
continuellement par les critiques des journaux, dénonce les attaques malveiants qu’il subit
en attribuant la faut et au public, ogre vorace de victimes, et à la figure du critique, qui se
prête trop complaisamment jeu de massacre exigé par les lecteurs.
Ces sont les illustrations eux-mêmes qui, à la fin, suggèrent combien l’expérience
personnelle de Balzac a influencé les opinions exprimées dans la « Monographie de la
Presse parisienne » : deux vignettes représentant l’écrivain lui-même paraissent dans
l’article. La première se trouve à la page 154, au moment de la description des Attachés aux
journaux républicains :
Le parti républicain surveille ses attachés, il les entretient dans leurs illusions. Un jour,
un républicain rencontre son ami sur le boulevard, un ami que son attachement aux
doctrines populaires maintenait dans une maigreur d’étique [sic] : - Tu t’es vendu ! lui
dit-il en le regardant. – Moi ! – Oui, je te trouve engraissé !313
La vignette qui suit montre un homme très maigre qui parle avec Balzac, sa célèbre canne
bien reconnaissable.
311 Ibid., p. 153. 312 Ibid., p. 170. 313 Ibid., p. 154.
264
Figure 184 : Vignette pour L'Attaché, « Monographie de la Presse parisienne », La Grande Ville, t.II
Figure 185 : Planche hors-texte pour Le Critique, « Monographie de la Presse parisienne », La Grande Ville, t.II
265
La situation est absolument singulière et ambiguë : bien qu’il soit probable que Balzac
dns son article fait référence à une épisode personnelle, nous ne sommes pas convaincue
qu’il aurait voulu être identifié avec un possible traditeur. L’image, nous semble-t-il,
retourne l’ironie sur Balzac même, faisant allusion aux changements de la pensée politique
de l’auteur. La valeur contre-textuelle de l’image prend ici la relève de l’interprétation du
texte.
La deuxième image de Balzac, enfin, paraît en cul-de-lampe à la conclusion du texte :
l’écrivain, en silhouette rondelette chargée, la canne à la main, cause avec une vieille dame,
l’allégorie caricaturée de la Presse, vêtue de feuille de journaux et coiffée d’un encrier,
trompette de la renommée dans la main droite. La vignette se réserve donc le dernier mot,
en dessinant Balzac dans le rôle de la victime de ce monstre moderne qui est la Presse.
L’illustration, encore une fois de type contre-textuelle, renverse la construction du texte
balzacien, mettant en lumière combien l’expérience personnelle de l’écrivain, bien connue
du public de l’époque, grève sur les épaules de l’auteurs.
266
Figure 186 : Vignette pour L'Attaché républicain, « Monographie de la Presse parisienne », La Grande Ville, t.II
Figure 187 : Cul-de-lampe, La Presse et Balzac, « Monographie de la Presse parisienne », La Grande Ville, t.II
267
7.4. Le Diable à Paris, ou le tiroir de l’image
L’aventure balzacienne dans la littérature panoramique s’achève avec Le Diable à Paris, livre
en deux volumes publié entre 1845 et 1846 où Hetzel propose à nouveau le schéma des
Scènes de la vie privée et publique des animaux et de La Grande Ville : l’ouvrage est en fait la
collection de plusieurs récits écrits par George Sand, Charles Nodier, Gérard de Nerval,
Théophile Gautier, Alfred de Musset, Stahl, Briffault, Soulié, Balzac, etc., et illustrés par
Gavarni, Bertall et Henry Monnier.
Comme dans Les Animaux et La Grande Ville, l’unité de l’œuvre est assurée par un
récit initial encadrant : Satan, intrigué par les histoires de certaines âmes des habitants de
Paris qui viennent d’arriver dans son royaume infernal, envoie l’un de ses fidèles diablotins,
Flammèche, faire un voyage dans la capitale française, avec l’ordre de lui transmettre des
reportages sur ce qu’il voit. Mais Flammèche, tombé amoureux d’une femme, est devenu
paresseux et n’arrive à écrire que des « billets doux ». Le diablotin alors réunit les écrivains
et les illustrateurs les plus célèbres de la ville et demande leur coopération : tous s’engagent
à rédiger un bulletin pour Satan, chacun selon l’instrument qui lui appartient, la plume ou le
crayon. Une table raisonnée des matières est jointe aux manuscrits, qui finissent dans le
Tiroir du Diable, d’où les bulletins arrivent directement au Souverain de l’Enfer.
Figure 188 et 189 : Planches hors-texte pour Le Diable à Paris, t.I
268
Cette petite histoire initiale sert en réalité à satisfaire deux exigences : la première,
nous l’avons déjà dite, est celle de garantir une unité à l’ouvrage ; la deuxième, c’est de
justifier la grande hétérogénéité qui caractérise Le Diable à Paris. Si Les Français peints par eux-
mêmes, les Scènes de la vie privée et publique des Animaux et La Grande Ville avaient tous un
thème bien défini autour duquel les écrivains composaient leurs récits – la peinture de
mœurs du peuple français par types, la peinture de mœurs par types métamorphosés et les
choses les plus caractéristiques de Paris par endroits –, Le Diable à Paris donne la liberté
complète aux écrivains aussi bien qu’aux illustrateurs. Mais, si les textes des romanciers
proposent une variété considérable de thèmes, du « Coup d’œil sur Paris » par George Sand
à « Une journée à l’école de natation » par Eugène Briffault, l’illustration n’aide guère à
mettre un peu d’ordre. Bien au contraire, dans Le Diable à Paris l’illustration rompt toute
règle de position que Les Français peints par eux-mêmes avaient systématisées : le schème
« vignette en tête de page, lettrine, type en planche hors-texte, et vignettes » ne s’applique
qu’en partie, les planches de Gavarni étant publiées séparées du texte, entre un article et
l’autre, comme une série d’illustrations hors-texte, un petit album inséré dans les pages de
l’ouvrage ; de la même façon, les vignettes, dont la plupart sont signées par Bertall – jeune
illustrateur génial découvert par Balzac –, ne se limitent plus à interrompre le texte, mais
elles se font encadrer par les mots, comme dans l’exemple suivant.
Figure 190 : Vignettes pour « Une Journée à l'école de natation » d'E. Briffault, Le Diable à Paris, t.I
269
Parfois, on trouve deux ou même trois vignettes l’une à côté de l’autre. Bertall
propose aussi de pages composées intégralement par vignettes, sorte de première version
de la bande-dessinée314. Même au niveau quantitatif, les images outrepassent cette fois-ci les
contributions des écrivains, et le livre paraît vraiment comme un album fragmenté par
l’introduction des récits.
Alors que Gavarni se consacre à l’illustrations des « Gens de Paris », c’est-à-dire des
types, dans les planches hors-texte, Bertall accomplit le même travail, mais dans la forme de
la vignette : le peintre et l’enlumineur se complètent mutuellement, l’un en poursuivant le
dessin de mœurs sur lequel il avait construit sa carrière, et l’autre avec le style de la
silhouette-charge. Gavarni donc tend à une représentation détaillée de ces types humains,
dont on distingue les trous dans les vêtements, l’espace noir des dents manquantes dans la
bouche, les rides des visages ; Bertall en revanche vise l’effet comique de ses charges, qui
acquièrent une valeur universelle et nécessitent l’écrit pour identifier les types qu’elles
représentent.
Figure 191 : Planche pour « Les Gens de Paris » de Gavarni, Le Diable à Paris, t.I
314 Sous l’influence, peut-être, de Rodolphe Töpffer, considéré comme le père de la bande-dessinée. Voir T. Groensteen, B. Peeters, Töpffer : L'Invention de la Bande Dessinée, Paris, Hermann, éditeur des sciences et des arts, 1994 ; AA.VV., I nipoti di Töpffer. Il fumetto svizzero oggi, Milano, Hazard Edizioni, 2002 ; K. Davis, Father of comic strip : Rodolphe Töpffer, Mississipi, University Press of Mississippi, 2007.
270
Pour Le Diable à Paris, Balzac rédige six articles, quatre pour le premier volume et
deux pour le suivant : Philosophie de la vie conjugale à Paris ; le cycle des Comédiens qu’on peut voir
gratis, composés par Un Espion à Paris ou Le petit père Fromenteau, Une Marchande à la toilette ou
Madame la Ressource en 1844, et Un Gaudissart de la rue Richelieu ; Ce qui disparaît de Paris ; et
Histoire et physiologie des Boulevards de Paris. En ce moment-là, Balzac vient d’achever la
publication d’une partie de La Comédie humaine, ce qui a certainement influencé les six
articles pour Le Diable à Paris : la Philosophie de la vie conjugale à Paris est bien un premier
brouillon des Petites Misères de la vie conjugale, que nous étudierons en détail dans le chapitre 9,
tandis que le cycle des Comédiens qu’on peut voir gratis provient de l’Illustre Gaudissart mais aussi
des Comédiens sans le savoir.
De fait, les thèmes abordés par Balzac s’organisent principalement autour de
deux axes : les articles du premier volume traitent principalement des types, du couple
marié aux marchands tels que le petit père Fromenteau, madame Nourrisson, marchande à
la toilette, et Gaudissart, commis ; le deuxième volume se concentre plutôt sur la
description des endroits particuliers de Paris, tels que les quartiers qui disparaissent et les
boulevards. Si donc les articles pour le premier volume ressemblent beaucoup à ceux des
Français peints par eux-mêmes, où le type est observé pendant qu’il est plongé dans son milieu,
les contributions du deuxième tome font l’opération inverse, puisque toutes les espèces
d’habitants ou promeneurs du lieu en question y sont cataloguées.
Ainsi, le lecteur apprend l’effrayante histoire de Père Fromenteau et de Mme
Nourrisson. Les histoires de ces deux personnages seront recueillies plus tard dans Les
Comédiens sans le savoir315. D’abord, on rencontre le père Fromenteau, homme de génie
tombé en disgrâce ; l’article de Balzac ne donne pas beaucoup de descriptions physiques de
ce personnage, mais Bertall ne renonce pas à le dessiner à la clôture du texte.
315 Les textes transportés dans Les Comédiens sans le savoir ne présentent pas de modifications substantielles, sauf celles concernant les corrections pour les personnages-narrateurs.
271
Figure 192 : Vignette pour Père Fromentin de Balzac, Le Diable à Paris, t.I
Par la suite, le lecteur apprend l’histoire de Mme Nourrisson, l’usurière en gonnelle,
autre renvoi à un célèbre personnage de La Comédie humaine, Jacqueline Collin, tante de
Vautrin. Appelée aussi Madame la Ressource, la marchande à la toilette trône au milieu des
parures sales et usées, comme « l’argousin dans le bagne, comme un vautour au bec rougi
sur des cadavres, au sein de son élément ». Après la description du type général de la
boutique et du personnage de la marchande à la toilette, une dame se présente au narrateur
de l’histoire :
Deux heures après, Madame Nourrisson (elle s’appelait ainsi) vint en robe de damas à
fleurs provenant de rideaux décrochés à quelque boudoir saisi, ayant un de ces châles
de cachemire passés, usés, invendables, qui finissent leur vie au dos de ces femmes.
Elle portait une collerette en dentelle magnifique, mais éraillée, et un affreux chapeau ;
mais, pour dernier trait de physionomie, elle était chaussée en souliers de peau
d’Irlande, sur les bords desquels sa chair faisait l’effet d’un bourrelet de soie noire à
jour.316
Mais c’est seulement après la sortie de scène de Mme Nourrisson que le dessin de Bertall
paraît en cul-de-lampe, à combler le vide laissé par le personnage. Toutefois, nous
remarquons combien l’illustration d’Asie (Jacqueline Collin), qui se trouve dans l’édition
Furne des Splendeurs et misères des courtisanes, et celle de Mme Nourrisson dans les Comédiens
sans le savoir, toutes les trois dessinées par Bertall, sont différentes.
316 H. de Balzac, « Une marchande à la toilette ou Madame la Ressource en 1844 », Le Diable à Paris, t.I, p. 275.
272
Figure 193 : Bertall, vignette pour « Mme la Ressource » de Balzac, Le Diable à Paris, t.I
Figure 194-195 : Bertall, Asie et Mme Nourrisson, vol. XI et XII de La Comédie humaine, éd. Furne, 1844 et 1846
273
Si les deux Mme Nourrisson se ressemblent beaucoup, Asie, la tant de Jacques
Collin, allias Vautrin ou Trompe-la-Mort, ne présente aucune similitude avec les deux
marchandes à toilette. Cette incongruité serait-elle en quelque sorte délibérée, pour
souligner l’habilité de Jacqueline Collin dans ses déguisements, ou Bertall n’a pas associé les
deux personnages ? Nous n’avons pas de réponses à ces questions, puisque ni Bertall ni
Balzac ont laissé de commentaires sur ce sujet.
Le troisième type présenté, Gaudissart, le commis voyageur, porte le nom d’un
personnage que Balzac avait inventé dans les années 1830, paru dans le récit L’Illustre
Gaudissart. L’article du Diable à Paris, titré « Un Gaudissart de la rue Richelieu », renvoie
évidemment au roman balzacien. Toutefois, cette fois-ci les deux textes sont différents :
« Un Gaudissart de la rue Richelieu » ne raconte pas l’histoire personnelle de Gaudissart
mais se présente au contraire comme la description physiologique du type commis. Les
deux vignettes de Bertall représentent respectivement le « Gaudissart sur place », « égal en
capacité, en esprit, en raillerie, en philosophie, à l’illustre commis voyageur devenu le type
de sa tribu », qui « ne doit se facultés qu’à son milieu de marchandises, comme l’acteur n’est
sublime que sur son théâtre »317 ; et le maître de ces commis, « un gros bonhomme à figure
épanouie, à front demi-chauve, à ventre de député ministériel »318. Les deux types n’ont rien
à voir avec le personnage de Gaudissart : ce dernier est une caricature vivante, alors que les
premiers deux ressemblent plutôt à un dandy et à un député.
317 Ibid., p. 290. 318 Ibid., p. 292.
274
Figure 196 : Planche pour L'Illustre Gaudissart, La Comédie Humaine, t. VI, éd. Furne, 1843
Figure 197 et 198 : Bertall, le type du commis et son maitre, « Un Gaudissart de la rue Richelieu », Le Diable à Paris, t.I
275
Dans le deuxième volume du Diable à Paris, en revanche, le lecteur dans la Physiologie
des Boulevards de Paris traverse la ville entière, en croisant l’auteur même de ce voyage, Balzac
saluant Hetzel.
Figure 199 : Vignette pour « Histoire et physiologie des boulevards de Paris » de Balzac, Le Diable à Paris, t.II
Alors que dans le premier volume la plume de Balzac est accompagnée quasi exclusivement
du crayon de Bertall, dans le deuxième c’est le paysagiste Bertrand qui intervient, en grande
quantité, pour compléter le récit de l’auteur : Ce qui disparaît de Paris et Histoire et Physiologie
des boulevards de Paris sont un montage de types et de lieux qui sont en train de disparaître,
soit à cause du progrès technologique soit à cause des politiques urbanistique qui vont
changer le visage de la ville. Là, c’est bien le Balzac « archéologue de Paris », comme l’a
défini Jeannine Guichardet319, qui émerge, soutenu par l’illustration.
Le Tiroir du Diable est donc rempli par toutes ces images qui envahissent les textes
et qui se présentent de manière autonome sous la forme de planches hors-texte. Une autre
construction typographique du livre est alors proposée par Le Diable à Paris, subordonné à
l’abondance de l’illustration. Ce que nous allons voir dans le prochain chapitre est alors le
modèle typographique Balzac va adopter pour sa « Grrrrande Comédie », comme il
l’appelle en imitant l’accent de Mme Hanska et le roulement du tambour du batteur : nous
avons vu l’importance de certains éléments paratextuels tels que le frontispice et la table des
matières, qui sont des indicateurs de la valorisation reconnue de l’illustrateur, et parfois
aussi du graveur. La position des images a également son importance, comme elle dévoile
un mécanisme qui reste dans les coulisses de l’œuvre : la présence d’un ordre et d’une place
spécifiques des illustrations signale la présence d’un projet raisonné, où s’ébauche l’équilibre
319 J. Guichardet, Balzac « archéologue » de Paris, op. cit.
276
– effectif ou poursuivi – entre écrivains et dessinateurs. Le sujet de l’image, enfin, relève du
choix des éléments à mettre en lumière à travers l’image : si Les Français peints par eux-mêmes
marquent nettement la prédominance de la représentation du type social, certains ouvrages
comme Les Scènes de la vie privée et publique des Animaux soutiennent la parité de nombre entre
types et scènes. Balzac, qui connaît parfaitement ces œuvres, a eu certainement l’embarras
du choix pour La Comédie humaine, non seulement parce qu’il avait déjà expérimenté
plusieurs formes du livre illustré mais aussi parce que l’un de ses éditeurs est l’homme qui a
permis et encourage l’émergence du livre romantique, Pierre-Jules Hetzel. Quelle formule
choisissent-ils ? Vignettes, planches hors-textes ou les deux ? Types ou scènes ? Qui est-ce
qui a le dernier mot sur les décisions regardant les illustrations ? Reconnaissent-ils
l’importance des dessinateurs dans l’édition de La Comédie humaine ? Ceux-là sont les
questions que nous nous sommes posées dans le chapitre 8.
Figure 200 et 201 : Bertall et Bertrand, vignettes pour « Histoire et physiologie des boulevards de Paris » de Balzac, Le Diable à Paris, t.II
277
CHAPITRE 8
LA COMÉDIE HUMAINE ILLUSTRÉE. UN MONUMENT DE STATUES
Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius,
Quod non imber edax, non Aquilo impotens
Possit diruere aut innumerabilis
Annorum series et fuga temporum.
Horace, Odes, III, 30
Les Français peints par eux-mêmes en cours de publication, Balzac parvient à trouver quatre
éditeurs – Furne, Dubochet, Paulin, et successivement Hetzel – qui sont disposés à se
réunir pour publier ses œuvres complétes que l’écrivain choisit d’intituler La Comédie
humaine. C’est l’« Édition » capitale, celle qu’il attendait depuis 1838. L’entreprise est
titanesque : l’édition, qui prend le nom de Furne puisqu’il est celui qui investit le plus dans
le projet, est composée par seize volumes in-8° ; la présence des illustrations sur bois de
bout, créées par les illustrateurs les plus célèbres du moment, fait de l’œuvre une édition de
luxe320. La parution de La Comédie humaine fait l’objet d’une grande publicité : affiches,
prospectus, annonces dans les journaux, la nouvelle œuvre de Balzac est bien lancée, et
commence à paraître sous forme de livraisons avec couverture jaune ou rose, sur laquelle
est gravée une vignette.
Toutes ces conditions semblent favorables au succès de l’édition : Balzac est de plus
en plus populaire, ses romans sont appréciés surtout par le public féminin, qui fait la chasse
au livre dès l’avis de la parution d’une nouvelle œuvre de l’écrivain. Pourtant, la critique est
encore loin de reconnaître à l’auteur d’Eugénie Grandet une place dans le Panthéon des
auteurs « illustres » de la France romantique, mais seulement parmi ceux qui sont
« illustrés », voire caricaturés, dans le Panthéon charivarique. La Comédie humaine ne sera pas
vraiment un succès, et Furne, resté seul à gérer l’entreprise, en 1848 laisse à son premier
commis, Houssiaux, les droits pour la deuxième édition, laquelle sera publiée après la mort
de Balzac dans les années 1850 – édition connue aujourd’hui sous le nom de « Furne
corrigé ». Par l’épistolaire balzacien, on sait que Balzac fonde beaucoup d’espoirs dans cette
320 Nous rappelons que le bois de bout est, avec la lithographie, l’un des nouveaux procédés du siècle, arrivé en France dans les années 1820, et qui demande des illustrateurs et des graveurs spécialisés dans cette technique. De plus, l’illustration est encore loin d’être « industrialisée », comme le dirait Sainte-Beuve : l’illustration « sérielle » des œuvres littéraires ne commencera qu’à partir des années 1850.
278
réédition, pour laquelle il prépare ses corrections sur ses exemplaires du Furne. Mais la
maladie l’empêche de finir les corrections et l’écriture des ouvrages manquants figurant
dans son catalogue ; La Comédie humaine reste donc inachevée.
De la même façon, l’illustration de l’édition Furne est incomplète autant que
l’écriture : comme nous le verrons au cours du présent chapitre, La Comédie humaine, bien
qu’édition de luxe, présente un apparat iconographique tellement hétérogène et discontinu
que tous les experts balzaciens hésitent à en entreprendre un commentaire détaillé321.
Balzac lui-même, semble-t-il, ne sait vraiment pas que dire sur ses illustrations. Le 17 août
1842, Balzac écrit au Comte Antoine Apponyi, ambassadeur d’Autriche à Paris322, pour lui
offrir un exemplaire du premier volume de La Comédie humaine :
Si j’ai pris la liberté de vous offrir la Comédie humaine pour votre belle bibliothèque,
c’est moins à titre d’ornement littéraire que comme curiosité bibliographique. Ce livre
a cela de curieux, qu’il est le premier où l’on ait pu réunir le luxe et la perfection qui
distinguent les livres tirés à la presse à bras, tout en l’en [sic] exécutant le tirage à la presse
mécanique. Cette espèce de triomphe qui consiste à faire tomber juste les lignes les unes
sur les autres dans la retiration, c’est-à-dire en tirant le second côté de la feuille au revers
du côté déjà noirci, s’est constamment bien accompli. Cela, de même que l’égalité de la
couleur et du foulage, n’avais jamais été obtenu ni en Angleterre ni à Paris, et n’a pu
s’obtenir à Paris que dans une seule imprimerie où l’on a spécialement étudié la presse
mécanique. Sous le rapport du bas prix, c’est aussi l’un des effets de notre librairie, qui,
malgré le défaut de protection, tâche de lutter avec la Belgique, qui n’a pas de droits
d’auteur à payer sur ses publications. Dans tout autre pays qu’en France, le prix du
papier de ce livre coûterait ce que coûte tout le livre. À part la curiosité typographique,
les gracieusetés de votre Excellence et de Madame la comtesse d’Apponyi m’auraient
donné le droit de vous l’offrir comme un remerciement. Nous serons encore deux
321 On pense notamment à l’article paru sur Littera de N. Preiss (op. cit.), et aux travaux de S. Le Men, qui a consacré des études au rôle de l’illustration dans La Comédie humaine : ses analyses des rapports entre Balzac et ses illustrateurs constituent un outil indispensable à la compréhension des rapports de force existant entre l’écrivain et ses illustrateurs, mais elle n’entre pas vraiment dans la question du rapport entre le texte et l’image. Nous renvoyons notamment à : « La ˝littérature panoramique˝ dans la genèse de La Comédie humaine : Balzac et Les Français peints par eux-mêmes », AB 2002, pp. 73-100 ; Id., Une Comédie inachevée : Balzac et l’illustration, Tours, Bibliothèque municipale de Tours, 1999. 322 Selon la notice donnée au tome II de la Correspondance de Balzac, le comte et la comtesse Apponyi étaient les ambassadeurs d’Autriche à Paris entre 1826 et 1849. Les Apponyi avaient ouvert leur salon au monde intellectuel parisien, et Balzac y fut reçu à partir de 1834. Voir la notice de Roger Pierrot pp. 801-802.
279
années à terminer cette longue entreprise, car La Comédie humaine aura près de vingt
volumes […].323
L’entreprise Furne de La Comédie humaine vient de publier le premier volume de ce projet
colossal quand Balzac rédige cette lettre.
La présentation que l’écrivain fait de l’édition de ses œuvres complètes est assez
particulière : il laisse de côté tout discours sur sa valeur artistique-littéraire pour souligner la
nouveauté qui concerne l’aspect typographique du livre. Ce qu’il est intéressant de voir
dans cette lettre, ce sont les éléments qui entrent dans ce que Balzac nomme « curiosité
bibliographique », ou encore une « curiosité typographique » : comme nous l’avons vu dans
le chapitre 5, Balzac avait utilisé la même expression en 1839 pour le premier volume des
Études sociales publiées chez Delloye et Lecou, contenant La Peau de chagrin ; cette « curiosité
typographique », qui est souvent interprétée comme une référence aussi aux illustrations,
trouve ici une démonstration très forte du contraire. Balzac est l’un des premiers parmi les
auteurs romantiques auquel est consacrée une impression des œuvres complètes illustrées
et, en dépit de cela, il n’y fait aucun type d’’allusion : il parle de la différence entre la presse
à bras et la presse mécanique, la qualité de l’encre, le prix du papier, le coût du livre, mais il
ne dit rien à l’égard des images qui enrichissent l’édition. Pourtant, les seize volumes de La
Comédie humaine seront illustrés de cent seize gravures, des bois de bout en forme de
planche hors-texte.
Or, c’est un comportement assez étrange de la part de Balzac, mais cela appartient
peut-être au jugement ambigu que l’auteur a toujours montré vis-à-vis de l’illustration : si
d’un côté Balzac contribue à l’essor du livre illustré en participant aux ouvrages de la
littérature panoramique, que nous venons d’analyser, et en acceptant de faire illustrer ses
œuvres complètes, les affirmations sévéres qu’on trouve dans ses lettres vont dans le sens
contraire. Ainsi, s’il dit à Mme Hanska que « les deux premières vignettes de La Comédie
humaine sont délicieuses »324, les vignettes des Scènes de la vie privée et publique des Animaux ne
lui plaisent du tout. Laissons donc de côté pour le moment ce qui est le jugement de Balzac
à propos de la valeur des illustrations et intéressons-nous à l’architecture de La Comédie
humaine illustrée pour tenter de pénétrer ce mystère.
323 H. de Balzac, Corr., t.IV, pp. 482-483 ; c’est nous qui soulignons. 324 H. de Balzac, LH, t.I, p. 575.
280
8.1. L’entreprise Furne : derrière les coulisses avec le péritexte
Avant de parcourir les pages des volumes de l’édition Furne, et de voir comment les
illustrations se fonctionnent avec le texte, il est indispensable de prendre en considération
encore quelques lettres de Balzac. Cette petite digression dans le péritexte met en lumière
l’intérêt et le contrôle que Balzac a exercés sur la production des planches de La Comédie
humaine : de fait, c’est à travers la correspondance balzacienne que nous pouvons identifier
ce que l’écrivain cherchait dans les images dessinées pour ses œuvres.
Quatre ans ont passé depuis la première annonce du projet d’une « impression
complète de mon œuvre, avec vignettes »325, quand le 1er juin 1841 Balzac écrit à Mme
Hanska qu’: « Enfin, d’ici à un mois, n[ous] publions mon œuvre, sous le titre de La Comédie
humaine par livraisons, et il faudra que je corrige au moins 3 fois 500 feuilles d’impression
compactes »326. C’est la toute première mention du titre général de l’ouvrage que Balzac fait
à la comtesse, mais l’écrivain n’explique pas le choix de ce titre qui rappelle La Divine
Comédie de Dante ; la date de l’annonce aussi surprend un peu, puisque le premier contrat
entre Balzac, Hetzel, Paulin et Dubochet qui nous est parvenu date d’avril 1841 (il est
toutefois fort probable que la lettre où Balzac donne la nouvelle à la comtesse a été
perdue).
Après quelques jours passés sans avoir de nouvelles de Mme Hanska, Balzac
s’inquiète de ce silence ; il écrit une autre lettre, et ajoute des informations :
L’édition de La Comédie humaine, (tel est le titre de l’ouvrage complet dont les
fragments ont composé jusqu’à présent les ouvrages que j’ai donnés) va prendre 2 ans
et contient 500 feuilles d’impressions compactes à lire, et mes travaux habituels n’en
doivent pas souffrir. Mes libraires ont décidé de joindre à chaque livraison une
vignette. Cette révision générale de mes œuvres, leur classement, l’achèvement des
diverses portions de l’édifice me donnent un surcroît de travail que moi seul je
connais, et qui est écrasant.327
Balzac tient à insister sur la difficulté, mentale et physique, outre que matérielle, que cette
impression lui demandera, et les chiffres rapportés à Mme Hanska sont effectivement
élevés. Mais c’est la phrase que nous avons soulignée qui nous intéresse le plus, car elle
325 Ibid., p. 391. 326 Ibid., p. 531. 327 Ibid., p. 534 ; c’est nous qui soulignons.
281
pourrait fournir la preuve que la décision d’illustrer La Comédie humaine a été prise après le
premier accord fait avec les éditeurs, probablement au début du mois de juin, vu que dans
la lettre du 1er de ce mois-là Balzac ne cite pas la clausule des vignettes.
De plus, cela nous met au courant du fait que la décision d’insérer les vignettes dans
l’ouvrage a été prise par les éditeurs ; certes, nous savons que Balzac peut avoir encouragé
cette solution, du moment que les Études sociales qui devaient paraître chez Delloye et Lecou
étaient censées être illustrées, avec le consentement de l’auteur. De toute façon, ce qu’il est
important de souligner, c’est que ce sont les éditeurs qui avaient le droit de prendre ce
choix, et non l’écrivain ; cela pose plusieurs questions sur les rapports de force qui vont
s’instaurer entre les éditeurs, les illustrateurs et Balzac, et nous amène à nous interroger sur
la part prise par l’auteur à l’égard des sujets à illustrer.
La correspondance que Balzac entretient avec les éditeurs, surtout avec Hetzel,
montre une certaine attention de l’écrivain à cette question : six lettres contenant des
indications sur les illustrations à exécuter nous sont parvenues, et certainement elles ne sont
qu’un petit témoignage du vif intérêt qui pousse Balzac à surveiller la production des
dessins. La lettre envoyée en octobre 1841 démontre l’enthousiasme initial de l’écrivain, qui
s’adresse à Hetzel en donnant un plan des illustrations à faire pour les Scènes de la vie de
province et les Scènes de la vie privée :
Avec des artistes comme Gérard-Séguin et Meissonnier [sic], il faut s’y prendre bien à
l’avance, or, dans le 1er volume des Scènes de la vie de province, qui contiendra l’Abbé
Troubert, Pierrette et la Rabouilleuse il faut donner à Gérard-Séguin l’Abbé Troubert (1), et
Pierrette (2), et à Meissonnier l’Abbé Birotteau (3), à Monnier Philippe Bridau (4), le colonel
Gouraud (5), l’avocat Vinet (6) – à Meissonnier la mère Lorrain (7) – la Rabouilleuse (8) à
Gavarni – Roguin (9) à Daumier. En leur donnant de l’avance ainsi à eux et aux
graveurs, vous vous en trouverez mieux. […] Dans le 4e volume des Scènes de la vie
privée, il faudrait donner Ursule Mirouët (1) à Gérard-Séguin – Goupil (2) à Monnier –
Minoret (3) le maître de poste à Monnier – le Curé Chaperon (4) à Meissonnier – Madame
de la Portenduère (5) à Meissonnier – Le Docteur Minoret (6) à Grandville. Dans le Contrat
de mariage, Mathias, le vieux notaire (7) à Meissonnier – Madame Évangelista (8) à
Géniole, et Manerville (9) à Gavarni. Dans le 3e volume, il n’y a que Meissonnier
282
capable de faire Gobseck, et je retiens le dessin pour moi, dites-le lui. C’est le rival de
Shylock. Je tâcherai de décider Ingres à nous faire Eugénie Grandet.328
Parmi toutes ces indications-là, une seule sera exécutée : le personnage de Philippe Bridau
sera effectivement illustré par Henri Monnier. Sept personnages sont de même représentés,
mais par un illustrateur différent de celui indiqué par Balzac : l’Abbé Birotteau, La
Rabouilleuse, le Curé Chaperon, Mme de Portenduère seront illustrés par Monnier ; Goupil
sera dessiné par Célestin Nanteuil ; Gobseck par Charles Jacque. Eugénie Grandet contient
trois illustrations, mais les crayons à l’œuvre seront ceux de Monnier et de Nanteuil, et non
celui d’Ingres. L’Abbé Troubert, Pierrette, la mère Lorrain, le Colonel Gouraud, l’avocat
Vinet, Roguin, Ursule Mirouët, Minoret, Minoret le maître de poste, le docteur Minoret,
Mme Évangelista et Manerville en revanche ne sont pas illustrés. La structure même des
Scènes et des ouvrages n’est pas celle donnée par Balzac dans cette lettre : Ursule Mirouët, par
exemple, passe des Scènes de la vie privée aux Scènes de la vie de province, au cinquième volume.
Il est évident que le chantier de La Comédie humaine est encore au stade initial, ce qui
justifie ces changements en cours d’œuvre. De toute façon, à travers cette lettre Balzac
inaugure et fixe une méthode de travail qui sera constante dans la construction de la partie
iconographique de l’édition Furne : c’est Balzac qui cherche à prendre le pas sur l’éditeur et
sur les illustrateurs en commandant les personnages à dessiner.
De plus, l’écrivain insiste sur le fait de donner à l’avance ses livres aux illustrateurs :
En leur donnant de l’avance ainsi à eux et aux graveurs, vous vous en trouverez
mieux. Je vous donnerai des indications semblables pour le 3e et 4e volume des Scènes
de la vie privée à mesure qu’elles me viendront à l’esprit, mais il est indispensable que les
dessinateurs lisent le livre.329
Voilà l’indication la plus importante : les dessinateurs doivent lire le livre qu’ils illustrent.
Entre 1841 et 1843, d’autres lettres montrent l’attention de Balzac envers les gravures
de son œuvre. En novembre Balzac écrit à Hetzel qu’ « il y a un délicieux dessin à faire
dont le sujet est dans La Bourse (feuille 10) pages 152 et 153, il s’agit de donner une bonne
feuille de La Bourse à celui de v[os] artistes qui pourra bien rendre l’amiral Kergarouët suivi
328 H. de Balzac, Corr., t.IV, pp. 329-330. 329 Ibid., p. 329.
283
de son ombre, c’est q[ue]lq[ue] chose qu’un sujet si comique, il peut tenter Grandville »330.
Grandville évidemment ne sera pas tenté, vu qu’il ne produira aucune illustration pour La
Comédie humaine.
Encore, le 18 août 1842, Balzac fait le point avec Hetzel sur les personnages qu’il
veut illustrer pour Ursule Mirouët, Pierrette et Eugénie Grandet, indications qu’il avait déjà
données en novembre 1841 pour le tome V : « Dans Ursule, il faut faire le Curé Chaperon,
Goupil. Dans E. Grandet : le père Grandet, la Grande Nanon, Madame Grandet. Dans Pierrette :
Vinet, le colonel Gouraud ou Rogron ». Cependant, outre ce mémorandum la lettre contient
aussi des reproches de Balzac à l’éditeur :
Je vous ai écrit chez vous que tout Même Histoire était intitulé [sic] la Femme de trente ans.
Ainsi la Déclaration se trouve dans le 1er chapitre intitulé Premières fautes. À quoi cela
servait-il d’aller chez vous, vous y écrire là-dessus ?...Hurluberlu !...Quant à Crottat, il
n’est pas dans César Birotteau, il n’y est que clerc, il faut le mettre à sa place dans la
Femme de trente ans, chapitre le Doigt de Dieu. Rien de tout cela n’arriverait si Plon avait
marché, car vous auriez eu constamment un volume en bonnes feuilles pour y choisir
à votre aise les gravures à faire.331
Le mécontentement de l’écrivain vis-à-vis d’Hetzel et de l’imprimeur Plon est fort : non
seulement Plon travaille lentement, puisqu’il « ne fait pas en moyenne 3 feuilles par
semaine »332, mais sa lenteur détermine le manque d’un tirage « en bonnes feuilles » pour
Hetzel, ce qui causerait, selon Balzac, l’impossibilité de l’éditeur de choisir à son aise les
gravures à commander. Cela veut dire que le choix du sujet à illustrer était pris par Balzac
mais aussi par l’éditeur Hetzel lui-même.
Et non seulement par Hetzel : dans une lettre adressée à Dubochet au début de
novembre 1842, où Balzac exprime la même plainte à l’égard de la lenteur de Plon,
l’écrivain écrit que :
J’ai envoyé Dubois lui [Plon] dire de continuer, je vous en prie allez aussi dire à Plon
d’aller et d’aller un peu plus vite, car les efforts que j’aurais faits pour vous donner un
volume d’avance pour les vignettes seront perdus. Ce volume-là doit avoir une fin à
composer, comme Albert Savarus, en manuscrit chez Plon, et il faut savoir le plus tôt
possible ce que fera la copie donnée, le Messager attend attend cette composition […].
330 Ibid., p. 339. 331 Ibid., pp. 483-484 ; c’est nous qui soulignons. 332 Ibidem.
284
En 40 jours Plon a fait 9 feuilles, c’est une dérision, à moins que vous ne lui ayez dit
d’aller lentement, et c’était surtout dans ce volume-là qu’il fallait soigner les vignettes,
j’en ai indiqué 3 pour Henri Monnier et 1 pour Johannot. Ça peut faire 4 chefs-
d’œuvre. Il faut prier Johannot de bien soigner Coralie et la donner à un bon graveur.333
L’ouvrage en question est évidemment Illusions perdues. En fait, juste quelques jours avant
Balzac avait écrit à Henri Monnier à propos de cette œuvre :
Mon cher Monnier, il y a dans Illusions perdues 3 figures qui te vont admirablement. 1°
C’est Sèchard un vieil imprimeur soulographe pour lequel Dubois (un associé [de]
Lacrampe) t’indiquera un modèle. 2° Camusot, l’entreteneur de Coralie. 3° Braulard, le
chef de la claque, marchand de billets. Ton Curé Chaperon est très bien.
Au-dessous de ces mots, on y trouve aussi quelques lignes de la main de Hetzel, qui
demande à Monnier d’exécuter les trois dessins indiqués par Balzac le plus vite possible.
La liste des personnages pour Monnier n’est pas encore achevée. Le 14 janvier 1843
Balzac écrit au caricaturiste pour lui demander d’autres illustrations :
Mon cher Monnier, J’ai écrit à Hetzel pour qu’il te donne à faire le Curé Birotteau,
Madame Descoings (la vieille actionnaire de la loterie royale de France), Philippe
Bridau, Flore Brazier, et l’illustre Gaudissart, ces cinq chefs-d’œuvre que tu feras
mieux que qui que soit. Puis vois si tu veux te faire en Bixiou que je te recommande.
[…] Ce serait alors 6 figures, mais elles sont à faire en 8 jours, nous sommes
affreusement pressés.334
Comme le mentionne la note en bas de page de Roger Pierrot, l’urgence avec laquelle
Balzac requiert les illustrations à Monnier est causée par la décision de l’auteur de publier le
tome VIII, contenant Le Curé de Tours, Un Ménage de garçon [La Rabouilleuse], L’Illustre
Gaudissart et La Muse du département, avant le tome VI, celui des Illusions perdues, que Balzac
n’arrivait pas à achever.
Comme nous l’avons suggéré tout à l’heure, il est fort probable que Balzac ait envoyé
d’autres lettres du même genre aussi dans les années suivantes, ou que d’autres messages
avec des indications pareilles écrits entre 1841 et 1843 aient été perdus. Les lettres qui nous
ont parvenues suffisent quand même à identifier un modus operandi balzacien : les indications
de l’écrivain se limitent à être des listes des noms des personnages à illustrer, qui ne
333 Ibid., pp. 509-510 ; c’est nous qui soulignons. 334 Ibid., p. 540.
285
fournissent toutefois aucune autre recommandation sinon celle de les bien soigner ou de
lire le texte. Cela veut dire que Balzac laissait aux illustrateurs le choix des éléments du
personnage à mettre en évidence à travers le dessin.
De plus, ces lettres de Balzac créent à travers l’énumération des personnages un effet
catalogue qui cause ce qu’Umberto Eco a appelé la « vertige de la liste »335 : les listes des
personnages balzaciens sont comparables au catalogue des femmes aimées par Don Juan
établi par Leporello, c’est-à-dire à une collection de noms.
Cependant, si Umberto Eco se concentre sur les listes par excès, le catalogue
balzacien est à étudier dans le sens opposé : sur les mille personnages de La Comédie
humaine, où on ne compte pas les différentes incarnations et transformations de certains
d’eux, la liste des personnages illustrés est très courte C’est alors une liste composée par
personnages illustrés, personnages qui auraient dû être illustrés, et personnages non
illustrés.
Un petit bilan de toutes ces listes d’illustrations commandées par Balzac et de celles
effectivement présentes dans les volumes de l’édition Furne sera sans doute utile pour
identifier le motif dans le tapis de l’iconographie de La Comédie humaine.
8.2. La Comédie humaine illustrée : le « vertige de la liste »
Quand nous ouvrons finalement les seize volumes de La Comédie humaine, le premier détail
qui saute aux yeux est la disposition des illustrations dans l’espace du livre, où la localisation
des planches rappelle instinctivement celle des Français peints-par eux-mêmes : généralement,
chaque œuvre est dotée d’une seule illustration, qui paraît à côté de la première page de
l’histoire, à la façon d’un frontispice. L’hypothèse élaborée par Ségolène Le Men, selon
laquelle Les Français peints par eux-mêmes auraient constitué le paradigme iconique des
illustrations de La Comédie humaine336, semble bien fondée.
335 U. Eco, Vertige de la liste, Paris, Flammarion, 2009. 336 Voir S. Le Men, « L’illustration de La Comédie humaine dans l’édition Furne : l’art de l’observateur » dans Une Comédie inachevée : Balzac et l’illustration, cat. exp., Tours, Bibliothèque municipale de Tours, 1999, pp. 9-10 ; et Id., « La littérature panoramique dans la genèse de La Comédie humaine : Balzac et Les Français peints par eux-mêmes », L’Année Balzacienne 2002, pp. 73-100.
286
Figure 202 : Philippe Brideau dans Un Ménage de garçon, La Comédie humaine
Cependant, si Les Français, comme nous l’avons déjà souligné dans le chapitre 7,
suivent un schéma très précis et régulier, qui détermine la présence d’une planche-
frontispice, une vignette en tête de page et une lettrine pour chacun de ses articles, le plan
des gravures de La Comédie humaine n’est pas aussi méticuleux que ça : sur 88 titres, 59 ont
été illustrés, mais 29 sont totalement dépourvus d’images ; le volume XIII a paru
entièrement sans planches, aussi bien que le XVII, à savoir le volume ajouté par Houssiaux
en 1848 (qui fait monter le numéro des ouvrages non illustrés à 31).
De même, les récits illustrés sont susceptibles de variations arbitraires dans la
quantité d’images présentes dans chaque roman et nouvelle : parmi les 59 ouvrages
contenant des gravures, 29 récits comptent une illustration, 14 deux illustrations, 7 trois
illustrations, 6 quatre illustrations et 3 six illustrations. S’il est vrai que pour chacun d’eux la
première illustration est située presque toujours à côté de la page initiale du récit, toutes les
autres images ne démontrent aucun ordre spécifique dans le choix de leur place dans le
texte : le seul motif qui porte à commander une illustration est lié aux personnages. Le type
d’image choisie aussi n’est pas fixe : même si la grande majorité des gravures est composée
par des portraits, on trouve aussi douze scènes ; cela veut dire que cent personnages sont
portraiturés.
L’intuition de Ségolène Le Men, selon laquelle Balzac aurait commandé des
illustrations seulement pour les personnages, les types, semble assez plausible : les lettres
287
que nous avons transcrites dans le sous-chapitre précédent conduisent en réalité vers cette
hypothèse, vu que Balzac ne demande que cela, même s’il faut constamment se rappeler
que ni lui ni Hetzel l’affirment clairement dans leurs lettres. La présence de Pierre-Jules
Hetzel parmi les éditeurs de La Comédie rend certainement encore plus plausible
l’hypothèse, puisque Hetzel n’a pas tardé à exploiter le système de la représentation des
types des Français peints par eux-mêmes dans ses Scènes de la vie privée et publiques des Animaux.
Les deux illustrations pour La Physiologie du mariage, notamment, calquent leur système de
représentation de types : on y retrouve « la Femme honnête », qui se promène le long un
boulevard, dont on aperçoit les vitrines des boutiques derrière elle, et « le Célibataire ». Mais
il suffit de voir ces deux images pour voir un manque dans l’organicité du système
iconographique de l’édition Furne : le Célibataire répond effectivement au type iconique
établi par Les Français, alors que la Femme honnête échappe à la règle du fond neutre.
Infraction qui se présente plusieurs fois dans les seize volumes.
Figure 203 et 204 : Planches pour La Physiologie du mariage, La Comédie humaine
Toutefois, si Les Français peints par eux-mêmes sont éminemment construits sur le
modèle de l’encyclopédie, et, par conséquent, l’unité de l’ouvrage est constituée à travers
l’organisation en articles qui reflètent la structure « par entrées » de ce genre, La Comédie
288
humaine, qui se veut une œuvre unique, cyclique, perde son d’organicité véritablement à
cause aussi337 de la série d’images posées en façon de frontispice.
De fait, comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, le frontispice est une illustration
placée au début d’un texte, sorte de seuil qui introduit à l’architecture du récit ; ainsi,
trouver un frontispice nouveau à chaque ouvrage contenu dans La Comédie équivaudrait à
souligner son indépendance par rapport aux autres récits. Ces illustrations en façon de
frontispice paraissent comme des images isolées : sorte d’affiche du texte, la gravure
anticipe le moment auquel elle fait allusion, en invitant le lecteur à courir vers la page à
laquelle elle est ancrée. Au frontispice de La Maison du chat-qui-pelote, par exemple, titre qui
ne laisse pas présager les noms des protagonistes, on trouve M. Guillaume qui travaille dans
sa boutique ; un lecteur qui ne connaît pas ce texte est fortement tenté de sauter à la page
où M. Guillaume paraît en scène, pour découvrir qui il est. Ou bien dans Le Message, où l’on
trouve l’image d’une jeune dame désespérée, affalée sur une botte de foin, assistée par une
autre femme : si le lecteur n’a jamais lu l’histoire auparavant, cette image est pour lui une
énigme totale.
De plus, deux images sont mal placées : Madame Latournelle, personnage de Modeste
Mignon, paraît en frontispice à Béatrix ; et M. Vervelle, le bourgeois qui possède une
collection faite exclusivement par les copies des grands chefs-d’œuvre effectuées par Pierre
Grassou, est illustré en frontispice de La Maison Nucingen.
337 Nous disons « aussi » parce que d’autres études ont déjà mis en lumière le contraste interne à La Comédie humaine, dans sa tentative d’être une seule œuvre composée, pourtant, par plusieurs fragments ; nous nous référons notamment à l’ouvrage collectif dirigé par Isabelle Tournier et Claude Duchet, Le « Moment » de La Comédie humaine : Balzac, Œuvres complètes. Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 1993.
289
Figure 205 et 206 : Père Guillaume dans La Maison du chat-qui-pelote et Le Message, La Comédie humaine
Figure 207 : Mme Latournelle en façon de frontispice à Béatrix, au lieu de Modeste Mignon, La Comédie humaine
290
Figure 209 : Daumier, Père Goriot dans Le Père Goriot, La Comédie humaine
Figure 208 : M. Vervelle en façon frontispice à La Maison Nucingen au lieu de Pierre Grassou, La Comédie humaine
291
Nous arrivons maintenant à la question qui embarrasse toujours les chercheurs qui
essaient de traiter les illustrations de l’édition Furne : de fait, il est bien difficile de faire un
discours général sur les illustrations qui enrichissent cette édition, non seulement à cause de
l’hétérogénéité du style des images, dont nous venons de parler, mais aussi à cause du fait
que les planches du Furne laissent inéluctablement une impression d’insatisfaction.
Exception faite pour quelques personnages, qui, comme le Père Goriot d’Honoré Daumier
doit à la verve originale de son illustrateur une réussite non commune, la plupart des autres
planches restent très difficiles à commenter.
En créant l’Annexe 9, l’analyse de chaque illustration du Furne a mis en évidence
que toutes les images entretiennent avec le récit balzacien une relation protextuelle, sauf la
planche consacrée à Coralie dans Illusions perdues, où l’actrice, qui devrait être esquissée
pendant son spectacle, faisant « la joie de la salle, où tous les yeux serraient sa taille bien
prise dans sa basquine, et flattaient sa croupe andalouse qui imprimait des torsion lascives à
la jupe », est saisie dans une scène que la narration de Balzac ne raconte pas, une vieille
femme – vraisemblablement Bérénice, sa servante – aidant Coralie à s’habiller.
Figure 7 : Coralie dans Illusions perdues, La Comédie humaine
292
Il semble que la seule manière de réussir à décrire et à donner un aspect unitaire aux
illustrations du Furne est de les voir, dans leur ensemble, comme une galerie de types : de
fait, les personnages illustrés incarnent dans leur être une « idée dans l’image », un universel
dans le particulier. Ainsi, nombreux sont les pavillons de cette galerie. L’aile des « pères »,
de sang ou putatifs, par exemple, est extrêmement riche : M. Guillaume, M. de Fontaine, le
père Grandet, le père Goriot, le père Séchard, Gobseck, le comte de Mortsauf, Ferragus,
Vautrin, Balthazar Claës, le comte d’Hérouville ; sans compter les personnages tels que le
colonel Chabert ou Peyrade, pères qui, dans la scène où ils sont illustrés, sont représentatifs
de leur profession (le soldat et l’espion) plutôt que dans leur rôle paternel. De même, les
vieilles filles telles que Mlle Pen-Noel, Miss Stevens, Mlle Rogron, Mlle Cormon,
s’opposant aux figures maternelles comme Mme Gruget, Mme Crochard, Mme Saillard,
Mme César (Birotteau), Mme de la Chanterie, Renée où au milieu de ces deux groupes on
trouve des personnages de transition entre les deux catégories, comme Asie, la veuve
Descoings, la grande Nanon, Mlle d’Esgrignon. Les femmes sont sans doute fort présentes
dans l’iconographie de La Comédie humaine, avec une pléiade de jeunes filles telles que
Eugénie Grandet, Flore Brazier, Louise de Chaulieu, Ève Chardon, Julie d’Aiglemont,
Modeste Mignon, et Pauline. On ressent là tout le vertige de la liste.
8.3. Le retour du personnage illustré : un système manqué
La question la plus prégnante que nous nous sommes posée concerne toutefois l’un des
aspects les plus caractéristiques de la poétique balzacienne, à savoir la représentation des
personnages reparaissants. Système déjà expérimenté par Rabelais, l’Abbé Prévost, Rétif de
la Bretonne, Beaumarchais et F. Cooper, Balzac s’est approprié ce mécanisme en atteignant
un degré de perfection jamais conçue ni auparavant ni après lui338.
En réalité, le système du retour des personnages balzacien n’est pas vraiment exempt
d’ambiguïtés ni d’impasses : les études de Fernand Lotte, Max Andréoli et Mireille
Labouret339 ont bien mis en lumière les problèmes qui concernent les personnages
reparaissant bien avant La Comédie humaine. Le cycle Vautrin, surtout, offre dans ce sens un
exemple paradigmatique, car la recherche de l’effet de répétition dans les personnages tels
338 À ce propos, voir l’article de D. Aranda, « Originalité historique du retour des personnages balzaciens » dans RHLF, novembre-décembre 2001, n°6, 101e année, pp. 1573-1589. 339 Voir notamment F. Lotte, « Le retour des personnages dans La Comédie humaine » dans AB 1961, pp. 227-281 ; M. Andréoli, Le Système balzacien, essai de description synchronique, Lille, Atelier national de reproduction des thèses, Université de Lille III, 1984, 2 vol ; et M. Labouret, « À propos des personnages reparaissant. Constitution du personnage et ˝sens de la mémoire˝ », dans AB 2005, pp. 125-142.
293
que Rastignac et Lucien340 cause des court-circuit non contournables : d’un côté, problèmes
dans la biographie des personnages, qui ne sont pas évoqués en suivant un ordre
chronologique linéaire, ce qui cause pas mal de soucis de mémoire aux lecteurs ; de l’autre
côté, le système contient effectivement des défauts, lorsque Balzac, en corrigeant les noms
des personnages pour consolider ce système, se perd lui-même dans leur biographie, et ne
s’aperçoit pas de certaines incongruités qui les affectent.
Sainte Beuve n’avait peut-être pas complètement tort de se plaindre de ce
mécanisme, « idée fausse et contraire au mystère qui s’attache toujours au roman. Un peu
de fuite en perspective fait bien. […] la séries des Études de mœurs de M. de Balzac finit par
ressembler à l’inextricable lacis des corridors de certaines mines ou catacombes. On s’y
perd et l’on en revient plus […] »341. Mais, enfin, n’est-ce pas véritablement ce labyrinthe de
personnages qui charme le plus le lecteur de La Comédie humaine ?
Cependant, le lecteur de l’édition Furne ne trouve pas de satisfaction dans ce sens
dans les illustrations : il n’y a que quatre personnages reparaissants qui font le sujet de plus
d’une illustration, à savoir la lorette Euphrasie, Mme Gruget, la duchesse Diane de
Maufrigneuse, et le forçat Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort.
Euphrasie est un personnage des Études philosophiques : en suivant l’ordre de l’édition
Furne, elle paraît d’abord dans La Peau de chagrin et puis dans Melmoth réconcilié. Dans La
Peau de chagrin, nous l’avons vu dans le chapitre 5, Euphrasie est l’une des prostituées qui
participent au festin de Taillefer ; elle fait son apparition dans le salon après Aquilina, en
formant avec elle un tableau bien singulier : « Un poète eût admiré la belle Aquilina ; le
monde entier devait fuir la touchante Euphrasie : l’une était l’âme du vice, l’autre le vice
sans âme ». Aquilina, la brune, raconte à Émile et à Raphaël de Valentin qu’elle avait un
amant, qui a été guillotiné ; Euphrasie intervient et coupe la parole à son amie, faisant de la
philosophie pendant qu’elle sert le café aux deux gentilhommes. Mais la petite histoire
d’Aquilina suffit pour créer le lien avec l’Aquilina et l’Euphrasie de Melmoth réconcilié. Dans
ce conte inspiré de Melmoth the wanderer par Maturin, Melmoth cherche quelqu’un auquel
340 Voir les articles de M. Labouret, « Fabriquer le temps à rebours : problèmes romanesques et mécanismes reparaissant dans La Torpille » dans L’Année balzacienne 2002, pp. 181-203 ; et Id., « La fabrique du roman : ˝parallèles˝ et ˝superposition˝ » dans Illusions perdues. Actes de la Sorbonne, José-Luis Diaz et André Guyaux (dir.), Paris, Presses de l’Université de Paris Sorbonne, 2003, pp. 163-174, où l’enjeu entre le même et l’autre qui entoure non seulement les personnages mais aussi les scènes est analysé en détail. Ici, nous résumons l’idée générale contenue dans ces articles. 341 Sainte-Beuve, Lundi XI, novembre 1838, cité dans Labouret 2005, p. 126
294
passer sa malédiction ; il réussit à la transmettre à l’un des caissiers du banquier Nucingen,
Castanier, en lui montrant que son espoir de s’enfuir avec l’argent volé en banque est voué
à l’échec. Melmoth lui montre aussi que son amante, la belle et douce Aquilina, en réalité ne
l’aime pas et le trompe avec un soldat. Castanier, furieux, accepte le pacte342, et, surprenant
le soldat dans la garde-robe d’Aquilina, lui prédit sa mort. Après avoir eu sa vengeance,
Castanier exploite son pouvoir pout tout voir et tout savoir, jusqu’au jour où il n’arrive plus
à tolérer son pouvoir. La malédiction de Melmoth passe alors à d’autres gens, dernièrement
à un clerc follement amoureux d’une lorette, Euphrasie. Si dans La Peau de chagrin l’une des
gravures hors-texte représente les deux femmes, Aquilina et Euphrasie, dans Melmoth
réconcilié on ne trouve qu’Euphrasie.
Figure 210 et 211 : Euphrasie dans La Peau de chagrin et dans Melmoth réconcilié, La Comédie humaine
La planche de La Peau de chagrin du Furne rappelle celle qui illustre ce même moment dans
l’édition Delloye et Lecou du roman : Aquilina et Euphrasie offrant le café à Émile et
Raphaël. Si dans l’image de l’édition Delloye et Lecou la scène montre les quatre
personnages, avec le décor bien esquissé derrière les deux lorettes, l’illustration de l’édition
Furne se focalise totalement sur les deux personnages féminins, la cafetière, les tasses et le
342 Sur le mécanisme du pacte dans cette œuvre, voir l’article d’A. Vanoncini, « Le pacte : structures et évolutions d’un motif balzacien », AB 2002, pp. 279-292.
295
plateau étant les seuls objets présents dans ce tableau. De même, on ne comprend pas bien
où Euphrasie est assise dans la gravure de Melmoth – une ottomane ? un lit ? un canapé ? –
mais on distingue une petite table avec un vase contenant une rose et des papiers blancs au
premier plan de l’image. L’élément qui frappe le plus concerne sans doute les cheveux
d’Euphrasie : si dans la première image elle est blonde, dans la deuxième elle est brune. Or,
si nous allons relire le passage de la description d’Aquilina et d’Euphrasie dans La Peau de
chagrin, on remarque que le texte ne donne aucune information sur la chevelure
d’Euphrasie : en fait, il est écrit qu’Aquilina est brune, mais d’Euphrasie il est dit seulement
qu’elle a la peau candide et les yeux bleu. La réponse ne se trouve pas non plus dans
Melmoth réconcilié, où le narrateur ne fournit aucun détail de l’aspect physique de la jeune
fille. Le manque d’une description particulière de cet attribut empêche de dire laquelle des
deux images donne une représentation erronée de ce personnage. Au contraire, il faut
s’interroger sur ce détail en adoptant une perspective différente : est-il vraiment essentiel de
savoir quelle est la couleur des cheveux d’Euphrasie ? Avoir cette information changerait-il
la valeur du personnage d’Euphrasie ? Généralement, on attribue aux couleurs un code
moral précis : noir-le mal, blanc-le bien, rouge-la passion ; mais, comme nous l’avons vu
dans le cas du vieil antiquaire de La Peau de chagrin, dans ce roman les couleurs peuvent être
trompeuses : l’antiquaire est noir et rouge au même temps ; Raphaël, au jeu de la roulette,
choisit le rouge alors que c’est le noir qui gagne ; Pauline et Foedora portent les deux.
Euphrasie paraît comme une figure candide, mais « à Paris seulement se rencontrent ces
créatures au visage candide qui cachent la dépravation la plus profonde, les vices les plus
raffinés sous un front aussi doux, aussi tendre que la fleur d’une marguerite ». Blonde ou
brune, l’image d’Euphrasie reste l’allégorie du Vice sans âme.
Une transformation bien étonnante est celle subie par le personnage de la veuve
Gruget. Elle paraît d’abord dans Ferragus, où elle est décrite à travers le point de vue de M.
Jules :
Il regarda fort attentivement le visage jaune de madame Gruget, ses yeux gris, sans
sourcils, dénués de cils, sa bouche démeublée, ses rides pleines de tons noirs, son
bonnet de tulle roux, à ruches plus rousses encore, et ses jupons d’indienne troués, ses
pantoufles usées, sa chaufferette brûlée, sa table chargée de plats et de soieries,
d’ouvrages en coton, en laine, au milieu desquels s’élevait une bouteille de vin.
296
Figure 212 : Mme Gruget dans Ferragus, La Comédie humaine
Mme Gruget revient une dizaine d’années plus tard dans La Rabouilleuse, où elle sert
d’infirmière à Flore Brazier, empoisonnée par Philippe Bridau. Là, Mme Gruget, tombée
dans la misère après la mort de sa fille Ida, subit un changement terrible :
Un instant après, apparut une femme que Bixiou désigna par ces mots : des guenilles
qui marchent ! C’était, en effet, un tas de linge et de vieilles robes les unes sur les
autres, bordées de boue à cause de la saison, tout cela monté sur de grosses jambes à
pieds épais, mal enveloppés de bas rapiécés et de souliers qui dégorgeaient l’eau par
leurs lézardes. Au-dessus de ce monceau de guenilles s’élevait une de ces têtes que
Charlet a données à ses balayeuses, et caparaçonnée d’un affreux foulard usé jusque
dans ses plis.
297
Figure 213 : Mme Gruget dans Un Ménage de garçon, La Comédie humaine
Tout autre type de femme est la duchesse Diane de Maufrigneuse. Personnage
reparaissant en plusieurs contes et romans, parmi lesquels Autre Étude de femme, Une
Ténébreuse affaire et Splendeurs et misères des courtisanes, Diane est l’un des actants principaux du
Cabinet des Antiques et la protagoniste des Secrets de la princesse de Cadignan. La duchesse de
Maufrigneuse est l’un des modèles le plus charmant de « femme comme il faut » : d’une
beauté unique, dans Le Cabinet des antiques elle joue à « s’improviser » jeune fille angélique à
l’âge de vingt-six ans. Son apparence angélique séduit Victurnien d’Esgrignon, jeune rejeton
d’une famille aristocratique de province. Trop inexpérimenté pour deviner que l’apparence
virginale de la duchesse n’est qu’un masque, Victurnien tombe amoureux de Diane et la suit
partout, en lui offrant tous les amusements les plus coûteux que la société met à leur
disposition ; un voyage en Italie marque un dernier coup aux finances de d’Esgrignon, qui
se retrouve accablé de dettes. Il projette de fuir avec la duchesse, et, pour obtenir l’argent
nécessaire, il falsifie des lettres de change. La gravure qui paraît dans l’éditon Furne du
Cabinet des Antiques se réfère à ce moment de la narration : Victurnien est décidé à s’en fuir à
298
l’étranger, et il demande à la duchesse, qui se trouve dans le même embarras, de le suivre.
Diane écoute le jeune homme très attentivement :
La duchesse écoutait comme elle savait écouter, le coude appuyé sur son genou levé
très haut. Elle avait le pied sur un tabouret. Ses doigts étaient mignonnement groupés
autour de son joli menton. Elle tenait ses yeux attachés aux yeux du comte ; mais des
myriades de sentiments passaient sous leur bleu comme des lueurs d’orage entre deux
nuées. Elle avait le front calme, la bouche sérieuse d’attention, sérieuse d’amour, les
lèvres nouées aux lèvres de Victurnien. Être écouté ainsi, voyez-vous, c’était à croire
que l’amour divin émanait de ce cœur. Aussi, quand le comte eut proposé la fuite à
cette âme attachée à son âme, fut-il obligé de s’écrier : Vous êtes un ange !343
L’illustration de Bertall restitue en effet cette attitude de la duchesse, vêtue d’ « un de ses
négligés coquets qui lui coûtaient autant de soins que d’argent, et qui lui permettaient de
commencer son rôle d’ange dès onze heures du matin » ; l’air gêné de Victurnien est
également bien esquissé.
Figure 214 : Victurnien d'Esgrignon et Diane de Maufrigneuse dans Le Cabinet des Antiques, La Comédie humaine
343 H. de Balzac, Le Cabinet des Antiques, Pl, t.VII, p. 188.
299
Dans Les Secrets de la princesse de Cadignan, le personnage de Diane reparaît mais sous un
autre nom, car, comme l’explique le narrateur, elle a hérité, à la mort de son beau-père, du
titre de princesse de Cadignan. Sa retraite de la société, le changement de nom et la
Révolution de Juillet, qui a porté de nouveaux « acteurs de la société », aident Diane à faire
oublier au beau monde ses aventures scandaleuses. Grande amie de la marquise d’Espard,
avec laquelle Diane se dispute le sceptre de la mode, la princesse de Cadignan, qui a
maintenant trente-sept ans, mais n’en paraît que vingt-cinq, confesse à son ancienne rivale
qu’elle s’est toujours « amusée », mais elle n’a jamais aimé vraiment ; elle ne connaît pas le
secret qui permet aux couples tels que Rastignac et Mme Nucingen de rester heureusement
ensemble pour longtemps. Son seul espoir serait d’être le premier amour d’un homme qui
n’a rien su de ses aventures passées. Mme d’Espard propose alors de lui faire rencontrer
Daniel d’Arthez, homme de génie en herbe dans Illusions perdues et maintenant intellectuel
très estimé qui, dit-on, n’a pas encore connu l’amour d’une grande dame ; en accord avec la
princesse de Cadignan, Mme d’Espard organise une soirée dite « de petits jours », c’est-à-
dire réservée aux intimes, invités verbalement, où l’on trouve Rastignac, Daniel d’Arthez,
Émile Blondet, et Mme de Montcornet. Diane arrive la première chez Mme d’Espard, pour
préparer au mieux sa pose :
La princesse passe encore aujourd’hui pour une des plus fortes sur la toilette, qui, pour
les femmes, est le premier des Arts. Elle avait mis une robe de velours bleu à grandes
manches blanches traînantes, à corsage apparent, une de ces guimpes en tulle
légèrement foncée, et bordée de bleu, montant à quatre doigts de son cou, et couvrant
les épaules, comme on en voit dans quelques portraits de Raphaël. Sa femme de
chambre l’avait coiffée de quelques bruyères blanches habilement posées dans ses
cascades de cheveux blonds, l’une des beautés auxquelles elle devait sa célébrité.344
Dans ce cas, aussi, la gravure répond fidèlement à la description du personnage.
344 H. de Balzac, Les Secrets de la princesse de Cadignan, Pl, t.XI, p. 98.
300
Figure 215 : Diane dans Les Secrets de la princesse de Cadignan, La Comédie humaine
Or, si dans ces images l’élément que nous pouvons apprécier le plus est le caractère de
protexte assumé par l’illustration, c’est-à-dire la traduction fidèle que le dessin fait de ce
personnage reparaissant, nous ne pouvons qu’être totalement déçue par l’absence des
caractéristiques particulières de Diane de Maufrigneuse. Bien que le type « femme comme il
faut » soit bien esquissé, où est la personnalité de Diane, sa distinction, son énergie ?
De fait, les gravures du Furne représentent Diane dans une pose statuaire, immobile,
qui est certainement l’un des aspects spécifiques de ce personnage. Mais la duchesse-
princesse est aussi un Don Juan en jupe, par sa collection d’admirateurs, dont les noms
sont recueillis dans un livre posé sur sa cheminé, mais aussi par son être toujours en
mouvement. Un mouvement qui est physique – elle va au théâtre, chez les amis, en Italie,
en province pour sauver Victurnien – autant qu’un mouvement essentiel, lié aux masques
qu’elle continue à changer – jeune femme dépravée, ange, cygne, don Juan femelle,
intellectuelle, femme incomprise et calomniée. L’image faillit à la restitution de ces
particularités : la comparaison avec le cygne n’est pas exploitée ; de la même façon, la
référence à Don Juan reste de côté.
Le cas de l’illustration du personnage de Diane de Maufrigneuse met alors en lumière
l’un des mécanismes qui ont causé la déception éprouvée devant les gravures de l’édition
Furne : les image se révèlent trop typisantes, c’est-à-dire trop généralisantes. Au-delà de la
légende au-dessous de la figure, aucun élément iconographique n’ancre véritablement le
301
personnage de Balzac dans celui qui est illustré : certes, on a le type qu’il représente, mais
où est Diane de Maufrigneuse, la femme qui ne veut pas être assimilées aux autres étoiles
du beau monde, qui veut toujours se distinguer, qui fait les dictames de la mode au lieu de
les suivre ?
La même observation se présente pour le personnage de Jacques Collin, dit Trompe-
la-Mort. Jacques Collin, forçat évadé et toujours en fuite, cherche à plusieurs reprises à
retourner au sein de la société dont il a été exclu. En raison de cela il se cache sous des
identités différentes ; en effet, le personnage paraît pour la première fois dans Le Père Goriot,
où il est décrit comme « un homme âgé d’environ quarante ans, qui portait une perruque
noire, se teignait les favoris, se disait ancien négociant, et s’appelait monsieur Vautrin ».
C’est Honoré Daumier qui se charge de représenter ce personnage mystérieux.
Figure 216 : Vautrin dans Le Père Goriot, La Comédie humaine
Comme dans le cas du père Goriot, dans cette planche c’est le style particulier de Daumier
qui réussit à rendre pleinement le caractère du personnage : la taille robuste, les épaules
larges, les favoris teints qui encadrent le visage, mais surtout l’air coquin et rusé restituent
tout le charme du travestissement du forçat.
302
Moins réussie est peut-être la planche de Bertall dans Splendeurs et misères des courtisanes,
où Jacques Collin est illustré sous le masque de l’abbé Carlos Herrera : l’expression sur le
visage de l’abbé est tellement différente de celle de Vautrin que Jacques Collin-Vautrin n’est
pas reconnaissable.
Figure 217 : Carlos Herrera dans Splendeurs et misères des courtisanes, La Comédie humaine
Par l’exemple de ces quatre personnages, un dénominateur commun à la majorité des
portraits du Furne peut être identifié : en effet, dans la plupart des cas la légende de
l’illustration ancre le personnage au moment où le narrateur en donne, pour la première
fois dans le récit, une description physique. Il est vraiment rare de trouver l’illustration d’un
personnage à la fin de l’histoire : les exceptions sont les romans qui comptent quatre ou six
illustrations chacun, par exemples les Mémoires de deux jeunes mariées, où est illustrée la mort
de Louise de Chaulieu ; en revanche, là aussi le contre-exemple est Illusions perdues, où la
troisième partie, « Les souffrances d’un inventeur », ne contient aucune illustration.
303
Figure 218 : La mort de Louise de Chalieu dans Mémoires de deux jeunes mariées, La Comédie humaine
Prenons le cas classique que choisissent les experts de l’illustration balzacienne pour
décrire ce que nous avons appelé la relation protextuelle entre le texte et l’image dans
l’édition Furne : le personnage de Mme Vauquer dans Le Père Goriot, dessinée par Bertall.
C’est grâce à l’illustration de ce personnage que Bertall s’attire l’éloge de Balzac et finit sous
son aile protectrice :
On faisait alors à la librairie Paulin une édition avec gravures des œuvres parues de
Balzac. Quelques dessins m’ayant été demandés pour le journal l’Illustration, dirigé alors
par M. Paulin, j’en profite pour me proposer timidement à la personne chargée de
l’édition de la Comédie humaine. – Eh bien essayez donc, me dit-on. J’essayai. Mon
premier dessin d’après Balzac, est là devant moi. C’était la maman Vauquer du Père
Goriot que j’avais entrepris de représenter. Je ne discuterai pas la valeur du dessin. Mais
le lendemain du jour où le bon à tirer du volume fut porté à l’auteur, il était neuf
heures du matin, un monsieur vint sonner à ma porte, on ouvrit, on le fit entrer dans
le petit atelier où je travaillais. Du premier coup d’œil je reconnus M. de Balzac que je
n’avais jamais vu, aux descriptions qui m’en avaient été faites. […] J’attendais anxieux,
n’osant élever la parole. – C’est vous, mon petit, me dit-il paternellement, qui avez fait
le portrait de la maman Vauquer ? et il me le montrait. – Oui, maître. – Vous l’avez
donc vue ? – Mais non. – Et comment avez-vous fait ? – J’ai copié mot à mot, trait par
304
trait, la description que vous en avez faite et j’ai tâché de ne point oublier ni un trait ni
un mot. – Eh bien, mon enfant, rien n’est plus ressemblant, le type est celui que j’ai
dessiné. La maman Vauquer existait, et je l’ai décrite telle qu’elle était, et telle que je la
vois dans votre dessin. C’est parfait et c’est vrai.345
Figure 219 : Mme Vauquer dans Le Père Goriot, La Comédie humaine
L’histoire de Bertall est sans doute intéressante, bien que, nous le répétons encore, il faille
être prudent à l’égard de ses affirmations ; la scène décrite par l’illustrateur est construite
comme une anecdote, dont on n’a pas d’autres sources avec lesquelles faire une
comparaison. De toute façon, il semble qu’on peut faire confiance au moins à ce qu’il dit à
propos de la méthode avec laquelle il a dessiné Mme Vauquer : comme le désirait Balzac,
Bertall a « copié mot à mot » la description du personnage qui se trouve dans Le Père Goriot.
Le résultat, si l’on croit l’illustrateur – et en effet cela expliquerait pourquoi Balzac a poussé
la carrière de Bertall, en lui faisant cadeau de son pseudonyme, « Bertall » et non « Bertal »
comme le dessinateur se signait habituellement jusqu’à-là –, a bien plu à l’écrivain, qui voit
sortir de la page un personnage « vrai », réellement existant.
345 Bertall, Souvenirs intimes, art. cit., pp. 31-32 ; c’est nous qui soulignons.
305
Cependant, si on peut partager en partie l’enthousiasme de Balzac et de Bertall pour
l’effet de vraisemblance créé par le personnage illustré de Mme Vauquer, on n’arrive pas à
être complètement satisfait de l’illustration. À la base de la désillusion que le lecteur de
l’édition Furne ressent à la vue des illustrations, est non seulement le rendez-vous manqué
avec les personnages reparaissants, mais aussi l’impossibilité de voir une construction « en
série » du personnage illustré qui aurait montré son évolution dans la progression de la
narration. Les personnages sont pétrifiés dans une pose éternelle, qui, il est vrai, restitue
leur corporéité, leur être de « types iconiques », mais à un seul moment particulier. Sur ce
détail repose l’unité de leur typicité, comme l’Idée s’est incarnée dans un corps spécifique,
mais, aussi, c’est dans cet élément qu’ils trouvent une hibernation dans un corps sans
temps, une statue aplatie sur le blanc de la page. Le personnage fixe en silence le lecteur, ne
demandant que d’être admiré dans sa pose. Nul enjeu entre la description physique du
personnage et les références picturales faites par le texte ne se profile dans les dessins : le
système est verrouillé, enfermé en soi-même, se refusant à une ouverture temporelle et
esthétique.
Maintenant, dans le dernier chapitre de notre étude, nous analyserons deux textes qui
se distinguent exactement pour leurs jeux intertextuels, pour les perspectives plurielles que
l’illustration ouvre : ce sont le Paris marié et les Petites misères de la vie conjugale qui surprennent
par leur richesse.
306
CHAPITRE 9
UN DUEL ENTRE CRAYONS : LE PARIS MARIÉ DE GAVARNI ET LES
PETITES MISÈRES DE LA VIE CONJUGALE DE BERTALL
Ô civilisation ! ô Paris, admirable kaléidoscope qui, toujours
agité, nous montre ces quatre brimborions : l’homme, la femme,
l’enfant et le vieillard sous tant de formes, que tes tableaux sont
innombrables ! Oh ! merveilleux Paris !...
H. de Balzac, « Les Voisins », 1830
La publication de La Comédie humaine s’achève en 1846, quand le dernier des quatre éditeurs,
Charles Furne, vend le stock des exemplaire invendus à son premier commis, Alexandre
Houssiaux. Ce dernier, relance une nouvelle publication en livraison en 1848, et ajoute le
volume XVII contenant les Parents Pauvres. Après la mort de Balzac, dans les années 1850
Houssiaux entreprend une troisième édition en 18 volumes, dans laquelle outre la notice
introductive par George Sand et le portrait de Balzac par Bertall, l’éditeur insère aussi Les
Paysans et les Petites Misères de la vie conjugale.
La légitimité du choix d’Houssiaux a été très débattue, mais aujourd’hui nous
acceptons la présence des Petites Misères de la vie conjugale à l’intérieur de La Comédie humaine
d’après certaines lettres de Balzac qui traite les Petites Misères comme une sorte de
continuation à la Physiologie du mariage.
Selon Jean-Louis Tritter346, l’écrivain n’a pas pu faire lui-même cet ajout dans les
Études analytiques à cause du traité stipulé avec Chlendowski – chez lequel les Petites Misères
sont parues illustrées par Bertall – où il était spécifié que Balzac aurait dû respecter un délai
jusqu’à la fin de mars 1846 pour toute réimpression de l’œuvre ; cependant, il est fort
probable que ce délai a été prolongé à cause du retard avec lequel Balzac a livré la deuxième
partie de l’ouvrage. Par conséquent, comme la publication du volume XVI était fixée pour
cette année-là, il aurait été impossible pour l’auteur d’appliquer les corrections
indispensables à l’intégration du texte dans la Physiologie du mariage ; en raison de cela, les
Études analytiques, titrées au pluriel bien qu’elles ne contiennent qu’une seule œuvre, ne sont
constituées que par la Physiologie du mariage de l’édition 1830.
346 J.-L. Tritter, « Histoire du texte » dans La Comédie humaine, vol. XII, Pl, 1981, pp. 867-868.
307
Mais l’histoire du texte des Petites misères de la vie conjugale paraît être encore plus
compliquée que cela : si, comme l’affirme Anna Fierro dans son article « Théâtre à lire,
roman à jouer. L’hybridation dans Petites misères de la vie conjugale »347, il est vrai que « les
dessins n’ont pas été ajoutés aux éditions postérieures à la première comme ornement ˝de
luxe˝, mais le texte, dans sa totalité, a été conçu dans la version illustrée »348, il ne faut pas
oublier que plusieurs fragments avaient déjà paru dans d’autres contextes. Dans le chapitre
7, nous avons annoncé que la Philosophie de la vie conjugale, article que Balzac avait donné à
Hetzel pour Le Diable à Paris, allait être reprise peu de temps après pour une édition à part ;
Hetzel en donnera le titre de Paris marié, mais cela n’était qu’une partie des futures Petites
misères de la vie conjugale. Encore, l’« Histoire du texte » qu’effectue Jean-Louis Tritter montre
la création de certains chapitres aux années 1830, dans quelques articles que Balzac avait
rédigés pour la presse illustrée349, notamment pour La Caricature et pour La Presse.
Ce dernier chapitre alors sera organisé autour de trois points principaux. D’abord,
nous traiterons, dans le premier sous-chapitre, l’évolution du texte de ses premiers
fragments à l’œuvre définive, à travers deux épisodes clé ; dans ce contexte, nous verrons
comment c’est aussi grâce au crayon de Bertall que le récit de Balzac acquiert des sens
nouveaux, qui renvoient à d’autres textes de La Comédie humaine, en créant ainsi un réseau
intertextuel fort intéressant. Dans un deuxième moment, nous analyserons dans le détail le
Paris marié commenté par Gavarni, texte intermédiaire entre les fragments épars dans la
presse et les futures Petites misères de la vie conjugale, en vue d’une comparaison avec les
illustrations de Bertall. Troisièmement, nous nous consacrerons finalement aux Petites
misères de la vie conjugale, en nous focalisant sur la relation entretenue entre le crayon de
Bertall et la plume de Balzac.
9.1. Intertextualité : comment l’illustration ouvre de nouveaux chemins
Parmi les fragments antérieurs au texte définitif, on cite généralement deux récits :
« Les Voisins », repris dans le chapitre « La Campagne de France », et La Consultation »,
remaniée dans « Solo de Corbillard ». Les deux articles gagnent en expansion grâce au
contexte général du couple marié des Petites misères de la vie conjugale.
347 Paru dans Hybridations. Les rencontres du texte et de l’image, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2014. 348 Ibid., p. 49. 349 J.-L. Tritter, art. cit., pp. 854, 856 et 866.
308
Dans une perspective génétique, nous signalerons les différences les plus évidentes
entre les deux couples des récits ; mais ce que nous visons dans cette comparaison n’est pas
seulement la mise en lumière de l’évolution de l’écriture balzacienne mais aussi celle de la
part que l’illustration apporte au texte, qui se révèle toujours une œuvre ouverte, cachant
des signifiés autres et, surtout, des citations intratextuelles. De nombreuses questions se
soulevent dans ce sous-chapitre, questions qui ne sont pas si évidentes si on ne tient pas
compte de l’évolution que le livre illustré accomplit grâce au crayon de Bertall, qui tend
déjà, comme le fera peu de temps après Gustave Doré, à une illustration de type
interprétative plutôt que littéraire. Comment l’illustration participe-t-elle à l’enjeu
intertextuel ? et comment élabore-t-elle cette stratification de récits ?
Le premier épisode que nous allons analyser est « Les Voisins », « Croquis » publié
dans La Caricature le 4 novembre 1830 : Mme de Noirville, femme d’un agent de change
habitant rue Taitbout, prend l’habitude d’observer un couple voisin, deux jeunes mariés
charmants qui semblent très heureux. Un jour, Mme de Noirville confie à son mari son
désir de faire la connaissance de la jeune dame brune de la maison voisine ; M. de Noirville
croit reconnaître dans la description faite par sa femme Mme de Bonrepos, épouse de l’un
de ses collègues de la Bourse ; il organise donc un dîner pour les présenter à Mme de
Noirville. Le jour de la soirée arrive, les Bonrepos sont annoncés ; Mme de Bonrepos est
ravissante mais boudeuse, et son mari…n’est pas le jeune homme blond que Mme de
Noirville a vu par sa fenêtre, mais un homme âgé d’une quarantaine d’années, « trapu » et
« marqué de petite vérole ». Mme de Noirville comprend alors que le beau jeune homme
qu’elle a aperçu n’est autre que l’amant de sa voisine. Une scène similaire se passe dans les
Petites Misères : Caroline, la protagoniste femelle du couple marié, voit de sa fenêtre un
ménage qui paraît dans la lune de miel, tant ils sont joyeux ensemble ; elle décrit la jeune
femme à Adolphe, son époux, et exprime le désir de faire la connaissance de leurs voisins.
Adolphe, sûr que la dame décrite par Caroline est Mme Foullepointe, mariée à un agent de
change, organise une rencontre avec eux. Mais, au contraire de Mme de Noirville, Caroline
ne réussit pas à contenir sa surprise lorsqu’au lieu du jeune homme blond lui est présenté
un vieux gargantuesque, « un gros monsieur à cheveux gris assez rares », avec « une figure
et un ventre siléniques, un crâne beurre frais, un sourire papelard et libertin sur de bonnes
grosses lèvres »350 ; ne devinant pas la vérité, Caroline s’adresse à Mme Foullepointe avec
350 H. de Balzac, Petites misères de la vie conjugale, Paris, Chlendowski, 1846, p. 175.
309
cette exclamation : « Je suis enchantée, madame, […] que vous soyez venue avec votre
beau-père (profonde sensation) ; mais nous aurons, j’espère, votre cher mari… »351. Le mal
est fait, et Adolphe, consterné, aimerait bien disparaître sous terre devant cette dernière
démonstration de bêtise de sa femme.
Les illustrations de Bertall enrichissent cette scène fortement théâtrale en dessinant
deux planches hors-texte : la première pourrait être le fond de cette scène, c’est-à-dire la
façade de la maison voisine et ses habitants aux fenêtres ; la deuxième représente l’entrée de
M. et Mme Foullepointe dans le salon de Caroline.
Dans la première image, onze fenêtres offrent chacune un spectacle différent, alors
qu’une douzième reste fermée ; les scènes représentées par Bertall différent de celles
décrites par Balzac :
Or, à Paris, à moins d’habiter un hôtel à soi, sis entre cour et jardin, toutes les
existences sont accouplées. À chaque étage d’une maison, un ménage trouve dans la
maison située en face un autre ménage. Chacun plonge à sa volonté ses regards chez le
voisin. Il existe une servitude d’observation mutuelle, un droit de visite commun aux-
quels nul ne peut se soustraire. Dans un temps donné, le matin, vous vous levez de
bonne heure, la servante du voisin fait l’appartement, laisse les fenêtres ouvertes et les
tapis sur les appuis : vous devinez alors une infinité de choses, et réciproquement.
Aussi, dans un temps donné, connaissez-vous les habitudes de la jolie, de la jeune, de
la coquette, de la vertueuse femme d’en face, ou les caprices du fat, les inventions du
vieux garçon, la couleur des meubles, le chat du second ou du troisième. Tout est
indice et matière de divination. Au quatrième étage, une grisette surprise se voit,
toujours trop tard, comme la chaste Suzanne, en proie aux jumelles ravies d’un vieil
employé à dix-huit cents francs, qui devient criminel gratis. Par compensation, un
beau surnuméraire, jeune de ses fringants dix-neuf ans, apparait à une dévote dans le
simple appareil d’un homme qui se barbifie. L’observation ne s’endort jamais, tandis
que la prudence a ses moments d’oubli. Les rideaux ne sont pas toujours détachés à
temps. Une femme, avant la chute du jour, s’approche de la fenêtre pour enfiler une
aiguille, et le mari d’en face admire alors une tête digne de Raphaël, qu’il trouve digne
de lui, garde national imposant sous les armes. Passez Saint-Georges, et vous pouvez y
surprendre les secrets de trois jolies femmes, si vous avez de l’esprit dans le regard.352
351 Ibid., pp. 175-176. 352 Ibid., pp. 170-172 ; c’est nous qui soulignons.
311
Les scénarios décrits par Balzac, beaucoup plus nombreux par rapport à ceux énumérés
dans « Les Voisins », sont treize : on distingue d’abord le groupe des personnages qui sont
espionnés par leur voisins du groupe des espions. Dans le premier cas, on compte quatorze
personnages : la servante, la jolie, la jeune, la coquette, la vertueuse femme d’en face, le fat,
le vieux garçon, des meubles, le chat du second ou du troisième étage, une grisette, un beau
surnuméraire, une femme qui coud, trois jolies femmes. Dans le deuxième groupe, on ne
trouve que trois figures : un vieil employé, une dévote, et un garde national.
Or, parmi ces personnages certains se révèlent d’autant plus intéressants qu’ils
cachent une référence aux textes de La Comédie humaine : la grisette surprise « comme la
chaste Suzanne » par le regard d’un vieillard renvoie non seulement au personnage biblique
mais aussi à la Suzanne de La Vieille fille, qui, au début du roman, se rend avant chez le
chevalier de Valois, et après chez du Bousquier – à savoir, les deux prétendants de Mlle
Cormon, la vieille fille d’Alençon – en leur disant qu’elle est enceinte, dans l’espoir
d’obtenir un peu d’argent des deux hommes. Ainsi, la future Madame du Val-Noble porte
un nom antiphrastique, dont le lecteur de Balzac garde sûrement le souvenir, et il ne peut
éviter d’y penser devant la grisette des Petites Misères de la vie conjugale, qui devient elle aussi,
par conséquent, une Suzanne très ambiguë.
Une deuxième citation est représentée par la scène du soldat observant une jeune fille
qui se met à la fenêtre pour profiter des derniers rayons de lumière et finir son travail à
l’aiguille ; l’homme, déjà marié, se retrouve à rêver d’avoir un autre ménage avec cette jolie
grisette. De fait, c’est l’histoire du magistrat Roger de Grandville dans Une Double famille,
lequel tombe amoureux de sa maîtresse, Caroline, en la regardant coudre à la fenêtre. Dans
ce cas, Bertall ne prolonge pas la référence, son image représentant un soldat qui regarde en
dehors de la maison.
Le chat aussi, animal fort présent dans La Comédie, devient, cette fois-ci grâce au
dessin de Bertall, est à la fois une autocitation – le chat paraît dans la planche Coupe d’une
maison parisienne dans le deuxième volume du Diable à Paris – et une citation à deux ouvrages
balzaciens spécifique : les chats sur le toit rappellent les Peines de cœur d’une chatte anglaise, où
le rendez-vous entre ces animaux est fixé sur les toits ; et la vieille dame qui lit au troisième
étage en compagnie de son chat ressemble beaucoup à Mme Vauquer du Père Goriot,
dessinée dans l’édition Furne par Bertall lui-même avec son chat qui la précède.
312
Figure 221 : Bertall, Coupe d'une maison parisienne, Le Diable à Paris, vol. II
La façade de la maison illustrée par Bertall pour les Petites Misères n’est pas totalement
conforme à celle du récit : au lieu de cinq étages, la maison en compte quatre. Mme
Foullepointe et son amant sont dessinés à la fenêtre centrale du deuxième étage, et non au
premier, comme l’écrit Balzac ; à côté d’eux, deux scènes originales de Bertall : à gauche, un
homme cherche à embrasser une servante, pendant qu’à droite un enfant jette quelque
chose qui tombe sur le tapis étalé sur les appuis par un domestique au premier étage. Au
dernier étage aussi l’illustrateur esquisse deux figures qui ne se trouvent pas dans le texte
balzacien : à côté de la grisette qui fait sa toilette, dans la fenêtre centrale paraît un homme
313
qui bat une femme, alors que dans celle de droite une dame arrose ses plantes. Bertall
élargit donc les mondes possibles que cachent les vitres des maisons, et il laisse ressentir au
lecteur toute la fascination qu’une fenêtre fermée (celle de droite au troisième étage)
exercice sur un artiste. Outre les gens espionnés, la maison montre aussi les espions : le
soldat en position centrale au troisième étage, la dame au côté gauche du premier, et le
jeune homme au centre sont bien les voyeurs décrits par Balzac. Espions et espionnés se
mêlent dans le même espace, montrant ainsi qu’il est toujours possible d’être l’un – le
voyeur – ou l’autre – l’observé. Une fascination sur laquelle Charles Baudelaire a écrit l’un
des poèmes du Spleen de Paris, Les fenêtres :
Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de
choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus
mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une
chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se
passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la
vie. Par-delà des vagues de toits, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre,
toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son
vêtement, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende,
et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieux
homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fier d'avoir vécu
et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que
cette légende soit la vraie ? » Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi,
si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que suis ?353
La deuxième gravure hors-texte, titrée « M. et Mme Foullepointe. Enseignement à
l’usage de Caroline », esquisse l’arrivée du couple espionné par Caroline dans son salon.
Derrière Madame Foullepointe, « la vraie Parisienne, une femme cambrée, mince, au regard
brillant étouffé par de longs cils, mise délicieusement »354, paraît son mari et le visage d’un
homme jeune et moustachu, l’opposé de M. Foullepointe : serait-il tout simplement le
domestique qui a annoncé le couple, ou l’un des autres invités de Caroline, ou Adolphe qui
se prépare à les présenter à sa femme ? Ou bien c’est l’homme qui Caroline s’attendait de
recevoir, le fantôme au milieu du ménage ?
353 C. Baudelaire, Petits poèmes en prose ou Le Spleen de Paris, Paris, l’école des loisirs/ Le Seuil, 1994 (1869), pp. 139-140. 354 Ibid., p. 175.
315
Un autre type de fantôme émerge du chapitre suivant celui qu’on vient d’analyser :
« Le solo de corbillard », dernier chapitre de la première partie des Petites misères, est lui aussi
inspiré d’un article que Balzac avait publié le 11 novembre dans La Caricature, avec le
surtitre « Caricature ». En effet, il est question d’une scène assez caricaturale dont le sujet
principal est un médecin, appelé d’abord par une grande dame de la Chaussé-d’Antin, et
ensuite par les pauvres qui se rendent dans son cabinet à l’heure des consultations gratuites.
Le texte met en évidence comment le médecin traite en manière différente ses malades
selon leur statut social : il prête à la grande dame, évidement chagrinée par la négligence de
son mari qui « s’amuse à Alger », autant d’attention qu’à un homme affecté de fièvre depuis
un mois et à une mère de famille malade d’une tumeur, tous les deux traités avec
impatience comme le démontre la différence de longueur entre les deux dialogues.
L’histoire subit une transformation considérable lorsqu’elle est insérée dans les Petites
misères : le protagoniste du sketch n’est plus le médecin mais Caroline. Comme le titre du
chapitre « Le Solo de corbillard » le fait entendre, Caroline, désespérée par le manque
d’attention de son mari vis-à-vis d’elle, est tombée dans la dépression. Trois vignettes la
peindront durant sa crise : une vignette en tête de chapitre la montre assise à la table, en
songeant au corbillard ; une deuxième l’esquisse au moment où la femme de chambre
cherche à la réveiller avec l’éther, pendant qu’Adolphe regarde la scène du seuil de la porte,
avec un air triste ; la dernière vignette représente Caroline au lit, couchée en rond sur le
côté gauche.
316
Ses crises poussent Adolphe à consulter un « grand médecin », selon la requête de
Caroline ; le narrateur commente qu’ « À Paris, les médecins sont tous des gens d’esprit, et
il se connaissent admirablement en Nosographie conjugale »355. On s’attendrait là à voir la
planche avec la représentation du « Médecin de Caroline », qui figure au contraire quelque
page plus loin, au milieu de la consultation. L’homme, qui semble un dandy plutôt qu’un
médecin, n’a d’autres signes de codification qu’une liste d’ordonnances volantes – qui
d’ailleurs sont signées Bertall – qui tombent à ses pieds sur le côté gauche de la gravure ; y
figure aussi un pot d’herbes officinales avec les ailes d’ange et un flacon de poudre qui
semble également animé. Ainsi, l’illustration suggère une comparaison entre la figure du
docteur, qui réussit à comprendre la vraie maladie qui affecte Caroline, et celle du magicien.
Figure 223 : Bertall, Le Médecin de Caroline, Petites misères de la vie conjugale
355 Ibid., p. 182.
317
Or, et « Les Voisins » et « La Consultation », avant de paraître dans leur version
définitive dans les Petites misères de la vie conjugale, ont paru dans une version intermédiaire
dans l’article « Philosophie de la vie conjugale » du Diable à Paris, sans toutefois que ces
deux épisodes aient des illustrations. Néanmoins, lorsque cet article est publié comme Paris
marié, Gavarni leur ajoute des dessins, ce qui crée un autre enjeu intertextuel, ou
« intericonotextuel », comme le définit Nathalie Preiss356, c’est-à-dire un enjeu de citations
et allusions entre illustrations de textes différents.
Dans le chapitre « La Campagne de France », Gavarni se concentre sur la figure du
vieillard espionnant avec les jumelles sur le visage ; la proie de son voyeurisme n’est pas
esquissée dans la vignette, mais peu importe. L’illustrateur s’éloigne légèrement du texte
pour faire de ce personnage le type du voyeur, qui se sert de la technologie optique pour
pénétrer illicitement dans les maisons d’autrui : au-dessus de sa tête, une didascalie cite « La
dioptrique appliquée à la myologie ». L’utilisation du vocabulaire médical, dans ce cas
spécifique, paraît étrange. Certes, l’intention caricaturale et satirique est évidente, mais le
sujet de cette caricature ne l’est pas autant : à l’époque, ceux qui emploient la terminologie
scientifique sans être des médecins étaient tout le groupe des physiologistes et écrivains
panoramiques qui avaient fait de l’œil parisien la puissance du siècle. Ces sont les
« flâneurs », les passants qui scrutent dans les intérieurs pour représenter dans leurs
ouvrages le peuple parisien. Or, Walter Benjamin souligne qu’à partir de Baudelaire cette
figure est de plus en plus ambiguë ; la vignette de Gavarni serait-elle l’un des premiers
symptômes de la critique qui tombera sur les flâneurs, type que Balzac représente
pleinement ? L’hypothèse ne semble pas totalement privée d’une certaine raison, vu que
Balzac lui-même est représenté avec des lorgnettes sur les yeux, outre sa canne et le volume
de la Physiologie du mariage, dans la lettrine créée par Gagniet dans la Physiologie du prédestiné en
1841 !
356 N. Preiss, « Balzac illustre(é) » dans Littera, n°3, 2018, p. 53.
318
Figure 224 : Gagniet, Lettrine pour la Physiologie du prédestiné, Paris, Bocquet, 1841
Le deuxième personnage que Gavarni réalise pour ce chapitre est M. Foullepointe.
Avec cette planche nous pouvons remarquer la différence de style existant entre le M.
Foullepoint de Paris marié et celui des Petites misères : Bertall, nous venons de le voir, dessine
M. Foullepointe derrière sa femme, dans le salon de Caroline, avec un troisième personnage
qui plane comme un fantôme à côté de la porte ; Gavarni, en revanche, s’inspire du modèle
des Français peints par eux-mêmes et esquisse M. Foullepointe debout, de profil, dans une pose
qui fait ressortir son ventre arrondi.
Figure 225 : Gavarni, M. Foullepointe, Le Diable à Paris
319
De même, le chapitre « Le solo de corbillard » contient deux gravures. La première
consiste dans un portrait de Caroline déprimée ; dans cette image, également comme dans
la précédente, nous pouvons apprécier les divers choix pris par les illustrateurs. La Caroline
de Bertall est entourée par les objets de son appartement, par sa femme de chambre et par
sa fille adorée, Marie ; Gavarni, par contre, imagine Caroline seule et mélancolique, les
cheveux lâchés sur les épaules, assise sur un repose-pied, le fond blanc. Également, l’image
du célèbre médecin est réduite au visage seul : quand Caroline affirme de n’avoir déjeuné
qu’avec deux tasses de thé, le médecin regarde Adolphe d’un air perplexe, et le dessin en
restitue l’expression.
Figure 226 : Bertall, Le Médecin de Caroline, Le Diable à Paris
Bien que les deux illustrateurs semblent interpréter le texte balzacien de manière
distincte, ce qui attire l’attention est le choix des scènes à dessiner, lesquelles sont souvent
les mêmes. Ce qui sera intéressant de voir alors, c’est la construction de ces deux éditions
illustrées, pour voir si d’autres citations entre images existent entre les deux éditions, celle
d’Hetzel et celle de Chlendowski. Nous allons maintenant approfondir le premier texte
dans l’ordre chronologique : Paris marié, édité par Hetzel en 1845.
9.2. Paris marié commenté par Gavarni. Une interprétation à l’enseigne de la
caricature
Nul doute que quand Hetzel avait entrepris la publication du Diable à Paris la « Philosophie
de la vie conjugale » ait dû se soumettre aux lois d’uniformisation typographique de
l’édition, surtout en matière d’illustration. Ainsi, comme nous l’avons vu dans le chapitre 6,
c’est Bertall qui est chargé des vignettes insérées dans les textes des auteurs, y compris le
nôtre. La « Philosophie de la vie conjugale », ébauche de la première partie des Petites misères,
est enrichie de quatre vignettes.
320
La première est un bandeau en tête de page représentant trois putti qui tirent par des
chaines fleuries un bloc de pierre sur lequel est écrit « Contrat » ; au-dessus du bloc se
trouve un serpent avec une pomme dans la bouche ; un quatrième putto vole dans l’air plein
de nuages en portant avec lui une autre guirlande de fleurs ; par terre, une série d’objets
féminins, tels que l’alliance, un collier et une épingle à cheveux, entourent une flèche
coupée à moitié. C’est l’image-étendard de l’amour désenchanté : les putti, allégories
enfantines du dieu de l’amour, Eros, font des travaux forcés, où le poids qui les harcèle est
celui du contrat matrimonial ; le serpent, allusion à l’épisode biblique de la tentation de la
femme dans le Jardin de l’Eden, est un symbole évident de l’empreinte du diable dans
l’institution du mariage.
Figure 227 : Bertall, Vignette pour la Philosophie de la vie conjugale, Le Diable à Paris
En effet, l’article de Balzac concerne les misères qui tombent sur les hommes mariés
à de jeunes femmes sans esprit ni goût, enfantines et fantasques. Le début du récit est
caractérisé par une période de dispute entre les deux époux, Adolphe et Caroline : Caroline
trouve que tout ce que fait son mari n’est jamais agréable, et à chaque fois qu’elle lui
présente ses observations elle compare Adolphe à M. Deschars, l’un des amis du couple.
Adolphe essaye de reconquérir Caroline en l’amusant : il l’engage à se promener, à dîner
chez Borel ou chez Véry, à se rendre au théâtre. La stratégie donne ses fruits : Caroline est
heureuse, et elle se vante de la bonté de son mari avec ses amies, y compris Mme Deschars,
« dévote atrabilaire » dévorée par la jalousie. Deux vignettes de Bertall interviennent pour
321
représenter les deux couples, Adolphe et Caroline chez Borel et les Deschars s’en
retournant chez eux. Le texte ne fournit pas beaucoup de détails physiques sur ces
personnages : on sait que Caroline est maigre, alors que Mme Deschars est grosse. C’est
l’illustration qui se charge de donner un corps aux personnages : voici Caroline, assise en
face d’Adolphe devant une table pleine de petits plats et bouteilles de vin ; jolie jeune
femme, sa taille mince est souligné par le corset très serré, « secret harnais » qui la gêne au
moment des repas ; Adolphe, en revanche, est esquissé de dos, selon un procédé que
Bertall adoptera aussi dans les Petites misères, comme tactique pour encourager la
personnification du lecteur avec le personnage. Par contre, M. et Mme Deschars sont
représentés de face, habillés pour sortir : l’excentrique et corpulente dévote porte un
chapeau orné d’une fleur, un long manteau et une ombrelle, le visage sombre ; son mari,
lunettes sur le nez et haut-de-forme à la main, lui donne le bras avec orgueil. Le contraste
physique entre les deux couples est évident ; néanmoins, ce que l’illustration n’arrive pas à
suggérer est l’égalité de fond qui rapproche les quatre personnages : ils sont tous
malheureux dans leur ménage, car les hommes ne peuvent comprendre leurs femmes.
La quatrième vignette est consacrée à un personnage mineur du récit : après un
certain temps, Caroline décide qu’elle veut une maison à la campagne. Adolphe exauce son
désir ; mais, loin d’être satisfaite, Caroline se plaint de tout :
Je ne sais pas comment on ne vend que cinq centimes à la Halle un chou qui doit être
arrosé tous les jours, depuis sa naissance jusqu’au jour où on le coupe, dit Caroline. –
Mais, répond un petit épicier retiré, le moyen de se retirer de la campagne, c’est d’y
rester, d’y demeurer, de se faire campagnard, et alors tout change…357
La réponse ne plaît guère à Caroline, qui en veut à Adolphe d’avoir eu la brillante idée
d’acheter une maison à la campagne. Du côté gauche du texte, le dessin du type d’épicier
retiré sourit au lecteur, les mains entrelacées sur le ventre proéminent.
357 H. de Balzac, « Philosophie de la vie conjugale » dans Le Diable à Paris, op. cit., p. 182.
323
Ces chapitres se retrouvent dans Paris marié, où le crayon de Gavarni ne se limite pas
à représenter les deux scènes-clé de l’histoire, mais insiste sur la caricature des misères qui
tombent sur Adolphe. Une vignette se présente tout suite au lecteur lorsqu’il ouvre le livre
au chapitre « Les travaux forcés » : un homme en chemise et pantalon semble avancer avec
grand effort à l’intérieur d’une chambre à coucher, dont on entrevoit le lit ; attaché comme
un boulet de galérien à la cheville droite de l’homme, un petit chapeau de femme est la
cause de l’effort physique accompli par Adolphe. Au-dessus du lit, l’écriture « À
perpétuité » souligne, avec cette référence temporelle, la durée et la dureté de la peine qui
affligera le mari de Caroline.
Figure 231 : Gavarni, Vignette pour Paris marié
Dans la page à côté, on voit Adolphe entrer dans la classe des « Résignés » : cette fois-ci
Adolphe, appuyé au lit, les bras croisés, est immobilisé dans un sac. « Bien sage » !
Figure 232 : Gavarni, Vignette pour Paris marié
324
Au lieu du tableau d’Adolphe et Caroline dînant au restaurant, Gavarni s’inspire d’une
sentence de Balzac pour créer une figure allégorique. Quand le narrateur décrit le repas
destiné aux femmes gênées par leur corset, il affirme qu’ :
Elles [les femmes] aiment, non pas la bonne, mais la jolie chère : sucer des écrevisses,
gober des cailles au gratin, tortiller l’aile d’un coq de bruyère, et commencer par un
morceau de poisson frais relevé par une de ces sauces qui font la gloire de la cuisine
française. La France règne par le goût en tout : le dessin, les modes, etc. La sauce est le
triomphe du goût en cuisine.358
Du côté gauche de la phrase, la France personnifiée par une femme très proche de la
Liberté de Delacroix, avec le chapeau phrygien, la même robe longue et un poignard à la
ceinture, tient dans la main gauche une poêle, pendant que la main droite soulève une
enseigne ovale sur laquelle est écrit : « Au coq harby – veuve la France – fait noces et
festins – repas de corps ». Une épée abandonnée par terre dessine une croix en horizontal,
sorte de limite à ne pas franchir. À la page suivante, la métaphore du combat en cuisine est
poursuivie avec la scène de Borel et Very qui se disputent, eux aussi portant les chapeaux
phrygiens et des poignards à la ceinture, les poêles par terre à leur côté.
La caricature ne s’arrête pas là : Caroline, heureuse des divertissements qu’Adolphe
lui offre, vante son mari à Mme Deschars et Mme Fischtaminel ; Mme Deschars, piquée de
la subtile allusion qu’elle « ne fait pas son devoir », et que c’est à cause de cela que son mari
ne l’amène pas au théâtre, répond qu’elle, mère de famille, ne veut pas dépenser deux cent
francs en amusements ; Mme Fischtaminel réplique qu’ « il vaut mieux que nos maris aillent
en partie fine avec nous que… ». Mme Deschars, ne veut pas entendre le reste, et s’en va,
coupant la parole à l’amie. Là Gavarni intervient avec sa plume, et dessine un couple
dansant sur la table d’un restaurant, l’homme portant le chapeau de sa femme en tête et la
femme celui de son mari.
358 H. de Balzac, Paris marié, Paris, Hetzel, 1846, p. 13.
326
Décidément une image très satirique de l’amusement d’un couple marié.
Une dernière caricature est insérée dans ce chapitre aux dépens de Caroline. Après
quelque temps qu’Adolphe offre ce divertissement à Caroline – promenade, dîner au
restaurant, et spectacle théâtral – la jeune épouse s’aperçoit, en se regardant dans la glace
après le dessert, qu’il y a des « rubis florissant sur ses pommettes et sur les ailes si pures de
son nez », ce qui cause sa mauvaise humeur au spectacle. Gavarni interprète ce moment en
esquissant Caroline en version mannequin placé devant une bouteille de champagne, où elle
regarde son reflet, le gros nez mis en évidence ; autour d’elle, un couteau à tartiner rappelle
le geste caractérisant du dîner de la femme en corset, aussi bien que le reste de quelque
coquille et un fruit témoignent de la gourmandise de la Parisienne.
Le dessin de Madame Deschars, à laquelle l’illustrateur consacre une planche hors-
texte, exprime toute sa célèbre habileté dans le dessin de femmes : la dévote, doué d’un air
prétentieux, porte un châle sur les épaules ; une broche ferme le cou de sa robe, simple et
sans ornements ; la taille forte, qui distingue se personnage, est mise bien en évidence. La
pointe du pied émerge de la jupe, détail qui devrait caractériser la femme comme il faut, et
qui devient en ce cas un élément ironique.
327
Figure 237 : Gavarni, Planche pour Paris marié
De la même façon, dans le chapitre « Nosographie de la villa » et « La misère dans la
misère », où il est question de la maison de campagne si fortement voulue par Caroline,
certaines des images relèvent du style caricatural. Outre la tête de l’épicier retiré, ou le
campagnard assis sous un arbre pendant qu’il marque une pause du travail, deux images
capturent l’attention du lecteur. La première est une vignette qui illustre l’axiome « Quand
un mari et une femme se tiennent, le diable seul sait celui qui tient l’autre »359 : Adolphe a
acheté la villa à la campagne, et se réjouit de la tranquillité retrouvée avec sa Caroline ; mais
c’est une paix qui ne dure pas, comme l’axiome le prédit. Gavarni opte pour une caricature
qui s’exprime non pas à travers l’exagération des traits physique, mais à travers la
métamorphose : sur le lit conjugal, un chat et un chien s’observent, prêts à la bagarre.
359 Ibid., p. 30.
328
Figure 238 : Gavarni, Vignette pour Paris marié
Quelques pages plus loin, le lecteur voit Caroline se plaindre des continuelles absences
d’Adolphe :
J’en ai bien assez de la campagne, et je n’y remets plus les pieds !... Mais je sais ce qui
m’arrivera : vous la garderez sans doute, et vous me laisserez à Paris. Eh bien, à Paris,
je pourrais du moins m’amuser pendant que vous mènerez madame de Fischtaminel
dans les bois. Qu’est-ce qu’une villa Adolphini où l’on a mal au cœur quand on s’est
promené six fois autour de la prairie ?... où l’on vous a planté des bâtons de chaise et
des manches à balai, sous prétexte de vous procurer de l’ombrage ?360
La vignette de Gavarni intervient à la moitié de la tirade de Caroline, illustrée pendant
qu’elle se promène au milieu d’un jardin parsemé de bâtons de chaise et de manches à
balai ; à gauche, un petit édifice construit par des cartes à jouer symbolise la fragilité du
ménage, subtil comme le papier, dont l’être heureux est une question de chance. Ainsi, le
jeu de mot villa Adolphini - villa Arnolfini, en référence au célèbre couple italien peint par
Van Eyck, rebondit sur le sens caricatural du texte et de l’image.
360 Ibid., pp. 40-41.
329
Figure 239 : Gavarni, Vignette pour Paris marié
Nul doute, par ces exemples, que Gavarni a interprété Balzac dans une manière nouvelle
par rapport à son style usuel : le dessin des femmes à la mode est mis partiellement du côté
pour exalter le registre comique du récit balzacien. Comme nous l’avons vu dans le cas de
l’allégorie de la France en cuisinière, Gavarni exploite des figures consolidées dans
l’imaginaire des lecteurs pour charger ses dessins d’un sens pluriel, intericonotextuel.
C’est le cas de la représentation de M. Deschars au début du livre : Caroline, comme
nous l’avons vu tout à l’heure, à un certain moment continue à comparer Adolphe à M.
Deschars : « Prends donc M. Deschars pour modèle ! »361, est la recommandation de sa
chère biche. Le lecteur voit alors la statuette de M. Deschars à la façon d’un saint : son
visage est entouré par une auréole, autour du cou il porte une alliance géante à la façon d’un
collier d’esclave ; deux bracelets de femme pendent sur son ventre, et sur le piédestal on lit
« St Deschars ». Les icones modernes, telles que les bijoux qui tombent sur le cou du
personnage, signalent la raison pour laquelle M. Deschars a été sanctifié : il a acheté une
robe et un corsage avec les lés de rechange à Mme Deschars, il lui a renouvelé sa chambre,
il a fait remonter ses diamants, il ne lui permet jamais de se promener sans lui donner le
bras. De fait, M. Deschars a toutes les bonnes qualités qu’un mari modèle devrait
posséder : il a entouré sa femme d’attentions matérielles.
Enfin, M. Deschars apparaît dans votre ménage à tout moment, et à propos de tout.
Ce mot : « Vois donc un peu si M. Deschars se permet jamais… » est une épée de
Damoclès, ou, ce qui est pis, une épingle, et votre amour propre est la pelote où votre
361 Ibid., p.6
330
femme la fourre continuellement, la retire et la refourre, sous une foule de prétextes
inattendus et variés, en se servant d’ailleurs des termes d’amitié les plus câlins ou avec
des façons assez gentilles.362
Adolphe paraît au lecteur sous les traits de Saint Sébastien pendant son martyr : lié au lit
conjugal, Adolphe est percé par des épingles qui portent le nom de M. Deschars ; au-dessus
du baldaquin, une didascalie : « Adolphe singe et martyr ».
Figure 240 et 241 : Gavarni, Vignettes pour Paris marié
362 Ibid., pp. 6-8.
331
9.3. Petites misères de la vie conjugale : un contre-texte en sourdine
Paris marié est publié presqu’en même temps que l’édition Chlendowski ; or, si nous avons
pu apprécier le style moqueur et caricatural de Gavarni, il faut tenir compte du fait que
nous n’avons pas de témoignages sur l’impression que l’œuvre fit à Balzac. Le contrat entre
l’écrivain et Hetzel pour cette édition n’a pas été retrouvé, et il n’existe aucune lettre qui
puisse témoigner de l’implication de Balzac dans le projet, et notamment dans la fabrication
des illustrations. Il nous paraît assez improbable que l’auteur ait participé à l’entreprise :
partagé entre la publication du Furne et l’écriture de la deuxième partie des Petites misères,
pour lesquelles Balzac est en relation constante avec Bertall et Chlendowski, outre les
nombreux voyages qu’il entreprend avec Mme Hanska, il est fort improbable que l’écrivain
eût encore du temps à consacrer à un autre ouvrage.
Les Petites misères de vie conjugale ne sont pas une œuvre facile à définir. Genre
« hybride », comme la définit Anna Fierro, selon laquelle l’illustration a vraiment pris la
relève du livre, et devient une sorte de médium entre les deux genres narratifs qui
caractérisent le texte : « l’intérêt pour cette œuvre […] naît du lien indissoluble, et inédit
chez Balzac, entre roman, image et théâtre, où l’image devient le pivot fondamental du
rapport entre les deux genres »363. L’affirmation d’Anna Fierro est peut-être trop radicale :
dans notre chapitre 4 nous avons souligné que l’illustration autant que le texte écrit est
énormément influencée par le théâtre, par lequel elle adopte le mécanisme de la scène.
Néanmoins, il est aussi vrai que dans Petites misères de la vie conjugale nous sommes devant un
texte qui ressemble beaucoup à un script : partout on trouve des indications entre
parenthèse de la réaction de ceux qui ont assisté à la scène – Caroline appelant « beau-
père » le mari de Mme Foullepointe, les amis ont une réaction de surprise –, les dialogues
sont nombreux, quand Caroline parle on retrouve toujours l’expression terrorisée ou déçue
d’Adolphe qui l’écoute, et vice-versa.
L’image accueille et renforce cette impression : dans la préface à la première partie,
on assiste à un véritable spectacle théâtral lorsque Bertall dessine en deux vignettes le
changement de l’expression du visage d’Adolphe à la nouvelle que Caroline est une riche
héritière ; on assiste à ses préparatifs avant la première rencontre avec cette charmante fille,
aux premiers mots échangés, à la première visite chez la famille de Caroline. Enfin, avant le
mariage, il est question du contrat : les parents des deux tourtereaux n’arrivent pas à
363 A. Fierro, art. cit., p. 49.
332
trouver un accord ; deux notaires interviennent, et le lecteur se retrouve dans la même
scène à laquelle il a assiste dans Le Contrat de mariage, où le notaire plus gros (celui de Mme
Évangelista) obtient raison sur le plus petit (Mathias).
Sur le plan général, comme le relève encore Anna Fierro, nous pouvons affirmer
que :
[…] la fonction des illustrations hors-texte ne se limite pas à la seule présentation du
personnage : elles sont employées pour résumer certains passages du texte ou en
mettre en relief d’autres, donnant le plus de visibilité possible à ces « petites misères »
qui envahissent la vie de chaque couple. Cette fonction de synthèse et de mise en
valeur est exercée aussi par les vignettes qui, selon leur position dans le texte,
acquièrent un rôle bien précis : les lettrines et les vignettes en tête de chapitre
annoncent la « misère » qui va suivre, tandis que les culs-de-lampe et les vignettes à
l’intérieur du texte résument celle qui vient de se produire.364
Toutefois, certaines lettrines offrent bien plus qu’une anticipation de la « misère » qui
tombera sur l’un des deux époux. La lettrine du chapitre « La logique des femmes », par
exemple, n’annonce pas vraiment ce qui va se passer dans le couple, mais illustre à travers
un jeu graphique allégorique le principe du chapitre, à savoir le fait que les femmes sont
douées d’une logique toute à elles : la lettre « V » est partiellement cachée derrière une
feuille de papier sur lequel il est dessiné, à l’angle bas du côté gauche, un œil regardant une
quantité de chandelles qui dansent devant lui. C’est l’œil du mari qui essaie de comprendre
la logique de sa femme, où l’esprit de Caroline est allégorisé dans la masse désordonnée de
bougies.
364 A. Fierro, art. cit., pp. 57-58.
333
Figure 242 : Bertall, Lettrine pour Petites Misères de la vie conjugale
Mais l’élément qui caractérise véritablement les Petites misères de la vie conjugale est la veine
contretextuelle qui joue son rôle dans des vignettes-clé. Ségolène Le Men a souligné que
Paris marié aussi bien que les Petites Misères représentent un moment fondamental dans
l’histoire du livre non seulement pour le style interprétatif de l’illustration mais aussi pour
l’évolution du statut artistique et social de l’illustrateur dont ces livres témoignent.
Croissance démontrée premièrement dans Les Français peints par eux-mêmes, où le paratexte
met en évidence les dessinateurs autant que les écrivains, la même stratégie est adoptée
dans l’édition Hetzel et dans celle de Chlendowski : outre la table des matières du texte
figurent maintenant la tables des illustrations hors-texte ; les noms des illustrateurs,
également, sont mis au même niveau de celui de l’auteur dans la page de titre. Ségolène Le
Men se concentre sur un détail des Petites misères de la vie conjugale :
L’édition originale illustrée des Petites Misères (Chlendowski, 1846) réunit sur la même
ligne de la page de titre les noms de Balzac et de Bertall ; au sommaire figure la liste
des chapitres tandis que la table de « placement des gravures » clôt l’ouvrage ; séparées
par l’épaisseur matérielle du livre, les deux collaborations voient ainsi renforcée la
spécificité de leur rapport, au point de suggérer deux lectures successives du même
livre, selon le point de vue adopté. La rencontre avec la structure originale de ce livre
que Balzac a voulu « androgyne » n’est pas ici fortuite. L’emplacement des tables
donne le texte au « côté mâle » de la première partie, et l’illustration au « côté femelle »
de la seconde partie, - présomption qu’explicite Bertall dans le contrepoint de la
lettrine (p.151) et du cul-de-lampe (p.194) de la seconde préface. Dans l’un et l’autre
334
cas en effet, le symbole de la bascule sert de métaphore concrète à la figure rhétorique
abstraite de l’antithèse, par le jeu des positions parallèles et opposées de l’homme et de
la femme. Lisibles de gauche à droite, ces vignettes résument de manière
diagrammatique la composition bipartie du livre, articulé par le pivot de la seconde
préface.365
Balzac effectivement définit son livre « androgyne »366 à la fin de la seconde préface, où il a
annoncé que la deuxième partie des Petites misères aurait renversé le point de vue : il était
avant question des misères qui tombent sur les maris, maintenant c’est le moment de voir
celles qui affectent les femmes ; dans ce sens, le livre appartient « au troisième sexe ».
Or, si on observe la lettrine et le cul-de-lampe indiqués par Ségolène Le Men,
l’hypothèse qu’elle a formulée paraît tout à fait probable : dans la lettrine, Balzac en version
caricaturée regarde Caroline et Adolphe du côté de chez Adolphe, alors que dans le cul-de-
lampe Bertall dessine la scène du point de vue de Caroline. L’assimilation des deux artistes
aux deux genres du livre, écrivain-texte-mâle et illustrateur-illustration-femelle, est
séduisante.
Figure 243 et 244 : Bertall, Lettrine et cul-de-lampe à la deuxième préface des Petites Misères de la vie conjugale
Maintenant, nous allons pousser un peu plus loin l’intuition de Ségolène Le Men. De
fait, si on ne regarde que ces deux vignettes, l’hypothèse de S. Le Men est destinée à rester
une séduisante lecture du sexe du livre illustré.
Reprenons un détail : la présence des deux co-auteurs du livre, Balzac et Bertall, dans
les deux images. Si on regarde avec attention les deux figurines, on s’aperçoit que la
365 S. Le Men, « Balzac, Gavarni, Bertall et les Petites misères de la vie conjugale », Romantisme, 1984, p. 31. 366 H. de Balzac, Petites misères de la vie conjugale, p. 194.
335
silhouette de Balzac est beaucoup plus chargée, et certainement moins flatteuse, que celle
de Bertall : Balzac tient sa célèbre canne dans la main droite ; son visage rond et son ventre
proéminent sont désormais une marque distinctive. Bertall ne figure que dans cette
vignette ; Balzac, au contraire, fait le sujet de trois autres images. D’abord, on retrouve la
même vignette parue dans Le Diable à Paris, où Adolphe se promenant avec Caroline lui
indique « un tel », et le « tel » a la silhouette de Balzac
Figure 245 : Bertall, Vignette pour Petites Misères de la vie conjugale
La deuxième est située en tête du dernier chapitre, titré « Commentaire où l’on
s’explique la felichitta des finale » : Balzac, debout et jouant du violon sur une petite
colonne, fait danser les quatre personnages – Adolphe, Caroline et leurs amants – au
rythme de sa musique. Cette fois-ci, la charge est moins cruelle, mais le signifié reste
sombre : Balzac est peint comme l’auteur de ce mélodrame domestique, le Deus ex machina
qui, comme le Joueur de flûte, réussit à contrôler les mouvements et les actions de ses
personnages et les oblige à construire cette charade. On remarque la prompte absence de
Bertall dans ce contexte, qui se dégage de toute responsabilité tendant à insinuer que Balzac
est un vrai marionnettiste, comme le dessinera quelque temps après dans Le Livre des 400
auteurs.
336
Figure 246 et 247 : Bertall, Vignette pour Petites Misères de la vie conjugale et Vignette pour Les Livre des 400 auteurs
La troisième illustration ne se trouve plus dans l’édition finale des Petites Misères, mais
il est toujours possible de la voir à la bibliothèque de la Maison de Balzac : c’était la lettrine
qui a paru dans le premier prospectus de l’œuvre, Balzac en robe de chambre qui tient un
« V » dans les mains. La vignette aurait dû être employée dans le livre, mais Balzac s’est
opposé fermement, comme le témoigne la lettre qu’il a écrit à Mme de Brugnol le 22 mai
1845 :
Vous avez raison pour la gravure, mais il y a d’autres raisons pour ne pas la faire
servir : 1° c’est toujours la même charge. C’est celle d’Hetzel dans les Animaux, et celle
de la Monographie de la presse, et celle de Philippon. 2° ce n’est pas digne. J’ai si grand
désir de voir réussir Ch[lendowsk]y [sic.] que je ne m’oppose pas à ce qu’il fasse une
charge sur moi ; mais il faut qu’elle soit spirituelle, et celle-là c’est une répétition.367
Mais cette anecdote suscite un cadre très contraire à celui décrit par Bertall dans ses
Souvenirs intimes, où il se souvient avec bonhomie des soirées passées chez Balzac à la
maison de Passy à causer des illustrations pour les Petites misères :
Je pouvais alors rencontrer à des jours donnés, Théophile-Gautier, Laurent Jan, Léon
Gozean [sic.], Kleudoski et son fils, et Mme Kleudowska, qui fumait tranquillement au
coin du feu, une énorme pipe polonaise en écume de mer. On buvait là d’admirable
café, la gourmandise, comme on sait, du maître de céans. C’étaient des conversations
brillantes, hérisses de paradoxes fous et de projets insensés. Quelquefois on entendait
367 H. de Balzac, Corr., t.V, pp. 17-18.
337
carillonner violemment à la porte, on se taisait alors, Mme de Brugnoles grimpait
l’escalier, regardait par le judas. On n’ouvrait pas. On savait à qui l’on avait affaire. Et
les conversations reprenaient de plus belle. C’est là que j’ai reçu toutes les instructions
pour la confection du livre qui me plaisait tant à faire.368
Si entre Bertall et Balzac il y avait vraiment cette harmonie idyllique, comment s’expliquer
que dans la correspondance Balzac se plaigne des vignettes de son ami Bertall ?
Le contresens est d’autant plus évident si on continue la lecture des souvenirs de
Bertall :
Il n’était pas de jour où l’on ne s’occupât de sa canne, de son habit bleu, de son
embonpoint bourgeois, de ses cheveux incultes, de la loupe avec laquelle il étudiait les
rides et les verrues de ses personnages, de son style concassé, de ses développements
d’entomologiste et de commissaire-priseur.369
Bertall sait que son « maître », comme il l’appelle, est attaqué par la critique non seulement
pour son style ou pour les thèmes de ses œuvres, mais aussi pour son aspect physique,
auquel on consacre maintes caricatures. Pourquoi alors participer à ce jeu, en sachant que
Balzac détestait ces images ?
Il ne s’agit pas d’être d’accord sur une image quelconque, comme dans le cas de la
cornucopie-cornu qui fait de cul-de-lampe à la fin de la première préface, image sur laquelle
Balzac s’était exprimé dans une lettre adressée à Bertall. Ici, on se demande comment on
pourrait justifier ce qui semble une véritable attaque envers la personne de Balzac dans ce
même livre. Chlendowski n’est pas Hetzel, il n’avait pas intérêt à s’attirer la mauvaise
humeur de l’écrivain, et aucune information n’est parvenue sur son habileté d’éditeur et
correcteur du livre. La vignette est donc bien du fait de Bertall.
On serait porté à croire que Bertall n’était pas aussi innocent et naïf qu’il se décrit
dans ses Souvenirs : par le témoignage d’Henry Monnier, nous savons que Balzac avait été
très pesant et directif dans la production de l’édition Furne ; par conséquent, il ne serait pas
si incroyable imaginer que Bertall, lequel, n’oublions pas, est l’un des illustrateurs de la
nouvelle génération, mieux informé de ses droits, ait pu être ennuyé par la pression exercée
par son maître. Ses vignettes représentant Balzac seront alors un cas de contre-texte
exploité en sens politique : non seulement il n’était pas du tout nécessaire de peindre
368 Bertall, Souvenirs intimes, art. cit., p. 34. 369 Ibid., pp. 34-35 ; c’est nous qui soulignons.
338
l’auteur dans son livre, mais il le fait ressembler lui aussi à une poupée dans les mains du
co-auteur, Bertall. Le joueur a été joué.
Figure 29 : Bertall, Lettrine pour le Prospectus des Petites Misères de la vie conjugale
339
CONCLUSION
« Est-ce un dénouement ? Oui, pour les gens d’esprit ; non, pour ceux qui veulent tout
savoir »370.
Les Petites misères de la vie conjugale sont la dernière grande œuvre illustrée publiée du vivant de
Balzac. Les derniers mois de sa vie, l’écrivain les passe en Russie, malade et écrasé par ses
travaux, auprès de Mme Hanska, finalement devenue sa femme. De retour à Paris, la santé
de Balzac est gravement compromise, et l’auteur de La Comédie humaine meurt après un
mois d’atroces souffrances.
Balzac expire sans avoir savouré la gloire littéraire qui lui fut toujours refusée de son
vivant mais que la mort lui devait consacrer. À ses funérailles, Victor Hugo prononce un
discours devant une assemblée nombreuse :
M. de Balzac était un des premiers parmi les plus grands, un des plus hauts parmi les
meilleurs. […] Tous ses livres ne forment qu’un livre, livre vivant, lumineux, profond,
où l’on voit aller et venir et marcher et se mouvoir, avec je ne sais quoi d’effaré et de
terrible mêlé au réel, toute notre civilisation contemporaine ; livre merveilleux que le
poète a intitulé comédie et qu’il aurait pu intituler histoire, qui prend toutes les formes
et tous les styles, qui dépasse Tacite et qui va jusqu’à Suétone, qui traverse
Beaumarchais et qui va jusqu’à Rabelais ; livre qui est l’observation et qui est
l’imagination ; qui prodigue le vrai, l’intime, le bourgeois, le trivial, le matériel, et qui
par moment, à travers toutes les réalités brusquement et largement déchirées, laisse
tout à coup entrevoir le plus sombre et le plus tragique idéal. […] Balzac va droit au
but. Il saisit corps à corps la société moderne. Il arrache à tous quelque chose, aux uns
l’illusion, aux autres l’espérance, à ceux-ci un cri, à ceux-là un masque. Il fouille le vice,
il dissèque la passion. Il creuse et sonde l’homme, l’âme, le cœur, les entrailles, le
cerveau, l’abîme que chacun a en soi.371
Hugo met en lumière les deux grands mécanismes de l’œuvre de Balzac : l’unité qui est à la
base de la centaine de ses romans et contes, qui forment un livre unique, La Comédie
370 H. de Balzac, Les Secrets de la Princesse de Cadignan, Pl, t. VI, p. 1005. 371 V. Hugo, « Allocution prononcée aux obsèques d’Honoré de Balzac », jeudi 22 août 1850, recueilli dans Honoré de Balzac. Mémoire de la critique, Stéphan Vachon éd., Paris, Presses de l’université de Paris-Sorbonne, 1999, pp. 149-150 ; c’est nous qui soulignons.
340
humaine ; et la profondeur atteinte par ses personnages, à travers lesquels Balzac conduit
une analyse de l’homme et de ses passions, de ses illusions, de ses abîmes.
Toutefois, si, comme l’affirment Charles Baudelaire et Théophile Gautier, Balzac,
plus qu’un excellent physiologiste, était un voyant qui, « comme Vichnou, le dieu indien,
possédait le don d’avatar, c’est-à-dire celui de s’incarner dans des corps différents et d’y
vivre le temps qu’il voulait »372, notre étude a essayé de démontrer comment la construction
du personnage balzacien a profité aussi d’un nouveau schéma, celui du type iconique, à savoir
de la nouvelle grille de lecture que la peinture, mais surtout l’illustration, ont inaugurée dans
les années 1820. C’est grâce à l’attention au corps humain donnée pour la première fois par
Delacroix dans ses illustrations du Faust de Goethe que le personnage, des arts figuratifs
aussi bien que de la littérature, est pensé non seulement comme un caractère, mais aussi
comme un être pourvu d’une apparence physique : le corps du personnage devient le lieu
où le caractère moral laisse des signes, détectables par le narrateur et, potentiellement, par
les autres personnages.
Du côté de l’illustration, nous avons vu comment la vision détaillée du corps du
personnage est rendue possible grâce au développement de deux procédés, le bois de bout
et la lithographie ; le premier rend possible l’exécution d’un dessin plus précis et permet de
graver l’image entre les lignes du texte écrit, pendant que le deuxième autorise l’artiste à
dessiner directement sur la matrice qui sert à la gravure, sans la médiation du graveur. Les
illustrateurs tels que Delacroix, Henry Monnier, Devéria, Gavarni et les frères Johannot
exploitent donc ces procédés d’abord dans leurs albums, et puis dans la presse illustrée de
1830, où le dessin de mode se mêle aux caricatures qui s’inspirent des théories scientifiques
de Buffon et Lavater pour la représentation des corps caricaturés. Du côté de la littérature,
en revanche, et notamment dans le cas spécifique de Balzac, la description du personnage
nécessite la médiation de l’illustration : nous avons émis l’hypothèse que c’est à travers son
expérience d’imprimeur, outre l’observation et le commentaire des illustrations de la presse
illustrée, que l’écrivain a appris à traduire en mots l’aspect physique des personnages. Cela a
conduit à la création d’un modèle, le type iconique, comme nous l’avons nommé, que Balzac
exploite pour la construction de ses personnages, qui deviennent par conséquent plus
complexes. La différence entre la description des personnages des Chouans et celle des
372 T. Gautier, « Honoré de Balzac », préface à La Comédie humaine, édition Houssiaux, 1868, recueilli dans Honoré de Balzac. Mémoire de la critique, Stéphan Vachon éd., Paris, Presses de l’université de Paris-Sorbonne, 1999, p. 286.
341
protagonistes de La Peau de chagrin nous semble une preuve évidente du changement
accompli par l’écriture balzacienne à cet égard.
Au cours de la décennie de 1830, néanmoins, le personnage n’est pas le seul élément
narratif qui bénéficie de la leçon de l’illustration : la scène aussi, unité narrative privilégiée
par Balzac, trouve une correspondance dans les frontispices des œuvres littéraires, où
l’aspect dramatique de la scène est exploité comme moment de contact entre le texte écrit
et l’image, comme en témoignent les exemples tirés des ouvrages balzaciens. Ce n’est
qu’avec l’édition illustrée par Gigoux du Gil Blas que le livre connaît une illustration plus
importante, qui dépasse le frontispice ou le bandeau en tête de page.
La Peau de chagrin illustrée, parue chez Delloye et Lecou en 1838, est en quelque sorte
l’acmé de la croissance du « livre romantique », comme est appelé le livre illustré de cette
période : l’illustration de la scène alterne avec le portrait de personnage, en donnant vie à
un enjeu entre le texte et l’illustration très intéressant à étudier. Pendant cette analyse, notre
enquête nous a conduite à une révélation : tout commentaire ultérieur du rapport entre
texte et image aurait dévalorisé le rôle de l’illustration dans le livre si l’on avait continué à la
considérer comme un paratexte.
De fait, à ce seuil temporel, le concept genettien de « paratexte iconique » ne réussit
pas vraiment à restituer la relation effective entretenue entre l’écriture et l’illustration : cette
dernière se refuse, selon les affirmations des illustrateurs eux-mêmes, à rester confinée aux
marges, elle veut être considérée comme un texte tout court. Les visual studies ont eu le
mérite de reconnaître à l’image son être d’ « iconotexte », c’est-à-dire un texte composé à
travers un langage différent de l’écriture. En analysant l’illustration comme un texte de
nature iconique qui se rapporte au texte écrit, nous avons identifié trois types de relation
entre écriture et illustration : l’illustration est un « protexte », littéraire ou interprétatif,
quand elle traduit fidèlement le mot écrit en image ; elle est un « altertexte » quand ce
qu’elle représente n’a aucun lien avec le texte écrit ; et l’illustration est un « contre-texte »
quand elle se pose en contraste avec l’écriture. C’est à travers ces trois catégories que nous
avons réussi à trouver la clé de lecture des illustrations de La Peau de chagrin et des œuvres
analysées dans les chapitres suivants : comment saisir la présence des charges de Balzac
dans ses propres ouvrages si l’on ne tient pas compte des rapports de forces entre l’écrivain
et les illustrateurs, où la volonté de ce dernier de s’affirmer en tant qu’artiste l’amène à
342
produire des images qui seulement en apparence, au premier coup d’œil, semblent un
entracte amusant ?
Paratexte iconographique vs Iconotexte
Protexte Altertexte Contre-texte
Ill. « Littéraire » Ill. « Interprétative »
Après l’édition de 1838 de La Peau de chagrin, les œuvres illustrées de Balzac
témoignent d’un nouveau phénomène : l’illustration tend à se focaliser de plus en plus sur
le personnage, au détriment de la scène et du décor. Si dans les physiologies on assiste à
une progressive stylisation du décor, et du dessin en général, qui n’exclut pas pourtant
l’emploi de la scène, avec la littérature panoramique on assiste à la suprématie de la figure
typique, construite selon un modèle rigoureux qui tend à raréfier la présence d’objets ou de
fonds dans les planches, en les confinant plutôt dans les vignettes ou dans les lettrines ;
seulement les objets strictement liés à la personnalité du type sont admis dans les gravures
hors-texte.
Ce modèle d’illustration, Balzac et ses éditeurs le proposent pour les gravures de La
Comédie humaine de l’édition Furne : l’écrivain donne des listes de personnages typiques à
illustrer aux dessinateurs, et, ainsi, il obtient l’effet d’une galerie de types qui, pourtant,
laisse une sensation froide et mortifère au lecteur-spectateur. Au lieu de transmettre la
richesse et la complexité des types balzaciens, les types illustrés restent médusés, pétrifiés
dans un seul instant temporel. Le personnage reparaissant, notamment, sur lequel nous
nous sommes concentrée, faillit dans son retour dans sa version illustrée – seulement
quatre personnages reparaissant comptent plus d’une gravure dans les textes différents.
L’illustration échoue au moment où on décide de mettre au premier plan le type. De fait, le
modèle des Français peints par eux-mêmes n’arrive pas à fonctionner dans un recueil de récits
de fiction qui se veut unitaire, telle La Comédie humaine : c’est Balzac lui-même qui, dans
l’Avant-propos à La Comédie, avait énoncé les deux unités narratives sur lesquelles ses romans
et contes se fondent, à savoir le portrait mais aussi la scène, outre les trois protagonistes de
son histoire de la société moderne, « les hommes, les femmes et les choses » ; tandis que
343
ces dernières ne trouvent presque pas de place dans les images. Le sacrifice de la scène et
des « choses », semble-t-il, n’a pas obtenu l’effet espéré, et l’illustration reste enfermée en
elle-même, refusant toute ouverture aux persnnages balzaciens.
L’échec du Furne semble être ressenti par Balzac lui-même : pour les Petites misères de
la vie conjugale il décide, en accord avec l’éditeur, Chlendowski, et l’illustrateur, Bertall, de
revenir à la forme d’illustration employée dans La Peau de chagrin de 1838, à savoir la
vignette in-texte outre quelques planches hors-texte. Le nombre élevé de gravures et le
retour au style caricatural de l’illustration permettent de dépasser la frustration causée par
les illustrations du Furne : le dialogue entre le texte et l’image est à nouveau assuré,
l’illustration fait l’écho aux gravures des textes de la littérature panoramique, en amplifiant
ainsi l’imaginaire évoqué par les mots de Balzac. Dans cette perspective, on a remarqué
comment la caricature a joué un rôle fondamental non seulement dans la formation du
jeune Balzac, comme paradigme du type iconique, mais aussi, dans les années 1840, comme
le seul style capable de saisir l’illustration du personnage : la scène de mœurs des années
1830 laissée de côté, c’est la caricature qui détermine le succès de l’illustration.
Sur ce dernier exemple nous avons arrêté notre enquête. Comme nous l’avons dit
dans l’Introduction, nous avons choisi de fixer la mort de Balzac comme seuil de la
chronologie à exploiter pour de nombreuses raisons : d’abord, parce que la quantité de
matériaux à analyser était déjà importante, et a demandé beaucoup de temps pour la
consultation et le commentaire ; deuxièmement, nous sommes convaincue que la
production d’illustrations contrôlées par l’auteur des récits implique des réflexions bien
différentes de celles qu’on évoque pour des éditions posthumes.
De fait, l’étude des éditions illustrées publiées après la mort de Balzac aurait dû faire
partie de notre analyse, mais le temps à notre disposition pour conduire notre recherche
était insuffisant pour nous consacrer aussi à cette part de la bibliographie balzacienne.
Nous nous contentons d’en esquisser quelques perspectives.
La mort de Balzac donne à l’écrivain le succès auquel il avait toujours aspiré ; la
conséquence de cette « sacralisation » de l’auteur de La Comédie humaine est, notamment, la
multiplication des impressions de ses œuvres, dont une bonne partie est illustrée.
Houssiaux publie le « Furne corrigé » en ajoutant des illustrations nouvelles ; Maresq fait
paraître une édition d’Œuvres complètes illustrées où le frontispice de Célestin Nanteuil s’ajoute
344
à un collage d’illustrations extraites du Furne, de La Peau de chagrin Delloye et Lecou ;
Gustave Doré illustre les Contes drolatiques. Tout cela seulement dans les années 1850.
Après, la veuve Houssiaux, Michel Lévy et Calmann-Lévy publieront d’autres éditions
illustrées à la fin du siècle. Au fur et à mesure que la célébrité de Balzac grandit, les éditions
illustrées de ses œuvres se multiplient, comme le démontrent les Annexes. Ces éditions
représentent un sujet très intéressant à traiter : les illustrations qui y figurent ne sont pas
toujours originelles, mais elles sont reprises à des éditions romantiques ou au Furne. Les
éditions Garnier des années 1950, par exemple, combinent les illustrations romantiques des
œuvres de Balzac avec d’autres illustrations romantiques qui ne se trouvent pas dans les
livres de Balzac, comme elles n’étaient que des estampes du siècle. Au cours du XXᵉ siècle,
en effet, on assiste à une utilisation très répandue de l’illustration exploitée comme
document historique, ce qui explique la coprésence de types d’illustrations différentes dans
le même livre ; c’est certainement maintenant la politique éditoriale qui établit le choix des
illustrations à insérer dans le texte.
On pourrait dire qu’après la mort de Balzac l’illustration devient une image
terriblement mouvante : elle passe d’édition en édition, elle revient et disparaît, et parfois
on perd l’édition d’origine de certaines images, tant elles sont exploitées. Cela serait un
aspect à étudier à l’avenir ; et on pourrait bien trouver, un jour, la réponse à la question que
nous posons, en guise de conclusion à un argument qui ne verra jamais un dénouement :
que font donc Mme Vauquer et Balzac à côté de la chaise vide de Charles Dickens373 ?
373 Nous remercions vivement Andrea Pitozzi pour avoir attiré notre attention sur cette image après l’une de nos conversations sur les illustrations du Furne ; à lui cet hommage, et mes remerciements de son soutien pendant ces trois années de Doctorat.
347
BIBLIOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIE
• Œuvres d’Honoré de Balzac
Annette et le criminel, Paris, Buissot, 1824, 2 vol.
Autre étude de femme, Pl, t.III.
Avant-Propos à La Comédie humaine, Pl, t.I.
« Bacchanales de 1831 », Pl, t.II.
Le Cabinet des Antiques, Pl, t.VII.
Complaintes satiriques sur les mœurs du temps présent, OD, Pl, t.II.
Correspondance, Paris, Garnier, 1960-1969, 5 vol.
Correspondance, Paris, Pl, 3 vol., 2006-2017.
Le Cousin Pons, Pl, t.VII.
« Le Dîner bourgeois, Scènes populaires dessinées à la plume par H. M. », OD, Pl, t.II.
« Études sur M. Beyle » dans S. Vachon, Balzac. Écrits sur le roman, Paris, Librairie Générale
Française, 2000.
Étude sur la Chartreuse de Parme de Monsieur Beyle, Chemin des Pins, Castelnau-le-Lez, éditions
Climats, 1989 (1840).
« La Femme comme il faut » dans Les Français peints par eux-mêmes, t.I.
La Femme de trente ans, Pl, t.II.
La Femme supérieure, la Maison Nucingen, La Torpille, Paris, Werdet éd., 1838.
« Gavarni », OD, Pl, t.II.
Histoire de l’Empereur racontée dans une grange par un vieux soldat, Hetzel, Paulin et Dubochet
éditeurs, 1842.
Illusions perdues, Pl, t.V.
348
Lettres à Madame Hanska, Paris, Laffont, 1990, 2 vol.
Lettres sur Paris, OD, Pl, t.II.
Madame Firmiani, Pl, t.II.
Le Médecin de campagne, Pl, t.IX.
« Monographie de la Presse parisienne », La Grande Ville, t.II.
Paris marié, Paris, Hetzel, 1846.
La Peau de chagrin, Paris, Delloye et Lecou, 1838.
La Peau de chagrin, Pl, t.X.
« Peines de cœur d’une Chatte Anglaise », Scènes de la vie privée et publique des animaux, t.I.
Petites misères de la vie conjugale, Paris, Chlendowski, 1846.
Petites misères de la vie conjugale, Pl, t.XII.
Pierre Grassou, Pl, t.VI.
Physiologie de l’Employé, Paris, Aubert et Lavigne, 1841.
Physiologie du mariage, Pl., t.XI.
Physiologie du rentier de Paris et de Province, Paris, P. Martinon, 1841.
Prospectus du journal La Caricature, dans OD, Pl, t.II.
Les Secrets de la princesse de Cadignan, Pl, t.XI.
Specimen de Balzac, René Ponot éd., Paris, éds. Cendres, 1992.
Une ténébreuse affaire, Pl, t.VIII.
« Travestissements pour 1832 et Physionomie de la population de Paris », OD II, Pl.
« Une marchande à la toilette ou Madame la Ressource en 1844 », Le Diable à Paris, t.I.
« Voyage pour l’éternité », OD, Pl, t.II.
349
• Bibliographie générale
Bakhtine, Michael, Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard, 1984.
Barthes, Roland, « Rhétorique de l’image », L’obvie et l’obtus. Essais critiques, t.III, Paris, Seuil,
1982 (1964).
Baudelaire, Charles, Baudelaire, Petits poèmes en prose ou Le Spleen de Paris, Paris, l’école des
loisirs/ Le Seuil, 1994 (1869), pp. 139-140.
Benjamin, Walter, Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Paris, Payot, 1974.
Id., Paris, Capitale du XIXᵉ siècle, Paris, Cerf, 1989.
Bergez, Daniel, Littérature et peinture, Paris, A. Colin, 2004.
Brooks, Peter, The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of
Excess, New Haven and London, Yale university Press, 1976.
Carroll, Lewis, Alice’s Adventures in Wonderland, London, Macmillan, 1865.
Del Lungo, Andrea, La fenêtre. Sémiologie et histoire de la représentation littéraire, Paris, Seuil,
2014.
Delacroix, Eugène, Correspondance, Paris, édition Plon, 1936, 2 vol.
Eco, Umberto, Vertige de la liste, Paris, Flammarion, 2009.
Forster, Edward Morgan, Aspects of the novel, London, Sydney, Auckland, Hodder &
Stoughton in association with Edward Arnold, 1993 (1927).
Genette, Gérard, Palimpsestes, Paris, Seuil, 1984.
Id., Seuils, Paris, Seuil, 1987.
Gendrel, Bernard et Labouret, Mireille (dir.), Les Cent-Jours vus de la littérature : Suivi d'un inédit
de Charles de Rémusat, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2017.
Ginzburg, Carlo, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Crisi della ragione, Aldo Gargani
(dir.), Torino, Einaudi, 1979, pp. 57–106 ; trad. en français : « Traces. Racines d’un
350
paradigme indiciaire » dans Id., Mythes, emblèmes, traces ; morphologie et histoire,
Paris, Flammarion, 1986, pp. 139-180.
Goethe, Johann Wolfgang von, Faust, trad. en français par Albert Stapfer, illustrations par
Eugène Delacroix, Paris, Motte éditeur, 1828.
Goncourt, Edmond et Jules de, L’art du dix-huitième siècle et autres textes sur l’art, Paris, éd.
Hermann, 1967 (1873-1874).
Hamon, Philippe, Exposition : littérature et architecture au XIXᵉ siècle, Paris, José Corti, 1989.
Id., Imageries. Littérature et image au xixᵉ siècle, Paris, José Corti, 2001.
Hyppolite, Pierre (dir.), Architecture, littérature et espace, Limoges, PULIM, Collection Espaces
Humains, 2006.
Jung, Willi (Hg.), Napoléon Bonaparte oder der entfesselte Prometheus, Bonn, Bonn University
Press, 2015.
Milner, Max, Le Diable dans la littérature française. De Cazotte à Baudelaire (1772-1861), Paris,
José Corti, 2007.
Mitchell, W. J. Thomas, Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago and London, University of
Chicago Press, 1987 (1986).
Monnier, Henry, Mémoires de Monsieur Joseph Prudhomme, Paris : Librairie Nouvelle, 1857, 2
vol.
Moretti, Franco, Il romanzo di formazione, Torino, Einaudi, 1999.
Muhlstein, Anka, La Plume et le pinceau. L’empreinte de la peinture sur le roman au XIXᵉ siècle,
Paris, Odile Jacob, 2016.
Nodier, Charles, Histoire du roi de Bohème et des septs chateaux, Paris, Delangle, 1830.
Nodier, Charles ; Taylor, Isidore ; Cailleux, Alphonse de, Voyages pittoresques et romantiques
dans l’ancienne France, Paris, imprimerie Didot frères, 1820, t.I.
351
Oppici, Patrizia et Pietri, Susi (dir.), L’Architecture du texte, l’architecture dans le texte, Macerata,
Edizioni Università di Macerata, 2018.
Peirce, Charles Sanders, Écrits sur le signe, Paris, Seuil, 1978.
Pietri, Susi, « Les mots et les pierres. Enjeux d’une rencontre » dans L’Architecture du texte,
l’architecture dans le texte, Patrizia Oppici et Susi Pietri dir., Macerata, Edizioni Università di
Macerata, 2018.
Preiss, Nathalie, Pour de rire ! La blague au XIXᵉ siècle, Paris, PUF, 2002.
Robert, Marthe, Roman des origines, origines du roman, Paris, Grasset, 1972.
Spandri, Francesco (dir.,), Littérature et économie. La représentation de l’argent dans le roman français
du XIXe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2013.
Staël, Madame de, De l’Allemagne, Paris, H. Nicolle, 1810, t.II.
Stapfer, Albert, « Préface », dans J.W. Goethe, Faust, trad. en français par Albert Stapfer,
illustrations par Eugène Delacroix, Paris, Motte éditeur, 1828.
Stara, Arrigo, L’Avventura del personaggio, Verona, Le Monnier, 2004.
Stead, Évanghélia, « Le voyage de l’image de Faust i de Goethe. Lecture, réception et
iconographie extensive et intensive au XIXᵉ siècle », dans L’image à la lettre, Nathalie Preiss
et Joëlle Raineau (dir.), Paris, éditons Paris-Musées/des Cendres, 2005.
Todorov, Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, « Points », 1970.
Valazza, Nicolas, Crise de plume et souveraineté du pinceau. Écrire la peinture de Diderot à Proust,
Paris, Classiques Garnier, 2013.
Vouilloux, Bernard, La peinture dans le texte, XVIIIᵉ-XXᵉ siècles, Paris, CNRS Éditions, 1994.
Id., Tableaux d’auteurs. Après l’« ut pictura poesis », Saint-Denis, PUV, 2004.
352
• Bibliographie sur l’histoire du livre
Adhémar, Jean, et Seguin Jean-Pierre, Le Livre romantique, Paris éditions du Chêne, 1968.
Bacot, Jean-Pierre, La presse illustrée au XIXᵉ siècle : une histoire oubliée, Limoges, Presses
universitaires Limoges, 2005.
Barbier, Frédéric, « Les formes du livre », dans Histoire de l’édition française, Vol. II, Henri-
Jean Martin et Roger Chartier (dir.), Paris, Promodis, 1984, pp. 570-585.
Id., « Les innovations technologiques », dans Histoire de l’édition française, vol. II,
Henri-Jean Martin et Roger Chartier (dir.), Paris, Promodis, 1984, pp. 536-543.
Id., Histoire du livre en Occident, Paris, A. Colin, 2012 (2000).
Bassy, Alain-Marie, « Le livre mis en pièce(s). Pensées détachées sur le livre romantique »,
Romantisme, n°43, 1984, pp. 18-28.
Brun, Robert, Le livre français, Paris, Presses Universitaires de France, 1969.
Chartier, Roger, « L’Ancien régime typographique » dans Annales E.S.C., 36° année, mars-
avril 1981, pp. 191-209.
Id., « Le livre au temps de Didot », dans Histoire de l’édition française, Henri-Jean
Martin et Roger Chartier (dir.), Paris, Promodis, 1984, vol. II.
Id., « Du livre au livre », dans Pratiques de la lecture, Roger Chartier (dir.), Paris, Petite
bibliothèque Payot, 1985, 2ème éd. 1993, pp. 79-114.
Mollier, Jean-Yves, L'Argent et les lettres : histoire du capitalisme d'édition : 1880-1920, Paris,
Fayard, 1988.
Mollier, Jean-Yves, « L’imprimerie et la librairie en France dans les années 1825-1830 »,
Balzac imprimeur et défenseur du livre, Paris, Paris-Musées, Éditions des musées de la ville de
Paris, Éditions des Cendres, 1995, pp. 17-38.
Panchout, Anne, « Un imprimeur nommé Balzac » dans Le trois révolutions du livre, Alain
Mercier (dir.), Paris, Imprimerie Nationale, 2002, pp. 311-316.
353
Vicaire, George, Manuel de l’amateur de Livres du xixᵉ siècle (1801-1893), Paris, Librairie A.
Rouquette, 1894, 2 vol.
• Bibliographie sur l’illustration, les illustrateurs et les techniques de gravure
AA.VV., I nipoti di Töpffer. Il fumetto svizzero oggi, Milano, Hazard Edizioni, 2002.
Baudelaire, Charles, « Quelques caricaturistes français », Œuvres complètes, Pl, t.II, 1976.
Bertall, Henry, « Souvenirs intimes » dans Le Courriel balzacien, n° 58, 1995, pp. 29-38 (1881).
Blachon, Rémi, La gravure sur bois au XIXe siècle. L’âge du bois debout, Paris, Les Éditions de
l'Amateur, 2001.
Bouchot, Henry, Les Livres à vignettes, XIXᵉ siècle, Paris, Rouveyre éditeur, 1891.
Bouquin, « Lithographie », dans Dictionnaire encyclopédique du livre, Pascal Fouché, Daniel
Péchoin et Philippe Schuwer (dir.), Paris, Éd. Du Cercle de la librairie, 2005, t. [2] E-M, p.
782.
Champfleury, Les "Vignettes" romantiques. Histoire de la "Littérature" et de l'Art 1825-1840,
Paris, Dentu, 1883.
Corbin, A., « La mise en scène du pouvoir et de la dérision », dans Presse et Caricature,
Cahiers de l’institut d’histoire de la presse et de l’opinion, n°7, 1983.
Corsini, S. ; Grinevald, P.-M., « Vignette », dans Dictionnaire encyclopédique du Livre, Pascal
Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer (dir.), Electre, éditions du Cercle de la Librairie,
2011, t. [3] N-Z, p. 980.
Davis, Kunzle, Father of comic strip : Rodolphe Töpffer, Mississipi, University Press of
Mississippi, 2007.
Devès, Cyril, « Le lecteur et son regard sur la littérature illustrée au XIXᵉ siècle en France:
entre choix, attentes et imaginaire collectif » dans L’esthétique du livre, Alain Milon et Marc
Perelman (dir.), Paris, Presses Universitaires de Paris 10, pp. 375- 393.
Farrant, Tim, « La vue d'en face ? Balzac et l'illustration », AB 2011, pp. 249-271.
354
Fierro, Anna, « Théâtre à lire, roman à jouer. L’hybridation dans Petites misères de la vie
conjugale » dans Hybridations. Les rencontres du texte et de l’image, Tours, Presses François-
Rabelais, 2014.
Grandville, Jean-Jgnace ; Taxile, Delord, Un Autre monde, Paris, H. Fournier, 1844.
Groensteen, Thierry et Peeters, Benoît Peeters, Töpffer : L'Invention de la Bande Dessinée, Paris,
Hermann, éditeur des sciences et des arts, 1994.
Gusman, Pierre, La Gravure sur bois en France au XIXᵉ siècle, Paris, Albert Moracé Grand
éditeur, 1929.
Kaenel, Philippe, Le métier d'illustrateur, 1830-1880. Rodolphe Töpffer, J.-J. Grandville, Gustave
Doré, Paris, Messene, 1996.
Id., « Allégories, rébus, hiéroglyphes : J.-J. Grandville et les ˝images ingénieuses˝ »
dans World & Image Interaction, Bâle, Wiese Werlag, pp. 109-122.
Lascar, A., « Annexe I. Les vignettes de 1832 » dans A. Karr, Sous le tilleul (1832), Paris,
Société des textes français modernes, 2018, pp. 521-525.
Le Men, Ségolène, « Balzac, Gavarni Bertall et les Petites misères de la vie conjugale »,
Romantisme, 1984, pp. 29-44.
Id., « Mœurs aquatiques, une lithographie de Grandville ˝expliquée˝ par Balzac »,
Gazette des Beaux-Arts, février 1988, pp. 63-70.
Id., La Cathédrale illustrée. De Hugo à Manet, Paris, Hazan, 2014 (1998).
Id., Une Comédie inachevée : Balzac et l’illustration, Tours, Bibliothèque municipale de
Tours, 1999.
Id., « Iconographie et illustration », dans L’illustration. Essais d’iconographie, Actes du
Séminaire CNRS (GDR 712), études réunies par Maria Teresa Caracciolo et
Ségolène Le Men, Paris, Klincksieck, 1999.
Id., « La ˝littérature panoramique˝ dans la genèse de La Comédie humaine : Balzac et
Les Français peints par eux-mêmes », AB 2002, pp. 73-100.
355
Id., Pour rire ! Daumier, Gavarni, Rops : L'invention de la silhouette, Paris, Somogy
éditions d'art, 2010.
Meininger, Anne-Marie, « Balzac et Henry Monnier », AB 1966, p. 217-244.
Melot, Michel, L’Illustration : histoire d’un art, Genève, Skira, 1984.
Id., « Conclusions » dans L’art de la caricature, sous la direction de Ségolène Le Men,
Paris, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2011, p.327.
Nerlich, Michael, « Qu’est-ce qu’un iconotexte ? Réflexions sur le rapport texte-image
photographique dans La Femme se découvre d’Evelyne Sinnassamy » dans, Iconotextes, Alain
Montandon (éd.), Paris, Ophrys, 1990.
Pelletan, Eugène, « La littérature illustrée », dans La Revue des deux mondes, février 1843.
Mirandola, Giorgio, Libro e illustrazione nell’Ottocento. Parte prima: Le tecniche manuali. Volume
primo: i procedimenti, Bergamo, Università di Bergamo, 2008.
Preiss, Nathalie, Les Physiologies en France au XIXᵉ siècle. Étude historique, littéraire et stylistique,
Mont-de-Marsan, Edition InterUniversitaires, 1999.
Id., « Le type dans les Physiologies » dans L’Illustration. Essais d’iconographie, Actes du
séminaire du CNRS (GDR 712), études réunies par Maria Teresa Caracciolo et
Ségolène Le Men, Paris, Klincksieck, 1999.
Id., « Balzac illustre(é) », Littera, n°3, 2018, pp. 37-65.
Refort, Lucien, La Caricature littéraire, Paris, Librairie Armand Colin, 1932.
Schapiro, Meyer, Words, Script, and Pictures : Semiotics of Visual Language, New York, George
Braziller, 1996.
Tran, Trung, « L’image dans l’espace visuel et textuel des narrations illustrées de la
Renaissance : morphologie du livre, topographie du texte et parcours de lecture », dans Le
livre et ses espaces, sous la direction d’Alain Milon et de Marc Perelman, Paris, Presses
universitaires de Paris 10, 2007.
356
Yousif, Keri, Balzac, Grandville and the Rise of the Book Illustration, Farnham, Surrey, England,
Burlington, Ashgate, 2012.
• Études sur Balzac
Andréoli, Max, Le Système balzacien, essai de description synchronique, Lille, Atelier national de
reproduction des thèses, Université de Lille III, 1984, 2 vol.
Aranda, Daniel, « Originalité historique du retour des personnages balzaciens » dans
RHLF, novembre-décembre 2001, n°6, 101e année, pp. 1573-1589.
Arrigon, Louis-Jules, Les débuts littéraires d’Honoré de Balzac, Paris, Perrin et Cie, 1924.
Barbéris, Pierre, Balzac et le mal du siècle. Contribution à une physiologie du monde moderne, Paris,
Gallimard, 1970, 2 vol.
Id., Aux sources de Balzac : les romans de jeunesse, Genève-Paris, Slatkine, 1985.
Bardèche, Maurice, Balzac, romancier. La formation de l’Art du Roman chez Balzac jusqu’à la
publication du Père Goriot (1820-1835), Genève, Slatkine Reprints, 1967.
Baroni, Silvia, Baroni, Le apparenze sociali in Honoré de Balzac, Mémoire de master, sous la dir.
de Daniele Giglioli, soutenu chez l’Université de Bergame, Italie, le 29 avril 2015.
Id., « La comédie de la description. “Capricci” balzachiani », Poli-Femo, n°11-12,
2016.
Bertini, « Balarouth : Balzac portraitiste en 1822 », Cahiers de littérature française, I, Bergamo et
Paris, Bergamo University Press et L’Harmattan, 2005, pp. 33-38.
Bonard, Olivier, La peinture dans la création balzacienne, Genève, Librairie Droz, 1969.
Borderie, Régine, Balzac peintre de corps, Paris, SEDES, 2002.
Chollet, Roland, Balzac journaliste. Le tournant de 1830, Paris, Garnier, 2016 (1983).
Id., « Ci-gît Balzac » dans Balzac, oeuvres complètes : Le moment de « La Comédie
humaine », Claude Duchet et Isabelle Tournier (dir.), Vincennes, PU Vincennes,
1995, pp. 283-298.
357
Davis, Jérôme, Balzac, une éthique de la description, Paris, Honoré Champion, 2010.
Davin, Félix, « Introduction aux Études philosophiques » dans Stéphane Vachon, Balzac. Écrits sur
le roman. Anthologie, Paris, Librairie Générale Française, 2000.
Diaz, José-Luis, « Balzac analyste du journalisme. Selon la ʺMonographie de la presse
parisienneʺ », AB 2006, pp. 215-235.
Duchet, Claude, « Présentation » dans Balzac et La Peau de chagrin, Claude Duchet (dir.),
Paris, C.D.U et SEDES réunis, 1979, pp. 7-24.
Dupuis, Danielle, « Entre théâtre et peinture : le tableau pathétique balzacien », AB 2001,
pp.83-98.
Ebguy, Jacques-David, Le héros balzacien. Balzac et la question de l’héroïsme, Saint-Cyr-sur-Loire,
Christian Pirot, 2010.
Fargeaud, Madeleine, « Le premier ami de Balzac : Dablin », AB 1964, pp. 3-24.
Farrant, Tim, « Du pittoresque au pictural », AB 2004, pp. 113-135.
Id., « La vue d'en face ? Balzac et l'illustration », AB 2011, pp. 249-271.
Felkay, Nicole, Balzac et ses éditeurs, 1822-1837. Essai sur la librairie romantique, Paris,
Promodis, 1987.
Fierro, Anna, « Théâtre à lire, roman à jouer. L’hybridation dans Petites misères de la vie
conjugale » dans Hybridations. Les rencontres du texte et de l’image, Tours, Presses François-
Rabelais, 2014.
Fiorentino, Francesco, « Province, mondanité, cohabitation. Notes sur l’espace romanesque
chez Balzac » dans Cahiers de Littérature française, I, 2005, pp. 71-82.
Gaborit, Élise, Labouret, Mireille et Lamy, Isabelle, Balzac, romancier des femmes, Catalogue de
l’exposition du Musée de Saché, 3 octobre 2015 – 3 janvier 2016, Tour, Conseil
départemental d’Indre-et-Loire, 2015.
358
Gagneux, Yves, Le musée imaginaire de Balzac : Les 100 chefs-d'oeuvre au cœur de la Comédie
humaine, Paris, Beaux-Arts Editions, 2012.
Gautier, Théophile, Portrait de Balzac, dans Portrait de Balzac, précédé de Portrait de Théophile
Gautier par lui-même, Paris, L’Anabase, 1994 (1858).
Id., « Honoré de Balzac », préface à La Comédie humaine, édition Houssiaux, 1868,
recueilli dans Honoré de Balzac. Mémoire de la critique, Stéphan Vachon éd., Paris,
Presses de l’université de Paris-Sorbonne, 1999.
Gerwin, Elizabeth, « Révision et subversion : Balzac et le mythe de Napoléon », @nalyses,
revue numérique, vol.8, n.3, automne 2013, pp. 48-88.
Goetz, Adrien, « Une toile de Rembrandt, marchant silencieusement et sans cadre.
L’esthétique du portrait peint dans La Comédie humaine », AB 2001, pp. 99-112.
Gozlan, Léon, Balzac en pantoufles, Paris, Michel Lévy, frères, J. Hetzel et Cie, 1856.
Guichardet, Jeannine, Balzac archéologue de Paris, Genève, Slatkine, 1986.
Hugo, Victor, « Allocution prononcée aux obsèques d’Honoré de Balzac », jeudi 22 août
1850, recueilli dans Honoré de Balzac. Mémoire de la critique, Stéphan Vachon éd., Paris, Presses
de l’université de Paris-Sorbonne, 1999, pp. 149-150.
Jobert, Barthélémy, « Delacroix chez Balzac », AB 2011, pp. 63-77.
Jung, Willi, « ˝L'effet des tableaux˝. Lecture picturale de La Maison du chat-qui-pelote », AB,
2004, pp. 211-228.
Labouret, Mireille, « Fabriquer le temps à rebours : problèmes romanesques et mécanismes
reparaissant dans La Torpille » dans L’Année balzacienne 2002, pp. 181-203.
Id., « La fabrique du roman : ˝parallèles˝ et ˝superposition˝ » dans Illusions perdues.
Actes de la Sorbonne, José-Luis Diaz et André Guyaux (dir.), Paris, Presses de
l’Université de Paris Sorbonne, 2003, pp. 163-174.
Id., « À propos des personnages reparaissant. Constitution du personnage et ˝sens
de la mémoire˝ », dans AB 2005, pp. 125-142.
359
Lavagetto, Mario, La macchina dell’errore, Torino, Einaudi, 1996.
Le Leyzur, Philippe et Oger Danielle (dir.), Balzac et la peinture, Tours, Muse ́e des Beaux-
Arts de Tours, Farrago, 1999.
Le Men, Ségolène, « Balzac, Gavarni Bertall et les Petites misères de la vie conjugale »,
Romantisme, 1984, pp. 29-44.
Id., « Mœurs aquatiques, une lithographie de Grandville ˝expliquée˝ par Balzac »,
Gazette des Beaux-Arts, février 1988, pp. 63-70.
Id., Une Comédie inachevée : Balzac et l’illustration, Tours, Bibliothèque municipale de
Tours, 1999.
Id., « La ˝littérature panoramique˝ dans la genèse de La Comédie humaine : Balzac et
Les Français peints par eux-mêmes », AB 2002, pp. 73-100.
Lorant, André, « Un jeune romancier à l’écoute de son cœur », introduction à Annette et le
criminel, Paris, Flammarion, 1982.
Id., « Sources iconographiques des romans de jeunesse de Balzac », AB 1998, pp.
65-80.
Lotte, Fernand, « Le retour des personnages dans La Comédie humaine » dans L’Année
balzacienne 1961, pp. 227-281.
Lukács, György, Balzac et le réalisme français, Paris, la Découverte, 1999 (1934-1935).
Lyon-Caen, Boris ; Thérenty, Marie-Ève, « Balzac et la littérature zoologique. Sur les Scènes
de la vie privée et publique des Animaux » dans La Comédie animale : le bestiaire balzacien, Aude
Déruelle dir., Actes de la journée d’études de juin 2009, publiés sur le site internet du
GIRB : http://balzac.cerilac.univ-paris-diderot.fr/bestiaire.html
Maës, Antoine, « L’illustre ascendance de Théodore Dablin. Une famille de serruriers du roi à
Rambouillet sous Louis xvi », AB 2017, pp. 41-66
360
Massol, Chantal, « Transfert d’écriture : le réemploi de La Grande Bretèche, dans Balzac,
oeuvres complètes : Le moment de « La Comédie humaine », Claude Duchet et Isabelle Tournier
(dir.), Vincennes, PU Vincennes, 1995, pp. 203-216.
Id., Une poétique de l'énigme. Le Récit herméneutique balzacien, Genève, Droz, 2006.
Meininger, Anne-Marie, « Balzac et Henry Monnier », AB 1966, p. 217-244.
Mollier, Jean-Yves, « L’imprimerie et la librairie en France dans les années 1825-1830 »,
Balzac imprimeur et défenseur du livre, Paris, Paris-Musées, Éditions des musées de la ville de
Paris, Éditions des Cendres, 1995, pp. 17-38.
Mozet, Nicole, La ville de province dans l’œuvre de Balzac, Paris, C.D.U./SEDES, 1982.
Id., « Introduction à Autre étude de femme », dans Autre étude de femme, Pl, t.III, pp. 657-
671.
Neefs, Jacques, « Figurez-vous… » dans Balzac et le style, études réunies et présentées par
Anne Herschberg-Pierrot, Paris, Sedes, 1998.
Pierrot, Roger, « Balzac "éditeur" de ses œuvres », dans Balzac imprimeur et défenseur du livre,
Paris, Paris-Musées, Éditions des musées de la ville de Paris, Éditions des Cendres, 1995,
pp. 55-68.
Pitt-Rivers, Françoise, Balzac et l’Art, Paris, éditions du Chêne, 1993.
Surville, Laure, Balzac, sa vie et ses œuvres d’après sa correspondance, Paris, éd. l’Harmattan, 2005
(1858).
Tolley, Bruce, Balzac avant La Comédie humaine, Courville, 1936.
Id., « Les Œuvres diverses de Balzac », AB 1963, pp. 46-51.
Tournier, Isabelle ; Duchet, Claude, (dir.), Le « Moment » de La Comédie humaine : Balzac,
Œuvres complètes. Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 1993.
Tritter, Jean-Louis, « Histoire du texte » dans La Comédie humaine, vol. XII, Pl, 1981.
361
Vanoncini, André, « Le pacte : structures et évolutions d’un motif balzacien », AB 2002, pp.
279-292.
Vouilloux, Bernard, « Les fantaisies journalistiques de Balzac », AB 2012, pp.5-24.
Watts, Andrew, Preserving the Provinces : Small Town and Countryside in the Work of Honoré de
Balzac, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, Peter Lang,
2007.
Werdet, Edmond, Portrait intime de Balzac : sa vie, son humeur et son caractère, Paris, A. Silvestre,
1859.
Wurmser, André, La Comédie inhumaine, Paris, Gallimard, 1970.
• Littérature panoramique
Balzac, H. de, « La Femme comme il faut » dans Les Français peints par eux-mêmes, t.I.
Id., « Peines de cœur d’une Chatte Anglaise », Scènes de la vie privée et publique des
animaux, t.I.
Id., « Monographie de la Presse parisienne », La Grande Ville, t.II.
Id., « Une marchande à la toilette ou Madame la Ressource en 1844 », Le Diable à
Paris, t.I.
Fournier, Marc, « Avertissement » dans La Grande Ville, t.II
Kock, Paul de, « Quelques mots avant d’entrer en matière » dans La Grande Ville, Paris, Au
Bureau central des publications nouvelles, 1842.
La Grande Ville, Paris, Au Bureau central des publications nouvelles, 1842.
Le Diable à Paris, Paris, Hetzel, 1844-1845, 2 vol.
Les Français peints par eux-mêmes, Paris, Curmer, 1840-1842, 9 vol.
Preiss, Nathalie ; Stiénon, Valérie, « ʺCroqués par eux-mêmesʺ. Le panorama à l’épreuve du
panoramique » dans Interférences littéraires/ Literaire interrferenties, n.8, « Croqués par eux-
362
mêmes. La société à l’épreuve du ʺpanoramiqueʺ », Nathalie Preiss et Valérie Stiénon dir.,
mai 2012.
Scènes de la vie privée et publique des animaux, Paris, Hetzel et Paulin éditeurs, 1842.
Stahl, P.-J., Préface aux Scènes de la vie privée et publique des animaux, Paris, Hetzel et Paulin
éditeurs, 1842.
363
• Sitographie
https://intru.hypotheses.org/les-axes-de-recherches-2/iconotextes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Holyrood
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108013v/f317.item
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31397144g
http://www.cnrtl.fr/definition/frontispice
http://www.balzac-etudes.paris-sorbonne.fr/balzac2/bibliographie-generale-selective.html
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k19956f/f232.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3120537/f29.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k355423/f644.item.r=litt%C3%A9rature%20illustr
%C3%A9e
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=25721
http://balzac.cerilac.univ-paris-diderot.fr/bestiaire.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Lafarge
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
in cotutela con Università Paris-Est
DOTTORATO DI RICERCA IN
STUDI LETTERARI E CULTURALI
Ciclo XXXI Settore Concorsuale: 10/F4 – Critica Letteraria e Letterature comparate
Settore Scientifico Disciplinare: L-FIL-LET/14 - Critica Letteraria e Letterature comparate
Illustrer La Comédie humaine. Entre texte et image Vol.II
Presentata da: Silvia Baroni
Coordinatore Dottorato Supervisore
Silvia Albertazzi Donata Meneghelli
Supervisore
Mireille Labouret
Esame finale anno 2019
AVERTISSEMENT
Les catalogues ci-joint sont le fruit d’un travail de plus de deux années. Ce travail n’a pas la
présomption d’être complet ou exhaustif, nous sommes conscientes qu’il est impossible :
non seulement il n’est pas possible de tout savoir, mais nous savons bien que certains
livres, surtout du XIXᵉ siècle, ont disparu, en ne laissant que de traces de leur existence.
Cependant, nous avons essayé de restituer le plus grand nombre possible d’éditions
françaises illustrées des œuvres de Balzac, à partir de son vivant jusqu’à nos jours. La
contrainte linguistique était nécessaire, non seulement pour marquer une limite à cette
recherche philologique mais aussi pour définir de façon cohérente le champ de notre
étude ; de toute façon, il serait de grand intérêt d’organiser un projet qui puisse associer les
centres d’études balzaciennes de toutes les nations pour rédiger un catalogue des éditions
illustrées des œuvres balzaciennes en toutes les langues.
C’est bien l’exigence d’identifier le corpus sur lequel construire notre travail qui nous
a amenée à la rédaction des catalogues : pendant la rédaction du mémoire du master, qui
visait la description du système d’apparences sociales dans les textes de Balzac, nous avions
cherché un appui dans les illustrations afin d’expliquer l’importance de la description du
corps des personnages dans la poétique balzacienne ; dans cette situation nous nous
sommes mesurée pour la première fois à la difficulté de gérer un ensemble d’images
complètement hors contrôle, en partie disponible sur les réseaux informatiques mais avec
des attributions imprécises d’illustrateur ou bien d’édition dans laquelle l’image a paru
originairement. C’est en raison de cela que l’idée d’un catalogue des éditions balzaciennes
illustrées a pris forme.
Au début de la deuxième année de doctorat donc, lorsque le sujet de la thèse était
finalement défini, nous avons projeté de créer une base de données fondée sur trois
critères, illustrateur-édition-année, où chaque illustration aurait pu être associée à
l’illustrateur, à l’édition de provenance originaire, et à l’année de production. Mais c’était un
programme trop vaste, pour lequel il aurait été nécessaire de faire intervenir et un groupe
d’étudiants ou doctorants experts en informatique pour la création d’un catalogue
numérique et une équipe de photographes spécialisés dans la photo documentaire pour la
numérisation des illustrations ; outre cela, il aurait fallu disposer d’une période temporelle
bien plus longue, deux ans n’étant pas suffisant pour réaliser ce type de catalogue. Nous
étions obligées d’y renoncer, même si nous caressons l’espoir qu’un jour ce sera possible de
concrétiser cette base de données, peut-être avec un projet post-doctorat.
Nous avons alors affiné ce projet, un labor limae qui nous a conduit au volume que
voici : un recueil d’annexes divisé en deux sections, la première regroupant les catalogues
qui nous ont servi pour la partie théorique de notre étude, comprenant exclusivement des
catalogues raisonnés des textes illustrés sous la supervision de Balzac, et la deuxième
section contenant les listes des éditions illustrées datées du vivant de Balzac à aujourd’hui,
partie qui, nous l’espérons, sera un outil précieux auquel tout lecteur ou spécialiste de
Balzac intéressé par l’illustration pourra recourir.
Nous avons décidé de recueillir tous ces annexes dans un volume à part, pour une
raison très simple : nous croyons que détacher les annexes du texte permettra au lecteur de
consulter le catalogue désiré quand il le veut, à son aise, de manière plus pratique qu’en
continuant à feuilleter dans le texte à la recherche du catalogue, doigt sur la page pour ne
pas perdre le fil le discours.
Dans la deuxième partie, notamment, les catalogues ont été organisés selon trois
types de mots-clés : nous avons distingué entre (1) œuvres en édition individuelle, parue au
moins dans La Comédie humaine, (2) recueils partiels composé par la décision d’un éditeur (et
non par l’auteur : les éditions des ouvrages composant un cycle, comme Illusions perdues ou
Les Parents pauvres, figurent dans la première catégorie), et (3) recueils qui se définissent
« complètes » sous le titre de « La Comédie humaine » ou d’ « Œuvres complètes », en signalant
pour chacune de ces éditions si elles sont vraiment un recueil complet ou non. Si la
recherche des œuvres individuelles, voire en édition consacrées seulement à un titre
balzacien spécifique, était effectivement plus simple, comme les notices des catalogues des
bibliothèques montrent toujours le titre sous lequel l’ouvrage paraît aujourd’hui mais aussi
son titre primitif (ex : pour La Rabouilleuse on reçoit aussi les résultats qui concernent Un
Ménage de garçon, son titre primitif), l’identification des groupes d’ouvrage s’est révélée plus
difficile. Sous le titre de « La Comédie humaine » et d’ « Œuvres complètes » figurent des recueils
composés de façon arbitraire, pas forcément complets d’ailleurs, qui entretiennent une
confusion substantielle.
Nous avons renoncé à créer un catalogue des illustrateurs, comme, à ce stade, il aurait
été partiel : trop de doutes sur l’attribution de certaines illustrations, signées et non signées
par l’illustrateur et/ou par le graveur, persistent pour établir un annexe utile dans ce sens ;
toutefois, pour les illustrateurs de l’époque romantique, un catalogue sur les illustrateurs et
graveurs de La Comédie humaine de l’édition Furne, accessible en ligne, avait été établi par la
Bibliothèque de la Maison de Balzac.
Pour réaliser les catalogues, nous avons recouru à plusieurs instruments.
Premièrement, nous avons formé la base des listes des éditions illustrées en consultant les
catalogues en ligne des bibliothèques principales de France, parmi lesquelles : la
Bibliothèque nationale, le circuit des Bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris, la
Bibliothèque Sainte-Geneviève, la Bibliothèque de l’Institut de France, la Bibliothèque
Mazarin, la Bibliothèque municipale de Tours, et le Catalogue National de France. Puis,
nous avons complété ce travail en comparant nos données avec des catalogues plus
anciens, qui présentent une liste de livres romantiques, comme celle établie par Charles
Asselineau374, ou encore celle de Jules Brivois375, de Champfleury376, de Georges Vicaire377.
Parallèlement, nous avons fait la vérification sur champ de chaque édition trouvée ; là où il
a été possible, nous avons spécifié le type d’illustration contenue dans le livre – couverture,
frontispice, portrait de l’auteur façon frontispices, vignette-titre, vignette(s), hors-texte(s) –,
de même que le nom de l’illustrateur(s) et du graveur(s).
374 C. Asselineau, Bibliographie romantique. Catalogue anecdotique des éditions originales des œuvres de Victor Hugo, Alfred de Vigny, Prosper Mérimée, etc., Paris, Rouquette, seconde édition, 1874 [1872]. 375 J.-J.-B.-L. Brivois, Guide de l'amateur. Bibliographie des ouvrages illustrés du XIXe siècle, principalement des livres à gravures sur bois, Paris, L. Conquet, 1883. 376 Champfleury, Les "Vignettes" romantiques. Histoire de la "Littérature" et de l'Art 1825-1840, Paris, Dentu, 1883. 377 G. Vicaire, Manuel de l’amateur de livres du XIXᵉ siècle, [1. A-B], Brueil-en-Vexin, Éditions du Vexin français, 1974 [1894].
Bien évidemment, toute signalisation d’éditions illustrées qui ne figuraient pas dans
ces catalogues sera très utile pour compléter le plus possible notre travail.
Sommaire
Annexe 1 : Catalogue des Œuvres de jeunesse illustrées 9
Annexe 2 : Catalogue des Œuvres illustrées imprimées par Balzac 15
Annexe 3 : Catalogue des Œuvres illustrées de Balzac
publiées entre 1820 et 1850 (Balzac vivant) 17
Annexe 4 : Table des illustrations de La Peau de chagrin,
Delloye et Lecou éd., 1838 19
Annexe 5 : Table des illustrations de l’Histoire de Napoléon, Dubochet et Hetzel,
1842 25
Annexe 6 : Table des illustrations de la Physiologie du rentier, Martinon,
1841 31
Annexe 7 : Table des illustrations de la Physiologie de l’employé, Aubert et Lavigne,
1841 41
Annexe 8 : Table des illustrations des articles de Balzac
pour la littérature panoramique 59
Annexe 9 : Table des illustrations de La Comédie humaine
de l’édition Furne, 1842-1848, 17 vol. in-8 117
Annexe 10 : Catalogue des éditions illustrées des œuvres composant
les Études sociales 209
Annexe 11 : Catalogue des éditions illustrées des œuvres composant
les Études philosophiques 227
Annexe 12 : Catalogue des éditions illustrées des œuvres composant
les Études analytiques 231
Annexe 13 : Catalogue des éditions illustrées
des textes hors La Comédie humaine 237
Annexe 14 : Catalogues des éditions illustrées
des recueils de textes balzaciens 281
Annexe 15 : Catalogue des éditions illustrées
des « Œuvres complètes illustrées » et de « La Comédie humaine » 303
Annexe 16 : Catalogue des groupes d’œuvres qui
ne recueillent pas la totalité de la producton balzacienne 283
9
Annexe 1 : Catalogue des Œuvres de jeunesse illustrées
Recueils
Titre de la recueil
Ouvrages qui
composent la recueil
Édition Date Type d’illustration
(couv. Ill, front,
vignette, hors-t)
Artiste(s) Note(s)
Les Romans illustrés anciens et modernes
L'héritière de Birague, Jean-Louis, La dernière fée, Le vicaire des Ardennes, l'Israëlite, Argow le pirate, Jane la Pale, L'excommunié, Le centenaire, Dom Gigadas
Paris, H. Havard
1851 Illustrations
Tony Johannot Henri-Charles-Antoine Baron Bertall Jean Adolphe Beaucé Gaspar Stall Adrien Lavieille
Premiers romans : 1822-1825
L'héritière de Birague, Jean Louis, ou La fille trouvée, Clotilde de Lusignan, ou Le beau juif, Le centenaire, ou Les deux Béringheld, La dernière fée, ou La nouvelle lampe merveilleuse, Le vicaire des Ardennes, Annette et le criminel, Wann-Chlore
Paris, R. Laffont ; coll. Bouquins
1999 Couv ill en coul
2 vol.
10
Premiers essais (1818-1823)
Titre de l’œuvre
Édition Date Type d’illustration
(couv. Ill, front,
vignette, hors-t)
Artiste(s) Note(s)
Falthurne : manuscrit de l'abbé Savonati, traduit de l'italien par M. Matricante, instituteur primaire
Saint-Martin de Bonfossé, Théolib ; coll. Liber
2016 Couv ill en coul
1 pl. h-t, à caractère historique (sur le tribunal secrète)
Sténie ou les erreurs philosophiques
Paris, G. Courville
1936 Illustration
Cromwell: tragédie en 5 actes et en vers
Paris, A la cité des livres
1925 Portr. In-4°
Le nègre Paris, l’Harmattan
2011 Couv ill en coul
Codes
Titre de l’œuvre
Édition Date Type d’illustration
(couv. Ill, front,
vignette, hors-t)
Artiste(s) Note(s)
Code des gens honnêtes ou L'art de ne pas être dupe des fripons
Paris, Société nouvelle d’édition
1944 Couv ill Ill en coul
Joseph Hémard (1880-1961)
Code des gens honnêtes : ou L'art de ne pas être dupe des fripons
Paris, Aux éditions du trait
1948 Ill hors-texte Jean Cocteau
Code des gens honnêtes ou L'art de ne pas être dupe
Levallois-Perret, Manya
1990 Couv ill
11
des fripons
Code des gens honnêtes ou L'art de ne pas être dupe des fripons
Paris, Nautilus 2001 Couv ill en coul Ill
Code des gens honnêtes ou L'art de ne pas être dupe des fripons
Coeuvres-et-Valsery (Aisne), Ressouvenances
2008 Couv ill
Album historique et anecdotique
Paris, Librairie ancienne et moderne
1827 Vignette de titre
Histoire de France pittoresque
Titre de l’œuvre
Édition Date Type d’illustration
(couv. Ill, front,
vignette, hors-t)
Artiste(s) Note(s)
L’excommunié Paris, Charlot
1947 Couv ill
Littérature et fantaisie
Titre de l’œuvre
Édition Date Type d’illustration
(couv. Ill, front,
vignette, hors-t)
Artiste(s) Note(s)
La Comédie du diable ; suivi de La procession du diable
Saint-Épain, Lume
2005 Couv ill Ill
Voyage de Paris à Java
(S. l.,) L'Amitié par le livre
1947 Ill René Mels In-16
12
Romans de jeunesse
Titre du roman
Édition Date Type d’illustration
Artiste(s) Note(s)
Annette et le criminel
Paris, Garnier Flammarion
1982 Couv ill en coul
(Annette et le criminel) Argow le pirate
Neuilly, Robeyr
1947 Ill Thalouarn In-16
(Le Centenaire ou les Deux Beringheld ) Le Sorcier
Paris, Pressédition
1948 Illustrations hors-texte
Honoré Daumier
3 vol. in-16
Le Centenaire ou les Deux Beringheld
Verviers, Gérard et Cie ; Paris, l'Inter
1969 Couv ill en coul
In-16
La Dernière fée ou la nouvelle lampe merveilleuse
Paris, Pressédition
1948 Front Vignettes
Gavarni (croquis de Balzac dans les deux front) Honoré Daumier (vignettes)
2 vol.
L’Héritière de Birague
S.l, Les Bons Romans
1867 Illustrations Clément Auguste Andrieux
Paru en feuilleton dans les
tomes 15 & 16. Vol. 9 &
10 de la collection (fasc.762-
784)
Le Vicaire des Ardennes
S.l., Les Bons Romans
1866 Illustrations Lampsonius Paru en feuilleton dans les
tomes 14 et 15, vol. 9 de la collection
Wann-Chlore Paris, Mémoire du Livre
1999 Couv ill en coul
Bernard Quentin
Cuise-la-Motte,
2009 Couv ill en coul
15
Annexe 2 : Catalogue des œuvres illustrées imprimées par Balzac
La Bibliographie de France registre le 12 aout 1826 que : « M. Balzac (Honoré) a obtenu,
le1er juin 1826, un brevet d’imprimeur à la résidence de Paris, en remplacement de M.
Laurens aîné, démissionnaire » (p.704, Journal de l’imprimerie et de la librairie).
29 juillet 1826 : (4901) : Œuvres complètes de La Fontaine. VIIe et VIIIe livraisons. Un seul
cahier in-8° de 34 demi-feuilles avec vignettes. Imp. de Balzac à Paris. – A Paris, chez H.
Balzac, rue des Marais, Faubourg Saint-Germain, n. 17 ; chez Sautelet. Prix de chaque
livraison 2-50. L’ouvrage complet en un seul volume in-8° 20-0.
25 octobre 1826 : (6574) Le Trobadour français, contenant romances, chansons de table et
rondes tirées des meilleurs chansonniers. In-18 de 6 feuilles 4/9, plus une planche. Imp. De
Balzac, à Paris. – A Paris, chez Caillot, rue Saint-André-des-Arts, n. 57.
06 décembre 1826 : (7552) Aventures de Robinson-Crusoë, par Daniel de Foé, traduction de
Themiseul de Saint-Hyacinthe. Editionne mignonne. Tome 1er(Première partie). In-32 de 3
feuilles, plus une planche. Impr. de Plassan, à Paris – A Paris, chez Lugan, passage du
Caire. Prix. 0-75. Edition prévue en deux volumes, de deux livraisons chacun. Couverture
pour les quatre livraisons imprimées chez M. Balzac, sur papier couleur (adresse : au Palais-
Royal, n. 263-264).
7 juillet 1827 : (4431) L’Art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées, enseigné et
démontré en 16 leçons, etc. Par le baron Emile d’Empesé. Première édition. In-18 de 3 feuilles
4/9, plus 5 planches. Imp. De Balzac, à Paris.
25 juillet 1827 : (4814) L’Art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées, enseigné et
démontré en 16 leçons, etc. Par le baron Emile d’Empesé. Deuxième édition. In-18 de 3
feuilles 4/9, plus 5 planches. Deuxième et Troisième édition. Imp. De Balzac, à Paris.
11 août 1827 : (5189) L’Art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées, enseigné et
démontré en 16 leçons, etc. Par le baron Emile d’Empesé. IVᵉ édition. In-18 de 3 feuilles 4/9,
plus 5 planches. Imp. De Balzac, à Paris.
11 août 1827 : L’Art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers, sans débourser un sou ; enseigné en
dix leçons. Ou Manuel du droit commercial à l’usage de gens ruinés, des solliciteurs, des surnuméraires, des
employés réformés et de tous les consommateurs sans argent. Par feu mon oncle, professeur émérite, précédé
d’une notice bibliographique sur l’auteur et orné de son portrait. Le tout publié par son neveu, Auteur de
l’Art de mettre sa cravatte. In-12. Impr. De Balzac, à Paris.
1er septembre 1827 : (5529) La Chasse au tir. Poème en cinq chants, dédié aux chasseurs. In-8° de 8
feuilles ¼, plus un frontispice gravé et des planches. Imprim. de Balzac, à Paris.
12 septembre 1827 : (5823) L’Art de ne jamais déjeuner chez soi et de diner toujours chez les autres,
enseigné en huit leçons, indiquant les diverses recettes pour se faire inviter tous les jours, toute l’année, toute
la vie. Par feu M. le chevalier de Mangenville, précédé d’une simple notice sur l’auteur et orné de
son portrait. In-8° de 3 feuilles 8/9. Imprim. De Balzac, à Paris.
16
26 septembre 1827 : (6060) Les Remèdes de bonnes femmes, ou Moyen de prévenir, soigner et guérir
toutes les maladies, rédigés et mis en ordre alphabétique d’après le manuscrit original de Mme Michel, ex-
garde malade. In-32 d’une feuille 5/8, plus une planche. Imprim. De Balzac à Paris.
14 novembre 1827 : Théâtre de l’Enfance, par Madame de Lafaye-Bréhier, auteur des Petits Béarnais,
du Robinson français, etc. Orné de gravures. 3 Volumes. In-12. Impr. De Balzac, à Paris.
21 novembre 1827 : Éléments de géometrie descriptive, à l’usage des élèves qui se destinent à l’Ecole
polytechnique, à l’Ecole militaire, à l’Ecole de la marine. Par E. Duchesne, professeur de mathématiques
spéciales au collège de Vendôme. Avec cahier de planches. In-12, Impr. de Balzac, à Paris.
2 février 1828 : L’Art de donner à dîner, de découper les viandes, de servir les mets, de déguster les vins,
de choisir les liqueurs, etc. etc. ; enseigné en douze leçons, avec des planches explicatives du texte ; par un
ancien maître d’hôtel du président de la Diète de Hongrie, ex-chef d’office de la princesse Charlotte, etc. etc.
In-18, Impr. de Balzac, à Paris.
16 février 1828 : Henriette Sontag, histoire contemporaine, traduite de l’allemand, ornée d’un portrait. 2
volumes. In-12. Impr. de Balzac, à Paris.
29 avril 1828 : Œuvres complètes de Molière, ornées de trente vignettes dessinées par Devéria et gravées
par Thompson. In-8°. Impr. de Balzac, à Paris. Déclaration non suivie de dépôt.
7 mai 1828 : Atlas d’anatomie pathologique pour servir à l’histoire des maladies des enfants, par Charles
Michel Billard. In-4° de dix planches, avec le texte explicatif. Impr. de Balzac, à Paris.
14 juin 1828 : Specimen des divers caractères, vignettes et ornements typographiques de la fonderie de
Laurent et de Berny, rue des Marais Saint-Germain, n°17. In-f° oblong. Impr. de Balzac, à Paris.
17
Annexe 3 : Œuvres illustrées de Balzac publiées entre 1820-1850 (Balzac
vivant)
Titre Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
Le Vicaire des Ardennes 4 vol. in-12
Paris, Pollet
1822 Front.
Annette et le criminel 4 vol. in-12
Paris, Buisson
1824 Choquet Front.
La Peau de chagrin 2 vol. in-8°
Paris, Gosselin et Canel
1831 Tony Johannot
Porret Deux vignettes
façon frontispice,
un pour chaque volume.
Romans et contes philosophiques 3 vol. in-8° 2éme édition
Paris, Gosselin
1831 Tony Johannot
Porret Trois vignettes
façon frontispices,
un pour chaque volume
Nouveaux contes philosophiques In-8°
Paris, Charles Gosselin
1832 Tony Johannot
Porret Vignette
Romans et contes philosophiques 3 vol. in-8° 3éme édition
Paris, Charles Gosselin
1832 Tony Johannot
Porret Trois vignettes
façon frontispices,
un pour chaque volume
Le Médecin de campagne 2 vol. in-8°
Paris, Werdet
1836 Henri Monnier (attribué à)
Vignette de l’édition Mame-
Delaunay en deuxième
page
La Femme supérieure, La Maison Nucingen, La Torpille 2 vol in-8°
Paris, Werdet
1838 Daumier Vignette en centre page-titre, qui se répéte dans tous les tris
volumes Vignette de
La vignette de Daumier sera reprise dans
18
Daumier réproduisant la caricature dessinée par Bixiou (dans
le vol.2)
l’édition Furne
La Peau de chagrin
Paris, Delloye et Lecou
1838
La Femme supérieure, La Maison Nucingen, La Torpille 2 vol in-16
Paris, Werdet
1839 Vignette en centre page-titre, qui se répéte dans tous les trois
volumes
Vignette de Daumier absente
Physiologie du rentier de Paris et de province (Balzac et Frémy)
Paris, P. Martinon
1841 Gavarni Henri Monnier Daumier Meissonier
Vignettes
Physiologie de l’employé
Paris, Aubert et Lavigne éditeurs
1841 Trimolet
Histoire de l’Empereur, racontée dans une grange par un vieux soldat
Paris, Dubochet et Hetzel éditeurs
1842 Lorentz Brevière Novion
Vignette Et Planches hors-texte
La Comédie humaine
Paris, Furne, Dubochet, Hetzel
1842-1846
Planches hors-textes
Petites misères de la vie conjugale
Paris, Chedowski
1846 Bertall Vignettes Et Planches hors-textes
Paris mariés Paris, Hetzel
1846 Gavarni Vignettes
19
Annexe 4 : Table des illustrations de La Peau de chagrin, Delloye et
Lecou éd., 1838
Type d’illustration
Sujet de l’image Page du roman
Illustrateur Graveur
Vignette de titre Squelette trascinant un homme dans un fossa
Page de titre - -
Vignette en page de faux titre
La ligne serpentine
Page de faux titre
- -
Le Talisman
Vignette en tête de page
Montage de scènes
p.1 Baron P. Brunellière
Lettrine (« V ») Secours aux asphyxiés
p.1 - -
Portrait L’homme qui marque les passes de la Rouge et de la Noir
p.8 Janet Lange Gaitte
Portrait Le novice au jeu de la roulette
p.10 Gavarni Nargeol
Scène La table des joueurs
p.12 Baron Gaitte
Scène Le jeune inconnu sort du 36 du Palais Royal
p.14 Janet Lange Pourvoyeau
Portrait Un jeune ramoneur demande la carità
p.18 Janet Lange H. Langlois
Portrait L’inconnu assis à côté d’un homme, au milieu d’une salle pleine d’objets
p.22 JL Langlois
Nature morte Table pleine d’objets
p.26 - P. Brunellière
Scène Le pagne d’une jeune fille d’Otahiti
p.27 Français P. Brunellière
Scène Rêve : le Sabbath de Faust
p.33 Baron Carlet
Scène Un jeune homme regarde un squelette
p.34 Sortet aqf
Portrait L’antiquaire p.37 - -
Scène L’antiquaire montre au jeune
p.42 Janet Lange Joubert
20
homme la peau de chagrin accroché au mur
Scène Le jeune homme essai de trancher la peau
p.45 Janet Lange Montaut d’Oloron
Scène Les quatre amis p.54 Janet Lange Monin
Nature morte Navire (Le corsaire rouge) au milieu el mer
p.59 - -
Scène Péristyle p.61 A. Dorlet aqf.
Portrait Le notaire p.64 Janet Lange -
Scène Bacchanale p.68 Baron Moret
Portrait Les hommes illustres du passé
p.70 Marckl Brunellière
Portrait Un médecin ivre p.77 Janet Lange Goalir
Nature morte Le dessert p.81 - -
Portrait Aquilina p.88 Janet Lange Torle aqf
Portrait Euphrasie p.91 - -
Scène Raphaël, Émile, Euphrasie et Aquilina causent entre eux
p.92 Jane Lange Beyer
Scène Deuxième bacchanale
p.98 Baron Beyer
Scène Raphaël et Émile causant, avec les deux femmes endormies à leurs pieds
p.102 Janet Lange Langlois
La Femme sans coeur
Vignette en tête de page
Trois scènes p.103 Baron Brunellière
Lettrine « A » Lecteur p.103 - -
Scène Raphaël vole l’argent de son père
p.108 Janet Lange Beyer
Scène Enterrement du père de Raphaël
p.114 - -
Scène Le commissaire-priseur remit à Raphaël son hérédité
p.115 - -
Portrait La femme des rêves
p.118 Gavarni Nargeon
Scène Raphaël cherche de l’eau à place
p.126 Janet Lange Pigeot
21
St. Michel
Scène Raphaël assis à la fenêtre de sa mansarde
p.128 - Goulu ?
Scène Jeunes filles jouant au volant en rue de Cluny
p.130 Nap. Thomas ? Brunellière
Scène Pauline apprend à jouer le piano
p.138 Janet Lange Cortet
Portrait Foedora p.149 Janet Lange Félicie Fournier née Monsaldy
Nature morte Le lit de Foedora p.151 Baron Corlet
Scène Foedora et son maintien
p.154 Marckl Legris
Portrait Foedora p.160 - -
Scène Le valet de Foedora chasse l’homme qui les avait aidés
p.163 Montaut ?
Portrait Raphaël et son chapeau
p.169 - -
Scène Pauline et sa mère parlent de Raphaël
p.172 - -
Scène Pauline donne une tasse de lait à Raphaël
p.174 Nap. Thomas Brunellière
Scène Au restaurant, Rastignac trouve un travail à Raphaël
p.180 - -
Scène Raphaël dine chez Foedora
p.189 Janet Lange Moubert
Scène Raphaëet Foedora à théâtre
p.194 Janet Lange Langlois
Scène Raphaël demande à Pauline d’aller au Mont-de-Piété
p.200 - -
Scène Un vieil amoureux de Foedora soupir en regardant le lit de la comtesse
p.205 - -
Scène Foedora regarde les rideaux de la fenêtre de sa chambre
p.210 - Langlois
Scène Raphaël regardant
p.213 - -
22
Foedora endormie
Scène Raphaël et Foedora
p.217 - -
Scène Raphaël maudit Foedora
p.223 Janet Lange Joubert
Scène Raphaël et Pauline se disent adieu
p.229 Janet Lange Ferdinand
Scène Raphaël et Rastignac dansent devant un chapeau plein d’or
p.231 Janet Lange Joubert
Scène L’homme de la banque frappe à la porte
p.239 - -
Portrait Le créancier p.241 - -
Scène Raphaël, ivre, crie dans la salle, pendant qu’Émile cherche à le retenir
p.245 H. Baron Adolphe Corlet aqf.
Nature morte Orgie d’objets p.249 Janet Lange -
Portrait Jeune fille pure et innocent
p.252 - -
Portrait Raphaël, ivre, allongé sur un sofa
p.259 - -
L’Agonie
Vignette en tête de page
La mort attrapant Raphaël
p.261 Baron Ferdinand
Lettrine « D » Ange pleure à coté du lit d’un malade/mort
p.261 - -
Portrait Poète classique en quête d’une rime
p.262 Janet Lange Berlier
Portrait Raphaël lisant le journal
p.269 - -
Scène Raphaël crie contre son ancien précepteur
p.274 - -
Portrait L’Antiquaire-dandy
p.279 H A
Scène Le ciel de Michel-Ange et Sanzio d’Urbin
p.280 - -
23
Scène Raphaël à théâtre et sa belle voisine
p.285 - -
Portrait Pauline p.287 Marckl Félicie Fournier née Monsaldy
Scène Raphaël et Pauline se retrouvent dans la vieille mansarde
p.290 - -
Scène Raphaël jette la peau dans un puits
p.299 - -
Scène Raphaël regarde Pauline jouant avec un chat au petit dejeuner
p.301 - -
Portrait Le jardinier amènant quelque chose
p.303 - -
Portrait Monsieur Lavrille p.307 Janet Alphonse Boilly
Portrait L’onagre p.311 - -
Portrait Planchette p.314 - Boilly
Scène Planchette essai d’agir sur la peau, devant à Raphaël et au Spieghalter
p.325 Janet Lange Pourvoyer
Scène Raphaël, avec Pauline sur ses genoux, indique le squelette qui se cache derrière le rideau de son lit
p.331 - -
Scène Pauline effrayée au lit de Raphaël malade ; derrière le lit, un squelette
p.336 - -
Portrait Le docteur Brisset
p.338 - -
Portrait Le docteur Caméristus
p.339 L. -
Portrait Le docteur Maugredie
p.340 - -
Scène Raphaël demande à un valet d’ouvrir la fenêtre
p.349 - -
Scène Consultation avec un médecin
p.356 Baron Corlet
Paysage Le lac p.358 Janet Lange -
24
Scène L’insulte p.363 - -
Scène Une calèche de poste
p.365 - -
Scène Raphaël arrive sur le lieu du duel appuyé sur son serviteur
p.366
Scène Raphaël tue son adversaire, en tirant son coup sans regarder
p.369 - -
Portrait Un vieil pasteur et un enfant
p.376 Janet Lange Goulu
Portrait Une Auvergnate p.377 JL -
Portrait Raphaël au milieu de la nature
p.380 Janet Lange P. Brunellière
Scène Le postillon relaie la voiture
p.387 - -
Scène Raphaël après avoir brulé les lettres de Pauline
p.389 - -
Scène Un monde de femmes dans le salon de Raphaël
p.393 - -
Scène Raphaël brise le châle de Pauline
p.397 H. Baron Corlet
Scène Jonathas cherche devant Pauline embrassant le cadavre de Raphaël
p.398 - H. Langlois
Épilogue
Vignette en tête de page
Homme assis sur un lit
p.399 HBaron Corlet
Lettrine « E » Portrait d’une femme
p.399 - -
Scène Ange survolant une ville
p.400 - -
Scène Ombra blanche survolant un fleuve
p.401 - -
25
Annexe 5 : Table des illustrations de l’Histoire de l’Empereur, Dubochet et Hetzel, 1842.
Vignettes par Lorents, gravures par MM. Brevière et Novion
Type d’illustration Sujet de l’image Page du roman Notes
Vignette de titre Napoléon à cheval Page de titre
Vignette en tête de chapitre
Les objets de Napoléon
p.3
Vignette Paysage bucolique p.3
Vignette « Il est arrivé à Paris en mendiant son pain » [Gondrin]
p.7
Vignette Portrait-scène
« Gouguelat est ici le pieton de poste »
p.10
Vignette Portrait
« Gondrin » p.14
Histoire de l’Empereur
Pl. hors-texte, façon frontispice
La grange pleine du monde
p.22
Vignette L’extérieur de la grange
p.23
Vignette Paysage
« Napoléon est né en Corse, qui est une île française, chauffée par le soleil d’Italie »
p.28
Vignette Scène fantastique
« …les balles et les décharges de mitraille qui nous emportaient comme des mouches… »
p.30
Vignette Portrait
« …l’on te les tapes à Montenotte… »
p.33 Vignette représentant un soldat allemand
Vignette Scène fantastique
« …et les fouaille partout… »
p.34 Napoléon fouaillant les ennemies
Vignette Scène
« Les femmes aussi, qui étaient des femmes très-judicieuses… »
p.35 Des femmes italiennes
Pl. hors-texte « Les sentinelles le voyaient toujours aller et venir »
p.37
Vignette Scène fantastique
« Voilà un pèlerin qui paraît prendre ses mots d’ordre dans le ciel… »
p.38
Pl. hors texte « Il rassemble ses p.39
26
meilleurs lapins »
Pl. hors-texte « Toulon, route d’Égypte »
p.41
Vignette Scène
« Nous prenons Malte comme une orange pour le désalterer de sa soif de victoire… »
p.42
Vignette Scène fantastique
« Le mody, soupçonné d’être descendu du ciel sur un cheval qui était, comme son maître, incombustible au bouet, … »
p.44
Vignette Portrait
« Vous entendez bien qu’on leur a fait faire la grimace tout de même… »
p.45
Vignette Scène fantastique
« Mais nous mangeons le mamelock à l’ordinaire »
p.47
Vignette Scène
« …car ils ne savaient quoi s’inventer pour nous contrarier »
p.48
Vignette Scène fantastique
« Nous revenons au Caire »
p.51
Vignette Nature morte
« La Gourde » p.53
Vignette Scène
« Napoléon met le pied sur une coquille de noix, un petit navire… »
p.53
Vignette Scène
[Napoléon] « …les fait sauter par les fenêtres… »
p.55
Vignette Scènes fantastique
« Il y avait des ennemies à balayer »
p.56
Vignette Scène
« L’Empereur a inventé la Legion d’honneur »
p.57
Pl. hors-texte « On t’ira pêcher des royaumes à la baïonette »
p.61
Pl. hors-texte « et s’il avait eu dans sa boule de
p.63
27
conquérir la lune, il aurait fallu s’arranger pour ça, faire ses sacs et grimper »
Vignette Scène
« Ça sera un royaume ! »
p.65
Pl. hors-texte « Un caporal de la garde était comme une curosité »
p.66
Vignette Scène
« je l’ai vu, les pieds dans la mitraille, pas plus gêné que vous êtes là… »
p.68
Vignette Scène fantastique
« …les mourants avaient la chose de se relever pour le saluer et lui crier :
ʺVive
l’Empereur !ʺ »
p.69
Vignette Portrait
« roi de Rome » p.71
Vignette Nature morte
« et ce ballon a fait le chemin d’un jour »
p.72
Pl. hors-texte « des animaux de cosaques qui s’envolent »
p.74
Vignette Scène
« Et voilà fectivement tous les rois qui viennent lécher la main de Napoléon ! »
p.75
Vignette Scène
« Nous étions devant le grand ravin »
p.77 Texte à p.76
Vignette Scène
[l’Empereur] « passe au galop en nous faisant signe qu’il s’importait beuacoup de prendre la redoute »
p.78 Texte à p.87
Vignette Scène
« Le froid nous pince »
p.80
Vignette Scène
« C’est là que l’armée a été sauvée par les pontonniers, qui se sont trouvés solides au poste… »
p.82
Pl. hors-texte « Les plus courageux gardaient les aigles, parce que les aigles,
p.84 Texte à p.83
28
voyez-vous, c’était la France »
Vignette Portrait
« Les maréchaux se disent des sottises, font des bêtises, et c’était naturel : Napoléon, qui était un bon homme, les avait nourris d’or, ils devenaient gras à lard qu’ils ne voulaient plus marcher. »
p.86 Texte à p.85
Vignette Portrait
Mais l’Empereur nous revient avec des conscrits et de fameux conscrits »
p.87 Texte à p. 85-86
Pl. hors-texte « Dans ce temps-là un bon grénadier ne duré plus de six mois »
p.88
Vignette Portrait-Scène
« Mais les Parisiens ont peur pour leur peau de deux liards et pour leurs boutiques de deux sous »
p.91 Texte à p.90
Vignette Portrait
« le drapeau blanc qui se met aux fenêtres »
p.92 Texte à p.91
Vignette Scène
« Pendant qu’il faisait sa faction, les Chinois et les animaux de la côte d’Afrique, Barbaresques et autres qui ne sont pas commodes du tout… »
p.94 Texte à p.93 Napoléon est en exile à l’île d’Elba
Vignette Scène
« le sacré coucou s’envole de clocher en clocher »
p.95
Vignette Nature morte
« Plus d’aigles ! » p.97
Vignette Portrait
« L’on s’empare de napoléon par trahison, les Anglais le clouent dans une île déserte de la
p.98
29
grande mer, sur un rocher élevé de dix mille pieds au-dessus du monde. »
Vignette Scène
« Fischtre, et la cavalerie, donc ! »
p.100
Vignette Portrait
« Là-dessus, nous partions d’abord au trot, puis au galop, une, deux ! »
p.102 Texte à p.101
Vignette Nature morte
« Il est mort » p.104 Texte à p.102
31
Annexe 6 : Table des illustrations de la Physiologie du rentier de Paris et de province, Martinon, 1841. Par MM. De Balzac et Arnould Frémy.
Dessins par Gavarni, Henri Monnier, Daumier et Meissonier
Type d’Illustration
Sujet Page Illustrateur Graveur Note(s)
Vignette de titre
Buste de tête Page du titre
Daumier (selon indication de la Maison de Balzac)
Vignette en tête de chapitre
Trois hommes ¾
p.5 -
Vignette à côté du texte
Un homme et une vieille femme
p.5 -
Vignette Silhouette d’un homme
p.6 H.D
Vignette Un homme avec chapeau à cylindre et bâton
p.9 H. D F.G
Vignette Un chercheur au milieu de ses alambyques
p.11 -
Vignette Le rentier en veste de garde national
p.16 -
Vignette Le rentier p.17 -
Le rentier, « intrépidement planté comme sont ses pareils sur leurs jambes, le nez en air »
p.19 ME BH
Vignette Un homme assis lisant un journal
p.21 F
Vignette Deux hommes assis causent
p.22 HD
Vignette Le rentier aime le repos : profession de receveur de rentes
p.26 F.G.
Vignette Ripresentata vignette de titre
p.28 [HD]
Vignette Le rentier sur p.32 -
32
son escalier Sembra sherlock holmes
Vignette Homme en chapeau teint dans le main un tableau, pendant que son chien fait pipi sur l’un de tableaux disposés contre me mur
p.33 -
Vignette Le rentier comme une coquille à son mobilier
p.36 -
Vignette Un homme en chemise se coiffant
p.39 HD FA
Vignette Un homme avec mains croisées
p.40 -
Vignette Rentier sur chaise dans un jardin
p.44 G Gagniet
Vignette La femme du rentier
p.49 -
Vignette Rentir qui pêche p.52 [HD] - Vignette rentier p.53 - Vignette La femme u
rentier et son chat
p.56 J/F G
Vignette en tête de chapitre
Le rentier Célibataire
p.58 -
Vignette Prudhomme salué par un passant
p.60 -
Vignette Le Dameret p.62 HD Vignette en tête de chapitre
Le Chapolardé p.63 [HD]
Vignette Les chasseurs d’actionnaires
p.65 -
Vignette en tête de chapitre
Promeneurs p.66 -
Vignette Un homme et un enfant
p.67 HD
Vignette en tête de chapitre
Le Taciturne p.69 -
Vignette en tête Le Militaire p.72 -
33
de chapitre Vignette en tête de chapitre
Le Collectionneur
p.77 ME
Vignette en tête de chapitre
Le Philanthrope p.80 -
Vignette Un homme regarde un chien
p.82 HD F.G
Vignette en tête de chapitre
Le Pensionné p.83 Gavarin [sic] Lavieille
Vignette en tête de chapitre
Le Campagnard p.84 M ? FG
Vignette en tête de chapitre
L’Escompteur p.87 JG
Vignette en tête de chapitre
Cette variété ne rit jamais et ne se montre point sans parapluie
p.89 G
Vignette en tête de chapitre
Le Dameret p.90 HD
Vignette Le rentier proprement dit
p.92 HD
Vignette en tête de chapitre
Le Rentier de faubourg
p.93 HD Loiseau
Vignette fin de chapitre
Homme avec feu d’artifice ?
p.96 -
Le rentier de province (Frémy)
Vignette en tête de chapitre
L’Habitant de Versailles
p.99 G
Vignette Rentier et femme se promenant
p.107 [HD] F.G
35
Annexe 7 : Table des illustrations de la Physiologie de l’employé,
Aubert et Lavigne, 1841.
Vignettes par M. Trimolet
Type d’Illustration
Sujet Page Graveur Note(s)
Vignette en couverture
Un homme feuilletant un gros livre
Couverture A. Baulant On retrouve la même vignette à p.7
Vignette de titre (Exemplaire R16Cc°177, Maison de Balzac)
Homme écrivant, assis à son bureau
Page de titre - On trouve la même vignette à p.8
Vignette de titre (Exemplaire R16Cc°177bis, Maison de Balzac)
Page de titre -
Vignette en tête de chapitre
Un homme assis, avec une plume dans la main, étudie des statuettes
p.5 Pred’homme
Vignette Un homme feuilletant un gros livre
p.7 -
Vignette Homme écrivant, assis à son bureau
p.8 -
Un homme (un directeur général peut-être) lit un document, assis à son bureau. Une carte géographique derrière lui.
p.10 A. Rose Phrase qui précéde la vignette : « Peut-être est-ce que dans ce sens que plus d’un député se dit : - C’est un bel état que d’être directeur général ! »
Vignette en tête de chapitre
Quatre hommes dans un bureau. L’employé à gauche écrit à la console, alors
p.12 - Chapitre dédie à l’utilité des employés
36
que les deux à droit se consultent debout. Le quatrième est en train de manger, au milieu de la salle ; à ses pieds, quatre souris attendent les miettes qui tombent à terre
Vignette Cinq hommes qui « paperassent »
p.14 Pred’homme
Vignette Deux employés se consultent sur des papiers
p.16 Pauquinon
Vignette Homme qui dort sur un canapé devant une table
p.17 Pred’homme
Vignette en tête de chapitre
Dans une chambre à coucher, un homme fait jouer un enfant pendant qu’une femme le regarde du lit
p.20 T
Vignette La masse de solliciteurs
p.23 T
Vignette Homme assis à table jouant une flute ; calembour graphique au côté gauche de sa tête
p.28 -
Vignette Un homme assis lit le Magasin pittoresque
p.29 T.
Vignette en fin de chapitre
Quatre hommes sortent d’un édifice, salués par le concierge
p.30 A. Baulant
Vignette en tête de chapitre
Un homme et une femme dns
p..31 Trimolet
37
un jardin regardent la ville au de là du fleuve
Vignette Un homme assis à table avec un verre dans la main droite
p.33 -
Vignette en fin de chapitre
Nature morte de bouteilles
p.34 -
Vignette en tête de chapitre
Un homme recueillit de raisin dans un vignoble
p.35 -
Vignette Un employé assis à son tiroir baille
p.37 T.
Vignette Un employé quitte promptement son bureau, lunettes et parapluie à la main, chapeau en tête
p.38 Baron
Vignette Un homme lit avec sa lorgnette le nom du bureau : « Cabinet noir »
p.40 Baron
Vignette Un directeur général montant des escaliers
p.42 Halley Hiback
Vignette Le grçon de bureau
p.44 Pred’homme
Vignette Un homme mange un crouton de pain et un œuf
p.45 -
Vignette Le colossal bureau du quai des Orfévres
p.47 Pauquinon
Vignette Le mobilier administratif
p.49 Pred’homme
Vignette en tête de chapitre
Six hommmes parlent entre eux
p.50 Halley Hiback Dans ce chapitre, Balzac analyse six
38
« météores » de la Bureaucratie : le Bibliothécaire, le Secrétaire particulier, le Caissier, l’Architecte, le Missionnaire
Vignette Un homme assis dans un fauteuil joue avec un petit chien pendnt qu’un autre homme de l’autre côté de la table conte des monnaies
p.52 Baron
Vignette L’architecte p.55 T
Vignette Le missionnaire p.57 -
Vignette Le caissier et un couple ministériel
p.60 Bols
Vignette Le caissier p.61 Bols
Vignette Le ministre et son secrétaire particulier
p.63 -
Vignette Trois hommes travaillent dans un bureau
p.66 - Chapitre dédié au « surnuméraire »
Vignette Le surnuméraire p.69 - Le texte annonce explicitement la vignette : « Quand, par des causes bizarres, vous êtes à Paris à sept heures et demie ou huit heures du matin, que vous voyez, par un froid piquant, par une pluie, par un mauvais temps quelconque, poindre un
39
craintif et pâle jeune homme, sans cigare, comme celui-ci : [vignette] Dites : - C’est un surnuméraire ! »
Vignette en tête de chapitre
Foule d’hommes
p.72 ARose
Vignette Homme qui lit p.73 Baulant
Vignette en tête de chapitre
Sept hommes ans un bureau
p.74 T Chapitre dédié à la variété de commis
Vignette L’employé bel-homme
p.77 -
Vignette L’employé ganache
p.79 -
Vignette Le ganache s’essuyant le visage
p.82 Vignette de titre de l’exemplaire « bis » de la Maison de Balzac
Vignette Le collectinneur jouant la flute
p.85 Predhomme Dans le texte le collectinneur joue la flûte traversière, dans l’image la flûte
Vignette L’employé vaudevilliste
p.88 Pred’homme
Vignette L’employé usurier
p.93 P. Anns
Vignette L’employé commmerçant
p.95 Petit
Vignette Le piocheur menace de quitter la baraque
p.97 -
Vignette Le pauvre employé dans son ménage familial
p.98 Fauchery
Cul-de-lampe Couronne de laurier
p.99 -
Vignette en tête de chapitre
Quatre hommes dans un bureau
p.100 Trimolet
Vignette Un train p.103 - Le texte compare les variétés
40
d’employés aux rouages d’une machine : « Maintenant voici ls moteurs ! »
Vignette en tête de chapitre
Le cef de bureau, assis à son tiroir, mâchouille sa plume
p.104 T
Vignette en tête de chapitre
Le chef de division, interpellé par un homme
p.108 Petit
Vignette en tête de chapitre
Le garçon de bureau
p.113 Baulant
Vignette en tête de chapitre
Le retraité pêchant
p.118 Fitu
Vignette Scène entre un couple dans la chambre à coucher
p.122 Fitu
Vignette À théâtre p.123 Fitu
Vignette Des soufflets mettent en fuite les employés et leurs livres
p.125 F
41
Annexe 8 : Table des illustrations des articles de Balzac pour la
littérature panoramique
Les Français peints par eux-mêmes, Paris, Curmer, 1840-1842.
Article de
Balzac
Type
d’illustration
Sujet Page Illustrateur Graveur Note(s)
L’Épicier Vignette en
tête de page
La boutique
de l’épicier
Gavarni Lavieille
Lettrine Lettre D
sous le bras
d’un épicier
Gavarni Lavieille
Planche hors-
texte
L’Épicier Gavarni Lavieille
Vignette en
cul-de-lampe
L’épicier et
sa femme
dans un
paysage
naturel
Gavarni Lavieille
La Femme
comme il
faut
Vignette en
tête de page
Promeneurs Gavarni Lavieille
Lettrine Lettre D
soutenue
par une
femme
Gavarni Verdeil
Planche hors-
texte
La Femme
comme il
faut
Gavarni Lavieille
Vignette en
cul-de-lampe
Deux
jeunes font
la révérence
à une dame,
vue
Gavarni Lavieille
42
d’épaules
Le Notaire Vignette en
tête de page
Un salon
plein de
gens autour
d’une table
Gagniet Birouste
Lettrine Un homme
avec
chapeau à
cylindre et
des livres
dans la
main
gauche, et la
lettre V
dans la
main droite
Gagniet Birouste
Planche hors-
texte
Le Notaire Gavarni Stipulkowski
Monographie
du Rentier
Planche hors-
texte, façon
frontispice
Le Rentier
et sa femme
Grandville Verdeil
Vignette en
tête de page
Squelettes
géants
d’animaux
dans la
galerie d’un
musée
Grandville Gérard
Lettrine Huitre
contenant la
tête d’un
rentier
Grandville Verdeil
Vignette Les savants Grandville Gérard
43
étudiant le
renier
Planche hors-
texte
Le Rentier Grandville Verdeil
Vignette Groupe de
rentiers
Grandville Loiseau
jeune
La Femme
de province
T. I Province
Planche hors-
texte façon
frontispice
La Femme
de province
NP Gavarni Lavieille
Vignette en
tête de page
Une jeune
fille et une
autre
femme
jouent à
cartes avec
deux
hommes
1 Gavarni Lavieille
Vignette
façon lettrine
sans lettre
Nature
morte
1 Gavarni Lavieille
44
Scènes de la vie privée et publique des animaux, Paris, Hetzel, 1841-
1842. Illustrées par Grandville
Article de
Balzac
Type
d’illustration
Sujet Page Graveur Note(s)
T.I
Peines de
cœur d’une
chatte
anglaise
Lettrine « Q » Une chatte
amenée devant
une porte par
deux souris
p.89 - Dans la
page la
chatte
anglaise
conte que
plusieurs
fois deux
amis souris
l’avaient
amenée
chez
Colburn
pour faire
écrire le
roman de
sa vie
Planche hors-
texte
« En apercevant
la preuve de ce
qu’elle nomma
mon
intempérance… »
NP (côté
droite de
page 92)
J. Caque
Planche hors-
texte
« Un soir, ma
maîtresse pria
l’une des jeunes
miss de chanter »
NP (côté
droite de
page 94)
Andrew W.
Best Leloir
Une
chienne
joue le
piano dans
un salon.
La planche
45
n’a aucun
rapport
avec la page
à côté
d’elle, elle
anticipe la
narration
Planche hors-
texte
« Ses manières
étaient celles d’un
chat qui a vu la
cour et le beau
monde »
NP (côté
droite de
page 98)
Brevière
Planche hors-
texte
« A la vue de ce
mécanisme, que
le docteur fit
jouer avec
satisfaction, Leurs
Grâces
rougirent »
NP ((côté
droite de
page 104)
Andrew
Best Leloir
Le docteur
est une
cigogne
Planche hors-
texte
« Mon silence
l’enhardit, et il
s’écria : Chère
Minette ! »
NP (côté
droite de
page 106)
Andrew
Best Leloir
Planche hors-
texte
« Milords, dis-je,
je suis une chatte
anglaise, et je suis
innocente »
NP (côté
droite de
page 110)
Brevière
Cul-de-lampe Autopsie de
Brisquet, avec le
docteur qui
montre l’assiette
incriminée
contenant du
112 Bv
46
poison
Guide-Ane à
l’usage des
animaux qui
veulent
parvenir aux
honneurs
Lettrine « M » Un oiseau écolier,
avec le chapeau à
oreille d’âne
p.183 ABL
Planche hors-
texte
« Mes
Bourriquets
braillaient
couramment
quand les siens
ânonnaient
encore »
NP (côté
droite de
page 184)
Caqué
Planche hors-
texte
« Vous allez être
un grand savant,
et moi je vais
l’annoncer au
monde »
NP (côté
droite de
page 188)
Tamisier
Planche hors-
texte
« Les savants
envoyèrent un
académicien armé
de ses ouvrages »
NP (côté
droite de
page 191)
Caqué
Planche hors-
texte
« Faire ce métier
d’oison qui
consiste à mener
les élèves aux
champs »
NP (côté
droite de
page 194)
Brevière
Planche hors-
texte
« Le grand
philosophe
tomba dans une
tristesse
NP (côté
droite de
page 201)
Brevière
47
profonde »
Planche hors-
texte
« Les femmes
s’extasièrent.
Quelle
éloquence ! On
n’entendait de si
belles choses
qu’en France… »
NP (côté
droite de
page 203)
Porret
Planche hors-
texte
« Mon maître,
obstinément
appelé l’illustre
Marmus »
NP (côté
droite de
page 206)
Porret
Cul-de-lampe Galerie d’un
musée, où les
animaux
anthropomorphes
regardent un
zèbre empaillé
p.208 Brevière
Voyage d’un
Moineau de
Paris à la
recherche du
meilleur
gouvernement
(signé :
George Sand)
Lettrine Deux moineaux
sur une statue
grecque
p.227 B
Planche hors-
texte
« Je partis en
qualité de
Procureur-
Général des
Moineaux de
Paris »
NP (côté
droite de
page 232)
J. Caqué
48
Planche hors-
texte
« Le premier
spectacle qui me
frappa fut celui
de l’activité
merveilleuse de
ce peuple »
NP (côté
gauche de
page 235)
Porret Dans la
Table de
matière du
livre, cette
planche et
celle
suivante
sont
inverties de
position
Planche hors-
texte
« Dès que je mis
le pied dans l’île,
je fus assaillis
d’animaux
étrangers au
service de l’état »
NP (côté
droite de
page 236)
Porret
Planche hors-
texte
« Il n’avait que
ses belles
couleurs pour
toute fortune, et
comptait vivre
dans le luxe,
l’abondance et les
honneurs »
NP (côté
droite de
page 240)
Andrew,
Best et
Léloir
Planche hors-
texte
« Après venaient
les gardes-du-
corps armées
d’aguillons
terribles »
NP (côté
droite de
page 244)
Andrew,
Best et
Léloir
Planche hors-
texte
« J’aperçus un
Loup en
sentinelle »
NP (côté
droite de
page 250)
Andrew,
Best et
Léloir
Planche hors- « Tous les loups NP (côté Godard
49
texte sont frères » gauche de
page 255)
Planche hors-
texte
« Maintenant je
comprends la
Louve mère de
Rome »
NP (côté
droite de
page 258)
Brevière
Cul-de-lampe Les Animaux
fetegent à la
fraternité et à
l’égalité
p.260 -
Voyage d’un
lion
d’Afrique à
Paris
Lettrine « A » Un lion-pèlerin p.361 Tamisier
Planche hors-
texte
« Les jeunes
Lionceaux
reçurent sa
bénédiction »
NP (côté
droite de
page 363)
Brevière
Planche hors-
texte
« Aussi ne vous
étonnerez-vous
pas en apprenant
qu’il appartient à
une
administration
célèbre située rue
de Jérusalem »
NP (côté
droite de
page 372)
Guibaut
Planche hors-
texte
« Un café » NP (côté
droite de
page 374)
Godard
Planche hors-
texte
« Un Lion de
Paris »
NP (côté
droite de
page 375)
Andrew,
Best et
Leloir
50
Planche hors-
texte
« Une Lionne » NP (côté
droite de
page 378)
Andrew,
Best et
Leloir
Planche hors-
texte
« Le Carnaval est
la seule
supériorité que
l’Homme ait sur
les Animaux »
NP (côté
droite de
page 380)
Godard
Planche hors-
texte
« Car il éclat alors
tant de passions
animales dans
l’Homme, qu’on
ne saurait douter
de nos
affinités »
NP (côté
droite de
page 380)
Porret
Lettrine Le Lion prince
oriental
T.II
Les Amours
de deux Bêtes
Frontispice « Le professeur
Granarius »
NP (côté
droite de
page 241)
Rouget
Lettrine Un chien assis
aux pieds d’un
arbre
p.241 -
Planche hors-
texte
« Elle resta clouée
à la pierre où elle
s’était assise »
NP (côté
gauche de
page 243)
Brugnot
Planche hors-
texte
« Arrière,
Bayadères
impures !... »
NP (côté
droite de
page 248)
Brevière et
Novion
Planche hors-
texte
« Le volvoce,
comme le choléra
NP (côté
gauche de
Brevière
51
en 1833, passait
en se nourrissant
de monde »
page 251)
Planche hors-
texte
« Le but de ce
steeple-chase
était… »
NP (côté
droite de
page 266)
Brugnot
Planche hors-
texte
« De nombreux
soldats habillés de
garance,
absolument
comme des
soldats français,
gardaient les
abords »
NP (côté
droite de
page 268)
Rouget
Planche hors-
texte
« Le Misocampe » NP (côté
gauche de
page 269)
Brugnot
Planche hors-
texte
« Jarpéado fit
asseoir sa chère
bien-aimée sur un
coussin de
pourpre, et
traversa le lac… »
NP (côté
droite de
page 271)
Quichon
Planche hors-
texte
« Mademoiselle
Pigoizeau »
NP (côté
droite de
page 276)
Tamisier
Cul-de-lampe Le professeur
parle avec sa fille
Anna
p.280 Bernard
52
Le Diable à Paris, Paris, Hetzel, 1845.
Article
de
Balzac
Type
d’illustration
Sujet Page Illustrateur Graveur Note(s)
Philosophie
de la Vie
conjugale à
Paris
(p.165)
Vignette en
tête de
chapitre
Trois anges
trascinent des
chaines fleuries
liées à un bloc
sur lequel il est
écrit
« contrat ». Un
serpent avec
une pomme
dans la bouche
y est au-dessus
p.165 Bertall -
Vignette Caroline et
Adolphe
dinant chez
Borel, au
Rocher de
Cancale
p.170 Bertall Baulant
Vignette Madame et
Monsieur
Deschars
p.172 Bertall P.C.
Vignette à
côté du texte
Un petit
épicier retiré
p.182 Bertall Lavieille
Un
Espion à
Paris
(p.229)
Cul-de-lampe Le petit père
Fromenteau
p.234 Bertall Tamisier
Une
Marchande
Vignette Rideaux
décrochés à
p.275 Bertall -
53
à la toilette
(p.271)
quelque
boudoir saisi,
avec
chaussures
Vignette Madame
Nourrisson
p.277 Bertall Baulant
Un
Gaudissart
de la rue
Richelieu
(p.289)
Vignette à
côté du texte
Un homme
(Gaudissart)
soulevant une
étoffe
p.290 Bertall -
Vignette Un commis-
type
p.292 Bertall Tamisier
T.II
Ce qui
disparaît
de Paris
(p.11)
Vignette en
tête de
chapitre
Les Piliers des
Halles
p.11 Bertall F.
Leblanc
Vignette à
côté du texte
Les maisons le
long d’un
boulevard
p.11 Bertrand Brueirt
Vignette Place Royale p.12 Bertrand J.
Quartlev
Vignette Rue Rivoli p.12 Bertrand J. Quartlev
Vignette Rue de
Castiglione
p.12 Bertrand J. Quartlev
Vignette Rue des
Colonnes
p.12 Bertrand J. Quartlev
Vignette à côté du texte
L’allumeur de
réverbères et
sa famille
p.14 (B) Bertall -
Vignette à côté du texte
La ravaudeuse p.15 (Bertall) -
54
Vignette à côté du texte
Le décrotteur p.15 B (Bertall) -
Vignette Le Bouquiniste p.16 B (Bertall) -
Vignette Une écaillère
sur sa chaise
p.16 (Bertall) -
Vignette Le marronniste p.16 (Bertall) Bara et
Gerard
Vignette à
côté du texte
Un marchand
de coco
p.16 (Bertall) -
Cul-de-lampe Le diable
regardant des
hommes dans
le vitre
p.19 B. (Bertall) -
Histoire et
physiologie
des
Boulevards
de Paris
(p.89)
Vignette en
tête de
chapitre
« La Madeleine
– Tête des
Boulevards »
p.89 Bertrand Brugnot
Vignette La Perspective,
à Pétersbourg
p.90 Bertrand Quartlev
Vignette On ne fait pas
deux
boulevards
sans rencontrer
un ami
p.91 B (Bertall) F.
Leblanc
A mon
avis, sur
la droite
y est
Balzac,
et vers
gauche
Hetzel
qui s’en
va
Vignette à
côté du texte
La femme
comme il faut
p.92 B (Bertall) DV
55
Vignette à côté du texte
« Rue
Caumartin »
p.95 (Bertrand) -
Vignette à côté du texte
« Maison de
Lulli »
p.95 B
(Bertrand)
Quartlev
Vignette à côté du texte
« Rue de la
Paix »
p.95 Bertrand -
Vignette à côté du texte
« Pavillon de
Hanovre »
p.95 Bertrand -
Vignette à côté du texte
« Bains
chinois »
p.95 Bertrand -
Vignette « Café de
Paris- Rue
Taitbout –
Tortoni –
Maison Dorée
– rue Lafitte »
p.96 (Bertrand) -
Vignette « Maison du
Grand balcon »
p.96 Bertrand Quartlev
Vignette « Entrée de la
rue Grange-
Batelière »
p.96 (B) Bertrand
Quartlev
Vignette « Maison et
café Frascati –
rue Richelieu –
Café Cardinal »
p.97 Bertrand Brugnot
Vignette « Boulevard
Montmartre –
Théâtre des
Variétés »
p.97 Bertrand Brugnot
Vignette
encadrée par
le texte
La lorette P.98 B (Bertall) DV
56
Vignette Le beau
monde chez
Tortoni, place
de la Bourse
p.98 B (Bertall) Tamisier
Vignette « Ancien hôtel
Lagrange »
p.99 (Bertrand) -
Vignette « Maison du
Pont de fer »
p.99 « Bertrand) -
Vignette « Bazar Bonne-
Nouvelle »
p.99 (Bertrand) -
Vignette
encadrée par
le texte
« Théâtre du
Gymnase
dramatique »
p.99 (Bertrand) -
Vignette à
côté gauche
du texte
Une
bourgeoise
inélégante de
Paris autour du
Bazar Bonne-
Nouvelle
p.99 B (Bertall) -
Vignette à
côté droite
du texte
Un bourgeois
retiré autour
du Bazar
Bonne-
Nouvelle
p.99 B (Bertall) AC
Vignette « Boulevard
Saint-Denis –
Portes Saint-
Denis et Saint
Martin »
p.100 Bertrand -
Vignette à
côté gauche
du texte
Les paysans de
Paris
p.100 B (Bertall) -
57
Vignette à
côté droite
du texte
Les ouvriers de
Paris
p.100 B ?
Vignette La fontaine de
la Porte Saint-
Denis
p.101 Bertall Verdeil
Vignette « Théâtre de la
Porte-Saint-
Martin »
p.102 (Bertrand) -
Vignette « Le Château
d’eau »
p.102 (Bertrand) -
Vignette « Théâtre de
l’ambigu »
p.102 (Bertrand) -
Vignette Les cris de
Paris
p.102 Bertall -
Vignette Le Boulevard
des Italiens du
peuple
p.102 Bertrand ?
Vignette « Restaurant
Deffieux »
p.103 (Bertrand) -
Vignette « Le Jardin
Turc »
p.103 B
(Bertrand)
-
Vignette « Le Cadran
Bleu »
p.103 B
(Bertrand)
J.
Duabtlev
Vignette
encadrée par
le texte
« Théâtre
Beaumarchais »
p.103 (Bertrand) -
Vignette Coup d’œil sur
Paris
p.104 (Bertrand) Brugnot
59
Annexe 9 : Table des illustrations de La Comédie humaine de l’édition
Furne, 1842-1848, 17 vol. in-8°
VOL. I (1842) : 1ÈRE PARTIE ÉTUDES DE MŒURS, SCÈNES DE LA VIE
PRIVÉE, LIVRE PREMIER
Œuvre
N. Pages
Titre illustration et didascalie
Illustrateur
Graveur
Type d’illustration
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières lignes du texte à côté
Dernières lignes du texte à côté
Note(s)
LA MAISON DU CHAT-QUI-PELOTE
32-84
“La figure de Monsieur GUILLAUME annonçait la patience, la sagesse commerciale, et l’espèce de cupidité rusée que réclament les affaires”.
Meissonier
Breviere sc.
Portrait Page de gauche
P. 33 : « Au milieu de la rue Saint-Denis… »
« …et paraissait l’examiner avec un enthousiasme d’archéologue »
LE BAL DE
SCEAUX
86-138
“Invariable dans
sa religion
aristocratique,
Monsieur de
FONTAINE en
avait aveuglément
suivi les maximes
”
Meissonier
Godard sc.
Portrait Page de gauche
p. 85: « Le
comte de
Fontaine, chef de l’une
des plus
anciennes
familles du
Poitou… »
« …contristé de l’avidité
avec laquelle
ses anciens camarad
es faisaient
curée des »
60
LA BOURS
E
140-167
Les artistes
eux-mêmes
reconnaissaient SCHINNER
pour un maître
M (Meissonier)
- Portrait-Scène
Page de gauche
p.139: « il est pour les
âmes faciles à s’épanouir une heure
délicieuse qui
survient au
moment où la nuit n’est pas
encre et où le jour n’est
plus… »
« …alors aux yeux
intérieurs du
génie. Celui
qui n’est pas
demeuré »
Adélaïde Gerar
d Seguin
- Portrait-Scène
Page de gauche
p.161 : « ce
vieux visage. Il sortit
en proie à mille
incertitudes. »
« Il se fouilla par des mouvements rapides et ne
retrouva pas la
maudite bourse.
Sa mémoir
e »
LA VENDETTA
168-230
Ginevra di
Piombo « Elle
prit une feuille de papier et se mit à croquer à la sépia la tête du
Français ?
J-Caqué
Portrait-Scène
Page de droit
p.168 : « En 1800, vers la fin du mois
d’octobre… »
« La petite fille
restait debout, malgré
la fatigue dont »
61
pauvre reclus »
MME FIRMIANI
231-250
- - - - - - -
UNE DOUB
LE FAMILLE
251-315
A toute heure du jour les passants apercevaient cette
jeune ouvrière
… Sa mère, Madame CROCHARD…
Tony Johannot
- Portrait-Scène
Page de gauche
p.251 : « La rue
du Tourniquet-Saint-Jean,
naguère une des rues les
plus tortueuses… »
« La partie la
plus large de la rue
du Tourniquet était
à son debou-
»
LA PAIX DU
MENAGE
316-349
Le Colonel
de Soulange
s « L’affaissement de ses
membres et
l’immobilité de
son front accusaient toute
sa douleur »
- - Portrait Page de
droit p.316 : incipit
« …exigences étaient
satisfaites avec
quelques aunes
de rouban rouge.
A »
LA FAUSS
E MAÎTRESSE
350-396
Malaga - Breviere
Scène-Portrait
Page de droit
p.350 : incipit
« Par un effet du hasard, malgré
le dissipa-
»
ÉTUDE DE
FEMME
397-405
-
ALBERT
406-
-
63
VOL. II (1842) : ÉTUDES DE MŒURS, SCENES DE LA VIE PRIVÉE, LIVRE
DEUXIÈME
Œuvre N. Pages
Titre illustration et didasc
alie
Illustrateur
Graveur
Type d’illustr
ation
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières lignes du texte
à côté
Dernières lignes du texte
à côté
Note(s)
MÉMOIRES DES
DEUX JEUNE
S MARIÉ
ES
1-194
« Si vous
aviez à me
reprendre en quoi
que ce soit, je deviendrais votre
obligée ». Il
tressailli, le
sang a coloré
son teint
olivâtre.
Tony Johann
ot
Breviere
Scène Page de gauche
p.1 : Dédicace à Geor
ge Sand
Dédicace à Geor
ge Sand
Mes yeux
ont été magiquement attirés
par deux
yeux de feu qui brillaie
nt comme
deux escarbo
ucles dans
Tony Johann
ot
Verdeil sc.
Scène Page de
droit
p.52 : « Ceci, ma chère Madame de l’Estorade… »
« …jeune fille ne
peut pas plus la
concevoir
que la femm
e mariée ne »
64
un coin du
parterre.
Ces deux petits font alors
de mon lit le
théâtre de leur
jeux
Tony Johann
ot
Brugnot
Scène Page de gauche
p.145 : « des convulsions
est pour moi
toujours
accroupi au pied de
leurs lits. »
« …savons qui
glisse, voilà des
éclats de
joie ! Enfin, si les triomphes »
Elle avait exigé
de moi que je
lui lusse en
français le De
Profundis,
pendant
qu’elle serait ainsi face à face
avec la belle
nature qu’elle s’était créé.
Tony Johann
ot
Levoir (?)
Scène Page de gauche
p.193 :
« courage, mais il est atteint: je ne
m’étonnerais pas de
voir suivre… »
« agenouillé
de l’autre côté de la bergère. »
UNE FILLE D’ÈVE
195-299
La comtesse de
Vandenesse
Tony Johann
ot
Tamisier Sc.
Portrait Page de gauche
Incipit
« …aux
portes, aux croisé
65
es, un artiste
»
LA FEMM
E ABANDONN
ÉE
300-338
La femme abandonnée
Ne Brevière
Portrait Page de
droit Incipi
t
« …lieves plus loin,
passe, dans
le départemen
t, pour incontestable et »
LA GRENADIÈR
E
339-360
-
LE MESSA
GE
361-373
« Allons,
Madame,
allons !... »
- Brugnot
Scène Page de gauche
Incipit
« Bientôt une
certaine
conformité d’âge, dépensée,
notre »
GOBSECK
374-422
GOBSE
CK, immob
ile, avait
saisi sa loupe
et contem
plait silencieusement l’écrin
Ch. Jacque(s
)
Tamisier sc.
Portrait Page de
droit Incipi
t
« Ecoutez, mon enfant, si vous avez
confiance »
AUTRE ÉTUDE DE
423-45
-
67
VOL. III (1842) : TROISIÈME PARTIE ÉTUDES DE MŒURS, SCÈNES DE LA
VIE PRIVÉE, LIVRE TROISIÈME
Œuvre
N. Pages
Titre illustration et
didascalie
Illustrateur
Graveur
Type d’illustr
ation
Côté de la page illustrée
(droite/gauche)
Premières
lignes du
texte à côté
Dernières
lignes du
texte à côté
Note(s)
LA FEMME DE TRENTE ANS
1-165
Monsieur CROTT
AT, notaire
NE ? Portrait Page de gauche
Incipit « …des cheveux grissonants couvraient à peine son »
C’est là, répondit-il avec mélancolie, en montrant un bouquet de noyers sur la route, là que, prisonnier, je vous vis pour la première fois
Birouste
? Scène Page de gauche
p.47 : « molles laissèrent voir toutes les beautés de cette jolie nature. Julie »
« C’est là, répondit-il avec mélancolie, en montrant un bouquet de noyers »
LE CONTRAT DE MARIAGE
166-284
Le bon monsieur Mathias
? ? Portrait Page de droit
p.166 : incipit
« …resta sous la domination paternelle pendant trois »
Ne me dites donc
J. Travies
Vichon
Scène Page de droit
p.200 : « de Lanstr
« …employé vers
68
pas de niaiseries
ac, estimés quatre cent cinquante mille francs. »
1817 en cinq pour cent, donnant quarante mille francs de revenus… »
Miss Stevens
Travies c.i.
Quichon
Portrait Page de droit
p.280 : « Délai calculable, doit lui laisser une fortune au moins égale à celle dont est …”
« Les affaires sont tellement avancées que les publications sont à terme »
BÉATRIX
285-476
Au moment où FANNY vit le baron endormi, elle cessa la lecture du journal
Johannot
J. Caqué
Scène Page de gauche
p.285 : incipit
« qui vodrait voya- »
Mademoiselle Pen-Noel
C. J.Travies
Quichon
Portrait Page de gauche
p.313 : « D’ivoire devenus jaunes
« …dents blanches enchâssés dans
69
comme du tabac turc par un usage de… »
des gencives rouges qui rassuraient »
Ces deux femmes, en apparence indolentes, étaient à demi couchées sur le divan
Birouste
? Scène Page de gauche
p.431 : « des larmes. Je viens de commettre la faute de lire cette lettre… »
« Mais pour ne pas donner son secret, elle se livrait à des »
VOL. IV (1845) : ÉTUDES DE MŒURS, SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE, LIVRE
QUATRIÈME
Œuvre
N. Pages
Titre illustration
et didascalie
Illustrateur
Graveur
Type d’illustration
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières
lignes du
texte à côté
Dernières
lignes du
texte à côté
Note(s)
BÉATRIX, DERNIÈRE PARTIE
1-94 Madame Latournelle “Elle prend du tabac, se tient rode comme un pieu…et ressemble parfait
Bertall Loiseau
Portrait
Page de gauche
Cette planche se réfère en réalité à Modeste Mignon
70
ement à une momie…”
LA GRANDE BRETECHE (FIN DE AUTRE ETUDE DE FEMME)
-
MODESTE MIGNON
113-345
Butscha “Modeste avait surnommé ce grotesque preir clerc, le Nain mystérieux.”
Bertall Diolot
Portrait
Page de gauche
p.113: incipit
“après avoir présenté tes res-“
Modeste Mignon, “Modeste remit la lettre dans son corset et tendit à Dumo
- - Portrait
Page de gauche
p.227: “La lettre pour monsier votre père…”
“…la rose de son poème, elle y passa la moitié de la journée”
71
y celle destinée à son père”
pp.203-207: pentagrammi con note
HONORINE
346-413
L’Abbé Loraux
Bertall Baulant
Portrait
Page de droit
p.346: incipit
“Ce petit préambule a pour but de rappeler à ceux e français”
UN DÉBUT DANS LA VIE
414-557
Pierrorin “…Pendant l’exercice de ses fonctions il portait une blouse bleue, etc., etc.”
Bertall Montigneul
Portrait
Page de droit
p. 414: incipit
“les avantages d’une centralisation puissante, les messageries Tou-“
Oscar Husson “Et quand ils retournaient, ils regardaient toujou
Non si legge
Barbant
Portrait
Page de droit
p.446: “riens, mais si l’on jalouse un sot élégamment vêtu,…”
“nouveaux voyageurs, monté sur l’imperiale, y placait, y calait avec”
72
rs Oscar, tapi dans son coin”
Mistigris “…Ce joyeux élève en peinture, qu’en style d’atelier on appelle un rapin.”
Bertall Tamisier
Portrait
Page de droit
p.448: “gilet noir, boutonné jusqu’en haut, commela redingote…”
“- Ce père Léger m’inquiète, dit-il”
Oscar était si grièvement blessé que l’amputatin du bras gauche fut jugée nécessaire…
Non riesco a leggere la firma
Brugnot
Portrait
Page de gauche
p.549: “veuve dynastie tenait du fanatisme, eut placé comme chef…”
“…avait plus servi sa femme par sa mort que par toute sa vie.”
73
VOL. V (1843) : ÉTUDES DE MOEURS, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE,
LIVRE I
Œuvre N. Pages
Titre illustration et
didascalie
Illustrateu
r
Graveur
Type d’illustration
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières
lignes du
texte à côté
Dernières
lignes du texte à côté
Note(s)
URSULE MIROUËT
1-205
Le curé Chaperon
Henry Monnier
Brugnot
Portrait
Page de gauche
p.1: incipit
“…on a malheureusement bâti pluseurs maisons en deçà du pont. Si”
Goupil “Aussi son visge semblait-il appartenir à un bossu dont la bosse eût été en dedans”
Célestin Nanteuil
Brugnot
Portrait
Page de gauche
p.9: “licieusement un jeune homme qui survint et qui jouait dans…”
“Goupil autuant par peur qu’à cause de son excessive intelligence et”
Madame de Portenduere “Vêtue de deuil, elle avait arboré un air solennel, en harmonie avec cette chambre mortuaire”
H. Monnier
Brugnot
Portrait
Page de gauche
p.107: “dité des principes de sa mère, son culte de l’honneur, s loyauté,…”
“…encore à ceux qui doivent être en présence dans ce petit drame, termine ii l’exposition.”
74
EUGÉNIE GRANDET
206-365
Le père Grandet
H. Monnier
Quichon
Portrait
Page de droit
p.206: dédicace “A Maria”
“sans admirer les énores madriers dont les bouts sont taillés en figures”
La grande Nanon appartenait à M.Grandet depuis trente-cinq ans
Henri Monnier
Montigneul
Portrait
Page de gauche
p.219: “prise dans l’achat de la maison, ainsi que le trumeau, le cartel,…”
“acquis. A l’âge de vingt-deux ans, la pauvre fille n’avait pu se placer”
Elle s’asseoit complaisamment à la fenêtre (EG)
Pas de signature
Pas de signature
Portrait
Page de gauche
p.249: “choses d’ici-bas était arrivé pour Eugénie. Matinale comme toutes…”
“moitié tombée de vétusté, mais à laquelle se mariaient à leur”
LES CELIBATAIRES PREMIERE HISTOIRE : PIERRETTE
366-492
…Enfin toutes ces choses humbles et fortes qui composent le costume d’un pauvre
Célestin Nanteuil
Tamisier sc.
Portrait
Page de droit
p.366: Dédicace à Mademoiselle Anna de Hanska
“…diligence, à une lieue, sur la grande route. Les deux plus longues”
75
Breton. La
vieille demoiselle avança la tête hors de la fenêtre, leva vers la mansarde ses petits yeux d’un bleu pâle et froid.
Pas de signature
Gautier sc.
Scène Page de droit
p. 370: “tent aux sorcières. Les tempes, les oreilles et la nuque, assez peu cachées, laissent voir leur caractère…”
“l’arrivée de Brigaut était un événement immense. Pendant la nuit, cet Édenn des malheureux,”
76
VOL. VI (1843) : ÉTUDES DE MOEURS, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE,
LIVRE II
Œuvre N. Pages
Titre illustration
et didasc
alie
Illustrateur
Graveur
Type d’illustration
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières
lignes du
texte à côté
Dernières
lignes du
texte à côté
Note(s)
LES CELIBATAIRS DEUXIÈME HISTOIRE : LE CURÉ DE TOURS
1-62
L’ABB
E
BIROT
TEAU, petit homme court, de constitution apoplectique, avait déjà subi plusieurs attaques de goutte.
Henry Monnier
A. Baulant sc.
Portrait
Page de gauche
p.1: Dédicace “A Davis, statuaire”
“L’Abbé Birotteau, petit homme court, de constitution apoplectique, âgé d’environ soixante ans…”
LES CELIBATAIRES TROISIÈME HISTOIRE : UN MENAGE DE GARCON
63-317
Philippe Brideau “Philippe fut un des bonapartistes les plus assidus du café Lemblin. Il y prit les habitudes, les manièr
Henri Monnier Del
Chevauchet sc.
Portrait
Page de gauche
p.63: Dédicace “A Monsieur Charles Nodier”
Dédicace
77
es, le style et la vie des officiers à demi-solde; etc. etc.”
La Veuve Descoings “Depus une dizaine d’années, la Descoings avait pris les tons mûrs d’une pomme de reinette à Pâques.
H. Monnier
A. Baulant sc.
Portrait
Page de gauche
p.115: “pondit-il gaiement, et pourquoi vous inquiéteriez-vous de ceux qui ne vous connaissent pas?”
“…à des travaux qui laissent jusqu’à un certain point la pensée libre, ils ressemblent un peu aux femmes-, leur esprit peut tour-“
Flore Brazier “La fille, quasi nue, portait une méchante jupe, courte, tronée et déchiquetée,
Henry Monnier
Tamisier sc.
Portrait
Page de gauche
p.171: “nue, portait une méchante jupe, courte, tronée et déchiquetée, en mauvaise étoffe de laine…
“…et dans leur trouble se jettent au milieu des engins que le pêcheur a placés à une distanc
78
en mauvaise étoffe de laine.”
” e convenable. Flore Brazier”
Jean-Jacques Rouget “A la mort de son père, Jacques, âgé de trente-sept ans, était aussi timide et soumis à la discipline paternelle que peut l’être un enfant de douze ans.”
Markl (?!)
Brugnot
Portrait
Page de gauche
p.179: “- oui, monsieur Jean… Au moment de faire sa déclaration…”
“Or, si les jeunes filles, ni les bourgeoises ne pouvaient fair les avances à un jeune”
Bixiou “Votre nom? Dit Joseph, pendant que Bixiou croquait la
Henry Monnier
Chevauchet
Portrait
Page de gauche
p.311:
79
femme appuyée sur un parapluie, etc., etc.”
Madame Gruget “…Des guenilles qui marchent! C’était, en effet, un tas de linge et de vieilles robes les unes sur les autres; etc.”
L. Marck
Brugnot
Portrait
Page de droit
p.312: “outre mes trente francs de garde; et, comme elle veut se faire périr avec du charbon…”
“Madame Bridau, pauvre femme, aimit Philippe, elle a péri par lu!... Le Vice! Le”
LES PARISIENS EN PROVINCE PREMIÈRE HISTOIRE : L’ILLUSTRE GAUDISSART
318-354
Gaudissart “…Chacun de dire en le voyant: - Ah! Voilà l’illustre Gaudissart!”
Picaud
P. P. Portrait
Page de droit
p.318: Dédicace “A madame la duchesse de Castries”
“… un prêtre incrédule qui n’en parle que mieux de ses mystères et de ses dogmes”
LES PARISIENS EN PROVIN
355-509
-
81
VOL. VII (1844) : ÉTUDES DE MOEURS, SCÈNES DE LA VIE DEPROVINCE,
[DEUXIÈME] TROISIÈME LIVRE
Œuvre
N. Pages
Titre illustrati
on et didascali
e
Illustrateur
Graveur
Type d’illustration
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières
lignes du
texte à côté
Dernières
lignes du
texte à côté
Note(s)
LES RIVALITÉS PREMIÈRE HISTOIRE : LA VIEILLE FILLE
1-119
Le chevalier de Valois d’Alençon “Son principal vice était de pendre du tabc dns une vieille botte d’or…”
Bertall Brevière
Portrait Page de gauche
P.1: Dédicace “A monsieur Eugène-Auguste-Georges-Louis MIDY de la Grenerave Surville”
“…cette illustre origine au mari de la fameuse Lamothe-Valois, impliquée dans l’affaire du collier.”
Du Bousquier “Il avait conservé le costume à la mode au temps de sa gloire…”
Bertall Baulant
Portrait Page de droit
p.18: “traire une voix forte mais étouffée, de laquelle on ne peut donner une idée…”
“Il devint le chef du parti libéral d’Alençon, le directeur invisible des élections, et fit un mal prodigieux à la Restauration”
Mademoiselle Cormon
Bertall - Portrait Page de gauche
p.45: “la longue
“La violence de s
82
“Mais la pauvre fille avait déjà plus de quarante ans !”
ur du col et gêné le port de la tête. Elle n’avait pas de rides, mais des plis…”
passion sans objet était si grande qu’elle n’osait plus regarder un homme en face, tant elle”
LES RIVALITÉS DEUXIÈME HISTOIRE : LE CABINET DES ANTIQUES
120-244
Mademoiselle d’Esgrignon “Quand je la voyais venant de loin sur le cours…et qu’elle y amenait Victurnien, son neveu, etc., etc.”
Bertall J. Caque
Scène Page de droit
p.120: Dédicace “A Monsieur le baron de Hammer-Purgastall
Dédicace
La duchesse écoutait comme elle savait écouter, le coude appuyé sur son genou levé très-haut.
Bertall Tamisier sc.
Scène Page de droit
p.188:
M. Blondet “Le bonhomme aimait passionnément
Bertall A. Leblanc
Portrait Page de gauche
p.213: “auraient-ils été supplantés par l’astuci
“…la botanique, il vivait enfin dans le monde
83
l’horticulture…..Il avait l’ambition de créer de nouvelles espèces…..”
eux Président, dont la fortune étit bien supérieure…”
des fleurs. Comme tous les fleu-“
LE LYS DANS LA VALLÉE
245-491
Le comte de Morstauf “Maigre et de haute taille, il avait l’attitude d’un gentilhomme, etc……….”
Bertall Baulant
Portrait Page de gauche
p.245: Dédicace “A Monsieur J.-B. Nacquart”
“As-tu dans le cœur des secrets qui, pour se faire absoudre, aient besoin des miens? Enfin, tu l’as deviné,”
La comtesse de Mortsauf “Enfin, il me mena vers cette longue allée d’acacias…….où j’aperçus, sur un banc, Mme de Mortsauf occupée avec ses deux enfants.”
Bertall Barbant
Portrait Page de gauche
p.287: “Quel changement dans ce paysage si frais et si coquet avant mon sommeil !”
“…par des masses d’arbres, par des rochers. Nous allongeâmes le pas pour aller saluer madame de”
85
VOL. VIII (1843) : ÉTUDES DE MOEURS, SCÈNES DE LA VIE DE
PROVINCE, QUATRIÈME LIVRE
Œuvre
N. Pages
Titre illustration
et didasc
alie
Illustrateur
Graveur
Type d’illustration
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières
lignes du texte à côté
Dernières
lignes du
texte à côté
Note(s)
ILLUSIONS PERDUES PREMIÈRE PARTIE : LES DEUX POÈTES
1-119
Séchard “Vous eussez dit d’une truffe monstrueuse enveloppée par les pampres de l’automne.”
Henri Monnier
Montigneul
Portrait Page de gauche
p.1: Dédicace “A monsieur Victor Hugo”
Eve et David Séchard “Quand les deux amants furent seuls, David se trouva plus embarrassé qu’il n’avait été dans aucun moment de sa vie.”
Celestin Nanteuil
J. Caque
Al limite tra Scène et portrait
Page de gauche
p.59: “de la Charente, parut inquiet. Davis lui conseilla d’emporter André de Chénier, et de remplacer un plaisir douteux par un plaisir certain.”
“…et lui donna de violents soupçons sur les relations d’Ève et de l’imprimeur.”
86
ILLUSIONS PERDUES DEUXIÈME PARTIE : UN GRAND HOMME DE PROVINCE À PARIS
119-393
La loge des Premiers Gentilshommes est celle qui se trouve dans l’un des deux pans coupés au fond de la sllle: on y est vu comme on y voit de toutes côtés.
Celestin Nanteuil
Picaud
Tra Scène e Portrait
Page de gauche
p.135: “cevoir du Contrôleur quelque impertinent avis pour se rnager, fit place aux deux femmes.”
“…se promit de profiter du premier accès de vertu de Louise pour la quitter. Son excellente vue lu permettait de voir les”
Lucien Chardon “Il se courrouça, il devint fier, et se mit à écrire la lettre suivante dans le paroxysme de la colère”
Celestin Nanteuil
Picaud
Portrait
Page de gauche
p.151: “se dit pas qu’il avait, lui le premier, étourdiment renié son amour, sans savoir ce que deviendrait s Louise à Paris ;”
“Rien? N’est-ce pas ce qui a servi à faire le monde ? Le génie doit imiter Dieu : je commence par avoir”
Ils avaient compris son manqu
C. Nanteuil
Brugnot
Portrait Page de droit
p.180: “contemplations de la nature
“Tu pourras le négocier chez
87
e d’argent
qu’ils ont mission de reproduire. Ces hommes si forts…”
monsieur Métivier, marchand e papier, notre corres-“
Camusot “Cet amateur était un bon, gros et gras marchand de soieries de la rue des Bourdonnais, etc.”
H. Monnier
Tamisier sc.
Portrait Page de droit
p.240: “dévoraient le poète accoudé dans le coin de la loge, le bras …”
“…et dont le sort devait être le sien, était le type des filles qui exercent à volonté la fascination sur les hom-“
Coralie faisait la joie de la salle, où tus les yeux serraient sa taille bien prise dans sa basquine, et flattaient sa croupe andalo
Celestin Nanteuil
- Scène
Page de gauche
p.241: « mes. Coralie montrait une sublime figure hébraïque… »
« …des divinités gardées par des dragons inabordables. En voilà »
88
use qui imprimait des torsion lascives à la jupe
BRAUL
ARD a vingt mille livres de rentes, puis il a ses claqueurs [IP]
Henri Monnier
A. Baulant sc.
Portrait Page de droit
p.316 : “en politique come en journalisme une foule de cas où les chefs ne doivent jamais être mis en cause.”
“Lousteau donnait cette explication à voix basse en montant l’escalier.”
ILLUSIONS PERDUES TROISIÈME PARTIE : ÈVE ET DAVID
393-570
-
89
VOL. IX (1843) : ÉTUDES DES MOEURS, TROISIÈME LIVRE [INTESTAZIO
H13], SCÈNES DE LA VIE PARISIENNE
Œuvre
N. Pages
Titre illustration
et didasc
alie
Illustrateur
Graveur
Type d’illustration
Côté de la page illustrée
(droite/gauche)
Premières
lignes du
texte à côté
Dernières
lignes du
texte à côté
Note(s)
HISTOIRE DES TREIZE. PRÉFACE
1-6 Ses amis, pris de vin comme lui, l’auront laissé se coucher dans la rue [Ferragus]
H. D. (Daumier)
- Scène Page de gauche
p.1: “Il s’est rencontré, sous l’Empire et dans Paris, treize hommes également frappés du même sentiment…”
“Ils sont paisiblement rentrés sous le joue des lois civiles, de même que Morgan, l’A-“
FERRAGUS
6-110
Madame Gruget “Cette femme a quelque passion, quelques vices cachés…..”
Bertall Loiseau
Portrait Page de droit
p.78: “mélisse pour les défaillances, des dragées pour les enfants, et du taffetas anglais pour les coupures.”
“- ça pourra-t-il nuire à ma fille, mon cher monsieur, dit-elle en lui jetant des regards de chatte inquiète. - En rien, madame. Mais,
90
d’ailleurs, il paraît que votre fille se”
Ferragus XIII “Il s’appuyait contre un arbre quand le cochonnet s’arrêtait”
H. D. (Daumier)
AB Scène Page de gauche
p.109: “il y a de tout cela ; mais ce n’est rien de tout cela : c’est un désert. Autour de ce lieu sans nom…”
“…les joueurs venaient alors la prendre dans les mains glacées de ce vieillard, sans la lui emprunter par un mot, sans même lui faire un signe d’amitié. Le”
LA DUCHESSE DE LANGEAIS
111-235
La duchesse de Langeais avait reçu de la nature les qualités nécessaires pour jouer les rôles de coquette
Bertall J. Caque
Portrait Page de droit
p.150: « Quand il marchait, s pose, s démarche, le moindre geste… »
« …dans la liberté de ses régards expressifs, dans les câlineries »
LA 236 Henri Bertall F. Portrait Page de p.252: “…parc
91
FILLE AUX YEUX D’OR
-302
de Marsay “Quoiqu’il eût vingt-deux ans accomplis, il paraissait en avoir à peine dix-sept.”
Leblanc
droit “espèce de force, si profond quand il fallait faire quelque décompte humain, si jeune à table, à Frascati, à…”
e que la femme est vulgairement à Paris sans ténacité. Peu d’entre elles se disent à la manière des hom-“
LE PÈRE GORIOT
303-531
Enfin toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne
Bertall Rougon
Portrait Page de gauche
p.303: Dédicace “A Geoffrey Saint-Hilaire”
“…et si terriblement agitée qu’il faut je ne sais quoi d’exorbitant pour y produire une sensation de quelque durée. Cependant il s’y rencontre çà et là des douleurs”
Vautrin “Sa figure, rayée par des rides prématurées,
H. D. (Daumier)
- Portrait Page de gauche
p.313: “rien au monde que son douaire et sa pension ; elle pouvait
“Si quelque serrure allait mal, il l’avait bientôt démontée,
92
offrait des signes de dureté que démentaient ses manières soupies et liantes”
laisser un jour cette pauvre fille, sans expérience et sans ressources…”
rafistolée, huilée, limée, remontée, en disant : Ça me connaît. Il”
Aux unes, il faisait horreur ; aux autres, il faisait pitié
Daumier
Baulant
Portrait Page de gauche
p.325: “en manière de raillerie: “Eh! Bien, elles ne viennent donc plus vous voir, vos filles?” en mettant en doute sa paternité…”
“…raisonnant ou répondant, car il avait l’habitude de répéter en d’autres termes ce que les autres disaient; mais il contri-“
93
VOL. X (1844) : ÉTUDES DE MOEURS, TROISIÈME LIVRE, SCÈNES DELA
VIE PARISIENNE
Œuvre N. Pages
Titre illustrati
on et didascal
ie
Illustrateur
Graveur
Type d’illustration
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières
lignes du
texte à côté
Dernières
lignes du
texte à côté
Note(s)
LE COLONEL CHABERT
1-60
Le Colonel Chabert “…..Sur la table vermoulue, les Bulletins de la Grande Armée étaient ouverts et paraissaient être la lecture du Colonel.”
Bertall Breviere
Portrait
Page de gauche
p.1: Dédicace “A madame la comtesse Ida de Bocarmé, née de Chasteler.”
“…qui dans toutes les Études se trouve sous la domination spéciale du principal clerc dont les commis-“
FACINO CANE
61-73
-
LA MESSE DE L’ATHÉE
74-89
Bourgeat “Cet homme avait la foi du charbonnier ; il amait la sainte Vierge comme il eût aimé sa femme.”
Bertall Breviere
Portrait
Page de droit
p.74:
SARRASINE
90-121
Sarrasine la crayonn
Bertall Breviere
Scène Page de droit
p.90: Dédicace
“on surprenait
94
a dans toutes les poses ; il la fit sans voile, assise, debout, couchée…..etc.”
“A?” aussi des airs de tête significatifs pour les amants, et des attitudes négatives”
L’INTERDICTION
122-189
Popinot “Cet homme avait une bouche sur les lèvres de laquelle respirait une bonté divine”
Staal AB Portrait
Page de droit
p.122: Dédicace “A monsieur le contre-amiral Bazoche”
“…tu changeras ton cheval borgne contre un aveugle. - Madame de Nucingen a trente-six ans, Bianchon.”
HISTOIRE DELA GRANDEUR ET DE LA DÉCADENCE DE CESAR BIROTTEAU
190-449
César Birotteau “Habituellement en parlant il se croisait les mains derrière le dos”
Bertall Breviere
Portrait
Page de droit
p.190: Dédicace “A monsieur Alphonse de Lamartine”
“…où elle se trouvayait à la fois et sur le seuil de la porte et sur son futeuil dans le comp-“
Le sieur Ragon
Bertall F. Lebl
Portrait
Page de droit
p.292: “mait
“- Mais
95
était un petit homme de cinq pieds au plus, à figure de casse-noisette….et souriant toujours.
anc le respect. Elle avait d’ailleurs en elle ce je ne sais quoi d’étrange qui saisit sans exciter le rire…”
oui, répondit la belle parfumeuse toujours sous le charme de cette ombrelle à canne, de ces bonnets à papillon, des”
Jamais toilette n’alla mieux à Madame César
Bertall - Scène Page de gauche
p.319: “s’habillèrent sur les quatre heures, après avoir livré l’entresol au bras séculier des gens de Chevet.”
“L’excellence des mets, la bonté des vins furent bien appréciées. Quand la société ren-“
Anselme Popinot “Anselme retourna chez lui, fit pour cinquante mille francs de
Bertall F. Leblanc
Tra portrait et scène
Page de droit
p.392: “Depuis le moment où ce mot lui fut jeté comme un anathè
“- Mon cher et bien-aimé patron, dit-il en s’essuyant le front
96
billets……..”
me, le petit Popinot n’avait pas eu un moment de sommeil…”
baigné de sueur, voilà ce que vous m’avez demandé. Il tendit les”
97
VOL. XI (1844) : ÉTUDES DE MOEURS, SCÈNES DE LA VIE PARISIENNE,
TROISIÈME LIVRE
Œuvre N. Pages
Titre illustrati
on et didascal
ie
Illustrateu
r
Graveu
r
Type d’illustratio
n
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières
lignes du
texte à côté
Dernières
lignes du texte à côté
Note(s)
LA MAISON NUCINGEN
1-60
M. Vervelle “…..Et ne fut pas médiocrement surpris de voir entrer une figure vulgairement appelée melon dans les ateliers.” [Pierre Grassou]
Bertall
Baulant sc.
Portrait
Page de gauche
p.1: Dédicace “A madame Zulma Carraud”
“…dans un petit salon où nous parlions à voix basse, après avoir reconnu le peu d’è-“
La planche se réfère en réalité à Pierre Grassou
PIERRE GRASSOU
61-80
-
LES SÉCRETS DE LA PRINCESSE DE CADIGNAN
81-132
La princesse de Cadignan “La princesse passe encore aujourd’hui pour une des plus fortes sur la toilette…..”
CH CH
F. Leblanc
Portrait
Page de droit
p.98: “en se les serrant avec amitié. Certes elles avaient toutes deux l’une à l’antre des secrets importants…”
“La blancheur si célèbre de la princesse avait pris une teinte mûrie”
LES 13 Madame - Bar Scène Page de P.169: “Aussitô
98
EMPLOYÉS
3-335
Saillard et sa fille “Quelqu’elle eût cinquante-sept ans, et que ses travaux obstinés au sein du ménage lui permissent bien de se reposer, elle tricotait les bas de son mari, etc…..”
bant gauche “cause de la beauté des cadres ; vaisselle d’ordre composite, c’est-à-dire un dessert en magnifiques assiettes du Japon…”
t qu’Élisabeth avait su tenir une aiguille, s mère lui avait fait raccommoder le linge de la”
M. Bidault-Gigonnet “Ce petit viillard, à figure d’une teinte verdâtre, laissait flotter ses cheveux gris sous un tricorne….”
Bertall
I. Caque
Portrait
Page de gauche
p.171: “nagé quelque froide et complète vengeance mise sur le compte du bon Dieu.”
“Après avoir marié leur fils unique, auquel ils donnèrent cinquante mille francs, ils pensèrent”
M. Phellion “Il avait une figure de bélier pensif, pe colorée,
Bertall
F. Leblanc
Portrait
Page de droit
p.202: “pouvoir rire aux dépens de cette innocente créature,
“Vimeux était un jeune homme de vingt-cinq ans, à quinze”
99
marquée de la petite vérole…..
les expéditionnaires étaient allés consulter…”
Vignette di Bixiou, qui constitue une vignette en bas e page Pas de légend
H. D. - Scène Page de gauche
p.320: “…qui lui présenta la lithographie, dont voici le principal trait rendu par ce léger croquis.”
“- Il y a là beaucoup d’esprit, dit Rabourdin en montrant un”
SPLENDEURS ET MISÈRES DES COURTISANES
336-588
L’Abbé Carlos Herrera “Les personnes les moins clairvoyantes eussent pensé que les passions les plus chaudes…..avaient jeté cet homme dans le sein de l’Église.” [Splendeurs et misères des
Bertall
Tamisier sc.
Portrait
Page de droit
p.361: “En entendant cet horribe arrêt exprimé par un mot (et quel mot? Et de quel accent fut-il accompgné?)…”
“Il faut un miracle pour que cet écrivain produise une œuvre, de même que l’amour pur et noble exige”
100
courtisanes]
Asie “En voyant ce monstre paré d’un tablier blanc sur une robe de stoff, Esther eut le frisson.” [Les Courtisanes]
Bertall
Tamisier
Portrait
Page de droit
p.387: “Esther et Lucien reparurent, et la pauvre fille dit, sans oser regarder l’homme mystérieux…”
“…une lueur étouffée entre ses petits cils pressés partit comme la flammèched’un incendie sur Lucien, qui, vêtu d’une magnifi-“
Le Baron de Nucingen “Le baron teignit ses cheveux et ses favoris…….fit une toilette de marié……” [Splendeurs et misères des courtisanes]
Bertall (?)
A. Castan
Portrait
Page de droit
p.451: “- Du la guedderas, ajouta-t-il, et du la veras monder tans ma jampre…”
“- Monsieur, dit Georges, voici mademoiselle Eugénie. - Attieu, montame…s’écria le banquier. Il reconduisit sa”
101
VOL. XII (1846) : ÉTUDES DES MOEURS, SCÈNES DE LA VIE PARISIENNE,
QUATRIÈME LIVRE, ET SCÈNES DE LA VIE POLITIQUE
Œuvre N. Pages
Titre illustration et didasc
alie
Illustrateur
Graveur
Type d’illustration
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières
lignes du
texte à côté
Dernières
lignes du
texte à côté
Note(s)
TROISIÈME PARTIE SPLENDEURS ET MISÈRES DES COURTISANES
1-96
-
UNE PRINCE DE LA BOHÈME
97-126
-
ESQUISSE D’UN HOMME D’AFFAIRES D’APRÈS NATURE
127-144
-
GAUDISSART II
145-154
LES COMÉDIENS SANS LE SAVOIR
155-208
Sylvestre Gazonal “Trop bien mis pour la circonstance.”
Bertall Ad. Soupey sc.
Portrait
Page de gauche
p.155: Dédicace “A monsieur le Comte Jules de Castellane.”
“…ses toiles sont payées au poids de l’or, et, ce qui lui semble plus extraordinaire que d’être invité”
Madame Nourri
Bertall F. Leblanc
Portrait
Page de droit
p.172: “Si vous
“…à l’hauteur où
102
sson “revendeuse à la toilette.”
vouliez y passer dans un moment, vous pourriez faire un fameux marché?...”
vous êtes logés, l’on marchande encore moins une dot. – Voyons, dit-“
SCÈNES DE LA VIE POLITIQUE
UN EPISODE SOUS LA TERREUR
209-225
-
UNE TÉNÉBREUSE AFFAIRE
226-408
Michu “Le régisseur de Gondreville.”
Bertall Timms
Portrait
Page de droit
p.230: “en fer qui présentent leurs innombrables piquants aux malfaiteurs.”
“…avec leur belle devise: Si meurs! La mer, vêtue en paysanne, avait mis s chaise devant”
Peyrade “Il devait être quelque personnge
Bertall F. Leblanc
Portrait
Page de droit
p.238: “percés comme ceux des cochons et d’une
“Il concevait, l’autre exécutait ; il était l’idée, l’autre
103
officiel…”
implacable avidité, d’une cruauté…”
était la forme.”
Z. MARCAS
409-433
-
L’ENVERS EL’HISTOIRE CONTEMPORAINE
434-531
Godefroid “offrait ce visage qui se rencontre chez tant d’hommes qu’il est devenu le type parisien.”
Bertall Reviere sc.
Portrait
Page de droit
p.440: “ment blessé, assez d’esprit pour faire en lui-même des élégies pleines de fiel.”
“Espérant y trouver un asile où ses dépenses pussent être fixées, où il pût jouir de la solitude nécessaire à un”
Madame de la Chanterie “Elle avait un visage douceâtre, à teintes à la fois molles et froides…”
Bertall P. Soyer
Tra scène et portrait
Page de droit
p.444: “Cette partie de l’île qui se nomme le Cloître a conservé le caractère commun à tous les cloîtres,…”
“…et une jolie chaîne de montre passée dans une des boutonnières de sn gilet de soie noire à fleurs bleues. Madame”
104
VOL. XIII (1845) : ÉTUDES DES MOEURS, SCÈNES DE LA VIE MILITAIRES
ET SCÈNES DE LA VIE DE CAMPAGNE : 1ER TIRAGE PARU SANS
IMAGES.
Il recueillit : Scènes de la vie militaire : Les Chouans (1-290) ; Une Passion dans le désert (291-303).
Scènes de la vie de campagne : Le Médecin de campagne (304-509) ; Le Curé de village (510-728).
105
VOL. XIV (1845) : ÉTUDES PHILOSOPHIQUES
Œuvre N. Pages
Titre illustration et didasc
alie
Illustrateur
Graveur
Type d’illustration
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières
lignes du
texte à côté
Dernières
lignes du texte à côté
Note(s)
LA PEAU DE CHAGRIN
1-224
Page initiale avec ligne serpentine [Sterne, Trsistram Shandy, ch. CCCXXII]
Le marchand de curiosités “Une barbe grise et taillé en pointe cachait le menton de cet être bizarre.”
Lavieille
- Portrait
Page de droit
p.20: “noire. La nuit, l’heure de mourir était subitement venue. Il s’écoula, dès ce moment, un certain laps…”
“Les lèvres de cet homme étaient si décolorées, si minces, qu’il fallait”
Raphael “Son regrd attestait des efforts trahis, mille espérances trompé
Lavieille
- Portrait
Page de gauche
p.23: “Cette peinture inspirait une prière, recommandait le pardon, étouffait l’égoîsm
“…ou vous trouvez -vous obligé de composer des flons flons pour
106
es !” e…” payer le convoi de votre maîtresse ? N’auriez-vous pas plutôt la maladie de l’or ? Voulez-vous”
Euphrasie, Aquilina “Un poète eût admiré la belle Aquilina ; le monde entier devait fuir la touchante Euphrasie.”
Lavieille
- Scène-Portrait
Page de gauche
p.53: “grec, sublime à ditance, mais grossière à vor de près. Néanmoins, s fondroyante…”
“Tais-toi, Aquilia ! Le femmes n’ont-elles pas toutes un amant à pleurer ; mais toutes”
Pauline “Un jeune chat, accroupi sur la table, se laissait barbouiller de café par Pauline; elle folâtrait avec lui, défenda
T. Johannot
- Scène Page de droit
p.78: “faire, comme un enfant, ricocher des cailloux sur l’eau, je suis resté constamment assis, une plume à
“Insensiblement Pauline s’impatronisa chez moi, voulut me servir et s mère ne s’y opposa”
107
it la crème qu’elle lui permettait à peine de flairer…..”
la main ;”
Foedora “Était étendue sur un divan, les pieds sur un coussin ; un béret oriental avait ajouté je ne sais quel piquant attrait d’étrangeté à ses séductions.”
T. Johannot
- Portrait
Page de droit
p.90: “ “Si d’abord, animé d’une volonté ferme et du désir de me faire aimer, je pris un peu d’ascendant sur”
JÉSUS CHRIST EN FLANDRE
225-240
-
MELMOTH RÉCONCILIÉ
241-282
Castanier “Il prit dans la caisse cinq cent mille francs
Bertall Tamisier sc.
Portrait-scène
Page de gauche
p.245: “sez aristocrate pour porter de vieux habits. Mais il n’est pas
“…et qui sans doute était entré par la porte du couloir que
108
en billets et bank-notes.”
rare de voir les gens qui liardent sur des riens…”
Castanier aperçut toute grande ouverte. L’ancien militaire éprouva, pour la pre-“
Madame Euphrasie “Cette bonne et belle fille était l’objet de l’ambition d’un clerc de notaire…..”
T. Johannot
A. Bejouet
Portrait
Page de droit
p. 259: “- Enfin, si je pars, me suis-tu? Demanda-t-il.”
“Mais alors dînons ! Tu as un bon petit dîner, tous plats de ton goût.”
LE CHEF-D’OEUVRE INCONNU
283-307
Maître Frenhofer “Le visage était d’ailleurs singulièrement flétri……”
Bertall P. Soyer
Portrait
Page de droit
p.296: “trop bien gardés pour que nous puissions y arriver. Je n’ai pas attendu votre avis et votre fantaisie…”
“Nicolas Poussin revint à pas lents vers la rue de la Harpe, et dépassa sans s’en apercevoir la modeste hôtellerie où il était logé.”
LA RECHERCHE DE L’ABSOLU
308-476
Balthazar Claës “Il paraissait âgé
Bertall F. Leblanc
Portrait
Page de droit
p.320: “galerie au parloir. Au
“Il était impossible de ne pas être
109
de plus de soixante ans, quoiqu’il en eût environ cinquante.”
retentissement de ce pas, l’être le plus inattentif eût été assailli de pensées, car il était impossible…”
profondément impressionné parce chef de la famille Claës. Jeune, il avait dû ressembler au”
Lemulquinier “Avait conçu pour son maître un sentiment superstitieux mêlé de terreur, d’admiration et d’égoïsme”
- - Portrait
Page de droit
p.432: “et les enfants réunis. Malgré sa réserve, le jeune proviseur… ”
“Au moment où Margaerite faisait son avant-dernière voyage de”
110
VOL. XV (1845) : ÉTUDES PHILOSOPHIQUES, T.II
Œuvre N. Pages
Titre illustration
et didascalie
Illustrateu
r
Graveu
r
Type d’illustration
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières
lignes du
texte à côté
Dernières
lignes du
texte à côté
Note(s)
MASSIMILLA DONI
1-73
-
GAMBARA
74-128
-
L’ENFANT MAUDIT
129-219
Le comte d’Hérouville
Bertall
- Portrait
Page de gauche
p.143: “cousse électrique. – Bertrand, ajouta le comte en posant la main droite sur le bras de l’écuyer, tu quitteras ta cuirasse…”
“Il serra autour de ses reins un large ceinturon de cuir dans la gaîne duquel il passa une dague qu’il ne portait pas habituellement. Ces misérables vêtements”
Gabrielle “Son front était rêveur, souvent étonné, riant
Bertall
Breviere s.
Portrait
Page de gauche
p.193: “mince sans être plat ; sur son cou et sur son front couraient des filets
“En admirant ces fleurs, qui semblent faites pour nous, je me demandais pour
111
parfois, et toujours d’une auguste sérénité.”
bleuâtres qui y dessinaient des nuances semblables à celles de l’agate…”
qui nous sommes”
LES MARANA
220-274
Juana “C’était une figure blanche, où le ciel de l’Espagne avait jeté quelques légers tons de bistre.”
Bertall
- Portrait
Page de gauche
p.227: “- Allons, dit la femme en pâlissant, que tous les saints nous assistent ! Et qu’il ne soit pas arrivé de malheur.”
“Ces boucles luxuriantes mettaient en relief des yeux brûlants, et les lèvres rouges”
ADIEU 275-314
Cette femme semblait ensevelie dans une méditation profonde.
Bertall
F. Leblanc
Portrait
Page de gauche
p.283: “- Ton nom ? Lu dit Philippe en l contemplant fixement comme s’il eût voulu l’ensorceler.”
“Elle laissa échapper un cri douloureux, et se leva tout à fait sur”
LA RÉQUISITIONNAIRE
315-329
-
112
EL VERDUGO
330-339
-
UN DRAME AU BORD DE LA MER
340-358
-
L’AUBERGE ROUGE
359-390
-
L’ÉLIXIR DE LONGUE VIE
391-412
-
MAÎTRE CORNELIUS
413-467
-
SUR CATHERINE DE MÉDICIS
468-660
Christophe “Était bien le peuple qui se dévoue, qui se bat, et qui se laisse tromper.”
Bertall
Breviere
Portrait
Page de droit
p.514: “Christophe Lecamus représentait bien la portion ardente et dévouée du Peuple : sa figure pâle avait…”
“Ses muscles vivaces étaient faits à se taire aussi bien qu’à parler. Il avait l’air plus audacieux que noble. Son”
Théodore de Bèze “était vêtu comme un courtisan…”
Bertall
F. Leblanc
Portrait
Page de gauche
p.646: “peuple parisien qui mérite parfaitement ce travestissement
“Le duc de Guise, qui toisait Chaudieu, regarda fixemen
114
VOL. XVI (1846) : ÉTUDES PHILOSOPHIQUES ET ÉTUDES ANALITIQUES
Œuvre N. Pages
Titre illustration et didasc
alie
Illustrateur
Graveur
Type d’illustration
Côté de la page illustrée (droite/gauche)
Premières
lignes du
texte à côté
Dernières
lignes du
texte à côté
Note(s)
SUR CATHERINE DE MÉDICIS, DEUXIÈME PARTIE
1-78
Laurent Ruggieri “Sa figure sévère, où deux yeux noirs jetaient une flamme aiguë, communiquait le frémissement du génie sorti de s profonde solitude.”
Bertall Baulant
Portrait Page de gauche
p.1: “Entre onze heures et minuit, vers la fin du mois d’octobre 1573, deux Italiens de Florence, deux frères, Albert de Gondi…”
“…que l’on peut comparer la politique intérieure de la France à un écheveau de fil brouillé, ces deux Flo-“
LES PROSCRITS
79-108
Godefroid “Au premier coup d’œil vous eussiez cru voir un enfant ou quelque jeune
Bertall F. Leblanc
Portrait Page de gauche
p.79: Dédicace à “Alme Sorori”
“Une ouverture ronde éclairait le grenier dans lequel la femme du sergent faisait
115
fille déguisée.”
sécher le”
LOUIS LAMBERT
110-207
Louis Lambert “ Il se tenait début, les deux coudes appuyés sur la saillie formée par la boiserie…..”
B. - Portrait Page de gauche
p.110: Dédicace “Et nunc et semper dilectae dicatum”
“A cette époque, les remplaçant étaient rares ; déjà plusieurs familles riches les retenaient d’avance pour n’en pas man-“
SÉRAPHÎTA
208-333
M. Becker “Lisait un in-folio, placé sur d’autres livres comme sur un pupître.”
Bertall Baulant
Scène-Portrait
Page de droit
p.208: Dédicace “A Madame Éveline de Hanska”
“…longue dentelle de granit où mugissent incessamment les flots de la mer du”
ÉTUDES ANALYTIQUES
PHYSIOLOGIE DU MARIAGE
334-620
Une femme honnête
Bertall P. Soyee
Portrait Page de gauche
p.361: “MEDI
TATION
III. DE
LA
FEMME
HONNE
TE. La
“Se promener, c’est végéter ; flâner, c’est vivre.
116
Méditation précédente a démontré…”
La jeune et jolie femme, long-temps”
Le Célibataire
Bertall Baulant
Portrait Page de gauche
p.449: “Méditation XII. Hygiène du mariage. Cette Méditation a pour but de sommetttre à votre attention…”
“…cette vigueur de pensée, cette énergie complète qui vous rendaient l’existence légère et douce quelques mois auparavant ?”
pp. 563-564: jeu de caractères effacés dans le paragraphe sur la religion
117
Catalogue de La Comédie humaine
Annexe 10 : Catalogue des éditions illustrées des œuvres composant les
Études sociales
Scènes de la vie privée
La Maison du chat-qui-pelote
Titre Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
MdCqP Paris, L. Carteret
1899 Louis Dunki Maurice Baud (graveur sur bois)
Ill In-8
MdCqP Paris, éditions Art et Pensée
1924 Quint (lithographies)
Couv ill Portrait de Balzac en couleurs par Quint en couv (lithographie) Ill
In-8
MdCqP Paris, R. Simon
1937 Couv ill en coul
MdCqP Grenoble (impr), Chamonix, Jean Landru éditeur
1944 P.-G. Klein Ill vignettes et hors texte En couleurs
In-4
MdCqP Marseile, Paris, R. Laffont
1945 Benno Vigny Couv ill Ill
37 Litographies
MdCqP Paris, Flammarion
1996 Couv ill en coul Ill
MdCqP Paris, Librairie générale française
1999 Couv ill en coul Ill
MdCqP Paris, Gallimard ; coll. Gallimard Education
2004 Couv ill Ill
118
Le Bal de Sceaux
Titre Édition Date Illustrateur Graveur Type illustration
Note(s)
BdS Paris, E. Flammarion
s.d. Couv ill
Œuvres illustrées de Balzac. BdS
Clichy, impr. De M. Loignon
1867 Ill
BdS Alger, Editions de l’Empire
1944 Jeanne Cazes
Ill
BdS Paris, les Editions universelles
1945 Éliane Bonabel
Ill
Scènes de la Vie privée. Le Bal de Sceaux. Fac-similé de l'édition de 1830
Sceaux : Société d'Edition du Bulletin Municipal d'Information de Sceaux (SEBMIS)
1982 Ill
Ill. non originales (planches Maresq et gravures romantiques)
BdS Paris, Flammarion ; coll. GF, étonnants classiques
2001 Couv ill en coul Ill
BdS (livre jeunesse)
Paris, Gallimard jeunesse
2004 Couv ill en coul
BdS Paris, Hatier ; coll. Classiques
2005 Couv ill en coul Ill
Ill non originales
BdS Paris, Flammarion ; coll. GF, étonnants classiques
2006 Couv ill Ill
BdS Livre pour jeunesse
Paris, Gallimard-jeunesse ; coll. Folio junior
2009 Couv ill en coul
BdS Paris, Flammarion
2015 Couv ill en coul
119
Mémoires des deux jeunes mariées
Titre (MddJM)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
MddJM Paris, H. Béziat 1936 Couv ill
MddJM Paris, Presses de la Cité
1946 Jean Droit Vignettes 34 aquarelles
MddJM Tours, Arraault 1947 Tony Johannot Gustave Staal
Couv ill en coul + ill
MddJM Paris, Editions de la Bibliothèque mondiale
1957 Couv ill + ill
MddJM Paris, Le Livre de Poche
1969 Couv ill en coul
MddJM Paris, Garnier-Flammarion
1979 Couv ill en coul
MddJM Genève, éd. Famot
1979 Front. Vignette de titre 3 vignettes
MddJM Paris, Gallimard ; coll. Folio
1981 Couv ill en coul
MddJM Paris, POL 1992 Couv ill
MddJM Paris, Gallimard, coll. La bibliothèque
2002 Couv ill en coul
LA BOURSE
Titre (B)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
B Paris, L. Hachette, coll Bibliothèque des Chemins de fer. Littérature française
1953 Couv ill
B Paris, Magnard ; col. Classiques & contemporains : collège
2009 Couv ill en coul
120
Modest Mignon
Un Début dans la vie
Titre (DdlV)
Édition Date Illustrateur Graveur Type illustration
Note(s)
DdlV, 2 vol.
Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
DdlV Paris, Nouvelle librairie populaire
1902 Couv ill
DdlV Paris, F. Rouff éditeur ; coll. Nouvelle Collection nationale
1927 Ill
DdlV Paris, Flammarion
1991 Couv ill en coul
DdlV Paris, Gallimard
2003 Couv ill en coul
Titre (MM)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
MM Paris, Nouvelle Librairie populaire
1902 Couv ill
MM Paris, G. Barrie et fils
1902 Ill
MM Paris, H. Béziat ; Collection des écrivains illustres
1937 Couv ill
MM Paris, R. Simon 1937 Couv en coul
MM Paris, Le Livre de poche
1967 Couv ill en coul
MM Paris, Gallimard 1982 Couv ill en coul
MM Paris, Gallimard; col. Folio
1982 Couv ill en coul
121
ALBERT SAVARUS
Titre (AS)
Édition Date Illustrateur Graveur Type illustration
Note(s)
AS Paris, E. Flammarion 1901 Couv ill
AS Paris, Nouvelle librairie populaire
1902 Couv ill
AS s.l., Les bibliophiles comtois
1930 Charles Jouas
Ill
AS Besançon, Cêtre 1981 Couv ill Ill
AS Paris, Ed. Autrement, 1994 Couv ill en coul
AS Paris, Librairie générale française,
2015 Couv ill en coul
AS Paris, Le livre de poche; coll. Classiques
2015 Couv ill en coul
La Vendetta
Titre (V)
Édition Date Illustrateur Graveur Type illustration Note(s)
V Paris, F. Ferroud
1904 Adrien Moreau (aquarelle) ; Xavier Leseur (aquaf)
Ill
V: roman
Paris, Lausanne, J. Tallandier ; Collections du Livre national. Romans pour tous
1919 Couv ill
V Paris, Flammarion, coll GF, Etonnants classiques
1996 Couv ill en coul Ill
V Paris, Librairie générale française ; coll. Le livre de poche, Libretti 10 francs
2000 Couv ill en coul Ill
122
V Paris, Librairie générale française ; coll. Le livre de poche, Libretti, 1.50euro
2000 Couv ill Ill
V Paris, Gallimard ; coll. La Bibliothèque
2001 Couv ill en coul Ill
V Paris, Flammarion ; coll. GF, Etonnants classiques
2006 Couv ill en coul Ill
Une Double famille
Titre (DF)
Édition Date Illustrateur Graveur Type illustration
Note(s)
DF Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
DF Paris, Librairie générale française, Coll. le livre de poche, libretti, 2 euro
2010 Couv ill en coul
LA PAIX DU MENAGE
Titre (V) Édition Date Illustrateur Graveur Type illustration
Note(s)
PdM Paris, A. Fleury ; coll. Le Coffret de Sylvie
1946 Line Touchet Couv ill Ill
123
La Fausse maîtresse
Titre (FM)
Édition Date Illustrateur Graveur Type illustration
Note(s)
FM Paris, Rouff
1944 Couv en coul Front.
FM Bruxelles, Le Cri
1992 Couv ill en coul
FM Paris, Éd. Corps 16
1993 Couv ill en coul
FM Paris, Gallimard
2010 Couv ill en coul
Une Fille d’Ève
Titre (FdE)
Édition Date Illustrateur Graveur Type illustration
Note(s)
FdE Paris, E. Flammarion 1901 Couv ill
FdE Paris, impr. Paul Dupont ; F. Rouff, éditeur,
1927 Ill
FdE Paris, Editions Baudelaire
1965 Alain Girard
Couv ill en coul Ill
FdE Paris, Garnier-Flammarion
1965 Couv ill en coul
FdE Paris, Garnier-Flammarion
1967 Couv ill
La Grenadière
Titre (G) Édition Date Illustrateur Graveur Type illustration
Note(s)
G Paris, Henri Leclerc
1901 Alphonse Lalauze (ill) Adolphe Lalauze (aquaf)
Ill
G Tours, Arrault
1946 Charles Alexander Picart Le Doux
Couv ill + ill
La Grenadière suivi de La Grenadière, Malheur et
Paris, Le courrier balzacien
2010 Takeshi Fukazawa
Ill Edité à l'occasion de l'accrochage "Balzac en Ganimé : du manga à la Touraine, Maison
124
grâce de Balzac, 1er juillet au 25 septembre 2010 Les illustrations de cette édition sont empruntées à l'adaptation en ga-nime de la nouvelle de Balzac par MM. Fukuda et Fukazawa
125
La Femme abandonnée
Honorine
Titre (H)
Édition Date Illustrateur Graveur Type illustration
Note(s)
H Paris, E. Flammarion
1900 Couv ill
Titre (FA)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
Scènes de la vie privée. FA
Paris, R. Simon
1935 Couv ill en coul
FA Paris, Librairie générale française
2014 Couv ill en coul
FA Paris, Le Livre de poche ; coll. Libretti
2014 Couv ill en coul
126
Béatrix
Titre (B)
Édition Date Illustrateur Graveur Type illustration
Note(s)
B Paris, J. Rouff
1899ca Couv ill
B, 2 vol
Paris, Nouvelle librairie populaire
1902 Couv ill
B Paris, Flammarion
1905 Couv ill
Scènes de la vie privée. Béatrix
Porrentruy (Suisse), éditeurs des Portes de France
1947 Dantan Portr.
B Paris, le Club français du livre
1953 Ill
B Paris, Garnier frères
1962 Couv ill Ill
B Paris, Editions Gallimard et Librairie générale française, coll. Le Livre de poche Classique
1966 Couv ill en coul
B Paris, Garnier-Flammarion
1979 Couv ill en coul
B Paris, Gallimard
1979 Couv ill en coul
B Paris, Le Livre de poche
1966 et 2012
Couv ill en coul
B Paris, Flammarion ; coll. GF
1998 Couv ill en coul
B: le jeu de la mouche
Tours, l’Atelier de la Dolve
1999 Geneviève Besse
Ill en coul
12 fac-sim. en quadrichromie des Épreuves corrigées par
127
Balzac, provenant de la BM de Tours, 12 collages sur papier Japon et aquarelles
B Paris, Gallimard ; coll. Folio
2009 Couv ill en coul
B Paris, Librairie générale française ; coll. Le Livre de Poche
2012 Couv ill en coul
Gobseck
Titre (G) Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
Scènes de la vie privée. G
Paris, impr. de Morris
1854 Gr. In-8°
G Paris, E. Flammarion
1900 Couv ill
G (livre pour jeunesse)
Paris, Nathan
2013 et 2007
Couv ill en coul Ill
128
La Femme de trente ans
Titre (F30A)
Édition Date
Illustrateur
Graveur Type d’illustration
Note(s)
F30A Paris : Ed. du Vert-Logis; Coll. choisie
s.d. Couv ill
Scènes de la vie privée. La Femme de trente ans
Paris, impr. De Morris
1858 Gr. In-8°
F30A, 2 vol.
Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
Suite d’illustrations pour F30A
Paris, L. Carteret 1902 Alcide Théophile Robaudi
Henri Manesse
Gr. In-8° D’après catalogue BNF
F30A Paris, L. Carteret 1902 Alcide Théophile Robaudi
Georges-Henri Manesse
Ill
F30A Paris, E. Flammarion ; coll. Auteurs célèbres
1905 ca
Couv ill
F30A Paris, R. Simon 1935 Couv ill en coul
F30A Paris, Éditions du Vert-Logis
1936 Couv ill
F30A Paris, Gründ ; coll. La Bibliothèque précieuse
1936 Couv ill en coul
F30A Paris, Neveu-Brunier
1945 Pierre Noël Couv ill Ill en coul
F30A Monaco, L’intercontinentale d’édition ; coll. Les romans romantiques
1945 Marcel Chapuis
Ill
F30A Paris, Aubenas, éditions du Dauphin, Habauzit et cie
1945 Girard-Mond
Ill
Le rendez-vous
Tours, Arrault 1946 Charles Alexandre Picart Le Doux
Couv ill Ill
F30A Paris, M. Gasnier 1946 Jean Jacquemard
Ill
129
F30A Paris, S.E.P.E 1948 Jean Krillé Ill Jaquette illustrée en couleurs par C. Morin
F30A Paris, Garnier frères
1952 Couv ill
F30A Paris, Gründ ; Bibliothèque précieuse
1954 Couv ill en coul
F30A Paris, Nouvelle librairie de France
1958 Deusenry (bois gravés)
Ill
F30A Paris, Editions de la bibliothèque mondiale
1960 Bertall Ill Portr. en front.
F30A Paris, Garnier frères
1962 Ill
F30A Paris : Garnier-Flammarion ; coll. GF
1965 et 1977
Couv ill en coul
F30A Paris, Garnier frères
1965 Couv ill Ill
F30A Paris, Le Livre de poche
1967 Couv ill en coul
F30A Paris : J. Tallandier ; coll. Le Trésor des lettres françaises
1970 Portr.
F30A Genève : Éditions de Crémille ; [Paris], diffusion F. Beauval
1972 Couv ill en coul + ill
F30A Neuilly-sur-Seine : Saint-CLair ; [Paris], diffusion F. Beauval,
1975 Couv ill en coul + ill
F30A Paris, Gallimard 1977 Couv ill en coul
F30A Paris, Garnier 1985 Couv ill en coul + ill
F30A Paris, Gallimard 1989 Couv ill en coul
F30A Paris, Gallimard ; coll. Folio
1991 Controlla se couv ill
F30A Paris, Librairie générale française
1991 Couv ill en coul
F30A Paris, Presses pocket
1991 Couv ill en coul
130
Ill en n/b et coul
F30A Paris, Flammarion
1996 Couv ill en coul
F30A Paris, Librairie Générale Française
2003 Couv ill en coul
F30A : 1834
Paris, Hatier 2006 Couv ill en coul Ill
F30A Paris, Flammarion
2010 Couv ill en coul
F30A Paris, Gallimard 2016 Couv ill en coul
Le Père Goriot
Titre (PG)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
PG Paris, Les grands classiques illustrés
? Ill
PG Paris, Nelson
s.d. Jacquett ill en coul
PG Verviers (Belgique), Gerfaut,
s.d. Couv ill en coul
PG, 2 vol in-16
Paris, E. Flammarion
s.d. Couv ill
PG Paris, Larousse
s.d. Ill
PG Bruxelles, A. Wahlen
1835 Figure au titre
PG, 2 vol.
Bruxelles, J. P. Meline
1835 Couv ill
(Le Père Goriot) : 6 vignettes illustrant le feuilleton paru dans "Le Voleur"
1860 Vignettes
Œuvres illustrées
Saint-Germain :
1876 Gr. In-8°
131
de Balzac. Le Père Goriot
impr. de D. Bardin
PG : Scènes de la vie parisienne
Paris, A. Quantin, coll. Calmann Lévy
1885 Albert Lynch (ill) Eugène-Michel-Joseph Abot (aquaf)
Ill
PG, 2 vol.
Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
PG, 2 vol.
Paris, Nouvelle librairie populaire
1902 Couv ill
PG Paris, Bibliothèque Larousse
1907 Portr. en front.
PG Paris, Société d’Editions Littéraires et Artistiques
1908 Albert Lynch
Ill
PG Paris, A. Lemerre
1910 Couv ill
PG Paris, Larousse
1911 Front.
PG Paris G. Crès et Cie ; Londres : J. M. Dent and sons; coll. Gallia
1913 Front.
PG Paris, Larousse
1919 Ill
PG Paris, Editions R. Kieffer
1922 Jean Quint Couv ill Ill en coul Aquarelle inédite
PG Paris, Larousse
1922 Ill
PG Paris, Hatier 1923 Couv ill
PG Paris, Larousse
1924 Ill
PG Paris, Hatier ; coll. Les classiques pour tous
1925 Couv ill
132
PG Paris, Editions Jules Tallandier
1930 et 1932
Varia (Bertall, Monnier, Gavarni, Lami, Johannot…)
Ill Vignettes en coul
PG Paris, Editions du Monde moderne
1930 Ill
PG Paris, Tallandier
1930 Gr. In-8° Ill non originales : ill romantiques
PG Paris, Editions Nilsson ; coll. La Bibliothèque précieuse
1932 Raffray Couv ill en coul Ill
PG Paris, éditions Jules Tallandier
1932 Gr. In-8 Gravures hors texte en couleurs, d'après les meilleurs artistes romantiques
PG Paris, Mornay, coll. Les beaux livres
1933 Antoine-François Cosÿns
Couv ill Ill
PG, 2 vol.
Paris, Larousse
1934 Couv ill
PG Paris, Hatier 1935 Couv ill
PG Paris, R. Simon
1935 Couv ill en coul
PG Paris, Gründ ; coll. La Bibliothèque précieuse
1935 Couv ill en coul Ill en coul
PG Paris, R. Simon
1936 Couv ill en coul
PG Paris, Editions du Vert-Logis
1936 Couv ill
PG Paris, Gründ ; coll. La Bibliothèque
1936 Couv ill en coul
133
précieuse
PG Paris, Henri Béziat ; Coll. Des écrivains illustres
1938 Couv ill
PG Paris : Gründ
1939 Couv ill en coul
PG Paris, SEN ; coll. Les Belles pages de France
1944 Couv ill Ill
PG Paris, Editions du Myrte
1944 Louis Muller
Ill
PG Paris, Chez l’artiste
1944 Maurice Berty (aquaf)
Ill
PG Paris, Editions littéraires de France
1946 Charles Genty (ill); Maccard (aquaf)
Delahaye (technicien graphique)
Ill
PG Paris, éd. Jacques Vautrain ; coll. Les Grands romanciers des XVIIIe et XIXe siècles
1946 J. M. Curutchet
Ill en coul
PG Paris, Editions du Chardon; coll. Chefs-d’oeuvres de toujours
1946 Couv ill en coul
PG Paris, Editions du Pré-aux-Clercs; coll. Relire
1946 Couv ill
PG Paris, R. Simon
1946 Claudel Couv ill en coul
PG Dijon, M. Jeanniard
1948 François-Martin Salvat
Ill lithogr.
PG Paris, Bordas, coll.
1949 Ill
134
Les grands maitres
PG Paris, Editions Athêna
1950 Theodore van Elsen
Couv ill en coul Ill en coul
PG Paris, Hachette
1951 Couv ill en coul Ill
PG Paris, A. Sauret, coll. Grand prix des meilleurs romans du XIXe siècle
1952 Pablo Picasso
Portr. de Balzac lithographié
PG : extraits 2 vol.
Paris, Larousse
1952 Couv ill en coul Front.
PG Paris, Editions La Bruyère
1952 Couv ill
PG Paris, Editions des Trois pommiers
1954 Couv ill en coul
PG Paris, le Club du meilleur livre,
1957 Couv ill
PG Verviers, Gérard et Cie
1957 Couv en coul
PG Paris, R. Laffont ; coll Les Cents chefs-d’oeuvre
1959 Paul Rudloff Couv ill Portr
PG Paris, Garnier frères
1960 Ill
PG Paris, Charpentier
1961 Cart ill Ill
PG Paris, Librairie générale française, Le Livre de poche
1961 Couv ill en coul
PG Paris, Gallimard,
1965 Couv ill en coul
135
Librairie générale française, coll. Gallia
PG Paris, J. Tallandier- coll. Le trésor des lettres françaises
1965 Cart ill Portr
PG Paris, Société nouvelle des Éditions G.P. ; coll. Super
1965 Jean Retailleau
Cart ill Ill en coul e b-n Vignettes et hors-t.
PG : morceaux choisis
Montréal, Paris, Bruxelles, Didier
1966 Couv ill Ill
PG Paris, Garnier frères
1966 Cart ill Ill
PG Paris, S.E.C.A.
1965 Cart ill Ill
Ill non originales
PG Paris, Garnier-Flammarion ; coll. GF
1966 Couv ill en coul
PG Paris, Hatier ; coll. Les classiques illustrés
1967 Couv ill en coul Ill
Ill non originales
PG Paris, Jules Tallandier ; Le Trésor des Lettres françaises
1967 Portr
PG Paris, Editions Baudelaire
1969 Couv ill en coul Ill
PG Paris, Éditions de l'Érable
1969 Cart ill Ill
PG Paris, Gallimard ; coll. Folio
1971 Couv ill en coul
PG Paris, Librairie
1972 Couv ill en coul
136
générale française
PG Paris, le Livre de poche
1972 Couv ill en coul Ill
PG Paris, Ministère de l'éducation nationale
1972 Ill
PG, 2 vol Paris, Larousse ; Nouveaux classiques Larousse
1974 Couv ill en coul Ill
PG Paris, Gallimard ; coll. Folio
1976 Couv ill en coul
PG Paris, Livre club Diderot
1977 Portr
PG Paris, Presses pocket
1978 Couv ill en coul
PG Paris, Garnier frères
1979 Couv ill en coul Ill
PG Genève : Famot, diffusion F. Beauval
1979 Ill
PG Paris, Garnier frères
1981 Couv ill en coul Ill
PG Paris, Librairie générale française
1983 Couv ill en coul
PG Paris, Magnard ; Collection Texte et contextes
1985 Champin Couv ill e coul Front.
PG Paris, Garnier frères
1986 Ill
PG Paris, Bordas
1987 Couv ill en coul Ill
PG Paris, Lattès 1988 Ill Jacquett ill
137
PG Paris, Presses pocket
1990 Couv ill en coul Ill
PG Paris, Gallimard ; coll. Folio
1990 Couv ill
PG Paris, Bookking international
1993 Couv ill en coul
PG Paris, Nathan
1994 Couv ill en coul Ill
PG Paris, Flammarion ; coll. GF
1994 Couv ill en coul
PG Paris, Nathan ; coll. Les grands classiques Nathan
1994 Couv ill en coul Ill
PG Evry, Ed. Carrefour ; Coll. Classique
1994 Couv ill en coul
PG Alleur (Belgique), Marabout ; [Paris], [diff. Hachette]
1995 Couv ill en coul
PG Paris : Librairie générale française
1995 Couv ill en coul Ill
PG Paris, Marabout
1995 Couv ill en coul
PG Paris, Le Livre de poche
1995 Ill
PG Paris, Flammarion
1996 Couv ill en coul
PG [Paris], Au sans pareil, diff. EDDL ; coll. La bibliothèque des chefs-d'oeuvre
1996 Couv ill en coul Ill
PG : Paris, 1997 Couv ill en
138
roman Hachette coul Ill
PG Paris, Presses de pocket
1998 Couv ill en coul
PG Evry, Ed. Carrefour ; Classique
1998 Couv ill en coul
PG Paris, Gallimard
1999 Couv ill en coul
PG Paris, Biotop ; Le trois-demi
1999 Couv ill en coul
PG Paris, les Éd. de la Seine
1999 Couv ill en coul
PG Paris, l'Aventurine ; coll. Classiques universels
2000 Couv ill en coul
PG Paris, Gallimard
2000 Couv ill en coul Ill
PG Paris, Larousse
2001 Couv ill en coul Ill
PG Paris, Librairie générale française, coll. Le livre de poche classique
2004 Couv ill en coul Ill
PG: 1835
Paris, Hatier 2004 Couv ill en coul Ill
PG Paris, Flammarion
2006 Couv ill en coul
PG (livre jeunesse)
Paris, l'École des loisirs
2006 Couv ill en coul
PG Paris, Larousse; coll. Petits classiques Larusse
2007 Couv ill en coul Ill
PG Paris : Éd. de Lodi
2008 Couv ill
PG Paris, 2009 Couv ill en
139
Flammarion coul Ill
PG (livre pour la jeunesse)
Paris, l’école des loisirs
2010 Couv ill en coul Ill
PG Paris, Larousse
2010 Couv ill en coul Ill
PG : histoire parisienne (texe du 1835)
Paris, H. Champion
2011 Couv ill
PG Paris, Gallimard
2011 Couv ill en coul
PG Montigny-le-Bretonneux, Yvelin édition
2011 Couv ill
PG Paris, Hachette éducation ; coll. Bibliolycée
2011 Couv ill en coul Ill
PG (livre pour la jeunesse)
Paris, Librairie générale française
2012 Couv ill en coul
PG Paris, Flammarion
2012 Séverine Scaglia
Couv ill en coul Ill
Le père Goriot : et autres textes sur le thème de l'argent (Livre pour la jeunesse)
Paris, Hatier 2013 Couv ill en coul
PG (livre pour la jeunesse)
Paris, Belin, Gallimard
2013 Couv ill en coul
PG : extraits 2 vol
Paris, Larousse
1972 et 1973
Couv ill en coul Ill
PG Paris, Gallimard
1972 et 1976
Couv ill en coul
140
PG (extraits choisis)
Paris, Magnard
1985 et 2016
Couv ill en coul Ill
PG Paris, Larousse
2001 et 2007
Couv ill en coul Ill
PG Paris, Gallimard jeunesse ; coll. Folio junior
2016 Couv ill
141
Le Colonel Chabert
Titre (CC)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
CC Paris, Ed. G. Ratier
19?? Couv ill en coul
CC Paris, E. Flammarion
1900 Couv ill
CC Paris, Société d'éditions "pour la Patrie"; Collection les chefs-d'oeuvre "en poche"
1918 Couv ill Ill
CC Paris, Edition pour les bibliophiles de Palais
1924 André Dignimont
Ill
CC Paris, Hatier ; coll. Les Classiques pour tous
1925 Couv ill
CC Paris, libr. Delagrave ; coll. Bibliothèque Juventa
1928 Ill
CC Paris, G. Briffault
1929 Fernand Hertenberger (aquaf)
Ill
CC Paris, René Kieffer
1930 André Mare Ill
CC Tours, impr.-édit. Mame
1938 A. F. Cosÿns Ill
CC Paris, La Tradition
1942 Charles Genty (aquaf)
Ill
Un sacrifice d'amour. Le Colonel Chabert
Paris, S.P.L.E
1943 Couv ill Ill
CC Paris, Neveu-Brunier
1944 P. Duteurte Ill
Un sacrifice
Paris, Société parisienne de
1944 Couv ill Ill
142
d'amour. Le Colonel Chabert
librairie et d'éditions
CC s.l, Joseph Floch
1944 Jean Pichard (lithogr)
Ill Vignettes et pl. hors-texte
CC Paris, Office français du livre, col. La renommée
1944 Pierre Leconte
Ill en coul
CC Paris, éditions du Dauphin, Habauzit et cie, coll. Bibliothèque classique
1944 Monique Vollant
Ill
CC Paris, Neveu-Brunier
1946 P. Duteurtre Couv ill Ill
CC Paris, Hatier 1947 Couv ill
CC Paris, F. Nathan
1948 Maurice Toissaint
Ill
CC Paris, Tournai, Casterman
1958 Fred Funcken Couv en coul Ill
CC Paris, Librairie Delagrave
1960 Pierre Rousseau
Couv ill en coul Ill
CC (livre jeunesse)
Paris, Nathan ; coll. Poche Nathan, Grands textes
1984 Couv ill en coul Ill
CC Paris, Nathan ; coll. Les Grands classiques Nathan
1990 Couv ill en coul Ill
CC Paris, Presses pocket ; coll. Lire et voir les classiques
1991 Couv ill en coul Ill
CC Paris, Ed. de la Seine ; coll. Succès du livre
1994 Couv ill
CC Paris, Librio 1994 Couv ill
143
CC Paris, Bordas ; coll. Bordas
1994 Couv ill en coul Ill
CC Paris, Flammarion
1994 Couv ill en coul
CC Paris, Ed. J’ai lu
1994 Couv ill en coul Ill
CC Paris, EJL ; coll. Librio
1994 Couv ill en coul
CC Paris, Gallimard ; coll. Folio
1994 Couv ill en coul
CC Paris, Librairie générale française
1994 Couv ill en coul Ill
CC Monaco ; [Paris] : Éd. du Rocher
1994 Couv ill
CC Paris, l’Archipel
1994 Couv ill en coul Ill
CC: roman
Lyon, Horvath
1994 Alain Bouldouyre
Couv ill en coul Ill
CC : texte intégral conforme au Furne corrigé de 1845
Paris, Hachette ; coll. Classiques Hachette : roman XIX siècle
1994 Couv ill en coul Ill
CC (livre jeunesse)
Ed. Carrefour ; coll. Classiques
1994 Couv ill en coul
CC Paris, Flammarion ; coll. Etonnants classiques
1995 Couv ill en coul Ill
CC Paris, Ed- J’ai lu ; coll. Classiques
1995 Couv ill en coul Ill
CC Paris, le Livre à la carte-Libris
1998 Couv ill en coul
CC Paris, Maxi- 1998 Couv ill en
144
livres-Profrance ; Classiques français
coul
CC Évry, Ed. Carrefour ; Coll. Classiques
1998 Couv ill en coul
CC Paris, Pocket 1998 Couv ill en coul
CC Paris, Gallimard ; coll. Folio
1999 Couv ill en coul
CC Paris, Grand caractère
2000 Couv ill
CC Paris, Gallimard
2002 Couv ill en coul
CC Hachette éducation, coll. Bibliocollège
2002 Couv il en coul Ill
CC Paris, Hatier 2002 Couv ill en coul Ill
CC : scènes de la vie privée
Paris, Pocket 2004 Couv ill
CC (livre jeunesse)
Paris. Hachette jeunesse ; coll. Lelivre de pche. Jeunesse. Classiques
2004 Couv ill en coul
CC : 1832
Paris, Hatier, coll Classiques et cie
2005 Couv ill en coul Ill
CC Paris, Maxi-livres
2005 Couv ill en coul
Le colonel Chabert : roman
Paris, Hachette
2007 Couv ill en coul
CC Paris, Flammarion ; Etonnants classiques
2007 Couv ill en coul Ill
CC Paris, Couv ill en
145
Gallimard ; coll. Foliothèque
coul
CC Paris, Flammarion
2009 Couv ill en coul
CC Paris, Gallimard, coll. Classico collège : texte intégral & dossier
2011 Couv ill en coul Ill
CC Paris, Flammarion
2011 Couv ill en coul Ill
CC Paris, Belin, Gallimard ; Classico collège
2011 Couv ill en coul Ill
CC : 1832
Paris, Hatier 2012 Couv ill en coul Ill
CC Paris, Magnard, coll. Classiques & Patrimoine
2012 Couv ill en coul Ill
CC : texte intégral (livre pour la jeunesse)
Paris, Hatier, coll. Classiques et cie, Collège
2013 Erwan Fagès Couv ill en coul Ill
CC (livre pour la jeunesse)
Paris, Flammarion, coll. Etonnants classiques
2013 Laurent Rivelaygue
Couv ill en coul Ill
CC Paris, Librio ; coll. Littérature
2013 Couv ill en coul
CC: roman (Livre pour la jeunesse)
Paris, Larousse
2013 Couv ill en coul
CC Paris, Belin, Gallimard ; Classico Lycée
2016 Ill
146
La Messe de l’Athée
Titre (MA)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
MA Paris, René Kieffer
1928 Antoine-Marius Martin (aquaf)
Ill
MA Paris, B. énav
1980 Jean Bernard (aquaf); Bension énav (lithog)
Fernand Mourlot (imprimeur)
Couv ill Ill
MA Paris, Editions Manucius ; coll. Littéra
2013 Couv ill Ill
L’Interdiction
Titre (I)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
I Paris, les Cent-une
1967 Claude Bogratchew (eaux-fortes)
Ill en coul
Le Contrat de mariage
Titre (CM)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
CM Paris, E. Flammarion ; coll. Auteurs célèbres
1902 Couv ill
CM Paris, Garnier-Flammarion
1966 Couv ill en coul
147
SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE
Ursule Mirouët
Titre (UM)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
UM Paris, A. Perche
s.d. Couv. ill
UM Alger, Office d'éditions et de publicité
s.d. Fig. au titre
UM Paris, E. Flammarion ; coll. Auteurs célèbres
1905 ca Couv ill
UM Paris, l'Adolescence catholique
1928 Malo Renault (1870-1938)
Front. Ill
UM Paris, Georges-Célestin Crès, éditeur ; coll. l'Adolescence catholique
1928 Malo Renault (1870-1938)
Couv ill Ill
UM Paris, Éditions du Vert-Logis
1936 Couv ill
Œuvres complètes. UM
Paris, H. Béziat ; Collection des écrivains illustres
1938 Couv ill
UM Paris, Garnir frères
1944 Couv ill
UM (2 vol.)
Paris, Monceau
1949 (BNF data 1947)
André-édouard Marty (1882-1974)
Ill
UM Paris, Garnier frères ; coll. Classiques
1952 Couv ill
UM : scènes de la vie de province
Paris, Club des jeunes amis du livre ; coll. Club des jeunes amis
1959 Cart. Ill Ill
148
du livre
UM Editons Baudelaire ; coll. Livre club des Champs-Élysées
1966 Cart. Ill Ill
UM Paris : le Livre de poche
1968 Couv ill en coul
UM (livre pour jeunesse)
Paris, Hachette ; coll. Grandes œuvres
1979 Célestin Nanteuil, Staal, Henri Monnier
Couv ill Ill
UM Paris, Gallimard
1981 Couv ill en coul
UM Paris, Gallimard ; coll. Folio
1991 Couv ill en coul
UM Paris, Flammarion
2013 Couv ill en coul
149
Eugénie Grandet
Titre (EG)
Éditeur Date
Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
EG Paris, Flammarion
s.d. Bigot-Valentin
Ill
EG Paris, imprimé pour les Amis des livres par Motteroz
1883 M. Dagnan-Bouveret
M. Le Rat (gravé à l’eauforte)
Ill.
EG Paris, A. Méricant
1900 ca
Edyck Couv ill Ill
EG, 2 vol Paris, Nouvelle librairie populaire
1902 Couv ill
EG (Édition abrégée à l'usage de la jeunesse)
Limoges, E. Ardant
1902 Gr. In-8°
EG Paris, Jules Rouff et Cie
1904 Couv ill
EG Paris, Larousse 1907 Front
EG Paris, Lafitte ; coll. Idéal-bibliothèque
1910 Couv ill en coul Ill
EG Paris, Larousse 1911 Portr.
EG Paris, F. Ferraud 1911 Auguste Leroux
Duplessis Froment Ernest Florian
Ill
Suite d'illustrations pour "Eugénie Grandet" d'Honoré de Balzac
Paris, Ferroud 1911 Leroux, Auguste
Florian, E. Duplessis Froment
Ill D’après un catalogue de la BNF
EG Paris, E. Flammarion
1911 Gr. In-8°
EG Paris, Blaizot, coll. Collection éclectique
1913 Brissaud, Pierre [Aquafortiste] Kieffer, René [Relieur]
Ill
150
EG (livre jeunesse)
Paris, Nelson 1917 Ill ?
EG Paris, Librairie Gedalge et cie
1921 Valérie Rottembourg
ill
EG Paris : Henri Laurens ; coll. Les grandes œuvres : pages célèbres illustrées
1922 René Prinet Couv ill en coul Ill
EG Paris, Larousse ; coll. Bibliothèque Larousse
1922 Portr.
EG Paris, Gedalge 1927 Valerie Rottembourg
Ill
EG Paris, éditions Jules Tallandier,
1927 Portr.
EG Paris, Editions Nilsson ; coll. La Bibliothèque précieuse
1932 Davanzo Couv ill en coul Ill
EG Turnhout (Belgique), impr. établissements Brepols ; Paris, libr. Garnier frères
1933 Charles Ducomet
Ill
EG Paris, Hachette 1934 André Pécoud
Ill
EG, 2 vol. Paris, Larousse ; coll. Classiques Larousse
1934 Couv ill
EG Paris : Société universitaire d'éditions et de librairie
1935 Maggie Salcedo
Ill
EG Paris, R. Simon éditeur
1935 Couv ill en coul
EG Paris, Editions du Vert-Logis ; Coll. choisie
1936 Couv ill
EG Paris, Gründ ; La Bibliothèque précieuse
1936 Couv ill en coul
EG Paris, les Belles éditions
1938 Couv ill en coul
EG, 2 vol Paris, A. Hatier ; Les classiques
1938 Couv ill
151
pour tous
EG Paris, Delagrave 1939 Pierre Rousseau
Ill
EG Tours, impr.-édit. Mame ; Collection 'Pour tous'
1939 Albert Uriet Ill
EG Paris : Gründ ; La Bibliothèque précieuse
1941 Couv ill en coul
EG Paris, chez l’artiste
1941 Maurice Berty
Elizabeth Lalau
Ill
EG Paris, Neveu-Brunier
1943 Pierre Noël Ill en coul
EG Etampes ; Paris : M. Gasnier ; Collection Jeunes de France. Pour les jeunes gens
1944 Georges Beuville
Ill
EG Paris, SEN ; (Sceaux, Seine, Impr. de Sceaux
1944 Couv ill Ill
EG Bruxelles, Éditions universitaires
1944 Thierry de Villers
Ill
EG Grenoble, Besson
1944 Traynier, Jean [Aquafortiste]
Ill en coul
EG Etampes, Paris, M. Gasnier
1945 Georges Beuville
Ill
EG Paris, éditions littéraires de France
1945 Charles Genty
Ill en coul
EG Monaco, L’intercontinentale d’édition
1945 Marcel Chapuis
Ill
EG
Lyon, A. Desvigne ; coll. Collection Joie et jeunesse
1945 Ill
EG Paris, G. Ratier 1946 J. Saunier Ill
EG Paris, R. Rasmussen
1946 Couv ill
EG Paris, les Éditions La Bruyère ; Collection des Chefs-d'œuvre
1946 Couv ill Ill
152
classiques
EG Tours, Arrault 1947 Charles Alexandre Piquart le Doux ; Georges Pichard
Couv ill Portr. Ill
EG Paris, R. Rasmussen ; coll. Reflets
1947 Couv ill
EG Paris, Londres, Edimbourg, Nelson éditeurs
1947 Couv ill en coul
EG (livre adapté pour jeunesse)
Paris, F. Nathan ; Oeuvres célèbres pour la jeunesse
1948 Cart en coul Ill
EG Paris : Bibliothèque Larousse ; Les Chefs-d'œuvre de Balzac
1949 Portr.
EG Paris, Delagrave ; Coll. Bibliothèque Juventa
1950 Pierre Lissac Couv en coul Ill
EG Paris, Delagrave ; coll. Les Chefs-d'œuvre littéraires.
1951 Pierre Rousseau
Couv ill Ill
EG Paris, Hachette 1951 Jaquette ill en coul
EG (livre adapté pour la jeunesse)
Paris, Société universitaire d'éditions et de librairie
1953 Maggie Salcedo
Couv en coul Ill
EG Verviers, Gérard & Co ; Coll. Marabout
1953 Couv ill en coul
EG Paris, Gründ ; Bibliothèque précieuse
1955 Couv ill en coul
EG Paris, Hachette, Bibliothèque verte
1955 André Hofer
Ill
EG Paris : Éditions du Panthéon ; Coll Pastels
1957 Claude Chopy (aquarelle)
Couv ill en coul Ill
EG Paris, Éditions de la Tour du guet
1957 Robert Bressy
Couv en coul
153
Ill
EG Paris, Tournai, Casterman ; Collection le Rameau vert
1957 François Craenhals
Ill
EG Paris : le Club du meilleur livre
1959 Ill
EG (livre adapté pur jeunesse)
Paris, Delagrave ; coll. Bibliothèque Juventa
1959 Couv en coul Ill
EG (livre pour la jeunesse)
Paris, G. P., coll. Spirale
1960 Pablo Coronado
Couv ill Ill, coul et b/n
EG Paris, O.D.E.J. ; Collection J.23
1960 Nardini Cart. Ill en coul Ill
EG Paris, Garnier frères
1961 Ill
EG (livre pour la jeunesse)
Paris, Hachette, coll Bibliothèque verte
1964 André Hofer
Couv ill en coul Ill
EG Paris, Garnier-Flammarion
1964 Couv en coul
EG Paris, le Livre de poche
1965 Couv ill en coul
EG Paris, Garnier frères
1965 Ill
EG Paris, Bordas ; Sélection littéraire Bordas
1965 Ill
EG, 2 vol. Paris, Larousse ; Nouveaux classiques Larousse
1965 Couv ill Ill
EG Paris, Ed. Baudelaire ; coll. Livre club des Champs-Élysées
1965 Couv ill en coul Ill
EG (livre pour jeunesse)
Paris, Société nouvelle des éd. G.P
1965 Félix Lacroix
Ill
EG Paris, Editions Baudelaire ; Livre Club des Champs-Elysées
1966 Couv ill Ill
EG Paris, Bordas 1966 Ill
EG Paris, Hatier ; coll. Les Classiques illustrés Hatier
1966 Couv ill Ill
154
EG Paris, Garnier frères
1966 Couv ill Ill
EG Paris, Editons Baudelaire ; coll. Livre club des Champs-Élysées
1967 Cart ill en coul Ill
EG (livre pur jeunesse ?)
Paris, Hatier 1968 Couv ill en coul Ill
EG Paris, Hatier ; Les classiques illustrés Hatier. 1ère série
1968 Ill en coul
EG (livre jeunesse)
Paris : Gautier-Languereau ; coll. Jeunes bibliophiles
1969 ca
Ill
EG Paris : Éditions de l'Erable
1969 Ill
EG Paris, J. Tallandier ; coll. Le Trésor des lettres françaises
1969 Ill
EG Saint-Ouen, Ed. Chaix-Desfossés-Néogravure
1969 Ill
EG Paris, Hachette ; coll. Textes en français facile. Série Récits
1971 Couv ill en coul Ill
EG Paris, Le Livre de poche
1972 Couv ill en coul
EG Paris, Gallimard ; coll. Folio
1972 Couv ill en coul
EG Paris, Garnier Frères
1979 Ill
EG Paris, Gallimard 1979 Ill
EG Bagneux, le Livre de Paris ; coll. Club pour vous Hachette
1979 Couv ill en coul Ill
EG, extraits
Paris, Hachette ; coll. Lectures pour les collèges
1979 Couv ill en coul Ill
EG : extraits
Pars, Bordas ; coll. Univers des lettres ; 446. Étude critique illustrée. Extraits
1980 Couv ill Ill
155
commentés
EG (livre pur jeunesse)
Paris, F. Nathan ; coll. Grand A
1980 Couv ill Ill
EG Paris, Librairie générale française ; coll. Le Livre de poche
1983 Couv ill en coul
EG Paris, Garnier frères
1983 Ill
EG (livre adapté pour jeunesse)
Paris, M. Vincent ; coll. Nuance
1984 Couv ill en coul Ill
EG Paris, Lattès 1989 Jaquette ill Ill
EG Paris, Presses pocket
1989 Ill en Coul et B/N
EG Laval, Kerdoré 1991 Couv ill en coul
EG Paris, Bordas 1991 Couv ill Ill
EG Bruxelles : Éd. Complexe
1993 Couv ill en coul
EG Paris, Booking interatinal ; Classiques français
1993 Couv ill en coul
EG (livre adapté pour la jeunesse)
Paris, Didier ; coll. Le français universel
1993 C. Maréchal (dessins)
Couv ill en coul Ill
EG Paris, Librairie générale française
1993 Couv ill en coul
EG Evry, Ed. Carrefour ; Coll. Classiques
1994 Couv ill en coul
EG Paris, Marabout 1995 Couv ill en coul
EG (1833), 2 vol.
Paris, Hachette ; Coll. Classiques Larousse
1995 Couv ill en coul Ill
EG Paris, Larousse 1993 Couv ill Ill
EG Alleur (Belgique) ; [Paris], Marabout
1996 Couv ill en coul
EG Paris, EDDL ; coll. Grands classiques
1996 Couv ill en coul
156
EG (livre pour jeunesse)
[Paris], Clé international ; coll Lectures Clé en français facile
1996 Couv ill Ill
1833. Eugénie Grandet : extraits
Paris, Nathan ; Les grands classiques Nathan
1996 Couv ill Ill
EG [Paris], Librairie générale française
1996 Couv ill en coul
EG Evry, Ed. Carrefour ; Coll. Classiques
1998 Couv ill en coul
EG (livre pour la jeunesse)
[Paris], Hachette jeunesse
1999 Couv ill Ill en coul
EG Paris, Pocket 1999 Couv ill en coul
EG Paris, Gallimard ; coll. Folio
1999 Couv ill en coul
EG (livre pur jeunesse)
Paris, Hachette jeunesse ; coll. Gai savoir
1999 Couv ill Ill
EG Paris, les Ed. de la Seine ; coll. Succès du livre
1999 Couv ill en coul
EG Paris, Flammarion
2000 Couv ill en coul
EG Paris, l’Aventurine ; coll. Classiques universels
2000 Couv ill en coul
EG Paris, Maxi-livres ; coll. Maxi-poche romans
2002 Couv ill en coul
EG Paris, Larousse ; coll. Petits classiques Larousse
2002 Couv ill en coul Ill
EG (livre jeunesse)
Paris, Hachette jeunesse ; coll. Le livre de poche. Jeunesse. Classique
2005 Couv ill en coul
EG Paris, Maxi-livres ; coll. Maxi-poche
2005 Couv ill en coul
157
romans
EG Rennes : la Maison des petits bonheurs ; coll. Œuvres immortelles
2005 Couv ill en coul
EG Paris, Nov’edit ; coll. Les chefs-d'œuvre de la littérature
2005 Couv ill
EG Paris, Hachette éducation
2007 Couv ill en coul
EG Bruxelles, Éd. Paperview ; Tours : "La Nouvelle République" ; coll. La bibliothèque de "La Nouvelle République"
2007 Jaquette ill
EG Paris, Flammarion
2008 Couv ill en coul
EG Paris, Ed. de Lodi
2008 Couv ill
EG (livre pour la jeunesse)
Paris, Hachette éducation, coll Bibliocollège
2012 Alain Boyer Couv ill Ill
EG Paris, Librairie Générale Française
2015 Couv ill en coul
EG Paris, Gallimard 2016 Couv ill en coul
EG Paris, Larousse s.d. Portr.
EG Paris, Nelson s.d. Jaquette illustrée en couleurs
EG Paris, Les belles éditions
s.d. Couv ill en coul
EG Paris, Lafitte s.d. Géo Dupuis Ill
EG (livre de jeunesse)
Paris, Librairie Garnier Frères
s.d. Charles Ducomet
Couv ill Ill
EG Paris, Editions du Vert-Logis
s.d. Couv ill
EG Paris, Lafitte ; coll. Idéal-Bibliothèque
s.d. G. Dupuis Couv ill en coul Ill
158
Pierrette
Titre (P) Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
P Paris, Garnier-Flammarion
1967 Couv ill en coul
P (livre pour la jeunesse)
Paris, Librairie Gedalge ; Coll. Aurore
1926 Valérie Rottembourg
Ill
P Paris, bureaux du "Siècle"
1853 Gr. In-8°
P Paris, Nouvelle librairie populaire
1903 Couv ill
P Paris, libr. Delagrave ; coll. Bibliothèque Juventa
1930 M. Lecoultre Ill
P Paris, les Belles Editons
1937 Couv ill en coul
P Paris, Libr. Gedalge
1907 Rottembourg, Valérie
Couv ill Ill
Le Curé de Tours
Titre (CdT)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
CdT Paris, G. Ratier
s.d. Couv ill en coul
CdT Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
CdT Paris, Maurice Glomeau éditeur
1922 R. Placeck Ill
CdT Paris, le Livre
1923 Ill
CdT. Scènes de la vie de province
Paris, R. Kieffer
1925 Max Camis Ill
CdT Paris, Marcel
1933 Jean-Paul Dubray
Portr.
159
Seheur
CdT. Texte intégral
Paris, Les Belles éditions
1938 Couv en coul
CdT Paris, G. Ratier
1943 Couv ill
CdT Lyon, éditions de Savoie
1946 J.-A. Carlotti
Ill
CdT Tours, Arrault
1947 Georges Pichard
Ill (aquarelles)
CdT Tour, Arrault et cie
1947 Arrault (aquaf), Henry Monnier, Charles Alexandre Picart le Doux ; Gilbert Riche
Ill
CdT Paris, Pocket ; coll. Classiques
1999 Couv ill en coul
La Rabouilleuse
Titre (R) Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
La Rabouilleuse. Les Célibataires
Paris, L. Borel
1900 Hermann Vogel
Portr.
R Paris, Larousse
1918 Portr.
R : les célibataires
Paris, A. Michel
192 ? H. Vogel Ill
R Paris, Gründ 192 ? Claude Chopy
Couv ill Front. Ill
R. Scènes de la vie de province
Paris, le Livre moderne, Boivin et Cie, Editeurs
1923 Charles Genty
Ill en noir
R Paris, Mornay 1931 Ferdinand Fargeot
Couv ill en coul Ill
160
R, 2 vol. in-16°
Paris, H. Béziat ; coll. Collection des écrivains illustres
1936 Couv ill
R Paris, les Belles Editons
1938 Couv ill en coul
R Paris, Les belles éditions
1939 Couv ill en coul
R Paris, Gründ ; Collection Gründ illustrée, première série
1943 Claude Chopy
Couv ill en coul Ill
R Paris, la Bibliothèque française
1946 Couv ill Ill
R Paris, S.E.P.E, coll. Lectures de Paris
1947 Georges Vial
Ill
R Lausanne, La Guilde du livre
1949 Front.
R Paris, Larousse
1949 Front.
R Paris, le Livre Club du libraire
1959 Henri Landier
Ill
R Paris, Garnir frères ; coll. Classiques
1959 Ill
R Paris, Le Livre de poche
1960 Couv ill en coul
R, 2 vol. Paris, Gründ ; coll. Bibliothèque précieuse
1960 Couv ill en coul
R Paris, Club des amis du livre ; coll. Le Meilleur livre du mois
1961 Cart. Ill en coul Ill
R Paris, A. Michel
1963 Cart. Ill Ill
R Paris, Librairie
1964 Couv ill en coul
161
générale française
R Strasbourg, Sélection des amis du livre ; Sélection des amis du livre
1964 Cart ill
R Paris, Editions Baudelaire
1965 Alain Girard
Couv ill en coul Ill
R Paris, Garnier frères
1966 Couv ill Ill
R Paris, O.D.E.J. - presse
1966 Cart. Ill Ill
R Paris, Gallimard
1972 Couv ill en coul
R Paris, Librairie générale française, classique poche
1972 Couv ill en coul Ill
R Paris, le Livre de poche ; coll. Classiques
1972 Couv ill en coul Ill
R Paris, Librairie générale française
1983 Couv ill en coul Ill
R Paris, Gallimard ; coll. Folio
1992 Couv ill en coul
R Paris, Pocket 1993 Couv ill en coul
R Paris, Flammarion
1994 Couv ill en coul
R Paris, Booking International ; coll. Classiques français
1994 Couv ill en coul
R : scènes de la vie de province
Issoudun, Arts et loisirs
1999 Charles Genty (1976-1956)
Ill Fac-sim. de l'éd. de Paris,
162
le Livre moderne, 1923
R Paris, Pocket ; coll. Classiques
1999 Couv ill en coul
R Paris, Gallimard
2008 Couv ill en coul
R Paris, Flammarion
2009 Couv ill en coul
Les Célibataires
Titre (C)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
Scènes de la vie de province. C (Pierrette, Le Curé de Tours, Un ménage de garçon)
Paris, Impr. Des arts et manufactures
1889 Gr in-8°
163
L’Illustre Gaudissart
Titre (IG)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
IG Paris, éditions H. & R.
1945 V. Néchoumoff
Ill
IG Tours, Arrault
1947 Charles Alexandre Picart le Doux
Couv ill Ill
IG Paris, Garnier
1970 Couv ill Ill
La Muse du département
Titre (MdC)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
MdD Paris, Le Livre
1924 Pierre Falké Ill
La Vieille fille
Titre (VF)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
VF Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
VF Paris, Nouvelle librairie populaire
1903 Couv ill
VF Paris, éditions Kra, coll. Poivre et sel
1930 Georges Beuville
Ill
VF Paris, René Kieffer
1931 Emilien Dufour
Ill
VF Paris, Gründ ; coll. La Bibliothèque précieuse
1939-1940
Couv ill en coul
VF Paris, Garnier frères ; coll. Classiques
1957 Ill
VF Paris, Editions
1967 Couv ill en coul
164
Baudelaire Ill
VF Paris, Gallimard ; coll. Folio
1978 Couv ill en coul
VF Paris, Librairie générale française
1987 Couv ill en coul
Le Cabinet des Antiques
Titre (CdA)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
CdA Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
CdA Paris, Garnier frères
1958 Ill
CdA Paris, Editions Baudelaire ; coll. Livre club des Champs-Élysées
1966 Cart ill en coul Ill
CdA Paris, Garnier ; coll. Classiques
1985 Couv ill Ill
CdA Paris, Gallimard
1999 Couv ill en coul
165
Illusions perdue
Titre
(IP)
Édition Date Illustrateur Graveur Type
d’illustration
Notes (s)
IP Genève, C.
Bourquin Les
éditions du
cheval ailé,
coll. Œuvres
immortelles
1945 Paul
Monnier
Portr.
IP Paris, Imprimerie Nationale
1950 Ill
IP Paris, les Éditeurs français réunis
1954 Jacquette ill
Illusions
perdues :
études de
mœurs au
XIXe
siècle,
1821
Paris, Cub des
libraires de
France
1957 Ill
IP, 2 vol. Paris, le Club du meilleur livre
1957 Couv en coul Ill
IP, 3 vol. Paris, Club des
amis du livre
1960 Cart ill Portr. Ill
IP Verviers, Gérard et Cie
1961 Couv ill
IP Paris, Garnier frères
1961 Ill
IP Paris, le Livre de poche
1962 Couv ill en coul
IP, 2 vol. Paris Larousse 1963 Couv ill en coul
IP Paris, Gründ ; Grand écran littéraire.6
1965 Claude Robert
Cart. Ill Ill
IP : extraits
Paris, Typogr. P. Gaudin
1965 Pierre Gaudin
Ill
IP Paris, Garnier-
Flammarion
1966 Couv ill en
coul
IP Paris, le Livre
de poche
1966 Couv ill en
coul
IP Paris, Garnier 1967 Couv ill
166
frères Ill
IP, 2 vol. Paris, J. Tallandier ; coll. Le Trésor des lettres françaises
1969 Portr
IP Paris, Garnier ; coll. Classiques
1969 Couv ill Ill
IP, 2 vol. Paris, Rombaldi ; coll. Le Club des classiques
1971 Ill
IP Paris,
Gallimard
1972 Couv ill en
coul
IP Paris, le Livre de poche
1972 Couv ill en coul
IP Paris, Librairie
générale
française, le
livre de poche
1972 Faucheux,
Pierre
Couv ill en
coul
Illusions
perdues :
extraits, 2
vol.
Paris,
Larousse ;
Nouveaux
classiques
Larousse.
Spécial
documentation
thématique
1973 Couv Ill
Ill
IP Paris, Garnier
frères,
1975 Couv Ill
IP, 2 vol. Paris,
Gallimard
1976 Couv ill en
coul
IP Paris, Gallimard ; coll. Folio
1981 Couv ill en coul
IP Paris, Librairie
générale
française
1983 Couv ill en
coul
IP Paris,
Flammarion
1990 Couv ill en
coul
IP Paris, Presses pocket ; coll. Lire et voir les classiques
1991 Ill
IP Paris, Booking international ;
1993 Couv ill en coul
167
coll. Classiques français
IP Alleur (Belgique) ; [Paris], Marabout ; coll. Bibliothèque Marabout
1995 Couv ill en coul
IP Paris, EDDL ; coll. Grands classiques
1996 Couv ill en coul
IP Paris, Pocket ; coll. Classiques
1999 Couv ill en coul
IP Paris, Librairie
générale
française, Le
livre de Poche
2006 Couv ill
IP Paris, Flammarion (éd. Mise à jour)
2007 Couv ill en coul
IP Paris, Le
Figaro
2009 Ill
IP Paris, Flammarion ; coll. GF (éd. Mise à jour)
2010 Couv ill en coul
IP : "Les deux poètes", du manuscrit à l'édition "Furne corrigé"
Lagrasse, Verdier ; coll. Collection Fondation Empreinte
2010 Couv ill
IP Paris,
Gallimard
2013 Couv ill en
coul.
IP Paris, Gallimard ; coll. Folio
2014 Couv ill en coul
168
SCÈNES DE LA VIE PARISIENNE
Ferragus
Titre (F)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
Ferragus, histoire des Treize
Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
Ferragus Paris, Nouvelle librairie populaire
1903 Couv ill
Histoire des Treize : Ferragus chef des Dévorants
Paris, Ed. Bossard
1926 Antoine-François Cosÿns
Achille Ouvré ; Antoine-François Cosÿns
Ill Portr. Front.
F chef des dévorants
Paris, Rombaldi
1945 Camille Berg
Couv ill Ill en pointes sèches
F chef des dévorants
Paris, EJL ; coll. Librio
1998 Couv ill en coul
F chef des dévorants
Paris, Gallimard ; coll. La bibliothèque Gallimard
1998 Couv ill en coul Ill
F chef des dévorants
Paris, Gallimard ; coll. Folio
2001 Couv ill en coul
F chef des dévorants (livre pour jeunesse)
Paris, Flammarion ; coll. Etonnants classiques
2003 Couv ill en coul Ill
F (livre pour la jeunesse)
Mont-Royal (Québec), Groupe Modulo, coll. Bibliothèque la Lignée
2006 Ill
F chef des dévorants
Paris, Flammarion
2007 Couv ill en coul
169
La Duchesse de Langeais
Titre (DdL)
Édition Date Illustrateur
Graveur Type d’illustration
Note(s)
DdL, 2 vol.
Paris, Editions de la Caravelle
s.d. Roger Foirier
Ill
DdL Paris, Société centrale d'achat
s.d. Couv en coul
Histoire des treize. DdL
Paris, libr. Plon, les Petits-Fils de Plon et Nourrit
1928 Ill Illustré d’après le film de la « Pax film »
DdL Paris, Rombaldi
1940 André E. Marty
Ill en couleur
DdL. Extraits, 2 fasc.
Paris, Ed. de la Caravelle
1942 Couv ill Ill
DdL Paris, Rombaldi ; coll. Ingres
1942 Couv ill Ill
DdL Paris, G. Ratier
1946 G. Get Ill
DdL Paris, M. Gasnier
1947 Jacques Roubille
Ill
DdL Paris, Éditions Hier et aujourd'hui
1947 Couv ill en coul
DdL Vichy, Szabo
1947 René Margotton
Couv en coul Gr in-8°
DdL Paris, Ghilde française
1948 Couv ill en coul
DdL Paris, Rombaldi
1950 André-Édouard Marty
Edmond Vairel
Couv ill en coul Front. Ill
Illusrations gravées sur cuivre et rehaussées au pochoir
DdL Paris, Éditions La Bruyère ; coll. Select-Univers.
1951 Couv ill
170
Série Amour
DdL Paris, Gründ ; coll. La Bibliothèque précieuse
1953+1956
Couv ill en coul
DdL. Roman
Paris, le Club de la femme
1958 Cart. Ill en coul Ill
DdL Paris, Charpentier
1962 Couv ill en coul
DdL Paris, Gallimard
1976 Couv ill en coul
DdL Paris, Flammarion
1988 Couv ill en coul
DdL Paris, Librairie générale française ; coll. Le Livre de poche, Classiques de poche
1998 Couv ill en coul Ill
DdL Paris, Flammarion
2008 Couv ill en coul
DdL Paris, Gallimard
2008 Couv ill en coul
DdL (llivre pour jeunesse)
Paris, Nathan ; coll. Carrés classiques. Lycée, roman XIXe
2008 Couv ill en coul Ill
171
La Fille aux yeux d’or
Titre (FaYO)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
FaYO Paris, le Livre mondial
s.d. Portr.
FaYO Paris, France-Edition
s.d. Couv ill en coul
FaYO Paris, G. et R. Briffaut ; coll. Le Livre du Bibliophile
1923 Alméry Lobel-Richie [aquafortiste]
Ill
FaYO Paris, France-Édition
1931 L. Cartault Couv ill Ill
FaYO Paris, Rombaldi ; collection Ingres
1942 Jean Serrière [graveur sur métal]
Couv ill Gr. In-8°
FaYO Paris, Éditions de la Caravelle
1943 Couv ill Ill
FaYO Malakoff, La tradition
1946 Maurice Leroy [aquafortiste]
Ill
FaYO Paris, Éditions du livre français ; coll. Les Classiques du XIXe
1946 Ill
FaYO Malakoff, La Tradition
1946 Maurice Leroy (eaux-fortes)
Gr. In-8°
FaYO Paris, V. de Valence
1947 Maurice-Jacques-Yvan Camus [aquafortiste]
Ill
FaYO Paris, Éditions de la Bibliothèque mondiale
1954 Portr. Ill
FaYO Paris, Librairie
1957 Couv ill en coul
172
Gründ
FaYO: roman
Paris, Aux Quais de Paris, Librairie Mireille Ceni
1961 Couv ill
FaYO Paris, Editions du Dauphin
1961 Ill
FaYO Paris, Genève, Slatkine
1996 Couv ill en coul
FaYO Paris, Éd. Mille et une nuits
1998 Couv ill Ill
FaYO Paris, Maxi-livres
2001 Couv ill en coul
FaYO Paris, Grand caractère
2005 Couv ill en coul
FaYO: dernier épisode de l’Histoire des Treize
Paris, Librio 2012 Couv ill en coul
FaYO (livre pour jeunesse)
Paris, Berlin, Gallimard ; coll. Classicolycée
2015 Couv ill en coul Ill
173
César Birtteau
Titre (CB)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
CB (livre pour jeunesse)
Paris, Librairie nationale d’éducation et de récréation
1905 ca
Henri Bressler
Couv ill en coul Ill
CB Paris, E. Flammarion ; Auteurs célèbres
1905 Couv ill
CB Paris, Hatier ; les classiques pour tous
1923 Couv ill
CB Paris, Hatier ; Les Classiques pour tous
1928 Couv ill
CB Paris, éd. Mornay ; coll. Les beaux livres
1929 Jacques Boullaire
Ill
CB Paris, Hachette ; coll. Des Grandes Romanciers
1932 G. Dutriac Ill
CB Paris, Aux dépens de la Société des bibliophiles du papier ; Les bibliophiles du papier
1933 Lucien Jonas
Desjobert [Lithographe]
Couv ill Ill
CB Paris, H. Béziat ; Coll. Des écrivains illustres
1936 Couv ill
CB Paris ; Londres ; Edimbourg : Nelson éditeurs
1936 Couv ill
174
CB Paris, R. Simon ; coll. Heureux celui qui sait
1937 Couv ill en coul
CB Tours, Mame ; coll. 'Pour tous'
1940 G. Dutriac Ill
CB Paris, R. Simon
1947 Couv ill
CB Verviers, Gérard et Cie
1958 Couv en coul Portr.
CB Paris, Éditions de la Bibliothèque mondiale
1958 Couv ill Portr. Ill
CB Paris, Nouvelle librairie de France
1959 Ill
CB Paris, Club du meilleur livre ; coll. Astrée
1961 Cart ill Portr. Ill
CB Paris, Editions Garnier frères
1964 Ill
CB Paris, Culture, art, loisirs ; coll. Bibliothèque de culture littéraire
1964 Cart ill Ill
CB Paris, Editions Baudelaire ; coll. Livre Club des Champs-Elysées
1965 Alain Girard
Couv ill en coul Ill
CB Paris, le Livre de poche
1966 Couv ill
CB Paris, J. Tallandier
1967 Cart ill Portr.
CB Paris, Le 1970 Couv ill en
175
Livre de Poche
coul
CB Paris, Le livre de poche
1973 Couv ill en coul Ill
CB Paris, Gallimard ; coll. Folio
1975 Couv ill en coul
CB Paris, Mengès ; coll. L’Essentiel
1977 Couv ill en coul Ill
CB Paris, Presses pocket
1977 Couv ill en coul
CB Paris, Gallimard
1982 Couv ill
CB Paris, Librairie générale Française
1984 Couv ill en coul
CB Paris, Gallimard ; coll. Folio
1990 Couv ill
CB Paris, Pocket
1994 Couv ill en coul
CB Paris, Éd. Carrefour ; coll. Classique
1994 Couv illen coul
CB Paris, Flammarion
1995 Couv ill en coul
CB Paris, Pocket
1999 Couv ill en coul
CB Paris, Flammarion
2008 Couv ill en coul
CB Paris, Flammarion
2010 Couv ill en coul
La Maison Nucingen
Titre (MN)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
MN Paris, Flammarion
1900 Couv ill
MN Paris, H. Béziat ; Collection
1936 Couv ill
176
des écrivains illustres
Splendeurs et misères des courtisanes
Titre (SMC)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
SMC : extraits
Paris, le Livre mondial
s.d. Portr. Ill
SMC, 2 vol.
Ernest Flammarion éditeur
1926 Couv ill
SMC Paris, H. Béziat ; Collection des écrivains illustres
1936 Couv ill
SMC Paris, Bordas ; coll. Les Grands maîtres
1948 Ill
SMC Paris, les Éditeurs français réunis
1955 Jacquette ill
SMC Paris, Nelson éditeurs
1956 Couv ill en coul
SMC Paris, Editions du Panthéon ; Coll. Pastels
1956 Suzanne Ballivet
Couv ill en coul Ill
SMC, 2 vol.
Paris, Le club du meilleur livre ; coll. Astrée
1958 Couv ill Ill
SMC Paris, Garnier frères ; coll. Classiques
1958 Ill
SMC Paris, les Amis du Club du
1960 Cart ill Portr. Ill
177
livre du mois
SMC Paris, le Livre de poche
1963 Couv ill
SMC Paris, Livre de poche
1965 Couv ill
SMC Paris, Editions Baudelaire ; coll. Livre Club des Champs-Elysées
1966 James Hodges
Couv ill en coul Ill
SMC Paris, Garnier frères
1967 Ill
SMC Paris, Garnier-Flammarion
1968 Couv ill en coul
SMC, 2 vol.
Paris, Tallandie r; coll. Le Trésor des lettres françaises
1972 portr
SMC : extraits
Paris, Montréal, Bordas ; coll. Univers des lettres
1972 Couv ill en coul Ill
SMC Paris, Gallimard
1973 Couv ill en coul
SMC Paris, Garnier frères
1975 Couv ill en coul Ill
SMC : extraits
Paris, Montréal, Bordas ; coll. Univers des lettres
1985 Couv ill en coul Ill
SMC Paris, Garnier ; coll. Classiques
1987 Ill
SMC Paris, Librairie
1988 Couv ill en coul
178
générale française
SMC Paris, Gallimard ; coll. Folio
1990 Couv ill
SMC Paris, Presses pocket ; coll. Lire et voir les classiques
1991 Couv ill en coul Ill b/n et coul
SMC Paris, Bookking international ; Coll. Classiques français
1993 Couv ill en coul
SMC Paris : Maxi-livres ; coll. Maxi-poche romans
2002 Couv ill en coul
SMC Paris, Flammarion ; coll. GF
2006 Couv ill en coul
SMC Paris, Librairie générale française
2008 Couv ill en coul
SMC Paris, Éd. de Lodi
2008 Couv ill
SMC Paris, Gallimard ; coll. Foliothèque
2010 Couv ill en coul
Les Secrets de la Princesse de Cadignan
Titre (SPdC)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
SPdC Paris, A. Saint-Jean Porte-latine
1946 Pierre Burnoud
Couv ill Ill en coul
SPdC Paris, Librairie générale française ; coll.
1999 Couv ill en coul Ill
179
Libretti
SPdC Paris, Magnard
2002 Couv ill en coul
Facino Cane
Titre (FC)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
FC Lausanne, Skira
s.d. Couv ill
FC Paris, Société du Livre d'art
1910 Charles Léandre
E. Decisy Ch Wittmann (grav en coul)
Portr. Ill
SARRASINE
Titre (S) Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
S Paris, Maurice Glomeau
1922 Léon Courbouleix
Couv ill en coul Ill en coul
L'hermaphrodite : Sarrasine sculpteur
Paris, Flammarion
1987 Couv ill en coul
S Paris, Ed. Allia
1989 Couv ill
S Paris, Garnier-Flammarion
1989 Couv ill
S (livre jeunesse) Evry, Ed. Carrefour ; coll. Classiques
1994 Couv ill en coul
S Paris, Ed. Mille et une nuits
1995 Foddis-Boï, Pier-Carlo
Couv ill Ill
S Paris, Ed. Allia
2000 Couv ill en coul
S Paris, Librairie générale française ; coll. Libretti
2001 Couv ill en coul Ill
S Paris, Magnard
2001 Couv ill en coul
Sarrasine. Paris, 2009 Couv ill en
180
L'hermaphrodite Flammarion coul
Pierre Grassou
Titre (PG)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
PG Paris, Nathan ; coll. Carrés classiques. Lycée, histoire des arts
2012 Couv ill en coul Ill en b/n et coul
Les Parents pauvres
La Cousine Bette
Titre (CB)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
CB Paris, Flammarion
s.d. Couv ill
CB (livre pour jeunesse)
Paris, l’Ecole des Loisirs
Couv ill en coul
CB Paris, Quantin
1888 George Caïn (dix compositions) Eaux-fortes en noir et blanc
Gaujean Alphonse-Adolphe Géry-Bichard
Ill
Les parents pauvres. La Cousine Bette
E. Flammarion ; coll. Auteurs célèbres
1905 Couv ill
CB, 2 vol. Paris, Larousse
1908 Front-portr in-16
CB, 2 vol. Paris, Larousse
1909 Portr.
CB, 2 vol. Paris, Larousse ; coll. 11e mille
1911 Couv ill
CB Paris, Larousse ; coll. 8e mille
1912 Couv ill
181
CB, 2 vol. Paris, A. Lemerre ; coll. Petite Bibliothèque littéraire
1912 Ch. Thévenin Portr.
CB, 2 vol. Paris, Larousse
1923 Portr.
Les parents pauvres. CB
E. Flammarion éditeur
1923 Couv ill
CB Paris, Nelson
1928 Couv ill In-16
CB, 2 vol. Paris, R. Simon
1937 Couv ill en coul
CB, 2 vol. Paris, les Belles Editions
1937 Couv en coul
CB, 2 vol. Paris, Gründ ; coll. La Bibliothèque précieuse
1938 Couv ill en coul
CB, 2 vol. Paris, Editions du Panthéon ; coll. Le Panthéon des Lettres
1946 J. Le Coultre Couv ill Ill
Scènes de la vie parisienne. Les Parents pauvres. La Cousine Bette
Lyon, Éditions de la Presqu'île
1947 Bob Meyer Ill
CB Paris, S.E.P.E. ; coll. Bibithèque de “Lectures de Paris”
1947 Portr.
CB Paris, Bordas ; coll. Les Grands maîtres
1948 Portr. Ill
CB Paris, 1949 Portr.
182
Larousse
CB : extraits 2 vol.
Paris, Larousse ; coll. Classiques
1952 Couv ill en coul Ill
CB Paris, Garnier frères
1954 Ill
CB Verviers, Gérard et Cie
1958 Portr.
CB Paris, Club du meilleur livre ; coll. Astrée
1959 Ill
CB Paris, Garnier frères
1959 Ill
CB Paris, Nelson
1960 Couv ill en coul
CB Paris, le Livre de poche
1963 Couv ill en coul
CB Paris, Editions Baudelaire ; coll. Livre Club des Champs-Elysées
1964 Alain Girard Couv ill en coul Ill
CB Paris, Livre de poche
1965 Couv ill en coul
CB Paris, Éditions S.E.C.A. ; coll. Les Grands romans classiques français
1966 Cart. Ill Ill
CB, 2 vol. Paris, J. Tallandier ; coll. Le Trésor des lettres françaises
1971 Ill
CB : extraits
Paris ; Bruxelles ; Montréal,
1972 Ill
183
Bordas ; coll. Univers des lettres Bordas. Etude critique illustrée. Extraits commentés
CB Paris, le Livre de poche ; coll. Classiques
1972 Couv ill en coul Ill
CB Paris, Librairie générale française
1972 Couv ill en coul
CB Paris, Gallimard
1972 Couv ill en coul
CB Paris, Flammarion
1977 Couv ill en coul
CB Paris, Garnier-Flammarion ; coll. G.F.
1977 Couv ill en coul
CB Paris, Garnier frères
1979 Ill
CB Genève, Famot
1979 Ill en coul
CB Paris, Librairie générale française
1984 Couv ill en coul
CB Paris, Garnier ; coll. Classiques
1985 Couv ill Ill
CB Paris, Lattès ; coll. Bibliothèque Lattès
1990 Ill
CB Paris, Booking international ; coll. Classiques français
1993 Couv ill en coul
CB Paris, Pocket 1994 Couv ill en
184
coul
Les parents pauvres. CB
Evry, Éd. Carrefour ; coll. Classiques
1994 Bertall Couv ill en coul Portr.
CB Paris, Ed. J’ai lu
1995 Couv ill en coul Ill
CB (adapté en français facile)
Paris, Clé international ; coll. Lectures Clé en français facile, niveau 3
1997 Couv ill en coul Ill
CB Paris, Flammarion
1998 Couv ill en coul
CB Paris, Pocket 1999 Couv ill en coul
CB Paris, Librairie générale française
2000 Couv ill en coul
CB Paris, l’Aventurine ; coll. Classiques universels
2000 Couv ill en coul
CB Paris, Gallimard
2006 Couv ill en coul
CB Paris, LGF ; coll. Le Livre de poche
2009 Couv ill en coul
CB Paris, Flammarion
2015 Couv ill en coul
Le Couin Pons
Titre (CP)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
CP Paris, Librairie Gedalge
s.d. Valérie Rottembourg
Couv ill en coul Ill
CP Edition abrégée à
Limoges, Librairie nationale
1904 Ill
185
l'usage de la jeunesse
d'éducation et de récréation
Les parents pauvres. CP
Paris, E. Flammarion ; coll. Auteurs célèbres
1905 Couv ill
CP Paris, Larousse 1er millle
1908 Portr.
CP Paris, Larousse ; coll. 6e mille
1910 Portr.
CP Paris, P. Lafitte ; coll. Idéal-bibliothèque
1912 Géo Dupuis Couv ill Ill
CP Paris : Bibliothèque Larousse
1920 Couv ill
CP Paris, libr. Hatier
1922 Couv ill
CP Paris, E. Flammrion éditeur
1923 Couv ill
CP Paris, Plon-Nourrit et Cie, impr.-libr.-éditeurs
1924 Couv ill Ill
Illustré d’après le film réalisé par Jacques-Robert
CP Paris, Larousse
1924 Portr.
CP Paris, Hatier ; Les Classiques pour tous
1927 Couv ill
CP Paris, Nelson, éditeurs
1929 Couv ill
CP, adapté pour la jeunesse
Paris, Société française d'imprimerie et de librairie
1932 Portr. Ill
CP, adapté par Anne
Paris, Delagrave ;
1938 Jaques Souriau
Couv ill en coul
186
Régnier coll. Bibliothèque Juventa
Ill
CP Paris, Gründ ; coll. La Bibliothèque précieuse
1938 Couv ill en coul
CP Paris, H. Béziat ; coll. Des écrivains illustres
1938 Couv ill
Le cousin Pons. : Scènes de la vie parisienne. : Les parents pauvres
Paris, Editions littéraires de France
1946 Charles Genty
Louis Maccard [graveur sur métal]
Ill
CP Paris : S.E.P.E. ; coll. Lectures de Paris
1947 Antoine de Roux
Ill
CP Paris, Garnier frères
1950 Ill
CP Paris : le Club français du livre ; coll. Classiques
1952 Ill
CP, 2 fasc. in-16
Paris, Larousse ; coll. Classiques
1958 Portr. Ill
CP Paris, Nelson
1959 Couv ill en coul
CP : études de mœurs, scènes de la vie parisienne
Paris, les Amis du Club du livre du mois ; coll. Le Meilleur livre du mois
1959 Cart. ill. Ill
CP (adaptation)
Paris, Librairie Delagrave, coll.
1960 Félix Lacroix Couv ill en coul Ill
187
Bibliothèque Juventa
CP Paris, les Productions de Paris ; coll. La Bibliothèque de l’étoile
1960 Ill
CP Paris, Garnier frères
1962 Couv ill Ill
CP Paris, Livre de poche
1963 Couv ill
CP Paris, Editions Baudelaire ; coll. Livre Club des Champs-Elysées
1965 Alain Girard Couv ill en coul Ill
CP Paris, Le Livre de poche
1965 Couv ill
CP Paris : Éditions S.E.C.A. ; coll. Les Grands romans classiques français
1966 Cart. Ill. Ill
CP Paris, Garnier frères ; coll. Classiques
1969 Couv ill Ill
CP Paris, le Livre de poche
1969 Couv ill
CP Paris, J. Tallandier ; coll. Le Trésor des lettres françaises
1972 Ill
CP Paris, Gallimard
1973 Couv ill en coul
CP Paris, Le Livre de poche
1973 Couv ill en coul
188
CP Paris, Ed. Garnier Frères
1974 Couv ill Ill
CP Genève, Famot
1979 Ill en coul
CP Paris : Librairie générale française ; coll. Le Livre de poche
1983 Couv ill en coul
CP Paris, Gallimard ; coll Folio
1988 Couv ill en coul
CP Paris, Gallimard ; coll. Folio
1990 Couv ill en coul
CP Paris, Flammarion
1993 Couv ill en coul
CP Paris, Bookking international
1994 Couv ill en coul
CP Paris, Pocket ; coll. Lire et voir les classiques
1994 Couv ill en coul Ill b/n et coul
Les parents pauvres. CP
Evry, Éd. Carrefour ; coll. Classiques
1994 Bertall Couv ill en coul Front.
CP Paris, Librairie générale française ; coll. Classiques de poche
1999 Couv ill en coul Ill
CP Paris, Pocket 1999 Couv ill en coul
CP Paris, Maxi-livres ; coll. Maxi-poche roman
2005 Couv ill en coul
CP Paris, Gallimard
2007 Couv ill en coul
CP Paris, Librairie Générale Française
2009 Couv ill Ill
189
CP Paris, l’Ecole des loisirs
2014 Couv ill en coul
CP Paris, Flammarion
2015 Couv ill en coul
Un Prince de la Bohème
Titre (PdB)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
PdB S.l, Les Editions de Passy
2013 Couv ill en coul
Les Employés ou La Femme supérieure
Titre (E) Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
La femme supérieure
Bruxelles, Meline, Cans et Cie
1837 Couv ill
Scènes de la vie parisienne. Les Employés, ou la Femme supérieure (extraits)
Paris, impr. de J. Voisvenel
1855 Gr. In-8°
E Paris, le Livre de poche
1970 Couv ill en coul
E Paris, Gallimard ; coll. Folio
1985 Couv ill en coul
E Paris, Gallimard ; coll. Folio
1990 Couv ill en coul
Les Petits bourgeois
Titre (PB)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
PB Paris, Garnier frères
1960 Ill
PB E. Flammarion
1927 Couv ill
190
L’Envers de l’histoire contemporaine
Titre (EdHC)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
Madame de la Chanterie ou L’Envers del’histoire conteporaine
Paris, P. Lethielleux; Collection Durendal
1941 Couv ill
Madame de la Chanterie ou L’Envers del’histoire conteporaine
Paris, Éditions de Montsouris ; Collection Dauphine, série rouge "Les rois des conteurs"
1942 Portr.
EdHC Paris, Le Livre de poche
1970 Couv ill en coul
EdHC Paris, Gallimard
1978 Couv ill en coul
191
SCÈNES DE LA VIE POLITIQUE
Une Ténébreuse affaire
Titre (TA)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
TA Paris, Flammarion, coll. Auteurs célèbres à 60 centimes
1900 ca
Couv ill
TA, 2 vol.
Paris, Flammarion 1901 Couv ill
TA Paris, Nouvelle Librairie populaire
1902 Couv ill
TA Paris, Carteret 1909 François Schommer
Léon Boisson [Eau-forte]
Couv ill Ill
TA Paris, P. Lafitte ; coll. Idéal-bibliothèque
1913 Géo Dupuis
Ill
TA Paris, Hachette, Série des grands romanciers
1928 Touchet Ill
TA Paris, Editions du dauphin ; Aubenas, Habauzit et Cie
1944 Noël Feuersteins
Ill
TA Monaco, L'intercontinentale d'édition, coll. Les romans romantiques
1945 Marcel Chapuis
Ill
TA Paris, Gründ ; Collection Gründ illustrée. Série Coquelicot
1947 Henri Eynard
Ill
TA Paris, Hachette ; coll. Des Grands romanciers
1950 J. Touchet Ill en coul
TA Paris, Éditions La Bruyère ; Collection Select-Univers. Série Angoisse
1951 Couv ill
TA Brie-Comte-Robert, Les Bibliolâtres de
1956 Jean-Marie Granier (graveur sur
Ill
Bois originaux en
192
France bois) camaïeu de Jean-Marie Granier
TA Paris, le Club du meilleur livre
1958 Ill
TA Paris, Éditions Alpina
1958 Couv ill
TA Paris, Le Livre de Poche
1960 Couv ill en coul
TA Paris, Club des amis du livre ; coll. Le Meilleur livre du mois
1963 Ill
TA Paris, A. Michel 1964 Ill
TA Paris, Le livre de poche
1965 Couv ill en coul
TA Paris, O.D.E.G.E 1967 Ill
TA Paris, Gallimard 1973 Couv ill en coul
TA Paris, Le Livre de poche
1973 Couv ill en coul
TA [Bruxelles], Labor ; [Arles], Actes Sud ; [Lausanne], l'Aire; coll. Babel
1991 Couv ill en coul
TA Paris, Gallimard; coll. Folio
1991 Couv ill (curata da rené guise)
TA Paris, Presses pocket
1993 Couv ill Ill
TA Paris, Pocket 1999 Couv ill en coul
193
Le Député d’Arcis
Titre (DA)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
DA Paris, Imprimerie nationale
1959 Deusenry (graveur sur bois)
Front.
Z. Marcas
Titre (Z.M)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
Z.M [Paris], Éd. Mille et une nuits
2009 Couv ill
194
SCÈNES DE LA VIE MILITAIRE
Les Chouans
Titre (Chou)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
Chou (livre jeunesse)
Liège, S.I.R.E.C,
s.d. Le Rallic Ill
Chou (livre jeunesse)
Paris, Nelson s.d. Couv ill en coul Ill en coul
Chou Paris, E. Testard
1889 Julien Le Blant
Auguste-Hilaire Léveillé (grav sur bois)
Ill
Chou Paris, E. Testard
1890 Julien Le Blant
Émile Boilvin (grav à l’eau-forte)
Ill
Chou Paris, libr. Delagrave
1928 Lecoultre Ill
Chou Paris, G. Ratier
1946 Get Ill
Chou Paris, S.E.P.E; coll. Bibliothèque de "Lectures de Paris"
1946 Portr.
Chou Paris, les Publications techniques et artistiques
1947 Emmanuel Poirier
Couv en coul Ill
Chou, 2 vol.
Paris, Gründ 1947 Henri Dimpre
Ill
Chou Paris, A. Fayard ; coll. Le ruban rouge
1947 Tétart Couv ill Ill
Chou, 2 vol.
Paris, Editions de la Nouvelle France
1947 Auguste Roubille
Couv ill en coul Ill
Chou (livre pour la jeunesse)
Paris, Hachette ; coll. Bibliothèque verte
1947 Emilien Dufour
Ill
Chou Paris, Hachette 1951 Emilien Ill
195
(livre pour la jeunesse)
Dufour
Scènes de la vie militaire. Chou, 2 vol.
Paris, Editions La Bruyère ; Collection Select-Univers. Série Amour
1951 Couv ill
Scènes de la vie militaire. Chou
Paris, S.E.P.E. 1953 Portr.
Scènes de la vie militaire. Les Chouans
Paris, Éditions G.P. (impr. de G. Maillet et Cie) ; coll. Super
1956 Mixi-Bérel Couv ill Ill
Chou Verviers, Gérard et Cie
1958 Couv en coul Ill
Chou Imprimerie Nationale
1958 Deusenry (graveur sur bois)
Front.
Chou (livre jeunesse)
Paris, Delagrave ; coll. Bibliothèque Juventa
1959 Couv ill Ill
Chou Paris, Le livre de poche
1961 Couv ill en coul Portr.
Chou Paris, Librairie Charpentier
1963 Julio Gilly Ill
Chou Paris, Garnier Frères
1964 Ill
Chou Paris, Le Livre de poche
1965 Couv ill en coul Portr.
Chou Paris, Garnier frères
1967 Couv ill Ill
Chou Paris, le Livre de Poche
1972 Couv ill en coul Ill
Chou Paris, Ministère de l’éducation nationale
1972 Ill
Chou Paris, Gallimard
1972 Couv ill en coul
Chou Paris, Librairie 1972 Couv ill
196
Générale Française
Ill
Chou Paris, J. Tallandier ; coll. Le Trésor des lettres françaises
1974 Portr.
Chou Paris, Gallimard, Folio
1976 Couv ill Ill
Chou Paris, Union parisienne d’impr. ; coll. Prestige du livre
1977 Ill
Chou (textes choisis)
Paris, Larousse, coll. Textes pour aujourd’hui
1979 Ill
Chou (livre jeunesse)
Neuilly-sur-Seine, Dargaud ; coll. Lecture et loisir
1979 Patrice Sanahujas
Couv ill en coul Ill
Chou Paris, Garnier frères
1983 Ill
Chou (livre jeunesse)
Paris, Bias ; coll. La Licorne
1987 Jacques Boutry
Ill
Chou Paris, Flammarion
1988 Couv ill en coul
Chou Paris, Larousse 1990 Couv ill en coul Ill
Chou Paris, Presses pocket
1990 Couv ill en coul
Chou Evry, Ed. Carrefour
1995 Couv ill en coul Portr.
Chou Paris, Booking international ; coll. Classiques français : maxi-poche
1995 Couv ill en coul
Chou Paris, Au sans pareil ; coll. La bibliothèque des chefs-d’œuvre
1996 Couv ill en coul Ill
Chou Paris, Librairie 1997 Couv ill en
197
générale française
coul Ill
Chou Paris, Pocket ; coll. Pocket classiques
1998 Couv ill en coul
Chou Evry, Ed Carrefour
1998 Couv ill en coul
Chou Paris, “Le Point” ; coll. Les Classiques du “Point”
2003 Jaquette ill en coul
Chou Paris, Gallimard ; coll. Folio.Classique
2004 Couv ill en coul
Chou Paris, Garnier-Flammarion
2014 Couv ill en coul
Les Chouans : roman : extraits Livre pour la jeunesse
Paris, Larousse, coll. Petits classiques Larousse
2014 Couv ill en coul Ill
Une Passion dans le désert
Titre (PdlD)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
PdD Paris, Valère
1938 Georges-Lucien Guyot
Couv ill en cou Ill
PdlD Paris, Maxime Cottet-Dumoulin éditeur
1949 Paul Jouve ; Haasen, Raymond [Aquafortiste]
Ill en coul et b/n
PdlD Paris, éd. Mille et une nuits
1994 Marion Bataille
Couv ill en coul Ill
PdlD Tours, Lume
2007 Paul Jouve Couv ill en coul Ill en coul
198
SCÈNES DE LA VIE DE CAMPAGNE
Les Paysans
Titre (P) Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
P Paris, R. Simon
s.d. Couv ill en coul
P Paris, Société des amis du livre moderne
1911 Pierre-Georges Jeanniot
Couv ill Ill
P Paris, Hachette ; coll. Classiques illustrés Vaubourdolle
1951 Couv ill Ill
P : extraits Paris, Larousse ; coll. Classiques Larousse
1954 Couv ill Front.
P Paris, Garnier frères
1964 Ill
P Paris, Le livre de poche
1968 Couv ill en coul
P Paris, Editions Baudelaire ; coll. Livre club des Champs-Élysées
1968 Cart. Ill en coul Ill
P Paris, Garnier-Flammarion
1970 Couv ill en coul
P Paris, Gallimard
1975 Couv ill en coul
P Paris, Gallimard ; Collection Folio
1993 Couv ill en coul
199
Le Médecin de campagne
Titre (MC)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
MC Paris, Les belles éditions
s.d. Couv ill en coul
MC s.l., Editions littéraires de France
s.d. Charles Genty
Ill
Histoire de l'Empereur racontée dans une grange par un vieux soldat : extrait du MC
Paris, J. Hetzel
1842 Lorentz Ill
MC Paris, Larousse
1908 Ill
MC Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
MC, édition abrégée pour la jeunesse par Léon Chauvin, trente et une gravures
Limoges, E. Ardant
1902 Ill
Histoire de l'Empereur racontée dans une grange par un vieux soldat : extrait du MC
Paris, Henri Leclerc
1904 Alphonse Lalauze [aquafortiste]
Ill
MC Lagny, émile Colin ; coll. Auteurs célèbres
1905 ca Couv ill
MC Paris, Larousse
1912 Couv ill
MC Paris, Larousse
1925 Ill
Napoléon : son histoire
Paris, éditions
1927 S. Olesiewicz
Ill en coul
200
racontée par un vieux soldat dans une grange. Précédée d'Une vie de Balzac à l'usage de la jeunesse (livre pour jeunesse)
Duchartre & Van Buggenhoudt
MC, 2 vol. Paris, Société des médecins bibliophiles
1933 Daniel Collasson
Couv ill Ill
MC Paris, R. Simon
1937 Couv ill en coul
MC Paris, Les Belles éditions
1938 Couv en coul
MC Paris, Gründ ; coll. La Bibliothèque précieuse
1939 Couv ill
L’Empereur Paris, éditions d’histoire et d’art
1943 Adam, Charlet, Raffet
Couv ill Ill
MC Paris, Editions littéraires de France
1944 Charles Genty
Ill
MC Lille, Nord-Editions ; coll. Classiques de France
1945 Jean Robichon
Ill
MC Paris, Hachette ; coll. Bibliothèque Verte
1948 A. Pécoud Couv ill en coul Ill
MC Paris, Editions La Bruyère
1951 Couv ill
MC Paris, le Club français du livre
1951 Ill
MC Paris, Le Livre
1954 Portr.
201
mondial
MC Paris, Editons de la Bibliothèque mondiale
1954 Couv ill
MC Paris, Editons de la Bibliothèque mondiale
1955 Portr.
MC Paris, Larousse ; coll. Classiques Larousse
1958 Couv ill en coul Ill
MC Paris, éd. Albin Michel
1960 Couv ill
MC Paris, Imprimerie nationale ; coll. Des grands auteurs
1960 Deusenry [graveur sur bois]
Front.
MC Paris, le Club du meilleur livre
1960 Ill
MC Paris, le Club du meilleur livre
1960 Cart. Ill Ill
MC Paris, Garnier frères
1961 Ill
MC Paris, Editions Baudelaire ; coll. Livre Club des Champs-Elysées
1965 Alain Girard Couv ill en coul Ill
MC Paris, Garnier-Flammarion
1965 Couv ill en coul
MC Paris, Le Livre de poche
1969 Couv ill en coul
MC Paris, Larousse ; coll. Nouveaux classiques
1971 Couv ill Ill
202
Larousse
MC Paris, le Livre de poche ; coll. Le Livre de poche classique
1972 Couv ill en coul
MC Paris, Gallimard
1974 Couv ill en coul
MC Paris, Garnier frères
1976 Couv ill Ill
MC Paris, Gallimard ; coll. Folio
1980 Couv ill en coul
MC Paris, Gallimard
1984 Couv ill en coul
MC Paris, Gallimard
1989 Couv ill en coul
MC Paris, Gallimard ; coll. Folio
1991 Couv ill en coul
Utopies balzaciennes. MC
Paris, Pocket ; coll., Lire et voir les classiques
1994 Couv ill en coul Ill
MC Paris, Pocket ; coll. Pocket classiques
1999 Couv ill en coul
Napoléon : histoire d'une légende. En appendice : "Vive l'Empereur !", extr. de l'oeuvre de Balzac : "Le médecin de campagne".
Paris, EDL 2003 Couv et jaquett ill en coul Ill
MC Toronto, Editions de l’originale
2012 Couv ill
203
Le Curé de village
Titre (CdV)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
CdV Paris, R. Simon
1939 Couv ill en coul
CdV Paris, Gründ ; coll. La bibliothèque précieuse
1939 Couv ill
CdV Paris, Ed. Inter Nos
1946 Paul-Louis Guilbert
Ill
CdV Pris, le Club français du livre ; coll. Classiques
1951 Ill
CdV Paris, Londres, Edimbourg, Nelson éditeurs
Jaquette ill en coul
CdV Paris, le Club du meilleur livre
1960 Ill
Le curé de village ; suivi de Véronique et de Véronique au tombeau
Bruxelles, Ed. Henriquez
1961 Couv ill Front.
CdV Paris, Nelson Editeur
1963 Couv ill en coul
Le manuscrit de premier jet de Le CdV
Bruxelles, Editions Henriquez
1963+1964 Ill
CdV Paris, Le Livre de poche
1965 Couv ill en coul
CdV Paris, Editions Baudelaire
1966 Couv ill en coul Ill
204
CdV Paris, Garnier-Flammarion
1967 Couv ill en coul
CdV Paris, Pocket
1994 Couv ill en coul Ill
CdV Paris, Gallimard
1998 Couv ill en coul
CdV Paris, Le Livre de Poche
1972 Couv ill en coul
Le Lys dans la vallée
Titre (LdV)
Édition Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
LdV Paris, Les Belles éditions
s.d. Couv ill en coul
LdV Paris, impr. De Schneider
1871 Gr. In-8°
LdV Paris, Editons du “Monde illustré”
1903 Gr. In-8°
LdV Paris, Larousse
1909 Portr.
LdV Paris, Larousse
1911 Portr.
LdV Angers, Librairie du Roi René, Y. Le Diberder
1926 D. Zanardi Front.
LdV Paris, H. Béziat ; coll. Des écrivains illustres
1936 Couv ill
LdV Paris, Gründ ; coll. La bibliothèque précieuse
1936 Couv ill en coul
LdV Paris, R. Simon
1937 Couv ill
LdV Paris, les Belles Editons
1938 Couv ill en coul
LdV Paris, 1942 Couv ill
205
Editons Balzac
LdV Paris, Gründ 1943 Michel Jacquot
Ill
LdV Paris, Eds. Jacques Vautrains, coll Les grands romanciers des XVIIIe et XIXe siècles
1945 Jean-Maurice Curutchet
Ill en coul
Scènes de la vie de province. LdV
Paris, les Éditions de la Nouvelle France
1946 Georges Tautel
Couv ill Ill
LdV Paris, M. Gasnier
1946 Line Touchet
Ill
LdV Paris, l’artiste 1947 Maurice Berty
Ill
LdV Paris, Hartmann
1947 Berthold Mahn
Ill
LdV (adapté pour jeunesse?)
Paris, F. Nathan
1947 Ill
Les oeuvres de Balzac sur la Touraine. LdV
Tours, Arrault, Coll.
1947 Charles Alexandre Picart Le Doux
Couv ill Ill
LdV Grenoble, Roissard
1948 Henri Rivoire
Ill en coul
LdV Paris, Stock, coll. Cent romans français
1948 Reynold Arnould (aquaf)
Livia Dubreuil (grav sur bois)
Couv ill Ill
LdV Paris, les Compagnons du livre
1950 G. de Sainte-Croix
Ill
LdV Monte-Carlo, Éditions Vedette, coll. Collection Bleuet
1952 Pierre Rousseau
Couv ill en coul Ill
LdV Paris, 1953 Couv ill
206
Hachette
LdV Neuchâtel, Nouvelle bibliothèque
1955 Front.
LdV: extraits
Paris, Larousse
1956 Ill
LdV Paris, Imprimerie nationale
1958 Deusenry (grav sur bois)
Front.
LdV Paris, Charpentier, coll. Lecture et loisir
1959 Pierre Rousseau
Couv ill en coul Ill
LdV Verviers, Gérard et Cie
1959 Couv en coul
LdV Paris, Londres, Edimbourg, Nelson éditeurs
1961 Jaquette en coul
LdV Paris, Éditions G.P.
1961 Daniel Dupuy
Cart ill Ill
LdV Paris, Garnier frères
1961 Ill
LdV Paris, Garnier frères
1963 Ill
LdV Paris, Le Livre de Poche
1965 Couv ill en coul
LdV Paris, J. Tallandier
1966 Cart ill + portr
LdV Paris, Garnier frères
1966 Ill
LdV Paris, Bordas 1968 Ill
LdV Paris, Garnier frères
1968 Ill
LdV Paris, F. Beauval
1970 Ill
LdV Paris, Garnier-Flammarion
1972 Couv ill en coul
LdV Paris, Le livre de
1972 Couv ill en coul
207
poche Ill
LdV Paris, Gallimard
1972 Couv ill en coul
LdV Paris, Hachette ; Montrouge, le Livre d Paris
1973 Ill
LdV Paris, J. Tallandier ; coll. Le Trésor des lettres françaises
1973 Portr.
LdV Genève, Famot
1979 Ill
LdV (livre jeunesse)
Paris, Hachette
1980 Johannot, Staal, Bertall, Daumier
Couv ill en coul Ill
Ill non originales
LdV Paris, Librairie générale française, coll Classiques de poche
1984 Couv ill en coul Ill
LdV Paris, Lattès 1989 Bertall Stall
Jaquette ill ill
Ill non originales
LdV Paris, Presses de Pocket
1990 Couv ill en coul Ill
LdV (livre pour jeunesse)
Evry, Ed. Carrefour
1994 Couv ill en coul
LdV Paris, Bookking international
1994 Couv ill en coul
LdV Paris, Librairie Générale française
1995 Couv ill en coul Ill
LdV Paris, EDL 1996 Couv ill en coul
LdV Alleur (Belgique), Marabout ; [Paris], [diff.
1997 Couv ill en coul
208
Hachette]
LdV Paris, Ed. Carrefour
1998 Couv ill en coul
LdV Paris, Pocket 1999 Couv ill en coul
LdV Paris, Maxi-livres
2002 Couv ill en coul
LdV Paris, Gallimard ; coll. Folio
2004 Couv ill en coul
LdV Paris, Garnier-Flammarion
2010 Couv ill en coul
209
Annexe 11 : Catalogue des œuvres illustrées composant les Études philosophiques
LA PEAU DE CHAGRIN
Titre (PC)
Éditeur Date
Illustrateur
Graveur Type d’illustration
Note(s)
PC Paris, Houdaille et Cie
s.d. Ill Ill non originales (éd. Delloye et Lecou, 1838)
PC Paris, chez Abel Ledoux
s.d. Ill Ill non originales (éd. Houdille, 1838)
PC, 2 vol.
Paris, Charles Gosselin, Urbain Canel
1831 Tony Johannot
Henri Désiré Porret (graveur sur bois)
Front.
PC : études sociales
Paris, H. Delloye et V. Lecou
1838 Gavarni, Baron, Henri-Charles-Antoine. Janet-Lange, Marckl, Louis Français, Thomas Napoléon, Vernet Horace
Brunellière, Prosper Aimée Marie [Graveur sur métal] Langlois, Philibert [Graveur sur métal] Pourvoyeur, Jean-François [Graveur sur métal] Montaut, Gabriel (1798-185) [Graveur sur métal] Joubert [Graveur sur métal] Torlet, Alphonse [Graveur]
Ill Page 180, le personnage assis à gauche de Rastignac passe pour représenter Balzac note P. Berès dans son catalogue d'exposition (1949)
210
Fournier, Félicie [Graveur sur métal] Boilly, Alpnonse [Graveur sur métal] Goulu [Graveur sur métal] Beyer [Graveur sur métal] Pigeot [Graveur sur métal] Legris [Graveur sur métal] Ferdinand [Graveur sur métal] Berlier [Graveur sur métal] Nargeot, Jean Denis [Graveur sur métal]
PC Paris, impr. De Morris et Cie
1854 Gr. In-8°
PC Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
PC Paris, Nouvelle librairie populaire
1903 Couv ill
PC Paris, E. Flammarion ; coll. Auteurs célèbres
1905 ca
Couv ill
PC Paris, bibliothèque Larousse
1909 Portr.
PC Paris, Bibliothèque
1910 Portr.
211
Larousse
PC Paris, Larousse
1912 Front.
PC Paris, Larousse
1921 Portr.
PC Paris, Larousse
1925 Ill
PC Mâcon, impr. Protat frères ; Paris, les éditions G. Crès et Cie
1923 E. Vibert Portr.
PC Paris, J. Tallandier ; coll. Les Chefs-d’oeuvre de l’esprit
1928 Barofi Couv ill Ill
Ill non originales (éd. Delloye et Lecou, 1838) avec deux ill originales par Barofi
PC Paris, Editions du Trianon ; coll. Grande collection Trianon
1930 Émilien Dufour
Ill en coul
PC Chartres, impr. Durand. Cachan, Société de gravure (illustrations) ; Paris, éditions Jules Tallandier
1930 Ill
PC Paris, impr. E. Ramlot ; H. Béziat; coll. Des écrivains illustres
1938 Couv ill
PC Paris, A. Leconte
1942 Couv en coul
PC Paris, Les Editions de la nouvelle France ; Coll. De la Main d’or
1943 Paul Cappatti
Couv ill Ill en bistre
PC Genève, Editions au
1944 Couv ill en coul
212
grand passage S. A.,
PC Paris, M. Gasnier
1945 Beuville Ill
PC Paris, Editions du Panthéon ; Collection le Panthéon des lettres
1945 Ill
PC Paris, Rouf ; coll. Ma bibliothèque
1946 Couv en coul
PC Paris, G. Ratier
1946 M. Guillemin
Couv ill en coul Ill
PC Paris, Ed. de la vie réelle
1946 Jean Cortot Ill en coul
PC Paris, R. Rasmussen ; coll. Reflets
1947 Couv en coul Ill
PC Paris, J. Vautrain ; coll. Les grands romanciers des XVIIIe et XIXe siècles
1947 Colette Pettier
Ill
PC Paris, Gründ ; Collection Gründ illustrée. Série Coquelicot
1948 Deslignères Ill
PC Paris, Editions du Dauphin
1950 Front
PC Paris, Club des libraires de France
1956 Couv ill Ill
Reproduction en fac-similé de l’édition 1838
PC Moscou, Editions en langues étrangères
1958 Couv ill Portr.
PC Paris, Garnier frères
1960 Ill
PC Paris, Charpentier
1962 Ill
PC Paris, Le Livre de poche
1966 Couv ill en coul
PC Paris, Garnier 1967 Ill
213
frères ; coll. Classiques Garnier
PC Paris, Editions G. P.
1969 Ill
PC Paris, Société encyclopédique française, Comptoir international du livre
1970 Ill Reprodution en fac-similé de l’éditin fite à Paris, par Abel Ledoux, 1845, gravures en taille douce
PC Paris, Garnier-Flammarion
1971 Couv ill en coul
PC : texte de l’édition originale, 1831
Paris, Le Livre de poche
1972 Couv ill en coul
PC Paris, M. de L’Ormeraie
1973 Couv ill Ill
Fac-similé éd. Houdaille, 1838
PC Paris, Gallimard
1974 Couv ill en coul
PC Paris, J. Tallandier ; coll. Le Trésor des lettres françaises
1976 Portr
PC Paris, Garnier frères
1980 Ill
PC Paris, G. P. ; coll. Super-bibliothèque
1980 Jean Retailleau
Ill
PC Paris, L’Ecole des loisirs, coll. Les classiques abrégés
1982 Janet-Lange (1815-1872)
Ill
PC Paris, Imprimerie nationale ; coll. Lettres françaises
1982 Jean Bernadac
Ill
PC Paris, le Livre de poche
1984 Couv ill en coul
214
PC Paris, Librairie Générale Française ; coll. Les classiques de poche
1985 Couv ill en coul Ill
PC Paris, Garnier frères
1985 Ill
PC Paris, Presses Pocket-, coll. Lire et voir les classiques
1989 Couv ill Ill
PC Paris, J.-C. Lattès ; coll. Bibliothèque Lattès
1990 Ill
PC : extraits
Paris, Bordas ; coll. Univers des lettres Bordas.Textes littéraires. Extraits
1991 Couv ill en coul Ill
PC Alleur (Belgique) ; [Paris], Marabout
1995 Couv il en coul
PC Evry, Ed. Carrefour ; Collection classique
1995 Couv ill en coul Portr.
PC Paris, EDDL ; coll. Grands classiques
1996 Couv ill
PC Paris, Flammarion
1996 Couv ill en coul
PC Paris, Librairie, générale française ; coll. Le Livre de poche
1996 Couv ill en coul
PC Paris, Pocket 1998 Couv ill
PC Paris, Ed. Carrefour ; coll. Classique
1998 Couv ill en coul
PC (livre pour jeunesse)
Paris, Maxi-livres ; coll. Maxi-poche fantastiques
2001 Couv ill en coul
215
PC Paris, Hatier ; coll. Classiques & Cie
2002 Couv ill en coul
PC Paris, Gallimard
2003 Couv ill en coul
PC (version du 1845)
Paris, Hachette éducation ; coll. Bibliolycée
2004 Couv ill en coul Ill
PC (livre pour jeunesse)
Paris, Clé international
2008 Couv ill en coul Ill
PC Toulouse, Milan ; coll. Vient (presque) de paraître
2010 Couv ill
PC Paris, Larousse ; coll. Petits classiques Larousse
2011 Couv ill en coul Ill
PC Paris, Hatier ; coll. Classiques & Cie. Lycée
2011 Couv ill en coul
La peau de chagrin : une histoire adaptée de l'oeuvre d'Honoré de Balzac Livre pour la jeunesse
Lognes, Itak éditions
2011 Julie Wendling
Couv ill en coul Ill
PC Paris, Flammarion
2013 Couv ill en coul
PC (livre pour jeunesse)
Paris, Librairie Générale Française
2013 Couv ill en coul
216
PC (livre pour jeunesse)
Paris, Le Livre de poche jeunesse
2013 Couv ill en coul
PC Paris, Gallimard ; Coll. Folioplus classiques
2014 Couv ill en coul
Mélmoth réconcilié
Titre (MR)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
MR Genève, Editions du Verbe ; Collection 10 chefs d'oeuvre classiques
1945 Couv ill
217
Le Chef-d’œuvre inconnu
Titre (CdOI)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
CdOI Paris, Maurice Glomeau
1911 Frédéric Bourdin
Ernest Florian (graveur sur bois)
Couv ill Ill
CdOI Paris, A. Vollard
1931 Pablo Picasso
Ill
CdOI Paris, A. Vollard
1931 Pablo Picasso
Tirage des eaux-fortes par Louis Fort
Ill
CdOI [s.l.], Editions du journal “Labyrinthe”
1945 Pablo Picasso
Couv ill Ill
CdOI Paris, J. Barreau
1946 Roger Wild Ill
CdOI Paris, A. Dérue
1957 Théo Van Elsen [lithographe]
Ill
CdOI Utrecht, Société de Roos
1962 Roger Chailloux [aquafortiste]
Couv ill Ill
CdOI : conte philosophique
Bienne, chez l’artiste
1964 Pierre Stampfli (images gravé à la main par lui : linogravure)
Couv ill Ill
CdOI Paris, Editions Livre Club du Libraire (L.C.L) ; coll. Les peintres du livre
1966 Pablo Picasso
Ill par Picasso
CdOI Paris, F. Mourlot
1977 Bension Énav
Fernand Mourlot (?)
Couv ill en coul Ill
CdOI Castelnau-le-Lez, Ed. Climats, coll.
1990 Couv ill en coul
218
Micro-climats
Le Chef-d'oeuvre inconnu : la belle Noiseuse
Paris, Findakly
1991 Couv ill
CdOI Châteauroux : R. Bonargent ; coll. Indifférences
1993 René Bonargent
Ill
CdOI Paris, Ed. Mille et une nuits
1993 Couv ill en coul Ill
CdOI Le Touquet : Auréoline, coll. Trait d’union
2003 Chris Couv ill en coul Ill
CdOI Paris, Flammarion ; coll. Etonnants classiques
2004 Couv ill en coul Ill
Le chef-d'oeuvre inconnu : 1831-1837 : texte intégral
Paris, Nathan, coll. Carrés classiques, nouvelle XIXe
2006 Couv ill en coul Ill
CdOI : extrait
Paris, Biotop 2007 Couv ill en coul Ill
CdOI Paris, Flammarion, coll. Etonnants classiques
2008 Couv ill en coul Ill
CdOI Paris, Nathan ; coll. Carrés classiques. Lycée : nouvelle XIXe
2012 Couv ill en coul Ill
Luc Maize (1913-2004) : accompagné
Lyon, ed. Fage, coll. Varia, découverte
2013 Luc Maize Couv ill en coul Ill en coul
219
par "Le chef d'oeuvre inconnu" [de] Honoré de Balzac
CdOI Paris, Gallimard
2014 Couv ill en coul
220
La Recherche de l’Absolu
Titre (RA) Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
RA Paris ; Londres ; New York, J. M. Dent et fils ; coll. Gallia
s.d. Portr.
RA, extraits Paris, Larousse ; coll. Classiques Larousse
1955 Couv en coul
RA Paris, Flammarion
1993 Couv ill en coul
RA Paris, Librairie générale française
1999 Couv ill en coul
RA Paris, Gallimard ; coll. Foilioplus classiques, 19e siècle
2011 Couv ill en coul
L’ENFANT MAUDIT
Titre (EM)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
EM Paris, Le roman littéraire
1928 André Verdilhan
Couv ill Ill
EM Paris, Bibliothèque mondiale
1958 Couv ill Ill
221
Adieu
Titre (A)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
A Paris, Les bibliophiles du palais
1965 Leonor Fini [Lithographe]
Ill
A Paris, Librairie générale française ; coll. Le livre de poche
1995 Rozier-Gaugriault
Couv ill en coul Ill
A : 1830
Paris, Nathan ; Collection collège
2012 Couv ill en coul Ill
Les Marana
Titre (M)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
M Paris, A. Méricant
s.d. Couv ill Ill
Le Réquisitinnaire
Titre (R)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
R Cherbourg, Isoète
1995 Couv ill
222
Un Drame au bord de la mer
Titre (DBM)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
DBM La Baule, Editions des Paludiers ; coll. Littérature et terroirs
1976 Couv ill Ill
DBM Rezé : Séquences
1993 Couv ill
DBM Rennes, la Part commune
2013 Couv ill en coul
Maître Cornelius
Titre (MC)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
MC Tours, Arrault ; coll. Les oeuvres de Balzac sur la Touraine
1947 Gustave Staal
Couv ill Ill
MC Castelnau-le-lez, Climats
1994 Couv ill en coul
223
L’Auberge rouge
Titre (AR)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
AR Paris, aux dépens d’un bibliophile
s.d. Paulette Humbert
Ill
AR Paris, F. Rouff ; Grande collection nationale
1914 Couv ill
AR : un crime mystérieux
Paris, Société parisienne de librairie et d’éditions
1943 Couv ill en coul Ill
AR Paris, Arléa 1994 Couv ill en coul
AR Oullins : Chardon bleu éd. ; collection Bienlire
1997 Couv ill
AR Paris, Maxi-livres ; coll. Un livre 1 euro
2001 Couv ill en coul
AR Paris, Gallimard
2004 Couv ill en coul
AR : 1831 : texte intégral
Paris, Nathan ; coll. Carrés classiques. Lycée : récit XIXe
2010 Couv ill en coul Ill
AR : 1831, texte intégral
Paris, Nathan ; coll. Carrés classiques, récit XIXe
2014 Ill
224
Sur Cathérine de Médicis
Titre (SCdM)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
SCdM Paris, les Ed. du Carrousel; coll. Littératures
1999 Couv ill en coul
SCdM Paris, la Table ronde
2006 Couv ill en coul
L’Elixir de longue vie
Titre (ELV)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
ELV Paris, Ecole Estienne
1914 Couv ill
ELV Paris, Gallimard
2009 Couv ill en coul
Les Proscrits
Titre (LP) Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
LP : (Etudes philosophiques)
Paris, Les belles éditions
s.d. Couv ill
LP Paris, F. Ferroud
1905 Gaston Bussière (Aquafortiste)
Ill
225
Louis Lambert
Titre (LL)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
Louis Lambert. Tome premier, Les Textes
Paris, José Corti
1954 Ill
Séraphîta
Titre (S)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
S Paris, E. Flammarion ; col. Auteurs célèbres
1905 Couv ill
S Paris, H. Jonquières ; col. At Home
1922 Drouart, Raphaël lithographie et bois
Ill
S Paris, Gründ ; col. La Bibliothèque précieuse
1939 Couv ill en coul
S Paris, Berg international ; La petite collection
1986 Ill
S Paris, Éd. l'Harmattan
1995 Couv ill
S Paris, les Éd. du Carrousel
1999 Couv ill en coul
227
Annexe 12 : Catalogue des éditions illustrées des œuvres composant les Études analytiques
Physiologie du mariage
Titre (PdM)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
PdM ou Méditations de philosophie éclectique, sur le bonheur et le malheur conjugal
Bruxelles, Méline, Cans
1837 Couv ill
PdM, pré-originale (1826)
Paris, E. Droz
1940 Gr. In-8°
PdM ou Méditations de philosophie éclectique, sur le bonheur et le malheur conjugal
Paris, Livre club du libraire
1962 Honoré Daumier Gavarni [lithographes]
Ill
PdM Paris : Garnier-Flammarion
1968 Couv ill en coul
PdM Paris, impr. Pierre Gaudin, René Jeanne
1974 Pierre Gaudin Ill
PdM Paris, Gallimard
1987 Couv ill en coul
PdM ou Méditations de philosophie éclectique, sur le bonheur et le malheur conjugal
Toront, Éditions de L'Originale
2005 Couv ill
PdM [Paris], Macha Publishing ;
2016 Nicolas Galy Oreste Cortazzo
Couv ill en coul Ill
228
coll. Trésors retrouvés de la littérature
Petites misères de la vie conjugale
Titre (PMdVC)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
PMdVC Paris, Chlendowski
1846 Bertall Ill
Suite d'illustrations pour "Petites misères de la vie conjugale" d'Honoré de Balzac
Paris, J. Porson
1942 Joseph Hémard
E. Vairel (enlumineur)
Ill
PMdVC Paris, R. Dacosta
1978 Bertall Couv ill Ill
PMdVC Paris : Arléa 1990 Cabu (1938-2015)
Couv ill en coul Ill
PMdVC : roman
Lyon, Visibilis
1998 Couv ill
PMdVC Paris, Éd. Payot & Rivages ; coll. Rivages poche. Petite bibliothèque
2011 Couv ill
Traité de la vie élégante
Titre (TdVE)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
TdVE Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal
2000 Couv ill en coul
TdVE Paris, Mille et une Nuits
2001 Couv ill en coul
229
Traité des Excitantes modernes
Titre (TEM)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
TEM Paris, Actes Sud ; coll. Babel
1994 Pierre Alechinsky
Couv ill Ill
TEM Paris, Ed. Mille et une nuits
1997 Karine Daisay
Couv ill en coul Ill
TEM Paris, Arléa 2003 Couv ill en coul
TEM Gallardon, Menu Fretin ; coll. Petite heuristique de l’estomac
2009 Ill
TEM Paris, Actes Sud ; coll. Babel
2013 Pierre Alechinsky
Couv ill en coul Ill
Théorie de la démarche
Titre (TdD)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
TdD Paris : Ed. des Mille-et-une-nuits
2015 Couv ill
TdD Paris : Paris Musées & L'échoppe
1992 Pol Bury Ill
231
Annexe 13 : Catalogue des éditions illustrées des textes hors La Comédie humaine
Physiologie de l’Employé
Titre (PE)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
PE Paris, Aubert, Lavigne ; coll. Physiologies Aubert
1841 Louis-Joseph Trimolet
Ill
PE Paris, Champion ; Genève, Slatkine
1979 Louis-Joseph Trimolet
Ill Fac-similé éd. Aubert, 1841
PE Bègles, le Castoral astral ; coll. Les inattendus
1994 Louis-Joseph Trimolet
Couv ill Ill
PE Rennes la Part commune
2014 Couv ill
PE Rennes, la Part commune
2015 Couv ill
232
Conversation entre onze heures et minuit
Titre (CeOeM)
Éditeur Date Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
CeOeM Paris, M. Vox
1945 Pierre Noël Gilbert Poilliot [graveur]
Couv ill Ill
CeOeM Paris, Union bibliophile de France ; coll. Vox
1948 Ill
CeOeM Paris, Chez l’artiste
1952 Bernard Ducourant
Ill
CeOeM Toulouse, Ed. Ombres
2001 Couv ill en coul
Contes drolatiques
Titre (CD)
Éditeur Date
Illustrateur Graveur Type d’illustration
Note(s)
CD, 2 vol. Paris, Gründ s.d. Couv ill
CD, 2 vol. Paris, J. Tallandier
s.d. Albert Robida
Ill
CD s.l., s.n. s.d. Raymond Laverrerie
Couv ill en coul Ill
Les plus célèbres contes drôlatiques
Paris, F. Rouff s.d. Couv ill
La belle Impéria : conte drolatique
Paris, L. Conard
1903 Edmond Malassis
Ill
Les joyeuzetés du Roy Loys le Unziesme : conte drolatique
Paris, L. Conard
1906 Edmond Malassis
Ill
D'ung paouvre qui avoyt nom Le Vieux par chemins
Paris, Georges Crès & Cie
1914 Joseph Hémard
Ill en coul
233
Les plus célèbres "Contes drôlatiques"
Paris, F. Rouff 1918 Gr. In-8°
Le péché véniel : conte drolatique
Paris, René Kieffer
1922 Hamman, Joë
Couv ill en coul Ill en coul
Les Cent contes drolatiques mis en lumière par le sieur de Balzac. Quatriesme dixain. Fragments inédits, ornés de quatre fac-similés
Paris, la Cité des livres ; coll. Les Cahiers balzaciens
1925 Ill
CD Paris, René Kieffer éditeur
1926 Pierre Noël Couv ill en coul Ill en coul
L’héritier du diable
Paris, René Kieffer
1926 Quint Ill
CD, 2 vol. Paris, G. Crès et Cie
1926 Joseph Hémard
Couv ill en coul Ill
Trois contes drolatiques
Bruxelles, aux éd. Du Nord ; coll. Les gloires littéraires
1926 Joseph Hémard
Couv ill en coul Ill en coul
CD, 3 vol. Paris, éditions Jules Tallandier
1925 A. Robida Ill
CD Paris, J. Fort 1927 Lucien Métivet
Ill
Grande imprimerie de Troyes : Caractères usuels ; Les contes drolatiques
Troyes, Grande imprimerie ; coll. Labeurs & journaux
1933 Ill
CV, 3 vol. Paris, Editions du Rameau
1934 André Collot
Couv ill Ill en coul
234
d’or
CD, 2 vol. Paris, Gründ ; coll. La Bibliothèque prècieuse
1936 Couv ill en coul
CD Paris, Gibert Jeune, Librairie d’amateurs
1939 Albert Dubout
Ill en coul Jaquette ill en coul
CD, 3 vol. Paris, l'Emblême du secrétaire
1941 André Deslignères
Ill en coul
La belle fille de Portillon
Paris, à l’enseigne de la Trirême
1944 Qio Colucci Guido Colucci [Calligraphe]
Ill en coul
Le péché véniel : escript pour la ioye et gaudisserie de tous les bons compaings et gens de bien, et non aultres
Paris, Sylvain Sauvage ; coll. Le Cabinet de l'honneste homme
1945 Sylvain Sauvage
Gilbert Poilliot [graveur sur bois] René Munsch [graveur]
Ill
La pucelle de Thilhouze
Paris, La Trirème
1945 Joseph Hémard
Ferrariello [enlumineur]
Ill en coul
Le curé d'Azay-le-rideau
Paris, Ed. Chantelune
1946 Maurice William Julhès
Ill en coul
Berthe la repentie : conte drolatique
Paris, Gründ ; coll. Bagatelle
1946 Van Rompaey
Ill
CV, 2 vol. Dijon, Saint-Cloud, Editions du Manoir
1948 Schem Couv ill en coul Ill
CD Paris, André Martel
1951 Maurice Leroy
Ill en b/n et coul
CD, 3 vol. Paris, Edition de l’Odéon
1952 André Hubert
Ill
CD Verviers, Gérard et Cie ; Paris, l’Inter
1965 Gustave Doré
Couv ill Ill
Ill non originales
CD Paris, Editions 1966 Couv ill en
235
Baudelaire ; coll. Livre Club des Champs-Elysées
coul Ill
CD, 3 vol. Paris, M. de L’Ormeraie
1973 Gustave Doré
Ill Ill non originales
CD, 2 vol. Coeuvres-et-Valsery, Ressouvenances
2008 Gustave Doré
Couv ill Ill
Ill non originales
CD Toronto, Editions de l’originale
2008 Couv ill
237
Annexe 14 : Catalogues des éditions illustrées des recueils de textes
balzaciens
Décennie
Titre Édition Date Illustrateu
Graveur
Type d’illustration
Note(s)
1820-1830
1830-1840
Nouveaux Contes philosophiques Maître Cornélius Madame Firmiani L'Auberge rouge Louis Lambert
Paris, C. Gosselin
1832 Tony Johannot
Henri désiré Porret [Graveur sur bois]
Front.
Romans et contes philosophiques, 3 vol.
Paris, C. Gosselin
1833 Johannot (vignettes)
Ill
Gambara, suivi de Le Curé de village
Bruxuelles, impr. de A. Wahlen
1839 Couv ill.
1840-1850
Histoire des parens pauvres. La Cousine Bette et les Deux musiciens, par M. de Balzac. - Le Cousin Pons ou les Deux musiciens, suivi de : Eugénie Grandet. El Verdugo. 2 vol.
Paris, impr. de Boniface
1847 Gr. In-8°
238
1850-1860
Comédie hmaine : œuvres illustrées. Oeuvres reliées ensemble ; en tête de chacune le même front. gr. de C. Nanteuil. - Le vol. contient aussi (relié en tête) : "Paris marié" / par H. de Balzac (Romans du jour illustrés), Louis Lambert . l'Elixir de longue vie . Les Comédiens sans le savoir . Etude de femme . La Maison Nucingen . Le Lys dans la vallée . Le Cabinet des antiques . La Vieille fille . Physiologie du mariage . Autre étude de femme . Une fille d'Eve . Madame Firmiani . L'Illustre Gaudissart . la Muse du
Paris, impr. de Schneider
1850 ca
Tony johannot
Ill
239
département . la Paix du ménage . Une passion dans le désert . Les Célibataires : Un ménage de garçon . Les Employés . Gobseck . Les Célibataires : Pierrette . le Curé de Tours
1860-1870
1870-1880
1880-1890
1890-1900
Le Colonel Chabert ; Honorine ; L’interdiction
Paris, J. Rouff
1898 Couv ill
La femme de trente ans ; la femme abandonnée
Paris, J. Rouff
1899 Couv ill
1900-1910
Gobseck, suivi de La femme abandonnée, La Grenadière, Le message
Paris, Flammarion
1900 ca
Couv ill
La Rabouilleuse ; Les Célibataires
Paris, L. Borel
1900 H. Vogel Ill.
Une double famille, suivi de La paix du ménage,
Paris, Flammarion
1901 Couv ill en coul
240
La fausse maitresse
La Paix du ménage. La fausse maîtresse
Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
La Femme abandonnée. La grenadière. Le message
Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
Un Prince de la bohême. Esquisse d'homme d'affaires. Pierre Grassou
Paris, E. Flammarion
1901 Couv ill
La femme abadonnée ; L’Interdiction
Paris, Nouvelle Librairie populaire
1902 Couv ill
La Maison du chat-qui-pelote ; La Vendetta
Paris, Nouvelle librairie populaire
1902 Couv ill
Une fille d’Eve ; La Bourse
Paris, Nouvelle librairie populair
1902 Couv. ill
La fausse maîtresse [Texte imprimé] ; Une double famille
Paris, Nouvelle librairie populaire
1902 Couv ill
Le Colonel Chabert ; Gobseck
Paris, Nouvelle librairie populaire
1902 Couv ill
Contes choisis : Réunit : " L'Élixir de longue vie " ; " La Messe de l'athée " ; " Jésus-Christ en
Londres, J. M. Dent et fils ; New York, E. P. Dutton, coll. Les classiques français
1905 Portr.
241
Flandre " ; " Un Episode sous la Terreur " ; " Le Réquisitionnaire " ; " Le Chef-d'œuvre inconnu " ; " El Verdugo " ; " La Grande Bretèche " ; " Facino Cane " ; " Un Drame au bord de la mer "
1910-1920
Traité de la vie élégante ; Physiologie du rentier de Paris ; Physiologie de l'employé ; Les boulevards de Paris
Paris, Bibliopolis ; coll. Curiosités littéraires et pages inconnues
1911 Bertall Daumier Gavarni Anthelme Trimolet
Ill
Le Colonel Chabert, Le Bal de Sceaux
Paris, Henri Fabre
1911 Couv ill
Gobseck ; Le bal de Sceaux (suite et fin). Pierre Grassou. Le message
Paris, H. Fabre
1911 Couv ill
Contes philosophiques : Réunit : " Le Colonel Chabert " ; " L'Élixir de longue vie " ; " La Messe de l'athée " ;
Paris ; Londres, J. M. Dent et fils ; New York, E. P. Dutton
1913 ca
Portr.
242
" Jésus-Christ en Flandre " ; " Un Episode sous la Terreur " ; " Le Réquisitionnaire " ; " Le Chef-d’œuvre inconnu" ; " El Verdugo " ; " La Grande Bretèche " ; " Facino Cané " ; " Un Drame au bord de la mer " ; " L'Interdiction ".
1920-1930
L'auberge rouge. El Verdugo. Le colonel Chabert. Le réquisitionnaire (livre pour la jeunesse)
Paris, Editions Pierre Lafitte, coll. Idéal-Bibliothèque
1922 Couv ill en coul + front + ill ( ?)
Traité de la vie élégante ; suivi de La théorie de la démarche
Paris, Bossard ; Collection des chefs-d'oeuvre méconnus
1922 Nadar Achille Ouvré
Portr.
Le curé de Tours ; La Maison du chat-qui-pelote ; La Vendetta
Paris, P. Lafitte
1925 Roger Broders
Couv ill en coul Ill
Louis Lambert ; Adieu
Paris, Hatier ; coll. Les Classiques
1925 Portr sur la couv
243
pour tous
Un début dans la vie. Madame Firmiani. Le Message. La Messe de l'Athée
Paris, E. Flammarion
1925 Couv ill
La Paix du ménage. Étude de femme. Autre étude de femme. La Grande Bretèche. Une double famille
Paris, Ernest Flammarion éditeur
1925 Couv ill
La Maison du chat-qui-pelote ; Un drame au bord de la mer
Paris, Hatier ; coll. Les Classiques pour tous
1927 Couv ill avec portr.
Le colonel Chabert : scènes de la vie privée Contiene anche : Gobseck, La Bourse, La Grenadière, L’Interdiction
Paris, Albin Michel
1927 Ill
Les Employés. Un prince de la Bohème. Gaudissart. II. Pierre Grassou
E. Flammarion éditeur
1927 Controlla se couv ill
L'Envers de l'histoire contemporaine. Z. Marcas
Ernest Flammarion éditeur
1927 Controlla se couv ill
La fille aux yeux d’or ; La Vendetta
Paris, F. Rouff ; coll. Ma Bibliothèque
1928 Couv ill en coul + ill
244
Le Colonel Chabert, Adieu, La Grenadière
Paris, libr. Delagrave ; coll. Bibliothèque Juventa
1928 Lecoultre Ill
Un épisode sous la Terreur [Texte imprimé] : et autres nouvelles [Le Réquisitionnaire. El Verdugo. L'Auberge rouge]
Paris, Hatier ; coll. Les classiques pour tous
1929 Couv ill
1930-1940
La Grenadière. Le Chef-d'oeuvre inconnu
Paris, E. Ramlot et Cie ; éditions Nilsson
1930 Gr. En couleurs
L'auberge rouge ; Un épisode sous la Terreur ; L’Elixir de longue vie ; Sarrazine ; Un drame au bord de la mer
Paris, F. Rouff ; Coll. Ma bibliothèque
1932-1933
Couv ill en coul Ill
La Maison du chat-qui-pelote, Le Bal de Sceaux, La Bourse
Paris, H. Béziat ; coll. Des écrivains illustres
1936 Couv ill
La Maison du chat-qui-pelote ; Le Bal de Sceaux ; La Bourse
Paris, Editions du Vert-Logis
1936 Couv ill
La maison Nucingen ; suivi de Les
Paris, Henri Beziat
1936 Couv ill
245
secrets de la Princesse de Cadignan, Sarrasine, Un homme d'affaires
Le colonel Chabert, suivi d’Adieu (livre pour la jeunesse)
Paris, Librairie Delagrave
1937 Jaquette ill Portr.
Le Colonel Chabert, suivi d’Adieu
Mesnil-sur-l'Estrée, impr. Firmin-Didot ; Paris, Delagrave
1937 J. Grellet Ill
La Vieille fille et le Cabinet des antiques
Paris, R. Simon
1937 Couv ill en coul
La fausse maîtresse ; La paix du ménage ; Etude de femme ; Autre étude de femme ; La grande Bretèche ; Une double famille
Paris, R. Simon
1937 Couv ill en coul par Claudel
La fille aux yeux d’or, suivi de La Duchesse de Langeais
Paris, R. Simon
1937 Claudel Couv ill en coul Ill
Le colonel Chabert, Le Curé de Tours
Paris, Gründ ; coll. La Bibliothèque précieuse
1939 Couv ill en coul
L’Enfant maudit, suivi de Gambara
Paris, R. Simon
1939 Couv ill en coul
246
et Massimilla Doni
1940-1950
L’Illustre Gaudissart, suivi de Le Chef-d’oeuvre inconnu, Sarrasine
Paris, Gründ ; coll. La Bibliothèque précieuse
1940 Couv ill
L’Auberge rouge ; Maitre Cornelius
Paris, Gründ
1940 Couv en coul
Histore des treize. Ferragus ; suivi de Pierre Grassou
Paris, Gründ
1941 Couv ill en coul
Histoire des treize. La Duchesse de Langeais. La Fille aux yeux d'or
Paris, Gründ ; coll. La Bibliothèque précieuse
1941 Couv ill en coul
La Maison du chat-qui-pelote, Le Bal de Sceaux, La Bourse
Paris, Gründ-, coll. La Bibliothèque précieuse
1942 Couv ill
L'Interdiction. Un épisode sous la Terreur
Paris, Éditions de Montsouris ; coll. Dauphine
1945 Couv ill Ill
Une fille d'Eve. Madame Firmiani
Paris, Aubenas, Ardèche, Habauzit ; Bibliothèque classique
1945 Monique Vollant
Ill
Le Père Goriot, suivi de la Maison Nucingen
Paris, Union Bibliophile de France ;
1946 Daumier, Gavarni, Bertal, Staal, etc.
Blaise Monod
Ill
247
coll. Vox
Traité de la vie élégante, physiologie de la toilette
Paris, Nouv. Société d’éd
1946 Georges Beuville
Ill en coul
Gobseck. Un entr'acte. L'Epicier
Genève, A. Skira ; Petite collection Balzac
1946 Couv ill
Melmoth réconcilié. Jesus-Christ en Flandre
Genève, A. Skira
1946 Couv ill
L’illustre Gaudissart, Gaudissart II, Facino Cane
Lausanne, Skira
1946 Couv ill
Une passion dans le désert ; Z. Marcas ; Un drame au bord de la mer
Lausanne ; Skira
1946 Couv ill
Adieu ; Etude de femme ; Une lutte ; Le dôme des Invalides
Lausanne, Skira
1946 Couv ill
Melmoth réconcilié ; Jésus-Christ en Flandre ; Le message
Lausanne, Skira
1946 Couv ill
Gobseck ; Un entr'acte ; L'épicier ; Le message
Lausanne, SKira
1946 Couv ill
La comédie du diable ; Aventures administratives d'une idée heureuse ; Le message
Lausanne, Skira
1946 Couv ill
L’Elixir de longue vie, El
Lausanne, Skira
1946 Couv ill
248
Verdugo, Les Proscrits
Honoré de Balzac. Scènes éparses. [6.] Traité de la vie élégante. Physiologie de la toilette
Paris, Nouvelle société d’édition
1946 Beuville Couv ill Ill en coul
La comédie du diable ; Aventures administratives d'une idée heureuse ; Le message
Genève, Editions Albert Skira ; Petite collection Balzac
1946 Pablo Picasso
Couv ill
La fille aux yeux d’or : roman. La Bourse
Paris, Gründ, Collection Gründ illustrée. Série Coquelicot
1947 Henri Dimpre
Ill
Le colonel Chabert ; Le Curé de Tours, El Verdugo
Paris, Gründ ; Collection Gründ illustrée. Série Coquelicot
1947 Jacques Liozu
Ill
Le Colonel Chabert ; la Grenadière
Paris, Éditions de Montsouris ; coll. Dauphine
1947 Couv ill Portr.
Le réquisitionnaire ; Un épisode sous la terreur ; L'auberge rouge
Lausanne, Skira
1947 Couv ill
Le Colonel Chabert, suivi de L’Empereur (Livre
Paris, Editions G.P. ; Collection "Rouge &
1947 Ill
249
jeunesse) Or"
Sarrasine, La Messe de l’athée
Lausanne, Skira
1947 Couv ill
Les Marana ; Vengeance d’artiste
Lausanne, Skira
1947 Couv ill
Les Parisiens comme ils sont. 1830-1846 ; [suivi du] Traité de la vie élégante
Genève, La Palatine
1947 Ill
La fille aux yeux d’or ; La bourse
Paris, Gründ ; Collection Gründ illustrée. Série Coquelicot
1947 Henri Dimpre
Ill
Louis Lambert, le collège de Vendôme. Adieu
Paris, Hatier ; coll. Les classiques pour tous
1948 Couv ill
La Femme de trente ans ; Une Double famille
Paris, Bordas, coll. Les grands maîtres
1948 Ill
Le Colone chabert ; Adieu ; La Grenadière
Paris, Delagrave ; coll. Bibliothèque Juventa
1948 Lecoultre Couv ill en coul Ill
La Maison du chat-qui-pelote ; Le Lys dans la vallée
Paris, le Club français du livre
1949 Ill Ill non originales
1950-1960
La vieille fille. [Suivi de] La Duchesse de Langeais
Paris, le Club français du livre ; coll. Classiques
1950 Ill in-8
Scènes de la Paris, A. 1950 Couv ill
250
vie politique. Une ténébreuse affaire. Un épisode sous la Terreur
Michel
Scènes de la vie militaire. Les Chouans. Une passion dans le désert
Paris, A. Michel
1950 Couv ill
Balzac. Études philosophiques. La Recherche de l'absolu, Le Chef-d'oeuvre inconnu. Jésus-Christ en Flandre. Melmoth réconcilié
Paris, A. Michel
1951 Couv ill
L’Interdiction, suivi de La Vieille fille, Etude de femme, autre étude de femme
Paris, Imprimerie Nationale
1951 Ill Œuvres choisies
La fille aux yeux d’or ; La paix du ménage
Paris, Éditions La Bruyère ; Collection Select-Univers. Série Amour
1951 Couv ill
La Fille aux yeux d’or. Ferragus
Paris, Editions Athêna
1952 Raoul Auger
Couv ill Ill
Le colonel Chabert, suivi d’Adieu (livre pour la jeunesse)
Paris, Librairie Delagrave
1957 Ill
251
Une passion dans le désert avec... Jésus-Christ en Flandre ; Adieu ; le Réquisitionnaire ; Maître Cornélius
Paris, Editions de la Bibliothèque mondiale
1956 Couv en coul Ill
L’Illustre Gaudissart ; La muse du département
Paris ; Londres ; Edimbourg : Nelson éditeurs
1956 Jaq. Ill en coul
La duchesse de Langeais, suivi de La fille aux yeux d’or
Paris, le Livre de poche
1958 Couv en coul + portr
La Peau de Chagrin ; Le Curé de Tours ; Le Colonel Chabert
Paris, Nelson
1958 Couv ill en coul
La Peau de Chagrin ; Le Curé de Tours ; Le Colonel Chabert
Paris, NY, Londres
1958 pl. en coul., jaq. ill. en coul.
La Maison du Chat-qui-pelote, Le Bal de Sceaux, La Bourse
Paris, Nelson
1959 Couv ill en coul
L'Envers de l'histoire contemporaine : suivi d'un fragment inédit, les Précepteurs en Dieu.
Paris, Garnier frères
1959 Ill
Louis Lambert. Séraphita [Appendice :
Strasbourg, Editions Brocéliande ; col.
1959 Ill
252
Le Livre mystique, préface de la première édition de : "Les Proscrits, Louis Lambert, Séraphita", 1835.
Source
1960-1970
Le Colonel Chabert, Adieu
Paris, Librairie Delagrave ; coll. Bibliothèque juventa
1960 Pierre Rousseau
Couv ill en coul Ill
L'Auberge rouge, récit, suivi de : Un Épisode sous la Terreur, le Réquisitionnaire, el Verdugo (le bourreau) [Livre jeunesse]
Paris, Casterman
1961 Couv ill en coul Ill
Le Cousin Pons, suivi de : Une Passion dans le désert ; la Réquisitionnaire [Livre jeunesse]
Paris, Les amis des livres ; coll. Le Club des trois couronnes
1961 Ill
Le Curé de Tours. Pierrette
Paris, Garnier frères
1961 Ill
La Recherche de l’absolu, suivi de Le Réquisitionnaire
Paris, Editions Alpina
1962 Cart ill
Histoire des Treize, 2 vol.
Paris, Club des amis
1962 Ill en n et coul
253
du livre, coll. Le Meilleur livre du mois
Cart ill
Histoire des treize. Ferragus. La Duchesse de Langeais. La Fille aux yeux d'or
Verviers, Gérard et Cie
1962 Couv ill en coul
La Maison du Chat-qui-pelote, Le Bal de Sceaux, La Vendetta
Paris, Garnier frères
1963 Couv ill Ill
Honorine ; le Colonel chabert
Paris, Charpentier ; coll. Ouvrage de poche
1963 Couv ill
Histoire des treize. Ferragus ; La duchesse de Langeais ; La fille aux yeux d'or
Club des libraires de France ; coll. Livres de toujours
1963 Ill
Le colonel Chabert ; Suivi de Ferragus, chef des Dévorants.
Paris, Le Livre de poche
1964 Couv ill
La Vieille fille ; Le Cabinet des Antiques
Paris, Le Livre de poche
1964 Couv ill en coul
Le Colonel Chabert, suivi de Honorine et de l’Interdiction
Paris, Garnier frères ; coll. Classiques
1964 Ill
Études de moeurs. Scènes de la
Paris, A. Michel
1964 Cart ill Ill
254
vie parisienne. Histoire des Treize. Ferragus. La Duchesse de Langeais. La Fille aux yeux d'or, 2 vol.
La Duchesse de Langeais ; suivi de La Femme de trente ans ; La Fille aux yeux d'or
Paris, Editions Baudelaire ; coll. Livre Club des Champs-Elysées
1965 James Hodges
Couv ill en coul Ill
La Fausse Maîtresse ; suivi de La Paix du ménage ; Etude de femme ; Autre étude de femme ; Une double famille
Paris, Editions Baudelaire, coll. Livre Club des Champs-Elysées
1966 Alain Girard
Couv ill en coul Ill
Les Petits Bourgeois ; suivi de Monographie du rentier ; La Maison du chat-qui-pelote ; Le Bal de Sceaux ; La Vendetta
Paris, Editions Baudelaire, coll. Livre Club des Champs-Elysées
1966 Ill
La Duchesse de Langeais, suivi de La Fille aux yeux d’or
Paris, Le Livre de poche
1966 Couv ill en coul
La comédie humaine. 11-12 Titres contenus :
Etampes, Gasnier
1966 Cuca Romley
Couv ill Ill
255
Les Lys dans la vallée ; La Fille aux yeux d’or
L'Illustre Gaudissart. La Muse du département
Paris, L. Mazenod ; coll. Les Écrivains célèbres. 53. Le Romantisme
1966 Ill
Le Colonel Chabert, Honorine l’Interdiction
Paris, Garnier frères
1966 Ill
Histoire des treize. Ferragus. La Duchesse de Langeais. La Fille aux yeux d'or
Paris : Garnier frères
1966 Couv ill Ill
Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau ; suivi de la Maison Nucingen
Paris, le Livre de poche
1966 Couv ill en coul
Le Cousin Pons, Suivi d’Une Passion dans le désert et le Réquisitionnaire.
Paris, O.D.E.G.E
1967 Ill
La recherche de l’absolu suivi de La Messe de l’athée
Paris, Le livre de poche
1967 Couv ill en coul
Les Célibataires
Paris, Le Livre de poche
1967 Couv ill en coul
Le Curé de Tours, Pierrette
Paris, Garnier frères
1967 Ill
256
Le père Goriot ; Eugènie Grandet
Paris : le Club des classiques
1967 Ill
Pierrette, suivi de Le Curé de Tours
Paris, le Livre d poche
1967 Couv ill en coul
Louis Lambert, suivi de Les proscrits et de Jésus-christ en Flandre
Paris, Le Livre de Poche
1968 Couvill en coul
Le Curé de Tours ; La Grenadière ; L’illustre Gaudissart
Paris, Garnier-Flammarion
1968 Couv ill en coul
La fausse maîtresse ; suivi de Albert Savarus et de Honorine
Paris, Le Livre de poche
1968 Couv ill en coul
Louis Lambert, suivi de Les proscrits et de Jésus-Christ en Flandre
Paris, Le livre de poche
1968 Couv ill en coul
Une fille d'Éve ; (suivi de) La muse du département
Paris, Le Livre de Poche
1969 Couv ill en coul
Le colonel Chabert ; suivi de Le curé de Tours et de La Grenadière
Saint-Ouen, Editions Chaix-Desfossés-Néogravure ; coll. Le fil d’Ariane
1969 Jean-Jacques Vayssières
Couv ill Ill
Gobseck ; suivi de Facino Cane et de Maître Cornélius
Paris, Le Livre de poche
1969 Couv ill en coul
257
Un début dans la vie ; suivi d’Un Prince de la Bohême ; et de Un homme d'affaires
Paris, Le Livre d Poche ; coll. Pluriel
1969 Couv ill en coul
Gobseck, suivi de Facino Cane et de Maître Cornélius
Paris, Le Livre de poche
1969 Couv ill en coul
1970-1980
La Maison du Chat-qui-Pelote, Le Bal de Sceaux, La Vendetta, La Bourse
Paris, Le Livre de poche
1970 Couv ill en coul
Eugénie Grandet, suivi en appendice des extraits de La Recherche de l’absolu et de La Vendetta
Paris, nouvelle éd. Larousse
1970 Couv ill Ill
Le chef-d'œuvre inconnu ; suivi de Pierre Grassou, Sarrasine, Gambara et Massimilla Doni
Paris, Le Livre de Poche
1970 Couv ill en coul
Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau ; suivi de la Maison Nucingen
Paris, Le Livre de Poche
1970 Couv ill en coul
258
L’Illustre Gaudissart ; La Muse du département
Paris, Garnier ; coll. Classiques
1970 Couv ill Ill
L'illustre Gaudissart ; suivi de Z. Marcas ; Gaudissart II ; Les comédiens sans le savoir ; et Melmoth réconcilié
Paris, Le Livre de poche
1971 Couv ill en coul
Études de femmes : Étude de femme. Autre étude de femme. La femme abandonnée. La Grenadière. Madame Firmiani. Les secrets de la princesse de Cadignan. Le message
Paris, Le livre de poche
1971 Couv ill en coul
L’Elixir de longue vie et autres contes fantastiques
Verviers, Gérard et Cie ; Paris, l'Inter
1971 Couve ill en coul
Le Médecin de campagne, suivi de La confession
Paris, Le Livre de Poche
1972 Couv ill en coul
Sarrasine, La Comédie du diable, L’Enfant maudit, El Verdugo, Etude de femme
Paris, Hatier
1972 Johannot Porret Ill Ill non originales
Sarrasine ; suivi d’Une Passion dans
Paris, Cercle européen
1973 Philippe Degrave
Ill
259
le désert ; La Fille aux yeux d'or ; La Duchesse de Langeais
du livre ; coll. Chefs-d'oeuvre interdits
La Duchesse de Langeais, suivi de La Fille aux yeux d’or
Paris, Le Livre de poche
1973 Couv ill en coul Ill
Une Double Famille ; Le contrat de mariage, L’Interdiction
Paris, Gallimard
1973 Couv ill en coul
Le contrat de mariage ; précédé d’Une double famille ; et suivi de L'interdiction
Paris, Gallimard
1973 Couv ill en coul
Le colonel Chabert ; Suivi de Ferragus, chef des Dévorants.
Paris, Le Livre de poche
1973 Couv ill Ill
Chefs d'œuvre interdits : Sarrasine, Une passion dans le désert, La Fille aux yeux d’or, La Duchesse de Langeais
Paris, Cercle européen du livre
1973 Philippe Degrave
Ill
L’Illustre Gaudissart ; La muse du département
Paris, J. Tallandier ; Le Trésor des lettres françaises
1973 Portr
Le Colonel Chabert, suivi de Ferragus, chef des Dévorants
Paris, Librairie générale française ; coll. Le livre de poche classiques
1973 Ill
260
Hitoire des treize
Paris, J. Tallandier ; coll. Le Trésor des lettres françaises
1973 Portr.
Le colonel Chabert ; (suivi de) El Verdugo ; Adieu ; Le Réquisitionnaire
Paris, Gallimard
1974 Couv ill en coul
Le Curé de Tours, suivi de Pierrette
Paris, Gallimard
1975 Couv ill en coul
La Duchesse de Langeais ; La Fille aux yeux d’or
Paris, Gallimard ; coll. Folio classique
1976 Couv ill en coul
César Birotteau, suivi de Le Colonel Chabert
Paris, Rombaldi ; coll. Le Club des classiques
1976 Ill
Contes étranges, 2 vol.
Nice, Le Chant des Sphères
1976 Arnaud Ansaldi
Ill en coul
La recherche de l’absolu suivi de La Messe de l’athée
Paris, Gallimard ; Coll. Folio classique
1976 Couv ill en coul
La duchesse de Langeais, suivi de La fille aux yeux d’or
Paris, Librairie générale française ; Prestige du livre
1976 Ill
La Comédie humaine 1. Les Chouans. Avertissement du gars ; Les Deux rêves ; Physiologie du mariage ;
Paris, Rencontre ; Genève, Édito-service ; Coll. Belvedere
1977 Portr.
261
Petites misères de la vie conjugale ; El Verdugo ; La Paix du ménage ; La Maison du Chat-qui-pelote ; Le Bal de Sceaux ; Un Épisode sous la Terreur
Le Colonel Chabert, suivi d’Une Ténébreuse affaire
Genève, Famot ; coll. Les Grands romans historiques
1978 Ill
Les Chouans, suivi d’Une Ténébreuse affaire
Paris, Gallimard
1978 Tony Johannot, Staal, Bertall et Daumier
Ill Ill non originales
Eugènie Grandet, Ursule Mirouet
Paris, Hachette
1979 Nanteuil ; Staal ; Monnier
Ill
Louis Lambert, suivi de Les proscrits et de Jésus-Christ en Flandre
Paris, Gallimard
1979 Couv ill en coul
Eugènie Grandet, suivi de Le Père Goriot (livre jeunesse)
Paris, Gallimard ; coll. Collection 1000 soleils or
1979 Couv ill en coul Ill
Histoire des treize
Paris, Hachette ; coll. Grandes Œuvres
1979 Bertall Daumier Lampsonius Nanteuil
Couv ill en coul Ill
1980-1990
Les secrets de la princesse de
Paris, Gallimard,
1980 Couv ill en coul
262
Cadignan et autres études de femmes Réunit : "Étude de femme", "Autre étude de femme", "La femme abandonnée", "La Grenadière", "Madame Firmiani", "Les secrets de la princesse de Cadignan" et "Le message"
Folio
Une fille d'Ève ; La fausse maîtresse
Paris, Gallimard ; coll. Folio Classique
1980 Couv ill en coul
Etudes de femmes
Paris, Gallimard
1980 Couv ill en coul
Le Père Goriot [Texte imprimé] ; Illusions perdues ; Splendeurs et misères des courtisanes
Paris, R. Laffont ; coll. Bouquins
1980 Couv ill
Le Colonel Chabert, suivi de El Verdugo, Adieu, Le Réquisitionnaire
Paris, Gallimard ; coll. Folio
1980 Couv ill en coul
Le Lys dans la vallée ; La Femme de trente ans (livre pour jeunesse)
Paris, Hachette ; coll. Grandes œuvres
1980 Couv ill en coul Ill
Le père Goriot ; La
Paris, Hachette
1980 Bertall, Daumier,
Couv ill en coul
263
Peau de chagrin (livre pour jeunesse )
Janet-Lange, Lampsonius, Célestin Nanteuil
Ill
Louis Lambert ; Les Proscrits ; Jésus-Christ en Flandre
Paris, Gallimard ; coll. Folio classque
1980 Couv ill en coul
Le chef-d’œuvre inconnu ; Gambara ; Massimilla Doni
Paris, Flammarion
1981 Couv ill en coul
Histoire véritable de la bossue courageuse : [et autres textes] Réunit : La dernière fée (épisode) Histoire véritable de la bossue courageuse Jésus-Christ en Flandre La tour de la Birette L'élixir de longue vie Le pacte Melmoth réconcilié La somnambule de la rue Saint-Honoré L'opium Les deux rêves Le conte de fées du
Paris, union générale d’éditions ; coll. Les Maîtres de l'étrange et de la peur
1981 Couv ill en coul
264
fantassin Goguelat Le grand d'Espagne Sarrasine
Histoire des treize ; Ferragus, La Duchesse de langeais, La Fille aux yeux d’or, Gaudissart II
Paris, Conservation du château de Langeais
1982 Johannot et al.
Couv ill Ill
Fac-simile Maresq
La Maison du chat-qui-pelote, Le Bal de Sceaux, La Vendetta, La Bourse
Paris, Gallimard ; coll. Folio
1983 Couv ill en coul
Histoire des Treize
Paris, Librairie générale française
1983 Couv ill en coul
Gobseck ; Une Double famille
Paris, Flammarion
1984 Couv ill en coul
La Muse du Département ; Un Prince de la Bohème
Paris, Gallimard
1984 Couv ill en coul
Le Colonel Chabert, suivi de Le contrat de mariage
Paris, Le Livre de Poche
1984 Couv ill en coul Ill
La Maison du Chat-qui-Pelote ; Le Bal de Sceaux ; La Bourse ; La Vendetta ; Madame Firmiani ; La Fausse maîtresse ; Étude de femme ;
Paris, J. de Bonnot
1984 Ill
265
Albert Savarus
La Maison du chat-qui-pelote, Le Bal de Sceaux, La Vendetta, La Bourse
Paris, Flammarion
1985 Couv ill en coul
Histoie des treize. Ferragus ; La duchesse de Langeais ; La fille aux yeux d'or
Paris : Garnier frères ; coll. Classiques
1985 Ill
Une Ténébreuse ; L'Interdiction ; Un Prince de la Bohème ; Les Secrets de la princesse de Cadignan ; Sarrasine
Paris, J. de Bonnot
1986 Ill
Avertissement du gars. Honoré de Balzac ; Les Chouans ; Une Passion dans le désert ; Un Épisode sous la Terreur ; Le Réquisitionnaire ; Les Marana
Paris, J. de Bonnot
1986 (o 1987 ? ci sono due date diverse)
Ill
La Vieille fille, Le Cabinet des Antiques
Paris, Flammarion
1987 Couv ill en coul
Nouvelles révolutionnaires (une episode sous la T + l’auberge rouge)
Paris, Presses pocket
1988 Couv ill en coul
266
Ferragus, La Fille aux yeux d’or
Paris, Flammarion ; coll. GF
1988 Couv ill en coul
Le colonel Chabert : et autres aventures héroïques... : extraits (Adieu, El Verdugo, Le réquisitionnaire)
Paris, Bordas, coll. Univers des lettres Bordas. Extraits
1989 Ill
La Maison Nucingen, précedé de Melmoth réconcilié
Paris, Gallimard
1989 Couv ill en coul
Le Père Goriot suiv de Eugènie Grandet
Paris, Larousse ; coll. Collection des grands classiques Larousse
1989 Ill
1990-2000
Théorie de la démarche et autres textes [Physiologie gastronomique Grandeur et servitude du dandysme Traité des excitants modernes Physiologie de la toilette]
Paris, A. Michel
1990 Couv ill en coul
Ferragus ; suivi de La Fill aux yeux d’or
Paris, Flammarion
1990 Couv ill
Le Colonel Chabert, Le contrat de
Paris, Librairie générale
1990 Controlla se cou ill
267
mariage française
Le curé de Tours, suivi de Pierrette
Paris, Gallimard ; coll. Folio
1992 Couv ill en coul
La recherche de l’absolu, suivi de La messe de l‘athée
Paris, Gallimard ; coll. Folio
1992 Couv ill en coul
Histoire des Treize
Paris, Presses pocket, coll. Lire et voir les classiques
1992 Couv ill en coul Ill en n et coul
Traité des excitants modernes ; suivi de Physiologie de la toilette ; et de Physiologie gastronomique
Bègles, Le Castor astral ; coll. Les inattendus
1992 Couv ill Ill
Le Colonel chabert, suivi de L’Interdiction
Paris, Garnier-Flammarion ; coll. GF
1993 Couv ill en coul
Un début dans la vie, prédédé de Le temps est un grand maigre
Paris, POL 1993 Couv ill en coul
Le chef-d’œuvre inconnu ; "L'élixir de longue vie" ; "L'auberge rouge" ; "Maître Cornélius" ; "Un drame au bord de la mer" ; "Facino Cane" ; "Pierre
Paris, Gallimard ; coll. Folio
1994 Couv ill en coul
268
Grassou".
L'illustre Gaudissart ; Gaudissart II ; Facino cane
Castelnau-le-Lez : Ed. Climats
1994 Couv ill
Melmoth réconcilié, Le Message
Castelnau-le-Lez : Climats
1994 Couv ill
El verdugo ; Un épisode sous la terreur ; Une étude de femme ; L'élixir de longue vie
Castelnau-le-Lez : Climats
1994 Couv ill
Le colonel Chabert ; Peines de cœur d’une chatte anglaise
Paris, Bookking international ; coll. Classiques français
1994 Couv ill en coul
Une double famille ; suivi de Le contrat de mariage ; et de L'interdiction
Paris, Gallimard ; coll. Folio
1995 Couv ill
Le Chef-d'oeuvre inconnu. Suivi de La leçon de violon
Paris : Librairie générale française
1995 Couv ill en coul Ill
Sarrasine, Gambara, Massimilla Doni
Paris, Gallimard
1995 Couv ill en coul
Histoire des Treize
Paris : Librairie générale française
1996 Couv ill en coul
La duchesse de Langeais ; la fille aux yeux d’or
Paris, Au sans pareil ; coll. La bibliothèque des chefs-
1996 Couv ill en coul Ill
269
d'oeuvre
Gambara, Massimilla Doni
Genève, Slatkine
1997 Couv ill en coul
Melmoth réconcilié, suivi de Jésus-Christ en Flandre
Paris, EJL 1997 Couv ill en coul
Traité de la vie élégante ; suivi de Théorie de la démarche
Paris, Arléa
1998 Couv ill en coul
Histoire des treize
Paris, Pocket ; coll. Classiques
1998 Couv ill
Contes étranges et fantastiques Réunit : Melmoth réconcilié, L’elixir de longue vie, Le sorcier
Editions 1 1999 Couv ill en coul
Scènes de la vie politique. Un épisode sous la Terreur ; Une ténébreuse affaire ; Le député d'Arcis ; Z. Marcas
Paris, Éd. du Carrousel,
1999 Couv ill en coul
Gobseck ; suivi de Maître Cornélius, Facino Cane et Adieu
Paris, Les éditions du Carrousel ; coll. Littérature
1999 Couv ill en coul
La Grenadière : et autres récits tourangeaux
Saint-Cyr-sur-Loire, C. Pirot
1999 Jean Jack Martin
Couv ill en coul Ill
270
de 1832
Une ténébreuse affaire ; Le député d'Arcis
Paris, Librairie générale française
1999 Couv ill en coul Ill
La Vendetta, suivi de La Bourse
Paris, EJL 1999 Couv ill en coul
Le Médecin de campagne, suivi de La confession
Paris, Librairie générale française ; coll. Classiques de poche
1999 Couv ill en coul Ill
La Grenadière [Texte imprimé] : et autres récits tourangeaux de 1832
Saint-Cyr-sur-Loire, C. Pirot
1999 Couv ill en coul
Histoire des treize
Paris, Librairie générale française ; coll. Classiques de poche
1999 Couv ill en coul
2000-2010
La Vieille fille, suivi de Le Cabinet des Antiques
Paris, Flammarion ; coll. GF
2000 Couv ill en coul
Pierrette, suivi de Ursule Mirouet
Étrépilly : les Presses du village ; collection Bleu
2001 Couv ill
La duchesse de Langeais ; Une ténébreuse affaire
Paris, Maxi-livres ; coll. Maxi-poche romans
2002 Couv ill en coul
Histoire des Paris, 2003 Couv ill en
271
Treize : 1833-1835
Hatier ; coll. Classiques & Cie
coul Ill
L’Elixir de longue vie, précédé de El Verdugo
Paris, Librairie générale française
2003 Couv ill en coul
Nouvelles Réunit : "La bourse" ; "El Verdugo" ; "Adieu" ; "Le réquisitionnaire" ; "L'auberge rouge"
Paris, L’Ecole des loisirs
2004 Couv ill en coul
Le chef-d’œuvre inconnu (1831) ; Sarrasine (1830)
Paris, Hatier ; coll. Classiques & Cie
2005 Couv ill en coul Ill
Le Colonel Chabert ; Facino Cane
Paris, Éd. du Chemin bleu
2005 Couv ill
Le chef-d'oeuvre inconnu : Pierre Grassou et autres nouvelles
Paris, Gallimard
2005 Couv ill en coul
Voyage de Paris à Java [Texte imprimé] : 1832 ; suivi... de La Chine et les Chinois : 1842
Arles, Actes Sud ; [Montréal], Leméac ; coll. Babel
2006 Couv ill en coul
La Comédie des ténèbres Réunit : "Le centenaire ou Les deux Béringheld" ;
Paris, Omnibus
2006 Couv ill en coul Ill
272
"Le pacte" ; "La comédie du diable" ; "Jésus-Christ en Flandre" ; "Melmoth réconcilié" ; "La dernière fée" ; "Histoire véritable de la bossue courageuse" ; "L'élixir de longue vie" ; "Les deux rêves" ; "L'opium" ; "Les litanies romantiques" ; "Le dôme des Invalides" ; "La peau de chagrin" ; "Maître Cornélius" ; "Le réquisitionnaire" ; "Les visions d'Ursule Mirouët" ; "L'auberge rouge" ; "Adieu" ; "La somnambule de la rue Saint-Honoré" ; "Le "grand jeu" de Madame Fontaine" ; "Le musicien ambassadeur de l'enfer" ; "Les proscrits" ;
273
"Les martyrs ignorés" ; "Aventures administratives d'une idée heureuse" ; "Séraphita"
Le Peintre et son modèle : Réunit : "Le chef-d'oeuvre inconnu" / d'Honoré de Balzac. "Le fils du Titien" / d'Alfred de Musset. "La toison d'or" / de Théophile Gautier.
Paris, Gallimard
2006 Couv ill Ill
Les Rivalités Paris, Librairie Générale française
2006 Couv ill en coul
Adieu, Les Marana, Le Réquisitionnaire
Paris, la Table ronde
2007 Couv ill en coul
La Muse du département, Un Prince de la Bohème
Paris, Gallimard
2007 Couv ill en coul
Sarrasine, Gambara, Massimilla Doni
Paris, Gallimard
2007 Couv ill en coul
Le chef-d’œuvre inconnu ; Gambara ; Massimilla Doni
Paris, Flammarion
2008 Couv ill en coul
La duchesse de Langeais, Ferragus ; La fille aux yeux d'or
Paris, Hatier ; coll. Classiques & Cie
2008 Couv ill Ill
Le chef- Paris, 2009 Couv ill en
274
d’œuvre inconnu suivi de la maison du chat-qui-pelote
Librio coul
2010-2020
Nouveaux contes philosophiques : Maître Cornélius. Madame Firmiani. L'auberge rouge. Louis Lambert
Toronto, Editions de l’originale
2010 Couv ill
La duchesse de Langeais, 1834 ; suivi de Ferragus : 1834 ; et de La fille aux yeux d'or : 1834
Paris, Hatier ; Classiques & Cie. Lycée
2011 Couv ill en coul
Le Chef d'oeuvre inconnu : 1831 ; Sarrasine : 1830 [livre pour jeunesse]
Paris, Hatier, coll. Classiques & Cie. Lycée
2012 Couv ill en coul Ill
Traité de la vie élégante ; suivi de Théorie de la démarche
Paris, Ed. Payot et Rivages ; coll. Rivages poche. Petite bibliothèque
2012 Couv ill en coul
Traité de la vie élégante, suivi du Code de la toilette
Paris, les Ed. de l’Amateur
2012 Jaquette ill en coul Ill
La femme abandonnée ; suivi de Le Message
Paris, Librio ; coll. Littérature
2013 Couv ill en coul
275
Le chef-d’œuvre inconnu 1831 ; suivi de Sarrasine, 1830
Pais, Hatier ; coll. Classiques & Cie. Lycée
2013 Couv ill en coul
Ferragus ; La Fille aux yeux d’or
Paris, Flammarion ; coll. GF
2014 Couv ill en coul
Traité de la vie élégante ; Physiologie du rentier de Paris ; Physiologie de l'employé ; Les boulevards de Paris
Rungis, Maxtor
2014 Ill
Vojage de Paris, à Java, suivi d’Un drame au bord de la mer
Paris, Gallimard
2015 Couv ill en coul
Le curé de Tours, suivi de Pierrette
Paris, Gallimard
2015 Couv ill
S.D.
La Peau de chagrin ; Le curé de Tours ; Le colonel Chabert
Paris ; Londres ; New-York : Nelson
s.d. Ill Jaquette ill en coul
Le père Goriot ; Les illusions perdues ; Splendeurs et misères des courtisanes – 3 vol
Paris, Ambassade du livre
s.d. Ill
La Maison du Chat-qui-pelote, Le Bal de Sceaux
Paris, Flammarion
s.d. Couv ill en coul
276
Les Rivalités Paris, Flammarion
s.d. Couv ill
Les Chouans ; Un drame au bord de la mer
Paris, impr. S. Rançon
s.d. Ill
Œuvres illustrées de Balzac. L’Enfant maudit ; Les Proscrits
Paris, impr. S. Rançon
s.d. Gr. in-8°
Oeuvres illustrées de Balzac, Louis Lambert. L'Élixir de longue vie
Paris, impr. S. Rançon
s.d. Gr. In-8°
Oeuvres illustrées de Balzac. Une fille d'Ève. Madame Firmiani
Paris : impr. de S. Raçon
s.d. Gr. In-8°
La Peau de chagrin ; El verdugo
Paris, impr. Schneider
18 ?? Janet Lange
Ill
Nouvelles : "La bourse" ; "El Verdugo" ; "Adieu" ; "Le réquisitionnaire" ; "L'auberge rouge"
Paris, l’école des loisirs
? Couv ill en coul
L’auberge rouge, suivi de La grande Bretèche, suivi de La vendetta
Paris, La technique du livre
s.d. Couv ill
La fausse maîtresse ; suivi de Le
Paris, La technique du livre,
s.d. Couv ill
277
curé de Tours ; suivi de La femme abandonnée
coll. Les Chefs-d’oeuvre français
La femme abandonnée, suivi de Le Message
Paris, Librio
? Couv ill en coul
La fausse Maîtresse. Les Parisiennes. La Grande Bretèche
Paris, Nilsson
s.d. Couv ill
La Paix du ménage, mœurs parisiennes du Premier Empire. Adieu, épisode de la retraite de Russie. Le Réquisitionnaire, souvenir de la Grande Révolution
Paris, Nilsson ; Les Cent chefs-d'oeuvre qu'il faut lire
s.d. Couv ill
La Maison du chat-qui-pelote, La Bourse, Le Bal de Sceaux
Paris, R. Simon
s.d. Couv ill en coul
Images tourangelles : illustrant quelques fragments de textes - Extraits du Lys dans la vallée, du Curé de Tours, de la Femme de trente ans, des Contes drolatiques,
Tours, M. T. Mabille
s.d. Marie-Thérèse Mabille
Ill en coul
278
de Maître Cornélius et de la Grenadière
Eugènie Grandet ; Le Chef-d’œuvre inconnu
Mesnil, impr. Didot
18 ?? Johannot, Staal, Bertall, Daumier, E. Lampsonius
Ill
Eugènie Grandet ; Le Chef-d’œuvre inconnu
Paris, impr. Schneider
18 ?? Johannot, Staal, Bertall, Daumier, E. Lampsonius
Ill
La peau de chagrin ; Le curé de Tours ; Le colonel Chabert
Paris ; Londres ; New-York : Nelson ; Coll. Nelson
S.d. Jaq. Ill en coul Ill en coul
La fausse maîtresse ; (suivi de) Le curé de Tours ; (suivi de) La femme abandonnée
Paris : La Technique du Livre ; coll. Les chefs-d'oeuvre français
19 ?? Couv ill
Une fille d’Eve, Madame Firmiani
Paris, Gustave Havard ; coll. Œuvres illustrées de Balzac. Comédie Humaine
s.d. (18 ??)
Johannot, Lampsonius, Bertall et al.
Ill
Oeuvres de]. 1, Le Père Goriot. Les Illusions perdues. 1re partie
l'Ambassade du livre
s.d. Cart. Ill Ill
Le Colonel Chabert, roman.
Paris, Nilsson ; coll. es
s.d. Couv ill, in-16
279
Gobseck l'usurier, roman
Cent chefs-d'oeuvre qu'il faut lire, à 95 centimes
Oeuvres illustrées de Balzac. Les Employés. Gobseck
Paris : impr. de S. Raçon
s.d. Gr. In-8°
Le Père Goriot ; Les Illusions perdues ; Splendeurs et misères des courtisanes 3 vol in-16
L’Ambassade du livre
s.d. Cart ill Ill
Les Proscrits : études philosophiques ; (suivi de) El Verdugo ; (suivi de) Le colonel Chabert
Paris, les Belles Editions
193 ? Couv ill
281
Annexe 15 : Catalogue des éditions illustrées des « Œuvres complètes illustrées » et de « La Comédie humaine »
• Éditions illustrées :
1. La Comédie humaine. Œuvres complètes de M. de Balzac, Paris, Furne, Dubochet et cie, Hetzel (et
Paulin pour les tomes I et II), 1842-1846. 17 vol. in-8°.
2. Œuvres illustrées de Balzac, Paris, Maresq et Cie, 1851-1853, 10 vol. in-4°. Réimprimées chez
l’éditeur Raçon et l’éditeur Léjay dans les mêmes années.
3. La Comédie humaine. Œuvres complètes de M. de Balzac, Paris, Houssiaux, 1853-1855, 20 vol in-8°.
4. Œuvres complètes de Balzac, Paris, vve Houssiaux, 1877, 20 vol. in-8°.
5. Œuvres complètes illutrées, Paris, Michel Lévy, 1869-1876. 24 vol. in-8°.
6. Œuvres complètes, Paris, Ollendorff, 1900-1902, 46 vol. Planches hors-texte, Illustrations par Adrien Moreau
et Cortazzo. Les volumes des Œuvres diverses n’ont pas été illustrées.
6. Œuvres complètes de Honoré de Balzac, Paris, Louis Conard, 1912-1940, 40 vol. in-8°. Illustrations par Charles
Huard, gravées par Pierre Gussman.
7. Œuvres illustrées de Balzac, Givors, A. Martel, 1946-1951, 31 vol. in-8°.
8. Œuvres complètes illustrées, Paris, Albert Guillot, 1946-1953, 50 vol. in-8°.
9. L’œuvre de Balzac publiée dans un ordre nouveau sous la direction d'Albert Béguin et de Jean A. Ducourneau,
Paris, le Club français du livre, 1965-1976, 16 vol, portr. et ill provenant d’autres éditions.
10. Œuvres complètes, Paris, Club de l’honnête homme, 1968-1971, 24 vol.
11. La Comédie humaine, Lausanne, éd. Rencontre, 1960-1962, 24 vol.
12. Œuvres complètes illustrées, Paris, G. le Prat, 1960-1961, 3 vol in-4°.
13. Œuvres complètes illustrées, Paris, les Bibliophiles de l’originale, 1965-1971, 30 vol. in-8°. [Fac-
simile Furne]
14. Œuvres complètes, Genève, Cercle du bibliophile, 1967, 37 vol. in-8°.
15. L’œuvre de Balzac, Paris, Club français du livre, 1962-1965, 16 vol. in-8°.
16. La Comédie humaine, Genève, Edito-Service, 1979-1981, 24 vol.
17. La Comédie humaine, Paris, éd. J. de Bonnot, 1984-1987, 28 vol.
• Editions avec couverture illustrée et/ou frontispice :
1. La Comédie humaine, Genève, Edito-Service, 1978-1979 ; portr.
2. La Comédie humaine, éditions Balzac, 194 ? ; couv ill
3. La Comédie humaine, Paris, Editions du Seuil, coll. L’Intégrale,1965-1966, 6 vol. ; portr.
4. La Comédie humaine, Paris, France loisirs, 1999, 12 vol. ; couv ill + jaquette ill. en coul.
5. La Comédie humaine, Paris, Classiques Garnier « Le Monde », 2008-2009, 26 vol, couv ill ; les
volumes 25 et 26 sont illustrées.
283
ANNEXE 16 : CATALOGUE DES GROUPES D’ŒUVRES, QUI NE
RECUEILLENT PAS LA TOTALITE DE L’ŒUVRE BALZACIENNE
• Editions illustrées :
1. Œuvres choisies, Paris, Imprimerie nationale, 1950-1952, 10 vol. in-8°.
2. La Comédie humaine : Etudes de mœurs, Paris, Nouvelle librairie de France, 1999, 7 vol.
3. La Comédie humaine. Textes choisis, Paris, Omnibus, 1999
4. La Comédie des ténèbres, Paris, Omnibus, 2006.
• Editions avec couverture illustrée et/ou frontispice :
1. Œuvres complètes. La Comédie humaine. Théâtre. Les Contes drolatiques, Paris, La Renaissance
du Livre, E. Mignot, 1911 (1912 ?), 3 vol. in-4°; portr. au t.I.
2. La Comédie humaine, Paris, Rencontre, Genève, Édito-service, coll. Collection Belvédère,
1977, 10 vol. ; portr. au tome I.
3. La Comédie humaine, Clermont-Ferrand, éd. Paleo, la collection de sable, 2012, 2 vol. ;
couv ill.
285
ABSTRACT
ILLUSTRER LA COMÉDIE HUMAINE.
ENTRE TEXTE ET IMAGE
Très peu lecteurs de Honoré de Balzac savent que certaines parmi ses œuvres ont été
illustrées de son vivant ; le cas exemplaire est celui de la première édition de La Comédie
humaine (1842-1846), illustrée d’une centaine de planches dessinées par les illustrateurs les
plus célèbres de l’époque. Pourtant, il n’existe pas encore aujourd’hui une monographie
consacrée à cet argument. Cette thèse est donc la première à s’occuper entièrement de ce
sujet. La présente étude est composée par deux volumes. Le premier contient la partie
théorique, dédiée à l’analyse du rapport entre le texte et l’illustration dans les éditions
illustrées des œuvres de Balzac publiées de son vivant. L’analyse est divisée en trois
sections, chacune correspondant à une période temporelle particulière qui prend en
considération la production de l’auteur et, à la fois, l’évolution du livre illustré : 1820-1830,
1830-1840 et 1840-1850. On traite donc toute la carrière de Balzac, dès les exordes à
l’apogée que la publication de La Comédie humaine représente. Les œuvres prise en analyse
démontrent que le concept d’illustration est vraiment complexe, et qu’il nécessite d’une
définition nouvelle pour que sa relation avec le texte écrit soit saisissable dans toutes ses
nuances : l’illustration ne se limite pas à traduire le mot en image, mais elle enrichisse
l’imaginaire du lecteur en allant outre, ou même ailleurs, par rapport à ce que le texte
raconte ou décrit. L’illustrations sort des marges pour se poser, à son tour, comme un texte
à lire parallèle au texte écrit ; l’étude des ouvrages de Balzac montre bien cette tension entre
les deux médiums. Ces sont la scène et le personnage, notamment, les deux éléments
narratifs qui véhiculent la réflexion : de fait, l’illustration devient l’interprète du « tableau
pathétique » (Danielle Dupuis, « Entre théâtre et peinture : le tableau pathétique balzacien,
L’Année balzacienne 2001) et, dans un deuxième temps, « des hommes, des femmes et des
choses » et du personnage-type.
Le deuxième volume de l’étude contient les catalogues des œuvres illustrées de Balzac
analysé dans le premier tome, et aussi les catalogues de toutes les éditions françaises
illustrées existant des textes de l’écrivain.
286
ABSTRACT
ILLUSTRARE LA COMMEDIA UMANA. TRA TESTO E IMMAGINE
Pochi lettori di Honoré de Balzac sanno che alcune delle sue opere sono state, a loro
tempo, illustrate; caso esemplare è la prima edizione delle sue opere complete, intitolata La
Commedia umana (1842-1846), illustrata con un centinaio di vignette create dagli
illustratori più celebri del periodo. A oggi, non esiste una monografia, in italiano, in
francese o in inglese, che abbia preso in considerazione questo aspetto delle opere di
Balzac; questa tesi è dunque il primo studio interamente dedicato a questo soggetto.
La tesi è composta da due volumi.
Il primo contiene la parte teorica, dedicata all’analisi del rapporto tra testo e illustrazione
nelle edizioni illustrate pubblicate mentre Balzac era in vita. Lo studio è diviso in tre parti,
che rispecchiano una divisione cronologica basata sulla vita dell’autore ma anche
sull’evoluzione del libro romantico illustrato: 1820-1830, 1830-1840, e infine 1840-1850.
Dagli esordi di Balzac nella letteratura si arriva dunque al momento del suo apogeo,
rappresentato dalla pubblicazione della Commedia umana. I testi presi in esame rendono
evidente come il concetto di illustrazione sia in realtà complesso, e che necessiti di una
nuova definizione per poter comprendere pienamente il rapporto che essa instaura con il
testo: l’illustrazione non si limita a tradurre il testo in immagini, ma è capace di arricchirne
l’immaginario attraverso immagini che non sono, a prima vista, strettamente legate alla
narrazione. L’illustrazione esce dai margini per far concorrenza al testo scritto, e le opere di
Balzac prese in analisi dimostrano questa tensione tra i due medium. Lo studio è condotto
in particolare sui due elementi chiave della poetica balzachiana, la scena e il personaggio: si
analizza come l’illustrazione si fa interprete del tableau pathétique e come ella rappresenti
“gli uomini, le donne e le cose” nelle immagini, alla luce della descrizione data dal testo.
Il secondo volume della tesi contiene invece i cataloghi ragionati delle opere di Balzac
analizzate nel primo volume, e i cataloghi delle edizioni illustrate francesi esistenti delle
opere di Balzac.