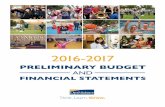"Réforme, romanisation, colonisation? Les moines de Saint-Victor de Marseille en Sardaigne (seconde...
Transcript of "Réforme, romanisation, colonisation? Les moines de Saint-Victor de Marseille en Sardaigne (seconde...
INTRODUCTION : DE LA MISE EN ŒUVREDE L’UNIVERSALISME GRÉGORIEN
Rompant avec une historiographie ancienne qui envi-sageait la « réforme grégorienne » comme un grand
affrontement politique et moral entre l’Église et les pouvoirs séculiers,mettant notamment aux prises la papauté et l’Empire, deux autoritésaux prétentions universelles, mais dépassant également les premièresmises en cause d’une telle vision de l’histoire, qui tendirent à nierl’existence même d’un projet ou d’un moment grégorien1, les travauxréalisés au cours des dernières années ont qualifié de « grégorien » leprocessus de transformation de l’institution ecclésiale engagé dansl’Occident de la seconde moitié du XIe siècle et montré son impact surles modèles culturels et les structures sociales, en s’attachant tout parti-culièrement aux réalités locales et aux configurations régionales : laréforme imposée par la papauté y est dès lors envisagée comme unnœud de pratiques sociales, fait d’affrontements et de ruptures, maisaussi de négociations et de compromis au sein de l’aristocratie2.
Michel LAUWERSUniversité Nice Sophia Antipolis, CEPAM (UMR 7264)
Réforme, romanisation, colonisation ? Les moines de Saint-Victor de Marseille en Sardaigne
(seconde moitié XIe-première moitié XIIe siècle)*
ai familiari sardi,Dessì e Mereu
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page257
Le dossier relatif à la présence des moines de Saint-Victor deMarseille en Sardaigne dans la seconde moitié du XIe et au début duXIIe siècle permet d’appréhender tout à la fois les dimensions « univer-saliste » et « locale » de la réforme : nous y observons, sous les ponti-ficats d’Alexandre II, de Grégoire VII et d’Urbain II, la mise en œuvred’un programme réformateur – dont il conviendra, dans les pages quisuivent, de définir les objectifs et les formes – à partir d’un centre(Rome) et de différents relais (dans le Midi de la France, l’abbaye Saint-Victor de Marseille), lesquels ont essaimé, favorisant la diffusiond’idées ou de principes nouveaux, mais aussi la circulation de personneset de biens. La marge de manœuvre réelle qui paraît avoir caractériséles interventions de la papauté en Sardaigne est en somme l’occasionde saisir des stratégies et des interactions (entre autorités ecclésiastiqueset puissances séculières, entre centre et périphérie) qui sont d’ordinairemoins lisibles. L’espace qu’il conviendra de prendre en considérationest celui de la Méditerranée occidentale, de l’Italie à l’Espagne, enpassant par la Provence et le Languedoc et en incluant les grandes îlesde la mer Tyrrhénienne. C’est à cette échelle, en effet, que se déploiel’action des moines réformateurs de la Provence et du Languedoc – quel’on ne peut dissocier, comme nous allons le voir, de celle des religieuxdu Mont-Cassin, par exemple, que les moines de Saint-Victor ontcôtoyés sur un certain nombre de terrains.
Si l’objet du présent volume impose dès lors de décloisonnerl’histoire du Midi, le dossier présenté dans les pages qui suiventnécessite en outre un décloisonnement des historiographies. En effet,les historiens travaillant en France ne se sont guère penchés sur lesactivités des moines de Saint-Victor en Sardaigne, que les études surle monachisme provençal passent généralement sous silence3. Du côtéitalien, la présence des moines de Saint-Victor en Sardaigne estcertes abondamment évoquée par les spécialistes de l’île4, dontl’histoire a du reste été profondément renouvelée dans la dernièredécennie5, mais en ignorant largement les apports récents des travauxsur la réforme et le monachisme en Provence et, de manière plus géné-rale, toute perspective comparatiste6.
258 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page258
I. « A NOBIS, PLUS QUAM GENTES QUE SUNT IN FINEMUNDI, VOS EXTRANEOS » : LA SARDAIGNE, LA RÉFORME GRÉGORIENNE ET SAINT-VICTOR DE MARSEILLE
1. De la tradition byzantine à l’obédience romaine
Séparée de l’Empire byzantin dont elle faisait partie depuis laconquête de Justinien en 534, dépendant alors de l’Exarchat deCarthage, la Sardaigne acquit une autonomie, entre le IXe et leXIe siècle, qu’elle défendit en particulier face aux velléités desMusulmans. La très brève conquête de l’île, en 1015, par Mudjahid,seigneur de la taïfa de Denia, qui entendait mettre en place un grandcalifat méditerranéen, dessein finalement brisé par les flottes pisaneet génoise, a peut-être hâté la réorganisation des pouvoirs sur l’île, auprofit de descendants d’un groupe dirigeant de l’époque byzantine, lesLacon-Gunale7 : les titres de « juges », « protospathaires » ou« archontes de Sardaigne » furent parfois donnés aux chefs de cettearistocratie, ainsi que l’attestent plusieurs inscriptions en caractèresgrecs de très belle facture, gravées et placées, au cours de la secondemoitié du Xe et des premières décennies du XIe siècle, dans les lieuxde culte majeurs du sud de l’île8 (fig. 1 et 2).
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 259
Fig. 1. Inscription de l’église San Giovanni à Assemini, dernier quart duXe siècle : « Seigneur, aide ton serviteur Torcotorios, archonte de Sardaigne, etta servante, Getite » (Blasco Ferrer, Crestomanzia, I, p. 56, ill. 3-4 ; Coroneo,Arte, 435-436, ill. 774).
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page259
Les milieux dirigeants entretenaient certes, depuis le haut MoyenÂge, des liens étroits avec la papauté : une cinquantaine de lettres dupape Grégoire le Grand sont ainsi adressées à la Sardaigne9. Mais lescoutumes et les rites insulaires demeurèrent marqués par la traditionbyzantine – dans des proportions et avec des significations qui sonttoutefois appréciées de manières très diverses selon les historiens10.L’existence dans le sud de l’île – à Cagliari, à Assemini, àSant’Antioco – d’édifices revêtus d’épigraphies médio-helléniques etdécorés de riches sculptures sur marbre d’allure byzantine (fig. 3 et 4)laissent entrevoir des complexes ecclésiaux et peut-être palatiauxd’une certaine envergure11.
Une charte, datée de 1089, écrite en caractères grecs et en languesarde (fig. 5), par laquelle Constantin Salusius, qui se proclame« juge » (iudiki), confirme et augmente les dons faits par son père àl’église San Saturno de Cagliari, illustre la domination d’un groupearistocratique dont les titulaires, parés de noms et de titres d’originebyzantine, se distinguaient parfois en usant de l’alphabet grec pourtranscrire le sarde12 : précoce mise par écrit de la langue vernaculaire(ou du moins d’une langue mêlant le latin et le vernaculaire), qui n’estpas sans évoquer la place généralement reconnue aux langues
260 CAHIERS DE FANJEAUX 48
Fig. 2. Inscription des premières décennies du XIe siècle, remployée dans lacrypte de l’église de Sant’Antioco : « Rappelle-toi, Seigneur, de ton serviteurTorcotorios, protospathaire, et de Salousios, archonte, et […] de Nispella »(Coroneo, Arte, p. 438-439, ill. 777-780).
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page260
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 261
Fig. 3. Plaque de chancel avec griffon et cheval ailé affrontés, seconde moitiédu Xe siècle, trouvée au large de l’île de San Macario, près de Nora (Coroneo,Arte, p. 448-451, ill. 805).
Fig. 4. Plaque de chancel avec chevalailé, premières décennies XIe siècle,retrouvée dans l’église de Sant’Antioco(Coroneo, Arte, p. 454-457, ill. 809).
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page261
262 CAHIERS DE FANJEAUX 48
Fig. 5. Charte grecque du juge Constantin pour San Saturno, 1089, Marseille,AD Bouches-du-Rhône, 1 H 88, n° 427. Fac-similé publié dans Bibliothèquede l’École des Chartes, 35, 1874.
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page262
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 263
vulgaires dans l’Église d’Orient13. Les sceaux de plomb des juges deCagliari, revêtus aussi de caractères grecs, sont une autre survivanced’une vieille tradition byzantine14 (fig. 6).
Soucieux d’affirmer son autorité dans l’ensemble de l’Églised’Occident, en particulier en Italie méridionale, Alexandre II sembleavoir été le premier pape réformateur à s’être réellement préoccupédu cas de la Sardaigne. C’est avec son appui, peut-être à son initia-tive, que dans les années 1060, des moines latins pénètrent sur l’île.
L’arrivée de ces religieux, venant de l’abbaye du Mont-Cassin,paraît contemporaine du partage de la Sardaigne ou du moins de lastabilisation de celui-ci en quatre judicats : Cagliari, Arborea, Torres(ou Logudoro), Gallura (fig. 7)15. Selon la Chronique du Mont-Cassinrédigée par Leone Marsicano, c’est le juge de Torres, un certainBarison, qualifié de rex par le chroniqueur, qui envoya en 1063 unedélégation vers ce monastère alors dirigé par l’abbé Didier : le jugepromit d’importants dons aux religieux qui viendraient s’installer surses terres, dans lesquelles, précise le chroniqueur du Mont-Cassin, lemonachisme était jusqu’alors « inconnu » (monastice religionisstudium hactenus partibus illis incognitum)16. Cette dernière notationne concerne probablement que le monachisme latin réformé, carplusieurs communautés religieuses s’étaient installées sur l’île dansle haut Moyen Âge17. Après quelques péripéties, liées aux volontés
Fig. 6. Sceau de plomb mentionnant l’archonte de Cagliari (au verso) et invo-quant la Vierge (au recto), XIIe siècle – deux chartes sardes de 1089 conservéesà Saint-Victor comportent de tels sceaux, mais en mauvais état (Blasco Ferrer,Crestomanzia, I, p. 67).
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page263
264 CAHIERS DE FANJEAUX 48
Fig. 7. Les quatre judicats et les trois archevêchés de Sardaigne au XIe siècle,avec les trois prieurés de Saint-Victor de Marseille.
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page264
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 265
hégémoniques des Pisans et narrées dans la Chronique18, les religieuxarrivèrent dans le judicat de Torres, et Barison leur remit deux églises,ainsi qu’en témoigne, en 1064, une charte conservée sous formeoriginale19. La demande adressée par le juge de Torres aux moines duMont-Cassin, qui manifestait une sorte d’adhésion au mouvementréformateur, était sans doute aussi une façon d’obtenir la reconnais-sance du judicat qu’il s’était taillé dans la partie septentrionale de l’île,en même temps que la mise en place d’une province ecclésiastique20.La nouvelle organisation de la Sardaigne en quatre judicats et troisprovinces ecclésiastiques (à la place de l’unique province attestée dutemps de Grégoire le Grand) paraît, en effet, étroitement liée à la diffu-sion de la réforme pontificale : du moins relèvera-t-on la belle coïn-cidence entre les interventions du pape et des moines, laterritorialisation du pouvoir des juges et la fixation de l’organisationdiocésaine 21. La réforme de l’Église fut aussi celle des structures depouvoir et le résultat de négociations entre le pape, ses représentantset les groupes aristocratiques. Du reste, la dissociation entre le nombredes judicats (quatre) et celui des provinces (trois) est vraisemblable-ment à mettre en relation, ainsi que nous le verrons, avec les résis-tances liées à la mise en œuvre de la réforme.
Répondant aux injonctions de la papauté, les dirigeants sardesfurent contraints de renoncer à certains usages désormais condamnéspar l’institution ecclésiale. Dans une lettre de 1065, Alexandre IIdénonce ainsi l’union matrimoniale jugée incestueuse, « détestable »et « contraire aux lois divines », du juge de Cagliari OrzoccoTorchitorius avec une consanguine au troisième degré. À vrai dire, cen’était pas la première fois qu’un pape reprochait aux juges sardesleurs unions illicites. Dans la seconde moitié du IXe siècle déjà,Nicolas Ier (858-867), dont le pontificat atteste une attention asseznouvelle et récurrente pour les questions matrimoniales, était inter-venu pour mettre fin aux pratiques incestueuses des insulaires, unepremière qui put d’autant plus servir de modèle, en tout cas de précé-dent prestigieux, aux yeux des réformateurs du XIe siècle qu’elle étaitnarrée dans la biographie officielle des papes, le Liber pontificalis :
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page265
« On rapporta (au pape Nicolas Ier) que les juges habitant l’île et lapopulation qui était soumise à leur gouvernement contractaient desmariages incestueux et illicites avec leurs proches qui étaient de leursang. […] Inspiré par le Saint Esprit, (le pape) rédigea de douceslettres qui avaient l’autorité de ses prédications et rayonnaient surl’ensemble du monde, tout en étant terribles envers les prévaricateurs.Il envoya aussi des missi très fermes, l’évêque Paul de Populonia etSaxus, l’abbé du vénérable monastère des Saints-Jean-et-Paul, afin desoustraire le peuple sarde à une si grave erreur. Ils partirent donc et trou-vèrent des adversaires de la discipline fort résolus qui refusèrent de rece-voir leurs avertissements. […] »22
En 1065, Alexandre II menace le juge de Cagliari : le fils quinaîtrait de son union incestueuse serait privé de tout héritage paternel,il n’obtiendrait ni dignité de juge, ni siège épiscopal23. Cet avertisse-ment laisse transparaître des pratiques de gouvernement fondées, àCagliari en tout cas, sur le contrôle de l’office d’évêque et de celuide juge par le groupe aristocratique dominant, pratiques assurémentpré-grégoriennes, fréquentes dans l’Occident de cette époque où lespuissants laïcs se partageaient charges princières et ecclésiales – onpeut penser ici au cas de la famille vicomtale et épiscopale deMarseille entre la fin du Xe et le milieu du XIe siècle24. OrzoccoTorchitorius fut en outre accusé d’avoir commis « plusieurs homi-cides », pour la réparation desquels il s’engagea à construire unmonastère. C’est dans cette perspective que le juge s’était adressé auMont-Cassin25, en s’engageant à céder six églises aux religieux quiseraient envoyés en Sardaigne par ce monastère, qui apparaît déci-dément comme le premier vecteur de la réforme dans l’île26.
Lutte contre des pratiques matrimoniales aristocratiques jugéesincestueuses et peut-être contre certaines formes de simonie, remo-delage des archevêchés et des diocèses, installation de communautésde moines latins : le pontificat d’Alexandre II (1061-1073) a constituéune étape décisive dans l’intégration de la Sardaigne au sein d’uneÉglise occidentale contrôlée par la papauté. La romanisation de l’îlesemble avoir été le prix payé par les juges pour instituer ou légitimer
266 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page266
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 267
leur pouvoir sur le territoire insulaire. Grégoire VII (1073-1085) ymultiplia les interventions de la papauté, réclamant des juges, dès ledébut de son pontificat, soumission et obéissance. La lettre adressée le14 octobre 1073 aux quatre juges de Sardaigne est du reste le premierdocument historique qui mentionne une organisation de l’île en quatrejudicats27. Le pape ouvre cette lettre en affirmant solennellement que« l’Église romaine universelle doit être la mère de tous les chrétiens ».Or la « charité » des Sardes, bien attestée dans l’Antiquité, s’estrefroidie et leur Église est désormais encore « plus étrangère [à Rome]que les peuples qui sont aux confins de la terre » : a nobis plus quamgentes, que sunt in fine mundi, vos extraneos28. Les Sardes doiventreconnaître « l’Église catholique comme leur mère »29 et lui rendre ladebita obedientia. Dans cette perspective, les juges avaient à seconformer aux injonctions de l’archevêque de Torres, représentant dupape jusqu’à la venue, annoncée comme prochaine, d’un légat.
Un peu plus d’un an plus tard, le 16 janvier 1074, Grégoire VIIécrit au juge de Cagliari Orzocco Torchitorius, dont on comprend qu’ils’apprêtait alors à effectuer un voyage à Rome30. La lettre intime aujuge de sauvegarder « le droit et l’honneur de saint Pierre ». Lamême année, Orzocco Torchitorius fit d’importantes cessions àl’archevêque de Cagliari qui venait d’être mis en place31. Grégoire VIIremercie ce même juge, le 5 octobre 1080, pour l’accueil fait à sonlégat, dont il convient, précise-t-il, de suivre les consignes32. Le paperappelle toutefois la nécessité de réformer le clergé insulaire selon « lacoutume de la sainte Église de Rome, mère de toutes les églises » :Grégoire mentionne à ce propos l’obligation pour les clercs de se raserla barbe, comme le fait « le clergé de l’ensemble de l’Église occi-dentale », en précisant que cette obligation vient d’être imposée àl’archevêque de Cagliari lui-même33. Cette notation jette une lumière(hélas très partielle) sur le processus d’effacement des traditionsbyzantines réclamé par la papauté. La taille de la barbe, qui marquait,comme la tonsure, l’abandon de l’état laïque et la conversion, estexigée dans plusieurs collections canoniques de l’âge grégorien :« Si un clerc, s’il est Romain, laisse pousser ses cheveux et négligede raser sa barbe, qu’il soit anathème ! »34. L’obligation faite aux
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page267
clercs latins de raser (ou de tailler ?) leur barbe ne fut vraisembla-blement jamais absolue, mais elle était volontiers invoquée poursouligner, comme le fait du reste ici Grégoire VII, tout ce qui sépa-rait des Grecs l’Église occidentale35.
Dans sa lettre de 1080, Grégoire VII énumère enfin tous ceux,Normands, Toscans, Lombards, ainsi que d’autres peuples « ultra-montains », qui ont réclamé au pape la permission d’envahir et dedominer la Sardaigne en son nom36 – ce que le souverain pontife atoujours refusé, préférant dépêcher son légat dans l’île et attendre lerapport de celui-ci. Comme le juge de Cagliari s’est bien comportéenvers saint Pierre et a montré qu’il voulait servir le légat, le pape nedonnera jamais à personne l’autorisation d’envahir la Sardaigne.
Les trois lettres de Grégoire VII, menaçant d’abord des jugesconsidérés comme très éloignés de Rome, faisant même allusion à unprojet d’« invasion » de la Sardaigne par les alliés du pape, avant delouer finalement l’obéissance des dirigeants sardes, paraissent bienmanifester la reconnaissance progressive par l’aristocratie insulairede la défense du « droit » et de l’« honneur de saint Pierre », ainsiqu’un gouvernement exercé en concertation avec les représentants dupape. Dans ces mêmes années, Grégoire VII entreprenait de fairereconnaître le dominium de saint Pierre sur la Corse, étant entendu que« l’île ne relevait d’aucun mortel ni d’aucun autre pouvoir que celuide la sainte Église romaine »37. C’est que, contrairement à laSardaigne, la Corse était gouvernée par des hommes « mauvais » et« sacrilèges » qui n’acceptaient nullement la « soumission » etl’« obéissance à saint Pierre » : aussi Grégoire VII confia-t-il àl’archevêque de Pise un vicariat apostolique pour la Corse, répondantainsi favorablement aux aspirations des Pisans à la domination sur lesgrandes îles de la mer Tyrrhénienne38.
268 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page268
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 269
2. Autour de la donation de Constantin : « mauvaises coutumes »et fondations victorines
Sous le pontificat de Grégoire VII, sans doute à l’époque de ladernière des lettres relatives à la Sardaigne, le juge OrzoccoTorchitorius, qui avait fait appel, quelques années plus tôt, aux moinesdu Mont-Cassin, se tourna vers les religieux de Saint-Victor deMarseille. Le 30 juin 1089, Constantin, le fils d’Orzocco Torchitorius(qui était mort en 1081), confirme, en effet, à l’abbé Richard de Saint-Victor la cession de deux églises, situées non loin de Cagliari, qu’avaitdéjà données son père aux moines marseillais39. La cession de ceséglises était destinée à fonder un monastère placé « sous la règle de saintBenoît et sous la coutume et la discipline du monastère de Marseille ».Dans cette perspective, il était prévu que l’abbé de Saint-Victor envoyâtsur place des religieux marseillais, chargés de prier pour la stabilitasdu royaume de Constantin : l’accueil de moines latins avait bien pourcontrepartie la légitimation du pouvoir du juge.
La même année, le juge Constantin confirmait d’autres donsréalisés par son père, cette fois à l’église San Saturno de Cagliari quirelevait de la juridiction de l’archevêque – il s’agit de la fameusecharte en caractères grecs évoquée au début de cette étude (fig. 5)40.Cependant, quelques mois plus tard, avant même la fin de l’année,Constantin décida de confier San Saturno aux moines de Marseille,en même temps que huit autres églises du judicat, disposant toutes deriches possessions41. Il ne fut en revanche plus question des deuxéglises dont la cession avait pourtant été confirmée quelques mois plustôt. Les moines de Saint-Victor y avaient gagné : San Saturno étaitl’église la plus ancienne et la plus prestigieuse de la région ; ce donconsidérable devait certes leur permettre de « construire un monas-tère selon la volonté divine », de « mener leur vie selon la règle desaint Benoît », mais il les plaçait aussi et surtout en situation deforce dans le judicat de Cagliari et faisait de San Saturno un centreactif pour la diffusion des directives romaines.
Les trois chartes de 1089 rejoignirent les archives de Saint-Victor de Marseille, où elles sont toujours conservées. La charte
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page269
grecque est soit un original, soit une copie quasiment contemporainede l’original, faite par un moine au moment de la cession de SanSaturno à Saint-Victor42. Ayant obtenu l’église, les moines reçurenttous les biens qui en dépendaient et les actes qui attestaient leursdroits. Les religieux tenaient d’autant plus à ces documents qui prou-vaient leurs possessions que leurs relations devaient être assez conflic-tuelles avec l’archevêque de Cagliari, qui perdait avec ces cessionsun énorme patrimoine. Outre les églises, les moines avaient en effetobtenu des droits sur les salines et la moitié des dîmes que le jugedevait à l’archevêque. Entre 1090 et 1094, Constantin fit don denouvelles églises monachis massiliensibus in monasterio eiusdemSancti Saturni Kalaris habitantibus43. Selon une confirmation dumilieu du XIIe siècle, les moines de Marseille auraient ainsi contrôlépas moins de vingt-huit églises dans la région de Cagliari, ainsi quedes droits importants sur le port et les salines44.
270 CAHIERS DE FANJEAUX 48
Chronologie des cessions d’églises à Saint-Victor dans le judicat de Cagliari
peu avant 1081 le juge Orzocco Torchitorius fait appel aux moines de Saint-Victor(au détriment de ceux du Mont-Cassin)
30 juin 1089* le juge Constantin confirme deux églises données à l’abbé Richardde Saint-Victor par son père Orzocco Torchitorius (mort en 1081)
1089* le juge Constantin accroît les dons réalisés par son père OrzoccoTorchitorius à l’église San Saturno de Cagliari, alors sous la juridiction de l’archevêque de Cagliari
après juin 1089* le juge Constantin donne l’église San Saturno de Cagliari, ainsi que huit autres églises du judicat, à Saint-Victor, avec l’accordde l’archevêque Lambert de Cagliari
1090* confirmation par l’archevêque Hugues de Cagliari (conservée endeux versions différentes) de la cession à Saint-Victor de l’égliseSan Saturno et d’autres églises du judicat
dans les années 1090* le juge Constantin abandonne les « mauvaises coutumes »
entre 1090 et 1094 cession à Saint-Victor de neuf autres églises du judicat de Cagliari*
* Actes conservés sous forme d’originaux dans les archives du monastère de Saint-Victor de Marseille.
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page270
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 271
Les cessions d’églises et de droits à Saint-Victor précèdent de peuune déclaration solennelle, que l’on date des années 1090, par laquellele juge Constantin (Constantinus rex et iudex Sardiniae) abandonne« dans la main de Dieu tout puissant et du bienheureux Pierre »toutes les « mauvaises coutumes de (ses) ancêtres et des autres princesde la Sardaigne » (pessimas consuetudines antecessorum meorum, etaliorum principum Sardiniae)45. Les « mauvaises coutumes » sontexplicitées : l’entretien de concubines, le mariage non respectueux desinterdits de parenté, l’homicide – autant d’échos aux directives ponti-ficales de l’époque d’Alexandre II. Mais le juge Constantin s’engageen outre à ne plus intervenir dans le choix des évêques et des prêtres :ipsos etiam episcopatus et ecclesias, ac presbyteros in honorem Deiet beati Petri canonice ordinandos relinquo. Enfin, il rendra dîmes etprémices : decimas etiam ac primitias ab hac die in antea me fideliterredditurum promitto. Cette déclaration passa, de même que les docu-ments précédents, dans les archives de Saint-Victor de Marseille.Peut-être rédigée par les moines, elle doit être replacée dans lecontexte de la politique de soumission des princes méridionaux,inaugurée par Grégoire VII et poursuivie par Urbain II, qu’illustrentles allégeances de Bernard II de Besalù, du comte de ProvenceBertand II, de Pierre de Melgueil, de Sanche Ramirez d’Aragon, deBérenger Raimond de Barcelone46.
Installés principalement dans la région de Cagliari, les moines deMarseille étaient aussi présents dans le judicat de Gallura. Une petitecommunauté religieuse disposant de terres et de trois autres lieux deculte s’était établie à côté de l’église Santo Stefano de Posada47.Dans les années 1090, elle était gouvernée par un moine venu deMarseille, dont nous connaissons une lettre fort intéressante (fig. 8)48.Rédigée entre 1092 et 1099, la lettre du moine Jean expose la situa-tion de la Gallura et de la maison victorine de Posada. Elle nousapprend que le juge de Gallura, un autre Torchitorius, qualifié de« tyran très impie et hérétique », avait été excommunié par Urbain II,tandis que son judicat était frappé d’interdit. Le légat du pape enSardaigne, qui était alors l’archevêque de Pise Daimbert, avait réuni
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page271
un synode à Torres, au cours duquel les évêques présents avaientinvité le juge rebelle à se réconcilier avec l’Église. Lors du concile,le légat avait lu des precepta apostolica envoyés par Urbain II,qu’approuvèrent évêques et juges, sauf celui de Gallura, qui fut dèslors définitivement condamné49. La déclaration du juge Constantin deCagliari à propos des « mauvaises coutumes » peut être vue commeune acceptation de ces precepta apostolica, sans doute liée au synodede Torres50. On ignore la raison pour laquelle le juge de Gallura, àl’inverse des autres dirigeants de l’île, n’adhéra pas au programmeréformateur, mais cette attitude rebelle doit être mise en rapport avecle fait que le juge n’obtint jamais de province ecclésiastique autonome– une province de Gallura qui aurait coïncidé avec son judicat et auraitété l’équivalent des provinces de Cagliari, Arborea et Torres51.
Dans le dernier quart du XIe siècle, des moines de Saint-Victors’étaient ainsi installés dans les judicats de Cagliari, de Gallura et deTorres. Au début du XIIe siècle, cette implantation marseillaise sestructura sous la forme d’un réseau de trois prieurés : San Saturnopour le judicat de Cagliari, Santo Stefano de Posada pour celui deGallura et San Nicola de Guzule pour celui de Torres, dont dépendaient
272 CAHIERS DE FANJEAUX 48
Fig. 8. Lettre du moine Jean, prieur de Posada, à Richard de Saint-Victor, entre1092 et 1099, Marseille, Archives des Bouches-du-Rhône, 1 H 76, n° 370.
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page272
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 273
de nombreux autres lieux de culte (fig. 7)52. La présence marseillaisen’avait toutefois pas partout la même densité. Les congrégationsmonastiques de Saint-Victor et du Mont-Cassin, ainsi que la cathé-drale de Pise, principaux acteurs de la réforme en Sardaigne, s’étaientpartagés le territoire insulaire : les religieux de Marseille se trouvaientconcentrés au sud de l’île, dans la région de Cagliari, où les avaientappelés les juges Orzocco Torchitorius et Constantin53, tandis que lejudicat de Torres se trouvait plutôt occupé par les moines du Mont-Cassin, sollicités par le juge Barison au début des années 1060, etensuite par les Pisans, qui entendaient s’imposer en Sardaigne commedans l’ensemble de la mer Tyrrhénienne – c’est aux Pisans que s’étaitadressé le juge Marianus après avoir constaté, en 1082, que leséglises de son judicat se trouvaient « vides et dépourvues de doctrineet de pratique religieuse » (vacuas atque nudas ecclesiastica doctrinaatque religione) et que sa « patrie était plongée dans le péché, enraison de la négligence des clercs et de leur mode vie similaire à celuides laïcs »54 : on retrouve ici un argumentaire très « grégorien ».
II. NOS SUMUS IN MAGNA TRIBULATIONE : LES « MARSEILLAIS » DANS LA TOURMENTE
1. L’Ecclesia marseillaise et l’activisme de ses moines
Pourquoi Saint-Victor ? Dans la première moitié du XIe siècle,peu après la restauration du monastère, à la faveur du long abbatiatd’Isarn (1021-1047), Saint-Victor de Marseille s’était transformé enune puissante Église contrôlant de nombreux prieurés, des églises etdes terres dans toute la Provence55. Cette Église favorisa et intégra desexpériences multiples, parfois originales, comme celle de la petitecommunauté de moines grecs de Saint-Pierre d’Auriol, installée dansles années 1040 par l’abbé de Saint-Victor et l’évêque de Marseille,qui atteste l’ouverture de la maison marseillaise sur la Méditerranée56.
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page273
À la fin de l’abbatiat d’Isarn, les possessions de Saint-Victor s’éten-daient vers l’ouest jusqu’en Espagne, où l’abbé s’était d’ailleursrendu peu avant sa mort pour obtenir la libération des moines de l’îlede Lérins, enlevés et détenus dans la taïfa de Denia57.
À partir des années 1070, les abbés marseillais s’engagèrent auxcôtés des papes réformateurs : Bernard (1064/1065-1079), puisRichard (1079-1106) furent même légats de Grégoire VII. C’est à cetitre qu’en 1077, après un ou plusieurs voyages en Catalogne, Bernardfut envoyé dans le royaume germanique afin de régler le conflitentre l’empereur Henri IV et Rodolphe de Souabe ; il se rendit égale-ment à plusieurs reprises en Italie. Grégoire VII lui manifesta sareconnaissance en concédant à Saint-Victor, en 1079, les mêmesprivilèges que ceux qu’il avait attribués à l’abbaye de Cluny en 1075.L’année suivante, une lettre pontificale établissait d’ailleurs un paral-lèle entre Cluny et Saint-Victor, deux Églises considérées commemodèles de la nouvelle « liberté romaine »58. À la mort de Bernard,c’est son frère, Richard, qui fut choisi pour lui succéder59. L’annéeprécédant la succession, Richard avait été envoyé en légation enCastille, en Léon, en Aragon et en Navarre ; il y retourna fréquem-ment ensuite60. Outre l’Espagne, l’abbé Richard sillonna la Gaule duMidi au service de la papauté. C’est à lui que s’adressèrent les jugesde Cagliari, sans doute dès le pontificat de Grégoire VII, comme nousl’avons vu, puis, plus résolument, en 1089. Le retournement quis’opéra cette année-là, à Cagliari, au profit de l’abbaye de Saint-Victor, recevant du juge Constantin la prestigieuse église de SanSaturno, survint après la mort du pape Victor III (1086-1087)61. Cedernier n’était autre que l’ancien abbé Didier du Mont-Cassin, àl’élection duquel l’abbé Richard, ainsi que l’archevêque de Lyon etcelui d’Aix, ancien moine de Saint-Victor, s’étaient opposés ; ilsemblerait même que Richard fut alors excommunié62. Peut-êtrefaut-il voir dans cette éphémère mise à l’écart de l’abbé de Saint-Victor, puis dans son retour en grâce au moment de l’arrivée d’UrbainII (1088-1099), les effets d’une forme de compétition entre le monas-tère marseillais et le Mont-Cassin, deux maisons qui se trouvaient enquelque sorte en concurrence en Sardaigne : on se souvient qu’avant
274 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page274
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 275
de solliciter les moines de Marseille, le juge de Cagliari avait faitappel à ceux du Mont-Cassin, par ailleurs bien implantés sur l’île.
Sous les pontificats de Grégoire VII et d’Urbain II, l’abbé deSaint-Victor de Marseille eut donc l’ambition de régenter l’Église aunom de la papauté romaine qu’il représentait dans une partie de laMéditerranée. Cette ambition entraîna d’ailleurs un certain nombre decrises, dont certaines étaient liées aux tensions entre ces moinesrésolument grégoriens et l’aristocratie laïque, tandis que d’autresrelevaient de l’expansion rapide de Saint-Victor : dans leur corres-pondance avec la maison-mère, plusieurs religieux envoyés dans desprieurés, en Languedoc notamment, se plaignent de leur éloignement ;de leur côté, les moines restés à Marseille regrettent les absences répé-tées de leur abbé, ainsi qu’une dispersion (des moines et des biens)qui vidait littéralement de ses forces la maison-mère63.
Des « Marseillais » étaient envoyés dans les dépendances sardesde Saint-Victor. Ces Massilienses mentionnés dans les documentsétaient en fait Provençaux et Languedociens. Le système de gouver-nement victorin pour la Sardaigne est conforme aux pratiques misesen place pour l’organisation des possessions provençales et langue-dociennes au cours du XIe siècle : la cohérence du système ecclésialétait assurée par une mobilité des moines envoyés de Marseille versles différentes dépendances et les différentes régions où se trou-vaient possessionnés les victorins64. Dans la première charte confir-mant, en 1089, la cession de deux églises de la région de Cagliari àl’abbé Richard, il est demandé à ce dernier d’y envoyer certains deses religieux : abbas mittat monachos65. Quelques mois plus tard, lorsde la cession de San Saturno, deux moines, un Bernardus et un Ugo,sont déjà sur place pour représenter l’abbé dans les tractations avecles autorités locales66. Ce sont ces moines qui ont probablementélaboré la charte consignant le résultat des négociations, qui présente,comme tous les actes concernant les possessions sardes de Saint-Victor, les caractères de la diplomatique provençale67. Un an plus tard,plusieurs moines sont arrivés de Marseille, ainsi qu’on le constate àleur mention dans une autre charte : Berengarius, Dalmatius,
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page275
Coraddus, Willelmus, Crescentinus, Stephanus, Petrus68. L’hypo-thèse a été avancée, sans que rien ne puisse toutefois la confirmer, queparmi les premiers « Marseillais » arrivés en Sardaigne, il y avaitcertains des moines grecs d’Auriol, que la connaissance du grec et descoutumes byzantines aurait prédisposé à guider leurs frères69.
Les relations institutionnelles entre Marseille et les prieurés loin-tains, ainsi que les modalités de transmission des consignes et desinformations entre centre et périphérie ne paraissent pas avoir été clai-rement définies. Mais les moines envoyés au loin demeuraient encontact plus ou moins régulier avec leur abbé. Selon la lettrementionnée plus haut du moine Jean, qui semble avoir été le respon-sable, un temps au moins, du prieuré de Posada, en Gallura, la situa-tion florissante du prieuré lui avait permis, un an plus tôt, d’envoyerà l’abbé Richard une somme d’argent appréciable, qu’il avait confiéeà un jeune moine dénommé Obert. À son retour en Sardaigne, Obertavait cependant prétendu au moine Jean que Richard l’avait nomméprieur de Posada. Dans sa missive, Jean s’en étonne, remarquantqu’Obert n’était porteur d’aucun écrit confirmant ses dires, ets’enquiert de la décision de l’abbé70.
Une lettre postérieure de quelques décennies témoigne d’uneautre dimension de la circulation des moines au sein de l’Églisevictorine : elle est écrite en 1140 par Bernard, le prieur de SanSaturno de Cagliari, à l’adresse de l’abbé Pierre de Saint-Victor.Bernard y prend la défense d’un moine nommé Hector, responsabled’un petit prieuré de l’Aveyron, et désespéré qu’au terme d’un longconflit entre Saint-Victor et le monastère de Vabres, l’abbé deMarseille ait accepté la soumission de son prieuré à Vabres. Hectors’était alors enfui jusqu’en Sardaigne. Le prieur de San Saturnoévoque le périple d’Hector, « navigant au milieu de la tempête, ayantsubi la violence de nombreuses infortunes, entre vents opposés enconflit », ne trouvant d’autre refuge qu’à San Saturno où Bernardl’accueille avant de réclamer l’indulgence de l’abbé de Saint-Victor71.
276 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page276
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 277
2. Pastorale et colonisation
L’installation des « Marseillais », décidée à la suite de négociationsavec les autorités laïques et ecclésiastiques, supposait que fussentaménagés des lieux adaptés pour les moines, mis à disposition desterres et des droits, et fût reconnu leur rôle pastoral72. L’acte de cessionde San Saturno, en 1089, prévoit que les religieux, mis en possessionde l’église et de ses dépendances, in potestate et dominio, y « construi-sent un monastère » (ut monasterium ibi secundum Deum construant,et habitantes secundum regulam sancti Benedicti vivant et morentur)et qu’une fois installés, ils entreprennent de rassembler les bons pourl’honneur de Dieu (bonos ad honorem Dei congregent) et de disperseret éradiquer les mauvais (malos vero disperdant, et eradicent). À uneépoque où les partisans de la réforme imposaient, parfois de façonvigoureuse, des principes et des règles d’un genre nouveau, cettedernière mission pouvait s’avérer délicate, ainsi qu’en témoignent àPosada les hésitations du moine Jean. Que devait donc faire le prieur,alors que le juge Torchitorius venait d’être excommunié ? Se rappro-cher du juge, obéir à ses ordres et continuer à célébrer l’office, àaccomplir les rites ? Ou refuser, conformément à l’interdit lancé parle pape, mais dans ce cas, perdre aussi les terres du prieuré ? Lemoine Jean écrit à son abbé : « Nous sommes dans la tourmente et nousne savons que faire » (nos sumus in hac tribulatione, et nescimus quidfaciamus). Et il continue : « Nous avons grande honte lorsque l’onnous montre du doigt, en disant : “Voici ceux qui s’accordent avec cethérétique” ». « Nous sommes dans un grand tourment », répète-t-il, et« l’infamie guette notre monastère ». Et encore : « Nous avonsjusqu’ici tout supporté pour vous obéir, mais voici qu’un poids énormepèse désormais sur nous, que nous ne pouvons plus supporter, alors quecet hérétique nous dit : “si vous voulez être avec moi, sur ma terre,sachez en vérité que je veux que vous assuriez l’office divin, mais sivous ne voulez pas le faire, quittez ma terre et ma parenté (exite deterra et cognatione mea), et alors, je ne vous laisserai rien de vospossessions, si ce n’est vos vêtements”. » À l’adresse de l’abbéRichard, le moine Jean conclut : « Nous voulons avoir votre conseil.
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page277
Que devons-nous faire pour l’honneur de Dieu, pour notre monastèreet pour l’Église romaine ? »73 Le religieux avait bien conscience qu’ildevait servir l’Église romaine et qu’en Gallura, les fragiles compromisentre l’aristocratie qui dominait localement, la papauté et lesMarseillais s’étaient soldés par un échec.
L’arrivée des moines rompait les équilibres anciens. Dans le sudde la Sardaigne, elle a lésé tout particulièrement l’archevêque deCagliari, qui fut privé de sa juridiction sur San Saturno et ses dépen-dances, en 1089, à la suite de la volte-face du juge Constantin qui,quelques mois après avoir confirmé ces biens à l’archevêque, les cédaà l’abbé Richard. Un acte de l’année suivante, émanant de l’arche-vêque Hugues (qui venait d’être mis en place) et confirmant finale-ment cette cession, est conservé en deux versions différentes dans lesarchives de l’abbaye marseillaise74. C’est que les moines avaientvraisemblablement procédé à des corrections, interpolations ou réécri-tures de la charte de confirmation obtenue de l’archevêque. Cesmanipulations laissent deviner des tensions que l’on conçoit d’autantmieux que les biens cédés aux « Marseillais » à Cagliari et dans sarégion étaient considérables : au total, près d’une trentaine d’égliseset la moitié des dîmes qui devaient revenir à l’archevêque. On peutpenser que dans les lieux de culte qui leur avaient été remis, lesmoines de Saint-Victor exerçaient, de manière directe ou indirecte, destâches pastorales – « rassembler » les « bons » et « disperser » les« mauvais » : sans avoir aucune information précise à ce sujet, onpressent ce rôle pastoral auprès des fidèles au début du XIIIe siècleencore, lorsque prenant San Saturno sous sa protection, le papeHonorius III interdit que de nouvelles « paroisses » fussent mises enplace sur les terres des religieux et établit que les dîmes des terresmonastiques ne devaient revenir qu’au prieuré75. Mais les moinescontrôlaient également les pêcheries, les salines et le port de Cagliari.La romanisation de la Sardaigne par les « Marseillais » revêtait lesapparences d’une entreprise de colonisation. Une charte rédigée enlangue sarde à la fin du XIIe siècle, conservée à nouveau dans lesarchives de Saint-Victor, qui consigne un accord entre le prieur de SanSaturno et les habitants d’un village proche de Cagliari concernant
278 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page278
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 279
l’exploitation du saltus, témoigne de l’existence de conflits liés auxusages avec la population locale76.
Revenons aux prélats sardes. Certains évêques, comme ceux deSulcis et de Dolia, se plaignirent auprès d’Urbain II des concessionsexorbitantes faites aux « Marseillais »77. Le pape les confirma cepen-dant, se limitant à reconnaître, de façon générale, que les moinesdevaient obéissance à l’ordinaire du lieu. Seuls les évêques de Sulcis(dont le diocèse comprenait la petite île de Sant’Antioco) réussirentà récupérer églises et possessions, sous le pape Pascal II, sans doutedu fait qu’un moine victorin issu de San Saturno était monté sur lesiège épiscopal78. En 1118, l’archevêque Guillaume de Cagliari selamentait de l’état de son église, autrefois « puissante et honorée »,désormais « en ruine », à la suite de « tribulations » qui sont évoquéesdans une lettre adressée au pape : les responsables de cette situationétaient les « mains laïques » (celles, on le comprend, des juges deCagliari) qui, « à l’encontre des décrets des papes », avaient spoliél’archevêque en transférant tous ses biens à la communauté de SanSaturno79. L’allusion aux « mains laïques » et aux « décrets despapes » constituent bien évidemment un retournement de l’argu-mentaire et des mots d’ordre « grégoriens », ici dirigés contre lesmoines « grégoriens » de Saint-Victor. Dans sa lettre, l’archevêqueGuillaume dénonce également la confiscation, à l’avantage des« Marseillais », d’un monastère dont les religieuses furent honteuse-ment expulsées – une manière forte qui caractérisait parfois les agis-sements de Saint-Victor, si l’on en juge par d’autres accusationsformulées, en d’autres régions, dans un contexte similaire80. L’arche-vêque de Cagliari implore enfin le pape de ne pas écouter les moinesde Marseille qui pourraient se rendre auprès de lui pour présenter leursméfaits sous un jour favorable81.
Pour régler le problème, Calixte II envoya dans l’île le cardinalPierre, titulaire de Santa Maria in Trastevere. En 1119, après denombreuses luttes (innumera variaque certamina), en présence etsous la pression de ce légat (instante et agente domno Petro aposto-licae sedis cardinali atque legato), ainsi qu’à la demande du juge deCagliari (rogatu etiam judici), un accord est finalement trouvé entre
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page279
l’archevêque et le prieur de San Saturno, Bérenger, qui se voitconfirmer l’essentiel des églises et des biens du prieuré. Le jourmême de l’accord, les litiges apaisés (sopitis omnibus litibus), l’autelmajeur de l’église de San Saturno est solennellement consacré « enl’honneur des bienheureux apôtres Pierre et Paul et de saint Victormartyr »82. La consécration était un instrument que nous dirions poli-tique, en tout cas une occasion de marquer la fin d’un conflit etl’imposition de la paix, ut omnis deinceps quaestio, omnisque contro-versia penitus aboleatur ; elle supposait des relations apaisées entreles moines de San Saturno et l’archevêque consécrateur. Si l’église deSan Saturno fut consacrée en 1119, c’est aussi qu’elle avait étéprofondément réaménagée par les moines qui s’étaient installés dansson voisinage en 1089, et que trente ans plus tard, les travaux derestructuration de l’édifice étaient à peu près achevés.
III. MONUMENTS GRÉGORIENS, DE MARSEILLE À CAGLIARI
1. Restaurer, reconstruire, réformer : des moines bâtisseurs
Une charte en langue sarde, rédigée vraisemblablement en 1074,qui fait état de la dotation de l’archevêché de Cagliari par le jugeOrzocco Torchitorius, paraît faire allusion à des travaux de construc-tion à venir : le juge fait en effet savoir qu’il met à la disposition del’archevêque le service dû par les liberus de paniliu de Cagliari,groupe d’artisans tenus d’accomplir une sorte de corvée, parmilesquels sont mentionnés des maistrus in pedra et in calcina, c’est-à-dire des travailleurs « maîtres dans la pierre et la chaux »83. Peut-être des projets monumentaux ont-ils alors été envisagés, alors quela papauté grégorienne remodelait les archevêchés, en vue de recons-truire ou d’adapter des édifices cultuels, en particulier de plan cruci-forme, qui renvoyaient tout à la fois aux martyria de l’Antiquité et à
280 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page280
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 281
la tradition byzantine, aux formes architecturales et à la liturgie del’Église romaine du XIe siècle84. Les moines de Saint-Victor, dontnous avons vu qu’ils se virent confier nombre d’églises, paraissentavoir joué un certain rôle dans la transformation de ces édifices : àl’entreprise de romanisation des lieux de culte s’ajoutait parfois leurréaménagement en prieurés.
Les religieux récupérèrent trois types de lieux de culte85. Lepremier type est constitué par des églises baptismales anciennes,comme Santo Stefano à Posada : sur ce site, les archéologues ont misen évidence la présence d’une église baptismale, édifiée durant lapériode byzantine, avant l’établissement du lieu de culte médiéval ; ony repère une piscine cruciforme, jouxtant une aire funéraire avec destombes d’époques byzantine, médiévale et moderne86. D’anciennescuves baptismales ont été également relevées près de Cagliari, asso-ciées à d’autres églises données aux « Marseillais », comme SanGiorgio de Decimo87 et Santa Maria di Vallermosa (que l’on peut iden-tifier à Santa Maria de Paradiso)88. De même que dans plusieurs casattestés en Provence89, les cuves baptismales n’étaient apparemmentplus visibles ou plus utilisées au moment de la cession de ces églisesaux moines de Marseille. Qu’en était-il de la fonction baptismale ?L’intérêt des religieux pour des églises anciennes qui avaient joué unrôle dans la cura animarum pourrait en tout cas indiquer leur volontéde réactiver ce rôle ou du moins de participer à l’encadrement desfidèles. Un deuxième type d’églises récupérées par les religieux deSaint-Victor dans le judicat de Cagliari est composé d’édifices situésen des lieux stratégiques pour le contrôle du littoral, du port et dessalines90 : l’implication des moines dans les activités d’extraction et decommerce du sel paraît expliquer la possession d’une sorte de réseaude bâtiments placés près des salines de Santa Gilla (San Genesio deUta, à l’ouest de Cagliari, et San Pietro dei Pescatori, à l’est) et dessalines orientales (Sant’Elia de Monte) ; sur le port de Cagliari se trou-vait l’église de Santa Maria de Portu Salis et sur celui de Palmas, prèsde Sant’Antioco, l’église de Santa Maria di Palmas91. Le troisième typed’édifices repris en main par les « Marseillais » est celui des églisesmartyriales fréquentées par des pèlerins92. Les religieux de Saint-
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page281
Victor héritèrent ainsi des grands sanctuaires de la Sardaigne méri-dionale : San Saturno de Cagliari, Sant’Antioco de Sulcis etSant’Efisio de Nora93. Il convient de s’attacher à ces trois édifices dontl’histoire, défrichée dans les dernières années par Roberto Coroneo,permet de reformuler la traditionnelle question de l’« art de la réformegrégorienne »94, en mettant en évidence le processus de « monumen-talisation » qui accompagna la réforme.
San Saturno de Cagliari est l’un des plus anciens lieux de cultechrétiens de l’île, établi sur le site d’une nécropole romaine95. Lepremier établissement chrétien, un martyrium avec une structure encroix grecque, s’y serait développé aux Ve et VIe siècles. L’installa-tion d’un monastère à l’emplacement d’une église martyriale, dansune zone de nécropole, devait d’autant plus séduire les moines venusde Saint-Victor que les origines de San Saturno renvoyaient à lagenèse du monachisme sur l’île. Vers 519, en effet, une premièrecommunauté monastique avait été fondée à San Saturno par l’évêqueFulgence de Ruspe, exilé en Sardaigne par les Vandales : la Vie deFulgence (533-534) raconte que celui-ci avait établi son monastèreiuxta basilicam96. Une telle histoire n’était pas sans rappeler celle deSaint-Victor, dont les moines marseillais du XIe siècle racontaient –ils le racontent précisément depuis le milieu du XIe siècle – queCassien, venu d’Orient, avait fondé à Marseille, à côté de la basiliquedu martyr Victor, une communauté monastique qui devait ensuite êtredispersée par les Vandales97.
La récupération et la restructuration des églises sardes par desmoines venus de Saint-Victor doit être mise en rapport avec quelquestextes élaborés à Marseille à partir des années 1060, alors que se diffu-saient les mots d’ordre de la réforme grégorienne, notamment despréambules de charte qui présentent les religieux comme les succes-seurs des apôtres, eux-mêmes campés en fondateurs d’Églises, maisaussi en constructeurs d’édifices de culte – édifices « de bois et depierre », insistent les préambules. À l’époque où les moines récupé-raient différents lieux de culte pour les transformer en prieurés, enProvence et en Languedoc, ils se représentaient donc en héritiers eten continuateurs d’apôtres constructeurs, en moines bâtisseurs98.
282 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page282
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 283
Leur installation et les constructions qu’ils entreprirent en Sardaigne,quelques décennies plus tard, illustrent ce modèle ecclésiologique.
Les églises cédées aux religieux furent souvent transformées.C’est qu’il fallait adapter à des exigences tout à la fois romaines etmonastiques des édifices de tradition ancienne qui n’étaient pasadaptés aux exigences de la vie et de la liturgie monastiques. SanSaturno n’était pas un édifice abandonné, ni même délaissé lorsqueles moines reçurent les bâtiments en 1089, ainsi que l’indiquent lesfragments retrouvés du décor sculpté et du mobilier liturgique, datésde la seconde moitié du Xe siècle. L’édifice ecclésial de plan cruci-forme surmonté d’une coupole – qui rappelait l’Apostoleion réamé-nagé à Constantinople à l’époque de Justinien – fut cependant intégrédans un lieu de culte nouveau : le monument originel fut ainsiconservé (et donc, en un certain sens, mis en valeur) au cœur du bâti-ment reconstruit, achevé vers 1119, au moment de la consécration(fig. 9). L’englobement de l’antique martyrium dans la partie centralede la nouvelle église était éminemment symbolique, mais en marquantune rupture, au centre du bâtiment, entre un sanctuaire profond etdéveloppé, d’une part, et une triple nef peut-être ouverte aux laïcs,d’autre part, la configuration des lieux favorisait surtout l’accom-plissement de la liturgie monastique en même temps qu’elle pouvaitpermettre l’accueil de fidèles. Comme ils l’avaient fait à Saint-Victorde Marseille et le firent dans d’autres églises de Sardaigne99, les« Marseillais » entreprirent en outre à San Saturno de mettre enscène l’antiquité du lieu de culte en remployant les colonnes et lemobilier liturgique anciens.
Sant’Antioco de Sulcis, petite île au sud-ouest de la Sardaigne, estun autre sanctuaire vénérable, édifié sur une nécropole comprenant deschambres funéraires phénico-puniques transformées en catacombeschrétiennes entre le IVe et le VIIe siècle100. Les moines de Marseille yrestructurèrent vraisemblablement un martyrium cruciforme en basi-lique longitudinale à trois nefs, avec coupole à la croisée du transept ;l’édifice fut couronné par une abside orientée, flanquée d’une absidemineure101 (fig. 10). Les études récemment menées sur les nombreusespièces (ou fragments) d’un riche mobilier liturgique daté de la fin du
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page283
Xe et du début du XIe siècle indiquent l’existence, avant l’arrivée desmoines, d’un lieu de culte richement décoré, lié à la famille judicale deCagliari (fig. 2 et 4)102. C’est donc un édifice prestigieux, commel’était San Saturno, que reçurent en 1089 les religieux de Saint-Victor.Ils y ont aménagé un accès aux catacombes à partir du bras méridional
284 CAHIERS DE FANJEAUX 48
Fig. 9 – San Saturno de Cagliari : la basilique martyriale des Ve-VIe siècles etles réaménagements des années 1089-1119 (S. Sorin, CEPAM, d’aprèsCoroneo, Architettura, p. 29).
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page284
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 285
du transept de l’église, tandis que les catacombes elles-mêmes étaienttransformées en crypte : la mise en place d’une enfilade de six colonnes(dépourvues de toute fonction architectonique : les catacombes étaientcreusées dans la roche), différentes les unes des autres, parfois surmon-tées de chapiteaux, dessina une sorte de déambulatoire, instituant unparcours dévotionnel autour de reliques enfermées dans un sarco-phage-autel. Si l’on a pu reconnaître dans ce dispositif une référence
Fig. 10. Sant’Antioco de Sulcis : l’église des IVe-VIIe siècle, réaménagée aux XIe-XIIe siècle (vers 1102, date de la consécration), ainsi que les catacombes trans-formées en crypte (S. Sorin, CEPAM, d’après Coroneo, Architettura, p. 35).
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page285
romaine (la confessio de Saint-Pierre au Vatican), un tel aménagementparaît plutôt une réplique de la crypte de Saint-Victor de Marseille, elleaussi en partie creusée dans la roche, comme l’étaient plusieurs struc-tures similaires réalisées au XIe siècle dans les églises provençalesrécupérées par Saint-Victor103. Les concepteurs du nouvel ensemble deSant’Antioco mirent en scène colonnes et blocs de marbre à fortevaleur représentative – certaines des pièces ainsi exposées appartenaientau mobilier de la fin Xe et du début du XIe siècle, d’autres remontaientà l’édifice originel, c’est-à-dire aux Ve et VIe siècles104 ; on peut penserque le démembrement et la réorganisation de ce mobilier plus oumoins ancien eurent lieu au moment de la cession de l’église aux reli-gieux, soucieux de transfigurer l’édifice, en effaçant au besoin certainesde ses formes byzantines. En 1102, l’église nouvelle (achevée ou surle point de l’être) était consacrée105.
L’église de Sant’Efisio de Nora, également établie sur le sited’une nécropole antique, est le troisième sanctuaire important dans larégion de Cagliari (fig. 11)106. Les moines y ont reconstruit un lieu deculte dédié au martyr Efisius, supplicié en 303 sous Dioclétien, dontle corps aurait été conservé sur place jusqu’en 1088 (les Pisansl’auraient ensuite emporté dans leur ville). L’existence d’un marty-rium ancien est vraisemblable et étayée par des inscriptions paléo-chrétiennes, mais on ignore tout de l’édifice du haut Moyen Âgeauquel appartenaient peut-être les sculptures médio-byzantinesretrouvées près de Nora, au large de l’île de San Macario (fig. 3).Comme à San Saturno et à Sant’Antioco, le réaménagement deslieux – qui consista ici en une reconstruction ex novo adoptant laforme d’une église à trois nefs – atteste la volonté des moinesmarseillais de réactiver les sanctuaires qui polarisaient la dévotion desfidèles. La réappropriation de sites littoraux auparavant exposés auxincursions arabes (c’était le cas de Nora) pouvait en outre favoriserune sorte de contrôle territorial par les pouvoirs nouveaux. L’églisede Sant’Efisio donnait accès à une petite crypte englobant peut-êtreune partie de la structure originelle, désormais souterraine. Lors dela construction de l’église, une petite stèle funéraire d’époque puniquefut intégrée, bien en vue, dans le mur méridional de l’église (fig. 12).
286 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page286
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 287
Fig. 11. L’église Sant’Efisio de Nora, reconstruite à la fin du XIe siècle.
Fig. 12. Sant’Efisio à Nora, stèle funéraire d’époque punique intégrée dans le mur de l’église.
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page287
2. Liturgie romaine et culte des saints fondateurs
Les réaménagements architecturaux, qui coïncident avec l’arrivéedes « Marseillais » (il en est de même pour les églises récupérées parles moines du Mont-Cassin), étaient au moins en partie des réponsesaux exigences résultant de la diffusion de la liturgie romaine enSardaigne. En réalité, à part la lettre de Grégoire VII appelant le clergésarde à suivre les usages de l’ensemble de l’Église latine107, on nedispose pas pour la Sardaigne de documents normatifs ou liturgiquesaussi clairs que pour l’Espagne, où le légat et abbé de Saint-VictorRichard joua un rôle de premier plan dans la lutte contre la liturgiemozarabe au profit du rite romain108 ; lorsqu’ils prenaient possessiond’un monastère, comme ce fut le cas à Ripoll en 1070, les moines deMarseille y apportaient du reste leur liturgie109.
En relatant l’ambassade envoyée au Mont-Cassin, en 1063, par lejuge Barison de Torres, la Chronique du Mont-Cassin explique tout demême que l’abbé Didier avait répondu favorablement à la demande dujuge en dépêchant en Sardaigne un groupe de douze moines porteursde manuscrits (divinarum scripturarum codices : sans doute des textesbibliques plutôt que liturgiques, mais l’expression peut être envi-sagée dans un sens générique). Les moines envoyés en Sardaigne parti-rent en outre cum diversis ecclesiastici ministerii apparatibus, ainsiqu’avec des reliques et « diverses autres choses » pour le culte110. Demême, lorsque trois ans plus tard, le juge de Cagliari avait cédé sixéglises au Mont-Cassin (nous avons vu qu’il préféra ensuite se tournervers Saint-Victor), il réclama à l’abbé Didier l’envoi « d’un moine avecdes livres » (monachus cum codicibus) et de tout ce qui pourrait êtreutile pour faire, diriger et gouverner un monastère (omnis argumentumad monasterium facere, et regere, et gubernare)111.
Pour une époque plus tardive, on dispose d’inventaires d’objetsde culte et de livres conservés dans certaines églises prises en chargepar Saint-Victor. En 1229, l’église San Pietro Pescatore de Cagliaricomptait une dizaine de livres liturgiques (libri ecclesiastici consueti),dont duo ordines unus latinus, alter vulgaris112. En 1338, un inven-taire complet des biens de San Saturno, réclamé par l’abbé de Saint-Victor après l’installation d’un nouveau prieur, Guillaume de Bagard
288 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page288
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 289
(localité de l’actuel département français du Gard), mentionneplusieurs livres liturgiques : officiale sive librum officiorum unum,legendarium unum113.
Si les moines de Marseille ont pu apporter en Sardaigne desusages liturgiques nouveaux, ils ont aussi rénové les traditions hagio-graphiques des grands sanctuaires martyriaux qu’ils restructuraient.Ce sont eux, semble-t-il, qui réécrivent, entre la fin du XIe et ledébut du XIIe siècle, une Passion de saint Saturne probablementcomposée entre le VIe et le VIIIe siècle, relatant l’histoire de ce jeunechrétien décapité en 304, à l’époque des empereurs Dioclétien etMaximien, à Cagliari, alors gouvernée par un certain Barbarus,praeses de la Sardaigne et de la Corse114. Selon la légende, le corpsdu martyr, recueilli par des fidèles, avait été mené à la périphérie dela cité et enseveli dans une crypte : Christiani rapuerunt corpusbeati Saturni et […] extra civitatem clam pertulerunt et in quamdamcryptam cum honore magno sepelierunt115. Une telle histoire rappe-lait évidemment celle de saint Victor, dont une légende hagiogra-phique, réécrite au début du XIe siècle, racontait le transport du corpsdu martyr à la périphérie de Marseille et son ensevelissement par desfidèles dans la roche, au sein d’une crypte116. À Cagliari, c’est à proxi-mité du lieu de sépulture de Saturne que Fulgence avait construit unmonastère, tout comme l’avait fait Cassien auprès du lieu de sépul-ture de Victor. Le texte recomposé en l’honneur du martyr deSardaigne, au moment où l’église de San Saturno était sans doute enchantier, évoque les « leçons » que les « moines » récitent « dans leurbasilique »117. Vers la même époque fut rédigée à Sant’Antioco, vrai-semblablement par des moines de Saint-Victor, une Passio sanctiAntiochi martyris118, qui mentionne de même l’inhumation du martyrdans une crypte et, à plusieurs reprises, la manière dont la turba mona-chorum chante désormais ses louanges119. La reprise de ces traditionshagiographiques paléochrétiennes renvoyait à la fondation de l’Églisechrétienne, à la primitiva Ecclesia de Jean Cassien et de Fulgence deRuspe, dont les moines de Saint-Victor se disaient les continuateurs,en Sardaigne comme en Provence.
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page289
CONCLUSION : UNE MISE AU PAS
Au terme de cette étude relative à la présence des moines deSaint-Victor de Marseille, à l’époque des papes « grégoriens », dansune île de la Méditerranée bien éloignée de leur maison mère,quelques conclusions s’imposent :
1. La première concerne la diffusion d’un programme réformateur,dont nous avons observé les éléments principaux : la réorganisation dupouvoir épiscopal et des diocèses120 et le contrôle accru sur les pratiquesmatrimoniales de l’aristocratie121, qui paraissent avoir été généralisésdans l’Occident de cette époque, tandis que l’effacement des traditionsculturelles et religieuses anciennes, d’allure byzantine, s’avère plusspécifique à la Sardaigne. Quelques réflexions ont été proposées danscette étude à propos du processus de « monumentalisation » des lieuxde culte mis en œuvre par les réformateurs latins : des enquêtes archéo-logiques précises, attentives à la chronologie des transformations, ainsiqu’aux rapports entre architecture et liturgie, devraient être menées afind’étayer, corriger ou prolonger les hypothèses avancées.
2. Entreprise initialement par les moines du Mont-Cassin et ceuxde Saint-Victor de Marseille, la réforme peut être envisagée commeune mise au pas, au nom d’un projet de romanisation – plutôt que delatinisation – apparemment plus ferme qu’il ne le fut ailleurs enItalie méridionale : en Calabre et en Pouille, par exemple, l’accultu-ration fut beaucoup plus lente et peu exigeante dans les domainesdogmatique et liturgique, jusqu’à permettre longtemps la coexis-tence des deux rites, grec et latin – une coexistence qui pouvait dureste conforter la prétention du pape à gouverner une Église univer-selle122. Les moines du Mont-Cassin eux-mêmes cultivaient d’ailleursdes traditions liturgiques grecques123. S’il est vrai que ceux de Saint-Victor avaient accueilli, près de Marseille, une petite communauté dereligieux grecs (dont on ne connaît toutefois pas le sort dans laseconde moitié du XIe siècle) et conservaient dans leurs archivesune charte grecque du juge de Cagliari, ils mirent néanmoins au pasles régions sardes qui leur étaient confiées, au nom de l’Égliseromaine, soutenant ainsi une stratégie de domination de certaines îles
290 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page290
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 291
de la mer Tyrrhénienne par la papauté. Sur l’île sarde, celle-ci setraduisit par l’installation (ou la reconnaissance) de pouvoirs « obéis-sants » : l’entreprise des papes réformateurs rencontra ici la quête delégitimité des juges. Nous avons vu qu’en Corse, la mise au pas futplus radicale encore, imposant le dominium direct du pape. En Sicileet dans l’ensemble de l’Italie normande, la légation apostoliqueaccordée aux souverains permit au contraire à ces derniers de réformeret de gérer leur Église sans guère d’intervention du souverainpontife124. Entre ces deux extrêmes, la Sardaigne présente en quelquesorte une situation intermédiaire – dont le grand intérêt est de nouspermettre d’observer au mieux des « réformateurs » à l’action.
3. Dans la perspective d’une géopolitique de la « réforme grégo-rienne », il faut enfin relever la part prise par la Provence ou, plus exac-tement, par certains Provençaux dans la diffusion de la réforme dansles pays de la Méditerranée occidentale. Ces Provençaux étaient desmoines, et leur histoire est aussi celle de la construction d’une Églisemonastique, dont on distingue, dans le cas de Saint-Victor, trois temps :celui, d’abord, de la restauration et de la constitution d’un solide patri-moine en Provence ; celui, ensuite, de l’essaimage et de la multiplica-tion des prieurés au-delà de l’horizon provençal ; celui, enfin, del’universalisme grégorien, que les « Marseillais » portèrent au loin.
ANNEXES
1.Lettre de Jean, moine de Gallura, à Richard, cardinal
et abbé de Saint-Victor de Marseille[entre 1092-1099]
Original : Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 1 H 76, n° 370.
Domino hac reverentissimo .R. cardinali sancte Romane Ecclesie atquecuncte congregationis monasterii Massiliensis abbati, Iohannes servus […]125
Dei, indignus monachus vester apud Galluri, fideles horationes.
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page291
Volo vobis notificare et indicare, domine pater, quod adversum nobis estin hac terra in qua sumus. Scitis vos, karissime pater, quia quod domnus papeanacematizavit iudicem Torquitorem et cunctam regionem suam, ita utnullus christianus det ei consilium, neque osculum pacis, et « Ave » ei nulluschristianus dicere presumat. Et ipse superbus et profugus semper in errore suaperseuerat, et ad gremium sancte Ecclesie reuertere nollet. Super omnia istamisit domnus pape legatum suum aput Sardinia etiam archiepiscopo Pisanoviro prudentissimo venit aput Turris, vocavit archiepiscopos et episcoposSardinie ut venirent ad sanctum sinodum ; venerunt omnes in hunc locum etvocaverunt ex parte apostolica istum ereticum ut reverteretur ad gremiumsancte matris ecclesie. Sed iste maledictus et impiissimus tirannus obduratusest sicut lapis adamantinus, ut nullus ferrus neque acer incidere in eumpotest ; fecit itaque ut archiepiscopi et episcopi omnes contristati sunt valde ;clamabant una voce omnes : « Anacematiza, anacematiza ! » Et confirmavitlegatus126 et episcopi cum consilio omnes principes Sardinie precepta apos-tolica maledixerunt et condepnaverunt eum et traxe in potestate demo-niorum. Modo, magister et pater, nos sumus in hac tribulacione et nesciemusquid faciam(us). Rogamus et obsecramus127, karissime domine, ut talemconsilium mitiatis nobis, sicut pastor bonus, que fiant salva anima et corporanostra. Quia nos, domine, magnam verecundiam habemus quod occuloshumanos digito demonstrant nobis : « Ecce illos qui participant cum illoeretico », et nos sumus in magna tribulacione et angustia, non tantum per nosset eciam per infamiam malam nostro monasterio. Adhuc omnia sustinemusper vestra obediencia, sed unum pondus adversum nobis est que nonpossumus sustinere de isto scomunicato que narrat nobis : « Si vultis fierimecum in terra mea, sciatis bene in veritate quod ego volo ut omne divinumofficium faciatis, set tantum non vultis facere hoc, exite de terra et de cogna-cione mea, et de rem vestram nullum vobis dabo nisi tantum vestimenta ».Modo de istum volumus abere vestrum consilium : quomodo faciamus adonorem Dei, et de nostro monasterio, et Ecclesie Romane.
Et de alia causa volo vos dicere modo de fratre Oberto quem ego misipreterito anno ad vos cum illa paupertate quam Dominus mihi donare placuit,scilicet CCCL sol. de Lucensis. Audivi de hoc quod tristatus sum valde quiamonasterius noster non habuit nisi C sol., et facio de vos, pater, multummirum de hoc quod fecistis, quia ego mandavi frater Oberto iuniorem et vosmisistis illum michi priorem sine litteris vestris et sine aliquo testimonio, etego non credo, quia amplius non vidi in Sardinia. Modo mandate michi omniacicius, ita ut ego faciam per litteris nostris cognitis. Valete.
292 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page292
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 293
2.Profession de foi du juge Constantin de Cagliari
[ca 1090]
Édition : E. Martène et U. Durand, Veterum scriptorum et monumen-torum, historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio, vol. 1,Paris, 1724, col. 526, d’après un original scellé de plomb alors conservé dansles archives de Saint-Victor de Marseille, aujourd’hui perdu.
Ego in Dei nomine Constantinus rex et iudex Sardinie, ob remedium animemee et parentum meorum, omnes pessimas consuetudines antecessorummeorum et aliorum principum Sardinie, scilicet concubinarum, homicidii,consanguinitatis, in manu Dei omnipotentis et beati Petri relinquo et refuto ;ipsos etiam episcopatus et ecclesias, ac presbyteros in honorem Dei et beatiPetri canonice ordinandos relinquo. Decimas etiam ac primitias ab hac die inantea me fideliter redditurum promitto. Et hec faciendi et attendendi omnibusinfra regnum meum positis consilium et adiutorium in quantum potero dabo.Hec omnia que predixi fideliter promitto et fideliter attendam.
Notes
Sigles et abréviations
Sources– ABdR : Marseille, Archives des Bouches-du-Rhône.– Blancard et Wescher, « Charte sarde » : M. Blancard et M.K. Wescher, « Charte
sarde de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille écrite en caractères grecs »,Bibliothèque de l’École des chartes, 35, 1874, 255-265.
– Blasco Ferrer, Crestomanzia : E. Blasco Ferrer, Crestomanzia sarda dei primisecoli, Nuoro, 2003, 2 vol.
– CDS XI : P. Tola, Diplomi e carte del secolo XI, dans Codice diplomatico dellaSardegna, Turin, 1861, réimpr. Sassari, 1984, 147-166.
– CDS XII : P. Tola, Diplomi e carte del secolo XII, dans Codice diplomatico dellaSardegna, Turin, 1861, réimpr. Sassari, 1984, 177-283.
– CSV : B. Guérard, Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, Paris, 1857.– Piras, Passio : Passio Sancti Saturnini (BHL 7491), ad fidem codicum qui
adhuc exstant nun primum critice edita ac commentario instructa ab A. Piras,Rome, 2002.
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page293
– Reg. Grégoire VII : E. Caspar, Das Register Gregors VII., I-II, MGH. Epistolaeselectae, II/1-2, Berlin, 1920.
– Sorgia, « Un documento » (= Sorgia, « Une lettre ») : G. Sorgia, « Un documentoinedito su Bernardo priore del monastero vittorino di San Saturno di Cagliari »,dans Studi Vittorini, p. 84-88 (= G. Sorgia, « Une lettre inédite (1140) de Bernard,prieur de San Saturno, à Pierre, abbé de Saint-Victor », Provence historique, 16,1966, 387-392).
– Volpini, « Documenti » : R. Volpini, « Documenti nel Sancta Sanctorum delLaterano. I resti dell’“Archivio” di Gelasio II », Lateranum, n. s., 52, 1986/1, 261-264.
– Vie d’Isarn : C. Caby, J.-F. Cottier, R.M. Dessì, M. Lauwers, J.-P. Weiss,M. Zerner, Vie d’Isarn, abbé de Saint-Victor de Marseille au XIe siècle. Édition,traduction, introduction et notes, Paris, 2010.
Travaux– Baratier, « L’inventaire » : É. Baratier, « L’inventaire des biens du prieuré Saint-
Saturnin de Cagliari », dans Studi storici in onore di Francesco Loddo Canepa,Florence, 1959, II, 43-74.
– Baratier, « Les relations commerciales » : É. Baratier, « Les relations commer-ciales entre Marseille et la Sardaigne au Moyen Âge », dans Atti del VI Congressointernazionale di studi sardi, I, La Storia, Cagliari, 1962, 293-342.
– Boscolo, L’abbazia di San Vittore : A. Boscolo, L’abbazia di San Vittore, Pisae la Sardegna, Padoue, 1958.
– Cau, « Peculiarità » : E. Cau, « Peculiarità e anomalie della documentazione sardatra XI e XIII secolo », dans Giudicato d’Arborea e Marchesato di ristano : proie-zioni mediterranee e aspetti di storia locale, éd. G. MELE, Oristano, 2000, 313-421,disponible, dans une version revue, sur le site Scrineum : http://scrineum.unipv.it/biblioteca/Cau/cau1.htm. Voir en particulier les annexes intitulées « Lecarte sarde (secc. XI e XII) in Archives Départementales des Bouches-du-Rhônedi Marsiglia » et « Il greco in Sardegna e la carta greca di Marsiglia (1081-1089) ».
– Codou, « Une mémoire de pierre » : Y. Codou, « Une mémoire de pierre : chan-tiers romans et monumenta paléochrétiens en Provence », dans Lérins, une îlesainte de l’Antiquité au Moyen Âge, dir. Y. Codou et M. Lauwers, Turnhout,2009, 562-600.
– Colombini, Dai Cassinesi ai Cistercensi : G. Colombini, Dai Cassinesi aiCistercensi. Il monachesimo benedettino in Sardegna nell’età giudicale (XI-XIIIsecolo), Cagliari, 2012.
– Commitenza, scelte insediative : Committenza, scelte insediative e organizzazionepatrimoniale nel Medioevo, éd. L. Pani Ermini, Spolète, 2007.
– Coroneo, « Frammenti » : R. Coroneo, « Frammenti scultorei dal VI all’XIsecolo », dans L. Porru, R. Serra, R. Coroneo, Sant’Antioco. Le Catacombe, laChiesa Martyrium, i frammenti scultorei, Cagliari, 1989, 123-161.
294 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page294
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 295
– Coroneo, « Le epigrafi » : R. Coroneo, « Le epigrafi medioelleniche e la commit-tenza dei primi giudici di Cagliari », dans Quaderni Bolotanesi, 17, 1991, 321-332.
– Coroneo, Architettura : R. Coroneo, Architettura romanica dalla metà del Milleal primo’300, (Storia dell’arte in Sardegna), Nuoro, 1993.
– Coroneo, Scultura mediobizantina : R. Coroneo, Scultura mediobizantina inSardegna, Nuoro, 2000.
– Coroneo, « Il culto dei martiri » : R. Coroneo, « Il culto dei martiri localiSaturnino, Antioco e Gavino nella Sardegna giudicale », MEFRMA, 118/1,2006, p. 5-16.
– Coroneo, La chiesa altomedievale : La chiesa altomedievale di San Salvatore diIglesias. Architettura e restauro, éd. R. Coroneo, Cagliari, 2009.
– Coroneo, Arte : R. Coroneo, Arte in Sardegna dal IV alla metà dell’XI secolo,Cagliari, 2011.
– Coroneo et Serra, Sardegna : R. Coroneo et R. Serra, Sardegna preromanica etromanica, Milan, 2004.
– Deswarte, Une Chrétienté romaine : T. Deswarte, Une Chrétienté romaine sanspape. L’Espagne et Rome (586-1085), Paris, 2010.
– Fixot et Pelletier, Saint-Victor (a) : M. Fixot et J.-P. Pelletier, Saint-Victor deMarseille. Étude archéologique et monumentale, Turnhout, 2009.
– Fixot et Pelletier, Saint-Victor (b) : M. Fixot et J.-P. Pelletier (dir.), Saint-Victorde Marseille. Études archéologiques et historiques, Turnhout, 2009, 213-238.
– Gregorio Magno e la Sardegna : Gregorio Magno e la Sardegna, éd. L.G.G.Ricci, Florence, 2007.
– Insulae Christi : Insulae Christi. Il cristianesimo primitivo in Sardegna, Corsicae Baleari, éd. P.G. Spanu, Oristano, 2002.
– Lauwers, « Cassien » : M. Lauwers, « Cassien, le bienheureux Isarn et l’abbéBernard. Un moment charnière dans l’édification de l’Eglise monastique proven-çale (1060-1080) », dans Fixot et Pelletier, Saint-Victor (b), 213-238.
– Lauwers, « Consécration d’églises » : M. Lauwers, « Consécration d’églises,réforme et ecclésiologie monastique. Recherches sur les chartes de consécrationprovençales du XIe siècle », dans Mises en scène et mémoires de la consécrationd’église au Moyen Âge, dir. D. Méhu, Turnhout, 2007, 93-142.
– Magnani, Monastères : E. Magnani Soares-Christen, Monastères et aristocratieen Provence, milieu Xe-début XIIe siècle, Münster, 1999.
– Magnani, « Saint-Victor » : E. Magnani Soares-Christen, « Saint-Victor deMarseille, Cluny et la politique de Grégoire VII au nord-ouest de laMéditerranée », dans Die Cluniazenser in ihrem politisch-sozialen Umfeld, dir.G. Constable, G. Melville, J. Oberste, Münster, 1998, 321-347.
– Martin, « L’Occident chrétien » : J.-M. Martin, « L’Occident chrétien dans le“Livre des Cérémonies”, II, 48 », dans Travaux et Mémoires, 13, 2000, 617-645.
– Martin, « Les actes » : J.-M. Martin, « Les actes sardes, XIe-XIIe siècle », dansL’héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle), vol. I (La fabrique documentaire),éd. J.-M. Martin, A. Peters-Custot, V. Prigent, Rome, 2011, 191-205.
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page295
– Mazel, La noblesse et l’Église : F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence,fin Xe-début XIVe siècle. L’exemple des familles d’Agoult-Simiane, de Baux et deMarseille, Paris, 2002.
– Mazel et Lauwers, « L’abbaye Saint-Victor » : F. Mazel et M. Lauwers,« L’abbaye Saint-Victor », dans Marseille au Moyen Âge, entre Provence etMéditerranée : les horizons d’une ville portuaire, dir. Th. Pécout, Méolans-Revel,2009, 125-144.
– Nebbiai-Dalla Guarda, « Saint-Victor de Marseille et l’Italie » : D. Nebbiai-DallaGuarda, « Saint-Victor de Marseille et l’Italie : notes d’histoire culturelle »,dans D. Nebbiai-Dalla Guarda, J.-F. Genest, Du copiste au collectionneur.Mélanges d’histoire des textes et des bibliothèques en l’honneur d’André Vernet,(Bibliologia, 18), Turnhout, 1999, 285-300.
– Orientis radiata fulgore : « Orientis radiata fulgore » : la Sardegna nel contestostorico e culturale bizantino, éd. L. Casula, Cagliari, 2008.
– Ronzani, Chiesa : M. Ronzani, Chiesa e « Civitas » di Pisa nella seconda metàdel secolo XI. Dall’avvento del vescovo Guido all’elevazione di Daiberto ametropolita di Corsica (1060-1092), Pise, 1996.
– Spanu, Martyria : P.G. Spanu, Martyria Sardinae. I santuari dei martiri sardi,Oristano, 2000.
– Spanu, « I possedimenti » (a) : P.G. Spanu, « I possedimenti vittorini del prio-rato cagliaritano di San Saturno. Il santuario del martire Efisio a Nora », dansCittà, territorio, produzione e commerci. Studi in onore di Letizia Pani Erminiofferti dagli allievi sardi per il settantesimo compleanno, éd. R. Martorelli,Cagliari, 2002, 65-103.
– Spanu, « I possedimenti » (b) : P.G. Spanu, « I possedimenti vittorini inSardegna », dans Committenza, scelte insediative, 245-279.
– Spanu et Zucca, I sigilli : P.G. Spanu et R. Zucca, I sigilli bizantini dellaSardnia, Rome, 2004.
– Studi sui Vittorini : Studi sui Vittorini in Sardegna, éd. F. Artizzu, E. Baratier,A. Boscolo, F. Casula, P. Leo, C. Manca, G. Sorgia, Padoue, 1963.
– S. Antioco : S. Antioco, da primo evangelizzatore di Sulci a glorioso protomar-tire, patrono della Sardegna, éd. R. Lai et M. Massa, Sant’Antioco, 2010.
– Turtas, Storia : R. Turtas, Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini alDuemila, Rome, 1999.
– Turtas, « La cura animarum » : R. Turtas, « La cura animarum in Sardegna trala seconda metà del sec. XI e la seconda metà del XIII. Da Alessandro II, 1061-1073, alla visita di Federico Visconti, marzo-giugno 1263 », Theologica etHistorica. Annali della Pontificia Facoltà teologica della Sardegna, 15, 2006,359-404.
– Zedda, « Bisanzio, l’Islam e i giudicati » : C. Zedda, « Bisanzio, l’Islam e i giudi-cati : la Sardegna e il mondo mediterraneo tra VII e XI secolo », ArchivioStorico Giuridico Sardo di Sassari, n. s. 10, 2006, 39-112.
296 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page296
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 297
– Zedda et Pinna, « La nascita dei giudicati » : C. Zedda et R. Pinna, « La nascitadei giudicati. Proposta per lo scioglimento di un enigma storiografico », ArchivioStorico Giuridico Sardo di Sassari, n. s. 12, 2007, disponible en ligne :http://www.archiviogiuridico.it/Archivio_12/Zedda_Pinna.pdf.
– Zedda et Pinna, La carta del giudice : C. Zedda et R. Pinna, La carta del giudicecagliaritano Orzocco Torchitorio, prova dell’attuazione del progetto gregorianodi riorganizzazione della giuridizione ecclesiastica della Sardegna, Sassari,2009, disponible en ligne : http://fermi.univr.it/rm/biblioteca/volumi/zeddapinna/volumeZeddaPinna.pdf.
* Je remercie vivement Jean-Marie Martin et Annick Peters-Custot, auxquels je doismaintes informations sur l’Italie méridionale, Yann Codou, qui m’a donné son avissur le dossier archéologique des églises sardes récupérées par les moines de Saint-Victor, Florian Mazel pour une relecture finale et Antoine Pasqualini et SabineSorin pour l’aide apportée dans le traitement des cartes et des illustrations.1. O. Capitani, « Esiste un “età gregoriana” ? Considerazioni sulle tendenze di unastoriografica medievistica », Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 1, 1965, 454-481 ; J. Gilchrist, « Was there a Gregorian Reform Movement in the EleventhCentury ? », The Canadian Catholic Historical Association : Studies Sessions, 37,1970, 1-10.2. Pour une synthèse inspirée de cette approche renouvelée qui s’est surtout déve-loppée en France : F. Mazel, Féodalités (888-1180), Paris, 2010, notamment chap.IV (« La rupture “grégorienne”, une révolution culturelle »), 235-297. 3. On ne peut guère faire état que de deux articles, très ponctuels, d’É. Baratier, àla fin des années 1950 (« L’inventaire » et « Les relations commerciales »), ainsique de quelques pages d’une étude, plus récente, de D. Nebbiai-Dalla Guarda(« Saint-Victor de Marseille et l’Italie »), qui s’inscrit dans le cadre des travauxmenés à l’IRHT sur les bibliothèques monastiques et leurs livres manuscrits.L’action des moines de Marseille en Espagne est au contraire traitée dans lestravaux français.4. On ne mentionnera que la synthèse, publiée dès 1958, par Boscolo, L’abbazia diSan Vittore, et celle, toute récente, de Colombini, Dai Cassinesi ai Cistercensi. Voiraussi, dans une perspective plus archéologique, Spanu, « I possedimenti », (a) et (b).5. R. Turtas (voir notamment sa Storia) a ainsi proposé une synthèse, novatrice surbien des points, de l’histoire de l’Église en Sardaigne, tandis que C. Zedda etR. Pinna (« La nascita dei giudicati » et La carta del giudice) ont réinterprétél’histoire politique et institutionnelle de l’île à l’époque de la « réforme grégo-rienne ». On doit par ailleurs à R. Coroneo maintes études sur les monuments ecclé-siaux et leur décor entre le très haut Moyen Âge et le XIIe siècle. 6. Les thèses de Magnani, Monastères (1999) et de Mazel, La noblesse et l’Église(2002), par exemple, ne sont pas utilisées dans les travaux italiens. Dans la biblio-graphie de Colombini, Dai Cassinesi ai Cistercensi (2012), les dernières études
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page297
françaises sur Saint-Victor remontent aux années 1960. Dans les études nombreuseset pourtant si importantes de R. Coroneo (ci-dessus note 5), on ne voit guère de réfé-rences concernant les édifices monastiques de la Provence, et la perspectivecomparatiste se limite le plus souvent aux travaux anciens sur le « premier artroman » catalano-provençal (J. Puig i Cadafalch). 7. Voir Martin, « L’Occident chrétien », 631-637, qui évoque la permanence d’uneadministration byzantine jusqu’aux alentours de 800, et Zedda, « Bisanzio, l’Islame i giudicati ». Sur le califat maritime de Denia et ses ambitions : T. Bruce, « Thepolitics of violence and trade : Denia and Pisa in the eleventh century », Journalof Medieval History, 32, 2006, p. 127-142, et Id., « Le califat méditerranéen et mari-time de Denia », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 130, 2012,p. 71-84. De manière générale, sur la présence musulmane en Sardaigne, on sereportera aux travaux encore inédits de P. Fois, La Sardaigne et l’Islam (VIIe-XIe siècle), thèse de l’université de Paris I-Panthéon Sorbonne, 2011.8. A. Guillou, Recueil des inscriptions grecques médiévales d’Italie, Rome, 1996,n° 215-231. Les inscriptions (de type dédicatoire) en caractères grecs aujourd’huiconservées (mais de manière fragmentaire et hors contexte d’origine) témoignent-elles de la committenza des juges de Cagliari, comme le suggère Coroneo, « Leepigrafi » ; Coroneo, Scultura mediobizantina, 23-30 ; Coroneo, Arte, 434-441 ?Sont-elles une manifestation de prestige, destinée à légitimer le (nouveau) pouvoirdes juges, comme l’avance G. Cavallo, « Le tipologie della cultura nel riflesso delletestimonianze scritte », dans Bisanzio, Roma e l’Italia nell’alto Medioevo. Settimanedi studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 34, Spolète, 1988, 467-529, ici 474-476 ? Ou s’agit-il plutôt de réalisations venues de Byzance destinéespeut-être à donner l’illusion d’une dépendance de l’île, comme me le suggère Jean-Marie Martin ? L’existence d’autres inscriptions, latines cette fois, témoigne d’undouble registre d’expression culturelle, grec et latin : cf. R. Coroneo, « Marmiepigrafici mediobizantini e identità culturale greco-latina a Cagliari nel secolo X »,Archivio Storico Sardo, 38, 1995, 103-121. La province byzantine de Sardaigneavait été dirigée par un juge civil et un dux militaire. Après la séparation avecByzance, les titres de « juge » et d’« archonte » sont attestés au IXe siècle.9. En dernier lieu : M.G. Sanna, « L’epistolario sardo-corso di Gregorio Magno »,dans Gregorio Magno e la Sardegna, 69-116.10. Sur l’influence de Byzance sur les usages religieux en Sardaigne, cf. Turtas,Storia, 140-175. Concernant certains rites et le chant liturgique (qui renvoie, dansle haut Moyen Âge, à des traditions grecques et latines) : G. Mele, « Notula su cultoe canti nella Sardegna bizantina », dans Orientis radiata fulgore, 247-261, Id.,« Appunti storici sul canto “gregoriano” e la liturgia in Sardegna dal secolo VIal XII. Rotte di culto e cultura », dans Gregorio Magno e la Sardegna, 203-227,et F. Trudu, « La consignatio compiuta dai presbiteri al tempo di Gregorio Magno.A proposito di tradizione liturgiche orientali in Sardegna », dans Orientis radiatafulgore, 389-413. Martin, « L’Occident chrétien », 636-637, pense que les traditionsbyzantines ont pu être réactivées au Xe siècle.
298 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page298
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 299
11. Voir les travaux de R. Coroneo, cités ci-dessus, note 8. Les pièces sculptées, dontles motifs et la facture sont similaires à ceux des sculptures produites à la même époqueen Campanie, pourraient en provenir ou avoir été réalisées par des artisans originairesde cette région d’Italie méridionale (des contacts entre la Sardaigne et les duchésd’Amalfi et de Naples, par exemple, sont attestés au milieu du Xe siècle). Sur leschapelles articulées à un palais ou château, documentées toutefois plus tardivement,cf. en particulier N. Usai, Signori e chiese. Potere civile e architettura religiosa nellaSardegna giudicale (XI-XIV secolo), Cagliari, 2011, 27-40. Le cas d’Ardara, dont lepalais fait actuellement l’objet de fouilles archéologiques, est sans doute le plus clair(voir la mention du « palais royal » d’Ardara dans la charte du XIe siècle citée ci-dessous, note 19 – mais rien n’indique que ce palais serait antérieur). 12. Sur cette charte : Blancard et Wescher, « Charte sarde » ; Blasco Ferrer,Crestomanzia, I, 51-62 ; L. Perria, « La carta sarda di S. Vittore di Marsiglia.Scrittura e tradizione bizantina in Sardegna nell’età giudicale », dans Chiesa,potere politico e culturale in Sardegna dall’età giudicale al Settecento, éd. G. Mele,Oristano, 2005, 361-366 ; O. Schena, « La carta sarda in caratteri greci. Note diplo-matistiche e paleografiche », dans Sardegna e Mediterraneo tra medioevo ed etàmoderna. Studi in onore di Francesco Cesare Casula, éd. M.G. Meloni etO. Schena, Gênes, 2009, 329-343. E. Cau, « Peculiarità » : « Il greco in Sardegna »,pense que la « chancellerie » des juges recourait habituellement au grec, usage déli-béré par les juges d’une pratique culturelle originale et distinctive. Une autrecharte sarde en caractères grecs a été retrouvée récemment dans les archivespisanes : A. Soddu, P. Crasta et G. Strinna, « Un’inedita carta sardo-greca del XIIsecolo nell’Archivio Capitolare di Pisa », Bollettino di studi sardi, 3, 2010, 7-44.13. G. Paulis et G. Lupinu, « Tra Lugodoro e Campidani. I volgari sardi e le espres-sioni della cultura », dans Storia della Sardegna, 1 (Dalle origini al Settecento), dir.M. Brigaglia, A. Mastino, G.G. Ortu, Bari, 2006, 131-139, ici 133-134.14. Sur les sceaux, utilisant dans chaque judicat la même matrice du XIe auXIIIe siècle : F.C. Casula, « Sulle origini delle cancellerie giudicali sarde », dansStudi di paleografia e diplomatica, Padoue, 1974, 82-88 ; Blasco Ferrer,Crestomanzia, I, 66-67 ; Spanu et Zucca, I sigilli, 48-49. Martin, « Les actes »,évoque l’absence d’actes écrits en Sardaigne avant la seconde moitié du XIe siècleet le recours des scribes, à partir de cette époque, à des écritures (grecques oulatines) importées, en même temps qu’à des pratiques locales, concernant notam-ment les clauses comminatoires menaçant de peines spirituelles, peut-être de tradi-tion grecque (A. Feniello et J.-M. Martin, « Clausole di anatema e di maledizionenei documenti (Italia meridionale e Sicilia, Sardegna, X-XII secolo) », MEFRM,123/1, 2011, 105-127, notamment 122-124).15. Les documents antérieurs au XIe siècle ne permettent pas de savoir de manièreassurée si le gouvernement de la Sardaigne était assuré par un seul ou par plusieursjuge(s) ou archonte(s) de Sardaigne. Les historiens sont en désaccord sur ce point.Martin, « L’Occident chrétien », reprenant la position ancienne de l’historien
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page299
A. Solmi (suivi par Spanu et Zucca, I sigilli, 34-36, mais nuancé par P.G. Spanu,« Dalla Sardegna bizantina alla Sardegna giudicale », dans Orientis radiata fulgore,353-387) pense à un partage en plusieurs judicats dès le IXe ou le Xe siècle, tandisque d’autres chercheurs, comme R. Turtas et C. Zedda et R. Pinna, reprenant la posi-tion de E. Besta, envisagent plutôt l’existence d’un seul iudex Sardinae siégeant àCagliari. On pourrait aussi envisager une situation où le gouvernement, ancré àCagliari, serait partagé entre plusieurs membres du même groupe de parenté (commec’est, par exemple, le cas, entre Xe et XIe siècle pour la famille vicomtale deMarseille), sans qu’il eût partition de l’île. L’inscription de la fig. 2 renverrait à untel cas de figure. Quoi qu’il en soit, il faut considérer que la stabilisation d’une divi-sion de l’île en quatre circonscriptions n’est pas antérieure au XIe siècle. 16. Chronica Monasterii Casinensis, MGH SS, 34, 387.17. R. Martorelli, « Culti e riti a Cagliari in età bizantina », dans Orientis radiatafulgore, 211-245.18. Voir à ce propos Ronzani, Chiesa, 126-132.19. Blasco Ferrer, Crestomanzia, I, 27-28 (édition) et 28-32 (commentaire) ;CDS XI, n° 6, 153. Dans les dernières lignes de cette charte, rédigée au « palaisroyal » d’Ardara, le scribe évoque, dans un langage qui tient tout à la fois du latinet du sarde, la difficulté à tenir la plume, à une heure tardive, alors que le soleilse couche.20. Zedda et Pinna, « La nascita dei giudicati », 90-91.21. Une lettre adressée en 1118 par l’archevêque de Cagliari au pape Gélase II etrapportant des faits survenus antérieurement évoque la tenue d’un concile, en 1066,destiné à l’établissement des diocèses suffragants de Cagliari : eiusdem temporeiudicis (Orzocco Torchitorius) qui per XVcim annos et plus postea vixit, Romaneecclesie legatus causa Christiani sini Sardiniam adiit cumque ibi ex more conci-lium celebraret, Caralitanus archiepiscopus cum prefato iudice et maioribus deterra suppliciter ab eo postulauit ut iuxta morem ecclesiasticum episcopos suffra-ganeos in archiepiscopatu constitueret et ordinaret. Eo itaque tempore factum est(Volpini, « Documenti », 263). Cf. Turtas, « La cura animarum », 365. Concernantl’organisation antique : P. Pergola et al., « Le sedi episcopali della Sardegnapaleocristiana. Riflessioni topografiche », Rivista di Archeologia Cristiana, 86,2010, 353-410. 22. Le Liber Pontificalis, éd. L. Duchesne, Paris, 1955-1957, II, 162, trad. (ici légè-rement modifiée) de M. Aubrun, Le Livre des papes. Liber pontificalis (492-891),Turnhout, 2007, 257. La même notice consacrée au pape Nicolas Ier évoque, un peuplus haut, l’affaire du renvoi de la reine Theutberge par Lothaire et le concubinagede ce dernier avec Waldrade, ainsi que l’excommunication et l’anathème lancéscontre Ingiltrude, l’épouse de Boson qu’elle avait quitté pendant sept années.Cf. F. Bougard, « En marge du divorce de Lothaire II : Boson de Vienne, le cocuqui fut fait roi ? », Francia, 27, 2000, 33-51.
300 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page300
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 301
23. Torcatorio iudici. Crimen istud, quod consanguineae tuae in tertio graduconiunctus es, quam sit divinis et humanis legibus detestabile, te ipsum oportetconsiderare, cum soboles ex tali coniugio non potest subcrescere et, si filius indefuerit, nec erede legitimum recipi, nec in episcopalem cathedram uel iudicis digni-tatem debeat omnino promoveri (S. Loewenfeld, Epistolae pontificum romanorumineditae, Leipzig, 1885, ep. 106, 52-53, cité par Zedda et Pinna, La carta delgiudice, 25).24. Mazel, La noblesse et l’Église, 71-76.25. Selon la lettre adressée en 1118 par l’archevêque de Cagliari à Gélase II : Nostriavus iudicis propter multa que fecerat homicidia in penitentiam accepit ut pro suispeccatis monasterium Deo edificaret et fratres, qui Deo servirent honeste, ibi collo-caret. Concernant la promesse de donner plusieurs églises aux moines du Mont-Cassin : Non multo post monachi de Monte Cassino, sui causa cenobii Sardiniamingressi, ad prefatum accessere iudicem. Quibus visis iudex gravisus (sic) multaseis ecclesias promisit, sed non tradidit, tali tamen conditione ut monachi, ad suaremeantes, abbati nuntiarent quatinus personas idoneas cum libris ceterisqueecclesie ornamentis in Sardiniam propere remandaret. Quo non facto… (Volpini,« Documenti », 263). 26. Don de six églises au Mont-Cassin en 1066, consigné, dans la première moitiédu XIIe siècle, dans le Registrum du moine du Mont-Cassin Pierre Diacre : éd.A. Saba, Montecassino e la Sardegna. Note storiche e codice diplomatico sardo-cassinese, Mont-Cassin, 1927, 135-138 ; CDS XI, n° 7, 153-154. Zedda et Pinna,« La nascita dei giudicati », 91, avancent que le recours aux moines du Mont-Cassinet la cession de six églises (et non de deux, comme l’avait fait Barison) seraient unefaçon de concurrencer le juge de Torres, voire de mettre en cause la reconnaissancede son judicat qui signifiait l’éclatement de l’île au détriment des juges de Cagliari.27. Gregorius episcopus servus servorum Dei Mariano Turrensi, OrzoccoArborensi, item Orzocco Caralitano, Constantino Callurensi, iudicibus Sardinie[…] : Reg. Grégoire VII, I, n° 29, 46-47 ; CDS XI, n° 10, 156.28. Verum quia neglegentia antecessorum nostrorum caritas illa friguit, que anti-quis temporibus inter romanam Ecclesiam et gentem vestram fuit, in tantum a nobisplus quam gentes, que sunt in fine mundi, vos extraneos fecistis, ut christiana religiointer vos ad maximum detrimentum devenit […] (Reg. Grégoire VII, I, n° 29, 46-47). La négligence des prédécesseurs de Grégoire VII, cause du refroidissement dela caritas, est évoquée dans d’autres lettres du pape, en particulier au duc deBohême (I, n° 17), aux roi, comtes et autres princes d’Espagne (IV, n° 28), ainsique le relève R. Turtas, « Gregorio VII e la Sardegna », Rivista di Storia dellaChiesa in Italia, 46/2, 1992, 376.29. […] Unde multum vobis necessarium est, ut de salute animarum vestrarumstudiosius admodum cogitetis et matrem vestram romanam Ecclesiam sicut legi-timi filii recognoscatis et eam devotionem, quam antiqui parentes vestri sibiimpenderunt, vos quoque impendatis (Reg. Grégoire VII, I, n° 29, 47).
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page301
30. Reg. Grégoire VII, I, n° 41, 63-64 ; CDS XI, n° 11, 157.31. Blasco Ferrer, Crestomanzia, I, 43-50, éd. 43-44 ; CDS XI, n° 8, 154-155.Voir à ce propos Zedda et Pinna, La carta del giudice, 24, selon lesquels le docu-ment, écrit en langue vernaculaire, doit être daté entre janvier et juin 1074. Cesdeux auteurs proposent une critique rigoureuse du document, dont ils relèvent desinterpolations faites en 1327 et proposent une nouvelle éd., 53-58. Les biensdonnés constituaient sans doute la dotation de l’archevêché, alors qu’un nouvelarchevêque venait d’être mis en place.32. Reg. Grégoire VII, VIII, n° 10, 528-530 ; CDS XI, n° 12, 157-158.33. Nolumus autem prudentiam tuam moleste accipere, quod archiepiscopumvestrum Iacobum consuetudini sancte R. ecclesie, matris omnium ecclesiarumvestreque specialiter, obedire coegimus, scilicet ut, quemadmodum totius occi-dentalis ecclesie clerus ab ipsis fidei christiane primordiis barbam radendi moremtenuit, ita et ipse frater noster, vester archiepiscopus, raderet. Le pape demandedonc l’aide du juge pour imposer cette nouvelle obligation : Unde eminentiequoque tue precipimus, ut ipsum ceu pastorem et spiritualem patrem suscipiens etauscultans cum consilio eius omnem tue potestatis clerum barbas radere faciasatque compellas […]. Il précise ensuite que les contrevenants se verraient confis-quer leurs biens (Reg. Grégoire VII, VIII, n° 10, 529).34. De coma capitis et barba. Gregorius. Si quis ex clericis, si tamen romani,comam capitis laxauerit suam aut barbam tondere neglexerit, anathema sit(Collectio canonum in V libris, lib. 3, cap. 206, éd. M. Fornasari, dansCC Cont.Med., 6, 411 ; cf. aussi lib. 3, cap. 207).35. Sur ces questions, voir l’introduction de G. Constable (47-130), dans Apologiaeduae (Gozechini Epistola ad Walcherum ; Burchardi, ut videtur, abbatis BellevallisApologia de barbis), éd. R.B.C. Huygens, dans CC Cont.Med., 62, Turnhout,1985, qui cite notamment, outre le cardinal Humbert en 1054 et la lettre deGrégoire VII, une lettre antérieure de Nicolas Ier aux évêques francs, dans laquellele pape dénonce les Grecs qui ne se rasent pas la barbe (110-111). La romanisa-tion visible du clergé semble bien être ici l’objectif poursuivi par Grégoire VII, plusqu’une volonté d’imposer une séparation entre les clercs (imberbes) et les laïcs(barbus), comme le suggère, de manière générale, G. Fornasari, « Iuxta patrumdecreta et auctoritatem canonum. Alla ricerca delle fonti della dottrina teologicae canonistica di Gregorio VII », dans Id., Medioevo riformato del secolo XI. PierDamiani e Gregorio VII, Naples, 1996, 353-410, ici 391-393.36.Sur le projet d’« invasion » de la Sardaigne : Ronzani, Chiesa, 136-150.37.[…] insulam […] nulli mortalium nullique potestati nisi sancte Romane ecclesieex debito vel iuris proprietate pertinere (Reg. Grégoire VII, V, n° 4, 351-352).Jamais Grégoire VII et ses successeurs immédiats (forts du compromis conclu avecles juges) n’ont affirmé un tel dominium de la papauté sur la Sardaigne (Turtas, Storia,197-198). Ce n’est qu’avec Alexandre III (à partir de 1166-1167), puis surtoutInnocent III, alors que l’Empire tentait d’imposer sa souveraineté sur l’île, que fut
302 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page302
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 303
invoqué le dominium eminens du pape sur la Sardaigne (M.G. Sanna, « Il “dominiumeminens” della Santa Sede sulla Sardegna nella teoria et nella prassi politica diInnocenzo III », dans Innocenzo III. Urbs et orbis, éd. A. Sommerlechner, 2, Rome,2003, 954-970). Cette absence d’affirmation du dominium des papes sur la Sardaigneà l’époque grégorienne n’équivaut toutefois aucunement à une absence de contrôleou de volonté de contrôle de l’île.38.Ronzani, Chiesa, 184-189, suggère que cette aspiration pisane, qui concernaitsurtout la Sardaigne, a été habilement détournée – par le pape – vers la Corse. Voiraussi C. Violante, « Le concessioni pontificie alla Chiesa di Pisa riguardanti laCorsica alla fine del secolo XI », Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il MedioEvo e Archivio Muratoriano, 75, 1963, 43-56.39.Charte du 30 juin 1089 : ABdR, 1 H 61, n° 291 ; CDS XI, n° 16, 160-161. Lejuge Constantin, avec sa mère (cum matre mea domina Vera) et l’accord de sonépouse (laudante uxore mea) et celui de l’archevêque de Cagliari, confirme à l’abbéRichard de Saint-Victor la donationem patris mei et matris meae et meam, soit lesdeux églises de s. Georgii de Decimo et de s. Genesii (San Giorgio de Decimo etSan Genesio de Uta). La lettre déjà mentionnée de 1118 évoque l’arrivée des« moines de Marseille » (à la place de ceux du Mon-Cassin) dans les terres du jugede Cagliari : Postea vero monachi de Massilia terram supra nominatam adeuntesse iudici eidem presentarunt, quibus iudex, suam volens complere penitentiam,quasdam ecclesias tribuit et tradidit (Volpini, « Documenti », 263).40. Charte de 1089 : ABdR, 1 H 88, n° 427 ; Blasco Ferrer, Crestomanzia, I, 51-62. 41.Charte de 1089 : ABdR, 1 H 61, n° 292 ; CDS XI, n° 17, 161-162 ; CSVn° 1006, 464-465. Liste des églises cédées à Saint-Victor en même temps que SanSaturno (selon CDS XI, n° 17) : Sant’Antioco sur l’île ; Santa Maria a Palma ouPalmas dans le Sulcitano ; San Vincenzo di Sigerro ; Sant’Ambrogio à Uta (maisSanta Maria di Sepollu, selon CSV n° 1006) ; Sant’Efisio a Nora ; Sant’Elia deMonte, près de Cagliari ; Santa Maria a Gippi ; Santa Maria ad Arco.42. La seconde hypothèse, minoritaire, est notamment soutenue par E. BlascoFerrer, « La carta sarda in caratteri greci del sec. XI. Revisione testuale e storico-linguistica », Revue de linguistique romane, 66, 2002, 321-365, ici 356.43. Les nouvelles églises données par le juge Constantin à l’abbé Richard deSaint-Victor (selon CSV n°1010) sont les suivantes : Santa Maria di Vineis, prèsde Pirri ; San Lucifero di Pau, dans la circonscription de Gippi ; San PietroPescatore, près des étangs de Cagliari ; Santa Barbara di Acquafredda, dans lacirconscription de Sigerro ; Santa Maria di Sepollu ou di Sebolla, près de Cagliari ;San Pietro di Serra ou di Serris, près de Cagliari ; une donnicalia dans le territoirede Pau avec l’église Santa Maria del Paradiso ; Santa Maria de Portu Salis, pas loindu port de Cagliari, près des salines ; nouvelle confirmation des églises de SanGiorgio et San Genesio.44. Voir la confirmation de l’archevêque de Cagliari en 1141 (ABdR, 1 H 83,n°405 ; CSV, n°1008, 467). Selon une confirmation du pape Honorius III en
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page303
1218, les moines de San Saturno possédaient vingt-cinq églises (cf. Spanu,« I possedimenti » (b), 254).45. E. Martène et U. Durand, Veterum scriptorum et monumentorum, histori-corum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio, vol. 1, Paris, 1724, col. 526 ;CDS XI, n°20, 164. La charte originale n’est plus conservée. Voir l’annexe 2 à laprésente étude.46. Voir Magnani, « Saint-Victor », 338-339.47. Les trois églises dépendant de Santo Stefano de Posada sont Santa Maria diLarathon, Santa Maria di Surrache, Sant’Andrea di Corte.48. AdBdR, 1 H 76, n° 370 ; éd. E. Martène et U. Durand, Veterum scriptorum etmonumentorum, historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio,vol. 1, Paris, 1724, col. 522-523 ; CDS XI n° 18, 162-163, ainsi que l’annexe 1 àla présente étude.49. Voir l’édition dans l’annexe 1. 50. Turtas, « La cura animarum », 362.51. Zedda et Pinna, « La nascita dei giudicati », 94. Sur le concile et le légat dupape, cf. R. Turtas, « L’arcivescovo di Pisa lagato pontificio e primate in Sardegnanei secoli XI-XIII », dans Nel IX centenario della metropoli ecclesiastica pisana,éd. M.L. Ceccarelli Lemut, S. Sodi, Pise, 1995, 190-194 ; Turtas, Storia, 214-216 ;Turtas, « La cura animarum », 361.52. La bulle de confirmation du pape Innocent II en 1135 est la première attesta-tion de cette organisation des possessions sardes en trois églises principales ouprieurés : Caralis Sardinie, monasterium sancti Saturni cum aliis sibi subditis eccle-siis ; in judicatu Turrensi, ecclesiam sancti Nicholay de Guzuli, cum aliis sibisubditis ; in Gallurensi judicatu, ecclesiam sancti Stephani de Posada, et sancteMarie de la Rasana, sancti Andree de Lata, et sancte Marie de Surrachi (ABdR,1 H 82, n° 398 ; éd. CSV n° 844).53. Dans le judicat de Cagliari, cette domination des victorins n’est ébranlée qu’àpartir du XIIe siècle, par les Pisans et par les Génois.54. Pise, Archivio di Stato, Diplomatico Coletti, 18 mars 1082, éd. E. Besta, Il« Liber Iudicum Turritanorum » con altri documenti logudoresi, Palerme, 1906,14-15, cité notamment par Ronzani, Chiesa, 190-199. Colombini, Dai Cassinesiai Cistercensi, 67-68, relève les analogies entre la lettre de 1082 et celle du papeGrégoire VII en 1073, comme si cette lettre du juge Marianus était une réponse auxinjonctions grégoriennes.55. Sur tout ceci, cf. Magnani, Monastères, et Lauwers, « Cassien ».56. […] monachos grechos, quos in eadem aecclesia ponunt episcopus Pontius etIsarnus abbas (CSV n°61). Cf. Magnani, Monastères, 243-244.57. Vie d’Isarn, 78 et suiv. (texte hagiographique), 144-152 (commentaire). On serappelle que c’est de Denia qu’était parti Mudjahid, quelques décennies plus tôt,pour conquérir la Sardaigne.
304 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page304
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 305
58. Magnani, « Saint-Victor », et Lauwers, « Cassien » (avec renvoi aux documentset à la bibliographie).59. Sur l’abbé (et cardinal) Richard de Saint-Victor : R. Hüls, Kardinäle, Klerusund Kirchen Roms, 1049-1130, Tübingen, 1977, 217-218.60. Sur la légation de Richard en Espagne : Deswarte, Une Chrétienté romaine,passim.61. Notons que la lettre de 1087 par laquelle le pape Victor III exhorte l’évêque deCagliari ainsi que d’autres évêques à restaurer les églises tombant en ruines est unfaux du XVIIe siècle : A. Carboni, Epistola di Vittore III ai vescovi di Sardegna.Prova e storia di un falso, Rome, 1960.62. Cf. D. De Rosa, Il pontificato di Vittore III. Un riesame critico, Rome, 2008,passim.63. G. Ammannati, « Saint-Victor di Marsiglia e la sua espansione nell’area pire-naica. Tre lettere della seconda metà del sec. XI », Studi Medievali, 3a ser., 48, 2007,41-64. Présentation et traduction d’une de ces lettres par Mazel et Lauwers,« L’abbaye Saint-Victor », p. 137-141.64. Magnani, Monastères, 276-283 ; Vie d’Isarn, 116-125 (note sur la mobilitédes moines).65. Charte du 30 juin 1089 : ABdR, 1 H 61, n° 291 ; CDS XI, n° 16, 160.66. Charte de 1089 : ABdR, 1 H 61, n° 292 ; CDS XI, n° 17, 162 : Bernardus etUgo monachi Massilienses domino abbate Richardo, vice sua, huiusmodi dona-tionis cartam a superiori rege receperunt, et fideliter interfuerunt. 67. Cau, « Peculiarità » : « Le carte sarde ».68. CDS XI, n° 19, 164.69. Boscolo, L’Abbazia di San Vittore, 40. 70. AdBdR, 1 H 76, n° 370 ; éd. E. Martène et U. Durand, Veterum scriptorum etmonumentorum, historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio,vol. 1, Paris, 1724, col. 522-523 ; CDS XI n° 18, 162-163.71. Cette lettre, recopiée dans les papiers de l’érudit marseillais J.A.B. Mortreuil,Paris, BnF, nouv. acq. lat., n° 1304, fol. 253-254, a été étudiée et éditée par Sorgia,« Un documento », 88 (= Sorgia, « Une lettre », 393).72. Ce rôle est attesté à partir du XIIe siècle pour d’autres monastères de l’île :Turtas, « La cura animarum », 366-372.73. Voir l’annexe 1.74. ABdR, 1 H 60, n°288 et 289. Sur ces deux versions, cf. Cau, « Peculiarità » :« Le carte sarde ».75. D. Scano, Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna,I, Cagliari, 1941, n° 65, 43-45.76. Blasco Ferrer, Crestomanzia, I, 72-76 (72 pour l’éd.).77. Boscolo, L’abbazia di San Vittore, 41-44.78. Celui-ci est évêque en 1112. Cf. CDS XII, n°8, 183.
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page305
79. Quantam ruinam quantasque tribulationes et inopias Caralitana quondampotens et honorata ecclesia et passa sit et nunc maxime patiatur, verbis enarrarevel litteris denotare verecundamur et erubescimus […]. Audistis, catholice paterecclesie, et, ut credimus, bene scitis quoniam Sancti Saturnini monachi prefate bonaecclesie fere omnia importune et contra patrum decreta per manum laicam habentet possident et, quod intolerabilius est, nullam super his male possessis reveren-tiam, nullam nobis exhibent obedientiam (Volpini, « Documenti », 262).80. Cf. Lauwers, « Cassien », 227-228.81. Volpini, « Documenti », 262-263. Outre les récriminations de l’archevêque, lesreligieux de Marseille se voyaient alors opposer les revendications des moines duMont-Cassin à propos des églises qui leur avaient été promises par OrzoccoTorchitorius cinquante-deux ans plus tôt (ces églises avaient été finalement donnéesen dotation au diocèse de Sulcis).82. CSV, n° 784, 132-134 ; CDS XII, n° 24, 196-197. En réalité, le conflit avecl’archevêque se raviva en 1120, après la mort du prieur Bérenger, car les« Marseillais », sous le priorat d’un Philippe, s’étaient approprié l’église SantaMaria de Leni : Boscolo, L’abbazia di San Vittore, p. 54 et suiv. ; Colombini, DaiCassinesi ai cisterciensi, 74-75.83. Voir ci-dessus, note 30. Ce texte est le plus ancien document évoquant des« métiers » de la construction dans la Sardaigne médiévale : cf. A. Pistuddi,Architetti e muratori nell’età giudicale in Sardegna. Fonti d’archivio ed evidenzemonumentali fra l’XI et il XIV secolo, tesi di dottorato, Università degli Studi diCagliari, 2008, 69 (qui évoque un autre document du XIe siècle, toutefois suspect,mentionnant l’appel du juge de Torres à un groupe de mastros de pedra pour leréaménagement de l’église San Gavino de Torres).84. Sur les édifices cruciformes : M.J. Johnson, « The Cruciform Churches ofSardegna and the Transmission of Architectural Form », dans Acts 18thInternational Byzantine Congress. Selected Papers Moscow, 1991, III. Art History,Architecture, Music, éd. I. Sevcenko et al., Shepherdstown, 1996, 401-422, ainsique les derniers travaux de R. Coroneo : « La chiesa altomedievale di Santa MariaIscalas di Cossoine », dans Orientis radiata fulgore, 115-131, et La chiesa alto-medievale, 65-98, qui distingue plusieurs types d’églises cruciformes, certaines desVIe et VIIe siècles, d’autres plus tardives (jusqu’au XIe siècle). 85. Je reprends dans les lignes qui suivent la typologie proposée par Spanu,« I possedimenti » (b).86. Spanu, « I possedimenti » (b), p. 265-271.87. Confirmation par le juge Constantin en 1089 de la cession faite à Saint-Victorpar son père, Orzocco Torchitorius. Sur ce site et sa cuve baptismale : D. Mureddu,« S. Giorgio di Decimoputzu : una ecclesia rurale altomedievale », dans InsulaeChristi, 453-464.88. Cession à Saint-Victor par le juge Constantin entre 1090-1094. Sur l’église etla cuve baptismale, installée sur des thermes romains mais sans doute plus en usage
306 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page306
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 307
au moment de la cession à Saint-Victor : D. Salvi, « Le terme romane e la chiesaaltomedievale di Santa Maria di Paradiso a Vallermosa (Cagliari) », dans InsulaeChristi, 467-470.89. Il en est ainsi à Saint-Maximin (Var), prieuré majeur de Saint-Victor, mais onpeut évoquer d’autres prieurés, dépendant de Lérins (Le Brusc, Baudinard) ou deSaint-Pons (Saint-Hermentaire).90. Sur l’exploitation des salines par les moines de Saint-Victor (qui avaient égale-ment reçu, précédemment, des droits sur les salines de la région de Marseille),cf. C. Manca, « Aspetti dell’economia monastica vittorina in Sardegna nel MedioEvo », dans Studi sui Vittorini, 55-79.91. Spanu, « I possedimenti » (b), 274. Toutes ces églises ont été cédées auxvictorins par le juge Constantin en 1089 ou entre 1090-1094.92. R. Coroneo, « Segni e oggetti del pellegrinaggio medioevale in Sardegna : l’etàgiudicale », dans Gli Anni Santi nella Storia, éd. L. D’Arienzo, Cagliari, 2000, 465-496.93. Spanu, « I possedimenti » (b), 275-279.94. Sans mentionner ici une bibliographie fleuve, d’ailleurs davantage consacréeaux images qu’aux monuments, on évoquera les travaux d’H. Toubert, Un artdirigé. Réforme grégorienne et iconographie, Paris, 1990, et, plus récemment,Roma e la riforma gregoriana : tradizioni e innovazioni artistiche, XI-XII secolo,éd. S. Romano et J. Enckell Julliard, Rome, 2007, ainsi que la mise au point d’A.Trivellone, « L’arte e la Riforma ecclesiastica tra XI e XII secolo », dans IlMedioevo, VI (Medioevo centrale : Arti visive, Musica), dir. U. Eco, Milan, 2009,493-516.95. Sur Saturno de Cagliari : Coroneo, Archittetura, 27-34 ; Coroneo et Serra,Sardegna, 35-44 ; Coroneo, Arte, 168-174, avec renvoi à la bibliographie antérieure.Concernant le premier établissement chrétien : L. Pani Ermini, « Ricerche nelcomplesso di S. Saturno a Cagliari », Rendiconti della Pontificia AccademiaRomana di Archeologia, 55-56, 1982-1984, 111-128 ; Ead., « Il complesso marti-riale di San Saturno », dans La « civitas christiana ». Urbanistica delle cittàitaliane fra tarda antichità e altomedioevo. Aspetti di archeologia urbana, éd. P.Demeglio et C. Lambert, Turin, 1992, 55-81.96. Sur la genèse du monachisme en Sardaigne, voir la synthèse récente de Ph.Pergola, « Christianisation, monastères et territoire en Sardaigne et en Corse »,Rivista di Archeologia Cristiana, 84, 2008, 365-376, ainsi que Lingua et ingenium.Studi su Fulgenzio di Ruspe e il suo contesto, éd. A. Piras, Ortacesus, 2010.97. Lauwers, « Cassien ».98. Lauwers, « Consécration d’églises ».99. R. Coroneo, « Marmi romani e decorazioni romaniche nella chiesa vittorina diS. Platano a Villaspeciosa », Studi sardi, 29, 1990-1991, 387-403.100. Sur Sant’Antioco : Coroneo, Archittetura, 34-38 ; Coroneo et Serra, Sardegna,53-59 ; Coroneo, Arte, 183-190 ; R. Martorelli, « Le catacombe di Sant’Antioco »,
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page307
dans S. Antioco, 59-78 ; R. Coroneo, « La basilica di Sant’Antioco », dansS. Antioco, 87-97.101. Alors que les premiers travaux de Coroneo (Archittetura, 34, par exemple)avaient relevé la restructuration « in senso latino » opérée à Sant’Antioco par les« Marseillais », ses dernières études évoquent la possibilité d’une substitution duplan longitudinal au plan centré antérieure à l’arrivée des moines de Marseille, quine seraient alors intervenus que dans une dernière phase des transformations(R. Coroneo, « La basilica di Sant’Antioco », dans S. Antioco, 91). 102. Après les synthèses pionnières de Coroneo (« Frammenti » et Scultura medio-bizantina), de nouvelles recherches ont été entreprises : M.C. Cannas, « Le lastremarmoree di Sant’Antioco con figure umane », dans Ricerche sulla sculturamedievale in Sardegna, II, éd. R. Coroneo, Cagliari, 2009, 79-114 ; A. Ruggieri,« Il ciborio bizantino della basilica di Sant’Antioco », Annali dell’AssociazioneNomentana di storia e archeologia, 2009, 155-160 ; E. Curreli, « Gli arredi litur-gici della basilica di Sant’Antioco », dans S. Antioco, 107-119.103. Voir ainsi les aménagements avec mise en scène de sarcophages, de colonneset de chapiteaux antiques dans les églises, prises en charge par les victorins, deFontaine-de-Vaucluse et de La Gayolle (Var) : Codou, « Une mémoire de pierre »,585-587.104. Sur les remplois à « valeur représentative », les travaux des historiens de l’art(et les colloques) sont actuellement innombrables. Concernant la Provence etSaint-Victor : A. Hartmann-Virnich, « Restauratio formae primitivis ecclesiae. Laconstruction d’une mémoire : l’évocation des premiers temps chrétiens dansl’architecture du premier âge roman. L’exemple de la Provence », dans Histoire -Fiction - Représentation, éd. C. Carozzi et S. Sato, Nagoya, 2007, 15-37 ; Codou,« Une mémoire de pierre ».105. Selon un parchemin retrouvé en 1637 dans une petite boîte d’argent placéesous l’autel : Anno domini MCII ind. II, III id. iul. Gregorius epus. consacravi eccle-siam istam et altare ad honorem Virginis Mariae sanctorumque omnium et sancticorpore eius presente (éd. dans S. Antioco, 141).106. Sur Sant’Efisio de Nora : Coroneo, Archittetura, 39-41 ; Coroneo et Serra,Sardegna, 248-249.107. Lettre de Grégoire VII du 5 octobre 1080, mentionnée ci-dessus note 31.108. Deswarte, Une Chrétienté romaine, passim. Concernant les rares traces dedocuments liturgiques pour la Sardaigne du haut Moyen Âge, cf. les travaux deG. Mele cités ci-dessus, note 10.109. J. Lemarié, Le bréviaire de Ripoll. Paris, B.N. lat. 742. Étude sur sa compo-sition et ses textes inédits, Montserrat, 1965.110. Chronica Monasterii Casinensis, MGH SS, 34, 387.111. Acte de 1066 : CDS XI, n°7, 153-154. Moines, livres et ornamenta sont enoutre mentionnés dans la lettre de 1118 citée ci-dessus, note 25.
308 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page308
RÉFORME, ROMANISATION, COLONISATION ? 309
112. L’inventaire rédigé en 1229 à l’initiative des chanoines de l’église collégialede Santa Maria de Cluso (ou de Clusis), à Cagliari, comporte trois parties, relativesaux biens possédés par l’église cathédrale Santa Gillia (Apud Sanctam Gilliam), parl’église San Pietro Pescatore de Cagliari (Apud Sanctum Petrum), par les chanoinesde Santa Maria de Cluso (Apud nos ; ex-libris à la fin du ms : Iste liber est SancteMarie de Cluso) (éd. A. Capra, « Inventari degli argenti, libri e arredi sacri dellechiese di Santa Gillia, di San Pietro e di Santa Maria di Cluso », Archivio StoricoSardo, 3, 1907-1908, 420-426). Cf. D. Nebbiai-Dalla Guarda, « Saint-Victor deMarseille et l’Italie », 298-300.113. L’inventaire complet des biens de San Saturno est réclamé par l’abbé Gilbertde Cantobre (qui devait, l’année suivante, quitter Saint-Victor pour prendre encharge l’évêché de Rodez), après avoir installé le nouveau prieur : ABdR 1 H 271,n° 1346/1, rouleau de 170 x 150 cm, composé de deux peaux cousues. Le mêmeinventaire signale unum librum officiorum appartenant à l’église Sainte-Luciedépendant de San Saturno. Cf. É. Baratier, « L’inventaire » ; D. Nebbiai-DallaGuarda, « Saint-Victor de Marseille et l’Italie », 295-296.114. Sur la Passio ancienne (BHL 7491), entre VIe et VIIIe siècle, et la Legendasancti Saturni (BHL 7490), fin XIe-début XIIe siècle : Spanu, Martyria, p. 51-60,et Piras, Passio. La Legenda, éditée par Piras, Passio, 101-108 (qui remplaceB.R. Motzo, « San Saturno di Cagliari », Archivio storico sardo, 16, 1926, p. 3-32,éd. 22-27, repris dans Spanu, Martyria, 157-158), est connue par deux copies duXVe siècle, établies lors du rattachement de San Saturno à la mense archiépisco-pale (Nebbiai-Dalla Guarda, « Saint-Victor et l’Italie », 296, Piras, Passio, 6-8).Boscolo, L’abbazia di San Vittore, 113-114, note 3, donne des éléments pour ladatation fin XIe-début XIIe siècle. 115. Piras, Passio, 106.116. Concernant saint Victor, cf. Vita Isarni, XXX-XXXIII.117. Le texte servait en effet aux moines le jour de la fête du saint patron, le23 novembre, et pour l’octave de la fête, selon une notation qui termine la Legendadans l’un des deux manuscrits conservés : Hae lectiones dicebantur ad matutinumin festo sancti Saturni et per octavam ab ecclesia Caralitana et a monachis in eiusbasilica (Spanu, Martyria, 158 ; Nebbiai-Dalla Guarda, « Saint-Victor et l’Italie »,296 ; Piras, Passio, 108, n.13). Le lien entre les transformations ou reconstructionsde San Saturno et la recomposition du texte pour la liturgie est souligné parCoroneo, « Il culto dei martiri », 6-7.118. Officium s. Antiochii, éd. B.R. Motzo, « La Passione di S. Antioco », dans Id.,Studi di storia e filologia, Cagliari, 1927, 103-128, repris par Spanu, Martyria, 177-185. L’auteur connaît la Passion de saint Saturne. Voir Spanu, Martyria, 83-95.119. […] presbyteros monachos colat. […] Obsecro etiam domine Ihesu Christe,ut episcopis, presbiteris, clericis vel monachis, vel laicis qui servituri sunt in locoisto vitam et sanitatem, pacem et letitiam sempiternam conferre digneris. […] Turbamonachorum canat hunc super astra polorum (éd. Spanu, Martyria, 177, 183, 184).
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page309
La mention des moines est un argument pour une datation au début du XIIe siècle(Coroneo, « Il culto dei martiri », 8).120. Pour une comparaison avec des situations voisines dans l’espace et le temps,où ce n’est cependant pas la papauté qui joua un rôle moteur dans la réorganisa-tion : A. Nef, « Géographie religieuse et continuité temporelle dans la Sicilenormande (XIe-XIIe siècle) : le cas des évêchés », dans À la recherche de légitimitéschrétiennes. Représentations de l’espace et du temps dans l’Espagne médiévale,IXe-XIIIe siècle, éd. P. Henriet, Madrid, 2003, 177-194 ; A. Peters-Custot, « Lesremaniements de la carte diocésaine de l’Italie grecque lors de la conquêtenormande : une politique de latinisation forcée de l’espace ? (1059-1130) », dansPouvoir et territoire, éd. P. Rodriguez, Saint-Étienne, 2007, 57-75. De manièregénérale : L’espace du diocèse. Genèse d’un territoire dans l’Occident médiéval(Ve-XIIIe siècle), dir. F. Mazel, Rennes, 2008.121. Voir sur ce point le dossier, relatif au monde hispanique, présenté parP. Henriet dans ce volume.122. Voir en particulier A. Peters-Custot, Les Grecs de l’Italie méridionale post-byzantine (IXe-XIVe siècle). Une acculturation en douceur, Rome, 2009, en parti-culier chap. 6, 233-306, qui rompt avec une historiographie ancienne, encorerécemment illustrée par S. Caruso, « Politica “gregoriana”, latinizzazione della reli-giosità bizantina in Italia meridionale, isole di resistenza greca nel Mezzogiornod’Italia tra XI e XII secolo », dans Cristianità d’Occidente e Cristianità d’Oriente(secoli VI-XI). Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo,51, Spolète, 2004, 463-541, en particulier 529 et suiv. (qui n’évoque pas le cas dela Sardaigne).123.La Chronique du Mont-Cassin (I, 32) évoque la célébration par les moinesd’une missam […] cum cantu promiscuo Greco videlicet atque Latino (MGH SS,34, p. 87). Voir T.F. Kelly, The Beneventan Chant, Cambridge, 1989, 203-218 ;R.E. Reynolds, « The Greek Liturgy of St. John Chrysostom in Beneventan script :an early manuscript fragment », Mediaeval Studies, 50, 1990, 296-302.124. S. Fodale, Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesaApostolica Legazia dei Normanni di Sicilia, Palerme, 1970.125. Un mot illisible.126. Et confirmavit legatus et confirmavit legatus.127. obsecramus obsecramus.
310 CAHIERS DE FANJEAUX 48
02 2° partie 179-444 :- 13/11/13 12:07 Page310