Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
Transcript of Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
© Éditions ESKA, 2013
le développement d’une échelle de mesuredu bien-être au travail répond à une fortedemande sociale : une évaluation précise
du phénomène constitue en effet un préalable audéveloppement de comportements favorables dela part des entreprises (lachmann, & al., 2010 :10). a partir d’une analyse hédonique puis eu-démonique du concept, cet article montre les li-mites des échelles existantes et la nécessité decompléter les travaux précurseurs qui proposentune vision combinée. ces limites tiennent essen-tiellement aux dérives sémantiques, au défautd’enracinement dans les expériences vécues parles acteurs, et à une forte propension à utiliserdes indicateurs de mesure secondaires. en com-binant les visions hédonique et eudémonique,une nouvelle échelle de mesure positive du bien-être au travail est proposée à partir d’une appli-cation du paradigme de churchill (Gilbert, &churchill, 1979) auprès de deux échantillons de313 et 865 salariés en France.
les soubassements théoriques hédonique eteudémonique du concept de bien-être remontentaux philosophes de la Grèce antique (Waterman,1993). de nombreux développements ont depuis
été menés sur ces bases tant en économie, en so-ciologie qu’en psychologie du travail. ils révè-lent des ambitions d’étendues variées englobantdes concepts proches tels que la qualité de vie(bowling, 1991), la satisfaction (Kiziah, 2003),les affects (Watson, & al., 1988), la santé men-tale (massé, & al., 1998) ou bien la santé psy-chologique au travail (achille, 2003). même siune définition consensuelle fait toujours défaut(Kiziah, 2003), la clarification conceptuelle peuà peu imposée par la psychologie positive (ar-gyle, 1987 ; cowen, 1994 ; seligman, & al.,2005) tend à restreindre le domaine de spécifi-cation du construit : de façon très générale, lebien-être est désormais défini comme un étatpsychologique positif (diener, 1994) qui écarteles aspects négatifs de la santé mentale.
l’intérêt des sciences de gestion pour ceconcept est récent. il s’est manifesté au fil de lamise en évidence de ses effets empiriques. enl’état actuel des outils de mesure, des relationssignificatives ont pu être observées sur le planindividuel avec la diminution des problèmes desanté physique, la résilience psychologique(Keyes, 2007), la longévité du salarié, et le ni-
ProPositiond’une échelle
de mesure Positivedu bien-être
au travail (ePbet)Franck BIÉTRY
Université de Caen,NIMEC EA 969
Jordane CREUSIERUniversité de Caen,
NIMEC EA 969
23N° 87 - JANVIER - FÉVRIER - MARS 2013
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page23
24REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
veau de sa rémunération (lyubomirsky, & al.,2005). sur le plan organisationnel, le bien-êtreaurait un effet sur la créativité, la qualité du tra-vail (lyubomirsky, & al. 2005), la performanceindividuelle (Wright, & bonett, 1997), les com-portements prosociaux (lee, & allen, 2002;Podsakoff, & al., 2000; smith, & al., 1983), laproductivité organisationnelle (harter, & al.,2002) et la satisfaction de la clientèle (schnei-der, & al., 2003). Pour toutes ces raisons, laquestion du bien-être est devenue essentiellepour la fonction ressources humaines. l’accrois-sement des connaissances dans le domaine faitdonc écho à un enjeu contemporain.
1. INTÉRÊTS ET LIMITES DES ÉCHELLESDISPONIBLES DE MESUREDU BIEN-ÊTRE
le développement d’une échelle de mesure adhoc répond au souhait d’éviter le recours à des in-dicateurs secondaires du bien-être au travail telsque l’absence de pathologies liées au travail oud’affects négatifs. il s’agit en particulier d’éviterles confusions avec des concepts proches maisdistincts au regard de leur définition. le bien-êtreconstitue un construit à part entière (dagenais-desmarais, & savoie, 2011) qui requiert à ce titreune mesure spécifique. en l’absence d’un teloutil, la littérature a pour l’instant utilisé leséchelles de mesure de la satisfaction, des affectset de la santé psychologique au travail.
nous porterons notre attention sur les limitesdes outils les plus souvent employés dans la re-cherche académique en présentant au préalableleurs fondements théoriques communs. cetteanalyse critique permettra à la fois de montrer lacomplémentarité des approches hédonique et eu-démonique, et la nécessité de développer une vi-sion combinée. cet article propose de combinerces angles de vues à la suite des travaux de da-genais-desmarais & savoie (2011) pour dépasserles mesures partielles et parfois éloignées du bien-être au travail. il propose et teste une nouvelleéchelle correspondant à cette vision enrichie.
1.1. La mesure hédonique du bien-être
dans cette première section, nous identifionsles contenus clés de l’approche hédonique dubien-être dans le but de mettre en lumière les
convergences, les divergences et les limitescommunes des échelles relevant de ce courantde pensée.
1.1.1. Contenus clés des échelles hédoniques
la conception hédonique du bien-être partageavec la santé psychologique une structure bimen-sionnelle. elle comporte à ce titre des aspects po-sitifs, mais aussi négatifs le plus souvent abordésen termes de détresse psychologique (achille,2003; berkman, 1971; Keyes, 2005, 2006;massé, & al., 1998). l’individu se considèreradans un état de bien-être quand les manifestationspositives l’emporteront sur les négatives. cetteapproche hédonique du bien-être présente égale-ment des points communs avec le concept de sa-tisfaction dans la vie (diener 1984) : elle relèvecomme elle d’un processus cognitif – information– et affectif par le biais du jugement porté sur lesévènements de la vie (diener, & al. 2000). lebien-être hédonique est opérationnalisé sousforme d’inventaires d’émotions (berkman, 1971;Warr, 1990) et de conséquences sans qu’une ty-pologie consensuelle se dégage. Quoi qu’il ensoit, il renvoie dans tous les cas à un principe demaximisation du plaisir et d’évitement de la souf-france qu’une simple différence exprime (Kahne-man, & al., 1999). trois dimensions devraient lemesurer selon diener (1994) : la gamme des émo-tions allant du plus négatif au plus positif, leur in-tensité, et leur stabilité dans le temps.
ce socle théorique a donné naissance à dif-férentes échelles de mesure en dépit des diffi-cultés d’opérationnalisation liées à des dérivesconceptuelles, et à son ambition d’exhaustivitéou à sa très forte propension à s’intéresser auxdimensions négatives plutôt que positives.
1.1.2. Analyse critique des ressemblanceset dissemblances des échelles hédoniques
sans prétendre à l’exhaustivité, la premièrepartie du tableau 1 répertorie les caractéristiqueset les limites essentielles des échelles de mesurehédoniques du bien-être les plus utilisées dansla littérature.
les échelles mobilisées pour évaluer le bien-être dans une perspective hédonique révèlentplusieurs points communs. a l’exception notablede massé, & al. (1998), elles présentent toutesla particularité d’avoir été constituées à partir
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page24
aut
eurs
obj
etd
imen
sion
sn
ombr
ed’
item
sr
aiso
nnem
ent
logi
que
alp
ha d
ec
ronb
ach
lim
ites
Part
ie 1
: C
ara
ctér
isti
qu
es e
t li
mit
es e
ssen
tiel
les
des
pri
nci
pale
s éc
hel
les
de
mes
ure
héd
on
iqu
es
min
neso
ta s
atis
fac-
tion
Que
stio
nnai
re(W
eiss
, & a
l., 1
967)
sat
isfa
ctio
n au
trav
ail
3: i
ntri
nsèq
ue, e
xtri
nsèq
ue, G
énér
ale
20h
ypot
héti
co-d
é-du
ctif
.78
(rou
s-se
l, 19
96)
éch
elle
de
sati
sfac
tion
au
trav
ail e
t non
pas
de b
ien-
être
. abs
ence
d’a
naly
seco
nfir
mat
oire
.
Pos
itiv
e an
d n
ega-
tive
aff
ect s
ched
ule
(Wat
son,
et a
l.,19
88)
hum
eur,
émo-
tion
2: a
ffec
t nég
atif
, aff
ect p
osit
if20
: 10
et10
hypo
thét
ico-
dé-
duct
if.8
4 à
.90
selo
n le
spé
riod
es
déf
aut d
’enr
acin
emen
t dan
s le
s ex
pé-
rien
ces
vécu
es ;
écha
ntil
lons
de
tail
les
rédu
ites
et m
ajor
itai
rem
ent c
ompo
sés
d’ét
udia
nts
; non
spé
cifi
quem
ent a
dapt
éau
trav
ail
Psy
chol
ogic
al W
ell-
bei
ng m
anif
esta
tion
sca
le (
mas
sé, e
t al.,
1998
)
san
té m
enta
le10
: d
étre
sse
(4)
: anx
iété
/dép
ress
ion,
irr
itab
i-li
té, a
uto
dépr
écia
tion
, dés
enga
gem
ent s
ocia
l ;b
ien-
être
(6)
: e
stim
e de
soi
, équ
ilib
re, e
ngag
e-m
ent s
ocia
l, s
ocia
bili
té, c
ontr
ôle
de s
oi e
t des
évén
emen
ts, b
onhe
ur
48 :
23 e
t25
indu
ctif
: per
s-pe
ctiv
e ex
pé-
rien
tiel
le ;
puis
vali
dati
on e
mpi
-ri
que
.93
Per
spec
tive
plu
s la
rge
que
le b
ien-
être
et
non
cons
acré
au
dom
aine
spé
cifi
que
dutr
avai
l
Part
ie 2
: C
ara
ctér
isti
qu
es e
t li
mit
es e
ssen
tiel
les
des
éch
elle
s d
e m
esu
re e
ud
émon
iqu
es e
t co
mb
inée
s
sca
les
of P
sych
olog
-ic
al W
ell-
bei
ng(r
yff
& K
eyes
,19
95)
bie
n-êt
reen
gén
éral
6 : a
ccep
tati
on d
e so
i, r
elat
ions
pos
itiv
es, m
aî-
tris
e en
viro
nnem
enta
le, c
rois
sanc
e pe
rson
nell
e,a
uton
omie
, but
dan
s la
vie
18 :
6*3
hypo
thét
ico-
dé-
duct
if.3
3<a
lpha
<.5
6d
éfau
t d’e
nrac
inem
ent d
ans
les
expé
-ri
ence
s vé
cues
; m
esur
e du
bie
n-êt
re e
ngé
néra
l ; a
lpha
très
fai
bles
inde
x of
Psy
chol
ogi-
cal W
ell-
bei
ng a
tW
ork
(dag
enai
s-d
esm
arai
s, &
sav
oie,
201
1)
bie
n-êt
re p
sy-
chol
ogiq
ue a
utr
avai
l
5: c
ongr
uenc
e in
terp
erso
nnel
le a
u tr
avai
l, P
ro-
gres
sion
au
trav
ail,
sen
tim
ent d
e co
mpé
tenc
e,d
ésir
d’e
ngag
emen
t au
trav
ail,
rec
onna
issa
nce
perç
ue a
u tr
avai
l, r
elat
ions
épa
noui
ssan
tes.
25in
duct
if e
t dé-
duct
if.9
6c
ompo
sés
d’it
ems
réfl
ecti
fs ;
esse
ntie
l-le
men
t eud
émon
ique
; éc
hant
illo
n de
jeun
es c
anad
ienn
es d
iplô
mée
s es
sent
iel-
lem
ent
mcG
rego
r et
lit
tle
(199
8)ê
tre
bien
, êtr
eso
i-m
ême
2 : b
onhe
ur, s
ens
65hy
poth
étic
o-dé
-du
ctif
.64<
alp
ha<
.89
Pet
its
écha
ntil
lons
d’é
tudi
ants
; co
mpi
la-
tion
d’é
chel
les
exis
tant
es e
t d’é
tend
ues
diff
éren
tes
bel
iefs
abo
ut w
ell-
bein
g sc
ale
(mcm
a-ha
n, &
est
es, 2
011)
con
cept
ion
dubi
en-ê
tre
en g
é-né
ral,
bien
-êtr
ere
ssen
ti
4: e
xpér
ienc
e du
pla
isir
, evi
tem
ent d
es e
xpé-
rien
ces
néga
tive
s, d
ével
oppe
men
t per
sonn
el,
aid
e à
autr
ui
16in
duct
if e
t dé-
duct
if.7
8<a
lpha
<.9
2é
chan
till
ons
d’ét
udia
nts,
très
maj
orit
ai-
rem
ent f
émin
ins
et d
iplô
més
Tab
leau
1 -
Car
acté
rist
iqu
es e
t lim
ites
ess
enti
elle
s d
es é
chel
les
de
mes
ure
héd
on
iqu
es d
u b
ien
-êtr
e
25N° 87 - JANVIER - FÉVRIER - MARS 2013
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page25
d’une démarche hypothético-déductive quilaisse peu de place aux innovations. la multi di-mensionnalité constitue le second point deconvergence de ces échelles. seules celles de sa-tisfaction générale (diener, & al. 1985) et desanté mentale (becker, 1971) sont structuréesautour d’un unique facteur. les résultats statis-tiques révèlent pour toutes les autres un nombrede dimensions qui va de deux (Warr, 1990; Wat-son, et al., 1988) à dix (massé, & al. 1998). danscet ensemble, le msQ de Weiss, & al. (1967) estle seul à présenter uniquement des items positifs.il s’agit en l’occurrence d’items qui peuvent êtreconsidérés comme des antécédents du bien-être(spector, 1997) : la possibilité de faire deschoses différentes, de bénéficier d’un managercompétent, etc. d’autres semblent au contrairefaiblement corrélés au bien-être au travail : ainsi,les efforts requis pour obtenir une prime peuventsatisfaire un besoin financier et dégrader ce fai-sant le bien-être au travail du fait de la fatigueinduite. toutes les autres échelles opposent uneperspective négative à une positive dans le res-pect du principe théorique hédonique : i.e.« anxiété-confort » (daniels, 2000).
malgré leurs qualités métriques avérées, ceséchelles hédoniques révèlent des limites concep-tuelles et méthodologiques. elles souffrent toutd’abord de dérives sémantiques puisque le bien-être est traduit en satisfaction générale dans lavie ou restreinte au travail, en humeur, en émo-tion, ou bien encore en santé psychologique. cesdérives finissent par faire planer le doute sur lavalidité interne globale du construit. la diffi-culté, non résolue à ce jour, d’établir une listeexhaustive d’émotions (diener, 1994) plaideplutôt pour la conclusion inverse. les limitesconceptuelles tiennent également au périmètrede la situation prise en considération. Gilbert, &al., (2011), hart (1999), mais aussi dagenais-desmarais & savoie (2011), défendent en effetla thèse de la spécificité du bien-être au travailpar rapport au bien-être général et aux autresconcepts auxquels il a été fait référence ci-des-sus. massé et al. (1998) observent à ce sujet quela structure factorielle du bien-être général nepeut pas être retrouvée intégralement dans lecontexte professionnel quand bien même la for-mulation de certains items est adaptée. les com-posantes varieraient selon les sphères sociales(diener, & al., 2003) et inciteraient à adopterune approche spécifique pour chaque domainede la vie. a ce titre, le bien-être au travail se dif-férencie de la qualité de vie puisqu’il ne peut pas
se mesurer par des indicateurs économiques ex-térieurs à la personne (Parmentier, 1994 ; voyer,& boyer, 2001). l’unique échelle de mesure hé-donique du bien-être restreint au travail est, ànotre connaissance, celle de utriainen, & al.(2011). elle présente toutefois l’inconvénientd’être destinée au cas très particulier des infir-mières puisque ses trois dimensions sont cellesde l’interaction entre les infirmières, l’interac-tion avec les patients, et la centration sur la santédes malades.
la seconde limite des échelles hédoniquesest méthodologique. elle tient à la prise encompte des aspects négatifs des situations. l’at-tention des chercheurs s’est traditionnellementdavantage portée sur eux que sur leurs pendantspositifs (seligman, & al. 2005). dans cette lo-gique, la détresse psychologique a fait l’objetd’un questionnement soutenu (diener, 1984;Keyes, 2007). il est pourtant difficile d’accepterune mesure du bien-être simplement par l’ab-sence de symptômes du mal-être. la thèse del’indépendance des deux affects semble plusplausible (veit, & Ware, 1983). a ce titre, la pro-pension de certains auteurs a proposé des itemsbipolarisés – du plus négatif au plus positif surune même graduation – soulève des interroga-tions : elle présuppose en effet une incompatibi-lité entre les deux ce qui ne semble pas toujoursle cas. ainsi, une situation stressante peut parexemple être recherchée par certains salariés pargoût du défi et générer ce faisant du bien-être autravail. Fort de ces constats, la psychologie po-sitive (argyle, 1987 ; cowen, 1994 ; seligman,& al., 2005) rejette les indicateurs négatifs pour-tant couramment assimilés à un déclin du bien-être au travail dans la littérature académique(meyer, & maltin, 2010). elle préconise de neconsidérer que les affects positifs pour mieux as-surer l’assise théorique du concept et en faire unconstruit à part entière. cette vision du bien-êtreconduit à envisager de nouvelles dimensions quireposent cette fois sur une conception eudémo-nique.
1.2. Les mesures eudémoniqueset combinées du bien-être
1.2.1. Contenus clés des échelleseudémoniques
la vision eudémonique privilégie la réalisa-tion personnelle, l’accomplissement, plutôt que
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES26
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page26
la maximisation du plaisir. le bien-être estconditionné à l’utilisation pleine de son potentieldans cette seconde perspective (deci, & ryan,2008; ryff, & Keyes, 1995; Waterman, 1993).il suppose de relever des défis essentiels, d’avoirle sentiment de vivre pleinement, d’être soi-même, de faire corps avec son activité (Water-man, 1993). la congruence avec soi-mêmeconstitue une condition irréductible (Waterman,1993). cette vision eudémonique passe égale-ment par l’harmonie des relations avec autruique le concept de bien-être social résume(Keyes, 1998). elle repose enfin sur l’autodéter-mination (ryff, & singer, 1998), sur l’effort etla mise en œuvre de compétences contrairementau plaisir hédonique qui peut être ressenti lorsde l’obtention passive d’une récompense collec-tive par exemple.
les travaux récents sur le sujet appréhendentl’hédonisme et l’eudémonisme en termes decomplémentarité plutôt que de concurrence(Keyes, & lopez, 2002; ryan, & deci, 2001).des compensations entre les deux dimensionsseraient possibles (Keyes, & al., 2002). Plu-sieurs données empiriques soutiennent cettethèse de l’indépendance (dagenais-desmarais,& savoie, 2011 ; linley, & al., 2009; mcGregor& little, 1998) même si des corrélations sontparfois rapportées entre certaines dimensions(Kiziah, 2003; ryff, & Keyes, 1995 ; Waterman,1993). dans le cadre du travail, une augmenta-tion de salaire ou un emploi stable peuvent parexemple générer un plaisir hédonique sans pourautant être synonyme d’accomplissement per-sonnel. la littérature pour l’instant « grise » dessciences de gestion (robert, 2007) reprendquant à elle la distinction entre les facteurs d’hy-giène, à l’image de l’environnement matériel detravail, et les dimensions intrinsèques telles queles émotions nées des conditions de réalisationde la tâche (herzberg, & al., 1959), pour suggé-rer l’existence d’effets contrastés : les premiersinduiraient un état de bien-être du « travailleurau travail » tandis que les seconds influenceraitle bien-être de la « personne au travail ».
ces débats ont conduit à la production denouvelles échelles de mesure.
1.2.2. Analyse critique des échelleseudémoniques et combinées
les caractéristiques et les limites essentiellesdes échelles de mesure du bien-être les plus uti-
lisées dans la littérature sont regroupées dans laseconde partie du tableau 1. deux d’entre-elles(ryff, & Keyes, 1995 ; dagenais-desmarais, &savoie, 2011) adoptent une approche purementeudémonique. la première est générale, c’est-à-dire indépendante d’une sphère sociale spéci-fique. la seconde présente au contraire laparticularité d’être consacrée au travail etd’avoir été conçue à partir d’une approche enra-cinée dans les expériences des acteurs. la va-riété des intitulés des facteurs masque de fortesconvergences : la qualité des relations aux autresest à chaque fois présente ainsi que le contrôlede l’environnement.
ces propositions font figure d’exceptionpuisqu’elles sont les deux seules à s’inscriredans une perspective exclusivement eudémo-nique. elles demeurent toutefois perfectiblespour plusieurs raisons. en plus de qualités mé-triques discutables, celle de ryff, & Keyes(1995) mesure tout d’abord un bien-être général.Page, & vella-brodrick (2009) ont pourtantmontré que les personnes donnent une réponserapide à partir de raccourcis de pensée appelésheuristiques quand la question introductive neprécise pas la sphère de référence. l’échelle dedagenais-desmarais, & savoie (2011) est assu-rément plus convaincante. inférée à partir de dis-cours d’acteurs, elle évite les digressions enrestant centrée sur les expériences de travail.malheureusement, elle souffre d’un fort biaisd’échantillonnage puisqu’elle s’appuie majori-tairement sur le questionnement de jeunesfemmes (75%) fonctionnaires (50%) et diplô-mées de l’université (96,5%). cette caractéris-tique est pénalisante puisque Keyes, & al.(2002) ont montré la corrélation du bien-être auxvariables sociodémographiques.
toutes les autres échelles recensées combi-nent les approches hédonique et eudémonique.Keyes, shmotkin, & ryff (2002), commemcGregor, & little (1998), compilent dans cebut des outils de mesure préexistants. leur inté-rêt essentiel est de montrer que les indicateursde bien-être hédonique et eudémonique sont dis-tincts. une part de variance commune existetoutefois dans la mesure où trois des six dimen-sions eudémoniques révèlent également des loa-ding élevés sur le facteur hédonique. seuls lesens de la vie, l’autonomie, et la croissance per-sonnelle sont de nature existentielle. ces conclu-sions invitent ensemble à concevoir une échelleparcimonieuse de manière à préserver la distinc-tion entre les deux conceptions théoriques.
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
N° 87 - JANVIER - FÉVRIER - MARS 201327
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page27
Tableau 2 – Catégorisation des échelles de mesure du bien-être par fondementthéorique et objet mesuré
Fondements théoriques
hédonique eudémonique combinée
objet
bien-être en général,satisfaction, santé au
travail, bonheur
diener, & al. (1985); Weiss,& al. (1967); Watson, & al.
(1988); massé, et al. (1998) ;Warr (1990) ; daniels
(2000) ; berkman (1971)
ryff, & Keyes(1995)
Keyes, & al. (2002) ; mc-Gregor, & little (1998) ;
Waterman (1993) ;mcmahan, & estes (2011)
bien-être au travail utriainen, & al. (2011) dagenais-desmarais, & savoie
(2011)
28REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
enfin, les travaux de mcmahan, & estes (2011)apportent une contribution supplémentaire en ré-vélant le lien existant entre la conception per-sonnelle du bien-être et le bien-être ressenti. ilsincitent donc à ne pas se satisfaire d’un raison-nement purement hypothético-déductif et à en-raciner au préalable la construction de l’échelledans les expériences vécues personnellement.Pour le reste, la partie hédonique de ces échellescombinées souffrent de limites identiques àcelles présentées dans la section précédente.
toutes les échelles du bien-être présentéespeuvent être classées en croisant leurs fonde-ments théoriques avec leurs objets (tableau 2).
ce tableau de synthèse et les discussionscritiques qui le précèdent permettent d’établirle cahier des charges vers lequel une nouvelleéchelle de mesure du bien-être au travail doittendre. a ce titre, l’ePbet que nous proposonsa pour ambition de combiner les visions hédo-nique et eudémonique dans le cadre restreint dutravail. cette restriction est justifiée par l’indé-pendance au moins partielle des sphères sociales.refuser ce principe d’inspiration eudémoniqueimpliquerait un renoncement au projet puisqu’ilnécessiterait de passer en revue toutes les ex-périences sociales de l’individu sans exception.a un second niveau, l’ePbet ambitionned’être ancrée dans la psychologie positive pouréviter les problèmes inhérents à la bipolarisa-tion des aspects négatifs et positifs. elle se li-mite également au bien-être psychologique etdélaisse les autres formes telles que le bien-êtreéconomique ou physique. a un troisième ni-veau, des qualités métriques satisfaisantes re-quièrent de travailler à partir d’un échantillonde salariés installés sur le territoire français etnon d’étudiants. il s’agit d’une condition per-mettant d’être en phase avec son contexte d’uti-
lisation ultérieure. christopher (1999) et ryan,& deci (2011) ont en effet observé que le stan-dard social du bien-être varie selon les culturesnationales. a ce jour, il n’existe pas d’échelledéveloppée dans le contexte français à notreconnaissance. cette carence suppose de resterouvert à des dimensions inédites du bien-être,c’est-à-dire de repasser au préalable par unephase qualitative exploratoire. la parcimonieconstitue une exigence supplémentaire. elle fa-cilite l’inclusion de l’outil dans des modèlescomplexes de recherche et dans les baromètressociaux des entreprises. Pour répondre à cetteambition praxéologique, les items formatifs se-ront préférés aux items réflectifs (crié, 2005).l’ePbet considère à ce titre le bien-être entant que variable latente de second ordre dontl’existence est inférée par ses composantes ob-servables. les dimensions de premier ordre sontdes attributs formatifs en ce sens qu’ils influen-cent la présence du construit (diamantopoulos,& Winkhofer, 2001). l’échelle proposée peutgrâce à cela orienter les décisions managériales.le respect de ce cahier des charges ambitieuxpasse par l’adoption du paradigme de Gilbertet churchill (1979).
2. MÉTHODOLOGIE
2.1. La phase qualitative
conformément aux prescriptions de Gilbert& churchill (1979), la génération d’une pre-mière liste d’items a été obtenue au terme d’uneenquête qualitative : treize personnes ont été in-terrogées dans ce but. il s’agissait en l’occur-
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page28
29N° 87 - JANVIER - FÉVRIER - MARS 2013
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
rence de huit salariés choisis pour leur variétéconformément aux recommandations d’eisen-hardt (1991), mais aussi d’un médecin du tra-vail, d’un professeur de psychosociologie, d’unconsultant en gestion des ressources humaines,d’un psychologue du travail, et d’un responsablequalité sécurité environnement d’une grande en-treprise privée. les entretiens ont duré de 38 mi-nutes à une heure dix. il a été demandé auxsalariés de décrire des incidents critiques, c’est-à-dire des situations professionnelles vécues ouhypothétiques particulièrement favorables à leurbien-être au travail. les données textuelles ontété traitées par codage puis classées dans desméta matrices non ordonnées (huberman, &miles, 1991) à l’aide du logiciel n6-Qsr de ma-nière à faire apparaître une première structurefactorielle hypothétique. nous nous sommes ef-forcés à ce stade de formuler chacun des itemsde la manière la plus précise possible en ne fai-sant figurer, autant que faire se peut, qu’une idéepositive par énoncé. cette liste d’items a ensuiteété confrontée à une autre liste d’items construitede manière indépendante, à partir de la revue dela littérature académique ou professionnelle. lebut à ce stade était de conserver un esprit ouvertpour obtenir la vision la plus large possible duphénomène étudié. les items sélectionnés dansla première version du questionnaire sont ceuxrecensés dans la littérature, qui n’ont pas faitl’objet d’un rejet par les personnes interrogées,mais aussi le cas échéant, ceux énoncés sponta-nément au cours des entretiens.
2.2. La phase quantitative
le respect des étapes suivantes du paradigmede Gilbert & churchill (1979) nécessite le son-dage par questionnaire et le traitement quantitatifdes données. les deux échantillons nécessairesà l’établissement des qualités métriques del’échelle ont été constitués en exploitant lesfonctionnalités de « Google doc ». cette solutionpermet une diffusion large du questionnaire danssa version initiale puis dans celle épurée. au-delà des cinq variables de contrôle (tableau 3),toutes les questions se présentaient sous formed’échelles de likert en sept points, le premierdegré correspondant à « pas du tout d’accord »avec la proposition énoncée tandis que le sep-tième traduit « tout à fait d’accord ». un texteintroductif figurant en en-tête présentait classi-quement l’objet de l’enquête et l’affiliation deschercheurs. il garantissait l’anonymat des ré-
ponses et incitait à relayer notre demande auprèsdu carnet d’adresses de chaque répondant. cettesolution virale a permis la création d’un premieréchantillon de 313 réponses valides puis d’unsecond de 865. les caractéristiques de noséchantillons sont les suivantes (tableau 3).28,9% des 865 répondants du second échantillontravaillent dans l’industrie, 9% dans le com-merce, 1,5% dans le btP, 13,1% dans les ser-vices, 3,7% dans le transport, 8,7% dansl’enseignement, 5,7% dans la santé, 9,1% dansla finance, 9,6% dans l’administration publiqueet 10,6% dans les autres secteurs d’activités. apartir des réponses obtenues, l’ensemble destraitements statistiques préconisés pour laconstruction d’une échelle de mesure fiable etvalide ont été réalisés.
2.3. Traitements statistiques
le questionnaire initial a fait l’objet d’uneacP avec rotation varimax. elle a permis de vé-rifier la normalité de la distribution des items,l’absence de multi colinéarité, la qualité de re-présentation et les loading de chaque item surleur dimension respective. les items montrantdes qualités de représentations inférieures à 0,6ont été éliminés. il en est de même des itemsprésentant un loading inférieur à 0,6 envers leurdimension. ceux formant une dimension à euxseuls ont également été écartés eu égard à la fai-ble quantité d’information apportée. une foisl’épuration achevée, l’indice Kmo – test de co-hérence - et le test de sphéricité de bartlett – testd’inter-corrélation- ont permis de s’assurer quela matrice obtenue était factorisable.
un re-test des résultats obtenus avec la nou-velle collecte de données et une analyse facto-rielle confirmatoire ont ensuite été réalisés. laversion épurée du questionnaire a donc elle aussifait l’objet d’une acP avec les mêmes critèresde fiabilité que le premier questionnaire avantd’être soumise aux traitements statistiques del’analyse confirmatoire. l’indicateur de fiabilitéprivilégié par Gilbert et churchill – l’alpha decronbach - étant sensible au nombre d’items etde degrés de liberté proposés (Peter, 1979), nousavons classiquement complété l’étude de fiabi-lité par l’estimation du rhô de Joreskög. l’ana-lyse factorielle confirmatoire a été réalisée aumoyen des modèles d’équations structurellesgrâce au logiciel amos. trois modèles ont étémis en concurrence : m0 pour le modèle à une
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page29
Tableau 3 : Caractéristiques des deux échantillons
caractéristiques échantillon 1 (n=313) échantillon 2 (n=865)
sexemasculin 38,98% 50,63%
Féminin 61,02% 49,37%
Âge
moins de 25 ans 33,87% 5,66%
de 25 à 35 ans 37,06% 24,74%
de 36 à 45 ans 14,38% 27,75%
de 46 à 55 ans 8,31% 27,51%
Plus de 55 ans 6,39% 14,34%
niveau d’études
aucun diplôme 4,47% 1,97%
inférieur au bac 15,02% 11,68%
baccalauréat 10,22% 12,02%
bac+2 à +3 24,60% 29,02%
bac+4 ou +5 33,55% 31,45%
supérieur à bac+5 12,14% 13,87%
ancienneté dans l’entreprise
moins de 2 ans 44,73% 12,60%
2 à 5 ans 19,49% 15,95%
6 à 10 ans 16,29% 16,07%
Plus de 10 ans 19,49% 55,38%
statut professionnel
employé/ ouvrier 30,67% 24,97%
technicien/ agent de maitrise 11,82% 23,12%
cadre/ ingénieur 30,67% 45,66%
autre 26,83% 6,24%
30REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
dimension qui serait la solution la plus simpleau niveau de l’agencement des items, m1 pourle modèle de premier ordre issu de l’acP, et m2pour le modèle de second ordre issu de l’analysedes inter-corrélations entre les dimensions. lemeilleur des trois a été conservé pour la suite decette étude.
la validité du modèle retenu a été testée à l’aidedes validités convergente (rhovc) et de la validitédiscriminante (racine carré du rhovc). la validitéconcomitante utilisée pour renforcer la validité dis-criminante consiste à vérifier que l’échelle propo-sée mesure bien le concept étudié et pas un conceptproche. elle a été vérifiée en comparant la signifi-cativité et l’intensité des liens entre le bien-être etses dimensions à ceux qu’auraient ces mêmes di-mensions du bien-être avec la satisfaction. nousavons utilisé la version courte en vingt items dumsQ validé en version française par roussel(1996) pour deux raisons essentielles : elle a faitl’objet de très nombreuses utilisations au niveauinternational et a montré à de nombreuses reprisesses excellentes qualités psychométriques.
3. RÉSULTATS EMPIRIQUES
3.1. Elaboration du questionnaire initialet structure factorielle après purificationdes items
une première lecture des entretiens a permisde séparer le matériel utile du matériel résiduel.ainsi, sur les 879 verbalisations contenues dansces neuf heures d’entretien, 591 se sont révéléesutiles à l’étude. Parmi ces extraits, 404 ont unlien direct avec le bien-être général ou le bien-être au travail. une seconde lecture approfondiea permis de générer une liste de codes en rapportavec les thèmes abordés par les interviewés. lesverbalisations ont pour cela été classées puis re-groupées en méta codes qui représentent les huitgrandes dimensions du bien-être au travail évo-quées par les interviewés : « sentiments », « re-lations aux collègues », « environnementphysique de travail », « management », « temps
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page30
Tableau 4 : Matrice des composantes après rotation Varimax
« au sujet de votre bien-être au travail, diriez-vous.. » dimensions
rel man tem env
be4 : « J’ai de bonnes relations avec mes collègues » ,868 ,181 ,055 ,182
be5 : « J’ai le sentiment d’être intégré parmi mes collègues » ,833 ,253 ,176 ,260
be6 : « mes collègues sont solidaires de moi » ,769 ,336 ,175 ,125
be7 : « J’ai des possibilités d’évolution si je le souhaite » ,178 ,874 ,102 ,080
be8 : « mes besoins et mes attentes sont pris en compte » ,199 ,814 ,055 ,148
be9 : « mon chef me montre de la reconnaissance pour mon travail » ,297 ,739 ,170 ,193
be12 : « mes horaires sont stables » -,117 ,065 ,829 ,191
be11 : « ma vie professionnelle ne déborde pas sur ma vie privée » ,243 ,021 ,781 ,152
be10 : « le temps que je passe au travail me semble raisonnable » ,257 ,229 ,737 -,058
be1 : « Je peux personnaliser mon espace de travail » ,033 ,029 ,097 ,856
be2 : « mon poste de travail est adapté à mes besoins » ,352 ,183 ,232 ,677
be3 : « le cadre dans lequel je travaille est agréable (couleurs, design…) » ,282 ,292 ,019 ,613
31N° 87 - JANVIER - FÉVRIER - MARS 2013
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
sociaux », « rémunération », « valeurs », « or-ganisation ». il ressort une liste de 46 items deces premiers traitements qualitatifs. de manièretotalement indépendante, une seconde liste de63 items susceptibles de mesurer le bien-être autravail a également été générée à l’aide de l’étatde l’art et de l’étude d’articles de vulgarisationissus de la littérature professionnelle. tous lesitems de la première liste, sans exception, ont puêtre rapprochés des items de la seconde et ontdonc été conservés pour créer le questionnaire.en revanche, 17 issus de la littérature n’ont pasété conservés car ils ont été rejetés par les inter-viewés. un tableau présentant ces résultats estdisponible en annexe 1. cette méthode de dou-ble vérification a permis d’obtenir une liste fia-ble et de minimiser les risques de passer « àcôté » d’un thème essentiel.
après avoir vérifié la normalité de la distribu-tion des items et le conditionnement de la matriced’inter corrélations, l’analyse en composanteprincipale (acP) opérée sur le premier échan-tillon révèle que huit dimensions peuvent êtreextraites selon le critère de Kaiser. elles expli-quent ensemble 66% de la variance du modèle.elles recoupent parfaitement les huit dimensionsissues des entretiens exploratoires. en revanche,plusieurs items possèdent à ce stade de l’analysedes qualités de représentation faible (items n° 1,4, 9, 14, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 44, 45) et desloading inférieurs à 0,6 (items n° 5, 10, 12, 17,19, 22, 25, 26, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42).d’autres forment une dimension à eux seuls(items n° 2, 3, 11, 18). il a donc été nécessaire
d’épurer l’échelle en supprimant ces items. Fi-nalement, 12 items ont été retenus pour la suitede l’analyse. une nouvelle acP avec ces 12items a permis d’obtenir un indice Kmo de0,849 et un test de sphéricité de bartlett à 0,000.Parmi eux, 8 ont une qualité de représentationsupérieure à 0.700 et les 4 autres sont supé-rieures à 0,600. Quatre dimensions ressortentcette fois et restituent 72,6% de la variance. lenombre de dimensions étant défini, il est possi-ble d’étudier la matrice des composantes. aprèsrotation varimax, elle se présente de la manièresuivante (tableau 4).
les corrélations des items avec leurs dimen-sions respectives étant presque toutes supé-rieures à 0.7, et celles partagées avec les autresétant quasiment toutes inférieures à 0,3, il est lé-gitime de les conserver pour la suite de l’ana-lyse. la première dimension est eudémoniquepuisqu’elle converge avec « les relations posi-tives aux autres » de ryff (1989) et aux « rela-tions épanouissantes » de dagenais-desmarais& savoie (2011). elle concerne directement lesrelations entre collègues et sera codée « rel »dans la suite des analyses. la seconde dimensionest également eudémonique : elle recoupe à cer-tains égards « la croissance personnelle » et « lesbuts dans la vie » de ryff (1989) et celle de la« reconnaissance » de dagenais-desmarais &savoie (2011). elle renvoie à l’influence du ma-nagement sur les ambitions d’épanouissementpersonnel et sera désormais codée « man ». latroisième présente un caractère plus hédonique :elle exprime un rapport aux temps satisfaisant et
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page31
Tableau 5 : Statistiques descriptives, corrélations, fiabilité et validitédes dimensions du bien-être au travail
moy e-t rho rhovc 1 2 3 4 5 6 7 8
Genre (1) -
age (2) 0,12 -
niveau deformation (3)
0,05 0,18** -
ancienneté (4) 0,16 0,64** 0,24** -
environnement (5) 13,3 4,1 0,75 0,5 0,09 0,01 0,14** 0,02 (0,733)
relation (6) 16,2 3,5 0,88 0,72 0,02 0,06 0,05 0,02 0,27** (0,875)
management (7) 11,2 4,5 0,84 0,65 0,01 0,12 0,09 0,16** 0,42** 0,43** (0,838)
temps (8) 13 4,6 0,77 0,53 0,04 0,05 0,12** 0,06 0,18** 0,14** 0,17** (0,769)
**significative à p<0,01. Les alphas de Chronbach sont indiqués sur la diagonale
32REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
sera codée « tem ». elle présente des pointscommuns avec la dimension « job carry over »de Warr (1990). enfin, la dernière dimension estrelative à l’environnement physique de travail etsera codée « env ». elle renvoie elle-aussi à unevision hédonique du bien-être. elle semble plusoriginale par rapport aux travaux disponiblesmême si elle n’est pas sans rappeler « la qualitédes conditions de vie » de diener, & al. (1985).ces résultats sont fiables puisque les alphas decronbach de ces dimensions s’élèvent respecti-vement à 0,882 ; 0,825 ; 0,825 et 0,680 pour unscore global de 0,853. les trois premiers sonttout à fait satisfaisants (>0,7). seul le quatrièmeest « acceptable » selon les normes établies par(nunnally, 1978).
3.2. Validités convergente et divergentedu modèle
conformément au protocole de Gilbert &churchill (1979), la cohérence interne des dif-férentes dimensions et celle du modèle globalobtenu au terme de cette étude exploratoire re-quièrent d’être confirmées auprès d’un secondéchantillon pour que l’échelle puisse être adop-tée. une nouvelle fois, la normalité de la distri-bution des douze items ainsi que l’absence demulti colinéarité ont été vérifiées avant acP.l’acP révèle que la qualité de représentationdes items s’est sensiblement améliorée par rap-port au premier échantillon puisque 9 des 12items ont cette fois une valeur supérieure à0.700. les items be2 et be3 qui révélaient descorrélations avec leur dimension un peu plus fai-bles que les autres items lors du premier échan-
tillonnage se sont fortement améliorés avec desvaleurs respectives de 0,802 et 0,750. la va-riance expliquée par les quatre premières dimen-sions est à nouveau élevée (73,76%). laconcordance entre les deux échantillons est doncbonne ce qui montre que les choix opérés lorsde la phase exploratoire étaient pertinents. enfin,les alphas de cronbach sont cette fois de 0,875pour la première dimension, 0,838 pour la se-conde, 0,769 pour la troisième, et 0,733 pour laquatrième. le score global s’élève quant à lui à0,806. la cohérence interne du modèle est doncconfirmée sur ce second échantillon. l’existenced’un construit de second ordre est révélée par lamatrice d’inter-corrélations (tableau 5).
un lien significatif de magnitude faible àmodérée existe bien entre les dimensions. l’ana-lyse par équations structurelles va confirmer cespremières conclusions. la revue de la littératureet les entretiens ont permis de construire troismodèles qui ont été testés à l’aide d’amos. lemodèle m0 réunit les douze items en une dimen-sion unique. il va à l’encontre des résultats ob-tenus au terme des acP mais permet d’établir legain marginal du raisonnement multidimension-nel et de s’assurer que la complexification dumodèle par ajout de dimensions de second ordreest justifiée. le second modèle m1 est conformeaux acP précédemment présentées. il fait appa-raître à ce titre une structure de premier ordre àquatre dimensions. enfin, le modèle m2 pour-suit l’analyse des inter-corrélations entre les di-mensions pour tester l’existence d’unedimension de second ordre. les résultats sont lessuivants (tableau 6).
le modèle à une dimension doit être rejetéd’évidence. aucun seuil n’est atteint. les mo-
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page32
Tableau 6 : Indices de mesure des trois modèles mis en concurrence
normem0
1 dimensionm1
Premier ordrem2
second ordre
Indices absolus
chi-square Minimum 2185 176 180
GFi >0,90 0,673 0,966 0,966
aGFi >0,90 0,527 0,946 0,947
rmsea <0,10 0,215 0,056 0,055
Indices incrémentaux
nFi >0,90 0,508 0,960 0,959
rFi >0,90 0,398 0,946 0,946
tli >0,90 0,404 0,960 0,961
cFi >0,90 0,512 0,970 0,970
Indices de parcimonie
ddl 54 48 50
chi-square /ddl <5 40,4 3,66 3,64
PnFi Le plus grand possible 0,415 0,699 0,727
Tableau 7 : Mise concurrence du bien-être au travail et de la satisfaction au travail
man env rel tem
satisfaction au travail 0,71 0,48 0,46 0,2
satisfaction extrinsèque 0,73 0,4 0,45 0,22
satisfaction intrinsèque 0,51 0,45 0,36 0,14
bien-être au travail 0,76 0,7 0,64 0,59
33N° 87 - JANVIER - FÉVRIER - MARS 2013
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
dèles m1 et m2 présentent tous les deux des ré-sultats extrêmement satisfaisants puisque l’en-semble des indices utilisés sont très largementsupérieurs aux normes établies par la commu-nauté scientifique. ils sont très proches l’un del’autre et ne révèlent pas de différences signifi-catives. les indices de parcimonie sont toutefoismeilleurs pour le modèle (m2) de second ordre.il a de ce fait été conservé. ce modèle est fiablepuisque les rhô de Joreskög (tableau 5) sonttous supérieurs au seuil préconisé. il est de plusvalide si l’on en croît le rhôvc et sa racine carrée.en effet, les valeurs respectives de la racine car-rée de rhôvc de chacune des dimensions (0,71 à0,84) sont toujours supérieures aux corrélationsexistant entre elles (0,17 à 0,56). le modèle desecond ordre révèle donc d’excellentes qualitéspsychométriques et explique bien la structure dubien-être au travail des salariés.
afin de vérifier que l’échelle proposée me-sure effectivement le bien-être au travail et pasun concept proche, nous avons décidé de la met-tre en concurrence avec le msQ qui mesure la
satisfaction au travail. ce dernier a fait l’objetd’une vérification de sa fiabilité par acP avantd’être utilisé. le tableau 7 montre que les quatredimensions du « management », de « l’environ-nement », des « relations aux collègues » et du« temps » corrèlent plus fortement avec le bien-être au travail qu’avec la satisfaction au travailou ses sous-dimensions. ce constat permet d’af-firmer que le questionnaire mesure bien le phé-nomène étudié et non autre.
3.3. Le développement de normes
sur ces bases, les normes de bien-être au tra-vail par dimension constitutive, c’est-à-dire lesmoyennes et écarts-types figurant dans les co-lonnes 2 et 3 de la matrice d’inter-corrélations –tableau 5 – semblent pouvoir être prises commeréférence. Pour répondre aux exigences de la der-nière phase du protocole de Gilbert & churchill(1979), il est possible d’affiner le score global par
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page33
nscore global moyen de bien-être au travail
(score maximum = 12*7 = 84)écart-type
secteur d’activité
industrie 250 54,3 11,5
commerce 78 53,4 12,0
construction 13 55,2 9,8
service 114 53,4 10,9
transport 32 51,3 14,1
enseignement 75 53,7 10,7
santé 49 52,9 9,7
Finance 79 54,8 11,4
administration publique 83 54,9 11,8
autre 92 53,7 11,4
Tableau 8 : Normes de bien-être au travail
34REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
secteur d’activité en fonction des résultats révéléspar le second échantillon (tableau 8).
la moyenne globale de l’échantillon étant de53,9, il semblerait que les secteurs du transport(51,3) et de la santé (52,9) soient les moins pro-pices au bien-être des salariés alors que les secteursde la construction (55,2) et de l’administration pu-blique (54,9) sont quant à eux le théâtre des plushauts niveaux de bien-être au travail. ces résultatssont à interpréter avec précaution car il s’agit là dela première exploitation de ce questionnaire. d’au-tres investigations permettraient de confirmer ounon ces résultats. cependant, les scores obtenus serépartissant selon une courbe de Gauss, il estpossible d’utiliser la moyenne et l’écart typepour déterminer l’intervalle de confiance au seinduquel la majorité de la population sera pré-sente. la formule [m-1,96σ ; m+1,96σ] déter-mine les bornes entre lesquelles figurent 95% dela population. ainsi, la borne basse correspondà 31 points. au-dessous de cette valeur ne setrouvent que 26 salariés, soit 3% de l’échan-tillon. la borne haute s’élève à 76 points. 19 sa-lariés seulement, soit 1,6% de l’échantillon,révèlent des scores supérieurs. en d’autrestermes, il est possible d’annoncer qu’un scorede 31 points constitue un point pivot en-deçà du-quel un salarié passerait d’une situation de bien-être « normal » à une situation alarmante ouanormale. il est également possible de prolongerce raisonnement pour chaque dimension dubien-être. ainsi, un score de 5 ou moins sur ladimension de « l’environnement », un score de8 ou moins sur la dimension des « relations »,un score de 3 ou moins sur la dimension du« management » et un score de 4 ou moins sur
la dimension du « temps » sont des seuils qui de-vront interpeller un manager.
ces résultats permettent ensemble de faireprogresser les connaissances praxéologiques ausujet du bien-être au travail sous réserve dequelques limites.
4. DISCUSSION ET CONCLUSION
4.1. Contributions
cet article contribue à enrichir la littératureacadémique consacrée au bien-être au travail etles réflexions managériales : premièrement,l’analyse critique présentée dans l’état de l’art amis en évidence les limites des échelles dispo-nibles. selon les cas, il s’agit d’une propensionà utiliser des indicateurs secondaires qui péna-lise la validité interne du construit, d’une insuf-fisante centration sur la sphère du travail, d’uneprésence d’affects négatifs, d’un défaut d’enra-cinement dans les expériences vécues, et/ou debiais d’échantillonnage. deuxièmement, l’iden-tification des dimensions du bien-être au travailautorise une clarification conceptuelle. comptetenu des résultats obtenus, il est en effet possiblede le définir comme « un état psychologique ré-sultant d’un rapport positif aux autres, à soi, auxtemps et à l’environnement physique de tra-vail ». les deux premiers rapports renvoient àune vision eudémonique. ils confortent l’intui-tion de robert (2007) selon laquelle le salariémais aussi la personne doivent être pris en
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page34
35N° 87 - JANVIER - FÉVRIER - MARS 2013
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
compte. ils incitent en ce sens à envisager l’ac-teur dans son contexte (louart, 1994), c’est-à-dire à distinguer d’une part les attentesd’intégration du salarié dans l’univers des rela-tions sociales de l’entreprise, et d’autre part,celles plus personnelles de trajectoire sociale. ace titre, il semble difficile de vouloir susciter unétat de bien-être au travail en ne considérant quela qualité des relations professionnelles. la ré-ponse apportée par le manager aux aspirationsde développement personnel est également im-portante. le bien-être au travail révèle à ce titreune dimension affective mais aussi prospective.il est tributaire de l’ambition et révèle de ce faitune composante dynamique. l’identité de la per-sonne telle qu’elle se définit actuellement et tellequ’elle s’imagine à l’avenir y concourent l’uneet l’autre. les rapports au temps et à l’environ-nement physique de travail renvoient pour leurpart à une vision plus hédonique que lachmann& al. (2010) avaient eux-aussi pré-sentis. lebien-être au travail est de ce fait dépendant despossibilités de « bien faire ». il requiert un sen-timent de pouvoir remplir correctement sa mis-sion professionnelle. ces deux derniers rapportsne figuraient pas en tant que dimensions dans leséchelles nord-américaines. Quelques items seu-lement y faisaient parfois référence. cette pré-gnance dans le contexte français conforte doncla thèse de la contingence culturelle du bien-êtresoutenue par christopher (1999) et ryan, &deci (2011). il s’agit là de la troisième contri-bution de cet article puisqu’aucune échellen’avait jusqu’à présent été développée spécifi-quement dans notre pays. enfin, le quatrièmeapport est managérial. l’échelle ePbet propo-sée dans le tableau 4 est fiable, valide statisti-quement, et utile aux managers du fait de sonorientation formative. elle pourra donc être in-cluse avec confiance dans les baromètres so-ciaux des entreprises pour orienter les politiquesde bien-être au travail. les actions d’améliora-tion qui pourrait en ressortir relèvent moinsd’une démarche philanthropique que d’un acteéconomique si l’on prend en considération leursimpacts sur la performance (lachmann, & al.2010). Plus généralement, la mesure du bien-être pourrait permettre de porter un regard com-plémentaire aux traditionnels calculs d’efficacitéet d’efficience : elle permet d’établir un ratiorapportant le résultat économique au niveau debien-être au travail des salariés. ce ratio pourraitenrichir et apaiser les discussions avec les par-tenaires sociaux au sein du chsct en fournis-sant une quantification du phénomène.
4.2. Limites
les limites essentielles de ce travail tiennentà l’échantillonnage, aux variables de contrôleprises en compte, au paradigme de churchill et,enfin, aux normes statistiques retenues. mêmesi la variété des interlocuteurs a été privilégiéedurant la phase qualitative, même si deux échan-tillons différents ont été constitués pour opérerles traitements quantitatifs, il reste néanmoinsque leurs représentativités tant théorique (eisen-hardt, & Graebner, 2007) que statistique ne peu-vent être garanties. il n’est de ce fait pas possibled’écarter définitivement l’éventualité d’une dé-pendance au moins partielle des conclusionsavancées aux personnes interrogées et auxcontextes dans lesquels elles sont immergées(rossiter, 2002). la seconde fragilité de la dé-monstration tient au faible nombre de variablesde contrôle, notamment en ce qui concerne lataille des entreprises. d’autres caractéristiquesplus personnelles, à l’image de l’appartenancesyndicale par exemple, pourraient être testées.les limites de la méthode de Gilbert & churchill(1979) tiennent quant à elles à la pertinence desenseignements tirés de la phase qualitative. leprotocole de recherche étant très séquentiel, cesanalyses premières orientent la suite des traite-ments (macKenzie, 2003). enfin, les seuils re-tenus pour garantir les qualités psychométriquesde l’échelle ne sont que des conventions par dé-finition contestables (cf. les divergences de vueentre nunnaly, 1978 et briggs, & cheek 1986).
4.3. Pistes de recherche
sous ces réserves, l’échelle ePbet ouvredifférentes pistes de recherche. la première dé-rive de sa structure factorielle. il serait en effetinstructif pour les managers d’identifier des pro-fils de bien-être au travail en fonction des scoresattribués par les salariés aux quatre dimensions.il paraît peu opportun en effet de tenter de défi-nir une politique standardisée d’amélioration dubien-être au travail compte tenu du poids de ladimension affective, c’est-à-dire du jugementporté par chacun. les actions envisagées, sanstoutefois relevées du sur-mesure, gagneraientplutôt à être adaptées à chacun des segments depopulation présentant des profils de bien-être si-milaires. a ce niveau, la différenciation straté-gique propre au marketing social prend tout sonsens (louart, 1994). la seconde piste s’inscrit
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page35
dans la même logique : elle pourrait consister àidentifier la part de bien-être qui relève de l’in-tentionnalité et qui est, à ce titre, influençable.lyubomirsky & al. (2005) soutiennent en effetque cet état psychologique relève à la fois d’uneprédisposition génétique et de l’image de soi,des circonstances de la vie, et aussi d’une vo-lonté. etre en mesure de cerner la composantesur laquelle le manager et les partenaires sociaux(lachmann, & al. 2010) sont susceptibles d’agirpourrait être utile.
au niveau théorique, l’étude pourrait êtrepoursuivie par une investigation des liens sus-ceptibles d’exister entre les quatre dimensionsconstitutives. cet approfondissement permettraitpar exemple d’appréhender les compensationspossibles entre-elles. Par exemple, un retrait dela course aux promotions (man) et/ou un tempsde travail accru au détriment de la vie privée(tem) peuvent-ils être équilibrés par une amé-lioration des relations aux collègues (rel) ouéchangés contre une révision favorable desconditions matérielles de travail (env) ? cettelogique permettrait de mieux cerner les dyna-miques d’émergence, de renforcement ou de dé-gradation du bien-être au travail. enfin,l’ePbet pourrait judicieusement être inclusedans des modèles complexes afin de revisiter lesliens avec les antécédents et les conséquencesjusque-là identifiés à partir d’indicateurs secon-daires. c’est à ce prix que le drh pourra justi-fier « chiffres en main » auprès de sa directionsa volonté de développer des efforts en faveurdu bien-être au travail.
BIBLIOGRAPHIE
achille, m.a. 2003. définir la santé au travail.un modèle multidimensionnel des indicateurs de lasanté au travail. in r. Foucher, a. savoie & l. brunet(éds.), Concilier performance organisationnelle etsanté psychologique au travail, 91-112, montréal,Qc: éditions nouvelles.
arGyle, m. 1987. The Psychology of happiness.new york: methuen.
bellenGer, l., & couchaere, m.J. 2004. Plusefficace et moins stressé: le bien-être, clé de la per-formance. editions esF, Paris.
berKman, P.l. 1971. measurement of mentalhealth in a general population survey. American Jour-nal of Epidemiology, 94, 105-111.
boWlinG, a. 1991. measuring health: a reviewof quality of life measurement scales. Social Indica-tors Research, 49 (1), 115-120.
briGGs, s.r., & cheeK, J.m. 1986. the role offactor analysis in the evaluation of personality scales.Journal of Personality, 54 (1), 106-148.
coWen, e.l. 1994. the enhancement of psy-chological wellness: challenges and opportuni-ties. American Journal of Community Psychology,22, 149-179.
crié, d. 2005. de l’usage des modèles de mesureréflectifs ou formatifs dans les modèles d’équationsstructurelles. Recherche et Applications en Market-ing, 20 (2), 5-27.
christoPher, J.c. 1999. situating psychologicalwell-being: exploring the cultural roots its theory andresearch. Journal of Counseling and Development,77, 141-152.
daGenais-desmarais, v., & savoie, a. 2011.What is psychological well-being, really? a grass-roots approach from organizational sciences. Journalof Happiness Studies, July, 1-26.
daniels, K. 2000. measures of five aspects of af-fective well-being at work. Human Relations, 53 (2),275-294.
deci, e.l., & ryan, r.m. 2008. Facilitating op-timal motivation and psychological well-being acrosslife’s domains. Canadian psychology, 49, 14–23.
diamantoPoulos, a., & Winkhofer, h.m. 2001.index construction with formative indicators: an al-ternative to scale development. Journal of MarketingResearch, 38 (2), 269-277.
diener, e. 1984. the independence of positiveand negative affect. Journal of Personality and So-cial Psychology, 47 (5), 1105-111.
diener, e.d. 1994. assessing subjective well-being: Progress and opportunities. Social IndicatorsResearch, 31, 103-157.
diener, e., emmons, r.a., larsen, r.J., &GriFFin, s. 1985. the satisfaction with life scale.Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71-75.
diener, e., naPa-scollon, c.K., oishi, s.,dzoKoto, v., & suh, e.m. 2000. Positivity and theconstruction of life satisfaction judgments: Globalhappiness is not the sum of its parts. Journal of Hap-piness Studies, 1, 159–176.
diener, e., oishi, s., & lucas, r.e. 2003. Per-sonality, culture, and subjective wellbeing: emo-tional and cognitive evaluations of life. AnnualReview of Psychology, 54, 403–425.
diener, e., saPyta, J.J., & suh, e. 1998. subjec-tive well-being is essential to well-being. Psycholog-ical Inquiry, 9 (1), 33-37.
eisenhardt, K. 1991. better stories and betterconstructs: the case for rigor and comparative logic.Academy of Management Review, 16 (3), 620-627.
eisenhardt, K., & Graebner, m. 2007. theorybuilding from cases: opportunities and challenges.Academy of Management Journal, 50 (1), 25-32.
Gilbert, a., & churchill, J.r. 1979. a para-digm for developing better measures of marketing
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES36
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page36
constructs. Journal of Marketing Research, Xvi,67-73.
Gilbert, m.h., daGenais-desmarais, v., &savoie, a. 2011. validation d’une mesure de santépsychologique au travail. Revue européenne de psy-chologie appliquée, 61 (4), 195-203.
GrosJean, v. 2004. le bien-être au travail: unobjectif pour la prévention. INRS. Hygiène et sécuritéau travail. 198, 29-40.
hart, P.m. 1999. Predicting employee life satis-faction: a coherent model of personality, work, andnonwork experience, and domain satisfactions. Jour-nal of Applied Psychology, 84, 564-584.
herzberG, F., mausner, b., & snyderman, bb.1959. The motivation at work. new-york: JohnWiley & sons.
huberman, a.m., & miles, m.b. 1991. Analysedes données qualitatives. Recueil de nouvelles mé-thodes, de boeck, bruxelles.
Kahneman, d., diener, e., & schWarz, n. 1999.Well-being: The foundations of hedonic psychology.new york, ny: russell sage Foundation.
Keyes, c.l.m., shmotKin, d., & ryFF, c.d.2002. optimizing well-being: the empirical en-counter of two traditions. Journal of Personality andSocial Psychology, 82 (6), 1007-1022.
Keyes, c.l.m. 2005. mental illness and/or men-tal health? investigating axioms of the complete statemodel of health. Journal of Consulting and ClinicalPsychology, 73 (3), 539-548.
Keyes, c.l.m. 2006. subjective well-being inmental health and human development researchworldwide: an introduction. Social Indicators Re-search, 77 (1), 1-10.
Keyes, c.l. 2007. Promoting and protectingmental health as flourishing: a complementary strat-egy for improving national mental health. AmericanPsychologist, 62 (2), 95-108.
Keyes, c.l.m., & loPez, s.J. 2002. toward ascience of mental health: Positive directions in diag-nosis and interventions. in c.r. snyder & s.J. lopez(eds.), Handbook of positive psychology, 45-59, newyork, ny: oxford university Press.
Kiziah, J.e. 2003. Job satisfaction vs work ful-fillment. Exploring positive experience at work. vir-ginia: virginia commonwealth university.
lachmann, h., larose, c., & Penicaud, m.2010. Bien-être et efficacité au travail. rapport auPremier ministre, anact, février.
lee, K., & allen, n.J. 2002. organizational cit-izenship behavior and workplace deviance: the roleof affect and cognitions. Journal of Applied Psychol-ogy, 87 (1), 131-142.
linley, P., maltby, J., Wood, a.m., osborne, G.,& hurlinG, r. 2009. measuring happiness: thehigher order factor structure of subjective and psycho-logical wellbeing measures. Personality and Indivi-dual Differences, 47 (8), 878-884.
louart, P. 1994. au-delà du débat globalisation-individualisation. la Grh à l’heure des segmenta-tions et des particularismes, Revue Française deGestion, 98, 79-94.
lyubomirsKy, s., sheldon, K.m., & schKade, d.2005. Pursuing happiness: the architecture of sustain-able change. Review of General Psychology, 9, 111-131.
macKenzie, s.b. 2003. the dangers of poor con-struct conceptualization. Journal of the Academy ofMarketing Science, 31 (3), 323-326.
massé, r., Poulin, c., dassa, c., lambert, J.,bélair, s., & battaGlini, a. 1998. élaboration etvalidation d’un outil de mesure du bien-être psycho-logique: l’émmbeP. Revue canadienne de santé pu-blique, 89 (5), 352-357.
mcGreGor, i., & little, b.r. 1998. Personalprojects, happiness, and meaning: on doing well andbeing yourself. Journal of Personality and SocialPsychology, 74 (2), 494-512.
mcmahan, e.a., & estes, d. 2011. measuringlay conceptions of well-being : the beliefs aboutwell-being scale. Journal of Happiness Studies,12, 267-287.
ménard, J., & brunet, l. 2012. authenticité etbien-être au travail: une invitation à mieux compren-dre les rapports entre le soi et son environnement detravail. Pratiques Psychologiques, 18 (1), 89-101.
meyer, J.P., & maltin, e. 2010. employee com-mitment and well-being: a critical review, theoreti-cal-framework and research agenda. Journal ofVocational Behavior, 77 (2), 323-337.
nunnaly, J.c. 1978. Psychometric theory. new-york, macGraw-hill.
PaGe, K.m., & vella-brodricK, d.a. 2009. the“what”, “why” and “how” of employee well-being:a new model. Social Indicators Research, 90, 441-458.
Parmentier, t.r. 1994. Quality of life as a conceptand measurable entity. Social Indicators Research,33, 3-46.
PodsaKoFF, P.m., macKenzie, s.b., Paine, J.b.,& bachrach, d.G. 2000. organizational citizenshipbehaviors: a critical review of the theoretical and em-pirical literature and suggestions for future research.Journal of Management, 26 (3), 513-563.
robert, n. 2007. bien-être au travail: une ap-proche centrée sur la cohérence des rôles. Note sci-entifique et technique, inrs, 267, 1-33.
rossiter, a. 2002. the c-oar-se procedure forscale developement in marketing. International Jour-nal of Research in Marketing, 22 (1), 23-25.
roussel, P. 1996. Rémunération, motivation etsatisfaction au travail, Paris, ed. economica.
ryan, r.m., & deci, e.l. 2001. on happinessand human potentials: a review of research on hedo-nic and eudemonic well-being. Annual Review ofPsychology, 52, 141-166.
ryFF, c. 1989. happiness is everything, or is it?explorations on the meaning of psychological well-
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
N° 87 - JANVIER - FÉVRIER - MARS 201337
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page37
being. Journal of Personality and Social Psychology,57 (6), 1069–1081.
ryFF, c.d., & Keyes, c.l.m. 1995. the structureof psychological well-being revisited. Journal of Per-sonality and Social Psychology, 69 (4), 719-727.
seliGman, m.e.P., steen, t.a., ParK, n., &Peterson, c. 2005. Positive psychology progress.empirical validation of interventions. AmericanPsychologist, 60 (5), 410-421.
smith, c.a., orGan, d.W., & near, J.P. 1983. or-ganizational citizenship behavior: its nature and an-tecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.
sPector, P.e. 1997. Job satisfaction: Application,assessment, causes, and consequences. thousandoaks, ca.: sage.
utriainen, K., KynGas, h., & niKKila, J. 2011.a theoretical model of ageing hospital nurses well-being at work. Journal of Nursing Management, 19,1037-1046.
veit, c.t., & Ware, J.e. 1983. the structure ofpsychological distress and well-being in general pop-ulations. Journal of Consulting and Clinical Psychol-ogy, 51, 730-674.
voyer, P., & boyer, r. 2001. le bien-être psy-chologique et ses concepts cousins, une analyse con-ceptuelle comparative. Revue Santé Mentale auQuébec, XXvi (1), 274-299.
Warr, P. 1990. the measurement of well-beingand other aspects of mental health. Journal of Occu-pational Psychology, 63, 193-210.
Waterman, a.s., 1993. two conceptions of hap-piness: contrasts of personal expressiveness (eudai-monia) and hedonic enjoyment. Journal ofPersonality and Social Psychology, 64 (4), 678–691.
Watson, d., clarK, l.a., & telleGen, a. 1988.development and validation of brief measures ofpositive and negative affect: the Panas scales.Journal of Personality and Social Psychology, 54 (6),1063-1070.
Weiss, d.J., daWis, r.v., enGland, G.W., &loFQuise, l.h. 1967. minnesota studies in vocationalrehabilitation, manual for minnesota satisfaction Ques-tionnaire. Vocational Psychology Research, 22, 1-119.
WriGht, t.a., & bonett, d.G. 1997. the role ofpleasantness and activation-based well-being in per-formance prediction. Journal of Occupational HealthPsychology, 2, 212-219.
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES38
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page38
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
N° 87 - JANVIER - FÉVRIER - MARS 201339
Annexe 1 : Origine des items retenus dans le questionnaire initial
Origine
ITEMS du questionnaire Entretiens - Verbatim Littérature
1mon poste de travail est confortable(bruit, luminosité, odeur, propreté)
une personne qui va travailler et qui a froid àson poste de travail, il n’est pas bien au travail.
de zanet, 2004
2mon entreprise favorise les openspaces
vous êtes en open space, vous ne pouvez pasvous concentrer non plus parce qu’il y a tou-jours quelqu’un au téléphone.
de Keyser et han-sez, 2000
3j’ai une ou des salles de pausesconviviales à disposition
Par contre, la présence de lieux de détente pourmoi, c’est un facteur qui me semble prédomi-nant.
lachmann et al,2010
4 je travaille en toute suretési on a l’impression d’être toujours en danger,on ne peut pas être épanoui au travail, ça c’estclair.
Grosjean, 2004
5le matériel que j’utilise est de bonnequalité
oui du bon matériel qui fonctionne, ça ne peutpas nuire à ton bien-être. le fait d’avoir un télé-phone qui ne marche pas, c’est pénalisant.
de Keyser et han-sez, 2000
6je peux personnaliser mon espacede travail
la personnalisation de l’espace de travail, çaeffectivement, c’est un facteur de construction.
lachmann et al,2010
7mon poste de travail est ergono-mique
une ergonomie bien adaptée du poste de travailva favoriser le bien-être au travail.
lachmann et al,2010
8le cadre dans lequel je travaille estagréable
Je pense plutôt que de travailler dans un envi-ronnement tout blanc, je pense qu’il faut unpeu de décoration, un peu de couleur ça égaye.
ryff, 1989
9la structure hiérarchique de mon en-treprise est claire
Je pense qu’il y a besoin d’une hiérarchie pourle bien-être.
lachmann et al,2010
10mon entreprise favorise le travail enéquipe
déjà, il faut qu’il y ait une bonne entente avecles équipes.
de Keyser et han-sez, 2000
11mon entreprise m’informe et meprépare au changement
si les changements sont bien amenés au gens,bien expliqués, qui participe au changement, çapeut être constructeur de bien-être.
lachmann et al,2010
12les taches de chacun sont bien défi-nies
déjà je pense que le respect l’un envers l’autre,que chacun respecte son domaine de travail.
de zanet 2004
13mes horaires sont stables et connusà l’avance
les horaires stables c’est important, quand tul’as c’est cool
de zanet 2004
14j’ai une vision claire de l’avenir demon entreprise
les gens à qui on explique ce que l’on attendd’eux pourquoi, comment, qu’est-ce qu’ils vontdevenir, c’est mieux
bellanger et cou-chaere 2004
15il y a une frontière entre ma vie pro-fessionnelle et ma vie privée
mais je préférais me dire : quand je suis au tra-vail, je travaille et quand je suis à la maison,c’est la maison.
lachmann et al,2010
16j’ai des taches variées dans mon tra-vail
Ça peut avoir des avantages que ce soit mono-tone, mais au bout d’un moment tu sais faireton travail, donc je pense qu’il en faut un peu.
Grosjean, 2004
17le travail est bien organisé dans monentreprise
effectivement, c’est un élément, c’est-à-direque plus les taches sont clairement organisées etplus c’est un facteur de construction.
Grosjean, 2004
18 les équipes de travail sont stablestu vois comme quoi on ressentait du bien-êtreau boulot parce qu’il y avait une super relationet on formait vraiment un groupe tous ensemble.
de zanet 2004
19je connais et je comprends lesgrands objectifs poursuivis par monentreprise
la communication, pour moi, c’est à la base detout et c’est surtout à la base du bien-être
bellanger et cou-chaere 2004
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page39
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES40
20je connais et je comprends la poli-tique générale de mon entreprise
c’est sûr que c’est mieux de savoir où veutaller l’entreprise
bellanger et cou-chaere 2004
21mon patron et/ou mon drh sontdisponibles
engagement du drh : alors là, on est sur dumanagement. et la dimension management elleest capitale pour le bien-être.
lachmann et al,2010
22j’ai les moyens de faire mon travailet d’atteindre mes objectifs
il faut des objectifs qui sont donnés à chaquesalarié, que les objectifs soient en rapport avecles moyens.
ryff, 1989
23j’ai des possibilités d’évolution si jele souhaite
ceux qui sont à des postes à responsabilités, quisont dans le cadre de la réussite, de l’évolution,généralement ils vont aussi bien.
ryff, 1989
24mes besoins et mes attentes sontpris en compte
on valide leurs compétences, on les reconnaîten tant qu’individuel avec des besoins des at-tentes donc pour le bien-être c’est intéressant.
ryff, 1989
25les managers de mon entreprise sontcompétents
avoir un bon manager, c’est capital.lachmann et al,2010
26j’entretiens de bonnes relations avecmon chef
Pour moi, mon manager au niveau moral c’estsuper. il ne va pas te laisser tout seul.
dagenais-desmaraiset al 2011
27j’ai de bonnes relations avec mescollègues
les relations avec les collègues, ça influence lebien-être. Parce que si tu ne t’entends pas avecles collègues, ce n’est pas bon.
ryff, 1989
28 je suis validé à mon postes’il n’y a plus de hiérarchie, sur le bien-être jepense que ça joue énormément parce qu’en fait,il n’y a plus de respect.
lachmann et al,2010
29mon salaire correspond à mes res-ponsabilités
si je me dis que je suis sous payé, je vais pasêtre bien au travail.
de zanet, 2004
30mes responsabilités correspondent àmes attentes
le fait est, d’avoir ses compétences pour tel outel métier, je pense que ça permet de créer uncertain bien-être
lachmann et al,2010
31mon travail est évalué régulière-ment
des réunions individuelles pour faire un pointannuel mais faut faire attention que ce soit bienencadré
dagenais-desmaraiset al 2011
32j’ai une marge de manœuvre dansmon travail
l’autonomie : qu’il ne soit pas derrière nous àdire tu fait ça ou ça. on est quand même profes-sionnel dans ce que l’on fait.
ryff, 1989
33mon chef me montre de la recon-naissance pour mon travail
Je crois que ce qui est important dans le bien-être, c’est la reconnaissance.
bellanger et cou-chaere 2004
34il y a une bonne communicationdans l’entreprise
la communication pour moi c’est à la base detout et c’est surtout à la base du bien-être
bellanger et cou-chaere 2004
35le temps que je passe au travail cor-respond à mes attentes
le temps de travail c’est le temps de travail.après on peut faire des heures supplémentairessi besoin mais il ne faut pas plus qu’on ne lepeut.
Grosjean, 2004
36 je me sens soutenu au travailsi je fais une erreur, j’apprécie d’être soutenupar mon chef et qu’il prenne du temps avecmoi.
de Keyser et han-sez, 2000
37 j’ai confiance dans mon entreprisesi on ne peut pas avoir un minimum confiancedans son entreprise, c’est clair qu’on ne peutpas être bien au travail.
dagenais-desmaraiset al. 2011
38mon entreprise est juste et équitableenvers tout le personnel
Quand il y a une bonne ambiance, le travail estéquitable.
lachmann et al,2010
39j’ai un sentiment d’engagement en-vers mon entreprise
Je pense que j’aurais besoin d’être impliquédans mon travail pour ressentir du bien-être.
dagenais-desmaraiset al. 2011
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page40
Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET)
N° 87 - JANVIER - FÉVRIER - MARS 201341
40je suis fier de travailler dans monentreprise
on n’a pas d’emblée une fierté, on aura unefierté parce que effectivement l’entreprise à la-quelle on appartient fera des choses pour notrebien-être.
dagenais-desmaraiset al. 2011
41 je me sens utile au travailmais c’est sûr que se sentir utile, c’est franche-ment dans le bien-être.
ryan et deci, 2001
42je suis motivé quand je suis au tra-vail
c’est sûr qu’être motivé au travail ça fait partiedu bien-être.
daniels, 2000
43j’ai le sentiment d’être intégréparmi mes collègues de travail
le fait être intégré de se sentir intégré dans legroupe de travail, c’est important.
ryan et deci, 2001
44 je suis fier de mon travaille bien-être, c’est aussi donner aux individusdu sens à l’entreprise et à leur travail.
dagenais-desmaraiset al. 2010
45 j’ai confiance en moi au travaille bien-être pour moi c’est vraiment un senti-ment d’équilibre et de confiance.
ryff, 1989
46mes collègues sont solidaires demoi
les relations avec les collègues ça influence lebien-être.
dagenais-desmaraiset al. 2011
ITEMS exclus
47 la fatigue daniels, 2000
48 la taille de l’entreprisede Keyser et han-sez, 2000
49 le temps de trajet pour aller au travaillachmann et al,2010
50 la mobilitélachmann et al,2010
51 le lieu de travailde Keyser et han-sez, 2000
52 la charge de travailbellanger et cou-chaere 2004
53 le type de contrat de zanet, 2004
54 la durée des congéslachmann et al,2010
55 le temps pour faire son travailde Keyser et han-sez, 2000
56 la sécurité de l’emploilachmann et al,2010
57 l’excitation d’aller au travaildagenais-desmaraiset al 2011
58 le dépassement de ses limites au travaildagenais-desmaraiset al 2011
59 l’implication au travaildagenais-desmaraiset al 2011
60 le stresslachmann et al,2010
61 l’âge du salarié diener et al 1998
62 la présence syndicalelachmann et al,2010
63 le genrede Keyser et han-sez, 2000
023-041 BIETRY_Mise en page 1 07/11/12 12:51 Page41



































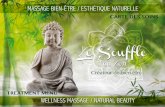
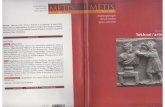
![La mal-mesure des Celtes. Errements et débats autour de l’identité celtique de 1850 à nos jours [Un siècle et demi d’ethnogenèse]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63153a41fc260b71020fe4ed/la-mal-mesure-des-celtes-errements-et-debats-autour-de-lidentite-celtique.jpg)


