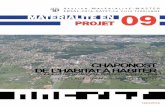PROJET PHARE P0929 DISPARITES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of PROJET PHARE P0929 DISPARITES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
Décembre 2009
PROJET PHARE P0929
DISPARITES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL
Co-responsables : Laurent Gobillon et Ariane Pailhé 10 chercheurs INED : Carole Bonnet, Olivia Ekert-Jaffé, Laurent Gobillon, François Héran, Dominique Meurs, Ariane Pailhé, Nathalie Picard, Sophie Ponthieux, Anne Solaz, Olivier Thévenon. 3 doctorants : Aziz Belhassaini, Matthieu Solignac, Szuszanna Stefan-Makay. 4 autres chercheurs : Elisabeth Algava (Dares), Andrew Clark (CNRS, PSE), Thierry Magnac (Université de Toulouse-IDEI), Sébastien Roux (CREST-INSEE).
4 chercheurs étrangers : Patrick Puhani (Université de Hanovre), Nicolas Robette (Bocconi University), Harris Selod (Banque mondiale), Haya Stier (Université de Tel Aviv)
1 ITA : Tania Vichnievskaia.
Depuis les années 1950, le marché du travail français a connu des transformations majeures avec la montée de la participation des femmes et un afflux d’immigrés, notamment d’Europe du sud et d’Afrique. L’activité féminine s’est développée sous l’influence d’un double mouvement, des besoins de main-d’œuvre et la tertiarisation de l’économie d’une part, et les progrès de la scolarisation des filles, l’évolution des normes sociales, un meilleur contrôle des naissances et, plus tard, le développement des modes de garde d’autre part. Le recours à l’immigration a aussi permis de combler les manques de main d’œuvre dans les métiers peu qualifiés, nécessaires à la reconstruction du pays après la deuxième guerre mondiale et au soutien de la croissance économique.
Cinquante ans plus tard, on constate que ces deux populations rencontrent des problèmes d’insertion sur le marché du travail. Malgré un rattrapage de niveau d’études, l’accès à l’emploi est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Les femmes sont aussi moins bien rémunérées que leurs homologues masculins. Les immigrés ont un risque de chômage bien plus élevé que les natifs et ne connaissent pas les mêmes progressions de carrière. Bien que scolarisés en France, les descendants d’immigrés sont eux aussi désavantagés en termes d’emploi.
Trois types de facteurs peuvent expliquer ces disparités entre sous-populations. Premièrement, il peut exister des différences de dotations, en capital humain ou en capital social. Certains groupes peuvent avoir un niveau de qualification plus faible ou une moindre expérience sur le marché du travail. Leurs réseaux sociaux peuvent aussi être moins efficaces. Deuxièmement, ces groupes peuvent avoir des comportements différenciés. Les
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
comportements familiaux et les normes vis-à-vis du travail peuvent varier. Enfin, ces groupes peuvent subir des discriminations, du fait de la préférence des employeurs ou des représentations que les employeurs ont des groupes (discrimination statistique).
Les conditions macro-économiques influencent aussi les inégalités sur le marché du travail. L’amplitude de ces disparités augmente en temps de crise, la situation des groupes fragilisés pouvant encore se détériorer.
Ce projet étudie les disparités sur le marché du travail entre sous-populations. Il s’intéresse plus particulièrement à la mesure des disparités de genre et d’origine (immigrés et descendants), et à l’effet des comportements familiaux (naissances, séparations) sur les inégalités d’accès à l’emploi et de salaire.
Trois axes de recherche seront développés. Le premier analyse l’effet des événements familiaux sur les disparités entre hommes et femmes sur le marché du travail. Le deuxième se focalise sur les difficultés d’intégration économique des immigrés et de leurs descendants. Enfin, le troisième examine l’évolution des disparités en temps de crise.
1. LES EVENEMENTS FAMILIAUX GENERENT-ILS DES DISPARITES
SUR LE MARCHE DU TRAVAIL ? Depuis les années 1960, les femmes sont entrées massivement sur le marché du travail. De 40 % au début des années 1960, le taux d'activité des femmes âgées de 25 à 49 ans est passé à 80 % en France aujourd'hui ; les femmes constituent désormais près de la moitié de la population active. Si la majorité des femmes cumulent aujourd’hui activité professionnelle et vie familiale et ont des trajectoires professionnelles beaucoup moins discontinues que leurs aînées, les différences de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’accès à l’emploi et d’évolution dans l’emploi perdurent. Le récent rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes rédigé par Brigitte Grésy (2009) souligne ainsi la persistance des inégalités : un accès et un maintien dans l’emploi plus difficile pour les femmes, une bipolarisation croissante des emplois féminins entre emplois peu qualifiés et emplois qualifiés, une ségrégation professionnelle persistante, des inégalités dans les conditions de travail, des formes d’emploi souvent précaires, des écarts de salaire maintenus ou encore une invisibilité des femmes dans les instances de décision. En outre, la dynamique de progression de l’activité féminine semble rompue (Afsa et Buffeteau, 2006).
L’un des principaux éléments explicatifs des différences de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail est l’inégale répartition des rôles au sein du couple dans la prise en charge des tâches domestiques et parentales (voir projet phare 1 de l’unité). Les femmes portent en effet principalement le poids des ajustements entre travail et vie familiale. L’activité des femmes diminue ainsi avec le nombre d’enfants et quand ils sont en bas âge.
La répartition des rôles au sein du couple est étroitement liée aux événements familiaux. Nous étudierons ici dans quelle mesure ces événements familiaux génèrent des disparités sur le marché du travail. Quelle est l’influence de la naissance des enfants sur les trajectoires professionnelles des hommes et des femmes ? Quelles en sont les conséquences sur les écarts de salaire entre hommes et
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
femmes ? Outre les naissances, d’autres événements familiaux affectent le parcours professionnel des hommes et des femmes. La rupture conjugale est sans doute un facteur d’intensification des problèmes d’articulation entre vie familiale et vie professionnelle. Nous étudierons ces effets en termes de disparités sur le marché du travail. Nous nous intéresserons aux disparités sur le marché du travail non seulement entre hommes et femmes, mais aussi entre femmes.
1.1. L’effet des naissances sur le parcours professionnel des femmes
Les différences de carrière entre hommes et femmes s’expliquent en grande partie par l’inégale répartition des tâches parentales entre parents. Nous montrons comment les naissances affectent les parcours professionnels des hommes et des femmes.
1.1.1. DES PARCOURS PROFESSIONNELS CONTRASTES SELON LE SEXE
Les travaux sur la division du travail domestique au sein du ménage ont montré que la venue d’enfants est une étape déterminante de la recomposition des rôles au sein des couples. Les naissances sont l’occasion de nouveaux arbitrages entre engagements familiaux et professionnels. Les profils de carrière entre conjoints s’éloignent ainsi de façon très nette au fil des naissances, les ajustements suivant la naissance reposant essentiellement sur les femmes (Pailhé et Solaz, 2007) : l’année suivant une naissance, 40% des mères qui travaillaient connaissent un ajustement professionnel lié à la naissance pour seulement 6% des pères.
a) Les carrières des couples
Nicolas Robette, Ariane Pailhé et Anne Solaz analysent l’effet des naissances à plus long terme. Il s’agit d’étudier la division du travail au sein des couples entre secteurs marchand et non marchand tout au long du cycle de vie, à partir de la formation du couple. Il s’agit aussi de mettre en évidence des typologies de couples en fonction de leurs trajectoires professionnelles, du nombre et du rythme de la venue de leurs enfants. Quels types de carrière poursuivent les hommes et femmes en couple ? A quel moment l’écart entre les carrières des deux conjoints se creuse-t-il ? Quels sont les couples qui ont une carrière comparable ? Quels sont ceux dans lesquels s’opère une spécialisation des rôles ? Quelles sont les caractéristiques des conjoints qui déterminent l’appartenance à tel ou tel type de couple ?
La variété des profils de parcours est caractérisée et synthétisée au moyen des nouvelles méthodes d’analyse des trajectoires. Les méthodes d’appariement optimal permettent de comparer des séquences sans présumer de relations de cause à effet (Abbott, 1995 ; Abbott et Tsay, 2000 ; Lesnard et de Saint-Pol T., 2006). Le calendrier rétrospectif des événements familiaux et professionnels de l’enquête Familles et employeurs (Ined, 2005) est mobilisé.
Les premiers résultats montrent une très forte hétérogénéité des parcours des couples, 11 profils pouvant être distingués. Cette hétérogénéité repose sur la variété des parcours professionnels des femmes et des rythmes des naissances. En revanche, les parcours des hommes en couple sont très uniformes. Un poster présentera ces premiers résultats en septembre 2009 au colloque de l’IUSSP. Un document de travail sera rédigé, une soumission étant prévue fin 2010.
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
b) L’hétérogénéité des carrières féminines
Ariane Pailhé et Anne Solaz précisent les disparités de carrières entre femmes. Elles s’intéressent plus particulièrement aux types de réorganisation de la vie professionnelle suite à une naissance et à leurs déterminants, en étudiant tout particulièrement l’effet des caractéristiques de l’emploi occupé par la mère avant la naissance : emploi salarié ou indépendant, privé ou public, stable ou précaire. Le type d’ajustement suivant la naissance dépend-il du type d’emploi occupé ? Les durées d’interruption d’activité et les modalités de retour à l’emploi après la naissance différent-elles pour les salariées en emploi précaire et celles en emploi stable ? Il s’agit d’étudier dans une perspective longitudinale si les inégalités d’emploi en début de carrière se creusent avec la naissance d’enfants, et s’il existe un cumul des inégalités.
Les données de l’enquête Familles et employeurs (INED, 2005) sont mobilisées et des modèles de durées sont estimés (modèle semi-paramétrique de Cox, modèle discret). Un premier document de travail a été réalisé et sera traduit pour être soumis dans une revue internationale à comité de lecture.
1.1.2. MODES DE GARDES ET EMPLOI DES MERES
a) Une comparaison entre la France et Israël.
L’emploi des mères de jeunes enfants dépend aussi des modes de garde disponibles. Olivia Ekert-Jaffé et Haya Stier analysent comment les modes de garde affectent les formes d’emploi des mères (temps du retour sur le marché du travail, emploi à temps partiel et/ou dans un secteur qui facilite la conciliation entre travail et famille….). Elles étudient en quoi le choix du mode de garde et l’effet des modes de garde sur l’activité sont influencés par le contexte institutionnel et la religiosité. Deux pays sont ici comparés, la France et Israël. Les deux sociétés sont classées comme familalistes (King, 2002) et offrent une aide conséquente à l’emploi des mères (Thévenon, 2009, Stier et al. 2001). Elles diffèrent cependant par les caractéristiques de la famille : par exemple, les Israéliennes sont le plus souvent mariées institutionnellement et leur fécondité est plus élevée (Ekert-Jaffe et Stier, 2009; Israël, 2008). De même, le rôle de la religiosité dans le lien entre activité et fécondité pourrait diverger dans les deux pays, puisqu’en Israël, la fécondité constitue moins un obstacle à l’activité pour les femmes orthodoxes que pour l’ensemble de la population.
Les données mobilisées sont l’enquête Familles et employeurs pour la France, et l’enquête « Mères 2000» pour Israël. Le projet devrait commencer à l’automne 2010, à l’occasion de l’accueil de Haya Stier à l’Ined.
b) Une comparaison entre la France et la Hongrie
En faisant une analyse comparative entre la France et la Hongrie, Szuszanna Makay propose dans sa thèse d’expliquer les différences de fécondité entre ces pays par l’activité ou l’inactivité des parents après une naissance. En effet, en Hongrie les femmes ont plus tendance qu’en France à cesser leur activité professionnelle dès la naissance du premier enfant. L’objectif est d’observer les comportements des parents après une naissance et d’étudier les déterminants qui influent sur l’activité et son éventuelle cessation : les déterminants socio-économiques, démographiques et les
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
possibilités de mode de garde. C’est d’une part l’influence des naissances successives sur la trajectoire professionnelle qui sera étudiée, et d’autre part, l’influence de l’activité sur la fécondité, avec l’hypothèse que certaines professions et situations sont plus favorables à la venue des enfants que d’autres
1.2. L’effet des naissances sur les écarts de salaire entre hommes et femmes
Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’effet des naissances sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Les enfants peuvent avoir une influence directe sur la productivité de leur mère (Becker, 1985), dans la mesure où ils absorbent une large part de leur énergie. Les enfants peuvent aussi avoir une influence indirecte: les mères qui interrompent leur carrière accumulent moins de capital humain. Les mères sont également plus susceptibles de travailler à temps partiel ce qui, peut restreindre leurs opportunités d’emploi. Elles peuvent choisir des emplois ou des entreprises qui leur permettent de mieux concilier emploi et famille, au prix d'une moins bonne rémunération (Filer, 1985). Les mères peuvent aussi faire l'objet de discrimination sur le marché du travail (discrimination statistique notamment). Les mères peuvent avoir des caractéristiques intrinsèques qui sont corrélées avec un moindre désir de faire carrière (Hakim, 2003). Ces différentes explications vont être analysées ici.
1.2.1. LES CONSEQUENCES DES INTERRUPTIONS DE CARRIERE
a) DUREE DES INTERRUPTIONS DE CARRIERE ET ECARTS DE SALAIRES ENTRE HOMMES ET FEMMES
Les interruptions de carrière, particulièrement celles liées aux congés de maternité et parental, sont souvent avancées comme un des facteurs explicatifs des écarts de salaires entre les hommes et les femmes. En effet, suite à leurs interruptions de carrière, les femmes accumulent moins d’expérience professionnelle que leurs homologues masculins. Les interruptions peuvent également jouer sur leurs choix d’employeurs et les détourner des carrières dans lesquelles les interruptions professionnelles sont lourdement pénalisées. D’un autre côté, le chômage ou l’inactivité ne sont pas sanctionnés de manière similaire pour les hommes et les femmes (Le Minez et Roux, 2002). Il est généralement difficile de chiffrer ces effets : peu de bases de données fournissent le calendrier professionnel nécessaire au calcul de l’expérience réelle. Une comparaison entre expérience potentielle et expérience effective à partir de l’enquête Jeunes et Carrières (1997) a montré que l’expérience des femmes salariées était effectivement surévaluée lorsqu’on s’en tenait à l’expérience potentielle et que le rendement de cette composante était par conséquent sous-estimé (Meurs-Ponthieux, 2000).
Dominique Meurs, Ariane Pailhé et Sophie Ponthieux reviennent sur cette question en exploitant des données récentes, l’enquête Famille-Employeurs (2005). Cette enquête offre la possibilité de connaître avec précision la participation au marché du travail depuis l’âge de 18 ans, les passages par l’inactivité ou le temps partiel, le déroulement de la vie familiale et la survenue des enfants. La recherche proposée ici s’articule autour des questions suivantes : dans quelle mesure les interruptions de carrière pénalisent-elles les femmes salariées en raison d’une moindre
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
accumulation d’expérience professionnelle par rapport aux salariés masculins (effet de structure) ? Observe-t-on un moindre rendement de l’expérience pour les femmes (effet prix)? La méthode employée est l’estimation d’équations de gains corrigées du biais de sélection et la décomposition des écarts de gains.
On ne constate pas d’impact direct négatif des enfants sur les salaires horaires courants des femmes. En revanche, les interruptions d’activité sont plus pénalisantes pour les femmes que pour les hommes, toutes choses égales par ailleurs. On a donc un cumul des effets de structure et de prix. Pour une sous-population de femmes et d’hommes âgés de 39 à 49 ans, l’écart des salaires entre les hommes et les femmes qui n’ont jamais quitté le marché du travail est entièrement « inexpliqué », tandis que l’écart des salaires entre les femmes qui n’ont jamais quitté le marché du travail et celles qui ont interrompu leur carrière est entièrement dû aux différences de caractéristiques entre ces deux groupes. Cet article a été soumis à l’automne 2008 et est en cours de révision.
b) CALENDRIER DES INTERRUPTIONS DE CARRIERE ET ECARTS DE SALAIRES ENTRE HOMMES ET FEMMES
Dominique Meurs, Ariane Pailhé et Sophie Ponthieux envisagent une extension de cette recherche. L’objectif est ici d’étudier le rôle de la phase du cycle de vie durant laquelle ont lieu les interruptions de carrière. Est-il plus ou moins pénalisant pour les femmes d’avoir les enfants lorsqu’elles sont jeunes et d’interrompre leur activité en début de carrière ? Ou vaut-il mieux d’abord faire carrière, puis avoir des enfants ? Avoir des enfants rapprochés est-il plus « rentable » ? Le calendrier des naissances et des interruptions d’activité de l’enquête Familles et employeurs sera ici mobilisé. Ce projet débutera en 2010.
c) LE « FAMILY GAP » EN EUROPE
L'écart de rémunération entre hommes et femmes dû aux enfants varie beaucoup selon le contexte institutionnel, notamment en raison de la variété de l’offre de garde. Les analyses comparatives font cependant défaut. Ariane Pailhé et Anne Solaz cherchent ici à prendre en compte le rôle des normes sociales en vigueur et le contexte institutionnel en menant une analyse comparative des pays européens. Elles mesurent l’ampleur de la perte de salaire due à la présence d’enfant en traitant la question de l'hétérogénéité inobservable des femmes. Cette question de l'hétérogénéité inobservée des femmes a été peu étudiée empiriquement et les résultats empiriques sont partagés : ce bais n’est pas significatif pour certaines études (Waldfogel, 1998, Albrecht et al, 1999 & Korenman et Neumark, 1994), il l’est pour d’autres. Cette question demande donc à être approfondie.
Les données de l’enquête européenne SILC seront mobilisées pour cette étude. Ce projet se situe dans le cadre du projet ANR GIndihla et fera l’objet d’un recrutement de post-doctorant.
1.2.2. CHOISIR DES EMPLOIS « FAMILY FRIENDLY » AU PRIX D’UN SALAIRE INFERIEUR ?
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
Une explication de la sur-représentation des femmes dans certains emplois, et notamment dans le secteur public, est qu'elles choisissent des emplois leur permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle : des emplois proches du domicile, aux horaires souples. La théorie économique des «prix hédoniques», explique le niveau inférieur des salaires féminins par leur choix d'emplois qui les aident à concilier travail et vie familiale.
Ariane Pailhé et Anne Solaz se proposent d’examiner si les salaires sont effectivement plus bas dans les entreprises qui permettent à leurs employés de mieux concilier travail et famille et de mesurer le poids de ces pratiques «family friendly» dans les écarts de gains entre hommes et femmes. Différentes modalités de l’articulation seront distinguées (offre d’avantages en nature, prestations financières, souplesse horaire, etc.). La typologie des établissements effectuée en amont sera mobilisée, ainsi que les données couplées de l’enquête familles et employeurs (INED, 2005).
Cet article a fait l’objet d’un poster au colloque de l’ESPE 2009 et d’une présentation en groupe de travail du projet ANR Gindihla en 2009, il sera retravaillé pour une soumission prévue en 2010.
1.2.3. DES BARRIERES POUR ACCEDER AUX EMPLOIS LES MIEUX REMUNERES ?
Une importante littérature s’est développée sur la mesure des différences de salaires entre hommes et femmes à compétences égales. Les écarts sont souvent plus larges dans le haut de la distribution des salaires, comme le montrent des régressions quantiles (cf. par exemple, Albrecht, Bjorklund et Vroman, 2003). On considère généralement que ce phénomène résulte d’un « plafond de verre » tel que les femmes n’auraient pas accès aux emplois les mieux rémunérés. Le lien entre les résultats des régressions quantiles et leur interprétation n’est cependant pas justifié par des arguments théoriques, et un modèle économique est nécessaire pour obtenir des conclusions fiables. Laurent Gobillon, Dominique Meurs et Sébastien Roux (CREST-PSE) se proposent de construire un tel modèle et d’estimer ses paramètres sur les données exhaustives des Déclarations Annuelles des Salaires pour des cadres en milieu de carrière. Leur modèle repose sur l’existence d’une concurrence entre hommes et femmes pour les emplois, sachant que les hommes sont plus souvent sélectionnés pour les emplois les mieux rémunérés. En conséquence, il existe un report des femmes non sélectionnées vers les emplois moins bien rémunérés. Le modèle permet de prédire la répartition des hommes et des femmes dans la distribution des emplois selon le niveau de rémunération, tout en tenant en compte les phénomènes de report.
A partir du modèle, il est possible de construire un estimateur non-paramétrique de la différence d’accès aux emplois pour les hommes et les femmes selon la position des emplois dans la distribution globale des salaires. Une estimation de cette fonction d’accès a été effectuée à partir des données exhaustives des Déclarations Annuelles des Salaires, 2003, pour les cadres à temps plein âgés de 40 à 45 ans. Les résultats montrent que l’accès des femmes aux emplois décroit avec le rang des emplois dans la distribution de salaires, ce qui est compatible avec un effet de plafond de verre. En bas de la distribution de salaires, la probabilité d’une femme d’obtenir un emploi est 12% plus basse que celle d’un homme. La différence de probabilité est bien plus importante en haut de la distribution de salaire et atteint 50%. Les travaux seront publiés sous forme de document de travail sous peu. Une soumission dans une revue internationale à comité de lecture est envisagée en 2010.
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
Une extension de ce travail est prévue à partir des fichiers des ressources humaines d’une grande entreprise française, comprenant des informations sur les grades et les salaires. Il s’agit de quantifier les différences d'accès à l'emploi entre hommes et femmes au sein d'un grade donné, et entre grades. En effet, pour un grade donné, il existe plusieurs types d'emploi qui sont rémunérés différemment. Les femmes peuvent ne pas avoir accès à certains de ces emplois. De plus, les femmes peuvent ne pas avoir accès à certains grades, en particulier ceux correspondant aux emplois les mieux rémunérés (il y a dans ce cas un phénomène de plafond de verre). Le projet commencera en septembre 2009.
1.3. Impact des ruptures d’union sur les parcours professionnels des hommes et des femmes
1.3.1. PLUS DE PRECARITE APRES UNE SEPARATION ?
Alors même que la fréquence des dissolutions de couple est aujourd’hui très importante, il n’existe à notre connaissance aucune recherche en France étudiant les conséquences d’une rupture d’union (divorce, séparation) sur les parcours professionnels des ex-conjoints. Analyser l'interaction des parcours professionnels et familiaux est pourtant nécessaire, par exemple pour anticiper ce que pourrait être la future situation économique des divorcé(e)s ou séparé(e)s à la retraite. En effet, les générations ayant connu de forts taux de divorce ne commencent à arriver à l'âge de la retraite qu'aujourd'hui.
A partir des données de l’enquête Jeunes et Carrières et de l’enquête Familles et Employeurs, Carole Bonnet et Anne Solaz étudient en quoi une rupture d’union influe sur l’activité des femmes et des hommes : interruption, reprise, augmentation ou diminution des heures de travail. Cette recherche vise aussi à définir l’horizon temporel de cette influence. Par ailleurs, l’effet des caractéristiques individuelles sur les trajectoires sera analysé. Cette recherche a fait l’objet d’une recherche méthodologique sur les méthodes d’appariement (matching and treatment group). Pour étudier la trajectoire professionnelle après divorce, il est en effet nécessaire de savoir comment se seraient comportés les individus sur le marché du travail s'ils n'avaient pas divorcé. Cet article a été soumis début septembre 2009.
1.3.2. CHOMAGE ET RISQUE DE DISSOLUTION DES COUPLES
Dans la lignée des travaux économiques sur la dissolution des couples, le travail d’Andrew Clark et Anne Solaz vise à tester plusieurs hypothèses quant à l’effet des variables économiques sur le risque de dissolution du couple. Le chômage n’affecte-t-il le couple qu’à travers ses seuls effets monétaires ou bien les effets de norme sociale jouent-ils? Constate-t-on des effets d’habitude (avoir résisté une fois au chômage consolide le couple) ou au contraire des effets cumulatifs (plus le chômage est long et fréquent, plus le risque de dissolution augmente) ? Le second objectif est de mobiliser les indicateurs subjectifs de bien-être individuel (calculés à partir d’un ensemble de questions sur la santé, l’aisance financière, le sentiment vis à vis de l’emploi) afin d’estimer si un chômeur est plus satisfait en couple que célibataire. Une troisième partie sera consacrée à
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
l’influence des variables macro-économiques sur la vie familiale (conjoncture économique, taux de divorce, taux de chômage régionaux. Les différences de caractéristiques (âge, revenus, éducation…) ou de comportement (quantité de travail domestique) entre conjoints affectent-ils la stabilité des couples ? Une analyse longitudinale est menée sur le British Household Panel Survey (1991-1999). Ce projet a pris du retard en raison de la difficulté à rendre cohérent les informations annuelles sur l’histoire familiale. Mais depuis peu, le calendrier conjugal est apuré, documenté et disponible. Il est donc possible de mener à terme ce projet.
Anne Solaz souhaite aussi actualiser ses travaux sur l’impact du chômage sur la stabilité des couples à partir des données de l’enquête Familles et Employeurs.
2. L’INTEGRATION DES IMMIGRES ET DE LEURS DESCENDANTS SUR LE MARCHE DU TRAVAIL
Après la Seconde Guerre Mondiale, la reconstruction du pays nécessitait une main-d'œuvre importante ; l'immigration a été encouragée pour pallier le manque de travailleurs. Ainsi des populations étrangères, notamment d'origine maghrébine, ont-elles migré en France pour bénéficier des opportunités offertes sur le territoire. Les travailleurs, principalement des hommes, ont généralement été rejoints par leur famille après un séjour suffisamment prolongé sur le sol français dans le cadre du regroupement familial. Les règles de migrations se sont durcies en 1974 suite à la crise économique et l'ouverture des frontières a varié ensuite selon le gouvernement en place.
A partir des années soixante-dix, l'accès à l'emploi devient plus difficile pour les immigrants. La demande de travail diminue et il existe souvent une inadéquation entre les qualifications des emplois proposés et le niveau de diplôme des travailleurs immigrés. Ces difficultés, déjà importantes, sont accompagnées de phénomènes de discrimination. Les enfants d'immigrés peuvent connaître un sort plus heureux s'ils arrivent à bénéficier du système d'éducation français. Il n'en demeure pas moins que nombre d'entre eux n'ont pas la possibilité de faire des études par manque de ressources. En outre, même si certains sortent diplômés de l'université, les problèmes de discrimination subsistent.
La situation actuelle des immigrés et de leurs descendants demande à être précisée. En particulier, il convient de s'interroger sur les disparités d'accès à l'emploi, en tenant notamment compte de la localisation de ces populations.
2.1. Les inégalités d’accès à l’emploi selon l’origine
La littérature sur les inégalités d’accès à l’emploi selon l’origine en France s’est rapidement développée ces dernières années. Elle révèle de très fortes inégalités. Il convient de s'interroger sur les problèmes d'accès à l'emploi lorsque les travailleurs cumulent les handicaps dus à la discrimination sur le marché du travail en étant en même temps d’origine immigrée et de sexe féminin. Par ailleurs, on peut approfondir l’analyse en s’interrogeant sur l’accès à des emplois particuliers. L'accès aux emplois du public revêt une importance particulière car il est nécessaire pour assurer une bonne représentation des immigrés par les autorités publiques.
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
2.1.1. LE CUMUL DES INEGALITES DE GENRE ET D’ORIGINE
Si de nombreuses études ont établi que les « secondes générations » issues de parents maghrébins subissent des discriminations dans l’emploi, la situation particulière des femmes de la seconde génération maghrébine est beaucoup moins connue. Dominique Meurs et Ariane Pailhé exploitent les bases de données FQP 2003 et des enquêtes Emploi 2005-2007 pour aborder la question du rôle respectif des facteurs « genre » et « origine » dans l’obtention d’un emploi. Existe-t-il ou non un désavantage accru pour les femmes issues de l’immigration maghrébine dans le risque de chômage ou d’inactivité par rapport aux autres groupes d’origine et de sexe, une fois prises en compte les caractéristiques observables ?
Les résultats montrent que les femmes issues de l’immigration maghrébine forment un groupe plus exposé au risque de chômage que les catégories d’hommes et de femmes de parents d’Europe du Sud ou natifs. A l’intérieur de chaque groupe d’origine, le risque d’être au chômage est d’une ampleur comparable pour les femmes et les hommes. Malgré leur investissement éducatif, les descendantes du Maghreb ne « bénéficient » donc pas d’une réduction du désavantage d’être une femme dans l’obtention d’un emploi. Enfin, alors que les descendantes de parents d’Europe du Sud ont le même risque de chômage et d’inactivité que les descendantes de « natifs », les descendantes du Maghreb sont de loin plus exposées au chômage et à l’inactivité. Ce travail est en cours de révision pour la revue Economie et Statistique.
2.1.2. UN ACCES DIFFERENCIE A LA FONCTION PUBLIQUE SELON L’ORIGINE ?
Dans la réflexion sur la place occupée par les immigrés et de leurs descendants sur le marché du travail, les emplois de la fonction publique constituent un champ particulier de recherche. En effet, ce secteur repose sur des règles d’embauche et de déroulement de carrière différentes de celles du privé. Le recrutement des fonctionnaires se fait par concours et la progression salariale est fortement liée à l’ancienneté. Ce mode de gestion de la main d’œuvre s’appuie sur deux principes affirmés à maintes reprises : un idéal républicain de méritocratie – via le concours ouvert à tous –, et l’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps, quelles que soient les conditions de travail dans les postes d’affectation au cours de la carrière.
Or on constate que les immigrés et leurs descendants sont sous-représentés parmi les fonctionnaires titulaires (Meurs, Pailhé et Simon, 2006). La sous-représentation des immigrés peut en partie s’expliquer par les conditions de nationalité française ou européenne, par les limites d’âge qui ont longtemps été en vigueur pour passer les concours, par d’éventuelles difficultés dans la maîtrise du français et par les particularités des épreuves écrites auxquelles les personnes issues d’un autre système éducatif sont peu préparées. Mais ces explications ne peuvent s’étendre aux secondes générations car elles sont françaises et éduquées en France.
La sous-représentation des immigrés et de leurs descendants dans la fonction publique pose deux problèmes politiques majeurs. Tout d’abord, les concours sont-ils un mode de sélection neutre vis-à-vis des origines, à l’oral comme à l’écrit, et remplissent-ils bien l’objectif affiché d’égalité des chances des candidats face à la sélection ? En d’autres termes, l’Etat donne-t-il l’exemple en matière de recrutement non discriminatoire ? Ensuite, les salariés de la fonction publique peuvent-
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
ils ne pas être représentatifs de la société sans que cela nuise à l’accomplissement de leur mission (thème de la bureaucratie représentative) ?
A plus long terme se pose aussi la question de l’évolution des modes de gestion de la main d’œuvre dans la fonction publique. Les modes d’entrée se diversifient : les conditions d’âge n’existent plus, les possibilités d’entrées comme contractuels s’élargissent, et les affectations des lauréats aux concours sont davantage décentralisées, avec un rôle actif donné aux services locaux des ressources humaines dans le recrutement final. Les politiques de rémunération tendent aussi vers plus d’individualisation, soit par la reconnaissance des difficultés spécifiques de certains postes ou fonctions, soit par évaluation des performances individuelles. Se rapprochant des pratiques du secteur privé, la fonction publique fait face aux mêmes préoccupations de traitement non discriminatoire de ses salariés. Il est donc important d’examiner si des inégalités de traitement selon l’origine s’observent actuellement et pourquoi.
Le thème de la « diversité et fonction publique » est actuellement abordé dans le cadre d’une enquête sur la police nationale et d’une enquête sur les candidats à la fonction territoriale.
a) La police nationale
Les différences de déroulement de carrière dans la fonction publique selon l’origine constituent un premier objet d’investigation. Etudier les deuxièmes générations suppose de collecter des informations sur les lieux de naissance et la nationalité des parents des personnes enquêtées. Ces données ne sont pas enregistrées dans les fichiers du personnel. Les bases de données publiques (enquête emploi, FQP,…) ne sont pas assez grandes pour que l’on puisse analyser statistiquement la double dimension – fonction publique et seconde génération.
Un premier contrat en 2007 avec l’Acsé (« Construction d’une méthodologie d’observation de l’accès et du déroulement de carrière des générations issues de l’immigration dans la fonction publique ») a permis à Dominique Meurs et Patrick Simon de mener une enquête spécifique auprès des 6600 salariés d’une administration publique (les agents de la municipalité de Nantes) afin de recueillir via un questionnaire des informations individuelles sur l’ascendance, le milieu social, et le parcours scolaire et professionnel. Le taux de réponse – 24,3%, soit 1605 réponses – est dans l’ordre de grandeur attendu, mais la rareté de la catégorie « descendant d’immigré » (80 personnes, soit 5% des répondants) limitait l’analyse statistique. L’enquête a été reconduite fin 2008 à plus grande échelle par Dominique Meurs et François Héran auprès des agents du ministère de l’intérieur1, via l’envoi d’un questionnaire postal à un échantillon représentatif de 18700 agents (soit 10% des salariés de ce ministère). Le taux de réponse est du même ordre de grandeur que précédemment (24%), mais la taille de l’échantillon est cette fois-ci suffisante pour permettre une analyse statistique des différences de déroulement de carrière selon l’origine et le sexe. Des questions subjectives permettent également d’avoir une idée sur la perception de comportements discriminatoires sur le lieu de travail. Un rapport sera rendu début novembre 2009.
1 L’enquête était demandée par le ministère de l’Intérieur et a été approuvée par l’observatoire de la diversité et de
la parité de ce ministère.
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
b) LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Une deuxième voie de réflexion porte sur l’accès des secondes générations au concours de la fonction publique et leur probabilité de réussite. Toujours dans le cadre du contrat avec l’Acsé (voir projet P0825), Dominique Meurs, Patrick Simon et Mireille Eberhard ont suivi des candidats au concours des IRA (catégorie A) en 2008, depuis la première épreuve écrite jusqu’à l’issue du concours. Un questionnaire a été distribué à tous les candidats lors de la première épreuve, avec des questions sur leur origine et leur parcours antérieur. 60% d’entre eux ont répondu. Les renseignements ainsi collectés ont été appariés avec les résultats (écrits et oraux du concours) pour 2865 personnes. L’exploitation de la base de données obtenue a débuté. Les résultats montrent que les secondes générations d’origine maghrébine ou africaine sont présentes parmi les candidats dans des proportions correspondant à leur poids dans la population française, mais qu’elles sont proportionnellement moins nombreuses à être admissibles à l’oral que les autres candidats. Aucune différence n’apparaît aux épreuves orales. L’épreuve écrite de culture générale apparaît comme la plus difficile à franchir pour les secondes générations d’origine maghrébine ou africaine, toutes choses égales par ailleurs. Dominique Meurs et Patrick Puhani (Université de Hanovre) réalisent des exploitations complémentaires de cette base en étudiant l’effet de la composition des jurys sur les résultats à l’oral. Cela donnera lieu à un article soumis à une revue anglo-saxonne.
La base de données, actuellement anonyme, peut avoir une utilisation secondaire très fructueuse en récupérant les noms et prénoms des candidats auprès de la DGAFP. En effet, il est alors possible de tester si la catégorisation patronymique recoupe la catégorisation utilisant l’ascendance des parents. Très peu de bases permettent de confronter une classification onomastique avec les déclarations sur les lieux de naissance et la nationalité, si bien que la validité des classements à partir des noms n’est jamais testée. La robustesse de l’effet de l’origine sur la réussite au concours peut aussi être vérifiée en utilisant la classification patronymique pour définir l’origine. Une telle approche est particulièrement importante pour confirmer les résultats obtenus pour l’oral, le jury des oraux ne disposant que des noms et prénoms. Une demande est en cours à la CNIL pour lever l’anonymat sur la base IRA.
2.1.3. DIVERSITE A FRANCE TELEVISIONS
Dans le prolongement des méthodes expérimentées pour la Fonction publique, une enquête spécifique sur la mesure de la diversité et les inégalités de carrière selon le sexe et l’origine a été commandée par la Halde à l’Ined. L’enquête a lieu début octobre 2009; un rapport sera rendu à la Halde en décembre. Ce travail a pour premier objectif d’étudier les inégalités de salaire selon le sexe et l’origine des salariés et d’estimer la part non expliquée par les caractéristiques productives (éducation, expérience, ancienneté, conditions de travail…). Le second objectif est de fournir des informations sur le ressenti d’éventuelles discriminations et les formes qu’elles peuvent prendre. Enfin, l’enquête permettra d’avoir un retour qualitatif sur les questions sur l’origine et leur degré d’acceptation par les salariés.
2.2. Emploi et inégalités territoriales
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
Les difficultés que rencontrent les immigrés à s’insérer sur le marché du travail peuvent dépendre de leur lieu de résidence. En effet, les réseaux sociaux sont souvent localisés. De plus, les immigrés pauvres résident principalement dans des quartiers où l’activité professionnelle n’est pas valorisée par la norme sociale. Enfin, la discrimination territoriale (délit de sale adresse) pénalise les populations de certains quartiers défavorisés où sont concentrés les immigrés pauvres. Il convient donc de préciser le rôle de l’espace dans le processus d’obtention d’un emploi des populations immigrées. Réciproquement, on peut s’interroger sur l’effet de l’intégration sociale sur la localisation des immigrés et de leurs descendants.
2.2.1. LES INEGALITES SPATIALES DE RETOUR A L’EMPLOI SELON LA NATIONALITE
Il existe encore peu d’études sur l’effet de la localisation sur le retour à l’emploi des immigrés chômeurs. Laurent Gobillon, Thierry Magnac (Université de Toulouse) et Harris Selod (INRA-LEA) ont donc entrepris des analyses quantitatives pour la région Ile-de-France. L’objectif est de mieux comprendre les sources spatiales du chômage des populations immigrées urbaines et périurbaines.
La base de données mobilisée pour cette étude est le Fichier Historique Exhaustif de l’ANPE (1993-2003) qui regroupe des informations socio-économiques sur tous les épisodes de chômage des individus inscrits, dont la commune de résidence. Il autorise donc l’identification de l’effet de chaque commune d’Ile-de-France sur la sortie du chômage. Par ailleurs le fichier contient la nationalité des chômeurs, ce qui permet de s’intéresser aux populations étrangères. Il n’est en revanche pas possible d’identifier les immigrés stricto sensu car le pays d’origine n’est pas reporté.
Il est donc possible de déterminer l’effet de chaque commune sur le retour à l’emploi pour chaque sous-groupe de nationalités, toutes choses égales par ailleurs. Une seconde étape de l’analyse consiste à expliquer ces effets communaux par des variables de ségrégation et d’accès à l’emploi.
L’étude est en particulier menée pour trois sous-groupes de nationalité : les Français, les Maghrébins, et les Africains Sub-sahariens. Des résultats préliminaires montrent que les disparités spatiales sont importantes pour tous les groupes de nationalités. Il existe par ailleurs un assortiment spatial des Africains désavantagés par leurs caractéristiques observables dans les communes désavantagées. Les communes défavorables au retour à l’emploi pour les Français sont souvent défavorables pour les Africains. Enfin, l’effet négatif de la part locale d’Africains Sub-sahariens sur les effets fixes communaux est bien plus faible pour les Africain Sub-sahariens (et même non significatif) que pour les français. Cette différence suggère des effets de réseaux pour les Africains Sub-sahariens qui bénéficieraient de la présence de populations de même nationalité. Un document de travail contenant ces résultats est prévu pour 2010 et sera soumis pour publication.
2.2.2. UN EMPLOI PLUS QUALIFIE PERMET-IL AUX IMMIGRES ET A LEURS DESCENDANTS DE MIEUX SE LOGER ?
Le degré d’intégration des immigrés et de leurs descendants sur le marché du travail a un effet sur leurs capacités financières à pouvoir se loger dans de bonnes conditions. Outre la taille et la qualité
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
du logement, la localisation revêt une importance particulière puisqu’elle influence l’accès aux opportunités d’emploi futures et aux aménités locales (parcs, infrastructures sportives et culturelles, etc.). Dans cette perspective, une accession sociale à des emplois plus qualifiés peut permettre aux immigrer de déménager dans des logements de meilleure tenue et mieux localisés. Matthieu Solignac se propose dans le cadre de sa thèse d’analyser l’effet de l’accession sociale sur la mobilité résidentielle et les choix de logement des immigrés et de leurs descendants. L’Echantillon Démographique Permanent (1968-1999) est utilisé car il permet d’assurer le suivi sur longue période de trajectoires résidentielles tout en fournissant des informations et des effectifs suffisamment importants d’immigrés et de leurs descendants pour mener des analyses détaillées.
Dans une première approche, la localisation communale des immigrés et de leurs descendants sera analysée tout comme son évolution au cours du temps. Ce sera l’occasion de vérifier le phénomène de dispersion à partir des zones d’installation initiales et sa vitesse selon les communautés. L’idée d’une « segmentation de l’espace » selon le niveau social et l’origine sera également testée. L’analyse des caractéristiques socio-économiques des espaces où se concentrent les populations d’origine immigrée reste insuffisante pour caractériser le phénomène. Est-ce le résultat d’une volonté de vivre « entre soi » manifestée par l’ensemble des sous-groupes composant la population ? Ou est-ce plutôt le résultat d’une compétition générale pour les meilleurs quartiers dont les quartiers les plus défavorisés sont la résultante ? L’idée d’une « balkanisation » des espaces n’est valide que si les populations d’origine immigrée se distinguent par une mobilité interne particulière. Dès lors que les mêmes zones sont évitées ou fuies, elle ne tient plus. Dans le cas où les proportions d’immigrés et de leurs descendants restent fortes dans certaines zones, il convient d’analyser les trajectoires individuelles pour distinguer zone d’installation temporaire et zone de relégation potentiellement durable. Ce n’est qu’à l’issue de ces analyses qu’un constant en terme de « ségrégation » pourra être fait.
La deuxième approche consistera à étudier les caractéristiques des logements occupés par les populations immigrés. Leur évolution peut être utilisée comme indicateur de mobilité sociale et d’intégration. Le salaire joue généralement ce rôle dans les études économiques. Mais la qualité du logement peut donner des informations sur les conditions de vie réelles, en prenant en compte la consommation effective. En particulier, les études sur le rôle du lieu de vie dans la réussite scolaire des enfants mettent en avant l’importance des caractéristiques du quartier mais également l’importance des caractéristiques du logement (comme le nombre de pièces par personnes).
Enfin, le parcours résidentiel sera étudié au regard de la vie en couple (analysée par l’intermédiaire des mariages mais aussi des naissances enfants). L’exogamie peut être une opportunité de mobilité sociale dont il convient d’observer le résultat au niveau spatial. D’autre part, le taux de mariages (ou d’unions donnant naissance à des enfants) entre populations descendant d’immigrés et de natifs peut être un indicateur d’interactions entre ces groupes. Cette information est rarement disponible et les caractéristiques des quartiers sont souvent utilisées comme approximation de ces interactions. La composition des couples en termes d’origine fournit ici un indicateur plus direct. Le cadre d’une telle approche anthropologique a notamment été développé par E. Todd et mérite d’être utilisé plus systématiquement.
2.2.3. COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL AUX IMMIGRES POUR S’INTEGRER ?
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
Alors que très récemment en France la préoccupation première était de disposer de données d'enquêtes quantitatives pour étudier de façon objective la complexité du phénomène migratoire et les conditions d'insertion des immigrés, les enquêtes MGIS et TEO (Trajectoire et Origine, Ined-Insee, 2009) élargissent les possibilités d’analyse en fournissant des données quantitatives sans précédent sur les immigrés en France. Dorénavant, le besoin se déplace sur la construction d'outils théoriques et empiriques permettant de formuler et de tester la notion d’assimilation économique des immigrés sur le marché du travail français et d'identifier les variables clés d'une « assimilation réussie ».
Aziz Belhassaini va étudier l’assimilation des immigrés dans le cadre de sa thèse. La réflexion s’inspire des développements théoriques et empiriques pionniers sur cette question aux Etats-Unis (Chiswick 1978 ; Carliner 1980 ; De Freitas 1980 ; Long 1980 ; Borjas 1982) et des développements plus récents sur la question de la convergence relative des salaires des immigrés par rapport aux natifs aux Etats-Unis (Beenstock et al 2005 ; Borjas 2000 ; Chiswick, 2008).
De nombreux travaux ont tenté de tester l’'hypothèse d'assimilation des immigrés, définie comme le processus par lequel les salaires des immigrés rattrapent ceux des natifs au fil du temps, ceteris paribus. Si le concept est relativement simple, sa mesure pose de redoutables difficultés. Il faut en effet corriger les estimations des effets de cohortes, prendre en compte le fait que les immigrés qui s'installent durablement ont des caractéristiques particulières par rapport à leur population d'origine ou aux vagues plus récentes de migrants. Il est possible de traiter une partie de ces difficultés en utilisant deux sources de données décalées dans le temps afin de différencier les effets de cohortes et les effets d'âge. Plus ces données sont riches, mieux les caractéristiques observables sont prises en compte. Les enquêtes MGIS et TeO permettent non seulement de proposer différentes mesures de l’assimilation économique des immigrés et d’évaluer l’effet de certains facteurs (comme la connaissance préalable de la langue), mais aussi d’évaluer l’impact des chocs liés aux changements de politiques d’immigration sur les rythmes d’assimilation.
3. CRISE ECONOMIQUE ET EVOLUTION DES DISPARITES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL
Même si on ignore encore son ampleur et sa durée, la crise économique actuelle va modifier de manière importante et durable les conditions sur le marché du travail. Il est aussi fort probable que les effets soient différenciés selon les caractéristiques des individus qu’elles soient individuelles (âge, sexe, origine, parcours professionnel antérieur, qualification) ou familiales (monoparentalité). Certains groupes peuvent ainsi apparaître plus vulnérables aux difficultés économiques et cela pourrait conduire in fine à une hausse générale des inégalités. Si les instances internationales ont déjà évoqué ces points dans des rapports récents (ILO, 2009 ; OECD 2009), en s’intéressant en particulier aux conséquences sur les femmes, les travaux académiques restent à ce jour peu nombreux.
Ce constat s’explique certainement en partie par le peu de temps écoulé depuis le début de cette crise qui ne permet pas encore de disposer du recul et des données nécessaires à son analyse. L’objectif de ce projet à moyen terme est donc, tout en collectant les données nécessaires à l’analyse de la crise récente, d’aborder le thème des crises économiques en étudiant dans un premier temps les effets de la récession de 1993. On garde bien évidemment à l’esprit que les deux crises revêtent des formes très différentes dans leur ampleur et leur durée. Dans un second temps, nous
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
utiliserons notamment les enquêtes Emploi, nationales et européennes, et les enquêtes européennes sur les Conditions de vie pour analyser les effets de la crise actuelle. La situation française sera comparée à celle de ses voisins européens.
L’objectif de Carole Bonnet, Olivier Thévenon et Ariane Pailhé est ainsi d’étudier de quelle manière la récession affecte différemment des segments de la population définis selon le sexe, la situation familiale, l’origine ou encore l’âge. L’impact peut être différent en termes de délai, jeunes et seniors pouvant être touchés en premier, mais aussi selon les phénomènes étudiés (retraits d’activité, allongement des périodes de chômage, difficultés d’entrée ou de retour à l’emploi).
3.1. Quelles sont les catégories écartées de l’emploi ?
Un premier axe de travail consistera à analyser dans quelle mesure certaines catégories de population ont été plus particulièrement concernées par une mise à l’écart du marché du travail, traduite en retrait d’activité ou en épisode de chômage plus ou moins long. On prêtera une attention particulière aux effets du milieu professionnel. Les secteurs employant une forte proportion de femmes ou de travailleurs non qualifiés ont-ils été plus particulièrement touchés ? De même, on s’intéressera aux effets de la situation familiale, de la situation économique du ménage et de la situation professionnelle des conjoints avant à la récession. De plus, on s’intéressera aux interactions entre conjoints, la perte d’emploi d’un des membres du couple pouvant avoir suscité une réaction particulière dans un contexte de récession. L’analyse s’effectuera ici au niveau du ménage, et non au niveau strictement individuel.
3.2. Un report de l’entrée dans l’emploi ?
On prolongera cette analyse en étudiant, dans un deuxième axe, dans quelle mesure les difficultés économiques ont pu retarder l’entrée en activité ou le retour à l’emploi de certaines populations, comme les étudiants ou les parents de jeunes enfants. On examinera en particulier si certains parmi ces derniers ont pu être incités ou « contraints » à bénéficier de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant plutôt que de reprendre leur emploi ou de se mettre en recherche active. Le type d’emploi occupé lors du retour sur le marché du travail après une naissance, à temps plein ou temps partiel, constituera aussi une variable d’intérêt. Enfin, on examinera si, à plus long terme, la récession a pu conduire certains ménages à avoir une naissance qui n’était pas prévue au lieu de participer au marché du travail.
3.3. Rechercher un emploi en temps de crise
La crise affecte aussi les perspectives d’emploi des chômeurs. Les chômeurs en recherche d’emploi sont ainsi soumis à une contrainte micro-éonomique : subvenir aux besoins plus ou moins pressants des membres de leur ménage et à une contrainte macro-économique : la conjoncture plus ou moins favorable. Nathalie Picard et Anne Solaz proposent un modèle théorique de recherche d’emploi tenant compte des contraintes du marché du travail et de la situation familiale. Dans un premier temps, l’individu sans emploi se présente ou non sur le marché du travail en fonction de ses contraintes familiales. Dans un second temps, son offre est confrontée à la demande sur le marché du travail, influencée par les conditions macro-économiques. En période de crise économique, la concurrence entre travailleurs peut amener certains chômeurs à accepter un emploi « non
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
satisfaisant », c’est-à-dire un emploi nettement en dessous de ses qualifications, de statut précaire ou éloigné du domicile.
Le modèle théorique va être testé sur deux bases de données complémentaires : une enquête générale (« Jeunes et Carrières », 1997) et une enquête sur une population particulière (« Sortants du RMI », 1997).
3.4. Quel effet sur le niveau de vie des ménages ?
Le dernier axe d’analyse des effets de la crise portera sur le niveau de vie des ménages, en abordant la question du point de vue des adultes et des enfants. On examinera, en particulier, comment les niveaux de pauvreté et les inégalités de revenu ont évolué après la crise, en tenant compte de la composition des ménages et de la situation d’activité de ses membres. On étudiera, par ailleurs, la manière dont les politiques sociales ont pu amortir l’impact de la crise sur le niveau de vie de différents groupes de population.
Références
Abbott A., 1995, « Sequence Analysis : New Methods for Old Ideas », Annual review of Sociology, Vol 21, 93-113.
Abbott A., Tsay A., 2000, « Sequence Analysis and Optimal Methods in Sociology”, Sociological Methods and research, Vol 29, N1: 3-33.
Albrecht J.W et al., 1999, “Career interruptions and subsequent earnings: A reexamination using Swedish data”, Journal of Human Resources 34(2):294-311.
Becker G., 1985, Human capital, effort and the sexual division of labour, Journal of Labour Economics 3(1):S33-S58.
Beenstock M., Chiswick B. et Paltiel A., 2005, “Endogenous Assimilation, and Immigrant Adjustment in Longitudinal Data”, IZA, Discussion paper N° 1840.
Borjas G.J., 1982, “The Earnings of Male Hispanic Immigrants in the United States”, Industrial and Labor Relations Review, April, pp 343-353.
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
Budig Michelle J.; England Paula., 2001, “The Wage Penalty for Motherhood”. American Sociological Review, Vol. 66, No. 2., pp. 204-225.
Borjas G.J., 2000, “Economics of Migration”, International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Section N°3.4, Article N° 38.
Carliner G, 1980, “Wages, Earnings and Hours of Firs, Second and Third Generation American Males”, Economics of Inquiry, 18, N°1, pp 87-102.
Chiswick B. et Miller P.W, 2008, “ The “negative” Assimilation of Immigrants : a Special Case”, IZA, Discussion paper N° 1750
Chiswick B., 1978, “The Effect of Americanization on the Earnings of Foreign-Born Men”, The Journal of Political Economy, Vol.86, Issue 5, pp 897-922.
Datta Gupta N., Smith N., 2001, “Children and career interruptions: the family gap in Denmark”, IZA Disc. paper n°263.
De Freitas G., 1980, “The Earnings Immigrants in the American Labor Market”, Ph.D dissertation, Columbia University.
Grésy Brigitte, 2009, Rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Ministère du Travail et des relations sociales.
International Labour Organization, 2009, « Global Employment Trends for Women”
Lesnard L., de Saint-Pol T., 2006, « Optimal Matching and the Social Sciences », Document de travail du Crest, Paris, Insee, No 2006-01.
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
Long J.E, 1980, “The Effect of Americanization on Earnings : Some Evidence for Women”, The Journal of Political Economy, Vol.88, N°3, pp 620-629.
Mincer J., S. Polachek, 1974, “Family investments in human capital: earnings of women”, Journal of Political Economy 82(2)-part II:S76-S108.
Neumark, David, Sanders Korenman. 1994. "Sources of Bias in Women's Wage Equations: Results Using Sibling Data." Journal of Human Resources 29(2):379-405.
OECD 2009, « Monitoring the effects of the financial crisis on vulnerable groups of the society”, Paris, 18 march.
Pailhé A., Solaz A., 2006, « Vie professionnelle et naissance : la charge de la conciliation repose essentiellement sur les femmes », Population et sociétés, n°426.
Verick Sher, 2009, « Who Is Hit Hardest during a Financial Crisis? The Vulnerability of Young Men and Women to Unemployment in an Economic Downturn », IZA Discussion Paper, n°4359
Waldfogel J., 1997, “The effect of children on women’s wages”, American Sociological Review 62(2):209-17.
Waldfogel J., 1998, “Understanding the “family gap” in pay for women with children”, The Journal of Economic Perspectives 12(1):137-56.
Ekert-Jaffe O. and Stier, H., 2009. “Normative or Economic Behavior ? Religiosity, Fertility and Women’s Employment in Israel“, Social Science Research, 38, 644-655.
Israel Central Bureau of Statistics, 2008. Statistical abstract of Israel no. 58, 2009 Jerusalem: Government Printing Office.
King L., 2002. Demographic trends, pronatalism, and nationalist ideologies in the late twentieth century, Ethnic and Racial Studies, Vol. 25 , 3,. 367–389
Legoff, J-M., Dieng W., 2006 Prise en charge des enfants en bas âge en Suisse et participation des femmes au marché du travail, Cahiers québécois de démographie, 35, 2, p. 141-160.
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99 • MEL ( À COMPLÉTER)
Prioux, F., 2009. Les couples non mariés en 2005 : quelles différences avec les couples mariés ?, Politiques sociales et familiales , 96, 87-95.
Stier, H, Lewin-Epstein N. and Braun M., 2001. Welfare regime, family-supportive policy, and women’s employment along the life course. American Journal of Sociology, 106, 6 (May), 1731-60.
Thevenon O., 2008. « Les politiques familiales des pays développés : des modèles contrastés », Population et Société, 448.