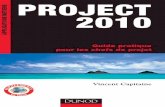Projet de norme marocaine
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Projet de norme marocaine
ICS : 97.220.10
, publiée
Norme Marocaine homologuéePar décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° au B.O.N° du
Correspondance
Droits d'auteurDroit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.
© IMANOR 2017 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR) Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73 Email : [email protected]
PNM EN 13451-1 IC 10.8.278
2018
La présente norme nationale est identique à l’EN 13451-1 : 2011 + A1 : 2016 et est reproduite avec la permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.
Tous droits d’exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par l’IMANOR.
Équipement de piscine
Partie 1 : Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai
Projet de Norme Marocaine
Projet
de no
rme m
aroca
ine
PNM EN 13451-1 : 2018
Avant-Propos National
L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.
Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.
La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen deNormalisation (CEN).
Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sensde « … la présente norme marocaine… ».
Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sontremplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveaunational, le cas échéant.
La présente norme marocaine comporte une annexe nationale normative (ZN) qui précise des dispositions nationales applicables et qui constituent des modifications par rapport au document de base EN 13451-1.
La présente norme marocaine NM EN 13451-1 a été examinée et adoptée par laCommission de Normalisation des Equipements publics (101).
Projet
de no
rme m
aroca
ine
NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD EN 13451-1:2011+A1
Octobre 2016 ICS 97.220.10 Remplace EN 13451-1:2011
Version Française Équipement de piscine - Partie 1 : Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai Schwimmbadgeräte - Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren Swimming pool equipment - Part 1: General safety requirements and test methods La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 29 Juillet 2011 et comprend l'amendement 1 adopté par le CEN le 13 Juin 2016. Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN. La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
C O M I T É E U R O P É E N D E N O R M A L I S A T I O NE U R O P Ä I S C H E S K O M I T E E F Ü R N O R M U N G EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles
© 2016 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN. Réf. n° EN 13451-1:2011+A1:2016 F
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
2
Sommaire
Page
Avant-propos européen .......................................................................................................................................5
1 Domaine d'application ...........................................................................................................................7
2 Références normatives ...........................................................................................................................7
3 Termes et définitions .............................................................................................................................8
4 Exigences de sécurité........................................................................................................................... 10 4.1 Intégrité structurelle ........................................................................................................................... 10 4.1.1 Généralités ........................................................................................................................................... 10 4.1.2 Matériaux ............................................................................................................................................. 11 4.2 Espace minimum .................................................................................................................................. 11 4.3 Mains courantes, barrières, barrières de sûreté ................................................................................ 11 4.3.1 Mains courantes ................................................................................................................................... 11 4.3.2 Barrières .............................................................................................................................................. 11 4.3.3 Barrières de sûreté .............................................................................................................................. 12 4.3.4 Prise totale ........................................................................................................................................... 12 4.3.5 Agrippement/prise partielle ............................................................................................................... 13 4.3.6 Prise de doigts ...................................................................................................................................... 13 4.4 Surfaces ................................................................................................................................................ 13 4.4.1 Revêtement de surface ........................................................................................................................ 13 4.4.2 Matériaux de surface ........................................................................................................................... 13 4.5 Saillies .................................................................................................................................................. 13 4.6 Arêtes et angles .................................................................................................................................... 14 4.7 Points de coincement, points d'écrasement et points de cisaillement ............................................. 15 4.7.1 Généralités ........................................................................................................................................... 15 4.7.2 Ouvertures admissibles ....................................................................................................................... 15 4.7.3 Protections et grilles ........................................................................................................................... 15 4.7.4 Parties mobiles .................................................................................................................................... 15 4.7.5 Fentes ................................................................................................................................................... 16 4.7.6 Coincement des cheveux ..................................................................................................................... 16 4.8 Résistance au glissement..................................................................................................................... 16 4.9 Accessoires ........................................................................................................................................... 16 4.10 Dispositifs de protection amovibles ................................................................................................... 17 4.11 Modification de l'équipement existant ............................................................................................... 17
5 Méthodes d'essai .................................................................................................................................. 17 5.1 Généralités ........................................................................................................................................... 17 5.2 Rapport d'essai .................................................................................................................................... 17
6 Instructions et informations ............................................................................................................... 18 6.1 Installation ........................................................................................................................................... 18 6.2 Fonctionnement technique ................................................................................................................. 18 6.3 Inspection et maintenance .................................................................................................................. 18
7 Marquage ............................................................................................................................................. 19
Annexe A (normative) Charges ....................................................................................................................... 20 A.1 Charges permanentes .......................................................................................................................... 20 A.1.1 Généralités ........................................................................................................................................... 20 A.1.2 Poids propre ........................................................................................................................................ 20 A.1.3 Charges de précontrainte .................................................................................................................... 20 A.2 Charges variables ................................................................................................................................. 20
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
3
A.2.1 Généralités ............................................................................................................................................ 20 A.2.2 Charges exercées par les utilisateurs .................................................................................................. 21 A.2.3 Charges exercées par la neige .............................................................................................................. 23 A.2.4 Charges exercées par le vent................................................................................................................ 23 A.2.5 Charges dues à la température ............................................................................................................ 23 A.2.6 Charges spécifiques .............................................................................................................................. 23 A.3 Nombre d'utilisateurs présents sur l'équipement .............................................................................. 23 A.3.1 Généralités ............................................................................................................................................ 23 A.3.2 Nombre d'utilisateurs en un point ...................................................................................................... 24 A.3.3 Nombre d'utilisateurs sur des éléments de type linéaire .................................................................. 24 A.3.4 Nombre d'utilisateurs sur une surface ................................................................................................ 24
Annexe B (normative) Méthode de calcul de l'intégrité structurelle ............................................................. 25 B.1 Principes généraux ............................................................................................................................... 25 B.1.1 État limite ............................................................................................................................................. 25 B.1.2 État limite ultime .................................................................................................................................. 26 B.1.3 État limite de service ............................................................................................................................ 26 B.2 Combinaisons de charges pour l'analyse statique .............................................................................. 26
Annexe C (normative) Essais physiques de l'intégrité structurelle ............................................................... 27 C.1 Critères d'acceptation/rejet ................................................................................................................ 27 C.1.1 Méthode d'essai .................................................................................................................................... 27 C.1.2 Conformité ............................................................................................................................................ 27 C.1.3 Rejet ...................................................................................................................................................... 27 C.2 Charge d'essai pour l'équipement ....................................................................................................... 27 C.2.1 Combinaisons de charges pour les essais ............................................................................................ 27 C.2.2 Coefficient de sécurité pour l'essai sur des séries identiques ............................................................ 28 C.2.3 Coefficient de sécurité pour l'essai sur un produit unique ................................................................ 28 C.3 Application de la charge ....................................................................................................................... 28 C.3.1 Généralités ............................................................................................................................................ 28 C.3.2 Charges ponctuelles ............................................................................................................................. 28 C.3.3 Charges linéaires .................................................................................................................................. 28 C.3.4 Charges surfaciques ............................................................................................................................. 28
Annexe D (normative) Méthodes d'essai de piège/coincement ..................................................................... 29 D.1 Coincement de la tête et du cou ........................................................................................................... 29 D.1.1 Appareillage ......................................................................................................................................... 29 D.1.2 Méthode d'essai .................................................................................................................................... 30 D.2 Coincement des doigts et des orteils ................................................................................................... 30 D.2.1 Appareillage ......................................................................................................................................... 30 D.2.2 Méthode d'essai .................................................................................................................................... 30 D.3 Coincement des pieds et des mains ..................................................................................................... 30 D.3.1 Appareillage ......................................................................................................................................... 30 D.3.2 Méthode d'essai .................................................................................................................................... 31
Annexe E (normative) Essais de résistance au glissement ............................................................................. 32 E.1 Principe ................................................................................................................................................. 32 E.2 Personne réalisant l'essai .................................................................................................................... 32 E.3 Banc d'essai .......................................................................................................................................... 32 E.4 Liquide d'essai ...................................................................................................................................... 32 E.5 Éprouvette d'essai ................................................................................................................................ 32 E.6 Méthode d'essai .................................................................................................................................... 32 E.7 Évaluation ............................................................................................................................................. 33 E.8 Classification ......................................................................................................................................... 33 E.9 Rapport d'essai ..................................................................................................................................... 33
Annexe F (normative) Utilisation d'acier inoxydable ayant des fonctions de support de charge dans l'atmosphère d'une piscine .................................................................................................................. 35
F.1 Généralités ............................................................................................................................................ 35 F.2 Piscines intérieures avec désinfection au chlore ................................................................................ 35 F.2.1 Généralités ............................................................................................................................................ 35
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
4
F.2.2 Composants ne pouvant pas être nettoyés régulièrement ................................................................ 35 F.2.3 Composants pouvant être nettoyés régulièrement ............................................................................ 36 F.3 Piscines extérieures avec désinfection au chlore .............................................................................. 36 F.4 Revêtements et peintures ................................................................................................................... 36
Bibliographie .................................................................................................................................................... 37
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
5
Avant-propos européen
Le présent document (EN 13451-1:2011+A1:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 136 « Équipements et installations pour le sport, les aires de jeux, et autres équipements et installations de loisir », dont le secrétariat est tenu par DIN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2017, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2017.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document inclut l'Amendement 1, approuvé par le CEN le 13 juin 2016.
Le présent document remplace l’!EN 13451-1:2011".
Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par des repères !".
L’EN 13451, Équipement de piscine, est constituée des parties suivantes :
Partie 1 : Exigences générales de sécurité et méthodes d’essai
Partie 2 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux échelles !verticales, aux échelles à inclinaison et aux" mains courantes
Partie 3 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux pièces d’aspiration et de refoulement et aux équipements de loisirs aquatiques disposant d’introduction et d’extraction d’eau/d’air
Partie 4 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux plots départ
Partie 5 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires !spécifiques" aux lignes de nage !et lignes d'eau de séparation des espaces"
Partie 6 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux plaques de touche
Partie 7 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux buts de water-polo
Partie 10 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux plates-formes de plongeon, plongeoirs et à l’équipement associé
Partie 11 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires !spécifiques aux fonds mobiles et cloisons mobiles de piscine"
La présente norme peut également s'appliquer à d'autres équipements non spécifiés, à condition que les exigences de sécurité soient respectées.
Il est possible que des exigences complémentaires soient ajoutées pour des applications telles que la compétition de natation et il convient de demander conseil auprès de l'organisme gouvernemental du sport en question.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
6
!Par rapport à l'EN 13451-1:2001, les principaux amendements suivants ont été apportés :
a) modification du Domaine d'application conformément à l'EN 15288-1 et à l’EN 15288-2 ;
b) mise à jour des références normatives : la CEN/TS 16165 a été ajoutée et les EN 12503-1, -5 et -6 ont étésupprimées ;
c) modification des exigences de l’essai de rejet pour l’intégrité structurelle (voir 4.1.1) ;
d) suppression de la définition du terme bassin/piscine ;
e) ajout d'exigences relatives aux matériaux (voir 4.1.2) ;
f) ajout d'exigences relatives aux barrières (voir 4.3) ;
g) suppression des exigences relatives à l'aspiration qui sont transférées dans l’EN 13451-3 ;
h) ajout d'exigences relatives aux points de coincement, points d'écrasement et points de cisaillement(voir 4.7) ;
i) modification des exigences relatives au rapport d'essai (voir 5.2) ;
j) modification des valeurs de la charge verticale totale des utilisateurs (voir Tableau A.1) ;
k) seulement deux gabarits pour les méthodes d'essai de coincement de la tête et du cou (voir Annexe D) ;
l) suppression de l'Annexe F et, à la place, ajout de la référence à la CEN/TS 16165 ;
m) Correction de l’acier 1.4571."
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
7
1 Domaine d'application
La présente Norme européenne spécifie des exigences de sécurité et des méthodes d'essai générales pour un équipement utilisé dans des piscines classées telles que spécifiées dans l'EN 15288-1 et l’EN 15288-2.
Lorsqu'il existe des normes spécifiques, il convient de ne pas utiliser la présente norme seule.
Il est nécessaire de prendre les précautions nécessaires lors de l'application de la présente norme générale seule pour un équipement pour lequel aucune norme spécifique à ce produit n'a encore été publiée.
2 Références normatives
Les documents de référence suivants sont indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
EN 1990, Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures
EN 1991-1-2, Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-2 : Actions générales — Actions sur les structures exposées au feu
EN 1991-1-3, Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-3 : Actions générales — Charges de neige
EN 1991-1-4, Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions du vent
EN 10088-1, Aciers inoxydables — Partie 1 : Liste des aciers inoxydables
EN 10088-2, Aciers inoxydables — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général
!Texte supprimé"
EN 15288-1, Piscines — Partie 1 : Exigences de sécurité pour la conception
!
CEN/TS 16165, Détermination de la résistance à la glissance des surfaces piétonnières — Méthodes d'évaluation"
!
EN ISO 12100, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et réduction du risque (ISO 12100)"
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
8
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 15288-1 ainsi que les suivants s'appliquent.
3.1 équipement de piscine éléments installés à l'intérieur et autour d'un bassin, destinés à :
faire fonctionner le bassin et ses zones fonctionnellement avoisinantes ;
utiliser celui-ci et ses zones fonctionnellement avoisinantes
NOTE Ces éléments peuvent faire partie de la technologie de la piscine (par exemple : arrivées ou sorties d'eau) ou être fournis afin d'aider les utilisateurs (par exemple : les échelles) ou pour une utilisation lors de compétitions et d'entraînements (par exemple : les plots de départ) ou pour les loisirs (par exemple : les fontaines).
3.2 point d'écrasement emplacement où certaines parties de l'équipement peuvent se rapprocher les unes des autres ou se rapprocher d'une partie fixe, en créant un risque d'écrasement des personnes ou de certaines parties du corps
[EN 1176-1:2008, 3.10]
3.3 point de cisaillement emplacement où une partie de l'équipement peut passer devant une autre, fixe ou en mouvement, ou devant une surface fixe, en créant un risque de coupure des personnes ou de certaines parties du corps
[EN 1176-1:2008, 3.11]
3.4 prise totale prise de la main autour de toute la circonférence d'un support quelconque
NOTE Voir Figure 1.
Figure 1 — Prise totale
[EN 1176-1:2008, 3.15]
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
9
3.5 agrippement/prise partielle prise de la main autour d'une partie de la circonférence d'un support
NOTE Voir Figure 2.
Figure 2 — Agrippement/Prise partielle
[EN 1176-1:2008, 3.16]
3.6 prise de doigts système de maintien trouvé par la main, au moins par accrochage de l'extrémité du doigt
3.7 piège coincement danger que présente la situation dans laquelle le corps, une partie du corps, la chevelure ou un vêtement peut se coincer
NOTE Un danger de coincement peut survenir dans des situations où le corps, des parties de celui-ci, etc., sont coincés, mais également dans les situations où le corps de l’usager n’est pas totalement libre d’émerger de l’eau, par exemple en cas de nage sous une échelle à marches plates.
3.8 arête ligne formée par deux surfaces de matière solide qui se rencontrent
3.9 angle point formé par deux ou plusieurs arêtes qui se rencontrent
3.10 espace minimum espace minimum nécessaire pour une installation et une utilisation de l'équipement en toute sécurité
3.11 zone minimum pour l'utilisation espace minimum nécessaire pour toute personne pouvant entrer en contact avec l’équipement
3.12 saillie objet ou partie d'un objet, qui se trouve dans la zone minimum pour l'utilisation ou fait saillie dans cette zone
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
10
3.13 main courante dispositif d'appui destiné à aider l'utilisateur à garder son équilibre
[EN 1176-1:2008, 3.21]
3.14 barrière moyen de séparation permettant d'empêcher le passage ou l'accès
3.15 barrière de sureté barrière destinée à empêcher les utilisateurs de chuter par-dessus, à travers ou dessous
3.16 fente petite ouverture, < 8 mm, où le coincement est possible, pouvant ainsi induire un risque de noyade
3.17 grille élément pour couvrir une goulotte ou une ouverture, conçu pour permettre le passage de l'eau
4 Exigences de sécurité
4.1 Intégrité structurelle
4.1.1 Généralités
L'intégrité structurelle, y compris la stabilité, de l'équipement, doit être évaluée par l'une des méthodes suivantes :
a) le calcul, effectué conformément à l'Annexe A et à l'Annexe B ;
b) des essais physiques, conformément à l'Annexe C ; ou
c) une combinaison de a) et de b).
Lorsque les calculs sont effectués conformément à l'Annexe B, aucun état limite ne doit être dépassé avec des charges combinées comme indiqué en B.2.
!texte supprimé"
Dans certains cas, ces calculs ou essais spécifiques ne sont pas appropriés, mais l'intégrité structurelle doit être au moins équivalente.
Chaque structure doit résister à la fois à des charges permanentes et variables exercées sur l'équipement et les parties de l'équipement comme indiqué à l'Annexe C.
Il n'est pas nécessaire de prévoir, pour un équipement de piscine, les charges accidentelles, c'est-à-dire les charges produites par le feu, la collision avec des véhicules ou les tremblements de terre.
Les charges associées à la fatigue sont nettement inférieures à celles qui sont combinées aux facteurs de charge appropriés lorsque les calculs sont effectués conformément à B.2. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de réaliser un essai de fatigue de l'équipement de piscine.
Les parties structurelles doivent résister à la condition de charge la plus défavorable.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
11
Si une partie d'équipement est constituée de différents éléments, elle doit être construite de manière à ce que chaque élément soit fixé dans sa position de travail.
4.1.2 Matériaux
4.1.2.1 Généralités
Tout matériau peut être utilisé à condition d’être adapté à l’emploi, en tenant également compte des caractéristiques particulières de l’environnement de la piscine (par exemple : atmosphère oxydante, humidité, vieillissement).
Lorsque de l’acier inoxydable est utilisé, voir 4.1.2.2 et lorsque des matières plastiques sont utilisées, voir 4.1.2.3.
Il convient de procéder à une évaluation des risques conformément à l’EN ISO 12100.
4.1.2.2 Utilisation de l'acier inoxydable
Étant donné qu’une corrosion par fissuration sous contrainte peut affecter l’acier inoxydable dans l’atmosphère d’une piscine, une évaluation des risques liés à la conception doit être effectuée chaque fois qu’il est envisagé d’utiliser de l’acier inoxydable.
Pour le choix et l’utilisation d'acier inoxydable avec une fonction de sécurité de support de charge critique dans l'atmosphère de la piscine, voir !Annexe F".
4.1.2.3 Utilisation de matières plastiques
Chaque fois que l'évaluation des risques identifie de possibles phénomènes dangereux pour les utilisateurs en cas de dégradation progressive des composés plastiques, des actions appropriées doivent être prises (par exemple : déclaration d'une durée de vie maximale, nécessité d'un contrôle périodique).
Chaque fois que l'évaluation des risques liés à la conception identifie la possibilité de rupture ou de défaillance en raison d'une dégradation, l’élément doit être l'objet d'une évaluation continue des risques.
NOTE Se reporter à la !NF T54-405-1" pour un essai de vieillissement possible.
4.2 Espace minimum
Le fabricant/fournisseur doit indiquer l'espace minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement et l'utilisation de son équipement.
4.3 Mains courantes, barrières, barrières de sûreté
4.3.1 Mains courantes
Les mains courantes d'usage général ne doivent pas avoir une hauteur inférieure à 800 mm ou supérieure à 1 100 mm par rapport à la position des pieds. Les mains courantes conçues pour les enfants seulement doivent avoir une hauteur ni inférieure à 600 mm ni supérieure à 850 mm par rapport à la position des pieds.
4.3.2 Barrières
Par leur conception, les barrières ne doivent pas encourager les usagers à s'y tenir debout ou à s'y asseoir et elles doivent empêcher l'escalade.
Les barrières peuvent se présenter sous la forme de grilles, de panneaux à face pleine ou de parois.
NOTE Il convient que la conception prenne en compte les besoins visuels liés à l'utilisation de l'installation.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
12
4.3.3 Barrières de sûreté
Les barrières de sûreté doivent être utilisées pour empêcher la chute des usagers d'une hauteur supérieure à 600 mm, excepté dans les situations où une évaluation des risques montre qu’une barrière de sûreté est inutile.
Les espacements doivent avoir une largeur 110 mm. En outre, lorsque deux ou plusieurs barrières de sûreté sont utilisées en combinaison (par exemple : échelle, escalier et plateforme), la barrière de sûreté doit être conçue pour assurer une protection continue.
Les barrières de sûreté doivent avoir une hauteur 1 000 mm, mesurée à partir du point le plus haut sur lequel une personne peut se tenir debout à une distance maximale de 1 000 mm des barrières proprement dites (voir Figure 3).
Dimensions en millimètres
Légende
1 point de station debout le plus élevé
2 plateforme
3 barrière de sûreté à une distance maximale de 1 000 mm du point de station debout le plus élevé
4 barrière de sûreté à plus de 1 000 mm du point de station debout le plus élevé
3, 4 sont différentes possibilités de placement des barrières
X hauteur du point le plus élevé sur lequel une personne peut se tenir debout
Figure 3 — Hauteur des barrières de sûreté
4.3.4 Prise totale
La section transversale de tout élément conçu pour être saisi, lorsque la mesure passe par son centre, doit être au minimum de 16 mm et au maximum de 50 mm, quelle que soit la direction.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
13
4.3.5 Agrippement/prise partielle
L'épaisseur de tout élément conçu pour être agrippé ne doit pas dépasser 60 mm.
4.3.6 Prise de doigts
L'espace minimum pour la saisie doit être d’au moins 15 mm en hauteur et d’au moins 20 mm en largeur. Voir Figure 4 pour un exemple.
EXEMPLE
Dimensions en millimètres
Figure 4 — Prise de doigts
4.4 Surfaces
4.4.1 Revêtement de surface
Le revêtement de surface dans la zone minimum d’utilisation ne doit pas présenter de risque de blessure. Une attention particulière doit être portée sur :
la finition des soudures ;
le risque d'éclats.
4.4.2 Matériaux de surface
Les matériaux qui entrent en contact avec l'eau ne doivent pas avoir d'effet nuisible sur sa qualité et doivent être adaptés à cela.
4.5 Saillies
NOTE Les saillies présentent un risque d'impact et/ou de coincement, notamment lorsque le mouvement de l'eau peut provoquer un déplacement involontaire des utilisateurs.
Les saillies d'une hauteur h ≤ 3 mm, non protégées par les zones adjacentes comme indiqué sur la Figure 5 a), doivent être arrondies avec un rayon R > h/2 ou chanfreinées conformément à la Figure 5 b).
Les saillies d'une hauteur h > 3 mm mais ≤ 15 mm, non protégées par les zones adjacentes comme indiqué sur la Figure 5 a), doivent être arrondies avec un rayon R 3 mm. Voir Figure 5 c).
Les saillies d'une hauteur h > 15 mm, non protégées par les zones adjacentes ou par des mesures supplémentaires (par exemple : poignées pour les installations à contre-courant) doivent avoir un rayon comme indiqué à l'alinéa précédent pour les 15 premiers millimètres de saillie et doivent avoir une inclinaison < 45°, dans le sens tangentiel pour la partie restante de la saillie. Voir Figure 5 d).
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
14
Dimensions en millimètres
a) Exemple de pièce fraisée protégée par des zonesadjacentes
b) Exemple de saillie d'une hauteur ≤ 3 mm
c) Exemple de saillie d'une hauteur > 3 mm et ≤ 15 mm
d) Exemple de saillie d'une hauteur > 15 mm
Légende
1 espace libre, voir exigences relatives aux pièges et coincement
B largeur max. de saillie pour une hauteur > 15 mm
L largeur min. de la partie supérieure plane de la saillie
H hauteur de saillie > 15 mm et < 75 mm
h hauteur de saillie > 3 mm et ≤ 15 mm
R rayon
Figure 5 — Exigences de sécurité relatives aux saillies
4.6 Arêtes et angles
Les arêtes et les angles dans la zone minimum doivent avoir un rayon dépendant du résultat de l'évaluation des risques liés à la conception.
NOTE Un rayon minimum de 3 mm s'est avéré adapté à toutes les conditions.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
15
4.7 Points de coincement, points d'écrasement et points de cisaillement
4.7.1 Généralités
Les dangers de coincement, d'écrasement et de cisaillement doivent être identifiés et pris en compte dans l'évaluation des risques.
Par sa construction, l'équipement ne doit créer aucun danger de coincement ou, dans le cas d'un équipement mobile, aucun danger d'écrasement ou de cisaillement.
4.7.2 Ouvertures admissibles
4.7.2.1 Principe
Toutes les ouvertures accessibles aux usagers doivent être limitées à la plage suivante de dimensions des ouvertures ou des espaces : 0 mm à 8 mm, 25 mm à 110 mm et 230 mm ou plus, sauf autorisation spécifique donnée dans d'autres articles/paragraphes de la présente Norme européenne et/ou parties de la présente série de normes.
Les dimensions admissibles des ouvertures ou espaces s'appliquent lorsque la longueur de l'ouverture dépasse la largeur.
4.7.2.2 Coincement des doigts et des orteils
Lorsque le risque de coincement des doigts ou des orteils existe, l'ouverture admissible doit être 8 mm et l'essai indiqué en D.2 et D.3 doit être appliqué. Si le gabarit C ne passe pas par l'ouverture, la conformité est assurée. Si le gabarit C passe par l'ouverture, le gabarit D doit passer lui aussi.
4.7.2.3 Coincement des pieds et des mains
Lorsque le risque de coincement des pieds ou des mains existe, l'ouverture admissible doit être 25 mm et 110 mm et l'essai indiqué en D.1 et D.3 doit être appliqué.
Si le gabarit D passe par l'ouverture, le gabarit A ne doit pas passer.
4.7.2.4 Coincement de la tête ou du cou
Lorsque le risque de coincement de la tête ou du cou existe, l'ouverture admissible doit être 110 mm ou 230 mm et l'essai indiqué en D.1 doit être appliqué.
Si le gabarit A passe par l'ouverture avec un jeu 1 mm, la conformité est assurée. Si le gabarit A passe par l'ouverture avec un jeu 1 mm, le gabarit B doit passer lui aussi.
Lorsque l'ouverture est 230 mm, il convient qu'elle n’ouvre pas la voie à d'autres risques ou dangers de coincement.
Lorsqu'il existe une combinaison de risques, la plus petite des tailles d'ouverture admissibles doit être utilisée.
4.7.3 Protections et grilles
Lorsque les ouvertures sont protégées ou leurs dimensions limitées (par exemple, par des couvercles ou des grilles), ces dispositifs ne doivent pas pouvoir être retirés sans utiliser d'outils ou ils doivent être inviolables.
4.7.4 Parties mobiles
Par sa construction, l'équipement doit empêcher tout danger d'écrasement ou de cisaillement entre parties mobiles et/ou parties fixes.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
16
Lorsque les dimensions des ouvertures varient en cours d'utilisation en raison du mouvement, les dimensions admissibles des ouvertures indiquées en 4.7.2 doivent s'appliquer.
4.7.5 Fentes
Les fentes créant un danger de coincement (par exemple des ongles, des cheveux) doivent être :
évitées par conception ;
éliminées par des moyens techniques (par exemple : joints d'étanchéité élastiques) lorsqu'elles ont été créées par l'installation de l'équipement.
4.7.6 Coincement des cheveux
Le coincement des cheveux doit être évité.
Une attention particulière doit être portée à l'élimination des fentes, notamment autour des sorties d'aspiration, lorsque l'effet de l'aspiration peut augmenter le risque. Chaque fois qu'une élimination complète est techniquement impossible, les points de coincement restants doivent être protégés.
NOTE 1 Les fentes se sont avérées constituer spécialement un danger de coincement des cheveux.
NOTE 2 La méthode d’essai pour l’essai de coincement des cheveux est spécifiée dans l’EN 13451-3.
4.8 Résistance au glissement
Les surfaces de l'équipement sur lesquelles l'utilisateur peut se tenir debout ou marcher pieds nus et pouvant être soumises à essai conformément à l'Annexe E, doivent être conformes au Tableau 1.
Tableau 1 — Angles minimum à obtenir pour les surfaces spécifiques
Surfaces de l'équipement Groupe d'évaluation
situées dans les zones horizontales du bassin avec une profondeur d'eau comprise entre 800 mm et 1 350 mm
12°
situées dans les zones horizontales du bassin avec une profondeur d'eau comprise entre 0 mm et 800 mm
situées dans les zones du bassin inclinées jusqu'à 8° avec une profondeur d'eau comprise entre 0 mm et 1 350 mm
situées dans les zones autour du bassin occasionnellement mouillées
18°
situées dans les zones du bassin inclinées de plus de 8° avec une profondeur d'eau comprise entre 0 mm et 1 350 mm
marches, plots de départ, marches des échelles et des escaliers
24°
!Pour les surfaces de l'équipement sur lesquelles l'utilisateur peut se tenir debout ou marcher pieds nus et qui ne peuvent pas être soumises à l'essai conformément à l'Annexe E, d'autres méthodes d'essai sont données dans le CEN/TS 16165."
4.9 Accessoires
Les accessoires, qu'ils soient fixes ou amovibles, doivent être :
a) considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement ;
b) soumis aux mêmes exigences de sécurité ;
c) soumis à essai avec l’équipement en position de travail.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
17
Les accessoires destinés à un équipement/article amovible inutilisé (par exemple, pour les plots de départ) doivent être protégés par des dispositifs inviolables appropriés lorsque l'équipement/article est retiré.
Lorsqu'un nouvel équipement utilise des accessoires installés existants, l'entrepreneur (fournisseur/fabricant/installateur du nouvel équipement) doit évaluer leur conformité.
4.10 Dispositifs de protection amovibles
Lorsque des dispositifs de protection amovibles sont utilisés pour prévenir les risques (par exemple, des couvercles pour les fixations inutilisées, des grilles pour les sorties d'aspiration), ils ne doivent pas pouvoir être retirés sans utiliser d'outils ou ils doivent être inviolables.
4.11 Modification de l'équipement existant
En cas de modification ou de réutilisation partielle de l'équipement existant, la personne qui modifie l'équipement (fabricant, fournisseur, installateur, opérateur, etc.) est responsable de la conformité à la présente Norme européenne de l'équipement complet modifié.
5 Méthodes d'essai
5.1 Généralités
Sauf spécification contraire, les exigences de l'Article 4 doivent être vérifiées à l'aide de la méthode la plus appropriée : mesurage, examen visuel ou essais pratiques.
Pour les articles fabriqués en série, soumettre à essai au minimum trois échantillons représentatifs.
Pour les essais, l'échantillon doit être installé conformément aux instructions du fabricant dans des conditions appropriées à son utilisation.
5.2 Rapport d'essai
Le rapport d'essai doit comprendre au minimum les informations suivantes :
a) le nom et l’adresse de l'organisme d'essais ainsi que le lieu où l'essai a été réalisé s'il est différent de l'adressede l'organisme d'essais ;
b) une identification unique du rapport (telle qu'un numéro de série) et de chaque page, ainsi que le nombretotal de pages du rapport ;
c) une référence à la présente Norme européenne ;
d) le nom et l’adresse du client ;
e) la description et l'identification de l'article d'essai ;
f) la date de réception de l'article d'essai, lorsque cela est applicable, ainsi que la (les) date(s) d'exécution del'essai ;
g) l'identification de la spécification d'essai ou la description de la méthode ou du mode opératoire ;
h) la description de la procédure d'échantillonnage, lorsqu'elle est pertinente ;
i) tout écart, ajout ou exclusion par rapport à la spécification d'essai ainsi que toute autre informationpertinente pour un essai spécifique ;
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
18
j) les mesurages, examens et résultats dérivés, étayés par des tableaux, graphiques, croquis et photographies,selon le cas, ainsi que toute défaillance identifiée ;
k) une déclaration concernant l'incertitude de mesure (le cas échéant) ;
l) la signature et la qualité, ou un marquage équivalent, de la (des) personne(s) acceptant la responsabilitétechnique du rapport d'essai ainsi que la date d'émission.
6 Instructions et informations
6.1 Installation
Une liste des pièces livrées avec l'équipement doit être fournie avec l'équipement.
Les informations doivent indiquer si un niveau de compétence particulier est requis pour l'installation et doivent au moins comprendre les éléments suivants, chaque fois que cela est applicable :
a) l'identification de l'équipement et de ses éléments ;
b) l'ordre de montage ;
c) les aides au montage, si nécessaire, par exemple des panneaux sur les pièces accompagnés d'instructionsappropriées ;
d) la nécessité d'utiliser des outils spéciaux ou autres dispositifs d'aide au montage ;
e) toutes les précautions devant être prises ;
f) les valeurs et les dimensions auxquelles il faut se conformer ;
g) les détails techniques nécessaires pour la conception des fondations et des fixations, si elles ne sont pasfournies.
6.2 Fonctionnement technique
Les instructions de fonctionnement doivent être fournies et doivent comprendre au minimum les éléments suivants :
a) toute mesure requise avant la première utilisation de l'équipement ;
b) toute mesure requise lors de la période de rodage ;
c) les instructions de fonctionnement ;
d) une déclaration indiquant qu'un équipement incomplet engendre un danger.
6.3 Inspection et maintenance
Des instructions relatives aux inspections programmées doivent être fournies si elles sont nécessaires et/ou applicables. Pour les définir, il faut tenir compte du fait que la fréquence d'inspection variera en fonction du type d'équipement ou des matériaux utilisés et en fonction d'autres facteurs. Proj
et de
norm
e maro
caine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
19
Les instructions de maintenance doivent spécifier les éléments suivants :
a) des schémas et diagrammes, nécessaires pour l'inspection, la maintenance, le contrôle du bonfonctionnement et la réparation correcte de l'équipement ;
b) les points à entretenir et les méthodes d'entretien, par exemple le graissage, le serrage des boulons, lerétablissement de la tension des cordages ;
c) que les pièces détachées doivent être conformes aux spécifications du fabricant ;
d) l'identification des pièces détachées ;
e) la durée de vie.
NOTE Une fréquence d'inspection visuelle adaptée est recommandée et il convient de l'enregistrer en usage public.
7 Marquage
Chaque fois que cela est possible, les équipements de piscine doivent être marqués du numéro de la présente Norme européenne.
NOTE Il convient que les marquages soient visibles après installation.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
20
Annexe A (normative)
Charges
A.1 Charges permanentes
A.1.1 Généralités
Les charges permanentes désignent :
a) le poids propre de la structure et des assemblages ;
b) les charges de précontrainte.
A.1.2 Poids propre
Le poids propre de la structure et des assemblages doit être évalué.
A.1.3 Charges de précontrainte
Les charges de précontrainte sont considérées comme des charges permanentes. Les charges de précontrainte maximales et minimales doivent être prises en compte.
NOTE Compte tenu du fluage et de la détente, la précontrainte est fonction du temps. Il peut être nécessaire de vérifier deux états :
a) la précontrainte initiale ;
b) la précontrainte finale.
A.2 Charges variables
A.2.1 Généralités
Les charges variables sont :
a) les charges exercées par les utilisateurs ;
b) les charges exercées par la neige ;
c) les charges exercées par le vent ;
d) les charges dues à la température ;
e) les charges spécifiques.Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
21
A.2.2 Charges exercées par les utilisateurs
La charge due aux utilisateurs de l'équipement de piscine doit être basée sur le système de charge suivant :
a) la masse totale :
1,64nG n m n (A.1)
où
Gn est la masse totale de n utilisateurs, en kilogrammes ;
n est le nombre d'utilisateurs sur l'équipement ou une partie de ce dernier, comme indiqué en A.3 ;
m est la masse moyenne d'un utilisateur ;
est l'écart-type du groupe d'âge concerné.
NOTE 1 Pour un équipement de piscine, les valeurs suivantes peuvent être utilisées :
m = 53,8 kg ;
= 9,6 kg.
b) le facteur dynamique :
dyn 1 1/C n (A.2)
où
Cdyn est le facteur représentant la charge due au mouvement (le fait de courir, etc.) des utilisateurs, y compris le comportement du matériau sous la charge d'impact ;
n est tel qu'indiqué en a) ;
c) la charge verticale totale exercée par les utilisateurs :
NOTE 2 Pour la charge verticale totale exercée par les utilisateurs, voir Tableau A.1.
tot;v dyng nF G C (A.3)
où
vtot;F est la charge verticale totale exercée par n utilisateurs sur l'équipement, en newtons ;
g est l'accélération due à la pesanteur (9,81 m/s2) ;
nG est tel qu'indiqué en a) ;
dynC est tel qu'indiqué en b).
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
22
Tableau A.1 — Charge verticale totale des utilisateurs
Nombre d'utilisateurs
n
Masse de n utilisateurs
nG
Facteur dynamique
dynC
Charge verticale totale des
utilisateurs
tot;vF
Charge verticale par utilisateur
1;vF
kg N N
1 69,5 2,00 1 391 1 391
2 130 1,50 1 948 974
3 189 1,33 2 516 839
5 304 1,20 3 648 730
10 588 1,10 6 468 647
15 868 1,07 9 259 617
20 1 146 1,05 12 033 602
25 1 424 1,04 14 810 592
30 1 700 1,03 17 567 586
40 2 252 1,025 23 083 577
50 2 801 1,02 28 570 571
60 3 350 1,017 34 058 568
— 1,00 — 538
NOTE 3 À l'infini, la charge verticale par utilisateur est égale au poids moyen.
d) la charge horizontale totale exercée par les utilisateurs :
La charge horizontale totale exercée par les utilisateurs est égale à 10 % de la charge verticale totale exercée par les utilisateurs conformément à A.2.2 c) et s'exerce au même niveau, avec la charge verticale.
tot;h tot;v0,1F F (A.4)
NOTE 4 Cette charge tient compte du mouvement des utilisateurs et des imprécisions dans la structure.
e) la répartition des charges exercées par les utilisateurs :
Les charges exercées par les utilisateurs sont réparties uniformément sur l’élément comme suit :
1) charges ponctuelles :
totFF en newtons (A.5)
où
F s'exerce sur une surface de 0,1 m 0,1 ;Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
23
2) charges linéaires :
tot /q F L en newtons par mètre (A.6)
où
L est conforme à A.3.3 ;
3) charges surfaciques :
tot /p F A en newtons par mètre carré (A.7)
où
A est conforme à A.3.4 ;
4) charges appliquées sur un volume :
LFq /tot en newtons par mètre, ou (A.8)
tot /p F A en newtons par mètre carré (A.9)
NOTE 5 Les charges appliquées sur un volume sont exprimées sous forme de charges linéaires ou de charges surfaciques suivant le type d'éléments formant la structure.
A.2.3 Charges exercées par la neige
Les charges exercées par la neige doivent être sélectionnées dans l'Eurocode relatif aux Actions sur les structures, EN 1991-1-3, en prévoyant une période de référence de dix ans.
A.2.4 Charges exercées par le vent
Les charges exercées par le vent doivent être sélectionnées dans l'Eurocode relatif aux Actions sur les structures, EN 1991-1-4, en prévoyant une période de référence de dix ans.
A.2.5 Charges dues à la température
Les charges dues à la température doivent être sélectionnées dans l'Eurocode relatif aux Actions sur les structures, EN 1991-1-2, en prévoyant une période de référence de dix ans.
A.2.6 Charges spécifiques
NOTE Si nécessaire, à préciser dans les parties ultérieures de l'EN 13451.
A.3 Nombre d'utilisateurs présents sur l'équipement
A.3.1 Généralités
Le nombre d'utilisateurs pour chaque élément structurel susceptible de supporter la charge des utilisateurs doit être calculé.
Le nombre calculé doit être arrondi au nombre entier supérieur.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
24
A.3.2 Nombre d'utilisateurs en un point
Sauf indication contraire dans la présente norme, le nombre d'utilisateurs, n, en un point est comme suit :
1n
Chaque point individuel de l'équipement de piscine sur lequel les utilisateurs se tiennent debout ou marchent, ou une surface plane supérieure à 0,1 m de large et qui forme un angle inférieur à 30° avec l'horizontale, doit pouvoir supporter la charge provoquée par un utilisateur.
NOTE Cette exigence s'applique également aux marches supportant le poids des utilisateurs.
A.3.3 Nombre d'utilisateurs sur des éléments de type linéaire
Le nombre d'utilisateurs, n, sur une ligne doit être calculé comme suit :
a) élément linéaire ayant une inclinaison inférieure ou égale à 60° :
6,0/prLn (A.10)
où
prL est la longueur de l'élément projeté sur un plan horizontal, en mètres ;
b) élément linéaire ayant une inclinaison supérieure à 60° :
2,1/Ln (A.11)
où
L est la longueur de l'élément, en mètres.
A.3.4 Nombre d'utilisateurs sur une surface
Le nombre d'utilisateurs, n, sur une surface doit être calculé comme suit :
a) plans ayant une inclinaison inférieure ou égale à 60° :
6,0/prAn (A.12)
où
prA est la surface projetée sur un plan horizontal, en mètres carrés ;
b) plans ayant une inclinaison supérieure à 60° :
72,0/An (A.13)
où
A est la surface, en mètres carrés.
La largeur du plan doit être supérieure à 0,6 m. Les plans ayant une largeur inférieure doivent être considérés comme des éléments de type linéaire.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
25
Annexe B (normative)
Méthode de calcul de l'intégrité structurelle
B.1 Principes généraux
B.1.1 État limite
Chaque structure et chaque élément de structure, par exemple les raccords, fondations, supports, doivent être calculés en tenant compte des combinaisons de charge en B.2.
La méthode recommandée pour le calcul doit être basée sur les principes généraux et les définitions d'états limites comme spécifié dans l'Eurocode structurel EN 1990.
Des règles techniques et des méthodes de construction pratique bien établies, autres que la présente méthode, peuvent être utilisées à condition que le niveau de sécurité soit au moins équivalent.
NOTE Les états limites sont des états au-delà desquels la structure ne satisfait plus aux exigences de la présente Norme européenne.
Sous forme de symboles, un état limite peut être écrit comme suit :
F M/γ S R γ (B.1)
où
F est un coefficient partiel de sécurité applicable aux charges ;
M est un coefficient partiel de sécurité applicable aux matériaux ;
S est l'effet de la charge ;
R est la résistance de la structure.
Afin de prévoir les incertitudes des charges réelles et du modèle utilisé pour déterminer les charges, les charges sont multipliées par un coefficient partiel de sécurité approprié ( F ).
Afin de prévoir les incertitudes des propriétés réelles des matériaux et des modèles utilisés pour déterminer les forces dans la structure, la résistance de la structure est divisée par un coefficient partiel de sécurité approprié ( M ).
Dans la plupart des cas, la représentation symbolique donnée ici ne peut pas être utilisée pour représenter l'état limite car la formulation réelle est souvent non-linéaire, par exemple lorsque les charges doivent être combinées. Proj
et de
norm
e maro
caine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
26
B.1.2 État limite ultime
Les états limites ultimes devant être pris en compte sont les suivants :
a) la perte d'équilibre de la structure ou de l'un de ses éléments, considéré(e) comme un corps rigide ;
b) la défaillance par déformation excessive, rupture ou perte de stabilité de la structure ou de l'un de seséléments.
NOTE Les états limites ultimes sont ceux associés à l'effondrement ou à d'autres formes de défaillance structurelle pouvant menacer la sécurité des personnes.
B.1.3 État limite de service
Lors de la détermination des exigences d'aptitude à l'emploi, la méthode recommandée pour le calcul doit être basée sur les principes d'état limite de service, tels que spécifiés dans l'Eurocode structurel EN 1990.
Les critères relatifs à la flèche applicables aux états limites de service mentionnés dans les Eurocodes appropriés ne s'appliquent pas aux équipements de piscine.
NOTE Les états limites de service correspondent à des états au-delà desquels les critères de fonctionnement spécifiés ne sont plus respectés.
B.2 Combinaisons de charges pour l'analyse statique
Les combinaisons de charges suivantes (charges d'essai) doivent être utilisées pour vérifier l'équation suivante :
tot G;c Q;c iG γ G γ Q (B.2)
où
G est la charge permanente comme indiqué en A.1 ;
iQ est l'une des charges variables comme indiqué de A.2.2 à A.2.6 ;
cG; est le coefficient partiel de sécurité pour les charges permanentes devant être utilisé dans les
calculs ;
cQ; est le coefficient partiel de sécurité pour les charges variables devant être utilisé dans les calculs.
Les coefficients partiels de sécurité suivants doivent être utilisés pour les charges :
cG; = 1,0 pour les effets favorables ;
cG; = 1,35 pour les effets défavorables ;
cQ; = 0 pour les effets favorables ;
cQ; = 1,35 pour les effets défavorables.
NOTE Il n'est pas nécessaire de combiner des charges variables indépendantes telles que les charges exercées par le vent et par les utilisateurs. Les charges liées s'exerçant dans des directions différentes, telles que les charges verticales et horizontales exercées par les utilisateurs, sont combinées.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
27
Annexe C (normative)
Essais physiques de l'intégrité structurelle
C.1 Critères d'acceptation/rejet
C.1.1 Méthode d'essai
Appliquer la charge d'essai totale sans choc.
L'éprouvette doit pouvoir supporter la charge d'essai totale pendant 5 min.
C.1.2 Conformité
L'éprouvette peut supporter la charge d'essai totale.
C.1.3 Rejet
L'éprouvette ne satisfait pas à l'essai lorsqu'elle présente des fissures, des détériorations ou une déformation plastique et lorsque les raccords sont desserrés.
C.2 Charge d'essai pour l'équipement
C.2.1 Combinaisons de charges pour les essais
Les combinaisons de charges suivantes doivent être utilisées pour les essais :
iQGG tQ;tG;essai (C.1)
où
G la charge permanente comme indiqué en A.1 ;
iQ est l'une des charges variables comme indiqué de A.2.2 à A.2.6 ;
tG; est le coefficient partiel de sécurité pour les charges permanentes devant être utilisé dans les essais
= 1,0 dans tous les cas ;
tQ; est le coefficient partiel de sécurité pour les charges variables devant être utilisé dans les essais
conformément à C.2.2 ou C.2.3.
NOTE Il n'est pas nécessaire de combiner des charges variables indépendantes, telles que les charges exercées par le vent et par les utilisateurs, mais il convient de combiner les charges liées s'exerçant dans des directions différentes, telles que les charges verticales et horizontales exercées par les utilisateurs.
Des charges permanentes sont présentes pendant l'essai. Comparées aux charges variables s’exerçant sur l'équipement de piscine, les charges permanentes sont faibles dans la plupart des cas, et par conséquent, aucun coefficient de sécurité supplémentaire n'est nécessaire pour ces charges lors des essais.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
28
C.2.2 Coefficient de sécurité pour l'essai sur des séries identiques
Le coefficient de sécurité suivant doit être utilisé pour les séries identiques lorsque toutes les éprouvettes ne sont pas soumises à essai :
tQ; = 0 pour les effets favorables ;
t;Q = 2,0 pour les effets défavorables.
C.2.3 Coefficient de sécurité pour l'essai sur un produit unique
Le coefficient de sécurité suivant doit être utilisé lorsque chaque éprouvette, y compris les produits uniques, est soumise à essai :
tQ; = 0 pour les effets favorables ;
t;Q = 1,35 pour les effets défavorables.
C.3 Application de la charge
C.3.1 Généralités
Les charges doivent toujours être appliquées à l'air libre, même pour un équipement destiné à être immergé après installation, étant donné la possibilité d'utilisation à l'air sec (par exemple, pour la maintenance).
C.3.2 Charges ponctuelles
Les dimensions suivantes ne doivent pas être dépassées lorsqu'une charge est appliquée sur un élément de la structure :
élément de type linéaire : 1,0l m ;
élément de type surfacique : 1,0m1,0 a m
où
l est la longueur supportant la charge d'essai, en mètres ;
a est la surface supportant la charge d'essai, en mètres carrés.
NOTE Pour simuler le transfert de charge provoqué par un utilisateur sur la structure, il convient que la charge soit normalement appliquée sur une longueur inférieure ou égale à 0,1 m.
C.3.3 Charges linéaires
Les charges linéaires peuvent être représentées par des charges ponctuelles réparties uniformément et espacées les unes des autres d'une distance inférieure ou égale à 0,6 m. La longueur de support soumise aux charges ponctuelles peut aller jusqu'à 0,6 m.
C.3.4 Charges surfaciques
Les charges surfaciques peuvent être représentées par des charges ponctuelles également réparties suivant un maillage de dimensions inférieures ou égales à 0,6 m × 0,6 m.
La surface supportant les charges ponctuelles doit être inférieure à 0,6 m × 0,6 m.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
29
Annexe D (normative)
Méthodes d'essai de piège/coincement
D.1 Coincement de la tête et du cou
D.1.1 Appareillage
Gabarits A et B, tels qu'illustrés sur la Figure D.1.
Dimensions en millimètres
a) Gabarit A
b) Gabarit B
Légende
1 poignée
Figure D.1 — Gabarits pour la détermination du coincement de la tête et du cou
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
30
D.1.2 Méthode d'essai
Dans des conditions normales de fonctionnement, appliquer successivement les gabarits A et B à la section minimale de chaque ouverture, en appliquant une force de 200 N. Enregistrer et consigner dans un rapport si les gabarits passent ou non par l'ouverture. Si le gabarit A passe par l'ouverture, noter la dimension du jeu.
D.2 Coincement des doigts et des orteils
D.2.1 Appareillage
Gabarit C, tel qu'illustré sur la Figure D.2.
Gabarit D, tel qu'illustré sur la Figure D.3.
Dimensions en millimètres
Légende
R rayon
Figure D.2 — Gabarit C pour la détermination du coincement des doigts et des orteils
D.2.2 Méthode d'essai
Dans les conditions normales de fonctionnement, appliquer le gabarit C à la section minimale de l'ouverture, en faisant tourner le gabarit et en le déplaçant à travers l'arc conique montré sur la Figure D.4, tout en appliquant une force de 50 N. Enregistrer et consigner dans un rapport si le gabarit passe ou non par l'ouverture.
D.3 Coincement des pieds et des mains
D.3.1 Appareillage
Gabarit D, tel qu'illustré sur la Figure D.3.
Gabarit A, tel qu'illustré sur la Figure D.1.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
31
Dimensions en millimètres
Légende
R rayon
Figure D.3 — Gabarit D pour la détermination du coincement des pieds et des mains
D.3.2 Méthode d'essai
Dans des conditions normales de fonctionnement, appliquer successivement les gabarits A et D à la section minimale de l'ouverture, en appliquant une force de 50 N. Le gabarit D doit aussi être tourné et déplacé à travers l'arc conique montré sur la Figure D.4. Enregistrer et consigner dans un rapport si les gabarits passent ou non par l'ouverture.
Figure D.4 — Rotation des gabarits C et D
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
32
Annexe E (normative)
Essais de résistance au glissement
E.1 Principe
La personne réalisant l'essai (personnel d'essai) se déplace debout, en avant et en arrière, sur la surface soumise à essai. La surface est mouillée avec de l'eau contenant un agent mouillant. L'inclinaison du banc d'essai est augmentée depuis la position horizontale jusqu'à un angle auquel la personne réalisant l'essai se trouve en position instable.
E.2 Personne réalisant l'essai
La personne réalisant l'essai est un adulte, pieds nus, dont les pieds doivent avoir été mouillés pendant au moins 10 min avant le début de l'essai. La personne doit être protégée contre la chute par un dispositif de sécurité qui doit lui permettre de se déplacer librement sur la surface soumise à essai.
NOTE Pour que les personnes se familiarisent avec la méthode d'essai, il convient qu'elles s'entraînent sur des surfaces dont les propriétés antidérapantes ont été prédéterminées conformément à la présente annexe.
E.3 Banc d'essai
Une plaque plane mesurant 600 mm de large et 2 000 mm de long, avec un angle d’inclinaison réglable de 0° à 45° doit être utilisée comme équipement d'essai. Un côté court doit être monté sur une charnière au sol et un inclinomètre avec des divisions de 1° doit être installé sur un côté du dispositif, pour indiquer l’angle d'inclinaison de la plaque par rapport au plan horizontal.
Pour la sécurité de la personne, des mains-courantes doivent être installées sur les côtés longitudinaux du dispositif.
E.4 Liquide d'essai
Le liquide d'essai doit être une solution aqueuse d'agent mouillant neutre, d'une concentration de 1 g/l. L'eau peut être celle fournie par le réseau de distribution municipal d'eau potable.
E.5 Éprouvette d'essai
L'éprouvette doit couvrir une surface d'au moins 1 000 mm de long et 500 mm de large. Les éléments de forme irrégulière doivent être placés les uns à côté des autres, aussi près que possible, pour couvrir la surface d'essai de 1 000 mm 500 mm.
Lorsque la résistance au glissement varie selon l’orientation, l’éprouvette doit être montée sur la surface d’essai dans la direction la plus défavorable.
Les fugues (surfaces libres entre les éléments) doivent être remplies avec un mastic du même type que celui utilisé pour les joints de carrelage en céramique.
E.6 Méthode d'essai
Le niveau des fugues doit être le même que celui des surfaces proches de l'élément dans une installation adaptée. Si les fugues se développent principalement dans une seule direction, l'éprouvette doit être soumise à essai dans cette direction et à un angle de 90°.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
33
L'éprouvette est montée et centrée sur la plaque plane du banc d'essai, dans la position la plus défavorable. Pendant toute la durée de l'essai, l'éprouvette doit être mouillée en continu et régulièrement avec au moins 5 l/min de liquide d'essai.
La personne réalisant l'essai se déplace de la moitié de la longueur d'une marche, en avant et en arrière, en position debout, en fixant la surface de l'éprouvette, dans le sens en aval. En même temps, l'inclinaison du banc d'essai augmente d'environ 1°/s, en commençant par la position horizontale. L'angle d'inclinaison auquel la personne n'est plus stable doit être déterminé en modifiant plusieurs fois l'inclinaison du dispositif autour de la valeur critique.
L'angle d'inclinaison doit être déterminé douze fois, en commençant à chaque fois par la position horizontale de l'éprouvette.
E.7 Évaluation
Pour l'évaluation des résultats, les valeurs les plus élevées et les plus basses du groupe de douze essais ne doivent pas être prises en compte.
La moyenne arithmétique des dix essais restants, arrondie au degré supérieur le plus proche, doit être indiquée comme résultat de l'essai.
E.8 Classification
Toutes les pièces de l'équipement doivent être classées en trois groupes d'évaluation :
a) 12° : les articles ayant un résultat d'essai compris entre 12° et 17°;
b) 18° : les articles ayant un résultat d'essai compris entre 18° et 23°;
c) 24° : les articles ayant un résultat d'essai supérieur ou égal à 24°.
E.9 Rapport d'essai
Le rapport d'essai doit également indiquer :
a) les caractéristiques de l'éprouvette ;
b) l'angle d'inclinaison.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
35
Annexe F (normative)
Utilisation d'acier inoxydable ayant des fonctions de support de charge dans l'atmosphère d'une piscine
F.1 Généralités
L'acier inoxydable est utilisé dans de nombreuses constructions de piscines. « Acier inoxydable » est de ce fait un nom collectif pour une multitude de matériaux différents ayant une composition d'alliage différente.
Outre des solutions de construction appropriées (par exemple : absence de vides) et une surface aussi lisse que possible, le choix du bon matériau est le critère le plus décisif pour éviter les problèmes de corrosion. Un autre critère décisif est l’accessibilité à des fins de nettoyage et d’inspection.
Les nuances d’acier inoxydable indiquées à la présente !Annexe F" doivent être utilisées pour les parties structurelles dans un environnement riche en chlorures : elles représentent l’état actuel des connaissances au moment de l’élaboration de la présente Norme européenne. En fonction des évolutions techniques, d’autres nuances d’acier inoxydable pourront être utilisées sous réserve d’une documentation adaptée et complète et d’une expérience relative à leur résistance à la corrosion par fissuration sous contrainte.
La corrosion peut être visible (par exemple, piqûres de corrosion) ou invisible et spontanée sans signe avant-coureur (par exemple, corrosion par fissuration sous contrainte).
La notation doit être conforme à l'EN 10088-1 et l'EN 10088–2. Outre un numéro, chaque acier a une brève désignation (par exemple, l'acier n° 1.4301 est brièvement désigné par X5CrNi18-10).
F.2 Piscines intérieures avec désinfection au chlore
F.2.1 Généralités
Dans les piscines intérieures, il faut tenir compte de l’éventualité d'un environnement hautement corrosif enrichi en chlorures du fait du séchage et de l’évaporation.
F.2.2 Composants ne pouvant pas être nettoyés régulièrement
Pour les éléments de structure dans des environnements riches en chlorures, l'apparition d'une corrosion par fissuration sous contrainte induite par les chlorures doit être prise en compte. Par conséquent, dans les équipements des piscines intérieures et leurs éléments de structure en acier inoxydable qui ne font pas l'objet d'un nettoyage régulier, seuls les matériaux suivants doivent être utilisés :
1.4565 (X2CrNiMnMoNb25-18-5-4) ;
1.4529 (X1NiCrMoCuN25-20-7) ; et
1.4547 (X1CrNiMoCuN20-18-7).
NOTE Dans les environnements où l'eau a une concentration de chlorures inférieure à 250 mg/l (eau potable), le matériau 1.4539 (X1NiCrMoCu25-20-5) peut également être utilisé.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
36
F.2.3 Composants pouvant être nettoyés régulièrement
F.2.3.1 Généralités
Eu égard à la corrosivité et à d'autres conditions connexes, (par exemple, température, humidité, etc.) et seulement dans le cas d'un nettoyage régulier pour des composants et parties facilement accessibles de l'équipement de piscine, en plus des matériaux susmentionnés, l’un des matériaux suivants doit être utilisé :
1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) ;
1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) ;
1.4578 (X3CrNiCuMo17-11-3-2) ;
!
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) ;"
1.4439 (X2CrNiMoN17-13-5) ;
1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3).
F.2.3.2 Concept d’inspection et de nettoyage
Conformément au résultat d'une évaluation des risques, un concept d’inspection et de nettoyage réguliers doit être établi par le fabricant de l'équipement de piscine.
Le concept de nettoyage doit réduire au minimum l’enrichissement en chlorures sur la surface du matériau et doit nécessiter des enregistrements appropriés.
F.3 Piscines extérieures avec désinfection au chlore
Les piscines extérieures désinfectées au chlore sont en général un environnement moins corrosif bien qu’une corrosivité plus élevée puisse apparaître localement, par exemple au-dessus des surfaces d'eau. Le danger d'enrichissement en chlorures est plus faible car la pluie lave les électrolytes.
Le choix du matériau approprié pour l'équipement de piscine et ses éléments de structure doit être effectué avec soin, en considérant la corrosivité de l'environnement et le nettoyage prévu des surfaces. Dans les environnements moins corrosifs ou lorsqu’un nettoyage régulier des éléments et composants facilement accessibles est prévu, l’un des matériaux suivants doit également être utilisé :
1.4301 (X5CrNi18-10) ;
1.4307 (X2CrNi18-9) ;
1.4567 (X3CrNiCu18-9-4) ;
1.4541 (X6CrNiTi18-10) ;
1.4318 (X2CrNiN18-7).
F.4 Revêtements et peintures
Le revêtement des surfaces en acier oxydable ne constitue pas une protection suffisante contre la corrosion et ne justifie jamais le choix d'un matériau moins résistant à la corrosion.
Projet
de no
rme m
aroca
ine
EN 13451-1:2011+A1:2016 (F)
37
Bibliographie
[1] EN 335-1, Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes d’emploi — Partie 1 : Généralités
[2] EN 335-2, Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes d’emploi — Partie 2 : Application au bois massif
[3] EN 335-3, Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes de risque d’attaque biologique — Partie 3 : Application aux panneaux à base de bois
[4] EN 13451-3, Équipement de piscine — Partie 3 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires propres aux pièces d’aspiration et de refoulement et aux équipements de loisirs aquatiques disposant d’introduction et d’extraction d’eau/d’air
[5] EN 1176-1:2008, Équipements et sols d’aires de jeux — Partie 1 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai générales
[6] EN 15288-2, Piscines — Partie 2 : Exigences de sécurité pour le fonctionnement
!
[7] EN 12503-1, Tapis de sport — Partie 1 : Tapis de gymnastique, exigences de sécurité
[8] EN 12503-5, Tapis de sport — Partie 5 : Détermination des caractéristiques antidérapantes de la base
[9] EN 12503-6, Tapis de sport — Partie 6 : Détermination des caractéristiques antidérapantes de la face supérieure
"
[10] EN ISO 1421, Support textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la force de rupture et de l'allongement à la rupture (ISO 1421:1998)
[11] EN ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (ISO/IEC 17025:2005)
[12] ISO 5904, Engins de gymnastique — Tapis de chute et surfaces pour exercices au sol — Détermination de la résistance au glissement
[13] FINA Handbook 2005-2009
[14] Managing health and safety in swimming pools, HSE Books UK, 1999
[15] Sicherheitsregeln für Bäder – GUV 18.14 D, 1984
[16] KOK-Richtlinien für den Bäderbau D, 2002
!
[17] NF T54-405-1, Profilés extrudés ou coextrudés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour usages extérieurs — Spécifications et méthodes d’essai — Partie 1 : PVC-U compact
"
Projet
de no
rme m
aroca
ine