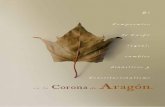Pourquoi la guerre
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Pourquoi la guerre
Sigmund Freud (1856-1939et Albert Einstein (1879-1955)
Respectivement psychanalyste allemand et physicien d’origineallemande
(1933)
“Pourquoila guerre ?”
Un document produit en version numérique par Vincent Magos, bénévole,analyste
Courriel : [email protected] Site web : http ://www.squiggle.be/index.php
Dans le cadre de la collection : "Les classiques des sciences sociales"Site web : http ://classiques.uqac.ca/
Une collection développée en collaboration avec la BibliothèquePaul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933) 2
Site web : http ://bibliotheque.uqac.ca/
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933) 3
Cette édition électronique a été réalisée par Vincent Magos, analyste, bénévole, à partir de :
Sigmund Freud et Albert Einstein
“Pourquoi la guerre ?”
Correspondance entre Albert Einstein et SigmundFreud. Il s'agit de la version éditée à l'initiative del'Institut International de Coopération Intellectuelle- Société des nations, en 1933.
Texte disponible, au format pdf sur le site :squiggle.be
ou
http://www.squiggle.be/PDF_Matiere/Pourquoi%20la%20guerre_Freud%20et%20Einstein.pdf
Polices de caractères utilisée :
Pour le texte : Times New Roman, 14 points.Pour les citations : Times New Roman, 12 points.Pour les notes de bas de page : Times New Roman,12 points.
Édition électronique réalisée avec le traitement detextes Microsoft Word 2004 pour Macintosh.
Mise en page sur papier formatLETTRE (US letter), 8.5’’ x 11’’)
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933) 4
Édition numérique réalisée le 27 août 2006à Chicoutimi, Ville de Saguenay, provincede Québec, Canada.
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933) 5
Les auteurs
Albert EinsteinPhysicien (1879-1955)
Voir l’EncyclopédieWikipédia.
Sigmund FreudPsychanalyste
Voir le sites suivants :La psychanalyse, par RenéDegroseillersmagapsy.com
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933) 6
Table des matières
Pourquoi la guerre ?
Correspondance entre Albert Einstein et SigmundFreud. Il s'agit de la version éditée à l'initiativede l'Institut International de CoopérationIntellectuelle - Société des nations, en 1933.
1)Lettre d’Albert Einstein à Sigmund Freud, Potsdam, le 30 juillet 1932
2)Lettre de Sigmund Freud à Albert Einstein,Vienne, septembre 1932.
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933) 7
Sigmund Freud et Albert Einstein
“Pourquoi la guerre ?”
Correspondance entre Albert Einstein et SigmundFreud. Il s'agit de la version éditée à l'initiative del'Institut International de Coopération Intellectuelle- Société des nations, en 1933.
“Pourquoi la guerre ?”
1) ALBERT EINSTEIN
Potsdam, le 30 juillet 1932.
Monsieur et Cher Ami,
Retour à la table des matières
Je suis heureux qu’en m’invitant à un libreéchange de vues avec une personne de mon choixsur un sujet désigné à mon gré, la Société desNations et son Institut international deCoopération Intellectuelle à Paris m’aient, enquelque sorte, donné l‘occasion précieuse dem’entretenir avec vous d’une question qui, enl’état présent les choses, m’apparaît comme laplus importante dans l’ordre de lacivilisation : Existe-t-il un moyen
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933) 8
d’affranchir les hommes de la menace de laguerre ?
D’une façon assez générale, on s’entendaujourd’hui à reconnaître que les progrès de latechnique ont rendu pareille questionproprement vitale pour l’humanité civilisée, etcependant les ardents efforts consacrés à lasolution de ce problème ont jusqu’ici échouédans d’effrayantes proportions.
Je crois que, parmi ceux aussi que ceproblème occupe pratiquement etprofessionnellement, le désir se manifeste,issu d’un certain sentiment d’impuissance, desolliciter sur ce point l’avis de personnes quele commerce habituel des sciences a placées àune heureuse distance à l’égard de tous lesproblèmes de la vie. En ce qui me concerne, ladirection habituelle de ma pensée n’est pas decelles qui ouvrent des aperçus dans lesprofondeurs de la volonté et du sentimenthumains, et c’est pourquoi, dans l’échange devues que j’amorce ici, je ne puis guère songerà faire beaucoup plus qu’essayer de poser leproblème et, tout en laissant par avance decôté les tentatives de solution plus ou moinsextérieures, vous donner l’occasion d’éclairerla question sous l’angle de votre profondeconnaissance de la vie instinctive de l’homme.Je suis convaincu que vous serez à mêmed’indiquer des moyens éducatifs qui, par unevoie, dans une certaine mesure étrangère à la
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933) 9
politique, seraient de nature à écarter desobstacles psychologiques, que le profane en lamatière peut bien soupçonner, mais dont iln’est pas capable de jauger les correspondanceset les variations.
Pour moi qui suis un être affranchi depréjugés nationaux, la face extérieure duproblème — en l’espèce, l’élémentd’organisation — m’apparaît simple : les Étatscréent une autorité législative et judiciairepour l’apaisement de tous les conflits pouvantsurgir entre eux. Ils prennent l’engagement dese soumettre aux lois élaborées par l’autoritélégislative, de faire appel au tribunal danstous les cas litigieux, de se plier sansréserve à ses décisions et d’exécuter, pour enassurer l’application, toutes les mesures quele tribunal estime nécessaires. Je touche là àla première difficulté : Un tribunal est uneinstitution humaine qui pourra se montrer, dansses décisions, d’autant plus accessible auxsollicitations extra-juridiques qu’elledisposera de moins de force pour la mise envigueur de ses verdicts. Il est un fait aveclequel il faut compter : droit et force sontinséparablement liés, et les verdicts d’unorgane juridique se rapprochent de l’idéal dejustice de la communauté, au nom et dansl’intérêt de laquelle le droit est prononcé,dans la mesure même où cette communauté peutréunir les forces nécessaires pour fairerespecter son idéal de justice. Mais nous
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)10
sommes actuellement fort loin de détenir uneorganisation supra-étatiste qui soit capable deconférer à son tribunal une autoritéinattaquable et de garantir la soumissionabsolue à l’exécution de ses sentences. Etvoici le premier principe qui s’impose à monattention : La voie qui mène à la sécuritéinternationale impose aux États l’abandon sanscondition d’une partie de leur libertéd’action, en d’autres termes, de leursouveraineté, et il est hors de doute qu’on nesaurait trouver d’autre chemin vers cettesécurité.
Un simple coup d’oeil sur l’insuccès desefforts, certainement sincères, déployés aucours des dix dernières années permet à chacunde se rendre compte que de puissantes forcespsychologiques sont à l’oeuvre, qui paralysentces efforts. Certaines d’entre elles sontaisément perceptibles. L’appétit de pouvoir quemanifeste la classe régnante d’un Etatcontrecarre une limitation de ses droits desouveraineté. Cet « appétit politique depuissance » trouve souvent un aliment dans lesprétentions d’une autre catégorie dont l’effortéconomique se manifeste de façon toutematérielle. Je songe particulièrement ici à cegroupe que l’on trouve au sein de chaque peupleet qui, peu nombreux mais décidé, peu soucieuxdes expériences et des facteurs sociaux, secompose d’individus pour qui la guerre, lafabrication et le trafic des armes ne
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)11
représentent rien d’autre qu’une occasion deretirer des avantages particuliers, d’élargirle champ de leur pouvoir personnel.
Cette simple constatation n’est toutefoisqu’un premier pas dans la connaissance desconjonctures. Une question se pose aussitôt :Comment se fait-il que cette minorité-là puisseasservir à ses appétits la grande masse dupeuple qui ne retire d’une guerre quesouffrance et appauvrissement ? (Quand jeparle de la masse du peuple, je n’ai pasdessein d’en exclure ceux qui, soldats de toutrang, ont fait de la guerre une profession,avec la conviction de s’employer à défendre lesbiens les plus précieux de leur peuple et dansla pensée que la meilleure défense est parfoisl’attaque.) Voici quelle est à mon avis lapremière réponse qui s’impose : Cette minoritédes dirigeants de l’heure a dans la main toutd’abord l’école, la presse et presque toujoursles organisations religieuses. C’est par cesmoyens qu’elle domine et dirige les sentimentsde la grande masse dont elle fait soninstrument aveugle.
Mais cette réponse n’explique pas encorel’enchaînement des facteurs en présence car uneautre question se pose : Comment est-ilpossible que la masse, par les moyens que nousavons indiqués, se laisse enflammer jusqu’à lafolie et au sacrifice ? Je ne vois pas d’autreréponse que celle-ci : L‘homme a en lui un
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)12
besoin de haine et de destruction. En tempsordinaire, cette disposition existe à l’étatlatent et ne se manifeste qu’en périodeanormale ; mais elle peut être éveillée avecune certaine facilité et dégénérer en psychosecollective. C’est là, semble- t-il, que résidele problème essentiel et le plus secret de cetensemble de facteurs. Là est le point surlequel, seul, le grand connaisseur desinstincts humains peut apporter la lumière.
Nous en arrivons ainsi à une dernièrequestion : Existe-t-il une possibilité dediriger le développement psychique de l’hommede manière à le rendre mieux armé contre lespsychoses de haine et de destruction ? Et loinde moi la pensée de ne songer ici qu’aux êtresdits incultes. J’ai pu éprouver moi-même quec’est bien plutôt la soi-disant« intelligence » qui se trouve être la proie laplus facile des funestes suggestionscollectives, car elle n’a pas coutume de puiseraux sources de l’expérience vécue, et que c’estau contraire par le truchement du papierimprimé qu’elle se laisse le plus aisément etle plus complètement saisir.
Et, pour terminer, ceci encore : je n’aiparlé jusqu’ici que de la guerre entre États,en d’autres termes, des conflits ditsinternationaux. Je n’ignore pas quel’agressivité humaine se manifeste égalementsous d’autres formes et dans d’autres
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)13
conditions (par exemple la guerre civile,autrefois causée par des mobiles religieux,aujourd’hui par des mobiles sociaux, — lapersécution des minorités nationales). Maisc’est à dessein que j’ai mis en avant la formede conflit la plus effrénée qui se manifeste ausein des communautés humaines, car c’est enpartant de cette forme là qu’on décèlera leplus facilement les moyens d’éviter lesconflits armés.
Je sais que dans vos ouvrages vous avezrépondu, soit directement soit indirectement, àtoutes les questions touchant au problème quinous intéresse et nous presse. Mais il y auraitgrand profit à vous voir développer le problèmede la pacification du monde sous le jour de vosnouvelles investigations, car un tel ex-posépeut être la source de fructueux efforts.
Très cordialement à vous.A. Einstein
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)14
“Pourquoi la guerre ?”
2) SIGMUND FREUD
Vienne, septembre 1932.
Cher Monsieur Einstein,
Retour à la table des matières
En apprenant que vous aviez l’intention dem’inviter à un échange de vues sur un sujetauquel vous accordez votre intérêt et qui voussemble mériter aussi l’attention d’autrespersonnes, je n’ai pas hésité à me prêter à cetentretien. Je présumais que vous choisiriez unproblème qui fût aux confins de ce que l’onpeut connaître aujourd’hui, et auquel nouspussions l’un et l’autre, le physicien et lepsychologue, accéder chacun par sa propre voie,de manière à nous rencontrer sur le mêmeterrain, tout en partant de régionsdifférentes. Aussi m’avez-vous surpris en meposant la question de savoir ce que l’on peutfaire pour libérer les humains de la menace dela guerre. J’ai été tout d’abord effrayé de mon— j’allais dire notre — incompétence, car jevoyais là une tâche pratique dont l’apanage
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)15
revenait aux hommes d’Etat. Mais je me suisrendu compte que vous n’aviez pas soulevé laquestion en tant qu’homme de science etphysicien, mais comme ami des humains,répondant à l’invitation de la Société desNations, tel l’explorateur Fridtjof Nansenlorsqu’il entreprit de venir en aide auxaffamés et aux victimes de la guerre mondiale,privés de patrie. Je réfléchis aussi que l’onn’attendait pas de moi l’énoncé de propositionspratiques, mais que j’avais simplement àexposer le problème de la sauvegarde de lapaix, à la lumière de l’examen psychologique.
Mais là-dessus encore, vous avez ditl’essentiel dans votre lettre et vous m’avez dumême coup pris le vent de mes voiles, mais jeme prête volontiers à voguer dans votre sillageet je me contenterai de confirmer ce que vousavancez, tout en y apportant mes digressions,au plus près de mes connaissances — ou de mesconjectures.
Vous commencez par poser la question entredroit et force. C’est là, assurément, le justepoint de départ de notre enquête. Puis-je mepermettre de substituer au mot « force » leterme plus incisif et dur de « violence » ?Droit et violence sont actuellement pour nousdes antinomies. Il est facile de montrer quel’un est dérivé de l’autre, et si nousremontons aux origines primitives pour examinerde quelle manière le phénomène s’est produit
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)16
tout d’abord, la solution du problème nousapparaît sans difficulté. Si, dans ce qui vasuivre, vous me voyez exposer comme au tantd’éléments nouveaux, des faits généralementconnus et reconnus, vous me le pardonnerez lafiliation des données m’y obligeait.
Les conflits d’intérêts surgissant entre leshommes sont donc, eu principe, résolus par laviolence. Ainsi en est-il dans tout le règneanimal, dont l’homme ne saurait s’exclure ;pour l’homme, il s’y ajoute encore, bienentendu, des conflits d’opinion, qui s’élèventjusqu’aux plus hauts sommets de l’abstractionet dont la solution semble nécessiter unetechnique différente. Mais cette complicationn’est apparue que plus tard. A l’origine, dansune horde restreinte, c’est la supériorité dela force musculaire qui décidait ce qui devaitappartenir à l’un, ou quel était celui dont lavolonté devait être appliquée, lia forcemusculaire se trouve secondée et bientôtremplacée par l’usage d’instruments ; lavictoire revient à qui possède les meilleuresarmes ou en use avec le plus d’adresse.L’intervention de l’arme marque le moment oùdéjà la suprématie intellectuelle commence àprendre la place de la force musculaire ; lebut dernier de la lutte reste le même : l’unedes parties aux prises doit être contrainte,par le dommage qu’elle subit et parl’étranglement de ses forces, à abandonner sesrevendications ou son opposition. Ce résultat
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)17
est acquis au maximum lorsque la violenceélimine l’adversaire de façon durable, le tuepar conséquent. Ce procédé offre deuxavantages : l’adversaire ne pourra reprendre lalutte à une nouvelle occasion et son sortdissuadera les autres de suivre son exemple.Par ailleurs, la mise à mort de l’ennemisatisfait une disposition instinctive, surlaquelle nous aurons à revenir. Il arrive qu’audessein de tuer vienne s’opposer le calculselon lequel l’ennemi peut être employé pourrendre d’utiles services, si, une fois tenu enrespect, on lui laisse la vie sauve. En pareilcas la violence se contente d’asservir au lieude tuer. C’est ainsi qu’on commence à épargnerl’ennemi, mais le vainqueur a dès lors àcompter avec la soif de vengeance aux aguetschez le vaincu, et il abandonne une part de sapropre sécurité.
Tel est donc l’état originel, le règne de lapuissance supérieure, de la violence brutale ouintellectuellement étayée. Nous savons que cerégime s’est modifié au cours de l’évolution,et qu’un chemin a conduit de la violence audroit, — mais lequel ? Il n’en est qu’un, àmon avis, et c’est celui qui aboutit au faitque l’on peut rivaliser avec un plus fort parl’union de plusieurs faibles. « L’union fait laforce. » La violence est brisée par l’union, laforce de ces éléments rassemblés représente dèslors le droit, par opposition à la violenced’un seul. Nous voyons donc que le droit est la
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)18
force d’une communauté. C’est encore laviolence, toujours prête à se tourner contretout individu qui lui résiste, travaillant avecles mêmes moyens, attachée aux mêmes buts ; ladifférence réside, en réalité, uniquement dansle fait que ce n’est plus la violence del’individu qui triomphe, mais celle de lacommunauté. Mais, pour que s’accomplisse cepassage de la violence au droit nouveau, ilfaut qu’une condition psychologique soitremplie. L’union du nombre doit être stable etdurable. Si elle se créait à seule fin decombattre un plus puissant pour se dissoudreune fois qu’il est vaincu, le résultat seraitnul. Le premier qui viendrait ensuite às’estimer plus fort chercherait de nouveau àinstituer une hégémonie de violence, et le jeuse répéterait indéfiniment. La communauté doitêtre maintenue en permanence, s’organiser,établir des règlements qui préviennent lesinsurrections à craindre, désigner des organesqui veillent au maintien des règlements, — deslois, et qui assurent l’exécution des actes deviolence conformes aux lois. De par lareconnaissance d’une semblable communautéd’intérêts, il se forme, au sein des membresd’un groupe d’hommes réunis, des attachesd’ordre sentimental, des sentiments decommunauté, sur lesquels se fonde, à proprementparler, la force de cette collectivité.
Je crois avoir ainsi indiqué tous leséléments essentiels ; le triomphe sur la
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)19
violence par la transmission du pouvoir à uneplus vaste unité, amalgamée elle-même par desrelations de sentiments. Tout le reste n’estque commentaires et redites. La situation estsimple, tant que la communauté ne se composeque d’un certain nombre d’individus d’égaleforce. Les lois de cette association fixentalors, en ce qui concerne les manifestationsviolentes de la force, la part de libertépersonnelle à laquelle l’individu doit renoncerpour que la vie en commun puisse se poursuivreen sécurité. Mais un tel état de tranquilliténe se conçoit que théoriquement ; de fait, lecours des choses se complique, parce que lacommunauté, dès l’origine, renferme deséléments de puissance inégale — hommes etfemmes, parents et enfants — et que bientôt, laguerre et l’assujettissement créent desvainqueurs et des vaincus, qui se transformenten maîtres et esclaves. Le droit de lacommunauté sera, dès lors, l’expression de cesinégalités de pouvoir, les lois seront faitespar et pour les dominateurs, et on laissera peude prérogatives aux sujets. A partir de cemoment-là, l’ordre légal se trouve exposé à desperturbations de deux provenances : toutd’abord les tentatives de l’un ou de l’autredes seigneurs pour s’élever au-dessus desrestrictions appliquées à tous ses égaux, pourrevenir, par conséquent, du règne du droit aurègne de la violence ; en second lieu, lesefforts constants des sujets pour élargir leurpouvoir et voir ces modifications reconnues
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)20
dans la loi, donc pour réclamer, au contraire,le passage du droit inégal au droit égal pourtous. Ce dernier courant sera particulièrementmarqué quand se produiront véritablement, ausein de la communauté, des modifications dansles attributions du pouvoir comme il arrive parsuite de divers facteurs historiques. Le droitpeut alors s’adapter insensiblement à cesnouvelles conditions, ou, ce qui est plusfréquent, la classe dirigeante n’est pasdisposée à tenir compte de ce changement :c’est l’insurrection, la guerre civile, d’où lasuppression momentanée du droit, et de nouveauxcoups de force, à l’issue desquels s’instaureun nouveau régime du droit. Il est encore uneautre source de transformation du droit, qui nese manifeste que par voie pacifique, et c’estle changement de culture qui s’opère parmi lesmembres de la communauté ; mais il rentre dansun ordre de phénomènes qui ne pourra êtretraité que plus loin.
Nous voyons donc que, même à l’intérieurd’une communauté, le recours à la violence nepeut être évité dans la solution des conflitsd’intérêt. Mais les nécessités, les communautésd’intérêt issues d’une existence commune sur unmême sol, hâtent l’apaisement de ces luttes et,sous de tels auspices, les possibilités desolutions pacifiques sont en progressionconstante. Mais il suffit de jeter un coupd’oeil sur l’histoire de l’humanité pourassister à un défilé ininterrompu de conflits,
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)21
que ce soit une communauté aux prises avec unou plusieurs autres groupements, que ce soitentre unités tantôt vastes tantôt plusréduites, entre villes, pays, tribus, peuples,empires, conflits presque toujours résolus parl’épreuve des forces au cours d’une guerre. Detelles guerres aboutissent ou bien au pillage,ou bien à la soumission complète, à la conquêtede l’une des parties.
On ne saurait porter un jugement d’ensemblesur les guerres de conquête. Nombre d’entreelles, comme celle des Mongols et des Turcs,n’ont apporté que du malheur ; d’autres, enrevanche, ont contribué à la transformation dela violence en droit, en créant de plus vastesunités au sein desquelles la possibilité du re-cours à la force se trouvait supprimée et unnouveau régime de droit apaisait les conflits,Ainsi les conquêtes romaines qui apportèrentaux pays méditerranéens la précieuse pax romana.Les ambitions territoriales des rois de Franceont créé un royaume uni dans la paix etflorissant. Si paradoxal que cela puisseparaître, force nous est d’avouer que la guerrepourrait bien n’être pas un moyen inopportunpour la fondation de la paix « éternelle », carelle s’avère capable de constituer les vasteunités au sein desquelles une puissancecentrale rend de nouvelles guerres impossibles.Cependant elle n’aboutit pas à ce résultat, carles succès de la conquête sont, en règlegénérale, de courte durée, les unités nouvelle-
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)22
meut créées se désagrègent à leur tour presquetoujours faute de cohésion entre les partiesréunies par contrainte. Et, de plus, laconquête n’a pu créer, jusqu’ici, que desunifications partielles, — de grande envergureil est vrai, — et dont les conflits réclamèrentjustement des solutions brutales. Le résultatde tous ces efforts guerriers fut simplementque l’humanité échangea les innombrables etquasi incessantes escarmouches contre degrandes guerres, d’autant plus dévastatricesqu’elles étaient rares.
En ce qui concerne notre époque, la mêmeconclusion s’impose, à laquelle vous avezabouti par un plus court chemin. II n’estpossible d’éviter à coup sûr la guerre que siles hommes s’entendent pour instituer unepuissance centrale aux arrêts de laquelle ons’en remet dans tous les conflits d’intérêt. Enpareil cas, deux nécessités s’imposent au mêmetitre : celle de créer une semblable instancesuprême et celle de la doter de la forceappropriée. Sans la seconde, la première n’estd’aucune utilité. Or la Société des Nations abien été conçue comme autorité suprême de cegenre, mais la deuxième condition n’est pasremplie. La Société des Nations ne dispose pasd’une force à elle et ne peut en obtenir que siles membres de la nouvelle association, — lesdifférents États, — la lui concèdent. Et il y apeu d’espoir, pour le moment, que la chose seproduise. Mais on ne comprendrait en somme pas
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)23
pourquoi cette institution a été créée, si l’onne savait qu’elle représente, dans l’histoirede l’humanité, une tentative bien rarementconçue, et jamais réalisée en de pareillesproportions. Tentative qui consiste à acquérirl’autorité, c’est-à-dire l’influencecontraignante, d’ordinaire basée sur ladétention de la force, en faisant appel àcertains principes idéaux. Deux facteurs, nousl’avons vu, assurent la cohésion d’unecommunauté : la contrainte de violence et lesrelations de sentiment. — les identifications,comme on les désignerait en langage technique,— entre les membres de ce même corps. Si l’undes facteurs vient à disparaître, il se peutfaire que l’autre maintienne la communauté. Detelles notions ne peuvent naturellement avoirune signification que si elles correspondent àd’importants éléments de communauté. Restealors à savoir quelle en est la puissance.L’histoire nous apprend que ces notions ontréellement exercé leur action. L’idéepanhellénique, par exemple, la conscienced’être quelque chose de mieux que les barbaresvoisins, et dont on retrouve la si vigoureuseexpression dans les confédérationsamphictyoniques, dans les oracles et dans lesjeux, fut assez puissante pour adoucir lerégime de la guerre parmi les Grecs, mais nonpoint suffisante, naturellement, pour supprimerles conflits armés entre les diverses factionsdu peuple grec ni même pour dissuader une villeou une fédération de villes de s’allier aux
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)24
Perses ennemis pour abaisser un rival. Lesentiment de communauté chrétienne, dont onsait pourtant la puissance, n’a pas davantage,au temps de la Renaissance, empêché de petitset de grands États chrétiens de rechercherl’appui du Sultan dans les guerres qu’ils selivrèrent entre eux. A notre époque également,il n’est aucune idée à qui l’on puisse accorderune telle autorité conciliatrice. Les idéalsnationaux qui gouvernent aujourd’hui lespeuples, — la chose n’est que trop claire, —.poussent à l’acte d’opposition. I1 ne manquepas de gens pour prédire que, seule, lapénétration universelle de l’idéologiebolcheviste pourra mettre un terme aux guerres,-— mais nous sommes de toute manière encorefort loin d’un tel aboutissement, et peut-êtren’y saurait-on parvenir qu’après d’effroyablesguerres civiles. Il semble donc que latentative consistant à remplacer la puissancematérielle par la puissance des idées setrouve, pour le moment encore, vouée à l’échec,on commet une erreur de calcul en négligeant lefait que le droit était, à l’origine, la forcebrutale et qu’il ne peut encore se dispenser duconcours de la force.
Je ne puis mieux faire maintenant quecommenter une autre de vos propositions. Vousvous étonnez qu’il soit si facile d’exciter leshommes à la guerre et vous présumez qu’ils onten eux un principe actif, un instinct de haineet de destruction tout prêt à accueillir cette
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)25
sorte d’excitation. Nous croyons à l’existenced’un tel penchant et nous nous sommesprécisément efforcés, au cours de ces dernièresannées, d’en étudier les manifestations.Pourrais-je, à ce propos, vous exposer unepartie des lois de l’instinct auxquelles nousavons abouti, après maints tâtonnements etmaintes hésitations ? Nous admettons que lesinstincts tic l’homme se ramènent exclusivementà deux catégories : d’une part ceux qui veulentconserver et unir ; nous les appelonsérotiques, — exactement au sens d’eros dans leSymposion de Platon, -— ou sexuels, en donnantexplicitement à ce terme l’extension du conceptpopulaire de sexualité ; d’autre part, ceux quiveulent détruire et tuer ; nous les englobonssous les termes de pulsion agressive ou pulsiondestructrice. Ce n’est en somme, vous le voyez,que la transposition théorique de l’antagonismeuniversellement connu de l’amour et de lahaine, qui est peut-être une forme de lapolarité d’attraction et de répulsion qui joueun rôle dans votre domaine. — Mais ne nousfaites pas trop rapidement passer aux notionsde bien et de mal. — Ces pulsions sont toutaussi indispensables l’une que l’antre ; c’estde leur action conjuguée ou antagoniste quedécoulent les phénomènes de la vie. Or ilsemble qu’il n’arrive guère qu’un instinct del’une des deux catégories puisse s’affirmerisolément ; il est toujours « lié », selonnotre expression, à une certaine quantité del’autre catégorie, qui modifie son but, ou,
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)26
suivant les cas, lui en permet seulel’accomplissement. Ainsi, par exemple,l’instinct de conservation est certainement denature érotique ; mais c’est précisément cemême instinct qui doit pouvoir recourir àl’agression, s’il veut faire triompher sesintentions. De même l’instinct d’amour,rapporté à des objets, a besoin d’un dosaged’instinct de possession, s’il veut endéfinitive entrer en possession de son objet.Et c’est précisément la difficulté qu’onéprouve à isoler les deux sortes d’instincts,dans leurs manifestations, qui nous a silongtemps empêché de les reconnaître.
Si vous voulez bien poursuivre encore un peuavec moi, vous verrez que les actions humainesrévèlent une complication d’une autre sorte. Ilest très rare que l’acte soit l’oeuvre d’uneseule incitation instinctive, qui déjà en elle-même doit être un composé d’eros et dedestruction. En règle générale, plusieursmotifs, pareillement composés, doiventcoïncider pour amener l’action. L’un de vosconfrères l’avait déjà perçu, — je veux parlerici du professeur G. Ch. Lichtenberg, quienseignait la physique à Göttingue à l’époquede nos classiques ; mais chez lui, lepsychologue était peut-être plus importantencore que le physicien. Il avait découvert larose des motifs quand il déclarait « Lesmobiles en raison desquels nous agissonspourraient être répartis comme les trente-deux
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)27
vents et leurs appellations se formuler Pain —Pain-Renommée ou Renommée — Renommée-Pain. ».
Ainsi donc, lorsque les hommes sont incités àla guerre, toute une série de motifs peuvent eneux trouver un écho à cet appel, les unsnobles, les autres vulgaires, certains dont onparle ouvertement et d’autres que l’on tait.Nous n’avons aucune raison de les énumérertous. Le penchant à l’agression et à ladestruction se trouve évidemment au nombre deceux-ci : d’innombrables cruautés que nousrapportent l’histoire et la vie journalière enconfirment l’existence. En excitant cespenchants à la destruction par d’autrestendances érotiques et spirituelles, on leurdonne naturellement le moyen de s’épancher pluslibrement. Parfois, lorsque nous entendonsparler des cruautés de l’histoire, nous avonsl’impression que les mobiles idéalistes n’ontservi que de paravent aux appétitsdestructeurs ; en d’autres cas, s’il s’agit parexemple des cruautés de la Sainte Inquisition,nous pensons que les mobiles idéaux se sontplacés au premier plan, dans le conscient, etque les mobiles destructeurs leur ont donné,dans l’inconscient, un supplément de force. Lesdeux possibilités sont plausibles.
J’ai scrupule à abuser de votre attention quientend se porter sur les moyens de prévenir laguerre et non sur nos théories. Et pourtant jevoudrais m’attarder encore un instant à notre
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)28
instinct de destruction, dont la vogue n’estrien en regard de son importance. Avec unepetite dépense de spéculation, nous en sommesarrivés à concevoir que cette pulsion agit ausein de tout être vivant et qu’elle tend à levouer à la ruine, à ramener la vie à l’état dematière inanimée. Un tel penchant méritaitvéritablement l’appellation d’instinct de mort,tandis que les pulsions érotiques représententles efforts vers la vie. L’instinct de mortdevient pulsion destructrice par le fait qu’ils’extériorise, à l’aide de certains organes,contre les objets. L’être animé protège pourainsi dire sa propre existence en détruisantl’élément étranger. Mais une part del’instinct. de mort demeure agissante au-dedansde l’être animé et nous avons tenté de fairedériver toute une série de phénomènes normauxet pathologiques de cette réversion intérieurede la pulsion destructrice. Nous avons mêmecommis l’hérésie d’expliquer l’origine de notreconscience par un de ces revirements del’agressivité vers le dedans. On ne sauraitdonc, vous le voyez, considérer un telphénomène à la légère, quand il se manifestesur une trop grande échelle ; il en devientproprement malsain, tandis que l’application deces forces instinctives à la destruction dansle monde extérieur soulage l’être vivant etdoit avoir une action bienfaisante. Cela peutservir d’excuse biologique à tous les penchantshaïssables et dangereux contre lesquels nousluttons. Force nous est donc d’avouer qu’ils
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)29
sont plus près de la nature que la résistanceque nous leur opposons et pour laquelle il nousfaut encore trouver une explication. Peut-êtreavez-vous l’impression que nos théories sontune manière de mythologie qui, en l’espèce, n’arien de réconfortant. Mais est-ce que toutescience ne se ramène pas à cette sorte demythologie ? En va-t-il autrement pour vousdans le domaine de la physique ?
Voilà qui nous permet de conclure, pourrevenir à notre sujet, que l’on ferait oeuvreinutile à prétendre supprimer les penchantsdestructeurs des hommes. En des contréesheureuses de la terre, où la nature offre àprofusion tout ce dont l’homme a besoin, ildoit y avoir des peuples dont la vie s’écouledans la douceur et qui ne connaissent ni lacontrainte ni l’agression. J’ai peine à ycroire et je serais heureux d’en savoir pluslong sur ces êtres de félicité. Lesbolchevistes eux aussi espèrent arriver àsupprimer l’agression humaine en assurantl’assouvissement des besoins matériels tout eninstaurant l’égalité entre les bénéficiaires dela communauté. J’estime que c’est là uneillusion. Ils sont, pour l’heure,minutieusement armés et la haine qu’ilsentretiennent à l’égard de tous ceux qui nesont pas des leurs n’est pas le moindreadjuvant pour s’assurer la cohésion de leurspartisans. D’ailleurs, ainsi que vous lemarquez vous-même, il ne s’agit pas de
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)30
supprimer le penchant humain à l’agression ; onpeut s’efforcer de le canaliser, de telle sortequ’il ne trouve son mode d’expression dans laguerre.
En partant de nos lois mythologiques del’instinct, nous arrivons aisément à uneformule qui fraye indirectement une voie à lalutte contre la guerre. Si la propension à laguerre est un produit de la pulsiondestructrice, il y a donc lieu de faire appel àl’adversaire de ce penchant, à l’eros. Tout cequi engendre, parmi les hommes, des liens desentiment doit réagir contre la guerre. Cesliens peuvent être de deux sortes. En premierlieu, des rapports tels qu’il s’en manifeste àl’égard d’un objet d’amour, même sansintentions sexuelles. La psychanalyse n’a pas àrougir de parler d’amour, en l’occurrence, carla religion use d’un même langage : aime tonprochain comme toi- même. Obligation facile àproférer, mais difficile à remplir. La secondecatégorie de liens sentimentaux est celle quiprocède de l’identification. C’est sur eux querepose, en grande partie, l’édifice de lasociété humaine.
Je trouve, dans une critique que vous portezsur l’abus de l’autorité, une secondeindication pour la lutte indirecte contre lepenchant à la guerre. C’est l’une des faces del’inégalité humaine, — inégalité native et quel’on ne saurait combattre, — qui veut, cette
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)31
répartition en chefs et en sujets. Ces derniersforment la très grosse majorité ; ils ontbesoin d’une autorité prenant pour eux desdécisions auxquelles ils se rangent presquetoujours sans réserves. Il y aurait lieud’observer, dans cet ordre d’idées, que l’ondevrait s’employer, mieux qu’on ne l’a faitjusqu’ici, à former une catégorie supérieure depenseurs indépendants, d’hommes inaccessibles àl’intimidation et adonnés à la recherche duvrai, qui assumeraient la direction des massesdépourvues d’initiative. Que l’empire pris parles pouvoirs de l’Etat et l’interdiction depensée de l’Eglise ne se prêtent point à unetelle formation, nul besoin de le démontrer.L’État idéal résiderait naturellement dans unecommunauté d’hommes ayant assujetti leur vieinstinctive à la dictature de la raison. Rienne pourrait créer une union aussi parfaite etaussi résistante entre les hommes, même s’ilsdevaient pour autant renoncer aux liens desentiment les uns vis à vis des autres. Mais ily a toute chance que ce soit là un espoirutopique. Les autres voies et moyens d’empêcherla guerre sont certainement plus praticables,mais ils ne permettent pas de compter sur dessuccès rapides. On ne se plait guère à imaginerdes moulins qui moudraient si lentement qu’onaurait le temps de mourir de faim avantd’obtenir la farine.
Vous le voyez, on n’avance guère les choses,à vouloir consulter des théoriciens étrangers
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)32
au monde, quand il s’agit de tâches pratiqueset urgentes. Mieux vaudrait s’efforcer, pourchaque cas particulier, d’affronter le dangeravec les moyens qu’on a sous la main. Jevoudrais cependant traiter encore un problèmeque vous ne soulevez pas dans votre lettre etqui m’intéresse spécialement. Pourquoi nousélevons-nous avec tant de force contre laguerre, vous et moi et tant d’autres avec nous,pourquoi n’en prenons-nous pas notre particomme de l’une des innombrables vicissitudes dela vie ? Elle semble pourtant conforme à lanature, biologiquement très fondée, et,pratiquement, presque inévitable. Ne vousscandalisez pas de la question que je pose ici.Pour les besoins d’une enquête, il est peut-être permis de prendre le masque d’uneimpassibilité qu’on ne possède guère dans laréalité. Et voici quelle sera la réponse :parce que tout homme a un droit sur sa proprevie, parce que la guerre détruit des vieshumaines chargées de promesses, placel’individu dans des situations qui ledéshonorent, le force à tuer son prochaincontre sa propre volonté, anéantit deprécieuses valeurs matérielles, produits del’activité humaine, etc. On ajoutera en outreque la guerre, sous sa forme actuelle, ne donneplus aucune occasion de manifester l’antiqueidéal d’héroïsme et que la guerre de demain,par suite du perfectionnement des engins dedestruction, équivaudrait à l’extermination de
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)33
l’un des adversaires, ou peut-être même desdeux.
Tout cela est exact et paraît même siincontestable qu’on en est réduit à s’étonnerqu’un accord unanime de l’humanité n’ait pointencore banni la guerre. On peut évidemmentdiscuter l’un ou l’autre de ces points et sedemander, par exemple, si la communauté ne doitpas avoir, elle aussi, un droit sur la vie del’individu ; on ne saurait condamner au mêmetitre tous les germes de guerre ; tant qu’il yaura des empires et des nations décidées à ex-terminer les autres sans pitié, ces autres-làdoivent être équipés pour la guerre. Mais nousavons hâte de passer sur tous ces problèmes, cen’est point la discussion à laquelle vousentendiez m’engager. Je veux en arriver à autrechose. Je crois que le motif essentiel pourquoi nous nous élevons contre la guerre, c’estque nous ne pouvons faire autrement. Noussommes pacifistes, parce que nous devons l’êtreen vertu de mobiles organiques. Il nous estdésormais facile de justifier notre attitudepar des arguments.
Voilà qui ne va pas sans explication. Etvoici ce que j’ajoute depuis des tempsimmémoriaux, l’humanité subit le phénomène dudéveloppement de la culture. (D’aucunspréfèrent, je le sais, user ici du terme decivilisation.) C’est à ce phénomène que nousdevons le meilleur de ce dont nous sommes faits
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)34
et une bonne part de ce dont nous souffrons.Ses causes et ses origines sont obscures, sonaboutissement est incertain, et quelques-uns deses caractères sont aisément discernables.Peut-être conduit-il à l’extinction du genrehumain, car il nuit par plus d’un côté à lafonction sexuelle, et actuellement déjà lesraces incultes et les couches arriérées de lapopulation s’accroissent dans de plus fortesproportions que les catégories raffinées. Peut-être aussi ce phénomène est-il à mettre enparallèle avec la domestication de certainesespèces animales ; il est indéniable qu’ilentraîne des modifications physiques ; on nes’est pas encore familiarisé avec l’idée que ledéveloppement de la culture puisse être unphénomène organique de cet ordre. Lestransformations psychiques qui accompagnent lephénomène de la culture, sont évidentes etindubitables. Elles consistent en une évictionprogressive des fins instinctives, jointe à unelimitation des réactions impulsives. Dessensations qui, pour nos ancêtres, étaientchargées de plaisir nous sont devenuesindifférentes et même intolérables ; il y a desraisons organiques à la transformation qu’ontsubie nos aspirations éthiques et esthétiques.Au nombre des caractères psychologiques de laculture, il en est deux qui apparaissent commeles plus importants :l’affermissement del’intellect, qui tend à maîtriser la vieinstinctive, et la réversion intérieure dupenchant agressif, avec toutes ses conséquences
Sigmund Freud et Albert Einstein, “Pourquoi la guerre ? ” (1933)35
favorables et dangereuses. Or les conceptionspsychiques vers lesquelles l’évolution de laculture nous entraîne se trouvent heurtées dela manière la plus vive par la guerre, et c’estpour cela que nous devons nous insurger contreelle ; nous ne pouvons simplement plus du toutla supporter ; ce n’est pas seulement unerépugnance intellectuelle et affective, maisbien, chez nous, pacifistes, une intoléranceconstitutionnelle, une idiosyncrasie en quelquesorte grossie à l’extrême. Et il semble bienque les dégradations esthétiques que comportela guerre ne comptent pas pour beaucoup moins,dans notre indignation, que les atrocitésqu’elle suscite.
Et maintenant combien de temps faudra-t-ilencore pour que les autres deviennentpacifistes à leur tour ? On ne saurait ledire, mais peut-être n’est-ce pas une utopieque d’espérer dans l’action de ces deuxéléments, la conception culturelle et lacrainte justifiée des répercussions d’uneconflagration future, — pour mettre un terme àla guerre, dans un avenir prochain. Par quelschemins ou détours, nous ne pouvons le deviner.En attendant, nous pouvons nous dire : Tout cequi travaille au développement de la culturetravaille aussi contre la guerre.
Je vous salue très cordialement et si monexposé a pu vous décevoir, je vous prie de mepardonner.