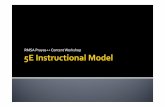La philosophie expérimentale en Italie : origines, état actuel ...
Thucydide et les origines de la guerre du Péloponnèse 5e partie
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Thucydide et les origines de la guerre du Péloponnèse 5e partie
188
Annexe 1
Structure de la seconde préface et liste des ajouts
23,4-6 Introduction 24,6 1er ajout 24-31,3 Début de l'affaire de l'affaire de Corcyre 31,4-44,11 Débat(s)2 d'Athènes 32-36,3 Discours des Corcyréens 33,3-4 2ème ajout 37-43 Premier discours des Corinthiens 44-55,1 Fin de l'affaire de Corcyre 55,2 Conclusion de l'affaire de Corcyre 56,1 Introduction de l'affaire de Potidée 56,2-65 Affaire de Potidée 66 Conclusion de l'affaire de Potidée 67-87,5 Premier débat de Sparte 68-71 Deuxième discours des Corinthiens 68,1-2 Introduction 68,3-71,3 Développement principal 68,3-70,13 Première partie 70,14-71,45 Seconde partie 71,46-7 Conclusion 73-78 Discours des Athéniens 73,1 Introduction 73,2-77,6 Développement principal 73,2-75,1 Première partie 75,2-76,1 Deuxième partie
1 Seulement les mots: Τοιαύτῃ µὲν γνώµῃ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς Κερκυραίους προσεδέξαντο. 2 Il y a eu un premier débat d'Athènes, lors duquel les Corcyréens et les Corinthiens ont tenu leur discours et un second débat, lors duquel les Athéniens ont décidé de conclure une alliance défensive avec Corcyre. 3 Seulement les mots: Καὶ ἅµα, εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νοµίζοµεν εἶναι τοῖς πέλας ψόγον ἐπενεγκεῖν, ἄλλως τε καὶ µεγάλων τῶν διαφερόντων καθεστώτων. 4 Seulement les mots: ...οὐκ αἰσθάνεσθαι ἡµῖν γε δοκεῖτε, οὐδ᾿ ἐκλογίσασθαι πώποτε πρὸς οἵους ὑµῖν Ἀθηναίους ὄντας καὶ ὅσον ὑµῶν καὶ ὡς πᾶν διαφέροντας ὁ ἀγὼν ἔσται. 5 Seulement la phrase: Μέχρι µὲν οὖν τοῦδε ὡρίσθω ὑµῶν ἡ βραδυτής. 6 Depuis les mots: Νῦν δὲ κ. τ. λ.
189 76,2-77 3ème ajout (= troisième partie) 78 Conclusion (79,2?) éventuel ajout7
80-85,2 Discours du roi Archidamos 80,1 Introduction 80,2-84 Développement principal 80,2-83 Première partie 84 Seconde partie 85,1-2 Conclusion 86 Discours de l'éphore Sthénélaïdas 86,58 4ème ajout 87,6-118,39 5ème ajout (la Pentécontaétie) 118,3 Les Lacédémoniens consultent l'oracle de Delphes. 119-125,2 Second débat de Sparte 120-124 Troisième discours des Corinthiens 120 Introduction 121-124,1 Développement principal 121-122 Première partie 123-124,110 Seconde partie 124,111-3 Conclusion 125,212-126,1 6ème ajout 126,2-139,3 Les Lacédémoniens présentent des exigences aux Athéniens. 127,2-3 7ème ajout 139,3-145 Débat d'Athènes 140-144 Discours de Périclès 140,1 Introduction 140,2-144,2 Développement principal 140,2-141,1 Première partie 141,2-144,213 Seconde partie 144,114 8ème ajout 144,215-4 Conclusion
7 Il s'agirait seulement des mots δοκῶν εἶναι. 8 Seulement les mots: ...µήτε τοὺς ̓Αθηναίους ἐᾶτε µείζους γίγνεσθαι µήτε τοὺς ξυµµάχους καταπροδιδῶµεν, ἀλλά... 9 Seulement les mots: Αὐτοῖς µὲν οὖν τοῖς Λακεδαιµονίοις διέγνωστο λελύσθαι τε τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς ̓Αθηναίους ἀδικεῖν. 10 Seulement les mots: Ὥστε πανταχόθεν καλῶς ὑπάρχον ὑµῖν πολεµεῖν. 11 Depuis les mots: ...καὶ ἡµῶν κοινῇ τάδε παραινούντων κ. τ. λ. 12 Depuis les mots: {Οµως δὲ καθισταµένοις κ. τ. λ. 13 Seulement les mots: ...ἀλλ᾿ ἐκεῖνα µὲν καὶ ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἅµα τοῖς ἔργοις δηλωθήσεται. 14 Depuis les mots: ...ἢν ἐθέλητε ἀρχήν τε µὴ ἐπικτᾶσθαι ἅµα πολεµοῦντες κ. τ. λ.
191
Annexe 2
Tableau de l'organisation dialectique de l'antilogie
Corcyréens-Corinthiens
Programme fixant les points B et A
32,1-2 Programme fixant les points C' et A'
37,1
A 32,3-5 A' 37,2-5 B 33,1-2 B' = Ø X 33,3-4
(= ajout?)
C 34 C' 38-40,116 a 34,1 a' 38 b 34,2 b' 39 Cette phrase anticipe les points D', E', F' et G' du discours des Corinthiens
34,3 Cette phrase résume les résultats obtenus en a' et b' de C'
40,1
D 35,1-4 D' 40,2-40,617 E 35,5 E' 41 F 36,1-2 F' 42,1-3 G 36,3 G' 42,4-43
16 Pour simplifier les citations, je considère les mots ̔Ως δὲ οὐκ ἂν δικαίως αὐτοὺς δέχοισθε µαθεῖν χρή, qui terminent le paragraphe 40,1, comme commençant le paragraphe 40,2. 17 Pour simplifier les citations, je considère les mots Δικαιώµατα µὲν οὖν τάδε πρὸς ὑµὰς ἔχοµεν, ἱκανὰ κατὰ τοὺς ̔Ελλήνων νόµους, qui commencent le paragraphe 41, comme faisant partie du paragraphe 40,6.
192
Annexe 3
Tableau de l'organisation dialectique
du premier débat de Sparte
Développement principal du discours des Corinthiens
Développement principal du discours des Athéniens18
Première partie A 68,3-69,1 A' 73,2-76,2 Développement principal
du discours d'Archidamos
Première partie B 69,2 B' 80,2-81 C 69,3 C' 82-83 Seconde partie D 69,4-519 D' 84,120 Seconde partie E 7021 E' 8422
18 Rappelons que le développement principal du discours des Athéniens est composé de trois parties A, B et C, la partie C étant à mes yeux un ajout. C'est donc les deux parties A et B qui constituent ensemble la partie A' de l'organisation dialectique du premier débat de Sparte. 19 Le début du paragraphe 70,1 (Καὶ ἅµα, εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νοµίζοµεν εἷναι τοῖς πέλας ψόγον ἐπενεγκεῖν ἄλλως τε καὶ µεγάλων τῶν διαφερόντων καθεστώτων) fait bloc avec la première partie du développement principal du discours des Corinthiens. Toutefois, pour simplifier les références, je considère que ces mots font encore partie de 69,5. 20 Pour simplifier les citations, je considère que la phrase Καὶ δύναται µάλιστα σωφροσύνη ἔµφρων τοῦτ᾿ εἶναι fait partie du paragraphe 84,1. 21 La seconde partie du développement principal du discours des Corinthiens commence au milieu de 70,1. Toutefois, pour simplifier les références, je considère que le paragraphe 70,1 commence avec les mots περὶ ὧν οὐκ αἰσθάνεσθαι ἡµῖν δοκεῖτε... 22 Le paragraphe 84,1 joue un double rôle dans l'organisation dialectique du premier débat de Sparte. Cf. chapitre 12, page 85-6.
193
Annexe 4
Tableau chronologique
490 Première guerre médique. Victoire des hoplites athéniens à Marathon sous le commandement de Miltiade.
482-480 Construction d'une importante flotte athénienne sur le conseil de Thémistocle.
480 Deuxième guerre médique. Les Thermopyles et l'Artémision. Sac de l'Attique par les Perses. Victoire de Salamine. Retraite de Xerxès, qui laisse à Mardonios le commandement des opérations.
479 Défaite de Mardonios à Platée, où les hoplites grecs sont commandés par Pausanias de Sparte. Autre défaite perse au cap Mycale.
478 Les Athéniens reconstruisent leurs murs sur le conseil de Thémistocle.
478 Pausanias se fait détester par les Grecs. Sparte se retire de la lutte contre les Perses. Athènes crée la confédération de Délos.
475-462 L'influence de Cimon, le fils de Miltiade, est prépondérante à Athènes.
470 Ostracisme de Thémistocle.
469 Victoire de Cimon à l'embouchure de l'Eurymédon.
462 Les Athéniens envoient Cimon et 4000 hoplites pour aider Sparte à écraser la révolte des hilotes messéniens réfugiés dans l'Ithomé.
462 En l'absence de Cimon, Ephialtes fait adopter une réforme qui limite les pouvoirs de l'Aréopage. Athènes conclut une alliance avec Argos.
461 Ostracisme de Cimon.
460-446 Mégare abandonne la confédération péloponnésienne. Guerre entre Sparte et Athènes.
460-454 Expédition athénienne en Egypte; brillamment commencée, elle finit par un désastre.
457 Athènes achève ses Longs Murs.
457 Victoire des Lacédémoniens sur les Athéniens à Tanagra. Victoire des Athéniens sur les Béotiens à Oinophyta.
451 Sparte et Argos font la paix pour trente ans.
451 Retour de Cimon à Athènes. Une trêve de cinq ans est conclue avec Sparte.
450 Mort de Cimon. La flotte qu'il commandait remporte une grande victoire sur les Perses à Salamine de Chypre.
449 Paix de Callias, qui met fin à la guerre entre les Grecs et les Perses. Les Athéniens commencent à reconstruire les temples détruits par les Perses.
446 Victoire des Béotiens sur les Athéniens à Coronée. Athènes perd la Béotie. Mégare fait défection. Athènes perd le contrôle de la Mégaride. L'Eubée se révolte. Les Lacédémoniens font une courte incursion en Attique. Périclès
obtient leur retrait rapide (en corrompant Pleistoanax et Cléandridas?) et écrase la révolte de l'Eubée.
446 Paix conclue entre Sparte et Athènes pour une durée de trente ans.
443 Ostracisme de Thucydide, un parent de Cimon. L'influence de Périclès devient prépondérante à Athènes.
434-433 Décrets de Callias, qui semblent en relation avec le plan de guerre de Périclès.
433 Conclusion d'une alliance défensive entre Athènes et Corcyre. Bataille des îles Sybota.
194 432 Bataille devant Potidée, puis siège de la ville par les Athéniens.
431-404 Guerre du Péloponnèse; elle comprend une période de paix instable qui a duré de 421 à 413.
431-421 Guerre de Dix ans.
431 Les Lacédémoniens promettent de libérer les Grecs. Le roi Archidamos de Sparte fait invasion en Attique.
429 Chute de Potidée.
429 Mort de Périclès victime de la fameuse "peste" d'Athènes.
425 Premier succès de Pylos. Les hoplites lacédémoniens sont bloqués sur Sphactérie. Sparte propose paix et alliance aux Athéniens, sans succès. Par la suite, Cléon et Démosthène parviennent à faire prisonniers les hoplites bloqués sur Sphactérie.
424 Défaite athénienne à Délion.
424 Thucydide l'historien est stratège. Il sauve Eion, mais ne réussit pas à empêcher Brasidas de prendre Amphipolis et, par la suite, il est exilé pour vingt ans.
423-422 Sparte et Athènes font une trêve pour la durée d'un an.
422 Cléon et Brasidas meurent sous les murs d'Amphipolis.
421 La paix conclue entre Sparte et Argos en 451 arrive à expiration.
421 Fin de la guerre de Dix ans. Athènes et Sparte font la paix pour cinquante ans (paix de Nicias). Peu après, elles concluent une alliance.
420 Athènes, Argos, Elis et Mantinée concluent une alliance défensive.
418 Bataille de Mantinée.
416 Affaire de Mélos.
415-413 Les Athéniens décident d'envoyer des troupes en Sicile sur la proposition d'Alcibiade. Avec Nicias et Lamachos, il est l'un des trois généraux qui commandent le corps expéditionnaire.
415 Mutilation des Hermès. Alcibiade est dénoncé pour avoir profané les mystères d'Eleusis. Par la suite, il est rappelé à Athènes, mais il préfère s'exiler.
414-413 Sparte reprend la guerre contre Athènes sur le conseil d'Alcibiade. Gylippe est envoyé en Sicile pour commander les troupes qui résistent aux Athéniens. Le roi Agis fortifie Décélie en Attique.
413 Suite de défaites athéniennes devant Syracuse. Retraite du corps expéditionnaire par voie de terre. Désastre de l'Assinaros.
411 Révolution à Athènes; les Quatre cents, puis les Cinq mille.
411 Rappel d'Alcibiade par les soldats et marins athéniens cantonnés à Samos.
410 Restauration de la démocratie. Victoire de Cyzique sous le commandement d'Alcibiade. Athènes restaure son autorité dans les Détroits. Sparte propose de faire la paix.
407 Retour triomphal d'Alcibiade à Athènes.
406 Défaite athénienne à Notion. Alcibiade, à qui on en attribue la responsabilité, est destitué.
406 Victoire athénienne aux Arginuses. Sparte propose à nouveau de faire la paix. Procès des généraux vainqueurs à Athènes.
405 Défaite athénienne à Aigos Potamoi. Le général lacédémonien Lysandre a désormais la maîtrise de la mer et il commence le siège d'Athènes.
404 Reddition d'Athènes. Destruction des Longs Murs et fin de l'empire athénien. Lysandre installe les décarchies. Les Trente prennent le pouvoir à Athènes.
403 Fin de la tyrannie des Trente et restauration de la démocratie.
196
Annexe 5
La date de la bataille de Potidée et la seconde préface
Les manuscrits des Histoires de Thucydide datent le premier événement de la guerre du Péloponnèse, à savoir le coup de main des Thébains contre Platée, du "sixième mois après la bataille de Potidée" au début du livre II23.
Dans le même passage, Thucydide indique que cette aggression s'est produite "au début du printemps" et, en II 4,2, il précise que c'était "à la fin du mois24", ce qui laisse le choix entre la nouvelle lune du huit mars et celle du sept avril 431. Comme l'invasion de l'Attique a eu lieu quatre-vingts jours plus tard, "au moment où les blés sont mûrs", il faut choisir la date la plus haute parce qu'elle permet de placer l'invasion de l'Attique à la fin du mois de mai.
Dans ces conditions, la bataille de Potidée se serait déroulée à la fin du mois de septembre. Or il n'est pas possible de concilier cette date avec la seconde préface.
Il faut admettre un certain délai entre la bataille de Potidée et la tenue du premier débat de Sparte. Il doit être d'une quinzaine de jours au moins et peut-être de davantage. Il n'était donc plus guère possible de faire invasion en Attique avant l'hiver 432-431. Or cette possibilité existe encore aux yeux des Corinthiens et de l'éphore Sthénélaïdas, puisqu'ils veulent que les Lacédémoniens la mettent à profit pour tenter de débloquer Potidée.
Il s'est écoulé un nouveau laps de temps entre le premier et le second débat de Sparte et il a sans doute été plus long25. Or Thucydide affirme que les Corinthiens "craignaient que Potidée ne pût tenir assez longtemps" en I 119 et, conformément à cette crainte, ils demandent aux alliés de Sparte dans leur troisième discours de décider d'attaquer sans délais. La mauvaise saison ne doit donc pas être déjà si proche qu'elle interdise une éventuelle invasion de l'Attique.
23 Cf. II 2,1: Τέσσαρα µὲν γὰρ καὶ δέκα ἔτη ἐνέµειναν αἱ τριακοντούτεις σπονδαὶ αἳ ἐγένοντο µετ᾿ Εὐβοίας ἅλωσιν· τῷ δὲ πέµπτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει, ἐπὶ Χρυσίδος ἐν Ἄργει τότε πεντήκοντα δυοῖν δέοντα ἔτη ἱερωµένης καὶ Αἰνησίου ἐφόρου ἐν Σπάρτῃ καὶ Πυθοδώρου ἔτι δύο µῆνας ἄρχοντος Ἀθηναίοις, µετὰ τὴν ἐν Ποτειδαίᾳ µάχην µηνὶ ἕκτῳ καὶ ἅµα ἦρι ἀρχοµένῳ Θηβαίων ἄνδρες ὀλίγῳ πλείους τριακοσίων (ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν βοιωταρχοῦντες Πυθάγγελός τε ὁ Φυλείδου καὶ Διέµπορος ὁ Ὀνητορίδου) ἐσῆλθον περὶ πρῶτον ὕπνον ξὺν ὅπλοις ἐς Πλάταιαν τῆς Βοιωτίας οὖσαν Ἀθηναίων ξυµµαχίδα codd. 24 Thucydide raconte en II 4,2 que les assaillants, pour qui l'affaire a mal tourné, ont de la peine à trouver leur chemin dans l'obscurité et précise alors qu'on se trouvait à la fin du mois (τελευτῶντος τοῦ µηνὸς). 25 Dans son discours, Périclès fait allusion aux longs délais nécessaires à la réunion d'une assemblée plénière de la confédération péloponnésienne. Cf. 141,7.
197
Après avoir entendu les Corinthiens, les alliés votent comme ils le leur ont demandé. Thucydide fait alors le commentaire suivant: "Cela décidé, une action immédiate était exclue car ils n'étaient pas prêts; ils étaient donc d'avis de se procurer chacun ce qui était nécessaire et qu'il n'y ait pas de délai" (I 125,2).
Cette remarque n'aurait guère de sens si vraiment il était impossible de faire invasion avant l'hiver. Dans ce cas-là, en effet, la première invasion de l'Attique aurait lieu le plus tôt possible après la décision des alliés de Sparte et ce n'est pas les préparatifs qu'il faudrait incriminer pour expliquer cette date mais bien la mauvaise saison.
Enfin, Thucydide ajoute: "Cependant, tandis qu'ils organisaient ce dont ils avaient besoin, ils laissèrent passer non pas un an mais moins que cela avant d'envahir l'Attique et de commencer la guerre ouvertement." Si l'on admet que nous sommes alors aux alentours du quinze novembre et qu'il faut ajouter quatre-vingts jours à la date du huit mars pour obtenir celle de la première invasion de l'Attique, il se serait écoulé entre cette dernière et le second débat de Sparte six à sept mois lunaires. Il est évident qu'un tel laps de temps est trop court pour qu'on puisse imaginer qu'il ait pu paraître aussi long qu'une année et la remarque de Thucydide n'aurait guère de sens non plus.
Il est presque toujours de mauvaise méthode de corriger le texte des manuscrits mais nous avons affaire là à l'exception qui confirme la règle. Il est du reste connu que les chiffres contenus dans les manuscrits de Thucydide ne méritent pas la même confiance que le reste du texte26. Je me range donc à l'avis d'A.W. Gomme qui propose de lire δεκάτῳ en place d'ἑκτῳ en II 2,127.
Dans ces conditions, la bataille de Potidée a eu lieu au milieu de juin 432, le premier débat de Sparte, au début de juillet et le second, au début d'août. Il était donc possible d'envisager une invasion de l'Attique aussi bien après le premier qu'après le second débat de Sparte.
26 C'est ainsi que, dans le même passage de II 2,1, les manuscrits indiquent que "Pythodore était archonte à Athènes pour deux mois encore". Comme les archontes entraient en charge au début de juillet, il faut supposer là aussi une erreur et considérer que le chiffre indiqué était quatre. Il est vrai que dans ce cas elle est plus facilement explicable d'un point de vue paléographique. 27 Cf. A Historical Commentary on Thucydides, vol. I, p. 423 et, pour la datation de l'ensemble des événements relatés dans la seconde préface, p. 196-198, 222-224 et 421-425. En ce qui concerne l'inscription IG i2 296, qui fait le compte de l'argent dépensé par Athènes à l'occasion des opérations militaires de l'année 432-431 et dont on a cru à tort qu'elle permet de montrer que la bataille de Potidée ne peut avoir eu lieu avant septembre 432, cf. A. W. Gomme, "IG i2 296 and the Dates of ΤΑ ΠΟΤΕΙΔΕΑΤΙΚΑ", Classical Review, 55, 1941, p. 59-67.
198
Annexe 6
La paix de 446 et ses conséquences
Le traité de paix de 446 a mis fin à ce qu'on appelle la première guerre du Péloponnèse. Bien qu'il n'ait pas été conservé, ses termes sont connus dans leurs grandes lignes grâce à ce que Thucydide en dit28. Il a été conclu entre Athènes et les cités de son empire, d'une part, Sparte et les cités de la confédération péloponnésienne, d'autre part29. Les cités qui n'étaient pas inscrites au traité étaient libres, le cas échéant, d'adhérer à l'une ou l'autre alliances30. La paix devait durer trente ans31, pendant lesquels les parties contractantes s'engageaient à soumettre à arbitrage les différends qui pourraient surgir entre elles32. Une fois qu'elle aurait rendu Nisée et Pèges, les deux ports de la Mégaride, ainsi que Trézène et l'Achaïe33, Athènes garderait ce qu'elle avait et il en irait de même pour Sparte34.
La paix de 446 est donc un partage de l'hégémonie sur la Grèce: les Lacédémoniens reconnaissent aux Athéniens le droit de commander aux cités de leur empire et les Athéniens renoncent à empiéter désormais sur le territoire de la confédération péloponnésienne. A cet égard, elle fixe un cadre acceptable à la coexistence pacifique de Sparte et d'Athènes.
Il faut noter, cependant, que la restitution de Nisée et de Pèges privait Athènes de tout contrôle sur la Mégaride, ce qui laissait libre la route de l'Attique aux troupes du Péloponnèse35.
C'est la raison pour laquelle Athènes n'avait pas la garantie matérielle que Sparte ne serait pas tentée un jour ou l'autre d'exercer des pressions sur sa politique par la menace de faire invasion en Attique, voire même en mettant cette menace à exécution.
28 Comme Thucydide n'en dit rien, je ne pense pas que le traité ait stipulé qu'Egine garderait son autonomie, ni que la liberté d'aller et de venir l'une chez l'autre ait été garantie aux parties expressis verbis. 29 La liste des cités de la confédération péloponnésienne et de l'empire athénien figurait sur le traité. C'est ce qu'implique en tout cas l'expression ἄγραφοι πόλεις utilisée par les Corinthiens en I 40,2. 30 Cf. I 35,2 et 40,2. 31 Cf. I 23,4, 115,1 et II 2,1. 32 Cf. I 79,4, 140,2, 144,2 et VII 18,2. 33 Cf. I 115,1 et IV 21,3. 34 Cf. I 140,2. 35 G. de Ste-Croix a bien mis en lumière l'importance du contrôle exercé par Athènes sur la Mégaride pendant la première guerre du Péloponnèse. Ce contrôle permettait aux Athéniens de bloquer la Géranie et de rendre pratiquement impossible une invasion de l'Attique par voie de terre. Cf. The Origins of the Peloponnesian War, p. 187-196.
199
Malgré les serments solennels qui accompagnaient le traité de 446, certains Athéniens avaient donc lieu d'être inquiets et de redouter l'avenir.
Ces Athéniens se recrutaient parmi les démocrates attachés à l'empire; le plus en vue et le plus influent était Périclès.
En 443, l'ostracisme de Thucydide, le fils de Mélésias, a sans doute creusé le fossé avec Sparte. Même s'il a été exilé parce qu'il s'opposait à l'affectation de l'argent du tribut aux constructions de l'Acropole, il était un parent de Cimon et, à ce titre, un partisan de l'entente avec Sparte. Son élimination ne pouvait donc qu'indisposer les Lacédémoniens.
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en 440 les Corinthiens et d'autres alliés de la confédération péloponnésienne se sont opposés à la proposition d'envahir l'Attique pour soutenir les Samiens qui s'étaient révoltés36. Il en découle que l'assemblée de Sparte avait pris la "décision préalable" de faire cette invasion37.
Le débat de la confédération péloponnésienne n'a sans doute pas été tenu secret et il a invité Périclès à se méfier des Lacédémoniens plus que jamais.
Du moment qu'il n'y avait guère d'espoir de provoquer la défection de Mégare, il n'y avait qu'un moyen de dissuader Sparte d'essayer de faire pression sur Athènes: il fallait décider qu'en cas d'invasion de l'Attique les Athéniens abandonneraient leur campagne, se réfugieraient à l'abri des Longs Murs et mèneraient les opérations sur le terrain dont ils étaient les maîtres: la mer.
C'est là, bien sûr, les grandes lignes du plan de guerre contenu dans le discours que Périclès prononce à la fin de la seconde préface durant l'hiver 432-431.
Un tel plan ne s'improvise pas et il n'y aucune raison de penser qu'il ait été formé si tardivement. Périclès aurait dit d'après Plutarque: "Je vois déjà la guerre qui accourt du Péloponnèse" (Per., 8,7). Il est difficile
de dater ce propos mais sa notoriété tend à montrer qu'il a été prononcé à une date assez ancienne pour avoir frappé les esprits et pour être resté comme un témoignage de ce que son auteur avait su voir loin.
Il y a d'ailleurs un indice qui laisse à penser que le plan de guerre de Périclès a été accepté par l'assemblée du peuple au moins dès l'année 434-433. En effet, nous savons grâce aux deux décrets de Callias38, qui ont été votés une
36 Cf. Thuc., I 40,5. 37 Le fonctionnement institutionnel de la confédération péloponnésienne est tel qu'une guerre éventuelle doit faire d'abord l'objet d'une décision préalable (προβούλευµα) de l'assemblée des Lacédémoniens. Une fois cette décision préalable prise, elle est soumise à un vote de l'assemblée de la confédération péloponnésienne. Il en découle que Sparte ne peut imposer à ses alliés une guerre dont ils ne voudraient pas et réciproquement. En revanche, rien n'empêche Sparte de faire une guerre sans l'accord de ses alliés. C'est ce que les Corinthiens ont tenté d'obtenir lors du premier débat de Sparte. Pour plus de détails sur le fonctionnement institutionnel de la confédération péloponnésienne, cf. G de Ste-Croix, op. cit., p. 105-123 et, plus brièvement, p. 339-340. 38 Cf. IG i2 91 et 92. On trouvera le texte des deux décrets, la bibliographie et un commentaire dans R. Meiggs and D. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions, 58, p. 154-161. R. Meiggs revient sur la datation des décrets dans The Athenian Empire, p. 519-523.
200
année de Grandes Panathénées après le commencement de la construction des Propylées et avant la guerre, que le peuple athénien a décidé de mettre à l'abri sur l'Acropole les trésors des sanctuaires de l'Attique et de prendre des mesures générales d'économie. Or tout cela n'a de sens qu'en prévision d'une invasion péloponnésienne. Comme rien ne permet de supposer que des événements importants aient mis une telle invasion à l'ordre du jour à ce moment-là, il me semble légitime de penser que nous avons affaire à une mesure en relation avec les préparatifs qu'implique l'acceptation du plan de guerre de Périclès.
201
Annexe 7
La guerre du Péloponnèse
Thucydide n'a pas consacré ses Histoires à "la guerre du Péloponnèse" mais à "la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens39". Ces deux expressions méritent quelques commentaires.
Nous avons vu que la seconde préface est aussi favorable à Sparte qu'à Athènes. C'est ce point de vue que reflète l'expression "la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens".
On peut évidemment s'étonner de ce que Thucydide ne marque pas la prééminence de Sparte au sein de la confédération péloponnésienne par l'expression "la guerre des Lacédémoniens et des Athéniens", quitte à ajouter la précision "et de leurs alliés", comme il le fait en II 1,1.
En fait, l'expression qu'il a choisie est destinée à souligner les responsabilités des alliés de Sparte, en particulier celle de Corinthe et celle de Thèbes, dans le déclenchement des hostilités. C'est donc encore une manière d'être favorable à Sparte que de parler de "la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens".
L'expression "la guerre du Péloponnèse", quant à elle, ne semble pas être antérieure à Diodore de Sicile. Elle trahit un point de vue favorable à Athènes, dans la mesure où il faut l'interpréter comme "la guerre des Athéniens contre les Péloponnésiens", de la même façon que les guerres médiques sont les guerres des Grecs contre les Perses, les guerres puniques, les guerres des Romains contre les Carthaginois, etc. Il n'est donc pas surprenant qu'elle date d'un temps où Athènes avait été reconnue comme la première cité de Grèce grâce au génie de ses écrivains, de ses penseurs et de ses artistes. Elle avait perdu la guerre du Péloponnèse sur le terrain militaire mais elle l'avait gagnée aux yeux de la postérité.
39 Cf. I 1,1: Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεµον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέµησαν πρὸς ἀλλήλους κ. τ. λ.
202
Annexe 8
Thucydide et Prodicos
Prodicos visait à atteindre la "rectitude des termes" en distinguant entre des mots apparemment synonymes grâce à une définition du contexte où ils sont le mieux utilisés. Il me semble que Thucydide a brillamment appliqué la méthode de ce grand sophiste au mot αἰτία, en le distinguant soigneusement de trois termes avec lesquels il pouvait être confondu dans certaines conditions: διαφορά, ἔγκλημα et πρόφασις.
Rappelons-nous comment il introduit la seconde préface en 23,5: Δι᾿ ὅτι δ᾿ ἔλυσαν, τὰς αἰτίας προύγραψα πρῶτον καὶ τὰς διαφορὰς τοῦ μή τινα ζητῆσαί ποτε ἐξ ὅτου τοσοῦτος πόλεμος τοῖς Ἕλλησι κατέστη.
La seule façon de donner pleine cohérence à ce passage est d'admettre que le mot αἰτία a le sens à la fois de grief et de cause et que Thucydide s'intéresse aux événements relatés dans la seconde préface à un double point de vue juridique et étiologique. En effet, d'une part, il veut donner aux affaires de Corcyre et de Potidée leur vrai statut juridique: celui de différends que les parties se sont engagées à régler par voie d'arbitrage en jurant le traité de 446. D'autre part, il veut leur reconnaître le rôle déterminant qu'elles ont eu seules d'un point de vue étiologique40: c'est à cause du siège de Potidée que les Lacédémoniens ont voté, puis fait voter, la guerre à leurs alliés. Il y a donc un élément sémantique dans αἰτία qui fait défaut dans διαφορά.
Dans la mesure même où les griefs des Corinthiens permettent seuls d'expliquer la décision des Péloponnésiens de faire la guerre aux Athéniens, ils méritent d'être qualifiés d'αἰτίαι, tandis que les griefs des autres alliés de la confédération péloponnésienne sont qualifiés d'ἐγκλήματα quand il en est fait mention en 77,4.
Si le siège de Potidée est bien la cause qui explique la décision des Péloponnésiens de faire la guerre aux Athéniens, il est clair que les différentes exigences présentées après coup par les Lacédémoniens et plus particulièrement leur demande d'abrogation du décret mégarien ne sont que prétexte à ouvrir les hostilités. C'est ce que Thucydide a exprimé dans le paragraphe 146 qui sert de conclusion à la seconde préface: Αἰτίαι δὲ αὗται καὶ διαφοραὶ ἐγένοντο ἀμφοτέροις πρὸ τοῦ πολέμου, ἀρξάμεναι εὐθὺς ἀπὸ τῶν ἐν Ἐπιδάμνῳ καὶ Κερκύρᾳ. Ἐπεμείγνυντο δὲ ὅμως ἐν αὐταῖς καὶ παρ᾿ ἀλλήλους ἐφοίτων ἀκηρύκτως μέν, ἀνυπόπτως δὲ οὔ. Σπονδῶν γὰρ ξύγχυσις τὰ γιγνόμενα ἧν καὶ πρόφασις τοῦ πολεμεῖν.
Or là encore il manifeste le souci de distinguer entre deux termes apparemment synonymes. En effet, le mot πρόφασις peut aussi avoir le sens de cause ou plus exactement d'explication mais c'est bien le sens d'explication alléguée
40 C'est aussi la raison pour laquelle un rôle crucial est attribué aux Corinthiens lors des deux débats de Sparte: ils sont les seuls, parmi les alliés, dont le discours soit reproduit par Thucydide.
203
pour excuser un comportement dont la cause est différente, et, par conséquent, de prétexte qu'il faut donner à ce mot, comme dans le discours de Périclès en 141,141.
L'insertion des ajouts a malencontreusement obscurci la distinction soigneusement opérée par Thucydide entre αἰτία et πρόφασις. En effet, le sens de πρόφασις dans l'expression ἡ ἀληθεστάτη πρόφασις n'est pas celui de prétexte mais celui d'explication, comme dans le fameux passage du livre VI42 où "l'explication la plus véritable" de l'expédition de Sicile, qui tient au désir des Athéniens de la conquérir tout entière, est opposée au beau prétexte qu'ils allèguent de "porter secours à leurs frères de race et aux alliés qu'ils s'étaient acquis".
C'est la raison pour laquelle Arnold W. Gomme, suivi par certains commentateurs et certains traducteurs, a estimé que Thucydide n'établissait pas une différence essentielle entre αἰτία et πρόφασις dans la seconde préface43.
Il vaut donc la peine de répéter qu'à mes yeux πρόφασις n'a le sens d'explication que dans l'expression ἡ ἀληθεστάτη πρόφασις et qu'ailleurs dans les ajouts il a le sens de prétexte, soit en 118,1 et en 126,1, dans la mesure où ces deux passages font allusion au paragraphe 146.
41 Notons que le mot πρόφασις est employé dans le sens d'explication en 133. C'est le seul cas dans le texte ancien de la seconde préface. Cette apparente exception s'explique sans doute par le caractère de digression de l'ensemble des chapitres 128 à 134, qui sont consacrés au vainqueur de Platée, Pausanias de Sparte. 42 Cf. VI 6,1: Καὶ ἐπὶ τοσήνδε οὖσαν αὐτὴν (la Sicile) οἱ Ἀθηναῖοι στρατεύειν ὥρµηντο, ἐφιέµενοι µὲν τῇ ἀληθεστάτῃ προφάσει τῆς πάσης ἄρξαι, βοηθεῖν δὲ ἅµα εὐπρεπῶς βουλόµενοι τοῖς ἑαυτῶν ξυγγενέσι καὶ τοῖς προσγεγενηµένοις ξυµµάχοις. 43 Cf. A Historical Commentary on Thucydides, vol. I, p. 153-4, 359, et 464-5. A. W. Gomme, op. cit., p. 425, glose un peu différemment l'emploi de πρόφασις en 126,1 ("openly expressed reason or motive"), mais la différence qu'il établit ainsi dans ce cas n'est pas assez nette. Après A. W. Gomme, Gordon M. Kirkwood ( "Thucydides' words for cause", American Journal of Philology, 73, 1952, p. 37-61) et Lionel Pearson ("Prophasis and Aitia", Transactions of the American Philological Association, 83, 1952, p. 205-223) ont repris le problème, mais, malgré tout l'intérêt qu'ils présentent, leurs travaux souffrent de leur refus de prendre en considération le problème posé par la genèse de la seconde préface.
204
Bibliographie
Editions, commentaires et traductions du livre Premier de Thucydide
Classen, J., Thukydides. Erster Band, Berlin, 1862 (nombreuses réimpr.).
Classen, J., Thukydides. Erster Band, bearbeitet von J. Steup, Berlin, 1897 (nombreuses réimpr.).
Croiset, A., Thucydide. Histoire de la guerre du Péloponnèse. Livres I-II, texte grec avec un commentaire critique et explicatif et précédé d'une introduction, Paris, 1886.
Gomme, A.W., A Historical Commentary on Thucydides, vol. I, Oxford, 1945 (nombreuses réimpr.).
Romilly, J. de, Thucydide. La guerre du Péloponnèse. Livre I, Paris, 1953.
Roussel, D., Histoire de la guerre entre les Péloponnésiens et les Athéniens, Paris, 1964.
Stuart Jones, H. et J.E. Powell, Thucydidis Historiae, vol. 1, Oxford, 1942 (nombreuses réimpr.).
Voilquin, J., Histoire de la guerre du Péloponnèse, vol. 1, Paris, 1966.
Travaux cités dans cette étude
Andrewes, A., "Thucydides on the Causes of the War", Classical Quarterly, 53 = n.s. 9, 1959, p. 223-239.
Bocksberger, S., "Un ajout dans le discours d'Athènes d'Alcibiade: Thucydide VI 16,4-5", Etudes de Lettres, série IV, tome 4, no 2, 1981, p. 37-56.
Bodin, L., "Thucydide et la genèse de son oeuvre", Revue des études anciennes, 14, 1912, p.1-38.
Bodin, L., "Isocrate et Thucydide", Mélanges Glotz, 1932, p. 93-102.
Bodin, L., "Thucydide I 84", Mélanges Desrousseaux, 1937, p. 19-25.
Bowra, C.M., Pindar, Oxford, 1964
Conche, M., Héraclite. Fragments, Paris, 1986.
Finley, J.H., Jr, "The Unity of Thucydides' History", Harvard Studies, suppl. vol. I, 1940, p. 255-298, article repris dans Three Essays on Thucydides, Cambridge (Mass.), 1967, p. 118-169.
Forrest, W.G., A History of Sparta. 950-192 B. C., Londres, 1968.
Gomme, A.W., "IG i2 296 and the Dates of ΤΑ ΠΟΤΕΙΔΕΑΤΙΚΑ", Classical Review, 55, 1941, p. 59-67.
Gomme, A.W., A Historical Commentary on Thucydides, vol. II, Oxford, 1956 (nombreuses réimpr.).
Gomme, A.W., A. Andrewes and K.J. Dover, A Historical Commentary on Thucydides, vol. V, Oxford, 1981
Grosskinsky, A., Das Programm des Thukydides, Berlin, 1936.
Grossmann, G., Politische Schlagwörter aus der Zeit des peloponnesischen Kriegs, Zürich, 1950.
205
Grundy, G.B., Thucydides and the History of his Age, Londres, 1911.
How, W.W. and J. Wells, A Commentary on Herodotus, vol. II, Oxford, 1912 (nombreuses réimpr.)
Huart, P., Γνώμη chez Thucydide et ses contemporains, Paris, 1973.
Kirkwood, G.M., "Thucydides' Words for Causes", American Journal of Philology, 73, 1952, p. 37-61.
Luschnat, O., "Thukydides", Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Suppl. XII, 1970, col. 1085-1354.
Meiggs, R., The Athenian Empire, Oxford, 1972.
Meiggs, R. et D. Lewis, Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B. C., Oxford, 1969.
Meyer, E., Forschungen zur alten Geschichte, II, Halle, 1899; réimpr. Hildesheim, 1966.
Patzer, H., Das Problem der Geschichtsschreibung des Thukydides und die thukydideische Frage, Berlin, 1937.
Pearson, L., "Prophasis and Aitia", Transactions of the American Philological Association, 83, 1952, p. 205-223.
Pohlenz, M., "Thukydidesstudien", Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaft zu Göttingen, p. 95-138, article repris dans Kleine Schriften, II, Hildesheim, 1965, p. 210-253.
Romilly, J. de, Thucydide et l'impérialisme athénien. La pensée de l'historien et la genèse de l'oeuvre, Paris, 1947.
Romilly, J. de, Histoire et Raison chez Thucydide, Paris, 1956.
Romilly, J. de, "Les intentions d'Archidamos et le livre II de Thucydide", Revue des études anciennes, 64, 1962, p. 287-299.
Romilly, J. de, "L'optimisme de Thucydide et le jugement de l'historien sur Périclès", Revue des études grecques, 68, 1965, p. 557-575.
Romilly, J. de, La loi dans la pensée grecque, Paris, 1971.
Ste-Croix, G.E.M. de, "Notes on Jurisdiction in the Athenian Empire", Classical Quarterly, 55 = n.s. 11, 1961, p. 94-112 et 268-280.
Ste-Croix, G.E.M. de, The Origins of the Peloponnesian War, Londres, 1972.
Schadewaldt, W., Die Geschichtschreibung des Thukydides. Ein Versuch, Berlin, 1929; réimpr. avec postface Dublin-Zurich, 1971.
Schwartz, E., Das Geschichtswerk des Thukydides, Bonn, 1919.
Stahl, H.P., Thukydides. Die Stellung des Menschen im geschichtlichen Prozess, Munich, 1966.
Steup, J., Quaestiones thucydideae, Bonn, 1868.
Ullrich, F.W., Beiträge zur Erklärung des Thukydides, Hamburg, 1846.
Wade-Gery, H.T., Essays in Greek History, Oxford, 1958.
Wilamowitz-Moellendorf, U. von, "Thukydideische Daten", Hermes, 20, 1885, repris dans Kleine Schriften, vol. III, Berlin, 1969, p.85-98.
Zahn, R., Die erste Periklesrede (Thuk. I 140-144). Interpretation und Versuch einer Einordnung in den Zusammenhang des Werkes, Kiel, 1934.
206
Table des matières
Introduction 1 Chapitre premier Les αἰτίαι et les διαφοραί 23 Chapitre 2 Les raisons d'Athènes d'accepter l'alliance de Corcyre ou la déraison des Corinthiens 36 Chapitre 3 La première partie de l'antilogie Corcyréens-Corinthiens 43 Chapitre 4 Le premier débat de Sparte 51 Chapitre 5 Le discours des Athéniens à Sparte 54 Chapitre 6 Une anomalie dans la structure du discours des Athéniens à Sparte 64 Chapitre 7 J. de Romilly et le discours des Athéniens à Sparte 67 Chapitre 8 La réfutation des Corinthiens par les Athéniens (A vs A') 70 Chapitre 9 La réfutation des Corinthiens par Archidamos (B vs B') 73 Chapitre 10 La réfutation des Corinthiens par Archidamos (C vs C') 78 Chapitre 11 La réfutation des Corinthiens par Archidamos (D vs D') 82 Chapitre 12 La réfutation des Corinthiens par Archidamos (E vs E') 85 Chapitre 13 La déraison des Corinthiens 92 Chapitre 14 La déraison de Sthénélaïdas 102 Chapitre 15 Archidamos et le discours de la raison 107 Chapitre 16 La décision des Lacédémoniens 109 Chapitre 17 Le troisième discours des Corinthiens 112 Chapitre 18 Les exigences de Sparte et la réponse des Athéniens 129 Chapitre 19 Le discours de Périclès 133 Chapitre 20 La vraie raison de l'alliance défensive avec Corcyre 148 Chapitre 21 La raison d'être des ajouts de 404 151 Chapitre 22 L'ajout de 23,6 157 Chapitre 23 L'ajout de 33,3-4 159
207
Chapitre 24 L'ajout du discours de Sthénélaïdas 162 Chapitre 25 L'ajout de la Pentécontaétie 163 Chapitre 26 Un ajout dans la présentation d'Archidamos? 167 Chapitre 27 Deux ajouts dans le récit des dernières démarches de Sparte 169 Chapitre 28 L'ajout du discours de Périclès 172 Chapitre 29 L'ajout du discours des Athéniens à Sparte 175 Conclusion générale 186 Annexes Annexe 1 Structure de la seconde préface et liste des ajouts 188 Annexe 2 Tableau de l'organisation dalectique de l'antilogie Corcyréens-Corinthiens 190 Annexe 3 Tableau de l'organisation dialectique du premier débat de Sparte 191 Annexe 4 Tableau chronologique 192 Annexe 5 La date de la bataille de Potidée et la seconde préface 195 Annexe 6 La paix de 446 et ses conséquences 198 Annexe 7 La guerre du Péloponnèse 201 Annexe 8 Thucydide et Prodicos 202 Bibliographie 205