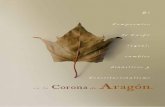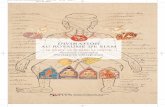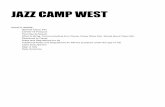"Une représentation de la guerre froide. Le camp de la paix et le camp de la guerre en...
-
Upload
affective-sciences -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of "Une représentation de la guerre froide. Le camp de la paix et le camp de la guerre en...
Une représentation de la guerre froide.
Le camp de la paix et le camp de la guerre (1948-1960)
Roman KRAKOVSKY
Pendant la guerre froide, l’Est et l’Ouest ont élaboré chacun une
représentation de soi et de l’autre. Elle s’est construite d’abord par
rapport à soi-même, sans référence à l’autre. Ainsi, l’Ouest s’est défini
autour de l’idée de la lutte pour la démocratie, l’Est, lui, principalement
autour de l’idée de la lutte pour de la paix. Mais l’image de soi s’est
faite également par rapport à l’extérieur, dans les rapports Est-Ouest. La
représentation de soi s’accompagnait d’une représentation de l’autre,
l’antithèse de soi. Dans ces regards croisés, l’ « autre », expulsé de
l’autre côté du rideau de fer, est devenu, pour l’Ouest, le camp anti-
démocratique voire totalitaire, et, pour l’Est, le camp impérialiste de la
guerre.
Le but de cette communication est d’analyser la représentation
socialiste de soi et de l’autre et ses évolutions en Tchécoslovaquie,
pendant la période fondatrice du régime, les années 1950. Plusieurs cadres
s’offrent à l’analyse de la représentation de l’Est et de l’Ouest, comme
l’anniversaire de la Libération ou certaines manifestations sportives de
masse, comme les courses cyclistes la Compétition de la paix. Mais le moment
privilégié de cette mise en scène est le plus manifestement la célébration
du 1er mai.
1/26
Chaque année, les rapports Est-Ouest sont somptueusement exposés
pendant la Fête du Travail, la plus grande et probablement la plus
populaire fête dans le bloc de l’Est. Le principal objectif de la journée
est de renforcer le lien social de la communauté socialiste1. Mais sur le
plan international, c’est avant tout la plus imposante manifestation de
l’internationalisme prolétaire. Ce jour, les travailleurs du monde entier
sont à l’unisson, qu’ils se trouvent à Prague, Moscou, Havane ou Paris.
C’est leur plus important rendez-vous annuel à résonance internationale. De
ce point de vue, le 1er mai constitue un théâtre idéal de l’exposition du
rapport à l’étranger, de la mise en scène de soi et de l’autre.
Cette date donne également l’occasion de prendre comme support
d’analyse un matériel pour le moment très peu mobilisé par les historiens,
la production iconographique et dramatique (images et allégories).
J’utilise les supports collectés dans les Archives nationales tchèques (les
fonds du Comité central du PCT et ceux des journaux) et des archives de
l’Agence de presse tchécoslovaque ČTK, principal fournisseur d’images à la
presse nationale dans les années 1950. Pour l’analyse de la signification
de ces performances dramaturgiques, je m’appuie sur le dépouillement sériel
du journal Rudé právo, journal du parti, et de Mladá Fronta, journal de l’Union
tchécoslovaque de la jeunesse, les étudiants des universités étant les
principaux concepteurs et interprètes de ces allégories.
Dans un premier temps, il convient de s’interroger sur les origines
du mouvement pour la paix, sur les acteurs et les facteurs de sa naissance.
Ensuite, il faut analyser le fonctionnement de cette représentation et le
1 Pour l’analyse du 1er mai comme représentation de la communauté socialiste, je revoie à mon
ouvrage Rituel du 1er mai en Tchécoslovaquie 1948-1989, Paris, L’Harmattan, 2004, 212 p.
2/26
jeu sur la frontière entre le camp de la paix et le camp de la guerre,
entre l’Est et l’Ouest. Cela permettra d’esquisser quelques observations
sur ce que l’image de l’ « autre », de l’Ouest, peut apprendre sur « soi »,
sur le régime communiste en Tchécoslovaquie, au cours des années 1950.
La création du système de représentation dichotomique
Pour trouver les origines de la représentation du camp de la paix et du
camp de la guerre et de la frontière qu’elle instaure, il faut remonter à
deux discours fondateurs du début 1946. Après une période de relâchement
des tensions, dans le cadre de la coalition antifasciste (1942-1945), la
confrontation idéologique et politique entre les anciens Alliés se
manifeste au grand jour2. Le 9 février 1946, Staline prononce son premier
discours sur les « deux camps » devant l’assemblée des électeurs de la
circonscription de Moscou. Dans ce discours, il revient pour la première
fois depuis l’entrée de l’URSS dans la Seconde Guerre mondiale sur la
conception léniniste des relations internationales. Il rappelle le
caractère inéluctable des crises et des conflits à l’époque du
« capitalisme monopoliste » et présente les deux guerres mondiales comme
l’expression des contradictions du capitalisme. Il utilise pour la première
fois le terme de « deux camps », celui du communisme et du capitalisme,
fondamentalement incompatibles et irréconciliables. Il défend l’idée que la
paix est possible seulement une fois que le régime capitaliste sera vaincu
2 La question allemande, le différend avec l’Iran concernant l’occupation soviétique de
l’Azerbaïdjan, etc.
3/26
et remplacé par le communisme3. Ce discours contient déjà un premier élément
pour la construction de l’image du « camp de la paix » : la paix est
incompatible avec un régime capitaliste. Sous, entendu, elle l’est
uniquement avec un régime communiste. Nourrir l’espoir d’une véritable
coopération internationale est vain.
Un mois plus tard, le 5 mars 1946, Winston Churchill entérine le fait
accompli. Lors d’une conférence donnée à Westminster College à Fulton, il
déclare qu’ « entre Stettin sur la Baltique et Trieste sur l’Adriatique, un
rideau de fer est tombé sur le continent »4. La rupture entre deux univers
est en train de prendre acte, la guerre froide est en train de naître.
La division du monde entre le camp de la Paix et le camp de la Guerre est
un des plus fascinants aspects de la politique de l’après-guerre. Mais ce
concept radicalement neuf n’est construit que progressivement. La période
1946-1949 est marquée par une série d’improvisations combinant deux
éléments, la question de la paix et la technique de l’organisation des
fronts.
En 1946, les leaders soviétiques prononcent une série de discours avec
la thématique de la paix. En mars, en pleine crise avec l’Iran, Staline
attribue la responsabilité de la menace d’une nouvelle guerre aux « actions
de certains groupes politiques engagés dans la propagande d’une nouvelle
guerre »5. Dans une interview à Pravda, le 29 octobre 1948, Staline appelle
3 Senarclens, Pierre, De Yalta au rideau de fer. Les grandes puissances et les origines de la guerre froide, Paris,
Presses de la FNSP, 1993, p. 173-174.4 La Feber, Walter, America Russia and the Cold War 1945-1975, New York, Wiley, 1976, p. 39. Sur les
origines de la guerre froide du côté occidental, voir Harbutt, Fraser, The Iron Curtain. Churchill,
America and the Origins of the Cold War, Oxford, Oxford University Press, 1986, 370 p. 5 Pravda, 23 mars 1946. Cité par Shulman, Marshall, Stalin’s Foreign Policy Reappraised, Cambridge,
Harvard University Press, 1963, p. 83.
4/26
aux « forces sociales en faveur de la paix » de renverser les leaders
britanniques et américains qui poursuivent « la politique d’une nouvelle
guerre ». L’importance de cette interview est soulignée par le discours de
Molotov, à l’occasion de la Révolution d’Octobre, une semaine plus tard.
Il pose les bases du mouvement communiste pour la paix.
En même temps, l’Union soviétique construit des bases d’une coalition
internationale anti-guerre. Le 5 octobre 1947, en réponse à la doctrine
Truman (12 mars 1947) et au plan Marshall (refusé en juillet 1947), est
fondé le Kominform. Sa fonction est de consolider le contrôle soviétique
sur les pays de l’Europe de l’Est et de coordonner leurs politiques
internationales. Dans son discours inaugural, Jdanov, souligne la
compétition doctrinale entre le communisme et le capitalisme et dresse le
tableau d’un monde divisé en deux blocs antagonistes. « Le principal
objectif du camp impérialiste est de renforcer l’impérialisme, de préparer
une nouvelle guerre impérialiste et de combattre de socialise et la
démocratie ». En revanche, le but du camp anti-impérialiste est de
« résister à la menace de nouvelles guerres et d’expansion impérialiste, de
renforcer la démocratie et d’anéantir les vestiges du fascisme »6. Le
journal officiel du Kominform, Pour une paix durable, pour les démocraties populaires,
véhicule la même thématique.
La mobilisation des opinions publiques et des autorités locales vient
avec les congrès pour la paix. Ces congrès sont particulièrement intéressés
par les scientifiques troublés par les conséquences de leurs travaux sur le
développement des armes nucléaires, par les artistes et les écrivains
6 Pour le discours inaugural de Jdanov, voir Jdanov, André, Rapport d'André Jdanov sur la situation
internationale, présenté à la Conférence d'information des neuf partis communistes qui s'est tenue en Pologne à la fin du mois
de septembre 1947, Paris, Maréchal, 1947, p. 1-27.
5/26
perturbés par les excès des investigations du Congrès américain sur les
communistes et, plus particulièrement en France, par ceux qui voient
l’influence croissante des Etats-Unis en Europe comme une menace pour la
culture européenne. Le premier parmi eux, le Congrès mondial des
intellectuels pour la paix, est organisé en août 1948, à Wroclaw. D’autres
congrès suivront, organisés sur le même principe, à Paris et New York
(1949), Wroclaw et Berlin (1950), Vienne (1952), etc. Discourir sur la paix
restera une constance de ces années d’extrême tension.
Après la signature du traité d’Atlantique du Nord, le 4 avril 1949, le
mouvement pour la paix est entré dans une nouvelle phase. Le caractère
universel du mouvement est définitivement abandonné et la défense de la
paix est attribuée à la classe ouvrière et les pays du « camp de la paix ».
Cette nouvelle situation devient évidente deux semaines plus tard, à
l’occasion du Congrès mondial pour la paix qui ouvre le 20 avril 1949. Deux
cessions sont tenues au même moment, dans deux endroits différents de
l’Europe, à Paris, dans la salle Pleyel7 et à Prague, à l’Assemblée
nationale. Cette dernière rassemble les délégations auxquelles les
autorités françaises ont refusé le visa, celles du nouveau bloc de l’Est8.
Une différence fondamentale sépare les deux cessions. A Paris, la lutte
pour la paix reste un enjeu universel. Dans leur manifeste, les délégués7 L’affiche du congrès est faite par Picasso. Il utilise une lithographie avec une colombe qui
deviendra le symbole international de la paix. L’artiste s’inspire du récit biblique de Noé
qui, une fois les pluies passées, envoit différents oiseaux chercher la terre. Une colombe
blanche ramène une branche d’olivier, espoir et promesse du renouveau. Le jour où s’ouvre le
congrès à Paris, Picasso devient père. Sa fille recevra le nom de Paloma, ce qui signifie
« colombe » en espagnol.8 Il s’agit de la délégation soviétique, chinoise, mongole, hongroise, coréenne,
tchécoslovaque, roumaine, yougoslave et est-allemande. Il y a également les représentants de
la « Grèce libre », de l’ « Espagne démocratique », de l’Indonésie et de l‘Union
internationale des étudiants, « représentant 3 millions d’étudiants démocrates dans 54 pays ».
6/26
proclament que « la défense de la Paix est désormais l’affaire de tous les
peuples »9. A Prague, en revanche, la lutte pour la paix est restreinte à un
groupe de pays bien défini : « Pour la paix et contre les instigateurs de
la nouvelle guerre »10.
A partir de 1949, le mouvement pour la paix dressera une frontière
politique plus que territoriale, divisant le monde en deux camps
antagonistes. Le mouvement structure le quotidien des populations dans le
bloc de l’Est, transformant le monde en un récit compréhensible. L’espace
politique de l’ « homme socialiste » se construit autour de cette idée qui
devient progressivement une institution symbolique, une grille à travers
laquelle on voit sans même s'en apercevoir11.
Il n’est pas ici question de faire l’histoire d’une idée, ni d’expliquer
grâce à elle le fonctionnement d’un modèle de société. Il s’agit de
reconstituer le récit de cette idée et de voir, par son intermédiaire, la
frontière politique entre le soi et l’autre qui rythme pendant près de 40
ans la vision d’une partie du monde. Car le regard sur l’autre en dit
davantage sur son porteur que sur celui sur qui le regard se pose.
En construisant la conception du monde autour d’un concept binaire Est /
Ouest, communiste / capitaliste, les régimes communistes renouent avec la
tradition dualiste européenne. Depuis les Grecs, les Européens ont ressenti
le besoin de vivre à travers les polarités bien/mal, vrai/faux, nous/eux,
etc. Même si ces distinctions dualistes ne reposent sur aucun facteur
objectif mais dérivent des mythologies qui sont à la base des illusions
9 « Manifesto », L’Humanité, 27 April 1949.10 « Z Paříže a Prahy zní mohutný hlas národů světa za mír », Rudé právo, 21 avril 1949.11 Hartog, François, Le Miroir d'Hérodote. Essai sur la représentation de l'autre, Paris, Gallimard, 1991, p.
326.
7/26
collectives, elles jouent un rôle fonctionnel dans la vie sociale. Car
l’ordre social ne peut être maintenu que si on arrive à faire la différence
entre celui qui respecte la loi et celui qui la transgresse12. Dans la
politique, cette dualité repose sur l’opposition l’ami – l’ennemi13. Comme
le note Carl Schmitt, cette distinction n’est pas seulement politique.
C’est une identification culturelle, car elle ne divise pas le monde entre
états, mais entre sociétés. L’appartenance au bloc de l’Est est fondée sur
les valeurs communes, sur un sens d’appartenance à la société socialiste,
défendant la paix14. Par ailleurs, propager la guerre est interdit par la
loi15.
La célébration du 1er mai fournit un exemple de cette identification
sociale. Tout au long des années 1950, une partie du défilé est consacrée à
la représentation des allégories du camp socialiste et du camp
impérialiste. L’identification des acteurs de ces allégories témoigne du
caractère profondément politique mais également social de l’idée du combat
pour la paix.
Les médias soulignent le caractère spontané des allégories. Elles sont
interprétées systématiquement comme une initiative populaire et donc
authentique reflétant le ressentiment profond des populations. En 1957,
12 Harle, Vilho, « European Roots of Dualism and Its Alternatives in International Relations »,
in Harle, Vilho (éd.), European Values in International Relations, Londres, Pinter Publishers, 1990, p.
7. 13 Schmitt, Carl, La Notion de politique suivi de La Théorie du partisan, Paris, Flammarion, 1992, p. 64-
65.14 En réponse au prix Nobel de la paix, l’Union soviétique crée le 21 décembre 1949 le Prix
international Staline de la paix. Il est décerné aux individus notables qui ont « renforcé la
paix entre les peuples ». Après la dénonciation du culte de personnalité par Khrouchtchev, au
20e congrès du PCUS de 1956, le prix est rebaptisé Prix international Lénine de la paix.15 Pour la Tchécoslovaquie, voir la loi pour la défense de la paix, Zákon na ochradu míru 165/1950.
Pour l’URSS, voir la loi sur la défense de la paix du 12 mars 1951.
8/26
l’allégorie de l’autre représente une limousine, protégée par les policiers
américains en uniformes. La limousine est conduite par « l’impérialisme
allemand ressuscité », sous la forme du général Hans Speidel, alors
commandant en chef des forces terrestres de l’OTAN en Europe16. Au moment
d’approcher les tribunes, il lève la main pour le salut nazi. Mais à ce
moment, « les pionniers rejoignent le jeu et lui imposent dans la main une
colombe. Speidel la rejette, mais il y a tout d’un coup tellement de
colombes… »17. Le message transmis est clair : L’allégorie et la performance
viennent du peuple, de l’imaginaire populaire. Elles expriment spontanément
l’appartenance des populations à une communauté rassemblée par l’idée de la
lutte pour la paix dans le monde.
Bien entendu, il s’agit d’une mise en scène où chaque pionnier qui
spontanément « rejoint le jeu » joue un rôle précis et soigneusement
répété. Les concepteurs et les acteurs de ces allégories, les étudiants des
facultés des arts plastiques et de l’Académie des Arts, de l’Architecture
et du Design de Prague (Vysoká škola uměleckoprůmyslová), sont d’ailleurs placés
sous le regard attentif du parti. Pendant les années 1950, un haut
fonctionnaire du Parti communiste occupe une place importante dans la
hiérarchie de l’école. Il a la charge de superviser la conception des
allégories de l’autre dans le cortège du 1er mai18. Les allégories ne sont
pas de simples « jeux », des performances politiquement innocentes. Bien au
16 Pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Hans Speidel (1897-1987) occupe le poste de
chef d’état-major de Rommel. Conspirateur à l’assassinat d’Hitler au printemps 1943 à Postdam,
il est, d’avril 1957 à septembre 1963, commandant en chef des forces terrestres de l’OTAN en
Europe. 17 « Jdou jednotné šíky, jdou », Rudé právo, 2 mai 1957.18 Archives nationales tchèques (ci-après ANT), fonds UAV NF, 1952, Zápis ze schůze Ustředního
májového výboru, 3 avril 1952.
9/26
contraire : leur forme et le fonds politique sont étroitement surveillés
par le Parti. Toutefois, les concepteurs des allégories ont une certaine
expérience des réalités sociales et les allégories sont conçues pour un
public. Pour produire sur les contemporains un effet et pour pouvoir être
comprises, ces allégories ne peuvent pas transgresser excessivement la
réalité sociale. Dans ce sens, bien que les images de soi et de l’autre ne
reflètent pas directement les réalités sociales, elles en sont une
description symbolique et traduisent une certaine façon de penser de leurs
concepteurs. Toute difficulté est de saisir la part de la coercition et de
la spontanéité.
La structure de la représentation
Les attributs qui représentent l’autre sont rarement les créations
authentiques des démocraties populaires. Bien au contraire. Les anciens
symboles sont réutilisés, « recyclés ». C’est dans leur association –
complètement nouvelle – que réside l’originalité de la nouvelle création.
En 1950 apparaît dans le défilé l’hydre du capitalisme, un être
hybride, mi-homme, mi-animal. Sa tête est celle de l’Oncle Sam,
représentation des Etats-Unis créée au début du 19e siècle et popularisée
pendant la Première Guerre mondiale par le dessinateur Thomas Nast. Le
signe du dollar et le drapeau américain et britannique sur son chapeau
haut-de-forme associent l’image du financier de Wall Street aux deux
superpuissances récemment définies comme « impérialistes ». Son nez aquilin
et sa barbe renvoient à l’image de banquier juif. Paradoxalement, cette
symbolique antisémite n’est pas incompatible avec un autre symbole fort et
10/26
complètement antinomique, la croix gammée qui forme la crête de l’hydre.
L’allégorie évoque le danger de la nouvelle guerre mondiale que préparent
les puissances impérialistes, à l’aide du capital juif. L’inscription sur
la queue se l’hydre : « Capitalisme, le plus grand danger », se termine par
un appel « Peuple, reste sur tes gardes ! », phrase emblématique de Julius
Fučík, héros communiste de la résistance tchèque exécuté par les nazis. En
1950, tous ces symboles sont familiers au public tchécoslovaque. La
découverte du nouvel « autre » se fait par l’intermédiaire de ce que les
Tchécoslovaques ont déjà expérimenté et qui appartient à la culture
nationale, que ce soit l’antisémitisme, la résistance ou la mémoire de la
culture américaine d’avant-1945. L’utilisation des signes bien connus pour
décrire un phénomène neuf permet de l’incorporer dans l’univers de la
culture tchécoslovaque. L’autre est ainsi apprivoisé et neutralisé. Par sa
différence maîtrisée, il renforce et alimente l’identité du groupe qui le
représente19.
La représentation visuelle de l’autre se déroule systématiquement
selon quelques principes fondamentaux. Le premier est la profonde
dichotomie. La représentation de soi accompagne systématiquement celle de
l’autre. Le camp de la paix se définit par rapport à ce qu’il n’est pas,
par opposition à l‘ennemi extérieur (impérialiste) et l’ennemi intérieur
(traître). La frontière entre « eux » et « nous » sert à mieux se définir
19 Kilani, Mondher, « Découverte et invention de l’autre dans le discours anthropologique. De
Christophe Colomb à Claude Lévi-Strauss », in Kilani, Mondher, L’Invention de l’autre. Essais sur le
discours anthropologique, Lausanne, Payot, 1994, p. 68.
11/26
soi-même. Dès qu’elle est transcrite, elle devient significative, car elle
est prise dans un système de langage, qu’il soit visuel ou auditif.
Cette structure dichotomique de la représentation de soi et de
l’autre sera conservée tout au long des années 1950. Elle fonctionne sur la
base de l’inversion et de la comparaison. Dans un premier temps, la
différence est exposée, ensuite elle est inversée. Défile donc d’abord
l’allégorie de l’autre puis l’allégorie de soi. C’est dans leur comparaison
que réside proprement l’invention de l’autre.
En 1951, à Ostrava, capitale d’une région minière de la Moravie
septentrionale, défilent l’un après l‘autre deux chars. Le premier évoque
« l’hydre de la réaction », monstre à sept têtes représentant les chefs des
« Etats impérialistes ». On reconnaît le président américain Truman, de
Gaulle, le Premier ministre britannique Attlee, le chancelier allemand
Adenauer ou Winston Churchill. Un mineur, principal salarié de la région et
héros emblématique du régime, est en train de l’abattre20. Le texte sur le
char complète l’image : « Nous la vaincrons ensemble avec le PCT, les
syndicats et l’Union de la jeunesse » et « Produire plus de charbon
détruira les plans de la réaction ». Immédiatement après ce « char de la
réaction » vient le « char du socialisme ». Les portraits des chefs d’Etats
ou de partis communistes du bloc de l’Est (on peut apercevoir les portraits
de Dimitrov, Zápotocký, Staline et Gottwald) sont réunis sous les ailes
protectrices de la colombe, symbole de la paix instauré par Picasso à la
conférence de Paris en 1949. Cette symbolique est redoublée par les
textes au-dessous des portraits : « Socialisme = Paix », « Guerre = Ruines
– Misère – Mort // Paix = Vie – Bonheur de nos enfants ».
20 Archives de l’Agence de presse ČTK (ci-après ČTK), cliché FO01226557.
12/26
Montrer l’autre de façon aussi contrastée, c’est faire valoir
qu’entre « eux » et « nous », la différence est profonde. Reconnaître de
Gaulle ou Churchill comme ennemis du communisme revient à dire que ceux-là
mettent le communisme en question. « Mais qui peut véritablement me mettre
en question ? » – se demande Carl Schmitt. « Il n’y a que moi-même ». La
relation à l’autre, c’est une relation à soi-même par l’autre. « L’ennemi
est la figure de notre propre question »21. On aime ou on déteste nos
ennemis au même degré qu’on s’aime ou se déteste soi-même22. L’image de
l’autre que le 1er mai donne à voir est le miroir dans lequel se reflète le
plus clairement le propre visage de la démocratie populaire tchécoslovaque.
L’allégorie de l'autre est une autre façon de se regarder soi-même, dans
une sorte de miroir à l’envers23. Définir l’Ouest à travers l’élément le
plus inquiétant pour l’Est, la guerre, est une manière de se montrer soi-
même sous cet angle.
Dire l’autre, c’est faire valoir une représentation du monde et fixer
ses limites. Mais c’est aussi une manière de placer le « nous » au centre.
Parler de l’autre, c’est une façon de parler de soi. Poser aussi nettement
la frontière entre le soi et l’autre contribue à mieux se cerner soi-même.
Peu importe si cela correspond à la réalité et si Adenauer, de Gaulle ou
Churchill sont véritablement ces excroissances de l’hydre de la guerre à
abattre. C’est même souvent le contraire : Depuis sa défaite face aux
travaillistes en 1945, Churchill ne joue plus aucun rôle dans la politique
britannique. Il revient seulement en octobre 1951. De Gaulle, lui,
démissionne de son poste de Président du gouvernement provisoire en janvier
21 Schmitt, Carl, op. cit., p. 37-38.22 Keen, Sam, Faces of the Ennemy, New York, Harper et Row, 1987, p. 1123 Hartog, François, op. cit., p. 370.
13/26
1946 et reste jusqu’à 1959 dans l’opposition au pouvoir en place. Portant,
le 1er mai 1951, les deux hommes représentent l’Etat d’Angleterre et de
France sur l’hydre de l’impérialisme. L’allégorie ne transcrit pas une
réalité. Elle dit davantage sur la façon de penser de celui qui représente
que sur celle qui est représenté. C’est une façon de traduire, en termes de
la stratégie tchécoslovaque de l’époque, la stratégie de l’autre. Les
éléments de cette représentation sont restés figés dans l’immédiat après-
guerre. Car montrer l’évolution du système à l’Ouest, les gouvernements et
les hommes politiques qui changent ne correspond pas au concept des
relations internationales élaboré entre 1946 et 1949 et basé sur
l’opposition fondamentale entre les deux camps. Montrer l’autre de façon
immuable est seulement une autre manière de dire que nous-mêmes n’avons pas
changé.
Pour que la représentation du socialisme que le cortège du 1er mai
donne à voir devienne vraiment complète, il faut établir une relation par
rapport à l’autre24. Cette relation est négative. Elle repose sur le
sentiment de haine et de mépris, et de leurs compléments, le rire et la
moquerie.
Les allégories représentent souvent les monstres fantastiques et
volontairement horribles (dragons, hydres, animaux fantastiques) ou les
objets de pires hantises de la guerre froide (arme atomique, retour du
fascisme ou d’une nouvelle guerre mondiale). Et pourtant, elles ne sont pas
censées faire peur. Bien au contraire. Le rire et l’esprit de dérision
reviennent souvent dans les comptes-rendus des allégories de l’autre. En
24 Stein, Howard F., « Psychological Complementarity in Soviet-American Relations », Political
Psychology, 2 (1985), p. 257.
14/26
1950, l’allégorie du dragon de l’impérialisme, long d’une trentaine de
mètres, ne provoque pas la peur mais la moquerie parmi les spectateurs :
« Nous rions de vous. Comme ris de vous l’ouvrier qui porte la pancarte
avec le dollar et le message : Brigades et tracteurs détruiront ces monstres ! »25. La
même année, à Ostrava, le char allégorique provoque « la dérision
générale »26. En 1951, la « culture du kitch hollywoodien est l’objet de la
raillerie »27. En 1958, encore, les femmes de Žižkov, qui représentent
l’allégorie de l’Atome pour la paix, « lancent un rire dans le visage des
instigateurs de la guerre atomique », non sans un certain sens du cocasse,
en scandant : « Taisez-vous, les soldats de l’atome, sinon l’atome vous
passera une raclée ! »28.
Mais dans les années 1950, en pleine guerre froide, rire du danger
d’une nouvelle guerre ne suffit pas. Le pas cadencé de la police, de
l’armée et des Milices populaires, une sorte de forces paramilitaires du
Parti communiste, qui suit immédiatement les allégories des étudiants,
annonce qu’il faut malgré tout « rester vigilant »29. Rire, certes, mais
rester prêt à « se battre pour la paix ». Par les armes, s’il le faudra.
Le rire et son antithèse, la peur, sont ici très étroitement
associés. Le choc de rencontre avec l’horrible « autre » et le rejet
fasciné qu’il suscite renoue avec les peurs et les désirs de l’inconscient
collectif forgé par le régime. L’allégorie de l’autre dans le défilé du 1er
25 En tchèque, le texte joue également sur la mélodie de la phrase : « Úderky a traktory, zničí
tyhle potvory ! », voir « Se sovětským svazem za mír, za vlast, za socialismus », Mladá fronta,
3 mai 1950.26 « Slavný 1. máj v Ostravě », Mladá fronta, 3 mai 1950.27 En tchèque, le slogan joue sur l’effet comique : « Buďte zticha, atomčíci, atom vám dá na
palici ! ». Voir « Míru patří naše srdce – násilníkům pěst », Mladá Fronta, 2 mai 1951.28 « Celým srdcem pro mír », Rudé právo, 2 mai 1958.29 « Slavný 1. máj v Ostravě », Mladá fronta, 3 mai 1950.
15/26
mai et le rire qu’elle est censé de provoquer est un moyen de se
familiariser avec son propre alter ego, le caractère horrible des
démocraties populaires dont l’image est rejeté sur l’autre. L’apprivoiser
et le dominer par le rire et la dérision permet d’admettre l’existence de
ses propres peurs et de se construire. Rire de l’étranger, de
l’impérialiste repoussé de l’autre côté de la frontière est le seul moyen
de combattre la face refoulée de l’imaginaire collectif que le régime est
en train de construire. Traquer l’étranger par le rire permet de traquer
l’étranger en soi et de reconnaître son inquiétante étrangeté30.
Cette inquiétante étrangeté est d’abord un choc, un étonnement face à
l’insolite, à l’étrange et à l’horrible. Elle se produit lorsque
disparaissent les limites entre l’imagination et la réalité, lorsque le
symbole cesse d’être symbole et prend toute la signification du symbolisé,
lorsque le fantastique devient soudainement réel31. Les allégories de
l’autre sont constitués de corps diaboliques et diabolisés de l’ennemi,
représenté en homme-animal (hydre ou dragon au visage humain), en homme-
objet (hommes à la tête d’atome, spectres de la guerre) ou en homme déguisé
et inquiétant (membres du Ku-Klux-Klan). Souvent, une partie de leur corps
ou carrément le corps entier est disproportionné par rapport au reste32. En
1950, l’ « hydre du capitalisme » à la tête de l’oncle Sam est longue d’une
trentaine de mètres (!). Ces attributs sont d’autant plus commodes à
utiliser que le vrai « autre » est largement méconnu par les populations
Tchécoslovaques à cette époque-là. La circulation des images, des
informations et des personnes est encore très restreinte.
30 Kristeva, Julia, Etrangers à nous-mêmes, Paris, Gallimard, 1991, 296 p.31 Freud, Sigmund, L’Inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 1998, p. 251 et alli.32 ANT, Centrální katalog FFKD, 1951, le cliché 38224/52.
16/26
Le lien avec l’autre est toujours conflictuel. Mais l’angoisse et le
malaise qui accompagnent l’inquiétante étrangeté peuvent être constructifs.
Le choc que produit le rencontre avec l’autre, l’identification avec celui
qui viole les limites fragiles et incertaines de l’identité propre du
régime provoque un désordre qui peut soit se pérenniser et devenir une
psychose collective, soit s’inscrire dans une dynamique normale.
L’allégorie de soi et de l’autre est une sorte d’interaction,
d’échange qui joue sur la frontière entre les deux. Cette tension est
présente tout au long de la guerre froide et paradoxalement, est
enrichissante. Comme le conflit enrichit l’individu car il lui permet
d’être mieux équipé psychologiquement, le besoin d’avoir des ennemis est le
fondement de la psychologie politique33. Aussi surprenant que cela puisse
paraître, les ennemis sont aussi indispensables que les alliés et quelques
rares exceptions des pays neutres et sans ennemis (Suisse, Finlande)
confirment cette règle.
L’impérialiste, aussi paradoxalement que cela puisse paraître, est
une partie indissociable du communiste. L’un sans l’autre n’existerait pas.
L’inimitié entre l’Est et l’Ouest n’est pas seulement un facteur de
division mais aussi d’union et d’association. La création des catégories
d’amis et d’ennemis permet à la jeune démocratie populaire de se
constituer, de se maintenir et de s’actualiser. L'ennemi assure la cohésion
de l'identité du groupe34. Certes, l’attribution des caractéristiques d’ami
33 Volkan, Vamik, « The Need to Have Ennemies and Allies : A Developmental Approach », Political
Psychology, 2 (1985), p. 219-247.34 Zur, Ofer, « The Love of Hating : The Psychology of Ennemy », History of European Ideas, 4 (1991),
p. 345-369.
17/26
et d’ennemi est souvent arbitraire. Mais elle permet de dresser clairement
les frontières. Et ces frontières, elles, peuvent se déplacer.
Les évolutions de la représentation (1948-1960)
Tout au long des années 1950, le thème belligérant restera l’attribut
dominant de l’autre. Dans la première moitié des années 1950, ce thème
repose sur la dichotomie entre la préparation d’une nouvelle guerre à
l’Ouest et la construction du socialisme par le travail à l’Est. En 1950,
l’allégorie de l’impérialisme représente un gratte-ciel de Wall-Street. De
haut en bas, le bâtiment est couvert par des symboles de l’autre : la
consommation occidentale est rappelée par le sigle « Coca-Cola » et « Texas
bar ». La guerre par l’inscription « III. War-to-day », « Atom Puma »,
« Guerre » ou la silhouette de l’avion avec « Terreur » écrit sur ses
ailes. La finance et la logique de l’exploitation de l’homme par l’homme
sont rappelées par les sacs de dollars et les écriteaux « Wall Street » et
« Nous voulons les profits ». Le banquier, installé confortablement sur le
gratte-ciel, tient dans les rênes les soldats de différents pays
capitalistes qui font avancer tout le bâtiment. Pour les motiver, le
banquier leur brandit sur une canne un appât. Le bâtiment est placé sous la
protection des membres du Ku-Klux-Klan qui marchent de chaque côté. La
folle entreprise de financement de la guerre par le capital se résume par
le texte au dessus de la tête du banquier, « Dollarium Trumans », un jeu de
mot avec « delirium tremens » et le nom du chef de la diplomatie
américaine.
18/26
Par opposition à cet « autre », le camp de la paix se représente par
les symboles de travail et les résultats de la reconstruction du pays : les
modèles des nouvelles fabriques et des logements pour les ouvriers, les
agriculteurs des coopératives sur les tracteurs, les résultats de la
planification ou de la compétition socialiste35.
Le rapport à soi et à l’autre se traduit également en lignes
verticales où le « haut » signifie l’avenir et le « bas » le passé révolu.
A plusieurs reprises, les allégories de l’ennemi évoquent l’enterrement de
l’arme atomique (195036, 195737) ou de l’OTAN (195838), où le corps
personnifié du rival stratégique s’engage sur son dernier chemin avant de
disparaître sous la terre. En 1951, l’allégorie de l’ennemi met en scène le
char mortuaire de l’ « espoir de la réaction », avec l’effigie d’Hitler sur
le cercueil39. L’ancien ordre bourgeois, sombrant dans les abîmes, contraste
avec le nouveau régime de la démocratie populaire, en train d’éclore dans
la joie collective. Les regards des manifestants du camp de la paix sont
orientés vers le haut, leurs mains levées. Comme le corps avance vers
l’avant, le regard s’élève vers le ciel. Le discours des médias associe les
travailleurs aux fleurs qui s’épanouissent et montent vers le ciel avec
l’arrivée de la Fête du travail. Ils instrumentalisent ainsi l’ancienne
tradition ouvrière du 19e siècle qui associait déjà le 1er mai avec le
35 ANT, Centrální katalog FFKD, 1952, le cliché 40391/52.36 ANT, Centrální katalog FFKD, 1951, le cliché 38224/52.37 ČTK, 1957, le cliché FO01087359.38 ČTK, 1958, le cliché FO01087357.39 ANT, Centrální katalog FFKD, 1951, le cliché 38224/52. Pour l’interprétation de ces
allégories, voir « Míru patří naše srdce - násilníkům pěst », Mladá Fronta, 2 mai 1951.
19/26
printemps et la montée en puissance des travailleurs avec la nature
bourgeonnante40.
Dans la seconde moitié des années 1950, le thème de préparation de la
nouvelle guerre / la construction de l’avenir par le travail est complété
par un nouvel attribut, l’atome. Il s’agit d’une réaction au développement
de l’arme nucléaire menée en parallèle aux Etats-Unis et en Union
soviétique. Le monopole nucléaire américain est brisé déjà en 1949 quand la
première bombe nucléaire soviétique est testée avec succès41. Mais la
principale amélioration vient au milieu des années 1950. L’URSS développe
la bombe à fission en août 1953et mène un essai avec la vraie bombe H en
novembre 195542.
L’atome renforce les attitudes dualistes car il radicalise la
définition de l’ennemi. Si l’autre trouve une protection absolue dans les
armes à la puissance absolue, le dualisme nous / eux devient lui aussi
absolu43. Ceux qui lèvent ces armes contre l’autre doivent d’abord
« anéantir » leur victime moralement. Ils doivent considérer l’autre comme
profondément criminel et inhumain, et donc inutile. Ils seraient sinon eux-
mêmes criminels et inhumains. Ainsi, la première représentation de
l’enterrement de la bombe atomique occidentale apparaît dans le défilé du
40 Pour l’association du printemps et du 1er mai dans la tradition ouvrière d’avant 1917, voir
Hobsbawm, Eric, « Birth of a Holiday : The First of May », in Wringley, Chris ; Sheperd, John
(dir.), On The Move. Essays in labour and Transport History Presented to Philipp Bagwell, London, The Hambledon
Press, 1991, p. 113-115.41 Le premier essai soviétique de bombe atomique a lieu le 29 août 1949. Il s’agit d’une copie
de l’américain « Gros bonhomme » largué sur Nagasaki et dont la composition a été obtenue par
les services d’espionnage soviétique.42 Le premier essai soviétique de la bombe H intervient le 12 août 1953. Toutefois, il s’agit
davantage d’une version améliorée de la bombe à fission que d’une vraie bombe thermonucléaire.43 Harle, Vilho, op. cit., p. 10.
20/26
1er mai en 1950, en réaction au premier essai nucléaire soviétique44. Mais la
pire criminalisation et dévaluation de l’Occident apparaît à travers les
scènes de son enterrement, de plus en plus fréquentes dans la seconde
moitié des années 1950. Sans surprise, l’atome y est systématiquement
présent. C’est souvent même son utilisation qui est responsable de
l’anéantissement de l’autre.
Le lancement du satellite soviétique Spoutnik, en août 1957, montre
au monde que l’Union soviétique dispose des missiles capables de frapper
n’importe où sur la planète. Sans surprise, cette année, l’allégorie de
l’autre est représentée par l’enterrement de l’OTAN. Le cortège funéraire
s’ouvre par une effigie de l’ « esprit d’Hitler », accompagné de créatures
monstrueuses appelées « atomčíci » - les figures humaines à la tête
d’atome. Au dessus de leurs têtes, marquées par les initiales OTAN, volent
les modèles des avions de chasse du Pacte atlantique. Le rappel de
l’utilisation militaire de l’énergie atomique préfigure l’avenir, la mort
du pacte. Le cercueil de l’OTAN qui suit est d’ailleurs entouré par les
spectres de la guerre, figures déshumanisées des membres du Ku-Klux-Klan
reconnaissables seulement par leur symbole de la croix45. L’OTAN doit
mourir, et il meurt, de surcroît, de ses propres actes. C’est la mort la
plus efficace, car le Pacte se l’impose lui-même.
A partir de cette année, les fusées spatiales et les satellites
accompagneront systématiquement les allégories du camp socialiste. Mais
paradoxalement, elles sont systématiquement présentées en tant que symboles
de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et de l’exploration des
44 ANT, Centrální katalog FFKD, 1951, le cliché 38224/52.45 « Pohřeb v průvodu », Rudé právo, 2 mai 1957.
21/26
terres au-delà de ses propres limites. Si pour le camp de la guerre,
l’atome est synonyme de l’(auto)destruction, dans le camp de la paix, sa
puissance est mise au service des populations46.
* * *
En 1960, les allégories du camp de la guerre disparaissent subitement
du cortège. Est-ce un signe que le mouvement pour la paix commence à
s’essouffler ? Si on élimine l’autre, que nous reste-t-il de nous ? La
disparition de l’autre est un souhait qui ne peut jamais être exaucé. En
tuant l’autre, on se tue soi-même, ou alors il faut se redéfinir par
rapport à un autre « autre ». La disparition de l’allégorie de l’autre du
défilé du 1er mai témoigne-t-elle du fait que le camp socialiste ne se
définit plus par rapport à son ennemi traditionnel ?
Il y a plusieurs explications de ce changement. La première raison
est géopolitique. La perception de l’ennemi dans la politique militaire
soviétique a subi un profond changement à la fin des années 1950. En
novembre 1958, les Etats-Unis et l’Union soviétique entament un moratorium
informel sur les essais nucléaires (1958-1960). En septembre 1959,
Khrouchtchev entreprend sa première visite aux Etats-Unis et en 1961, il
rencontre Kennedy à Vienne. Le 22e Congrès du PCUS (1961) modifie la
doctrine militaire, prenant en compte les effets des armes de destruction
massive. La nouvelle position est que la guerre peut être évitée avant même
la disparition finale du capitalisme. Peu après la crise des missiles de
Cuba (octobre 1962) s’ouvrent les pourparlers sur l’arrêt des essais et le
46 « Strhující proud radosti a odhodlání », Rudé právo, 2 mai 1958.
22/26
contrôle des armes nucléaires. En 1963, Khrouchtchev décrit la nouvelle
situation par le terme de « coexistence pacifique ». La frontière entre
« eux » et « nous » est profondément modifiée. Les Etats-Unis et l’Union
soviétique continueront la compétition économique et politique en évitant
de brandir la menace d’une guerre thermonucléaire. Le thème de la lutte
pour la paix dans le monde restera d’ailleurs présent dans le cortège de la
Fête du travail, sous une forme strictement politique et non plus
militaire, à travers les appels à la solidarité internationale prolétaire
avec les peuples opprimés de Vietnam, du Chili, etc.
La deuxième raison est sociale. La disparition de la représentation
radicalement antagoniste « nous/eux » témoigne de l’essoufflement du
raisonnement dichotomique caractéristique des sociétés est-européennes des
années 1950. La majorité des pays de l’Est se libéralise. Les victimes des
procès politiques des années 1950 sont progressivement réhabilitées (Gustáv
Husák ou Laco Novomeský devenant symboles de cette réhabilitation en
Tchécoslovaquie). La culture est discutée plus librement dans les médias.
La télévision et le cinéma permettent aux populations de se familiariser
davantage avec l’Occident et de se faire une image plus subtile de la
réalité. La société de consommation s’installe progressivement dans les
villes. Les catégories radicalement dichotomiques des années 1950 ne
correspondent plus à l’état d’esprit des sociétés devenues modernes et
plurilinguistiques.
La dernière explication est idéologique et est liée davantage à
l’évolution politique de la Tchécoslovaquie. Après l’Union soviétique, la
Tchécoslovaquie est le premier pays du bloc de l’Est à atteindre
officiellement, en 1960, la phase du socialisme. Cette réussite est marquée
23/26
par la nouvelle constitution et le qualificatif « socialiste » ajouté au
nom du pays. Dans cette nouvelle ère, l’autre n’a plus de place. La
réalisation du socialisme a confirmé que l’ennemi a définitivement disparu
de la société. On ne le représente plus. Il semble que le pays a réussi à
intérioriser la relation ami/ennemi, sans pour autant la supprimer. Le camp
de la paix ne se définit plus par rapport au camp de la guerre. Le miroir
se renverse : le camp de la guerre est défini par l’action du camp de la
paix. A l’intérieur des frontières de l’Etat, la représentation de l’autre
se fera désormais davantage à travers les opérations de soutien à la
décolonisation, dans la première moitié des années 1960, ou à la lutte du
peuple vietnamien contre l’impérialisme américain, dans la seconde moitié
des années 1960 et au début des années 1970.
* * *
Les allégories de soi et de l’autre témoignent du caractère
dichotomique de la pensée des sociétés communistes dans leur période
fondatrice. Dans les années 1950, les démocraties populaires prolongent
l’esthétique dualiste soviétique du bon/mauvais, héros/anti-héros de
l’entre-deux-guerres47. Cette esthétique contribue à établir, entre 1946 et
1949, une nouvelle vision soviétique de la frontière, moins matérielle ou
stratégique et plus géopolitique et donc plus plastique. Il s’agit moins
d’une ligne que d’un espace dont les limites sont définies de façon
politique et sociale, à travers la dichotomie guerre/paix. Les pays
47 Cette esthétique dualiste a été analysée par Clark, Katherine, The Soviet Novel. History as Ritual,
Bloomington, Indiana University Press, 1981, 320 p.
24/26
occidentaux, et plus particulièrement les Etats-Unis, ont perçu la
nouveauté de cette idée et ont développé une conception originale des
relations internationales fondée sur la géopolitique des blocs qui dominera
la période de la guerre froide. Dans les années 1960, la vision du monde
devient plus complexe et sa conception radicalement dualiste devient
obsolète. Toutefois, malgré la déstalinisation et l’ouverture progressive
des sociétés, les pays est-européennes continuent à s’auto-définir sur les
bases de cette conception dualiste du monde pour les prochaines 40 années.
Pour cette raison, l’autodéfinition est-européenne en tant que camp de la
paix mériterait une analyse plus approfondie.
Résumé : Pendant la guerre froide, l’Est et l’Ouest ont élaboré chacun leur
propre représentation de soi et de l’autre. Le but de la communication est
d’analyser la représentation socialiste de « soi » et de l’ « autre » et
leurs dynamiques en Tchécoslovaquie, pendant la période fondatrice des
années 1950. L’argumentation repose sur l’analyse iconographique et
discursive des allégories de l’Est et de l’Ouest exposés dans le défilé du
1er mai. L’auteur s’interroge d’abord sur les origines du mouvement pour la
paix et ses protagonistes. Ensuite, il analyse comment le camp de la paix
et le camp de la guerre sont représentés, suivant certains principes
(profonde dichotomie, inversion, comparaison). Enfin, il évoque certains
points sur ce que la représentation de l’autre, de l’Ouest, peut apprendre
sur soi, sur le régime communiste en Tchécoslovaquie.
25/26
The Representation of the Cold War. The Peace and War Camps in
Czechoslovakia 1948-1960
Abstract : During the Cold War, East and West each developed its own
representation of itself and the other. The purpose of the paper is to
analyse the socialist representation of “oneself” and the “other” and its
dynamics in Czechoslovakia, during the founding period of the 1950s. It
relies on the iconographic and discursive analysis of the allegories of
East and West performed during the May Day celebrations. First, the author
questions the origins of the Peace Movement and its protagonists. Then, he
analyses how the Peace and the War Camps were represented, following a
number of fundamental principles (essential dichotomy, inversion and
coparison). In the end, he emphasises some points about what the
representation of the “other”, the West, can show about “oneself”, the
nature of communist regime in Czechoslovakia.
26/26