Images de l'Afghanistan en guerre
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Images de l'Afghanistan en guerre
1
THIBAULT LEROY
IMAGES DE L’AFGHANISTAN EN GUERRE
Production, utilisation et conservation des images par l’ECPAD 2002-‐2008
Mémoire de Master 2 d’Histoire sous la direction de Hugues Tertrais
3
« L’image que l’on a d’une guerre, ce n’est que la partie immergée d’un conflit qui existait avant et qui existe après et qui n’est pas filmée, n’est filmé que ce qui nous frappe, ainsi les journalistes se précipitent en Irak lorsque ça flambe, parce que celui qui filme veut avoir de
belles images, comme le militaire veut gagner la guerre. Mais ce que je voulais dire par dessus tout c’était que la notion de guerre en direct est absurde parce que la guerre n’est pas
un « Paris-Dakar ». Dans le « Paris-Dakar », il y a un départ et une arrivée ; une guerre n’a ni départ ni arrivée, parce qu’elle s’enracine dans l’histoire passée et dans le futur. Ainsi les
images ne peuvent donner qu’une vue partielle du conflit, et c’est elle qui prétend être une vérité intangible, et cela, évidemment, c’est un grave risque du monde actuel »
Marc Ferro,
dans L’image de guerre et son utilisation, séminaire de l’École militaire, 1996, p.901.
1 L’image de guerre et son utilisation: séminaire, École militaire, Paris, 20 janvier 1996. Paris : Centre d’études
4
Glossaire
Le lecteur trouvera ci-après le glossaire des principaux acronymes rencontrés dans ce
mémoire :
ACM Actions civilo-militaires. Plus rarement employé pour AntiCoalition Militia, groupes anticoalition.
ANA Armée nationale afghane BANA Bataillon de l'Armée nationale Afghane CEMA Chef d'Etat-major des armées CIMIC Civi-Military Cooperation ; Actions civilo-militaires COS Commandement des opérations spéciales Coy Groupe de combat DIO Détachement d'Instruction opérationnelle ECPAD Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense EMA Etat-major des armées FOB Forward Operating Base, base opérationnelle avancée GTIA Groupe tactique interarmes IED Improvised Explosive Device, en Français, EEI, engin explosif improvisé
ISAF International Security Assistance Force, ou FIAS en Français, est la force internationale d'assistance à la sécurité, déployée en Afghanistan sous mandat de l'ONU.
KMTC Kaboul Military Training Center NDS Services secrets afghans NEDEX Equipe d'enlèvement des explosifs
OEF Operation Enduring Freedom, nom de l'opération américaine de contre-terrorisme en Afghanistan
OMLT Operationnal Mentoring Liaison Team, Equipe opérationnelle de liaison et de mentoring QRF Quick Reaction Force, Force de réaction rapide RIMa Régiment d'infanterie de Marine RMT Régiment de Marche du Tchad RPG Roquettes de fabrication soviétique RPIMa Régiment de parachutiste de l'Infanterie de Marine SIRPA Service d'information et de relations publiques des armées TC Time code, situe le moment dans une bande vidéo UXO Munitions non explosées VAB Véhicule à l'avant blindé VBL Véhicule blindé léger
5
Introduction
L’Afghanistan très contemporain n’a que peu mobilisé les historiens. Au contraire,
beaucoup a été écrit sur le sujet par des journalistes, des politistes, voire par les militaires eux-
mêmes. Seul l’historien spécialiste de l’Afghanistan, l’américain Mike Barry, a actualisé son
ouvrage Le Royaume de l’insolence par une nouvelle édition en 2011. Très généraliste, le
livre ne détaille pas le champ d’intervention français. La frilosité des historiens naît d’une
limite : quelles archives utiliser ? Quelles sources seront assez neuves pour dépasser le simple
rappel des faits, et entrer, avec de sérieuses preuves à l’appui, dans le vif de l’analyse ? Il
existe peu d’archives sur la guerre en Afghanistan parce que nous sommes ici dans une
histoire du temps présent. Les documents officiels n’ont pas été reversés. S’ils le sont, leur
lecture n’est possible qu’une fois le délai de réserve de trente ans passé. Pourtant,
l’Afghanistan est désormais au cœur du débat. Après plus de dix ans de présence, les Français
ont, semble-t-il, acté l’idée du retrait par l’élection de François Hollande, qui s’était démarqué
dans la campagne présidentielle en proposant de retirer les troupes avant la fin de l’année
2012. Les opérations n’ont fait la une des actualités que lorsqu’il y eut des pertes. L’image
des Français en Afghanistan est liée à celle de la dernière séquence : un « retrait sans gloire »,
tel que le titrait le journal Libération le 25 mai 2012. La couche supérieure de l’actualité
écrasant toutes les autres, c’est à l’historien qu’il appartient de reconstituer la sédimentation
des diverses représentations diffusées à propos de l’Afghanistan.
« L’image » : elle domine nos écrans, se multiplie par tous les média qui la supportent
– télévision, ordinateur, cinéma, mais aussi téléphone mobile et tablettes tactiles. Nous
sommes entourés d’images, elles façonnent notre représentation du monde. Voici la définition
qu’en donne le dictionnaire de l’Académie française : « Représentation ou reproduction de
l’apparence visible des êtres et des choses »2, l’image étant aussi associée, par métonymie, à
« la communication audiovisuelle dans son ensemble ». L’image, et sa communication, ne
reproduisent pas le réel. Ils le transforment. Beaucoup a été représenté en image, à la
télévision et même déjà au cinéma, de la guerre en Afghanistan. Des documentaires d’Un œil
2 Dictionnaire de l’Académie française, neuvième édition.
6
sur la planète3 à C’est pas le pied la guerre4, ou Armadillo5 au cinéma, le public a pu se faire
une idée visuelle de ce que « les gars » endurent en Afghanistan. Tous postérieurs à 2008, ces
films mettent en scène la guerre.
La guerre, qu’est-ce donc ? A quel moment bascule-t-on dans la guerre ? La guerre,
c’est le « recours aux armes », selon le dictionnaire ; « la continuation de la politique par
d’autres moyens »6, selon la formule de Clausewitz. Il y a une complexité à définir le concept
de la guerre : pour une guerre, faut-il des adversaires ? Y a-t-il un climat ou une situation de
guerre ? La problématique de la définition est au cœur du sujet. Pensons « l’image de
guerre », donc non pas la guerre dans sa réalité concrète et mesurable, entre des protagonistes
identifiés, mais dans sa représentation, à l’écran. Du cinéma, de la télévision, ce sont souvent
des instantanés, des clichés immédiats, qui distillent l'idée que l'Afghanistan est un
« bourbier ». Cela évacue l’une des principales données du problème : l’« avant » et
l’« après » de la guerre, indispensables pour la définir. Ces images tombent en dehors de toute
chronologie. On peut constater un Afghanistan en chaos aujourd’hui, mais l’approche d’un
historien ne peut se satisfaire d’un cliché.
Si l’on veut étudier l’image de la guerre en Afghanistan, il fallait donc des archives
pour l’historien tout autant que des documents audiovisuels qui s’adaptent à la longue durée.
Ce sont les archives de l’ECPAD qui répondent à ce double critère. L’ECPAD est
l’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, basé au fort
d’Ivry. Il est l’agence d’image des armées françaises ; ses reporters assurent la couverture
audiovisuelle de leurs opérations en France et à l’étranger. Présents en Afghanistan depuis
2002, ils ont laissé plusieurs milliers de photos et des dizaines de cassettes de films. Nous
avons relevé dans le fonds d’archives « Actualité »7 de l’établissement près de 41 notices,
incluant 563 cassettes. L’interrogation de la base de données de l’ECPAD concernant les
films sur le mot clef Afghanistan donne 204 éléments. La taille du corpus est donc très
importante. Une fois les documents faisant référence à l’Afghanistan qui ne sont pas tournés
là-bas retirés, il reste encore une grande quantité de cassettes. Même problème posé par les
3 « Mourir pour Kaboul ? », Un œil sur la planète, magazine de la rédaction de France 2, 2007. 4 C’est pas le pied la guerre ?, de Fred Hissbach, diffusé sur France 2, le jeudi 29 septembre 2011. 5 Armadillo, de Janus Metz, 2010. Il a remporté le Grand Prix de la semaine internationale de la critique, au
Festival de Cannes, en 2010. C’est un documentaire qui suit des soldats danois au camp d’Armadillo, dans la
province d’Helmand, au sud de l’Afghanistan. 6 CLAUSEWITZ (von), Carl, De la guerre, traduction par Muriawec, Laurent, Paris : Perrin, 2006. 7 Voir « Sources », p. 132.
7
photographies : chaque reportage verse aux archives des centaines de clichés. En
comparaison, les films qui ont été produits à partir de ces images sont bien moins nombreux.
Deux productions de l’ECPAD, un film de vingt-deux minutes et un film de cinquante deux
minutes ont attiré notre attention8. Il s’agit du film Une politique de Défense, en 2004, et
OMLT : Les mentors, en 2007. Le fonds d’archive nous est donc apparu riche, documenté sur
toute la période, et encore peu exploité.
Si les images sont fournies par l’armée française, voici leur biais : l’image, c’est aussi
la communication. Béatrice Rodier-Cormier a consacré sa thèse 9 aux enjeux de la
communication de défense. Elle y explique le lien entre l’armée et la nation, nécessaire à la
bonne santé de la Défense, crucial pour une démocratie. Il faut noter que la bibliographie sur
le sujet ne manque pas10, même si elle est dominée par les anglo-saxons et concentrée, pour
une grande partie, sur les expériences du Vietnam et du Golfe. Toutefois, ce sont des
chercheurs qui ont travaillé sur la propagande, et non la communication. En France, outre
l’Indochine, analysée par Béatrice Rodier-Cormier, peu de recherches se sont attelées à la
communication de Défense pendant les conflits contemporains : Tchad, Liban ou Kosovo. Les
études portent sur les rapports entre les armées et les médias, sur la présence des journalistes
pendant les opérations. Quelques études salutaires fournissent une approche nouvelle sur le
sujet. A propos de l’Afghanistan, le Centre de Doctrine d’Emploi des Forces (CDEF) a édité,
dans sa revue Doctrine Tactique, un numéro spécial consacré à l’Afghanistan 11 . Le
Lieutenant-colonel Jérôme Sallé, alors adjoint communication et porte-parole – de décembre
2008 à avril 2009 – détaille ce qu’il appelle « La communication opérationnelle en
Afghanistan : relever le défi de la « guerre »12 de la communication »13. Il y explique comment
est huilée l’organisation de la communication sur le théâtre. Il montre que la Défense
s’intéresse de près à ces enjeux. On ne peut oublier l’ouvrage du Centre d’études en sciences
8 Si on exclut les films du Journal de la Défense, produits après 2008. 9 RODIER-CORMIER, Béatrice, Op. Cit. 10 COMBELLES-SIEGEL, Pascale et CENTRE D’ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES DE LA DÉFENSE
(PARIS), La communication des armées : bibliographie commentée, Paris : Centre d’études en sciences sociales
de la défense, 1998. Les Documents du C2SD. 11 CDEF, Doctrine Tactique. juillet 2009, n° 17. 12 Le terme est mis entre guillemets par l’auteur. 13 LCL SALLÉ, Jérôme. « La communication opérationnelle en Afghanistan : relever le défi de la « guerre » de
la communication » In : Doctrine Tactique. juillet 2009, n° 17, pp. 68–70.
8
sociales de la Défense dirigé par Claude Weber14, mais il est vrai qu’un approfondissement
des nouvelles relations stratégiques entre la Défense et la communication depuis 2001 est un
objet d’étude qui nous semblerait original. Disons qu’il mériterait d’être présenté par un
travail complet.
La communication, donc le sens de l’image, est pensée comme un combat. Il y a
d’abord le soutien du public, nécessaire à toute entreprise de longue durée, gourmande en
moyens et qui met à l’épreuve la résilience de l’opinion face aux morts. Le LCL Sallé note
« De manière générale, mourir pour la patrie ne va plus de soi, surtout lorsque le citoyen ne
perçoit pas spontanément la légitimité de l’engagement. »15 De plus, la mort du soldat a
changé de perception dans l’opinion publique. Il n’est plus le sacrifié héroïque de guerres qui
s’inscrivent dans l’imaginaire collectif, de Valmy à Verdun. Il est devenu un mort de fait
divers, ce qui pose un problème conséquent à la Défense, à son lien avec la Nation. Cela
interroge le sens de la mort publique. Quelle en est l’image ? c’est tout l’intérêt, quand on
questionne l’engagement français en Afghanistan, de considérer bien sûr le moment terrible
de l’embuscade d’Uzbeen, des 18 et 19 août 2008. Dix soldats y perdent la vie, neuf pendant
les combats, un dixième lors de l’accident d’un véhicule. L’opinion publique est touchée et
curieusement rappelée à l’actualité de la guerre. Entre 2001, date où la France décide de
s’engager en Afghanistan, et 2008, où elle y perd, en quelques heures, le plus grand nombre
d’hommes depuis l’attentat du Drakkar en 1983 au Liban, l’image de la guerre en Afghanistan
a vécu des modifications. Participer à la riposte américaine aux attentats du 11-Septembre a
rencontré un vif soutien dans l’opinion, en octobre 2001, et fut décidé par l’unanimité de la
classe politique16.
Lorsque l’envoi du contingent est décidé, l’Etat-major se questionne : « Qu’est ce
qu’on a sur l’Afghanistan ? »17. Pas grand chose à cette date. Certes, la France a enregistré
quelques collaborations, notamment archéologiques au XXe siècle18, mais elles appartiennent
14 WEBER, Claude et CENTRE D’ETUDES EN SCIENCES SOCIALES DE LA DEFENSE (PARIS). La filière
communication au sein de la défense : typologie, recrutement, formation et carrière. Paris : Centre d’études en
sciences sociales de la défense, 2002. Les Documents du C2SD. 15 LCL SALLE, Jérôme, Ibid. 16 A l’exception, entre autres, de Noël Mamère, député des Verts. 17 Cité par MERCHET, Jean-Dominique, Mourir pour l’Afghanistan, pourquoi nos soldats tombent-ils là bas ?,
Paris, Ed. Jacob-Duvernet, 2010 (Edition mise à jour). 199 p. 18 KHAN, Akbar. L’Aide de la France au niveau du développement culturel scientifique et technique de
l’Afghanistan de 1921 à 1979. Thèse de doctorat, 2001.
9
à un lointain passé. De même pour les visites en France du commandant Massoud, l’un des
chefs bien connus de la résistance afghane, dans les années 1980. Après la chute des tours
jumelles, les Etats-Unis embarquent avec eux une large coalition internationale dont la France
fait partie. Le but est, initialement, de chasser le régime taliban qui abrite des groupes
terroristes tout en sécurisant le pays pour les opérations humanitaires. L’ONU donne à cette
opération son aval par la résolution 1378 du 14 novembre 2001. Les marsouins du 21e RIMa
posent le pied à Mazar-e-Charif dans la foulée de ces opérations, soit 350 personnes à peine,
dont la mission principale est de sécuriser et de remettre en état les installations aéroportuaires
de la capitale du Nord de l’Afghanistan19.
Rien ou presque n’est alors connu par le bataillon français, pourtant l’Afghanistan finit
par être, en 2012, l’un des plus longs engagements contemporains de l’Armée française. Un
engagement exigeant : la France y a perdu, au jour où nous écrivons ces lignes, 82 hommes20.
Les premières années ont pourtant été calmes. Lorsqu’ils arrivent à Kaboul, pour les mandats
Pamir, attribués à l’OTAN par les Nations Unies, les Français évoluent dans un
environnement presque accueillant. Tout juste soulagés du départ des talibans, alors
assommés par la rapidité mécanique du déploiement international, la population fait,
effectivement, bon accueil au contingent français. Certes, le pays sort de trente ans de guerre.
Mais l’image du conflit semblait derrière plutôt que devant. Et pourtant, plus proche de nous,
cette image d’un pays incontrôlable, plongé en guerre civile, est d’une terrible actualité. Ce
qui fait qu’aujourd’hui un homme d’âge mûr aura, là bas, toujours connu la guerre, depuis
1979. Certains regretteraient même la parenthèse du régime taliban, qui assurait une sécurité
relative, au prix d’odieux sacrifices sur les droits humains les plus élémentaires, à commencer
par ceux des femmes. La pax americana n’a pas pris sur le terrain afghan.
Dans un dossier de l’IRIS intitulé « Afghanistan, 10 ans de conflit », Gérard Chaliand,
présenté comme géostratège spécialiste de l’Afghanistan, expose sa vision, en 2011, de l’issue
potentielle du conflit. « Il n’y a donc pas de victoire militaire possible pour les occidentaux.
Toutefois, il n’y a pas non plus de victoire militaire possible pour les talibans, mais il leur
suffit évidemment de ne pas perdre. Il va donc falloir négocier pour essayer de déboucher sur
19 Cette opération était le sujet de notre mémoire de Master 1, La communication de l’armée française en
Afghanistan ��� durant l’opération Héraklès Décembre 2001 - Janvier 2002, 2011. 20 82 hommes, au 6 février 2012. Voir http://icasualties.org/oef/Nationality.aspx?hndQry=France pour des
chiffres à jour.
10
une non-victoire décente. »21 Dans cette même communication, qui est celle, rappelons-le,
d’un think tank plus que d’une université, le général Pierre Chavancy, ancien chef des armées
françaises en Afghanistan, confie : « nous n’avons pas de missions militaires. Il s’agit avant
tout de convaincre, et c’est ce que je vais m’attacher à vous faire comprendre : convaincre
qui, comment et dans quel but. »22 Le général a une vision plus optimiste que celle de M.
Chaliand. Il considère par exemple que la réputation des talibans auprès de la population est
remise en cause par leurs propres bavures, le fait qu’ils apparaissent aussi responsables de la
dégradation des conditions de vie. Ensuite, il estime que la formation de l’armée et de la
police afghanes a fait des progrès. Pourtant, les évènements de janvier 2012 – où quatre
soldats français ont été tués par des insurgés infiltrés dans l’armée – et des faits avérés de
corruption de la police contredisent quelque peu ce constat.
L’engagement en Afghanistan est aussi complexe du fait du pays même. Ses
montagnes allongées près de l’Himalaya, reliefs imposants de l’Hindou-Kouch, semblent
inflexibles et permanentes23. L’Afghanistan est insaisissable, terriblement lointain, malgré tout
fascinant. Fascinant parce que magnifique : « Quiconque a voyagé en Afghanistan en
conserve un souvenir ébloui » narrent Bernard Dupaigne et Gilles Rossignol, auteurs du Le
carrefour afghan. Nous n’avons pas eu cette chance, on se fiera à leur description. « Steppes
du Nord, immensités fleuries au printemps par l’éclosion de tulipes sauvages ; massifs
montagneux, difficiles d’accès, où la vie s’organise autour d’étroites vallées encaissées et de
cultures en terrasses miraculeusement accrochées aux parois ; déserts du Sud, où le vent
forme des dunes mouvantes, d’où émergent pourtant quelques restes de forteresses ou de
palais, ravagés en même temps que les canaux d’irrigation, lors du passage de Gengis Khân,
au début du XIIIe siècle ; vallées fertiles, où les cours d’eau et les canaux de dérivation sont
bordés de peupliers ; vastes étendues arides, où des nuages de poussière signalent des
troupeaux en transhumance. »24 Les auteurs décrivent un pays difficile d’accès, particularité
qui conditionne toute existence et tout déplacement en Afghanistan. De plus, ajoutent-ils,
21 LEPRI, Charlotte (dir.), Afghanistan : 10 ans de conflit, Colloque des 16èmes Conférences stratégiques
annuelles de l’IRIS, septembre 2011, p. 13. 22 Idem, p. 15. 23 Voir carte du relief, Annexes, 2, p. 142. 24 DUPAIGNE, Bernard, ROSSIGNOL, Gilles, Le carrefour afghan, Paris, Gallimard, 2002, p. 23. Voir
également carte, p. 25.
11
« pays enclavé, l’Afghanistan appartient à un vaste ensemble géologique entre les hauts
plateaux iraniens, le sous-continent indien et les steppes de l’Asie centrale »25.
L’Afghanistan est donc coincé entre le Pakistan au Sud, Etat rival, objet de toutes les
suspicions, à la frontière perméable ; l’Iran à l’Ouest, sensible à y étendre son influence ; les
anciennes républiques musulmanes soviétiques de l’Asie Centrale ; il possède même une
frontière avec la Chine à l’est26. Enfin, l’idée nationale en Afghanistan est un fait. Le pays est
ainsi composé d’une myriade de groupes linguistiques ou culturels, dont les principaux sont
les Pachtounes, les Tadjik, les Ouzbeks, les Turkmènes, ou encore les Hazaras. On y parle
plusieurs langues, principalement le pachto et le dari. Et, si une grande partie de la population
vit à Kaboul, d’autres pôles urbains essentiels composent le pays : Hérat à l’ouest, Mazar-e-
Charif au Nord, Kandahar au sud, Jelalabad à l’est. L’essentiel de la population vit dans des
villages ou dans des bourgs, en plus de ces villes, et semble vivre de l’agriculture. La
population afghane, au centre de toutes les attentions dans la bataille des « cœurs et des
esprits », est complexe. De la même manière, les « ennemis » ou les « terroristes » ne sont pas
tous des talibans. A eux s’ajoutent d’autres groupes insurgés, partisans par exemple de
Gulbuddin Hekmatyar, qui avaient déjà combattu les soviétiques, ou encore des combattants
non idéologisés, trafiquants et bandits, combattants étrangers, mercenaires.
Il faut dire qu’il y a la guerre en Afghanistan depuis, au moins, 1979. C’est la date à
laquelle l’Union soviétique décide d’une intervention, qui indigne alors la communauté
internationale par sa brutalité27. Moscou était le principal partenaire de Kaboul, et selon le
politburo, il ne s’agit ni plus ni moins d’une « opération de police » dans un pays sous son
influence. La révolution socialiste, en Afghanistan, dérape, après une réforme agraire mal
comprise et appliquée au forceps. La guerre en Afghanistan a ses causes propres : les guerres
intestines commencent avant l’intervention soviétique et le conflit perdure après son retrait,
en 198828. Le régime communiste du Dr Najibullah survit trois ans au départ de l’armée
25 Idem, p. 24. 26 Voir Annexes, Carte de l’Afghanistan. 27 La violence des opérations soviétiques est discutée. Lire à ce sujet RAFFNAY, Meriadec, Afghanistan, les
victoires oubliées de l’armée rouge, Paris : Economica, 2010 ; et Tactiques de l’armée rouge en Afghanistan,
traduit par le colonel PHILIPPE, François, Economica, 2010. 28 Pour une compréhension adéquate du contexte afghan avant et pendant l’intervention soviétique : BARRY,
Michael, Le Royaume de l'insolence. L'Afghanistan, 1504-2001, Paris : Flammarion, 2002 ; DORRONSORO,
Gilles, La révolution afghane : des communistes aux tâlebân, Paris : Éd. Karthala, 2000 ; DUPAIGNE, Bernard,
ROSSIGNOL, Gilles, Le carrefour afghan, Paris : Gallimard, 2002.
12
rouge, puis s’efface devant la coalition des « Seigneurs de la guerre », parmi lesquels Ahmed
Chah Massoud, Hekmatyar, Dostom ou Rabbâni. Mais ceux-ci, incapables de s’accorder sur
l’avenir politique du pays, se déchirent. La guerre civile s’installe. Les talibans, « étudiants en
religion », formés au Pakistan, entrent en scène en 1994 par la prise de plusieurs villes.
Lorsque leur supériorité devient évidente, Massoud, Dostom et d’autres chefs du nord
s’unissent au sein de l’Alliance du Nord.
Les talibans imposent au pays une loi rigoriste, anachronique et criminelle. Ils
dynamitent les séculaires statues de Bamiyan en 2000 et imposent aux bouddhistes de porter
un insigne jaune. Pour Ahmed Rachid, journaliste pakistanais qui a passé près de trente ans à
couvrir l’Afghanistan, une des raisons de leur succès s’explique aussi par l’inattention des
pays occidentaux, détournés de l’Afghanistan dont ils ne considèrent pas la désintégration
après 1992, se satisfaisant juste d’y avoir enterré l’Union soviétique29. Lorsque les Américains
décident finalement de chasser les talibans parce qu’ils refusent de livrer Ben Laden,
l’Afghanistan devient un théâtre majeur de la « guerre contre le terrorisme » à laquelle vont
participer les Français. Orian Barat-Ginies dans son ouvrage L’engagement militaire français
en Afghanistan 2001-201130 analyse trois phases : une première, en 2001, où la France n’a pas
de projet politique clair concernant son engagement ; une seconde, de 2004 à 2007, où « les
forces connaissent mieux le théâtre », elles sont plus déterminées et agissent dans des
missions mieux définies ; et enfin une troisième, après 2008, qui représente un tournant pour
toute la coalition, une phase de bilan et de réorientation.
L’engagement français se réaffirme surtout à partir de 2006 et 2007, lorsque
apparaissent les premières OMLT, les Operationnal Mentoring Liaison Team, des équipes de
soldats encadrant les troupes de l’armée afghane directement sur le terrain. Ce dispositif
modifie l’empreinte française sur le terrain, en les amenant directement au contact. Les
Français reçoivent également la responsabilité de la région de Kapisa, alors qu’ils étaient
limités à Kaboul31. De fait, les accrochages se multiplient : les Français sont amenés à se
battre. Au même moment, de manière diffuse et progressive, le contexte sécuritaire en
29 RASHID, Ahmed, L’ombre des taliban, Paris, Editions Autrement, 2001. Traduit de l’anglais par Geneviève
Brzutowski et Laurent Bury. 30 BARAT-GINIES, Oriane, L’engagement militaire français en Afghanistan 2001-2011, Paris : L’Harmattan,
2011. P 20-21. Orian Barat-Ginies est conseillère juridique au centre interarmées de concepts, de doctrines et
d’expérimentations (CICDE), jeune chercheuse rattachée à l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire
(IRSEM), officier de réserve de la Marine nationale. 31 Voir carte du déploiement des unités terrestres (en 2009), Annexes, 4, p. 144.
13
Afghanistan se dégrade. Les groupes d’insurgés reprennent l’initiative et modifient leurs
stratégies. Apparaissent les premiers suicide-bombers, les terribles IED32, et des attaques
coordonnées et harcelantes des unités de l’ISAF33.
Alors qu’elles étaient plus timides auparavant, les publications sur l’Afghanistan se
multiplient après 2008. Notons le livre de Jean-Dominique Merchet 34 , Mourir pour
l’Afghanistan, pourquoi nos soldats tombent-ils là bas ?, édité pour la première fois en 2008.
La revue Manière de Voir, dirigée par Le Monde Diplomatique, consacre un numéro spécial à
l’Afghanistan en 2010. Les publications militaires aussi : la revue Doctrine sort un numéro
spécial « L’emploi des forces terrestres en Afghanistan » en 2009 ; le général Vincent
Desportes parle des « difficultés » des Français en Afghanistan dans La guerre probable :
penser autrement35 en 2007, sans oublier le très important colloque de l’Ecole militaire, Les
crises en Afghanistan depuis le XIXe siècle, tenu en 200936. A l’inverse des publications parues
au début de la période, celles-ci n’estiment pas qu’une victoire militaire est possible sans un
réel investissement politique. Le milieu universitaire est, au mieux, resté prudent sur le sujet.
Il y a bien un mémoire de Guillaume Gautier en 200837, soutenu à l’Institut d’Etudes Politique
de Rennes, mais son directeur, Gilles Richard est un historien spécialiste d’histoire politique,
assez peu connu pour des travaux en relations internationales… Seule une thèse sous la
direction de Bertrand Badie s’inscrit davantage dans notre champ d’étude, écrite par Yama
32 Improvised Explosive Devices, ou Engin Explosif Improvisé (EEI), traduction française moins utilisée. Les
IED sont des bombes artisanales placées sur les routes visant à harceler les convois militaires. L’effet physique
recherché est moindre que l’effet psychologique. 33 International Security Assistance Force, ou Force International d’Assistance et de Sécurité (FIAS). C’est la
force multinationale déployée par l’OTAN en Afghanistan. L’ISAF est partagée en plusieurs Regional
Command. Les Français dépendent de la RC-Capital, Kaboul, et effectuent aussi leurs missions dans la province
de Kapisa, à l’est de la capitale. Stratégique, la province est le verrou de Kaboul tout en étant connectée aux flux
provenant de la frontière pakistanaise, enjeu stratégique majeur. 34 Jean-Dominique Merchet est journaliste à l’hebdomadaire Marianne, après avoir été journaliste à Libération.
Il est connu pour être un specialiste des questions de défense. 35 DESPORTES, Vincent (Gal.), La guerre probable : penser autrement, Paris : Economica, 2007. 202p. 36 CENTRE D’ETUDES D’HISTOIRE DE LA DEFENSE (PARIS). Les crises en Afghanistan depuis le XIXe
siècle. Paris : IRSEM, Institut de recherche stratégique de l’École militaire, 2010. Études de l’IRSEM. Issu d'une
journée d'études organisée le 29 avril 2009 par le Centre d'études d'histoire de la défense. - Contient une
contribution en anglais. - En appendice, une chronologie 37 GAUTIER, Guillaume, Du 11 septembre 2001 à l’accord de Bonn : les cent jours de la campagne
d’Afghanistan, Institut d’études politiques de Rennes, 2008. Mémoire sous la direction de Gilles Richard.
14
Torabi en 200938, mais c’est une thèse de sciences politiques. Une thèse d’histoire est bien
répertoriée en préparation, sous la direction de Daniel Lefeuvre (Université Paris 8), sur Les
relations éducatives, culturelles et scientifiques entre la France et l'Afghanistan au XXe siècle
(1921-1979).
L’historiographie sur la seconde guerre d’Afghanistan est donc encore assez pauvre.
Ce n’est pas le cas de l’historiographie sur l’audiovisuel. Nous gardons par exemple en tête
ces quelques mots de Marc Ferro, historien spécialisé dans l’utilisation des images comme des
archives à part entière : « « Lorsque fut avancée, à l’aube des années dix-neuf cent soixante,
l’idée d’étudier les films comme des documents et de procéder ainsi à une contre-analyse de
la société, l’ordre universitaire s’émut. Il n’était alors d’histoire notamment que quantitative :
« Fais-le, mais n’en parle pas », me conseillait Fernand Braudel ; « Passez d’abord votre thèse
», croyait bon d’ajouter Pierre Renouvin. Aujourd’hui, le film a droit de cité dans les archives
comme dans les recherches »39. Le débat entre historiens sur l’utilisation de ces sources s’est
un peu apaisé au début des années 2010, mais, dans les années 1970 et 1980 notamment, il
s’est précisément tendu sur la méthode. C’est pourquoi nous croyons bon d’y revenir afin de
renforcer la légitimité de notre exposé.
L’Afghanistan est un théâtre complexe, l’image une archive qui ne se manipule pas
sans méthode. Un biais de la recherche serait de considérer le foisonnement de ces sources si
important qu’elles pourraient se suffire à elles-mêmes. Nous pensons l’inverse : mieux vaut
les encadrer, les « tenir », par d’autres sources complémentaires, démarche indispensable,
évidente. Ainsi, une très grande banque d’images sur le sujet est également conservée à
l’Institut National de l’Audiovisuel (INA)40. Rien que pour l’année 2002, nous avons retrouvé
une cinquantaine de notices. Nous avons surtout enrichi le visionnage des films faits par
l’ECPAD par un visionnage de journaux télévisés susceptibles d’utiliser les images de
l’armée. Ce fut particulièrement le cas pour Uzbeen. Malheureusement, nous n’avons pas
accédé aux rushes des journalistes civils, qui se seraient rendus en Afghanistan. Nous n’avons
pas non plus rencontré de journalistes partis en Afghanistan. Peut-être aurions-nous pu
comparer alors le travail de journalistes militaires avec celui de leurs confrères des chaînes de
télévision ou de l’Agence France-Presse. Mais à mieux y réfléchir, ce n’est pas le même sujet. 38 TORABI, Yama, State-, nation- et peace-building comme processus de transactions : l’interaction des
intervenants et des acteurs locaux sur le théâtre de l’intervention en Afghanistan, 2001-08. Thèse de doctorat
sous la direction de Betrand Badie, 2009. 39 FERRO, Marc, Cinéma et Histoire, Paris, Gallimard, 1993 (1ère édition : 1977), p. 11. 40 Le centre de consultation se trouve à la BNF, site François Mitterrand, dans le XIIIe arrondissement de Paris.
15
L’ECPAD peut certes envoyer aux médias, s’ils sont en besoin d’images, des bandes
éléments, c’est-à-dire des images non montées et sans commentaires, mises à disposition
pendant un mois. Ce qui leur fournit déjà un support pour travailler, et ce non négligeable.
Mais les journalistes n’utilisent pas de la même manière des images d’archive d’une part et
leurs propres images d’autre part. Dans un cas, ils vont prendre ces images pour enrichir leur
sujet et apporter aux images les commentaires de leur choix. C’est une forme d’illustration.
Dans l’autre cas, ils tournent leurs propres images, correspondant à l’angle qu’ils ont choisi.
Ils n’évoluent alors pas dans les mêmes logiques de communication ou de mémoire
auxquelles répondent les reporters de l’ECPAD.
Le travail des journalistes ou celui des opérateurs militaires pourraient répondre
différemment à la question de l’évolution de l’image de guerre. Seulement, les journalistes
civils ne se présentent en Afghanistan que de manière épisodique, à condition qu’existe un
sujet. Ils ne sont pas là pour couvrir le quotidien. Ensuite, l’ECPAD construit des archives de
manière réfléchie quand les médias accumulent de l’information audiovisuelle. C’est aussi
cette construction d’archives qu’il était intéressant d’interroger. Pour comprendre ces images,
nous nous sommes enrichis d’une lecture de sources publiées, du ministère de la défense et de
l’IRSEM en particulier, concernant notre sujet, mais aussi et surtout d’entretiens avec les
principaux acteurs concernés, les opérateurs de l’ECPAD. Sans eux, il est clair que bien des
clefs de compréhension nous auraient échappé à la lecture des archives. Leurs récits ajoutent
ce qui est essentiel derrière ces archives : la dimension humaine. Enfin, 2001 et 2008 sont des
bornes chronologiques qui font sens puisqu’elles correspondent à la maturation de la présence
française, et permettent de montrer toute la complexité de leur engagement. Dynamique,
celui-ci s’adapte à l’évolution sur le terrain, et fait apparaître, successivement, plusieurs
degrés d’intensité, qui sont autant d’images différentes.
Comment les images peuvent-elles faire source pour l’histoire ? Comment sont
produites et utilisées les images de l’Afghanistan de l’ECPAD ? Comment, au fil d’une
évolution chronologique, les images aident-elles à mieux définir la représentation
audiovisuelle de la guerre ? Telles sont les questions qui guident notre réflexion. L’objectif
principal de cet exposé est de proposer une histoire contemporaine avec des sources
originales. Les images dominent les récits à propos de la seconde guerre d’Afghanistan. Il
s’agit d’une opération de longue durée de l’armée française, non sans répercussions sur son
environnement mental. Les Français ont réalisé avec la première guerre du Golfe en 1991 que
le champ d’intervention principal se situerait loin en dehors des frontières nationales. Jusque
16
là, la crainte principale reposait toujours sur un conflit à nos portes, du fait de la guerre froide.
L’opération extérieure est devenue non plus la marge de la pensée stratégique, mais son cœur,
ce qui est absolument réactivé par la perspective d’une « guerre contre le terrorisme »,
globalisée et internationale. L’Afghanistan représente pour nous la pierre angulaire de cette
nouvelle donne. Parce que c’est en ce pays qu’est menée la première guerre contre le
« terrorisme », en 2001, et qu’il est considéré comme son sanctuaire par les responsables
politiques. « Ici se joue une part de la liberté du monde » affirmait Nicolas Sarkozy le 20 août
2008 à Kaboul, devant les soldats français. Ces éléments posent une nouvelle réalité : les
grandes puissances n’envisagent plus de conflits ouverts entre elles, mais des opérations
contre des groupes politiques transnationaux. Il y a eu un renversement dans l’horizon mental
des militaires et l’Afghanistan l’a considérablement affirmé. Sur le terrain, ce renversement se
traduit aussi par une modification des pratiques : la lutte contre les groupes insurgés passe par
une meilleure compréhension du milieu, des actions positives menées en direction de la
population, une intégration des problématiques de communication par le commandement. La
guerre se pense différement ; se montre-t-elle différemment ?
Nous choisissons de placer les images au cœur de notre réflexion, et non pas de les
regarder comme des substituts à des archives plus classiques. Nous ne faisons en effet pas
l’histoire de la guerre, mais l’histoire des images de cette guerre. C’està-à-dire que notre
analyse porte sur le champ des représentations bien plus que sur les évènements. De plus, il ne
s’agit pas de réfléchir uniquement aux images, mais à tout leur circuit de conception. Il ne
s’agit pas d’avoir une approche sémiologique, qui consisterait par une analyse systématique à
en proposer des interprétations. Les historiens doivent croiser les sources. C’est la
combinaison de ces sources qui permet de comprendre les images dans leur globalité. Elles
impliquent des acteurs pour les produire. Elles imposent aussi de réfléchir à leur utilisation,
présente ou à venir.
Pour y répondre, notre exposé s’articule en deux moments. D’abord, il convient de
comprendre le fonctionnement de l’ECPAD et le but recherché dans la production de ces
images. Il faut donc rechercher dans l’histoire de l’ECPAD, ses statuts, son organisation et le
rôle qui lui est attribué la manière dont elle définit sa mission. L’établissement du Fort d’Ivry
se donne une mission de conservation aussi qui fait passer ces images dans le champ
mémoriel. De plus, les reporters sont les premiers acteurs de la réalisation des images. Il s’agit
de les connaître, de comprendre la particularité d’un engagement en Afghanistan, qui
implique des conditions difficiles de travail ou de se faire accepter par les personnels
militaires. Il est aussi question de la manière dont ils pensent leur métier, qui a une certaine
17
incidence sur leur angle de prise de vue. Intervient alors la question de ce que l’historien peut
faire de ces images. Ces archives peuvent faire sens, mais la question centrale est celle de la
méthode. Une fois les sources bien identifiées dans leur nature, il convient d’identifier les
enseignements qu’elles peuvent livrer. Ceux-ci tiennent en deux points : des informations
historiques, contenues dans la source, et la représentation du monde que propose l’image.
Ensuite, une fois ces bases posées, reste à inclure dans la démonstration une réflexion sur les
images elles-mêmes, selon le déroulé de la période. Il y a deux phases, comme deux images
qui s’opposent. Premièrement une image de paix, qui montre des Français bien accueillis, un
contexte plutôt calme, des soldats au milieu des populations civiles comme s’ils n’étaient pas
des combattants. Les images montrent un déplacement des combats sur d’autres terrains, à la
croisée des chemins du militaire, du politique et de l’humanitaire. Secondement, on voit un
retour de la guerre, à partir de 2006. L’image, progressivement, démontre que la situation se
tend pour les Français, dans un contexte de moins en moins favorable, jusqu’au moment
d’Uzbeen. Celui-ci articule les interrogations sur le sens des images. On attend à ce moment
que la communication agisse, et on se demande quelle image peut venir définir le drame.
18
Première partie : L’histoire par l’image
Le rôle institutionnel de l’ECPAD dans la production d’images sur un théâtre d’opération
extérieure
Les archives que nous utilisons vont déterminer l’histoire que nous allons chercher à
reconstituer. Comment faire l’histoire à partir d’images fixes et mobiles ? Comment
comprendre, à la fois le récit, la subjectivité des images, et le rôle qu’elles tiennent, pour ceux
qui les produisent ? Et qui sont ceux qui les produisent ? Les photographies et les films sont
une vision choisie qui construit une réalité. Il existerait d’autres témoignages. Ces questions
sont donc essentielles, et ce qui y répond est hors-champ. L’administration, la structure, c’est-
à-dire l’ECPAD, l’opérateur, le premier, ne sont pas dans l’image. Ils n’en ont pas moins une
influence décisive sur les images qu’ils réalisent. Celui qui tient la caméra ou l’appareil photo,
c’est un acteur essentiel du processus de production des images. Pendant la guerre
d’Indochine, ses grands noms ont reçu le surnom honorable de « soldats de l’image ». Une
tournure qui est chargée de sens. Soldats, parce qu’ils sont avant tout des militaires. Ils
obéissent à un engagement. Ils appartiennent à une structure, une hiérarchie. Ils portent une
arme, quand ils sont sur le terrain. Ils peuvent s’en servir, si le besoin s’en fait sentir. Toutes
ces caractéristiques les différencient éminemment des reporters journalistes civils, qui n’ont
pas d’arme ni leur esprit de corps. Mais ils partagent un métier, avec ses pratiques, ses
techniques, sa passion aussi. L’image, pour beaucoup d’entre eux, c’est une passion. Marier
soldat et image, c’est aussi envisager l’intérêt de l’image pour la défense : Une arme ? Un
témoignage ? Un devoir ? L’image a un sens pour les armées. Le décortiquer est
indispensable.
L’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense est une
structure jeune, s’il en est, puisqu’il n’adopte cette forme et cet acronyme qu’en 2001. Mais il
est l’héritier des Sections Ciné et Photo qui se sont succédées, depuis la première Guerre
mondiale, bâtissant un savoir-faire et transportant surtout, de générations en générations,
d’importantes archives. Il s’agit d’un long travail que de produire de l’archive, et si nous
pouvons aujourd’hui confortablement les consulter au Fort d’Ivry, il n’est pas inutile de
connaître les circonstances dans lesquelles elles ont été produites. Nous présenterons donc
plusieurs points. Tout d’abord, l’histoire même du cinéma des armées, né dans la première
19
guerre mondiale, est une longue progression qui traverse tout le XXe siècle. Les équipes
accompagnent la troupe, toujours, sur le terrain. Nous les retrouvons en Indochine et en
Algérie. Ils suivent l’histoire de l’armée française et, dans les années 1990, épouse la
modernisation de la Défense, jusqu’à ce que la fin du service national impose de nouvelles
transformations. L’Etablissement devient alors autonome et est doté d’une nouvelle structure,
reconnu comme un acteur clef de la communication de défense. Ensuite, il convient de
s’intéresser aux hommes eux même. Qui sont-ils, ces « soldats de l’image » ? Nous verrons
qu’ils répondent à une organisation bien particulière, qu’ils ont choisi des pratiques
spécifiques. Ils s’adaptent, aussi et surtout, à un contexte de travail particulier : un mandat en
Afghanistan. Des mandats qui, de leur propre avis, les ont bousculé et marqué profondément.
Pour eux, l’image est une mission à plusieurs volets. Cela répond à un besoin de
communication, de la part de la Défense, et à une « mission du devoir de mémoire ». Ceux
qui ont tourné des images pendant la première guerre mondiale ne pensaient pas qu’elles
survivraient un siècle. Ceux qui tournent en Afghanistan le savent ; ils pensent leur métier
différemment. Enfin, nous abordons l’analyse de nos sources et la méthodologie particulière
que nous avons retenu pour les analyser. Plusieurs milliers de photographies et des dizaines
de films forment un corpus très important qu’il faut maîtriser. Une fois ces clefs de
compréhensions livrées, l’image de l’armée française en Afghanistan devient, à part entière,
une source pour l’histoire.
20
Chapitre 1. L’Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense, des origines à nos jours
L’ECPAD aura bientôt un siècle. Certes, la technique audiovisuelle ne prend son essor
véritable qu’au XXe siècle, et n’est franchement considérée dans l’environnement de la
Défense comme un acteur essentiel qu’après la seconde guerre mondiale. Toutes les images
que nous étudions proviennent de l’établissement. Pourtant, il est parfois méconnu, y compris
chez les historiens. Rappeler son histoire, son statut et les missions que lui confie le ministère
de la Défense est donc essentiel. Comprendre le rôle que peut jouer l’ECPAD dans une
logique globale de communication audiovisuelle est l’objectif de ce premier chapitre.
Ce développement se construit essentiellement à partir de la bibliographie, à laquelle
s’ajoutent de la documentation officielle et des entretiens. La bibliographie ne contient
toutefois pas d’ouvrage d’historien qui soit suffisamment détaillé pour proposer une histoire
de l’ECPAD depuis ses origines.
1.1. DU SCPA à l’ECPAD : histoire de l’établissement audiovisuel de la Défense
1.1.1. Genèse des services cinématographique et photographique des armées
Aux origines, il existe dès le XIXe siècle des images de la guerre sans qu’il s’agisse
d’images militaires, c’est-à-dire que des prises de vue photographiques sont réalisées sans que
l’armée ne s’intéresse encore à l’image. Ce fut le cas lors de la guerre de Crimée, où la
photographie fait ses premières armes, pour ainsi dire, et avec laquelle naît, selon la légende,
l’image de guerre. Le Service cinématographique des armées (SCA), d’une part, et le Service
photographique des armées (SPA), d’autre part, naissent de et avec la première guerre
mondiale. Créés en 1915, ils sont placés sous l’autorité conjointe des ministères de la Guerre,
des Affaires étrangères, de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.41 En ce qui concerne le
film, la création est motivée par la double influence de l’industrie du cinéma et l’avance dans
ce domaine qu’ont pris les Allemands42. Ainsi, d’abord, les sociétés Eclair, Pathé, Gaumont et
41 BOROT, François, L’Armée et son cinéma, 1915-1940. Thèse, université de Nanterre, 1986. 42 CHALLÉAT, Violaine, « Le cinéma au service de la défense, 1915-2008 », In : Revue historique des armées,
15 septembre 2008, n° 252, pp. 3–15.
21
Eclipse veulent pouvoir disposer de films sur les combats, d’autant plus que la guerre entraîne
pour le secteur des conséquences douloureuses, en recettes comme en moyens. Ensuite, les
Allemands se sont organisés dès septembre 191443. Ils ont donc dix mois d’avance, et dans le
domaine photographique particulièrement, inondent les pays neutres de leur propagande.
« Dès 1914, l’Allemagne semble maîtriser, sans commune mesure, les possibilités données
par la photographie et elle en fait un outil de propagande internationale », écrit Hélène Guillot
dans son article « La section photographique de l’armée et la Grande Guerre »44. Mais, là
encore, ce n’est pas directement l’armée qui est intéressée par l’idée. C’est le ministère des
Affaires étrangères qui est à la manœuvre. Le ministre Delcassé explique ainsi :
« Les services de propagande de mon Ministère sont constamment sollicités par nos agents et amis à l’étranger qui demandent que nous leur fournissions des documents photographiques sur la guerre et notamment sur les dévastations artistiques. La publication ou l’exposition de tels documents est jugée désirable pour agir sur l’opinion de neutres. […] J’ai été amené à me demander s’il n’y aurait pas intérêt à étendre cette enquête photographique dans la mesure où le Ministère de la Guerre pourrait l’autoriser, et si votre administration, qui est parfaitement outillée à cet effet, ne pourrait pas faire recueillir des scènes de dévastation de guerre. Sans parler de l’intérêt documentaire et peut-être scolaire que pourrait avoir une telle collection, elle serait très utile pour la diffusion à l’étranger des preuves les plus intéressantes ou les plus saisissantes et je serais disposé à en faciliter la reproduction dans les journaux, revues, cartes postales, etc. et les expositions dans les librairies à l’étranger (…) »45
Les buts des deux sections, cinéma et photographie, sont alors similaires et
logiquement réunies en 1917 par Lyautey, pour « permettre la réunion d’archives aussi
complètes que possible concernant toutes les opérations militaires » et « rassembler, pour la
propagande française à l’étranger, des clichés et des films susceptibles de montrer la bonne
tenue des troupes, leur entrain et les actions héroïques qu’elles accomplissent »46. Mission
triple, donc, car les films servent aussi au divertissement de l’arrière. « Au cours du conflit,
ses images servent à contrer la propagande ennemie, à préparer les reconstructions d’après-
guerre et à enrichir les renseignements de l’Etat-major, pour finalement être archivées. […]
43 Les photographies allemandes proviennent du Verkehrsbureau de Leipzig, l’homologue de la Section
Photographique des Armées est le Militärische Film und Photostelle. 44 GUILLOT, Hélène, « La section photographique de l’armée et la Grande Guerre », In : Revue historique des
armées, 15 mars 2010, n° 258, pp. 110–117. 45 « Rapport sur la création, le fonctionnement, et les résultats de la section photographique de l’armée »,
10 octobre 1917, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, ministère de la Culture, p. 21 ; cité par
GUILLOT, Hélène, Ibid. 46 Cité par CHALLÉAT, Violaine, Ibid.
22
Elles servent aussi à informer, relayées par les diffuseurs (Eclair, Pathé, Eclipse et Gaumont)
et le service projette à l’arrière du front des films muets pour distraire les troupes »47 L’armée
qui se filme et se photographie comprend l’intérêt stratégique mais aussi l’intérêt culturel et
pédagogique. Ce qui, plus tard, peut devenir mémoriel. Des hommes pensent très vite que ces
images fournissent des archives intéressantes, qu’elles doivent être conservées et
sauvegardées du temps, au profit des générations futures, contribuant à édifier une mémoire
de la guerre. Au départ, la présence de ces équipes, qui répondent aux ordres de l’Etat-major
mais sont équipés par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, laisse les
grands stratèges circonspects. Le fondateur du Cinéma des Armées, le lieutenant Croze, serait
reçu en ces termes par le maréchal Pétain : « Monsieur, nous sommes là pour faire la guerre,
pas pour nous amuser »48. Ce qui témoigne, pour le moins, d’un relatif mépris des plus hautes
autorités. Bien que le Service Cinématographique et Photographique des Armées (SCPA),
unifié en 1917, nous aient laissé cent-mille clichés et deux-mille films environ de la Grande
guerre, les débuts sont encore hésitants. À cela s’ajoutent les conditions techniques dans
lesquelles exercent les opérateurs :
« Avec la contrainte d’un matériel encombrant et lourd – l’opérateur transporte caméra, trépied et bobines en nitrate de cellulose [ce qui] expliqu[e] que la section filme surtout les à-côtés de la bataille : les transports de troupes ou d’artillerie, les blessés, les prisonniers, les cantonnements... Pour compléter ces images, on réalise des mises en scènes. […] À partir de 1917, le savoir-faire des opérateurs de la section et les exigences du public contribuent à l’évolution de la production vers un réalisme accru. Les cadavres apparaissent à l’écran, les premiers assauts sont filmés en juillet 1916 dans la Somme et sur la cote 304 à Verdun en juillet 1917»49.
Même si les films et les photos des opérateurs sont envoyés dans leurs propres
maisons de production – car, ces hommes, initialement, exerçaient dans le civil – il n’en
demeure pas moins que ces images sont soumises à censure. Est donc écarté tout ce qui
pourrait nuire au moral ou révéler le secret des opérations. Les premières sections évoluent
donc dans un cadre strict, obéissant aux contingences de la commission de censure militaire
d’une part, et des limites imposées par la technique d’autre part. La production d’image
47 « ECPAD : un outil unique », Images Défense, n°1, Premier trimestre 2003. pp. 2-3. 48 Images Défense, N°2, Juin 2003. P. 1. 49 CHALLÉAT, Violaine, Ibid. Voir également à ce sujet, pour voir directement les sources photographiques de
Verdun : CHALLÉAT, Violaine, GUILLOT, Hélène, BEUVIER, Miguel et ETABLISSEMENT DE
COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE DE LA DÉFENSE (FRANCE). Images de
Verdun : 1916-1919 : les archives de la Section photographique de l’armée, Ivry-sur-Seine : ECPAD, 2006.
23
s’arrête en 1919, les sections sont démobilisées après l’armistice. L’archivage est confié au
ministère de l’Instruction publique.
1.1.2. La longue mise en place d’un établissement unifié
La photographie et le film n’ont opéré leur unification qu’en 1917. Dissoutes après la
guerre, les sections sont recréées pour la première fois en 1921. Pendant l’entre-deux-guerres,
une section existe bel et bien, rattachée semble-t-il au service géographique de l’armée50. Naît
le Journal de Guerre, film d’actualité d’édition hebdomadaire51. La seconde guerre mondiale
ouvre véritablement la voie à l’organisation et à l’unification d’un service photographique et
cinématographique, bien que les activités de la section s’arrêtent brutalement en 1940 avec la
signature de l’armistice franco-allemand. Mais elle va connaître des rebondissements et de
multiples déboires, pendant toute la période de la guerre. Rattachée au bureau de la
propagande du ministère, la section est éclatée, déménage, de Paris à Marseille, de Marseille à
La Bourboule (Puy-de-Dôme) en 1940. Elle est également implantée à Alger : c’est de là
qu’une partie de ses hommes rejoint les Alliés en 1944, couvre le débarquement en Provence
et regagne Paris le 1er septembre 52 . Enfin, en 1946, c’est l’unification. « Le service
cinématographique des armées, organisme unique pour les trois armées, est enfin créé par
décret du 26 juillet 1946 ; il quitte en septembre 1947 ses locaux dispersés dans la capitale
pour s’installer au Fort d’Ivry. »53 Les films et les photographies françaises de la seconde
guerre mondiale obéissent à l’appareil de l’Etat français, et même s’ils semblent jouir d’une
certaine liberté dans les faits, doivent concourir en principe à relayer le message de Vichy. Il
s’agit de participer au bon moral des troupes, à l’instruction et à la défense des intérêts
français, notamment concernant l’Empire. Il faut attendre l’Indochine et le général de Lattre,
en 1951, pour une véritable révolution, à la fois organisationnel et conceptuelle.
50 CHALLÉAT, Violaine, Ibid 51 LE SEIGNEUR, Jacques et MOUNIER, Claude, L’image au service de l’histoire ; histoire du cinéma aux
armées, ECPA, 1975. 52 Pour une meilleure compréhension du SCA pendant la deuxième guerre mondiale, se reporter à BOROT,
François, « L’armée française et son cinéma durant l’entre-deux guerres, 1918-1940 », In : L’image de guerre et
son utilisation: séminaire, École militaire, Paris, 20 janvier 1996. Paris : Centre d’études d’histoire de la
défense, 1996 ; ou LAUNEY, Stéphane. Le service cinématographique de l’armée de Vichy, 1940-1944,
Maîtrise, Paris : université Paris IV, 2005. 53 CHALLÉAT, Violaine, Ibid.
24
« Bien que la section Indochine du SCA fonctionne depuis 1946, le cinéma, jusqu’en 1951, demeure avant tout un outil mis au service de la propagande à mener auprès des troupes et de la population. Il n’existe donc pas pour cette période de directives précises sur la prise d’images cinématographiques. […] De fait, les quelques évènements immortalisés par la caméra sont les arrivées et les départs des troupes, les commémorations et les remises de médaille. »54 Pendant les cinq premières années du conflit, pas ou peu d’images de guerre, donc, se conformant à la maxime émise trente-cinq ans plus tôt par le lieutenant-colonel Dupuis à la section, les images devant montrer « une impression forte de puissance matérielle et morale de l’armée française et de sa discipline [qui] est essentiellement utile à la propagande ».55
Les choses changent ensuite, « pendant et après l’année de Lattre, le cinéma est enfin
considéré comme un moyen puissant d’information de l’opinion publique française et
étrangère »56. Les cinéastes ont accès aux zones de combat, et même si leurs images sont
encore sujettes à censure, ils purent tourner, grâce à un matériel nouveau et plus performant,
au cœur même de ce que vécurent leurs camarades. Ils deviennent les premiers reporters de
guerre, Schoendoerffer, Camus, Péraud ou Kowal deviennent aux yeux de leurs camarades de
véritables « soldats de l'image »57, surnom attribué depuis aux équipes qui leur ont succédé.
De Lattre était convaincu de l’importance stratégique de l’image et a donné toute sa
dimension médiatique au conflit en Indochine. Par ses convictions, il a laissé une trace
durable au SCA. En novembre 1952 naît le Service d’action psychologique, d’information et
cinématographique des armées (SAPICA), auquel sont rattachés les sections cinéma. L’image
est pensée comme une arme, pour convaincre l’opinion, bien sûr, mais surtout les appelés et
les locaux, des actions de l’armée française, notamment dans le nouveau conflit qui s’ouvre
en Algérie. En 1961, le SCA devient ECA, Etablissement cinématographique des armées, puis
ECPA, Établissement cinématographique et photographique des armées, en 1969. Il est
rattaché au SIRPA, Service d’information et de relations publiques des armées. L’ossature
telle que nous la connaissons aujourd’hui se met peu à peu en place. « Une instruction
ministérielle en date du 13 août 1971 fixe les missions de l’ECPA : production de tous les
films pour les armées, réalisation des reportages intéressant le ministère, reproduction,
diffusion et enfin conservation des films et des photographies. »58 Dans la seconde moitié du 54 RODIER-CORMIER, Béatrice, Aux origines de la communication de défense ?: Indochine 1945-1954,
Châteauneuf-Val-de-Bargis : les Éd. des Riaux, 2002. Perspectives. P. 93 55 Ibid, p. 92. 56 Ibid, p. 93. 57 CHALLÉAT, Violaine, Ibid. 58 Ibid.
25
vingtième siècle et une fois les chapitres Indochine et Algérie refermés, l’ECPA a atteint une
forme de maturité. Le service national l’enrichit de talents prometteurs, « Costa Gavras,
Philippe de Broca, Robert Enrico, Georges Lautner, Claude Lelouch… ont fait leurs
premières armes au Fort d’Ivry. »59 Puis, il suit l’armée française dans la plupart de ses
interventions : Kolwezi, Liban, Tchad, opérations sous mandat de l’ONU, avec l’OTAN…
Innovant, aussi, dans la technique, là où deux de ses techniciens, Jean-Marie Lavalou et Alain
Masseron, inventent la « Louma », long bras articulé portant une caméra, « pour filmer dans
le cadre confiné et exigu d’un sous-marin »60. Depuis, la Louma a été utilisée sur les plateaux
de télévision, pour couvrir les matchs de football, et fut popularisée par des réalisateurs
comme Steven Spielberg.
1.1.3. De propagande à communication
Il est fructueux de lire dans l’histoire du SCA une évolution progressive de la
propagande à la communication61, d’une section soumise d’abord aux ordres précis et au cadre
strict voulu par les États-majors à un établissement soucieux de l’image de la Défense, de
manière plus autonome et plus moderne. L’Indochine montre qu’un basculement dans
l’opinion accompagné de changements au niveau stratégique peut avoir des conséquences sur
les tournages, donc les images qui sont produites. Uzbeen, en 2008, pourrait-il être le 1951 de
l’Indochine ? Le contexte est radicalement différent. Surtout, l’ECPAD aujourd’hui est nourri
des expériences de son passé. Comment estimer toutefois la communication opérationnelle ?
On définit le conflit en Afghanistan comme un conflit « des cœurs et des esprits », qui se joue
sur les sentiments de la population comme l’adhésion des opinions publiques. Le Général
Jean-Louis Georgelin, Chef d’Etat-major des Armées en 2008, estimait le 24 août sur France
Inter que « le soutien des opinions publiques occidentales est vraiment déterminant ».
« Dans ce genre de conflit, de type contre-insurrectionnel, le soutien de l’opinion publique est déterminant. Si les opinions publiques dans nos pays occidentaux flanchent, si elle baisse les bras devant les premières difficultés, si elle ne comprend pas la nécessité
59 Voir Images Défense, n°1 déjà cité. 60 Ibid. 61 Nous renvoyons sur ce point notre lecteur au développement que nous consacrons au sujet de la propagande
dans notre mémoire de Master 1, « Chapitre 1 : Histoire de la communication des armées », La communication
de l’armée française en Afghanistan durant l’opération Héraklès Décembre 2001 - Janvier 2002.
26
de défendre la liberté, la sécurité de nos pays dans ces territoires là, alors notre adversaire marque un point supplémentaire. »62
Pourtant, nous savons que l’axe principal de la communication de Défense n’est pas la
communication opérationnelle, mais un champ plus global, dans lequel elle s’arrête moins sur
des opérations précises, dussent-elles perdre le nom de guerres. En effet, il est rarement
question de faire abonder dans les médias des images de l’Afghanistan. Pas plus qu’on n’a vu
des images estampillées défense prendre toute la place dans les journaux. Une cohabitation de
bonne intelligence s’est même plutôt opérée avec les journalistes du civil. Le mot propagande
est aujourd’hui complètement abandonné. Il est même péjoratif. C’est la première guerre du
Golfe qui a fait ce retournement63. Les médias y ont perdu toute crédibilité en suivant, de trop
près, les opérations de la coalition. Ils ont même été suspectés de les soutenir largement.
Depuis, médias et armée ont établi le constat qu’ils n’avaient vraiment pas le même métier.
S’ils peuvent produire les uns et les autres des images, celles-ci n’ont pas le même rôle.
L’armée communique. Communiquer, c’est établir une relation, une forme de
correspondance, pas nécessairement chercher à convaincre. La communication, bien entendu,
est absolument subjective et recherche un intérêt. Le média, lui, informe. Dans ce mécanisme
de communication, l’ECPAD a une place décisive par sa fonction de production et de
conservation des images qui témoignent de l’activité des forces sur le terrain. La modernité du
début siècle, qui offre des moyens supplémentaires d’exploitation, permet par ailleurs de
répandre plus facilement ces images grâce à la multiplication des écrans.
1.2. L’ECPAD : une institution de la Défense
1.2.1. 2001 : Nouveau statut administratif et fin du service national
Après la fin du Service d’information et de relations publiques des Armées (SIRPA)
en 1998, devenu la Direction à l’Information et la Communication de la Défense (DICOD), le
tournant du siècle amorce une petite révolution de structure pour l’ECPA. Par décret du 21
avril 2001, l’ECPA devient Etablissement de communication et de production audiovisuelle
de la défense, ECPAD. Son donneur d’ordres reste l’Etat-major des armées, et il est sous
tutelle du ministère de la Défense. Jacques Taranger, alors conseiller pour l’organisation et 62 Entretien avec Jean-Louis Georgelin, France inter, le 24 août 2008. 63 Voir KELLNER, Douglas, The Persian Gulf TV War, Boulder, Co, Westview Press, 1992.
27
l’administration auprès du directeur de la DICOD64, explique à la revue Objectif Défense, en
avril 2001 précisément, les modalités de cette réforme :
« Le décret portant statut de l’établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) transforme lʼECPAD en Etablissement public administratif lui conférant de ce fait une autonomie financière et une personnalité juridique. Concrètement, cela signifie que c’est un organisme public qui a plus de liberté d’action et qui peut exercer une activité commerciale dans le cadre des missions qui lui sont dévolues (...). Pour l’accomplissement de toutes ses missions, y compris régaliennes, qui touchent directement la Défense, le directeur de lʼECPAD pourra passer directement tous les actes nécessaires, et se lier à des organismes qui peuvent être publics ou privés, français ou étrangers. (...) Le délégué à l’information et à la communication de la Défense ne sera plus le supérieur hiérarchique du directeur de lʼEtablissement. »65
Ce décret fait de l’ECPAD l’unique dépositaire des productions audiovisuelles du
ministère de la Défense et consacre son caractère de spécialiste de l’image. La marche
d’unification et de centralisation des services photographiques et cinématographiques des
armées est donc achevée. La structure est simplifiée. Son articulation avec le ministère de la
Défense, les armées et les autres ministères devient cohérente et rationnelle. Il demeure
toutefois des SIRPA d’Armée, organismes de communication et de réalisation audiovisuelle
propres à chaque armée, de Terre, de l’Air, et de la Marine Nationale. Les SIRPA ont des
missions différentes de l’ECPAD et surtout une implantation géographique et humaine plus
proches de leurs armées66. Mais leurs archives sont versées à l’ECPAD. Autre changement de
grande importance, l’ECPAD devient un acteur commercial. Il peut, de son propre chef,
assurer l’exploitation des films et des photographies archivées au Fort d’Ivry, comme celles,
plus contemporaines, réalisées immédiatement sur le terrain. Il peut percevoir de l’argent,
créer des filiales. Sans rentrer dans les détails techniques, un Etablissement public à caractère
administratif est un régime de droit public qui consacre l’autonomie administrative et
64 M. Jacques Taranger est devenu en 2009 expert de haut niveau (EHN-I) auprès du secrétaire général pour
l'administration du ministère de la Défense, chargé de l’accompagnement de la mise en œuvre des nouvelles
organisations administratives. 65 Interview de Monsieur Jacques Taranger...», Objectif Défense, N° 102, avril 2001, p. 5. 66 D’après le capitaine DANEY, Jean-Daniel, Les actualités d’aujourd’hui seront les archives de demain,
Diplôme de qualification militaire, décembre 2010, p. 14. Ce document est un document personnel que nous a
prêté gracieusement le capitaine pour enrichir notre travail ; il s’agit d’un mémoire interne à l’établissement. Le
capitaine Daney a été officier images en Afghanistan.
28
financière de cette personne morale. Ses différentes missions sont explicitées par l’article 2 du
décret du 18 avril67 :
« Art. 2. - Sous la tutelle du délégué à l'information et à la communication de la défense, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions : 1o De concevoir, de réaliser et d'assurer dans le domaine des techniques de l'information et de la communication la production, l'exploitation, la diffusion et la conservation de supports, d'oeuvres, de documents audiovisuels et multimédias intéressant le ministre de la défense ; 2o De réaliser des reportages d'actualité intéressant le ministre de la défense en vue d'une exploitation immédiate ou de la constitution d'archives ; 3o De réaliser, éditer et diffuser à la demande des organismes d'information et de communication relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception, des produits audiovisuels et multimédias ; […] 8o D'être dépositaire exclusif de tous documents et productions audiovisuelles sur tous supports réalisés par des moyens humains et techniques relevant du ministre de la défense et en assurer l'exploitation dans le respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle à leurs titulaires. […] »
Mais 2001 est aussi l’année où les derniers conscrits quittent les armées. Ils étaient
alors la dernière génération à effectuer un service militaire. La décision est prise lors d’un
conseil des ministres le 27 juin 2001. « Cette suspension immédiate des incorporations
bénéficiera aux 180 000 à 200 000 jeunes nés avant 1979. »68 Lors de la cohabitation Chirac-
Jospin, l’abandon définitif du service national, la fin des incorporations et la « libération
anticipée » des appelés est un projet politique qui a mûri depuis le milieu des années 1990. Il
existait autour de la question un relatif consensus de la classe politique. La fin du service
national fait émerger de nouveaux besoins pour la Défense, en terme de communication et de
mémoire. Le roulement des Français dans les armées qui facilitait le contact de la Défense
avec la population civile est perdu. Dans ce contexte, la Défense saisit vite les enjeux de la
communication69. La population ayant cessée d’être familière de la Défense, de la fréquenter,
elle devient un public auprès duquel il convient de se faire connaître, si possible apprécier.
Avec l’émergence des nouvelles technologies et la multiplication des écrans, la production de
67 Décret no 2001-347 du 18 avril 2001 portant statut de l'Etablissement de communication et de production
audiovisuelle de la défense, texte paru au JORF/LD page 6231. Reproduit dans les Annexes, 5, p145. 68 « La suspension de la conscription » in Armées d’aujourd’hui, n°262, Juillet-Août 2001, p. 6. 69 Voir à ce sujet le chapitre « Pour un nouveau regard sur la communication de Défense » in RODIER-
CORMIER, Béatrice, Aux origines de la communication de défense ?: Indochine 1945-1954, Châteauneuf-Val-
de-Bargis : les Éd. des Riaux, 2002. Perspectives.
29
source audiovisuelle devient un enjeu de premier ordre. Il va « monter en puissance », pour
reprendre une expression militaire. C’est dans ce contexte d’ouverture, de dynamisme et
d’autonomisation de l’établissement que celui-ci va couvrir les évènements, faire naître des
images consultées rapidement, presque immédiatement disponibles et exploitables par ses
partenaires.
1.2.2. Quel public ?
Dans les faits, l’autonomie de l’établissement s’est traduite par la constitution de
l’ECPAD en société de production, pour des films ou des ouvrages ayant vocation à valoriser
ses archives. Dans ce domaine, il répond d’abord aux commandes du ministère de la Défense,
des industriels de la Défense, d’autres organismes du gouvernement. Il peut aussi être
contacté par d’autres acteurs publics, ou privés. Il peut s’agir du secteur audiovisuel – cinéma
ou télévision – pour lequel elle assiste, par son expertise technique ou la cession de droits sur
ses archives, à la réalisation de documentaires70. Par exemple, il co- produit, depuis 2006, le
Journal de la Défense, magazine mensuel sur la chaîne parlementaire LCP71. Toute relation
avec des acteurs publics, des collectivités locales, des institutions ou d’autres ministères que
celui de la Défense, ou toute entreprise privée, passe par le pôle commercial de
l’établissement qui traite le dossier en satisfaisant aux besoins de son client. La transaction
effectuée est commerciale et mentionnée dans un devis. Même les particuliers peuvent y avoir
accès. Bien sûr, il ne s’agit pas d’une privatisation, l’établissement restant sous tutelle, mais
les modifications de statut entraînent nécessairement une redéfinition de la place de
l’établissement.
Les films d’instruction sont, nous dit Violaine Challéat, abandonnés72. Sans doute, leur
proportion dans les productions de l’ECPAD a effectivement été drastiquement diminué. Il est
bien sûr très difficile de les apprécier en nombre. Mais, avec toute la réserve requise, si on
entend par ce terme les productions à destination de la troupe pour préparer ses missions, nous
ne pensons pas qu’ils ont disparu. Concernant l’Afghanistan, nous savons que des films ont
été réalisés au bénéfice des soldats, notamment pour leur présenter le contexte d’opérations
des OMLT73. C’est ce que nous confirme l’Adjudant-chef Jannick Marcès, opérateur vidéo à
70 Décret no 2001-347 du 18 avril 2001 portant statut de l'ECPAD. Article 2, point n°5. Voir Annexes. 71 CHALLÉAT, Violaine, Ibid. 72 Ibid. 73 Rappel : Operationnal Mentoring and Liaison Team, équipes de combattants de la coalition intégrées aux
unités de l’armée afghane pour assurer leur formation directement sur le terrain et aux prises avec l’ennemi.
30
l’ECPAD. A partir de ses images tournées en 2007 sur le terrain, un film a été réalisé74, « à
vocation interne : pour la formation des gens qui allaient partir en Afghanistan, dans le cadre
des OMLT »75. D’autres images extraites des réalisations de l’ECPAD servent sans doute à ce
genre de support, sans qu’une estimation réelle soit possible. Car, sauf à consulter les archives
du pôle commercial – qui ne sont pas encore reversées – on ne peut bien estimer l’impact du
nouveau statut sur la relation avec les publics de l’ECPAD. Toutefois, on peut esquisser une
hypothèse à partir de l’article de Violaine Challéat, conservateur du patrimoine à l’ECPAD,
d’une part, et d’autre part en retenant ce que tout public est amené à connaître en se rendant à
l’établissement. Les plaquettes de présentation sont en effet très claires à ce sujet. En 2008, 60
vidéos étaient mises en ligne, dont 46 pour la Web TV créée en juin de la même année. 49
diffusions étaient réalisées au profit des chaînes de télévisions76. En 2009, ces chiffres sont, à
peu près, multipliés par deux. Depuis 2007 et la mise en place de ses nouveaux moyens de
production, l’ECPAD a multiplié par deux le temps de diffusion d’images d’actualité au profit
des médias.77 Pendant la période, le web a pris une place de plus en plus importante : la mise
en ligne du site internet, en 2002, et la diffusion de brèves au profit du site internet de l’EMA
a démultiplié les publics en installant les images de la Défense sur la Toile. Ainsi, dans tous
les cas, progrès techniques et nouveaux statuts sont à l’origine d’une nouvelle communication
pour l’ECPAD : il veut diversifier ses publics notamment par des partenariats au delà du
monde de la Défense. La diffusion des actualités de l’armée dans les cinémas semble loin.
Pourtant, sur la totalité des images produites en Afghanistan, seule une minorité a un
destin immédiat. A la question « Est-ce que vous avez une idée de la proportion des images
filmées qui finissent par avoir un support ? », l’adjudant-chef Marcès nous répond :
« C'est une minorité. On a beaucoup plus d'images qui partent aux archives que d'images
exploitées. C'est certain et c'est le côté frustrant de notre boulot. Parfois, on est étonnés, parce
qu'il y a des choses qui n'ont pas été exploités et qui le sont un an après, par exemple. »78
74 OMLT : les mentors, de Louis-Dominique Butor et Jean-Daniel Daney, ECPAD, 2008. Film de 52 minutes,
enregistré sous la référence D 2082741 V. Note : « Confidentiel Défense ; Diffusion Restreinte ». 75 Entretien avec l’ADC Janick Marcès, Janvier 2012. Reproduit en annexe. 76 Informations extraites de notre mémoire La communication de l’armée française en Afghanistan durant
l’opération Héraclès, décembre 2001-janvier 2002, « Chapitre 1 : Histoire de la communication des armées », p.
41. 77 « La communication de Défense », document distribué par le Pôle archives. 78 Entretien avec l’Adjudant-chef Jannick Marcès, janvier 2012.
31
Il est vrai que les images sont nombreuses, mais le nombre de manifestations
organisées autour de l’Afghanistan reste limité. Notons toutefois la mise en ligne de vidéos et
de photos sur le site de l’ECPAD. Citons aussi la récente exposition « Derrière le mur : le
126e RI en Afghanistan », exposition de 2011 qui retrace les activités du 126e Régiment
d’Infanterie de Brive en Afghanistan. Il est difficile de savoir combien d’images ont
véritablement connu une exploitation, que ce soit immédiatement après leur envoi à
l’établissement, ou près d’un an plus tard. Pour ce qui relève du ministère de la Défense,
l’ouverture du site dédié de l’EMA et la mise en ligne des brèves a considérablement
augmenté l’exposition du sujet. Pour les contrats disons « extérieurs », l’exploitation est
beaucoup plus mince. L’intérêt de l’ECPAD pour ses images n’est pas en cause.
L’exploitation tient au contexte délicat de l’intervention, certes. Mais aussi au regard que
portent les médias sur ces images. Sauf à combler un manque, ce qui arrive, les journalistes
exploitent pour grande partie les images qu’ils réalisent eux même. Les images de l’ECPAD
sont-elles davantage regardées comme des produits mémoriels ? C’est certainement une partie
de la réponse : l’établissement organise des expositions, notamment en partenariat avec le
musée de l’Armée ; s’ouvre vers les plus jeunes, aussi, avec des séances pédagogiques de
découverte pour les élèves, du primaire au lycée79 ; enfin, bien sûr, accueille pour la
valorisation de ses archives des chercheurs, étudiants ou professeurs. En définitive, le dernier
public – le plus important ? – de l’ECPAD, ce serait les générations futures.
1.2.3. Conservation des images
Avec le CNC, l’ECPAD est la plus grosse institution de conservation de films en
France. Elle a à gérer un corpus important, pour ne pas dire franchement monstrueux, de films
témoignant de l’histoire militaire de la France au XXe siècle. La découverte de son dernier
fonds, le plus récent, le plus immédiat, nous montre à quel point l’archivage fait entièrement
partie du code génétique de l’établissement. L’ECPAD conserve dans ses cartons plusieurs
centaines de milliers de photographies et des dizaines de milliers de films80. Ils concernent
tous les grands épisodes de l’armée française, depuis la création des SCA et SPA en 1915.
Première et Seconde guerre mondiale, guerre d’Indochine, guerre d’Algérie, Tchad, Liban,
Kosovo, Côte d’Ivoire. La liste n’est pas exhaustive. Mais aussi l’armée française en 79 Armées d’aujourd’hui, n° 263, septembre 2001. 80 La description des fonds de l’établissement est disponible sur son site internet, www.ecpad.fr
32
métropole, où toutes ses composantes sont représentées : service de santé des armées,
régiments, cérémonies… Les trois armées, Armée de terre, de l’air et Marine nationale, ont
toutes été immortalisées. C’est toute l’histoire contemporaine de l’armée française qui a au
Fort d’Ivry sa mémoire en images.
« Les archives de l’ECPAD sont parfois le théâtre de scènes qui ressemblent à de la magie
noire : quelques grammes de celluloïd, une ampoule, trois fois rien… mais voilà que se
dressent, venus de temps révolus, les fantômes de nos aïeux, les combats auxquels le temps
confère la dimension mythologique, les pans entiers de l’histoire militaire de la France. Ces
archives audiovisuelles de la Défense que protègent les spécialistes de l’ECPAD, ce sont les
images que les reporters de l’établissement ont capturées depuis 1915. »81
Mais de telles sources sont fragiles, et la conservation des films se heurte à des
difficultés. Il leur fait résister au passage du temps et à ses multiples dégradations. Le premier
support des films était le nitrate de cellulose, matière dangereuse parce que très inflammable,
et donc ardue à conserver. Depuis 1961, leur circulation et leur conservation privée sont
même interdites. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si les Archives françaises du film du CNC
et les fonds des armées de l’ECPAD se sont respectivement réfugiées à la batterie de Bois
d’Arcy et au fort d’Ivry. Les collections sont entreposées dans des casemates. Dix huit à
l’ECPAD, toutes équipées de système de détection incendie, certaines climatisées, d’autres
pourvues de déshumidificateurs. Depuis le nitrate, deux autres supports ont été utilisés : le
triacétate de cellulose (ou acétate) et le polyester. Ils proposent une conservation de plusieurs
centaines d’années, mais, dans de mauvaises conditions de conservation, les bobines acétates
peuvent se décomposer en dégageant de l’acide acétique (c’est ce qu’on appelle le
« syndrome du vinaigre »). S’y ajoute la perte de plasticité qui entraîne un film cassant. La
conservation doit aussi faire l’objet d’une manipulation vigilante. Lors de la sortie des stocks,
les films peuvent subir d’importantes variations de températures ou d’humidité qui peuvent
lui être nocives. Qui plus est, les techniciens vérifient systématiquement que la bobine est
bien sèche, et prennent garde de ne pas y apporter des poussières. On le voit : la conservation
du film dans des conditions propres à le rendre toujours accessible ne va pas de soi. D’un
autre côté, si le film est en mauvais état, l’institution prend à sa charge de le restaurer. Ce
travail technique et délicat est souvent permis par la mise au jour de nouvelles copies. La
81 « Fragiles images », Image Défense, Lettre insitutionnelle de l’ECPAD, n°3, septembre 2003, p. 3.
33
plupart des dégradations de nature chimique sont en effet irréversibles et, sans ce bricolage,
les films sont perdus : d’où l’importance accordée aux précautions de conservation.
L’ECPAD dispose du matériel et du personnel pour réaliser ces prouesses techniques : « baies
de duplication et de restauration vidéo tous standards et formats, télécinéma numérique 16 et
35 mm, atelier de numérisation, salle de projection, magasin d’archivage. (… ) Une équipe de
39 personnes sous la responsabilité d’un conservateur du patrimoine, dont 8 documentalistes
spécialisés et 20 techniciens. »82 Dans tous les cas, la copie originale est systématiquement
assortie d’une copie de sauvegarde. Désormais, celle-ci se fait autant que possible sur format
numérique. De cette façon, les utilisateurs (chercheurs, étudiants, professionnels du
cinéma…) n’ont pas à manipuler les originaux, ce qui serait, on s’en doute, fort dommageable
pour les fonds. La reproduction sur format numérique permet d’envisager une amélioration de
l’exploitation de ses films et lui assurer ainsi une seconde de vie83. Le support informatique
paraît, effectivement, absolument pérenne. Mais il ne faut pas s’y tromper, des images
informatisées obéissent aux mêmes règles de conservation qui leur imposent classements,
légendes et copies. Et l’informatique n’est pas en soi un support ; c’est le disque dur qui l’est,
et celui-ci doit toujours être idéalement conservé et surveillé. Que notre lecteur ne se
méprenne pas non plus : les cassettes que nous avons visionnées sont des VHS – Bétacam. Et
il s’agit donc, ni plus ni moins, que de bandes magnétiques. Le tout numérique ne s’est
vraiment imposé qu’après 2008.
L’ECPAD a développé une véritable expertise de la conservation. L’établissement se
place à la pointe dans le domaine de l’archivage audiovisuel. De fait, elle offre une banque
unique d’images, réellement incontournable pour tout producteur de documentaire, dont le
sujet a trait à l’histoire militaire de la France au vingtième siècle. Hormis l’Institut national de
l’audiovisuel et le CNC, personne ne lui dispute sa place de spécialiste. Etabli depuis les
lendemains de la seconde guerre mondiale au Fort d’Ivry, le cinéma des armées est vite
devenu une mémoire de l’armée française. Les opérateurs de la première guerre mondiale ont
constitué des archives précieuses, très recherchées pour leur originalité par les professionnels.
L’ECPAD remplit sa mission de communication sur le terrain en poursuivant le travail qui
82 Idem. 83 Nous renvoyons pour les informations utilisées dans ce paragraphe au Guide de la conservation des films.
Paris : Commission supérieure technique de l’image et du son, 1995.
34
était celui de ces opérateurs, photographiant, filmant, et, aujourd’hui, en constituant des sujets
montés pour l’état-major des armées. C’est ce qu’on appelle un journaliste de défense. Et
l’ECPAD valorise les images ainsi collectées en constituant des archives, qui servent de
supports à des expositions ou à des documentaires. Et ces images se transforment en mémoire.
C’est là toute l’action de l’établissement. Les reporters, eux, sont en première ligne. Dans
quelle vision du temps s’inscrivent-ils ? Comment déclinent-ils, sur le terrain, en Afghanistan,
ces deux volets de leur mission ?
35
Chapitre 2. Les reporters de guerre : l’ECPAD sur le terrain
Les reporters de l’ECPAD peuvent être déployés partout où le ministère de la Défense
ou l’Etat-major des armées l’exige, que ce soit pour couvrir un événement ministériel ou
l’activité des forces, dans leur théâtre respectif. Une équipe ECPAD, c’est toujours un
Officier image (journaliste), un caméraman et un photographe. D’où viennent ces hommes et
comment sont-ils formés ? Comment s’organisent-ils ? Quelles sont leurs pratiques ?
Comment pensent-ils leur métier ? Telles sont les questions qui guideront notre raisonnement.
Pour y répondre, nous nous basons sur les entretiens que nous avons menés avec les hommes
eux même. La contemporanéité de notre sujet nous a facilité la tâche : nous avons pu,
facilement, être mis en rapport avec des reporters qui rentraient du théâtre. Leurs impressions
étaient fraîches. Toutefois, comme l’Afghanistan est encore une opération en train de s’écrire,
il faut tout de suite remarquer que l’actualité a un impact sur leurs témoignages.84 De plus,
nous disposons d’une publication personnelle, le mémoire du capitaine Daney, officier image
en Afghanistan, « Les actualités d’aujourd’hui seront les archives de demain », écrit en
décembre 2010 ; et d’un périodique institutionnel de l’ECPAD, Images Défense, dont nous
avons consulté à la bibliothèque nationale de France les publications de 2003 – sans savoir si
elles se sont arrêtées depuis. Un numéro spécial, en juin 2003, est consacré aux reporters de
guerre. Enfin, les images elles-mêmes viennent appuyer nos hypothèses pour y rechercher la
traduction de leurs pratiques. Notre exposé aborde leur formation et leur organisation. Ce sont
des militaires, des professionnels de l’image aussi. Ils adoptent une organisation spécifique.
Ensuite, nous revenons sur les particularités du mandat en Afghanistan. Ils doivent s’adapter à
un contexte particulier, souvent difficile. L’occasion d’affiner et de parfaire des pratiques de
reportage, tout en collectant, par une sorte d’enquête, des centaines voire des milliers
d’images. Ce qui, enfin, nous amène à détailler les caractéristiques de leur mission.
2.1. A la fois témoins et acteurs
2.1.1. Des journalistes militaires
84 En janvier 2012, lorsque nous avons mené nos entretiens, quatre soldats français ont été tués par des soldats de
l’armée afghane, manifestement passés à la solde de l’insurrection. Cela a pu renforcer la suspicion qu’ils
pouvaient avoir à l'égard des soldats afghans.
36
Les reporters de l’ECPAD qui partent en Afghanistan sont tous des militaires. « Les
civils ne peuvent être envoyés sur les théâtres d’opérations. Ils participent néanmoins
activement aux différents tournages en France et à l’étranger. »85 En tant que militaire, donc
que soldat, on attend d’eux qu’ils puissent remplir leur mission audiovisuelle sur le terrain,
mais, si cela est nécessaire, qu’ils puissent aussi laisser la caméra pour sortir l’arme. Être
soldat a donc nécessairement un impact sur leur comportement professionnel, mais aussi sur
leur regard. Il existe des parcours différents. « Les officiers sont sous contrat et spécialisés
dans le journalisme et la réalisation. Les sous-officiers ont pour la plupart suivi une formation
civile ou militaire (école d’audiovisuel) : école de Rochefort, par exemple. Les engagés
volontaires qui intègrent l’ECPAD sortent des écoles audiovisuelles. »86 Si tous ont en
commun un amour de l’image, du travail bien fait et des pratiques audiovisuelles, certains
n’ont pas commencé dans l’armée avec cette spécialité. Chacun révèle sa particularité. Par
exemple, le sergent Jean-François d’Arcangues vient d’une formation spécialisée, avant
d’avoir signé pour l’armée de l’air.
« Ici, des photographes avaient une formation photo avant l’armée, d’autres ont été formés par l’armée. En fonction des armées c’est différent : l’armée de terre forme un spécialiste photo qui appartient à un certain niveau, ce qu’on appelle seconde partie de carrière. Les autres armées c’est différent. Moi, dans l’armée de l’air, j’ai signé un contrat pour être photographe dans l’armée. A l’armée de terre, j’aurais du d’abord signer pour rejoindre telle ou telle unité puis demander à être formé à la photo. Les cursus sont différents. »87
Mais d’autres ont connu un engagement dans l’armée avant de rejoindre les équipes
image. C’est le cas de l’adjudant Vincent Larue. Il était dans le renseignement et travaillait
déjà avec du matériel audiovisuel, « j'avais beaucoup d'équipement en photo, vidéo. Pour
pouvoir fournir du matériel : la preuve par l'image pour pouvoir remplir des dossiers »88. C’est
par ce biais qu’il a connu l’Afghanistan, dès les premières années. Il était souvent en contact
alors avec l’ECPAD, qu’il a croisé à plusieurs reprises. Il a pu les rejoindre en 2006. Il existe
85 « Quelques informations pratiques sur l’ECPAD », Images Défense, Lettre institutionnelle de l’ECPAD, n°2,
juin 2003. 86 Idem. 87 Entretien avec le Sergent Jean-François d’Arcangues, reporter ECPAD (2011). Il est parti pour la première fois
en Afghanistan en 2009, y est retourné en 2010. Il est photographe. 88 Entretien avec l’Adjudant Vincent Larue, reporter ECPAD (2012). Il a effectué plusieurs missions en
Afghanistan, d’abord dans le renseignement. Il a rejoint l’ECPAD en 2006. Initialement photographe, il est
devenu caméraman.
37
des passerelles entre les différents mondes de l’audiovisuel. Ils peuvent venir de la Défense,
comme le commandant Bousquet, qui, par exemple, a rejoint l’ECPAD après un séjour au
SIRPA Terre89.; ou le commandant Olivier De La Bretesche qui se rendit en Afghanistan en
2004 comme conseiller communication pour l’EMA, avant de rejoindre, plus tard,
l’ECPAD90. Ils peuvent ensuite se reconvertir dans le monde civil, certains des opérateurs
devenant JRI dans les télévisions françaises ou à l’Agence France Presse.
Le service militaire amenait dans les rangs de l’ECPA de jeunes talents, comme
Claude Lelouch, ou ont su en révéler aussi, tel l’inoubliable Pierre Schoendoerffer. Avec la
professionnalisation, ce turn-over s’est interrompu. Le recrutement pallie à ce défaut, l’armée
intégrant désormais des gens qui deviennent professionnels, qu’ils soient déjà formés ou non.
L’ECPAD assure d’ailleurs elle même une partie de la formation de ses personnels via l’école
de Rochefort. Elle y a en charge la formation des pratiques audiovisuelles, notamment
enseignées aux photographes. Si les reporters qui partent sur le terrain sont toujours militaires,
ce n’est pas forcément le cas des monteurs, réalisateurs, archivistes, documentalistes, et tous
les indispensables personnels administratifs, qui peuvent très bien être des civils employés par
l’Etablissement. L’armée offre certainement une solide formation qui les prépare au moins à
affronter des conditions de travail difficiles. C’est aussi lié à leur objet de travail. Chacun
d’entre eux reçoit une habilitation "confidentiel défense" qui leur permet de couvrir tous les
évènements vécus par les unités présentes sur le terrain, que ces images soient plus tard
classifiées ou non. Ce sont des personnes qui peuvent être mis au secret, intégrant au plus près
les sections et leur fonctionnement. Ils ont également le savoir-faire pour ne pas gêner, ou le
moins possible. Toute chose bien plus difficile pour un civil. Car, sur le terrain, l’insertion au
cœur des personnels nécessite un patient travail d’intégration.
2.1.2. Composition des équipes images
89 Equipe audiovisuelle de l’armée de Terre. Les missions des SIRPA sont moins globales que celles de
l’ECPAD. 90 Le commandant Bousquet est parti en Afghanistan pour le SIRPA Terre (Notices 04.9.168 et 169, rushes du
SIRPA Terre). Le commandant de La Bretesche fut conseiller de communication en Afghanistan en 2004, versa
ses documents audiovisuels personnels aux archives de l’ECPAD (Collection De La Bretesche D-190). Il est
aujourd’hui directeur du pôle production de l’ECPAD.
38
L’ECPAD envoie sur le terrain ses équipes, qu’on appelle « équipes images ». Ils sont
trois : un officier image, un caméraman et un photographe. « Une des missions de l’ECPAD
est d’être en mesure d’armer et de projeter 6 équipes images. »91, soit dix huit personnels
disponibles. De plus, « chaque mois, en alternance avec le SIRPA Terre, une équipe est
maintenue en alerte, avec un délai de 72 heures, dans le cadre du Module d’alerte de la
communication opérationnelle (MACO). »92 Régulièrement, en France ou à l’étranger, les
équipes sont engagées pour couvrir les activités du ministère de la Défense ou des forces
françaises. C’est en 200693 que sont dessinés les contours actuels de l’équipe image. Le
preneur de son est progressivement remplacé par l’officier image. Celui-ci est
« l’interlocuteur privilégié du commandement ». Officier subalterne, il agit comme journaliste
et chef d’équipe. Il accompagne le caméraman en tant que journaliste pendant les interviews
et participe à la prise de son, parfois à la prise d’image lui même. « Chargé de la réalisation
des sujets et du commandement, il assure également la sécurité de ses personnels quand le
besoin s’en fait sentir et crée la dynamique de groupe nécessaire à la bonne marche de
l’équipe ». Il assure un rôle de pivot : il est en contact avec le conseiller communication,
relais de l’Etat-major sur le théâtre ; il s’applique à angler ses sujets selon les éléments de
langage décidés par la haute hiérarchie militaire ; l’officier établit un relais avec ses hommes.
Le capitaine Daney94, officier image, est revenu lors d’un entretien sur les différents mandats
qu’il a effectué en Afghanistan. Il conçoit le rôle de l’officier image comme un « manager ».
« On a un vrai rôle de manager. Ce sont des missions qui sont longues, il peut y avoir des baisses de moral dans l'équipe, des petits soucis, donc on a ce rôle de surveillance du moral, de la santé, si tout va bien : les contacts réguliers avec la famille… »95
L’officier image est accompagné d’un photographe, qui prend les clichés bien sûr,
mais est également « chargé du traitement des images prises, c’est-à-dire le classement, le
légendage et l’archivage de l’ensemble de ses reportages ». Tâches indispensables, parfois
fastidieuses, elles sont effectuées par le reporter à son retour de mission. Elles permettent,
91 DANEY, Jean-Daniel, Op. Cit., p. 6. Porte la note : « Contrat d’objectifs et de moyens 2009-2011, p. 14 ». 92 idem, p. 7. 93 Protocole EMA/ECPAD n°179/DEF/EMA/CAB/COM du 31 juillet 2006. 94 Le capitaine Daney est officier image depuis 2006. Il a fait quatre fois l’Afghanistan, fin d’année 2007, deux
fois en 2009 et une fois en 2010. A chaque fois, il y est allé pour des durées de trois mois. Désormais, il ne
devrait plus retourner sur le terrain, mais participe à la création d’une école de l’ECPAD. 95 Entretien avec le capitaine Daney, janvier 2012.
39
plus, elles conditionnent l’exploitation future de ses images. Le caméraman agit davantage en
lien avec le chef d’équipe, un peu comme le binôme rédacteur/journaliste reporter d’image
(JRI) de la télévision. L’officier image peut aussi être vu comme le réalisateur. Avec son aide,
le caméraman monte ses images et y apporte des commentaires, nécessaires à la réalisation
des brèves : « lors des opérations extérieures, les équipes fournissent sur place des sujets
courts (brèves). Il s’agit d’un sujet audiovisuel (ne dépassant pas deux minutes trente),
accompagné d’un article écrit. (…) Sans faire d’analyse de situation ou de contexte, mais
traités de manière factuelle, ces produits sont destinés au site internet de l’EMA »96. Dans le
cas d’une plus grosse réalisation – un film dépassant la durée de quelques minutes, par
exemple – l’ECPAD engage davantage de moyens à partir de ces images, mobilise des
monteurs et un réalisateur. Ces images peuvent également être mises à disposition des médias,
sous la forme de bandes éléments, qui, sans montage ni commentaires, peuvent être librement
utilisées par les chaînes de télévision, après être passées par la cellule actualités de l’ECPAD
qui se charge de leur validation. Enfin, comme le photographe, le caméraman se charge lui
même du reversement aux archives, se chargeant du classement, du dérushage, de la
préparation du produit à son stockage (numérisation, par exemple).
En somme, l’équipe image est le « bras armé audiovisuel » de l’Etat-major des armées,
pour reprendre une expression du capitaine Daney. Tous militaires, ces hommes sont préparés
et formés pour répondre à la fois aux besoins techniques particuliers des métiers de
l’audiovisuel, et prêts à endurer des situations de crise, jusqu’aux plus tendues comme peut
l’exiger le contexte afghan.
2.2. L’ECPAD sur le terrain, en contexte afghan
2.2.1. Aggravation des risques : des conditions de plus en plus difficiles
L’évolution du contexte afghan a impacté l’armée française autant qu’elle a touché les
reporters de l’ECPAD. Ils dressent eux même le constat de la dégradation. Certains se
souviennent, avec une pointe de nostalgie, de « Chicken Street », l’avenue commerçante de
Kaboul. Cette carte postale rappelle l’ambiance détendue lors de leur arrivée en Afghanistan
en 2002. « On arrivait à avoir du contact avec la population » explique l’adjudant-chef
Jannick Marcès, photographe puis caméraman, « autant en 2006 ou 2007, la courbe des
96 DANEY, Jean-Daniel (Cne), Ibid. idem pour les citations précédentes, sauf entretien.
40
accrochages et des explosions, et des IED97 et compagnie sur les routes, c'est exponentiel ».
« Avant on était dans un climat plus serein, d'abord parce qu'on était pas autant engagés,
ensuite parce qu'on était vus comme les libérateurs. » témoigne l’adjudant Larue. Si la date de
la dégradation reste difficile à fixer avec précision, tous citent l’accrochage d’Uzbeen et son
impact sur l’opinion et la classe politique comme point de non retour. « Ca a été un grand,
grand bouleversement et ça a changé beaucoup de choses cet évènement malheureux »
commente l’adjudant Vincent Larue. Croisés dans les couloirs de l’établissement, au détour
d’un visionnage, d’autres reporters confirment ces impressions. Les images que nous avons
étudiées approuvent et respectent la même analyse. En quoi ce changement de contexte a
déterminé les pratiques des reporters ? L’ont-ils modifié ?
Le transport, d’abord. Il est toujours en Afghanistan une difficulté à prendre en
compte. Il est source de risques, attendu que des accrochages en chemin peuvent éclater avec
des ACM98, ou que le convoi peut sauter sur un IED. Ensuite parce que le moyen de transport
n’est pas extensible : trois hommes de l’équipe image, ce sont trois places prises dans les
véhicules ou les hélicoptères. Cela aurait pu être la place d’un combattant. Pour cette raison,
parfois, les hommes de l’ECPAD ne peuvent pas tous partir ensemble. Plus rarement, on fait
débarquer un homme de l’infanterie.
« Quand un effectif d'une mission est complet, les véhicules sont pleins. (…) Donc il faut faire de la place. C'est assez rare que l'on fasse débarquer quelqu'un de l'infanterie pour pouvoir embarquer, mais c'est déjà arrivé. C'est arrivé qu'on dise, on prend le caméraman, mais on est obligé de laisser un personnel derrière. On aime pas ça, nous, parce que la mission c'est quand même pas une mission audiovisuelle, c'est une mission opérationnelle. Mais nous, on est là aussi pour porter cette opération. Sans nous, personne ne verra ce qu'ils ont fait. » 99
Pour chaque opération, le chef pense un dispositif et regarde les moyens qu’il peut
mobiliser. La présence des hommes d’image peut modifier ce dispositif, et cette présence peut
être vécue, par certains chefs, comme une intrusion négative et malvenue. Enfin, le transport
est conditionné par l’Afghanistan en soi : mauvais état des routes et zones montagneuses font
que des distances relativement courtes imposent plusieurs heures de trajet. Pour toutes ces
97 IED : Improvised Explosive Device, en français Engin Explosif Improvisé (EEI, moins utilisé). Il s’agit de
bombes artisanales placées sur les routes et qui explosent au passage d’un convoi. 98 ACM : Anti-coalition Militia, acronyme américain pour désigner les ennemis potentiels, autant les insurgés
que les bandits. 99 Entretien avec le Capitaine J.-D. Daney.
41
raisons, l’équipe ECPAD doit faire preuve de souplesse et d’une relative adaptabilité.
L’emploi de l’équipe incombe en dernier ressort à l’officier qui est en charge des opérations.
Le contexte de plus en plus difficile en Afghanistan a rendu le travail des opérateurs
plus compliqué. L’équipe image, en 2002, circulait à côté des véhicules militaires. Ils avaient
leur propre 4x4. En 2007, on voit les hommes à l’intérieur des véhicules. Par mesure de
sécurité, nul n’en doute, l’équipe image a intégré la carapace que le contingent dresse sur lui
dans ses déplacements. En les insérant encore plus dans le dispositif militaire, en revanche, ils
sont davantage dépendants de la hiérarchie opérationnelle, qui obéit à ses propres codes, qui
pense à sa propre communication – celle de son unité, de son régiment… - avant de réfléchir à
une vision d’ensemble. Les opérateurs ont donc à cœur de bien s’intégrer, se faire accepter,
pour se fondre dans le groupe et pouvoir, ainsi, mieux suivre les hommes et couvrir les
évènements.
2.2.2. Insertion au cœur des personnels
Savoir se faire accepter est une condition sine qua non d’un bon travail pour les
reporters. Il s’agit, pour un militaire, de relever un défi qui peut se poser aussi à des
journalistes civils. Etant militaires eux même, une première barrière tombe. Celle du langage,
de la sociabilité militaire, des codes et de l’entraînement qui font de la vie militaire un tout,
renforcé par « l’esprit de corps ». « Quand un artilleur, un gars de l'infanterie, ou un aérien
vous parle de son avion, de son canon, de son char, de sa mission d'infanterie, mieux vaut
qu'il ait en face de lui quelqu'un qui sache de quoi il parle. »100 L’insertion au cœur des
dispositifs est un plus pour l’ECPAD par rapport aux journalistes civils qui, eux, n’ont pas
cette chance. Interrogée pour la feuille institutionnelle de l’ECPAD en 2003, la journaliste
Dororthée Olliéric, grand reporter pour France 2, explique que ces hommes, par leur sens
professionnel « font le même travail que les reporters civils », mais « ils ont la possibilité
d’accéder, en tant que militaires, à certaines zones fermées aux civils »101. Ce statut militaire
peut donc être vu comme un atout : meilleure compréhension des enjeux militaires, insertion
plus facile, entente cordiale entre les hommes… Toutes choses moins évidentes pour des
civils. Et puis, ils vivent les choses ensemble. Quand ils sont confrontés à un IED sur le
terrain, ils le subissent avec les hommes. L’emphase permet de mieux comprendre, pour le 100 Entretien avec le Capitaine Daney. 101 « Interview de Dorothée OLLIERIC, Grand reporter à France 2 », Images Défense, n°3, juin 2003.
42
reporter, quand il s’agit de faire usage de sa caméra, et quand il ne le faut pas. Pour eux, c’est
même une question de vie ou de mort. L’esprit sur le terrain veut que chacun s’assure de la
sécurité de l’autre. Ne pas abuser de cette solidarité par des actes inconsidérés, un
raisonnement qui conduit les reporters à se surveiller dans leur conduite :
« On a la chance de faire un travail qui nous permet de restituer par l'image l'intensité de ce que peuvent vivre certaines personnes. […] Tu dois toujours faire ça en sécurité. Ne pas remettre en question l'opération, ne pas sortir ton appareil photo à n'importe quel moment, pouvoir immortaliser les choses tout en sachant qu'il y a une opération militaire en cours. Et, que tu ne dois pas d'un coup perturber l'opération parce que tu vas commettre une action qui va mettre ta vie en danger, et comme tu te mets en danger, quelqu'un va vouloir te protéger. »102
Mais sans jamais appartenir aux unités, sans participer vraiment aux opérations,
autrement qu’avec un appui audiovisuel – qui peut être décisif pour la « bataille médiatique »
- les hommes de l’ECPAD sont dans un entre-deux. Membres de la famille militaire, mais
étrangers aux opérations. La place qu’ils adoptent sert d’abord leur mission, répondre aux
besoins de communication, ordonnés par l’Etat-major des armées. Le capitaine Daney met
l’accent sur la pédagogie nécessaire pour bien faire comprendre aux chefs d’opération le rôle
de l’ECPAD, qui ils sont, comment ils fonctionnent, et lever les doutes sur leur capacité à
parer à d’éventuels difficultés sur le terrain. « Bien souvent ils ont tellement la tête dans la
formation, dans leur préparation de mission, qu'un élément supplémentaire, leur fait se poser
des questions - il ne nous connaît pas bien au départ. De quoi ils sont capables ? Comment ils
vont se comporter ? Est-ce qu'ils ont bien les réflexes d'un combattant ? Eux raisonnent
combat. »103 Ainsi, au départ, les hommes de l’ECPAD commencent par de petites missions.
Ils habituent les hommes à la présence d’une caméra. Se faire filmer pendant l’effort, pendant
son travail ou, carrément, pendant un combat, ne va pas de soi. Ils font connaissance,
simplement. L’équipe image cherche alors à acquérir la confiance de ceux qu’ils
accompagnent, montrent qu’ils parlent la même langue. Lorsque cela est possible, ils vont sur
des missions plus complexes. Cela prend du temps.
« Il peut être sous la contrainte pour vous emmener. Le chef a dit "vous l'emmenez", pas de problème. Mais une fois arrivé sur le terrain, il dit "tu restes dans le VAB ou à proximité du VAB". Les mecs font leur mission. Toi, tu vois rien. Quand tu rentres, tu rentres. Toi, tu as vu le VAB, les mecs autour. Une petite interview de rien. Tu n'as rien. Et bien il faut acquérir cette confiance. Ce n'est jamais plié d'avance. Il faut y aller
102 Entretien avec l’adjudant Vincent Larue, janvier 2012. 103 Idem.
43
tranquille. C'est dans le temps que ça se fait. Nous on a cette chance, que n'ont pas forcément les journalistes civils, on a la chance d'avoir le temps, même si des fois on ne l'a pas trop, de s'insérer dans les unités, et essayer d'aller de plus en plus loin avec les unités, pour aller jusqu'au bout ensuite et être ensuite au milieu du combat. »104
Cette confiance est faite de petites choses. Ce vécu est assez difficile à imaginer, bien
que les sons des rushes, les petites remarques lors des interviews nous aident parfois à situer
le degré d’entente qui s’est établi entre l’opérateur et son interlocuteur. « Il y a de bons et
mauvais clients », comme dit l’Adjudant-chef Jannick Marcès. Certes. Il y a des personnes
avec qui ça passe, et ça se ressent à l’image. Parfois, c’est l’inverse. Ainsi, en 2002, pourtant
période « tranquille », l’ECPAD couvre le déploiement sur le terrain d’un nouvel appareil de
guidage. Le caméraman fait l’interview de l’officier, qui refuse de donner son nom à la fin de
l’entretien. Il a donné quelques détails techniques, mais répond très brièvement aux questions.
Le sujet a, par ailleurs, fini par être classifié105. Il a fait le minimum demandé, l’interview est
de médiocre qualité. Autre exemple : lorsqu’il suit les premières OMLT françaises,
l’adjudant-chef Marcès cherche à rejoindre le cœur de l’action. Il a fait son maximum pour en
obtenir le droit auprès du chef de l’opération. Le jour où, enfin, l’opportunité s’offre, il
accompagne les équipes. Mais alors qu’elles entrent dans le village et livrent un assaut, lui est
laissé en arrière, avec les véhicules. Il le vit alors comme une grande frustration106. La pratique
des reporters est donc dépendante de la bonne entente entre eux, les hommes et le
commandement. C’est une règle du jeu, tacite, sur le terrain, à échelle humaine. L’évolution
de la situation l’a peut-être rendue encore plus compliquée : de nouvelles consignes de
sécurité ont émergé avec la dégradation de la situation, qui ont conditionné l’exercice de leur
mission. La multiplication des accrochages et des situations à haut risque a accru la nécessité
d’établir une confiance entre eux et les unités. Cette confiance détermine leur vie quotidienne
mais ils la jugent aussi nécessaire pour mener à bien leur mission.
2.3. Missions des reporters
2.3.1. Les règles de la communication
La première mission de ces équipes est la communication. « Les équipes images sont
projetées sur les théâtres d’opération par la cellule communication de l’état-major des armées 104 Idem. 105 Référence 02.9.96, cassette n°30, TC 20 :14. 106 L’opérateur l’exprime sur les feuilles de dérushage des cassettes Bétacam SX de la référence 07.9.177.
44
lorsque celle-ci le décide. L’équipe devient alors un acteur à part entière de la chaîne de
communication opérationnelle (…)»107 L’ECPAD est en rapport sur place avec le conseiller
communication, lui même homme de l’Etat-major, qui transmet les lignes de la
communication décidées en haut lieu. Ce dernier est le représentant de « Paris », c’est-à-dire
de l’Etat-major des armées (EMA) ou du ministère de la Défense, donneurs d’ordre en
matière de communication. Le conseiller en communication est directement le supérieur
hiérarchique, sur place, de l’équipe de l’ECPAD. Il peut relayer la commande d’un sujet ou en
valider les images. Pour communiquer, cet officier a plusieurs cartes dans son jeu. Il a
l’équipe image ECPAD, mais aussi des officiers communication, et le centre presse, qui
assure le lien avec les journalistes. Il peut donc transmettre à l’équipe une demande précise de
sujet, répondant à un souhait émanant de Paris de voir tel ou tel sujet être couvert. S’il y a
nécessité d’avoir des images sur l’arrivée du Rafale, par exemple. Ou bien la livraison d’un
nouveau véhicule de l’armée de l’air, le déploiement d’un nouveau régiment, une opération au
profit de la population… Dans ce cas là, l’officier image emmène avec lui son opérateur vidéo
ou son photographe. Ils peuvent aussi y aller seuls, séparément. En règle général, ces images
sont ensuite disponibles sur Internet, via le site de l’EMA, sous la forme de « brèves » ;
parfois, nous l’avons dit, elles servent à des bandes éléments. Enfin, l’équipe a elle même
« une force de proposition », pour reprendre une expression du capitaine Daney. « On voit des
choses que Paris ne voit pas » dit-il.
A quelles règles obéit cette communication ? Tous les sujets, s’ils peuvent être filmés,
ne sont pas forcément « porteurs ». Cela dépend de son contexte de production. Si, le jour où
ils partent en reportage pour couvrir le déploiement des avions Rafale à Kandahar, un avion,
admettons, vient de tomber à l’eau suite à un ravitaillement, le contexte n’est pas bon. Et
donc, il n’y a pas de reportage. « Nous, on n’est pas dans l’information, on est dans la
communication », résumait le capitaine. Pour l’adjudant Larue, cela signifie « ne pas se tirer
une balle dans le pied »108. Prenons un cas particulier. A certains moments, notamment en
2007 et 2008, les soldats français se plaignaient, sur le terrain, de la pauvreté de leur
équipement. Le journaliste Jean-Dominique Merchet, dont l’ouvrage Mourir pour
l’Afghanistan, Pourquoi nos soldats tombent-ils là bas ? 109 revient sur l’impact de
l’embuscade d’Uzbeen, explique que le matériel adapté, nécessaire aux opérations en
107 DANEY, Jean-Daniel (Cne), ibid. 108 Entretien avec l’adjudant Larue, Op. Cit. 109 MERCHET, Jean-Dominique, Op. Cit.
45
Afghanistan, n’est véritablement inscrit au budget et livré qu’en 2009. Il s’agit surtout des
«tourelleaux téléopérés» 110 sur les véhicules blindés de l’armée de terre, les tourelles
existantes jusque là laissant le servant de la mitrailleuse à découvert. La commande a
finalement été passée, et « si tout va bien, il aura fallu dix huit mois entre la lettre du chef
d’état-major et l’arrivée du matériel sur le terrain »111. Entendra-t-on les plaintes de la troupe
dans les vidéos de l’ECPAD, de manière explicite et face caméra ? Non. Sans faire référence
précisément aux faits développés par le journaliste, l’adjudant Larue démontre que ce n’est
pas possible :
« Les gens demandent à ce que tu viennes : " il faut montrer ça, c'est comme ça qu'on vit ". Oui [leur répond-t-il], mais je suis désolé il faut quand même que tu sois en tenu, on est là pour mettre en valeur ton travail on n’est pas là pour dégrader le machin, en disant les sales conditions de vie, regardez, où vivent les Français. On ne se tire pas une balle dans le pied quoi. »112
L’Etat-major des armées a même toute latitude pour se réserver l’exclusivité de la
production des images à un moment donné. « Lorsque la situation l’exige, ou si le
commandement décide de garder le contrôle de l’information, l’équipe peut être le seul
capteur d’images engagé dans une opération ». Le capitaine Daney prend l’exemple dans son
mémoire de la libération des otages du Ponant dans le golfe d’Aden. Sans aucun journaliste
civil à proximité, c’est l’armée qui a fournit les seules images disponibles sur le sujet. La
Défense peut aussi avoir intérêt à posséder ses propres images. Le capitaine Daney fait
référence à l’épisode de 2004, où, en Côte d’Ivoire, le contingent français a été accusé de tirer
sur la foule des jeunes Ivoiriens. Pas d’équipe image, pas d’image, pas de preuves. « Ce jour-
là, la bataille médiatique fut perdue »113 conclut le capitaine. La communication obéit donc à
des règles strictes, qui n’ont pas tellement changé depuis la fin de la seconde guerre
mondiale : bonne tenue, langage approprié, respect de la discipline et de la hiérarchie, mise en
valeur du travail effectué sur le terrain, et avec professionnalisme… Cela n’empêche pas de
faire apparaître, surtout dans les bandes sons des interviews, que telle unité a rencontré telle
difficulté. Enfin, l’armée exerce une forme de contrôle sur les images qui sont produites.
110 Sorte de tourelle armée commandée à distance, le plus souvent à l’intérieur du véhicule qui la porte. 111 MERCHET, Jean-Dominique, Op. Cit., p. 119. 112 Entretien avec l’adjudant Larue, Op. Cit. 113 DANEY, Jean-Daniel (Cne), p. 8.
46
L’une des règles de la communication est, en définitive, la maîtrise de la chaîne de
communication.
2.3.2. Pratiques autonomes des reporters
Mais toutes les images ne se résument pas à des œuvres de communication : Où ranger
dans ce cas les images de combat ? Et les moments de fête, de sociabilité, de vie quotidienne ?
Certaines images ne se placent que mal aisément dans cette définition restreinte. Sinon, s’ils
n’avaient que ce but en tête, certaines cassettes ne seraient pas non plus « retirées » : si elles
ne sont pas visionnables, c’est bien qu’elles ne sont pas faites pour servir à la communication.
Or elles ont bien été tournées ! C’est parce que les équipes de l’ECPAD ne se limitent pas à
l’aspect communicationnel. Ses hommes ont même une plus haute idée de leur métier. Pour
une grande partie d’entre elles, les opérateurs parlent plutôt d’images tournées de manière
autonome, sans lien immédiat, hiérarchisé, avec le commandement. Il s’agit d’un « devoir de
mémoire » pour l’Adjudant-chef Marcès, de « témoignage » pour l’adjudant Larue.
Il existe une forme de libre initiative des reporters, soucieux de couvrir au maximum
non seulement les opérations qui font l’actualité, mais aussi le quotidien et les conditions de
vie des soldats français. Parfois ceux-ci font l’objet de sujets de communication précis – la
boulangerie de campagne, l’installation des tentes dans lesquelles dorment les soldats,
quelques images où on les voit au téléphone avec la famille, au pays. Et puis il y a les « belles
images ». Toutes sortes de réalisations difficilement classables, où l’on voit les paysages, les
hommes, les Afghans. C’est le soldat qui se rase au dessus du moteur114. C’est le soldat qui
fait une tour Eiffel avec de vieilles roquettes.115 Ces images qui ne semblent pas, à première
vue, répondre à des canons de communication, sont mises en valeur par la suite lorsqu’elles
sont mises en ligne. Elles sont, à elles seules, porteuses de sens. La première situe très bien le
lieu et le contexte rustique de l’opération, et pourtant, en exécutant une activité des plus
banales, se raser, le soldat montre que la normalité de la vie continue. La seconde est une
forme d’hommage au pays, avec la figure très représentative de la Tour Eiffel, tout en
rappelant, avec les roquettes employées pour sa maquette, le contexte guerrier de l’opération.
L’arrière plan expose les montagnes enneigées, les tentes du campement… Et le sourire des
deux soldats, tout comme la maquette elle-même, nous invite au comique. C’est un côté 114 Référence N2001-0017 ; mis en ligne sur le site ecpad.fr sous la titre « Afghanistan 2001 ». 115 Idem, référence N2009-0100.
47
décalé de la vie en opération extérieure, qui brise le cliché, prend la représentation guerrière à
contre-sens.
Par amour de la « belle image », les reporters sont friands de ce genre de clichés. Les
opérateurs vont filmer le quotidien de ces hommes, sans quoi ils cessent d’apparaître comme
humains. Les images de l’ECPAD sont pensées à taille humaine : la plupart d’entre elles
placent un individu dans le champs. Même si un certain nombre de codes interdisent qu’ils
soient filmés contrairement aux bonnes tenues, des images s’efforcent de titiller cette ligne
pour donner un aperçu de la vie humaine sur le théâtre. Dans les moments d’action, l’ECPAD
filme. Une fois le moment passé, le caméraman et son officier image se dirigent vers des
soldats ou des officiers, pour faire quelques interviews, recueillir leurs impressions, à chaud.
Le 31 juillet 2008, par exemple, juste après un accrochage violent subi par des soldats
français – le 8e RPIMa, en vallée de Tagab – le SIRPA Terre recueille les explications de
l’officier116. Pendant l’action, on entend les commentaires des soldats. La meilleure illustration
de ce comportement nous a été fournie par les images de l’adjudant-chef Marcès, lors de son
séjour en 2007, au cœur des OMLT. Une nuit du 6 novembre 2007, l’équipe OMLT 2 que
suivent le capitaine Daney et l’adjudant-chef Marcès partent en QRF (Quick Reaction
Force)117, manifestement au profit d’américains. Au retour, les véhicules de l’armée française
sont la cible de tirs nourris, à la mitrailleuse PKM et même au lance-roquettes RPG. La salve
n’est pas filmée, le caméraman tourne lorsque le convoi s’arrête un peu plus loin. Les
hommes descendent, inspectent le véhicule. Ils constatent les impacts de gros calibre. Ils y
vont chacun de leur commentaire, tous recueillis alors par l’opérateur118. Enfin, les reporters
essaient de faire la part belle aux Afghans et à leur pays, cherchant à ne pas rester uniquement
limité aux forces françaises. « Dans les choses qu'on adore faire aussi dans notre travail, c'est
montrer la culture locale. » explique l’adjudant Larue. Le « couleur locale », c’est à la fois un
plaisir et un impératif pour les reporters.
« Et c'est aussi hyper important. On ne peut pas faire de montage si au delà des images des militaires français sur place, on ne montre pas le pays, ses habitants, sa culture. C'est humain. Tous autant qu'on est, on adore l'humain. L'humain ça ne trompe pas. C'est la vie courante. J'adore ces séquences là. […] L'Afghanistan, les premières années on avait cet humain là, local. On allait boire le thé avec les gens. On s'enrichissait de leur culture, en discutant avec ces gens j'ai appris plein de choses. Le problème, c'est que maintenant avec toutes ces tensions, avec les attentats, les pièges sur les routes, les embuscades, de
116 Référence REV2008-SITER-002, TC 10 :30. Reversement à l’ECPAD des archives du SIRPA Terre. 117 La QRF est une mission d’assistance d’urgence assurée par roulement. 118 Référence 07.9.177, cassette n°10, TC 13 :42 à TC 19 :23.
48
plus en plus on se coupe de la population. Rentrer dans une maison, c'est risqué pour nous et pour eux. Cet enrichissement que j'adore, et beaucoup ici sont dans mon cas, on l'a un peu perdu. » 119
Depuis 2008, la crainte et la suspicion ont rendu presque impossibles ces rencontres.
De fait, il nous faut interroger les images pour vérifier à quel moment les Afghans « sortent
du champ » des photos.
2.3.3. Penser le reportage en opération extérieure
On comprend donc quelle est la mission demandée aux reporters. Mais la
représentation qu’ils ont de leur métier dépasse cette mission. Les reporters font effectivement
bien plus que ce qui leur est demandé. Ils pourraient se limiter à des photos sur les patrouilles,
les cérémonies, les actions… Non, ils vont aussi photographier des soldats dans leur vie
quotidienne, qui se rasent dans le rétroviseur d’un camion ou prennent leur douche en plein
air et vont à la rencontre des Afghans. On pourrait être en droit d’interroger finalement
l’intérêt de telles photographies et de tels films à court terme. Dans son mémoire intitulé bien
à propos « Les actualités d’aujourd’hui seront les archives de demain », le capitaine Daney
revient sur la « mission du devoir de mémoire » des reporters :
« Après leur exploitation, toutes ces images sont destinées à enrichir le fonds d’archives national. (…) La matière audiovisuelle captée dans les conflits modernes rejoindra donc les images originelles des Poilus conservées précieusement depuis près de 100 ans. Elles feront partie de l’héritage à léguer aux générations futures, à l’instar de ce que la génération actuelle a pu recevoir. (…) Le travail des équipes de l’ECPAD revêt au final deux volets. L’un est la captation d’images pour une exploitation immédiate au service des forces et de la communication opérationnelle, l’autre le reversement de ces mêmes images au service des archives pour constituer au fil des missions la composante « Images » de notre devoir de mémoire. »120
Toutes ces images produites librement, s’ajoutant à celles qui ont produit pour les
besoins de communication, s’ajoutent naturellement aux archives. A chaque nouvelle
opération, un nouveau fond se constitue. Ainsi, au fur et à mesure de leur travail, les archives
s’enrichissent de nouvelles images : les reporters en sont conscients. Que les reporters
connaissent le destin de leurs images explique l’idée qu’ils se font de leur métier. A
« l’exploitation immédiate » répond le « devoir de mémoire ». Sur les images qui sortent du
119 Entretien avec l’adjudant Vincent Larue, janvier 2012. 120 DANEY, Jean-Daniel (Cne), Op. Cit. , p. 9.
49
champ de la communication, toutes ces nombreuses images qui ne font pas référence à un
événement particulier, nous demandions l’avis de l’adjudant-chef Jannick Marcès.
« J’en suis convaincu, c'est des images qui vont prendre un charme énorme en vieillissant. Prenons les poilus. Les images des poilus dans les tranchées, on les a vu, on les voit à chaque 11-novembre. Ce qu'on voit beaucoup moins, c'est la vie courante. Je peux t'assurer, va voir les fonds d'archives, voir la vie courante des poilus dans les tranchées, ça a un charme incroyable ces images en vieillissant. Voir le petit gars qui est avec ses bandes au mollet, en train d'écrire ses lettres dans la tranchée, moi j'adore ces images là. Je trouve ça très sympa. […] Moi j'aime bien : c'est humain, profondément humain. C'est rustique, il faut le montrer. J'ai pris des douches en Afrique avec vue sur les étoiles, le pommeau c'était relié à un sceau, je trouve ça drôle. Quand je le vis, je trouve ça drôle, ça peut l'être de le montrer aux gens aussi […] »121
Il est remarquable que l’exemple des Poilus leur revienne en tête. Cela entre en
cohérence avec ce que nous disions de la structure institutionnelle de l’ECPAD122 : les
reporters du vingt-et-unième siècle se vivent comme les héritiers des pionniers de la Grande
guerre, ils estiment avoir leur même devoir à remplir vis-à-vis des générations futures. En
définitive, ils se considèrent comme des témoins. Certains ont l’idée de fabriquer des preuves,
presque tous pensent qu’il s’agit surtout de sauvegarder de l’oubli les actions de l’armée
française. A l’adjudant Larue, nous lui demandions « quels sont les meilleures images que
vous avez produites ? » :
« C'est pas pour moi, mais pas rapport à ces gens, cette énergie, ce sacrifice, ce dépassement de soi, ce sont des choses qu'on ressent, ces échanges, on participe à des choses qui sont très fortes. […] Après, ce sont des instants intenses, je ne dis pas sublimes, je ne dis pas magnifiques, mais ce sont des instants forts en émotion. Oui, t'es témoin de ça. Tu as la chance d'avoir une caméra ou un appareil photo. Si tu as bien fait ton travail, tu as la chance de te faire la petite souris et de réussir à capter ces petites expressions, ces petits échanges, de faire passer de l'émotion, de l'intensité, aux gens qui vont regarder les photos après. »123
La « mission du devoir de mémoire », qui tient cher à l’ECPAD comme entité autant
qu’aux reporters comme individus, est un devoir rendu de deux côtés. En effet, si il mentionne
les « gens qui vont regarder les photos après » - et sans idée de savoir qui -, il parle aussi de
ceux qu’il prend en photo. Ceux qui, d’une manière ou d’une autre, font sacrifice d’eux même
pour remplir la mission militaire. Les reporters pensent leur métier en fonction de ces deux
121 Entretien avec l’adjudant-chef Jannick Marcès, janvier 2012. 122 Chapitre 1, 1.2.2 Quel public ? 123 Entretien avec l’adjudant Vincent Larue, janvier 2012.
50
personnes, qu’ils se chargent de mettre en relation. Ce qui revient à les définir, en fin de
compte, comme des témoins.
Les reporters de l’ECPAD sont des hommes du monde militaire qui en connaissent les
usages et les impératifs. Ils s’organisent de manière à pouvoir se fondre au milieu des
hommes qui effectuent leur mandat en Afghanistan, et remplissent des missions de
communication au profit des armées sur le terrain. Toutefois, la façon dont ils pensent leur
métier dépasse ce simple cadre de communication et se rattache au devoir de mémoire qui,
pour l’établissement, est une priorité, celle-ci résumant sa fonction et son histoire. Retenons
que l’Afghanistan a impacté les hommes et leurs pratiques. Le contexte qui est allé en se
dégradant a rendu les conditions de travail de plus en plus difficiles, en raison des mesures de
sécurité appliquées à partir de la résurgence des tensions, en 2006. Elle a aussi tendu le
rapport que doivent entretenir les reporters avec les soldats, fait de confiance acquise, et non
pas assurée.
Dans leurs pratiques, les reporters ont à cœur de mettre en valeur le travail de l’armée
française. Cela obéit à leur mission, c’est un devoir qu’ils remplissent. Par les multiples
reportages, accompagnés d’interviews, ils sont la cheville ouvrière de la communication en
Afghanistan. Les images qu’ils ont produites sont donc diverses et nombreuses. Le corpus
qu’ils nous transmettent est un ensemble auquel il faut apposer des critères de lecture pour lui
donner de la lisibilité, le mettre en cohérence et lui rendre sens. Nous avons maintenant bâti
une idée du comment et du pourquoi, nous reconnaissons toutefois l’approche très subjective
de cette partie de notre raisonnement. Elle dépend de la vision qu’ont les reporters de leur
métier, et repose beaucoup sur leurs propres témoignages. Le biais serait d’ignorer les autres
représentations que nous n’avons pas rencontré. Il faut toutefois rappeler que, parmi nos
témoins, les visions que nous avons présentées font l’unanimité.
Comprendre leurs pratiques et la manière dont ils entendent mener leur mission nous
ouvre en tout cas la compréhension des images sans naïveté, sans extrapolation. Au contraire,
pour diriger le travail historique, ces sources ont besoin d’une méthodologie rigoureuse.
51
Chapitre 3. Des sources audiovisuelles pour l’historien
Nous avons parlé de l’établissement, nous avons parlé des hommes : nous devons
maintenant parler des images. Comprendre l’image qui est ou sera transmise de l’Afghanistan
par l’ECPAD implique d’adopter une méthodologie particulière et rigoureuse. Bien sûr,
jusqu’à maintenant, nous avons mobilisé des images, des légendes d’images et des entretiens
avec des opérateurs. Produire un discours historique nécessite des sources : naturellement,
dans notre énoncé, nous n’avons pas manqué, d’ores et déjà, de les employer à cet effet. Mais
la méthodologie ne pouvait venir qu’au terme du raisonnement qui présentait d’abord
l’histoire de l’ECPAD et l’identité de ses reporters. En effet, c’est ce qui permet de préciser la
nature et le contexte de production des images, deux éléments indispensables pour élaborer
une méthode de travail. Il n’est d’ailleurs pas question d’établir ici un traité technique, qui ne
serait pas à sa place, mais plutôt d’interroger la méthode, de la mettre au cœur de notre
réflexion, pour comprendre ce que les images peuvent nous transmettre de traces intelligibles
en histoire. Nous savons que le travail de l’Etablissement revêt deux volets : communication
et mémoire ; travail rempli par le personnel sur le terrain, dont la mission et la pensée entre en
résonance de ces objectifs. Mais des images, à elles seules, ne suffisent pas pour
communiquer ou établir une mémoire. Le résultat escompté étant immatériel, l’un et l’autre
sont des constructions de l’esprit. L’image est un support à une représentation, fournit en
quelque sorte des repères à la construction d’un imaginaire. La photographie ne suffit pas
pour faire sens, ce n’est le cas que quand elle s’accompagne d’un schéma mental. Renversons
la proposition ; il y a une représentation des évènements, et les images deviennent des preuves
appuyant cette représentation. C’est tout le sens d’une mémoire. Les Français sont en
Afghanistan et forment l’armée afghane, entretiennent des rapports cordiaux et respectueux
avec les civils, sont des soldats professionnels qui s’accordent sur le terrain avec leurs alliés,
qui utilisent un matériel perfectionné. Des images viennent attester de cette vision. Elles
l’accompagnent et la concrétisent en lui donnant un contenu. L’idée, ici, est de comprendre
comment s’émanciper des buts recherchés par la Défense, tels que nous les avons présentés,
pour lire les images en historiens. Confirment-elles de tels buts ? Ou, au contraire,
retranscrivent-elles fidèlement la dynamique de l’histoire ? Nous ne pensons pas que les
images de l’ECPAD déforment la réalité, bien au contraire. Elle présente une réalité. Lorsque
l’on regarde la télévision, en France, le journal télévisé nous présente une réalité – qui a tort
de se prétendre objective – correspondant à certains canons culturels. A des lieux et des
52
époques différents, les faits ne sont pas présentés de la même manière. C’est pourquoi il est
nécessaire de présenter ici notre méthode : d’abord en présentant les particularités des images
de l’ECPAD, ensuite en démontrant que l’audiovisuel peut faire sens, et, enfin, en proposant
une méthode particulière et adaptée d’analyse de ces images.
3.1. Particularités des images de l’ECPAD
3.1.1. Un corpus important
Le nombre des archives photographiques et filmiques de l’ECPAD concernant
l’Afghanistan est très important. Cela représente un défi que de toutes les consulter. À la vue
de ce nombre, plusieurs remarques s’imposent.
Les notices photos renseignent toujours le nombre de clichés qu’elles contiennent. Ce
chiffre fait apparaître le total reversé par le photographe aux archives. Une notice peut
contenir entre quelques centaines et plus d’un millier de photos. Pour l’année 2002, la notice
photo que nous consultons contient 976 photos124, et le chiffre grimpe à 1410 pour l’année
2003125 ! Mais nous avons vite constaté une différence entre le nombre affiché et le nombre de
clichés réellement consultables, c’est-à-dire les photos à disposition du chercheur, que ce soit
dans l’album photo ou sur le poste informatique de consultation, à la médiathèque de
l’ECPAD126. D’où vient cette différence, qui évacue parfois plusieurs centaines de photos ?
Certaines ne sont pas visibles, ce pour des raisons techniques : simplement, elles ont été
ratées. D’autres sont en attente de validation par l’Etat-major des armées, ou ont été
volontairement retirées du visionnage. Sujet trop sensible, présence sur la photo de forces
spéciales, d’un traducteur afghan, de renseignements opérationnels : toutes ces raisons
expliquent, sans être exhaustives, ces restrictions. Ce sont les mêmes raisons, et les mêmes
effets, que pour la vidéo : quelquefois la légende explique cette rature, plus souvent un certain
flou entoure cette mise à l’écart. Mais il faut aussi savoir que des photos ont été écartées par
l’iconographe, qui prépare le reportage à son reversement, avant le traitement par le
124 Fonds Opération extérieures. Reportage 01 2002 036. 125 Reportage N2003-111. 126 Presque toutes les photos que nous avons consultées sont au format numérique, à l’exception de la référence
01 2002 036.
53
documentaliste, qui le renseigne127. Il enlève les doublons, fréquents et ce d’autant plus avec le
passage aux appareils numériques, retire les photos ratées. Gageons que pour celles-ci, c’est
un mal pour un bien : on y gagne en confort et en rapidité. Mais il faut retenir cette légère
amertume : de l’appareil du reporter photographe à notre poste de consultation, il y a déjà eu
un premier tri. Ce tri est inévitable, en certains cas esthétiques et techniques.
Toutes les archives vidéo ne sont pas non plus consultables sur l’Afghanistan, et pour
les mêmes raisons : présence des forces spéciales, d’un traducteur afghan, interdiction
formulée par l’Etat-major des armées… Quelques exemples. Le reportage de mars à mai 2002
a vu trois cassettes mises à l’index pour raison « confidentiel santé »128. En 2005, les notices se
référant aux missions des forces spéciales – théoriquement, dans la région de Kandahar – sont
classées confidentielles129. Sur cette année, on doit se contenter de cassettes concernant les
missions de l’armée de l’air depuis Douchanbé, au Tadjikistan voisin, et quelques cassettes
sur Kaboul130. En 2007, le reportage de mars à mai voit quatre de ses cassettes retirées. Trois
ont été récupérées par le Commandement des Opérations Spéciales (COS)131. Encore en a-t-on
l’explication. Parfois, des cassettes sont inscrites « manquantes », sur la notice qui
accompagne le reportage. En 2008, trois cassettes manquent pour le reportage de juillet à
septembre132. Dans le cas de reversement – des dons, par exemple – certaines cassettes ne sont
pas versées aux archives. Sans feuille de dérushage correspondante, on ne sait pas ce qui
manque. Dans la plupart des cas, ces retraits ne concernent qu’une minorité de cassettes et ne
changent peut être rien au tableau d’ensemble. Mais, pour l’année 2005, c’est, en soi, un vrai
problème : il est difficile dans ces conditions de comprendre l’activité des forces françaises
sur l’année. Les actions des forces spéciales modifient sans doute lourdement l’image d’une
armée française, qui avant 2007, est restreinte à Kaboul, construite sur un petit contingent, et
limitée à des missions qui ne concernent pas d’éventuels accrochages avec « l’ennemi ». Sans
ces sources, mais sachant qu’elles existent, il est impératif de garder à l’esprit que l’armée
française est aussi intervenue dans des régions plus compliquées, comme le sud,
127 C’est l’explication donnée par le personnel de la médiathèque du Fort d’Ivry, après notre étonnement suite à
cette différence de quantité. 128 Référence 02.9.32, cassettes 18, 26 et 27. 129 Références 05.9.151 et 152, respectivement « mission en Afghanistan » et « Mission ARES 6 ». 130 Référence 05.9.97. 131 Référence 07.9.21, cassettes n° 47, 57, 58 et 59. 132 Référence 08.9.145, cassettes n°1, 18 et 19.
54
probablement pour des opérations de combat. Ce qui pourrait pondérer toute conclusion sur
l’empreinte française en Afghanistan avant 2007.
Mais ces manques n’invalident pas pour autant nos conclusions d’historiens, basées
pour bonne part sur une analyse approfondie des images. A peine gâche-t-il la sensation de
travailler sur des matériaux « brut de décoffrage ». Prise isolément, chaque photo conserve
son degré d’informations, traduisibles en discours et analyses historiques. De plus, ces
biffures ne concernent qu’une petite partie de toutes les photos et vidéos. Sur le total, la
proportion peut varier entre 5 et 15%, plus souvent moins. Et de ce total, nous sommes en
mesure de remarquer des évolutions pertinentes, sur la période allant de 2002 à 2008. Mais ce
corpus d’images n’est véritablement lisible qu’à condition de l’envisager dans toute sa
complexité, c’est-à-dire de comprendre les informations qu’il peut nous transmettre. L’image,
seule, ne suffit pas : il faut croiser les sources.
3.1.2. Plusieurs niveaux de sources
Après ces premières remarques, constatons en effet qu’une image ne peut
raisonnablement pas s’exploiter toute seule. Les photos, en règle générale, sont toujours
accompagnées d’une légende. Elle est indispensable. La légende situe la photo dans l’espace
et le temps, elle indique qui apparaît à l’écran, décrit l’action qui se déroule. Généralement,
une légende accompagne une série de deux à dix clichés environ, sans doute pour eux comme
pour nous plus commode qu’une légende photo par photo. Ainsi, peut-on lire «Planche 01,
photos 01 à 11 : Le 12 janvier, à l'occasion d'une reconnaissance des abords de l'aéroport de
Kaboul, une patrouille du 21e RIMa composée de sous-officiers NEDEX133 du 17e
Régiment du génie parachutiste découvrent un très important stock de munitions dans un
dépôt gardé par l'Alliance du Nord. »134 Ici, la légende nous dit précisément, qui, quoi, quand
et où. La seule lecture de la photo est loin de suffire à fournir ces informations. A l’image, on
voit effectivement un groupe de militaires français penchés sur un ensemble de munitions en
mauvais état. Mais, on ne connaît pas le lieu ou la date. La légende nous indique que le dépôt
est gardé par l’Alliance du Nord – l’association des partisans de Massoud ou de Dostom
contre le régime des talibans. Si les armes leur appartiennent, ou s’il s’agit d’anciennes armes
soviétiques, nous n’en savons rien. On sait toutefois que l’équipe de déminage et de 133 NEDEX : équipe de neutralisation, enlèvement et destruction d'explosif. 134 Légende de la première planche, référence 01 2002 036.
55
dépollution vient certainement pour détruire ces munitions. La photo donne elle une idée
précise de l’équipement des hommes qui interviennent – alors assez léger – et de la quantité
de munitions ou sous-munitions présentes en Afghanistan en 2001 : extrêmement
nombreuses. N’étant pas un expert, retrouver sans la légende les quelques informations citées
plus haut relève de la gageure. L’iconographe de l’ECPAD135 nous explique l’importance de
son travail :
« Quand la personne du pôle archive va créer la notice, il a besoin du contexte pour inscrire les mots clefs, et faire en sorte que les personnes qui viennent consulter puissent retrouver les images. La valorisation des images est importante : dans le temps, si le légendage n’est pas fait, c’est comme si l’image n’existait pas. Mais, en tant qu’iconographe, mon travail est de mettre en valeur les images pour l’année prochaine, pour vingt ou trente ans. »
« C’est comme si l’image n’existait pas ». Parce que la légende permet aussi d’inscrire
une traçabilité. Dans le stock d’images, retrouver celles qui concernent tel ou tel régiment,
opérant dans tel lieu et à tel moment, voir retrouver les photos d’un officier en particulier ;
sans la légende, c’est impossible. Le traitement informatique rend la recherche plus rapide,
plus efficace. La légende est donc la carte d’identité de la photo. Il s’agit du même cas de
figure quand on travaille sur des vidéos. La légende est à la photo ce que la feuille de
dérushage est à la vidéo, un impératif essentiel : « Aucune image non classée ou non
clairement identifiée ne saurait être reversée au service des archives de l’établissement »136. La
feuille de dérushage se présente de diverses manières. Les informations se réduisent au nom
de l’opérateur, aux lieux filmés, aux dates. Un tableau ou une liste décrit succinctement les
évènements à l’écran, en précisant les noms propres pour les interviews, renseigne le nom du
régiment, l’action entreprise. Toute information nécessaire pour comprendre l’image. Elle
précise ainsi s’il s’agit d’une patrouille, d’un déminage, d’un moment de vie quotidienne…
La feuille de dérushage précise, à côté de ces descriptions, le time code (noté « TC ») qui
indique le moment sur la bande auquel la description fait référence. La feuille de dérushage
revêt la même importance que la légende. En pratique, elle sert de base au documentaliste
pour établir la notice, sur laquelle sont compilées toutes les informations. Sans y faire
référence toujours de manière explicite, nous y trouvons donc tous les éléments de contexte
nécessaires. 135 Iconographe rencontré lors de l’entretien avec les photographes de l’ECPAD, le 10 janvier 2011. Il ne nous a
pas transmis son nom. 136 DANEY, Jean-Daniel, Ibid.
56
S’ajoute enfin une part importante d’oral. Dans le domaine d’étude des représentations
auquel notre exposé se rattache, les sources orales fournissent des éléments de réponse non
négligeables. Il est toutefois important de préciser qui sont les reporters que nous avons
rencontré et sur quels critères. La source orale introduit en effet une part importante de
subjectivité à laquelle il convient de ne pas être soumis. D’une part, les souvenirs et les
impressions des reporters font écho à leurs propres personnalités. Chacun voit et pense les
choses à sa manière. Eux même, d’ailleurs, avouent ne parler qu’en leur nom. Jamais ils n’ont
prétendu parler dans l’absolu, mais toujours au regard de leurs expériences personnelles. Ils
ne sont pas figés dans une conception monolithique de leur travail en général, et de
l’Afghanistan en particulier ; ainsi, par exemple, certains souhaitent y retourner, d’autres ne
préféreraient pas. Nous avons mené quatre entretiens : un premier en 2011137, et trois en
janvier 2012. Successivement, nous avons rencontré le sergent Jean-François d’Arcangues,
photographe, parti pour la première fois en Afghanistan 2009, une seconde fois en 2010 ;
l’adjudant-chef Jannick Marcès, initialement photographe puis caméraman, parti en 2002,
2005 et 2007 ; l’adjudant Vincent Larue, même parcours, parti lui en 2007 et 2008 ; et le
capitaine Jean-Daniel Daney, officier images, parti en 2007 sur la même mission que Jannick
Marcès, puis deux fois en 2009 et une fois en 2010. Nous avions choisi d’entendre chaque
spécialiste de l’équipe image – photographe, caméraman, officier. De plus, nous voulions
rencontrer des reporters qui avaient été sur le terrain avant 2008, et si possible, qui avaient
aussi connu le début des opérations. L’adjudant Vincent Larue connaît l’Afghanistan pour y
avoir été avec le renseignement, dès 2002. C’est d’ailleurs en Afghanistan qu’il avoue avoir
fait connaissance avec l’ECPAD. L’adjudant-chef Marcès a traversé toute notre chronologie.
Seul le sergent d’Arcangues est un peu « hors-période ». Ils ont donc pu présenter une vision
« d’ensemble » et apportent un double témoignage : comme hommes d’image, d’abord, ils
nous ont expliqué leurs pratiques138 ; comme militaires et participant, ensuite, pour raconter
leur métier sur le théâtre particulier de l’Afghanistan. Nous savons bien que la représentation
qu’ils en ont aujourd’hui est un souvenir, un peu déformé par le temps – et les entretiens ayant
duré en moyenne deux heures, il eût été difficile, pour eux, de tout y résumer. Ils nous livrent
nécessairement un témoignage qui est à la fois partial et partiel : nous en sommes conscients.
Or ils ont été capables de nous présenter l’Afghanistan tel qu’ils l’ont vu et tel qu’ils ont
voulu le représenter : c’est ce qui nous intéresse. Un mot enfin sur la façon dont nous avons
137 Initialement, ce premier entretien avait pour but de jeter les bases de notre travail de Master 1. 138 C’est pourquoi les entretiens nous ont été d’une utilité précieuse au second chapitre.
57
mené les entretiens. Nous n’avons pas utilisé de « questionnaire », constatant en fait
rapidement qu’il était très difficile de s’y tenir. L’angle de l’entretien était par contre à peu
près toujours le même ; recevoir leurs impressions sur les différences entre l’Afghanistan de
2002 ou 2003, au début du mandat, et l’Afghanistan de 2007 et 2008. Cette question nous
permet de vérifier ce qui apparaît déjà dans l’analyse des images. Et c’est aussi une formule
qui permet de centrer la discussion sur les impressions. Cheminant ensuite à travers des
exemples concrets, et notamment sur Uzbeen ou les OMLT, nous voulions apprécier la
double dimension de leur témoignage : les pratiques spécifiques aux reporters et la maîtrise de
leurs images, mais aussi le ressenti personnel par rapport au contexte afghan. Ce sont les deux
aspects qui conditionnent la production d’images. D’une part, la manière dont ils tournent et
dont ils sont formés, ensuite la façon dont ils ont perçu l’Afghanistan139. Aux images et leurs
légendes, les sources orales viennent en complément. On ne saurait ainsi regarder ces
différents niveaux de sources comme autrement que complémentaires.
La source se décompose en plusieurs niveaux de lecture : l’image, la légende, le vécu
du reporter. Il y a donc trois degrés, l’audiovisuel, l’écrit, l’oral. Le premier et la seconde sont
fournis aussitôt, la troisième est construite a posteriori par les besoins du chercheur. L’écrit
identifie l’image, l’oral l’explique. On ne pouvait guère comprendre les images sans
considérer la mentalité des reporters. Sur ces hommes, nous avons déjà écrit, et ces entretiens
nous ont, en premier lieu, servi à bâtir une réflexion sur l’identité des reporters de guerre de
l’ECPAD. Mais les récits qu’ils nous ont faits appuient considérablement notre
compréhension des archives, c’est pourquoi l’analyse de l’image se fait aussi avec le renfort
de citations venues de ces entretiens. Ces expériences donnent une toile de fond. Elles
permettent aussi de mieux cerner des images qui se distinguent des autres sources
audiovisuelles disponibles.
3.1.3. Des images réelles ?
L’ECPAD réalise et produit des films qui entretiennent des différences tangibles avec
les films grand public, les images des journalistes, les films des Afghans eux-même. Il
convient ici de mettre en rapport ces images disponibles pour qu’en ressorte in fine la
particularité de celles de la Défense. Il ne s’agit pas de « productions » au sens strict du terme,
139 Les entretiens sont reproduits en Annexes.
58
mais de matériaux bruts, de rushes et de photos, mis bout à bout, sans qu’une plume ne soit
venue y mettre la cohérence d’un récit. De plus, contrairement aux productions du cinéma, les
films de l’ECPAD ne sont pas des fictions mais bien des images tournées dans la réalité.
Autrement dit, devant la caméra, il n’y a pas d’acteurs, mais des personnes qui participent à
un moment historique. L’image vient en saisir un instantané. Des films de fictions ont déjà
servis d’objets de thèse140. Prenons l’exemple de la thèse de François Garçon141, qui s’intéresse
au cinéma français de 1936 à 1945142. Son plan s’articule de la manière suivante : après avoir
analysé les structures de l’industrie cinématographique française et l’impact de l’occupation
sur ses acteurs et ses publics, il entreprend une analyse des films en cherchant à y déceler les
traces du discours collaborationniste de Pétain. Ses chapitres prennent ainsi les titres du
triptyque pétainiste, Travail, Famille, Patrie. Après avoir analysé à partir des archives la
composition sociologique et économique du cinéma, il va chercher dans ses productions les
traces de l’imaginaire officiel. Il résume son travail par cette formule : « reconstruire
l’horizon mental d’une profession artistique soumise à des contraintes comme aucun autre
métier de création n’en subit alors ». Les images de l’ECPAD peuvent subir pareille analyse
et le lecteur ne manquera pas de remarquer la similarité de plan que nous avons adopté. La
comparaison pourrait être fructueuse : les images de M. Garçon sont issus de la production de
fictions, mais jusqu’à quel point les images de l’ECPAD appartiennent au « réel » ? Prenons,
arbitrairement, trois critères pour définir des images de fiction : des acteurs qui jouent un rôle,
un scénario écrit à l’avance, une mise en scène qui incombe au réalisateur. Sur le premier
point, il est clair que les hommes filmés ne sont pas des acteurs. Le second est déjà moins
évident : s’il n’y a pas d’écriture, la communication définit, on l’a vu, des postures, des sujets,
qui sont ordonnés depuis une hiérarchie. Concernant la mise en scène, on ne peut pas dire
qu’elle s’applique à toutes les images, mais est-elle complètement absente ? Par exemple, en
2004, un soldat français est filmé par le SIRPA Terre, il tient un fusil de précision, observant
dans le viseur de son arme, assis à côté d’un camarade qui porte les jumelles. On ne sait guère
140 En partenariat avec l’INA, l’université Paris I propose d’ailleurs un master recherche « histoire et
audiovisuel », représentant un courant qui connecte parfaitement l’audiovisuel comme source à l’histoire comme
discipline. 141 François Garçon est historien, maître de conférences à l’université Paris I après avoir obtenu un doctorat
d’histoire aux universités de Genève et d’Oxford. Il y dirige depuis 2006 le master Cinéma-Télévision-
Nouveaux Médias, qui incarne un peu sa double fibre universitaire et professionnel, François Garçon ayant
successivement travaillé à la direction du groupe Havas ou encore à Canal +. 142 François Garçon, De Blum à Pétain, Le cinéma du Front populaire à la Libération, Paris, Le Cerf, 1984.
59
ce qu’il vise ainsi. L’opérateur lui demande : « tu peux mettre ton doigt sur la détente ? »143,
comme pour simuler une situation de tir. Le soldat s’exécute. L’image, en gros plan, du soldat
qui met le doigt sur la détente est plutôt réussie. Mais c’est une mise en scène. De même pour
l’entraînement de soldats afghans, poussés à reproduire pour la caméra ce que le reporter les a
vu faire quelques minutes auparavant. Entre le moment où la scène se passe réellement, et le
moment où la caméra tourne, il y a un léger délai. En règle générale, observons que ces
remarques d’opérateur se font soit sur des critères de communication, soit sur des choix
esthétiques : l’angle de prise de vue, la lumière, l’arrière plan. Ce dernier a une certaine
importance : il sert de toile de fond, un général sera interviewé derrière son bureau, un homme
de terrain sera mis près d’un véhicule. Il essaie de prendre aussi le paysage afghan, qui se
prête bien. Ces considérations sont assez aléatoires et tout homme d’image réfléchit à la
« beauté » de son plan. C’est une démarche professionnelle. En revanche, pour collecter des
images assez diverses, comme le tireur d’élite qui ajuste une cible et pose son doigt sur la
détente, il est plus simple, plus facile, de prendre une image qui inclut une part de mise en
scène qu’une image où le tireur fait réellement usage de son arme – parce qu’être au bon
endroit au bon moment est aléatoire. « C'est difficile d'être au bon endroit quand il se passe
quelque chose. Il y a le facteur chance, il y a le facteur autorisation. »144 Pour toutes les
entraves qu’imposent l’Afghanistan, en terme de sécurité, de hiérarchie, de transport, filmer
l’action ne va pas de soi. L’adjectif « réel » est donc tout relatif : sans être une pure fiction, les
images de l’ECPAD obéissent à des impératifs techniques et communicationnels. Le réel ne
fonctionne pas comme un sceau qui vaudrait bon d’authenticité ; nous pensons qu’il vaut
mieux, au contraire, préciser comment l’image est construite, jusqu’à quel point elle est
façonnée par l’opérateur. Nous nous inscrivons dans le sillage de l’historien des
représentations Pierre Laborie. Un universitaire que Nicolas Offenstadt, enseignant
d’historiographie à Paris I, reprend ainsi :
« La matérialité et la « réalité » des faits, établies a posteriori par l’historien, compte moins dans la compréhension des comportements collectifs que la manière dont les hommes d’autrefois les ont vécus et perçus. Nécessaire à toute intelligence du passé, le détour par l’étude des prismes de l’imaginaire social, des systèmes de représentation collective et de leur sédimentation dans l’histoire s’avère un passage obligé parce qu’ils président aux lectures et à la réception des évènements par les contemporains. »145
143 Référence 04.9.168, cassette n°3, TC 23 :52. Images SIRPA Terre. 144 Entretien avec l’adjudant-chef Jannick Marcès, janvier 2012 145 OFFENSTADT, Nicolas (dir.), Les mots de l’historien, Toulouse : Presses universitaires du Mirail, 2006. P.
96.
60
La frontière entre fiction et réalité est mince, mais l’idée n’est pas de croire que ces
prismes aboutissent à une vision « fictionnelle » de l’histoire, comme s’il fallait l’opposer au
réel. Au contraire, il s’agit d’une analyse qui permet de mieux comprendre comment les
contemporains construisent une représentation de la réalité. Comment ils donnent à voir leur
vision du passé. Le fonds sur lequel nous travaillons a par ailleurs servi à quelques
productions : à ce moment là, le réalisateur a choisi dans un ensemble disponible les images
nécessaires à son documentaire, à son reportage. Ce choix mérite d’être interrogé dans la
mesure où les images participent d’un récit d’ensemble, lui même étant encore une fois une
vision de la réalité qui cherche à faire sens. En définitive, comme toute archive, l’image est
complètement dépendante de son contexte de production et de son auteur. Ce qu’il faut
interroger, c’est la réalité telle qu’elle est construite. Concernant la réception, seule une étude
bien postérieure à celle-ci aura toutefois les données pour l’analyser.
L’ECPAD n’est pas le premier, loin de là, à produire des images sur l’Afghanistan.
Bien d’autres pistes existent. Le fonds Massoud de l’INA (Institut national de l’audiovisuel),
que nous n’avons que trop rapidement exploré pour proposer une analyse pertinente, contient
près de 460 films. Il illustre la vie de la résistance afghane des troupes du commandant
Massoud, entre 1980 et 2001, date de sa mort. Le fonds contient aussi des images qu’a
continué à tourner l’équipe d’Ariana Films, son agence d’images, et certains films vont
jusqu’à 2005. Mais c’est un travail complet qu’il faudrait entreprendre. D’abord resituer ces
archives dans leur contexte et entreprendre une véritable classification afin de repérer plus
précisément les lieux et dates de production des images, parfois manquantes. Ensuite, mieux
comprendre la particularité de l’équipe Ariana. Qui sont-ils ? Quel est leur véritable rapport
avec Massoud ? Enfin, visionner et dérusher – c’est-à-dire noter les éléments visibles à
l’écran. Et c’est là probablement le travail le plus délicat : quand l’auteur n’a pas dérushé le
film, c’est comme une photo sans légende. Le document risque, malgré lui, de rester muet.
Qui plus est, la bande son est en dari, autrement dit, seule une oreille experte peut
honnêtement retranscrire les paroles des protagonistes. Bref, ce travail ne nous concernait pas.
Toutefois, l’existence de ces images nous a interpellé et il appartient à un patrimoine. Un
patrimoine mémoriel, qui sert les Afghans dans la reconstruction de leur imaginaire
collectif146. Les reporters de l’ECPAD, qui, sans être les seuls, leur succèdent en quelque sorte,
146 Les images du fonds Massoud sont conservées à l’INA, bibliothèque nationale de France. Elles ont été
numérisées par un partenariat entre le ministère de la Culture afghan et l’INA, entrepris depuis 2002. Par
61
ont, sans le savoir, continuer un travail en suivant une autre armée, d’une autre nationalité, à
une autre période. Ils obéissent d’ailleurs à la même logique mémorielle. Les images de
l’ECPAD ne sont pas si différentes que les autres parce qu’elles obéissent à des logiques
professionnelles similaires. La communication et le souci des « belles » images suggèrent
toujours une part de mise en scène. Les images afghanes montrent aussi que l’enjeu mémoriel
est voisin de la production d’images : Marc Ferro dit que les images sont « agent de
l’histoire » parce qu’elles deviennent des symboles tout en étant des sources.
3.2. Faire sens à partir de l’audiovisuel
3.2.1. Une archive nouvelle, source pour l’histoire
Les archives que nous exploitons sont neuves : de par leur caractère inédit, le fonds
Afghanistan de l’ECPAD étant encore non exploitée par des historiens ; de par leur nature
même, complexe et dynamique. L’image n’est cependant pas une source inconnue pour
l’histoire. Depuis les années 1970, les historiens du cinéma ont posé les premières pierres
d’une méthodologie pour faire l’histoire à partir d’images fixes ou mobiles. La naissance de
cette histoire a d’abord eu à cœur de se démarquer des esthètes, cinéphiles et sémiologues. Il a
fallu des pionniers comme Pierre Sorlin147, Marc Ferro ou François Garçon pour faire la
pédagogie de leur démarche : trouver du sens historique à un ensemble d’images, produites
dans une société donnée à un moment donné. Ce qui est loin de l’approche esthétique qui bâtit
son discours sur des repères essentiellement subjectifs. Le film ne se comprend pas, dans un
sens historique, en dehors de son contexte de production et de réception, c’est-à-dire des
éléments de sa fabrication comme l’analyse de son public. Il n’y a toutefois pas de modèle
absolu ; la méthode des historiens de l’image est la même que les autres historiens, chacun
étant conscient des biais introduits par ses sources, s’emploie à ancrer son discours dans les
limites qu’elles lui imposent. Nous avons décrit jusqu’ici les limites que nous avons ailleurs, des images afghanes ont été sauvées des destructions par des techniciens consciencieux qui en avaient
conservé des copies dans de faux murs. Beaucoup d’images afghanes sont donc encore disponibles. 147 L’article de SORLIN, Pierre, «Clio à l’écran ou l’historien dans le noir», Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 4-6/1974, pp. 252-278, fait office de référence dans le domaine de la méthodologie. Mais il
travaille à partir de sources fictionnelles. Nous saurons donc prendre une certaine autonomie par rapport à son
travail.
62
identifiées dans les archives de l’ECPAD. Mais quels sont les enseignements que peuvent
livrer les images ? Comment l’image devient une source ? A l’ensemble des représentations
construites ou en construction sur cette intervention en Afghanistan, les images peuvent
fournir un support. Mais elles contiennent aussi des traces inattendues d’informations
pertinentes. Nous n’avions pas anticipé que les rushes vidéo contenaient de longues
interviews détaillées qui interrogent les acteurs sur leurs missions. Certes, les interviews sont
utiles à toute réalisation. Montées dans un film, elles donnent au spectateur un interlocuteur
qui livre informations et ressenti. Mais aussi, par elles, beaucoup d'informations intéressantes
transitent jusqu'à nous. Elles nous mettent en contact avec des interlocuteurs sur le terrain,
questionnés sur leurs actions au moment précis où ils agissent. Ces réactions, bien souvent à
chaud, apportent une source historique fiable, directement exploitable. Quiconque voudrait
retranscrire les minutes d'interviews par écrit ferait un travail salutaire de constitution
d'archives. Travail salutaire peut être mais non dénué d'inconvénients : il serait long, d'abord,
et fastidieux. Ce serait aussi un peu défigurer l'interview vidéo, qui superpose aux mots les
expressions de visage, les répétitions, les injonctions du reporter qui guide son interlocuteur,
toutes choses utiles à décrire et qui conditionnent l'analyse même de l'interview. De ces
dernières, nous en avons recopié quelques unes. Surtout, nous avons extrait des citations, des
moments clefs, des postures. Elles permettent de voir quels sont les fameux « éléments de
langage » qui sont employés. « La communication en opération a pour but de transmettre des
informations justes, adaptées et utiles, susceptibles d’expliquer et de légitimer les actions de
la force »148. « Justes, adaptées et utiles », le trio signifie que les informations doivent être
vérifiables, données au bon moment et par la bonne personne. Il est considéré que seul celui
qui a l’autorité et la compétence pour répondre peut le faire, dans le cas inverse il renvoie son
interlocuteur vers une autorité plus légitime. En clair, la parole, dans la Grande Muette, est
une composante stratégique. Ce que nous entendons dans les films, via les réponses données
par les interlocuteurs aux interviews de l’ECPAD, obéit certainement à cette discipline.
Les historiens de l’image, joli paradoxe, accordent une grande importance au son.
Dans les images brutes, les rushes, le son qualifie la réalité. Un combat ? Les détonations, les
bruits sourds des obus et les claquements secs des balles rendent plus fidèlement que les
images, secouées, compliquées. Le son, c'est aussi le témoignage, c'est ce que nous avons dit
148 LIEUTENANT-COLONEL WINCKLER, « Vers Une Doctrine Des Forces Terrestres Pour La
Communication En Opération », Objectif Doctrine, décembre 1999.
.
63
de l'interview. Enfin, le son ce peut être une bande rajoutée au montage, des effets, de la
musique, qui habillent l'image et accentuent un certain sens qu'on a voulu lui donner. De
l'orage pour des séquences dramatiques, de la musique orientale pour parler de l'Afghanistan
mythifié, le son donne du rythme et participe à la construction du récit. C’est le son qui livre
l’information, l’image fait le support. Que dire alors des photographies ? Elles donnent un
sentiment, un instantané, transmettent une forme, assez fugace, de représentation figée, là où
le film décrit une action dans la durée. Il y a des moments que l’on devine avec les clichés, et
qui s'approfondissent avec le film. Les deux formats ne sont pas antagonistes, l’un après
l’autre, ils offrent un angle différent et sont complémentaires. La comparaison dans le temps
est plus facile avec la photo : l'Afghanistan photographié cent fois en dix ans fait mieux
apparaître les évolutions. C’est d’ailleurs en utilisant la photographie que des villes rasées des
bombardements ont été reconstruites telles qu’elles étaient avant-guerre. Les photographies
permettent de comparer une image à plusieurs moments dans le temps. Si on précise la focale
pour s’approcher de l'objectif, l’idée se fait plus précise, grâce au film, à un instant donné.
L’adjudant Vincent Larue explique la différence entre les deux médias pour un professionnel
sur le terrain :
« En photo, je me suis dit que par exemple c'est beaucoup plus complexe que la vidéo pour ces témoignages, ces expressions. La photo fige un instant. Le relationnel est là, tu peux saisir plus de choses (i.e. avec la vidéo). C'est deux types de médias, de vision. […] En vidéo, tu peux, de par le son, de par les échanges qui peuvent se produire, réussir à saisir plus de choses, plus de témoignages voilà. Ne serait-ce que ça. Un portrait c'est plus complexe. Un instant saisi c'est plus difficile, il faut plus de temps. »149
On voit bien le vocabulaire qu’il emploie pour définir ces différences. Il présente deux
perceptions du temps. L’idée de la durée n’est pas seulement retranscrite par l’animation à
l’écran, mais aussi par le témoignage animé. Le film devient donc une source en grande partie
par la bande son, et la photographie par l’instantané d’un moment, qui permet des
comparaisons chronologiques.
L’image pour l’histoire comporte deux volets. Le premier, absolu, est ce que l’image
nous transmet d’informations historiques. Ce que nous voyons dans les images et qui nous
renseigne. A ce titre elle est une source parce que l’archive audiovisuelle apporte des
éléments sur des évènements du passé : l’interview dans les films, les comparaisons des
photos, les faits présents à l’image. Le second, plus relatif, tient à ce que l’image en elle
149 Entretien avec l’adjudant Larue, janvier 2012.
64
même agit dans l’histoire. Par la communication, les enjeux de mémoire, parce qu’elle est
symbole, l’image joue un rôle. Et ce rôle aussi est une information historique. Ce sont ces
deux volets qu’il faut prendre en compte et analyser.
3.2.2. Sélectionner les images
Si l’audiovisuel peut faire source, quelle méthode adopter ? Les sources sont en grand
nombre. Pour éviter la confusion et permettre à la fois une analyse pertinente des films et des
comparaisons sur la durée, nous avons choisi de sélectionner quelques thèmes prépondérants.
Chacun de ces thèmes choisis permet, en respectant scrupuleusement notre objet, d’évacuer
des images qui ne correspondraient pas à notre travail. Pour autant, choisir ainsi, même
intelligemment, n’est-ce pas réduire le champ de notre étude, et donc introduire un biais qui
peut fausser les résultats ? D’une part, nous n’attendons de résultats que sur ces thèmes précis.
Ensuite, même si nous proposons une analyse de l’image que l’armée française renvoie d’elle
même, nous limitons bien sûr nos conclusions aux images qui ont été exploitées.
Quels sont ces thèmes ? Il s’agit de la vie quotidienne des soldats français, de la
population civile et la manière dont elle est approchée, de la formation de l’armée afghane, et
enfin des patrouilles, combats et mesures de sécurité. Ces quatre thèmes présentent l’avantage
d’être présents sur toute la période. L’idée est de remarquer les différences dans la manière de
les représenter et analyser cette représentation en miroir de l’évolution de la situation afghane.
Développons brièvement chacune d’entre elles. Les images de la vie quotidienne du bataillon
français concernent tout ce qui n’est pas inclus dans le métier du combattant et les devoirs du
militaire, tout ce qui regroupe les moments de vie tels que la correspondance avec la famille,
l’hygiène, la restauration, les loisirs. Ce sont les moments libres, sur place, en Afghanistan.
Les images de vie quotidienne revêtent une importance visuelle pour les reporters, parce
qu’ils considèrent que ce sont pas des images qui sont très montrées, à l’inverse des images de
patrouille ou de civils. A terme, ils considèrent qu’elles prennent beaucoup de valeur, en
vieillissant. « Ce n’est pas super enthousiasmant quand on le fait, il faut être honnête. Mais,
quand on est avec les gars, il faut le faire. Parce qu'ils aiment bien être pris dans des situations
de vie courante. »150 Prendre ces images plaît donc aussi aux troupes. Pourquoi ? D’abord,
« parce que cela fait partie de la mise en confiance », cette problématique de l’insertion des
150 Entretien avec l’adjudant-chef Jannick Marcès, janvier 2012.
65
reporters sur le terrain. Ensuite parce qu’ils considèrent qu’être pris en photo est important
pour témoigner de leurs conditions de vie. Ils sont souvent les premiers à les demander,
comme des cartes postales. Quel est, en revanche, pour nous, l’intérêt de ces cartes postales ?
La manière de représenter la vie sur place donne une idée de l’ambiance qui règne sur le
terrain. Et aussi de saisir l’évolution : le contingent français passe de 300 à plusieurs milliers
d’hommes. L’entretien et le support de tout ce personnel, ce que les militaires appellent
« soutien de l’homme », prend du coup une place de plus en plus importante avec toutes les
problématiques qui y sont liées : logistique, santé, construction de camp et lieux de vie pour
se reposer, etc. Le second thème, la manière dont sont approchés les civils, permet aussi de
saisir ces évolutions et le « climat » sur place. Cela permet de mesurer le degré de bonne
entente avec eux, l’accueil, la bonne humeur. Le contact avec les civils est une composante
essentielle de la stratégie de « contre rébellion »151 en Afghanistan. Celle-ci s’insère dans une
« manœuvre globale » : combiner l’action militaire à une action plus politique, dont l’objectif
est la « maîtrise du milieu », tout autant que d’ « ôter tout argument aux forces adverses en
rétablissant l’état normal de fonctionnement du pays. Il repose sur l’action directe sur le
milieu afin d’isoler et de désorganiser la rébellion, tout en protégeant la population dans les
zones qui y sont favorables ou vitales du point de vue économique et politique. »152 Ce contact
avec les civils se traduit par des actions civilo-militaires (ACM ou CIMIC153). L’armée
s’implique avec elles dans la réalisation de projets au profit de la population. Ces projets sont
menées, généralement, en partenariat avec des ONG, et essaient de faire travailler la main
d’œuvre locale. Cette implication permet de faire remonter des informations au
commandement sur la composition sociale de la population rencontrée et les différentes
organisations et institutions présentes sur place. En Afghanistan, rencontrer, connaître puis
comprendre la population sont un enjeu stratégique. Si la manœuvre est théorisée tardivement,
elle est présente dès les débuts. La population apparaît aussi en dehors de cette approche : les
forces allaient d’elles-mêmes à leur rencontre, lors d’une patrouille ou en ville. Si le verbe est
au passé, c’est que, là plus qu’ailleurs, la situation évolue. Il ne faut pas prendre les images
pour argent comptant, et penser que telle évolution dans la représentation vaut quitus pour
toute la période et tout le pays. A ces images théorisées s’ajoutent toutes celles où les civils 151 « La contre rébellion est un mode d’action destiné à s’opposer, en phase de stabilisation, à une menace
asymétrique qui pratique indifféremment la guérilla ou le terrorisme. », selon le Colonel Philippe Coste, du
Centre de Doctrine d’Emploi des Forces (CDEF). 152 COSTE, Philippe (Col.), « La phase de stabilisation et la contre rébellion », Doctrine, n°17, Juillet 2009. 153 ACM : Actions civilo-militaires ; CIMIC : Civil Military Cooperation.
66
apparaissent, notamment parce qu’il s’agit de faire du « couleur local », ce qui donne une idée
de la perception, par les Français, de ce que vivent les Afghans. Ensuite, la formation de
l’Armée nationale afghane, l’ANA, est tout autant considérée comme un volet phare de la
stratégie de la Coalition en Afghanistan. C’est surtout après 2007 que la formation de l’armée
afghane devient un enjeu politique, puisqu’il s’agit du nouveau cadre d’afghanisation du
conflit dont l’objectif est de transférer aux autorités du pays la charge de sa stabilisation. Cette
ligne, adoptée par les Alliés, est confirmée en France après 2007 par la participation aux
OMLT154, les équipes de formation insérées dans les bataillons afghans. Mais la formation de
l’armée afghane commence plus tôt avec la formation des officiers, assurée par les Français,
dès 2002155. A la différence qu’il n’y a pas d’actions entreprises alors sur le terrain. La
manière dont est filmée et photographiée la formation de l’armée afghane, et cette armée elle
même, donne une idée de sa montée en puissance mais aussi de l’implication française. En
montrant le rôle actif des Français, il est clair que la communication est bien présente dans de
telles images. Enfin, nous considérons un dernier thème pour les patrouilles, les combats et
les mesures de sécurité ; thème qui ne pouvait être laissé de côté compte tenu de la
problématique. Comment apprécier des images de guerre autrement qu’en y recherchant ce
qui fait, encore dans les esprits, le cœur du métier de soldat ? Ce thème regroupe tout ce qui
est présence des armes, niveau de l’équipement, déroulement d’une patrouille et,
éventuellement, accrochages avec « l’ennemi ». De telles images doivent nous permettre de
mieux cerner la dimension combattante en Afghanistan.
L’idée est donc, pour percevoir l’image de guerre, de parcourir les thèmes qui revêtent
une importance stratégique essentielle et particulière à l’Afghanistan. La nouvelle nature des
conflits, éloignée des champs de bataille conventionnels, et la particularité de l’Afghanistan,
territoire complexe jusque dans sa géologie, mettent à l’épreuve la définition même de la
guerre. Ces quatre thèmes sont là pour répondre à la problématique, et se montrent cohérents
compte tenu du contexte afghan. Nous n’avons pas retenu les cérémonies de remises de
décoration, les relèves de contingents, les déploiements de nouveau matériels. Concernant les
visites du ministre de la Défense, nous assumons un entre-deux. Mme Michèle Alliot-Marie
se rend une à deux fois par an en Afghanistan pour visiter les troupes françaises. De ses
conférences de presse ou de sa propre image, nous en avons visionné un certain nombre,
parce qu’il s’agissait de données sur la manière dont chacun des thèmes précités était abordé.
154 Rappel : OMLT : Operationnal Mentoring Liaison Team. 155 Le nom de la mission est « EPIDOTE », voir Annexes pour détail des missions.
67
Mais le ministre appartient à un autre temps, celui de la politique française, qui n’est pas notre
objet et construit, en creux, une autre représentation.
3.2.3. Traitement des données
Une fois que nous avons sélectionné ces quatre thèmes, il ne s’agit pas de les présenter
l’un après l’autre suivant la chronologie mais de les insérer pleinement dans le raisonnement.
Il nous paraissait essentiel de garder une dimension chronologique, qui ne soit pas celle des
reportages, mais celle du conflit : d’être dans des « temporalités croisées ». D’abord parce que
l’on veut mesurer les représentations dans leur évolution : saisir leur différence dans le temps
et la manière dont elles sont traitées. Ensuite parce que l’image choisie est celle d’un conflit
particulier, avec ses bornes. C’est pourquoi la chronologie que nous avons retenue colle à la
trame des évènements de l’intervention française en Afghanistan. Remarquons que les
mandats de l’ECPAD ne sont pas permanents. Une équipe image n’étant en effet pas présente
tout le long des opérations sur le terrain, il existe des espèces de « ruptures », cycliques, que
nous avons déjà mises en valeur. Pour ne pas être dépendant de ces trous noirs, et également
pour traiter la masse de données, nous avons décidé d’un « échantillonnage », pratique
habituelle des historiens de l’audiovisuel confrontés à un « trop plein » de sources. C’est le
cas lorsqu’un historien choisit de traiter une émission de télévision quotidienne, comme le
journal télévisé, pour l’analyser sur une période de dix ans. Rapidement, l’inflation de
documents rend le projet extrêmement long et difficile. Echantillonner consiste à n’étudier
que le mois n la première année, puis, pour l’année suivante, étudier le mois n+1, et ainsi de
suite jusqu’à reconstituer une année complète. C’est, selon les possibilités offertes par le
fonds d’archives, une technique que nous avons retenu. Il nous fallait donc bien analyser le
calendrier : or, les mois « chauds » sont généralement ceux du printemps et de l’été où les
insurgés passent à l’offensive. Ils sont aussi remplis d’activités politiques (élections, nouvelle
constitution…). Nous avons donc procédé à un échantillonnage des photos, et rechercher par
thèmes les vidéos correspondantes. En clair, notre corpus se constitue au final par une
sélection objective de thèmes qui intéressent le sujet des images de guerre, recherchés dans
des échantillons dont la constitution se fait, elle, chronologiquement. Au final, nous avons des
exemples de chaque mois et de chaque année, et un panorama représentatif des images
tournées en Afghanistan. Avec les légendes et les entretiens, nos sources sont constituées.
68
Une fois ces données obtenues, il faut les confronter entre elles pour en dégager le
sens. La photographie se prête assez bien au traitement statistique. Certes, au regard du
nombre de photographies retirées, confidentielles ou simplement non publiées, les chiffres
obtenus ne rendent compte que de la vision donnée des opérations par la communication. Afin
d’apprécier cette communication – et son adaptation à l’évolution de la situation afghane –
valait-il encore mieux se limiter à un corpus qui soit suffisamment nourri pour couvrir la
période et la richesse des activités sur le théâtre. L’ECPAD a mis en ligne des extraits de ses
reportages photographiques en Afghanistan, sur toute la période que nous étudions – de
janvier 2002 à septembre 2008156. Il s’agit de quatre cents photos. C’est un panorama qui
donne l’intérêt de ne pas avoir à le sélectionner nous-même, et permet d’établir une
comparaison statistique sur les différents thèmes mis en ligne, et donc utilisés comme vitrine.
Il a le double avantage d’être facile à saisir dans un logiciel tout en présentant une partie de la
communication faite sur l’Afghanistan. Ces résultats donnent une première estimation ; ils
sondent, en quelque sorte, l’échantillon. L’analyse des images est donc loin d’être exclue et il
n’est pas question de n’avoir qu’une lecture de chiffres. Par la suite, toujours en suivant la
chronologie, les notices de reportages, films ou photos, nous aident à préciser les évènements
qui permettent de faire sens. La légende nous indique le thème. Seules les cassettes qui nous
ont intéressées sur ces thèmes précis ont été regardées, à la suite desquelles nous avons
adjoint les reportages photo pour, comme nous l’avons expliqué, changer d’optique. Enfin, les
entretiens ou la documentation, ponctuellement, viennent appuyer la compréhension des
images, que nous essaierons à la fois de décrire et de commenter fidèlement.
Nous avons donc visionné trois mille six cents photos environ, et quarante cassettes,
soit environ vingt-deux heures de films. Nous n’avons qu’un regret, peu d’images visibles
pour l’année 2005, mais la certitude qu’elles existent. Apprécier, reconstituer, avec elles, en
restant toujours proche des sources, le tableau ainsi peint de la présence française en
Afghanistan ; savoir apporter de la contradiction ; en un mot, saisir la complexité des images,
donner un sens, sans chercher à les réduire en voulant proposer un récit unique : telle est la
manière dont nous avons bâti notre méthode.
156 « Reportage en Afghanistan… », sur le site www.ecpad.fr, rubrique Photos, Opérations. Consulté le 20 mai
2012.
69
Préciser ici notre méthode nous a amené à construire une réflexion sur la nature des
sources audiovisuelles. C’était une étape obligée, qui détermine la lecture des archives de
l’ECPAD. Cela a mis en lumière un certain nombre de difficultés : au premier aspect, les
images sont nombreuses, presque trop, et impliquent une sélection. Mais il y a aussi des
manques, des retraits, qui pèsent aussi sur la construction de l’échantillon. Ce qui implique de
croiser aux sources audiovisuelles des sources orales. De plus, les sources de l’ECPAD ne
sont pas uniquement des images : celles-ci se complètent avec les légendes et les entretiens
oraux. Ces difficultés nécessitent donc de réfléchir avec précision et clarté sur ce que
l’historien peut attendre de sources audiovisuelles, donc de connaître leur particularité.
L’image, qu’il s’agisse de photographies ou de films, induit une part de mise en scène. On ne
saurait prendre donc l’image de la guerre en Afghanistan autrement que comme une réalité
construite, une réalité proposée, bien plutôt qu’une réalité donnée et établie. Elles sont aussi
actrices, « agent de l’histoire », c’est-à-dire que, comme les images du fonds Massoud ont été
exhumées pour enrichir le patrimoine audiovisuel afghan, les images de l’ECPAD s’ajoutent
au répertoire des images de la Défense suivant une même logique mémorielle. Elles proposent
donc une vision de l’histoire, que l’historien ne peut pas mépriser. Pour bien exploiter ces
archives, il appartient donc de bien les connaître. Photographies et vidéos ne proposent pas,
ainsi, le même angle de vue, n’agissent pas dans la même temporalité. Ces archives sont
complexes, faire sens à partir ces sources exige de mobiliser une méthode bien définie. Celle-
ci, pour parer à la taille du corpus tout en suivant un axe de recherche précis, présente d’abord
un échantillon, obtenu à partir d’une sélection thématique et chronologique. Il convient
ensuite de mettre ces données en perspective de l’histoire. Et proposer un raisonnement qui
fasse apparaître l’image que nous propose l’armée de ses opérations en Afghanistan.
70
Seconde partie : L’Afghanistan vu par
l’ECPAD (2001-‐2008)
De 2001 à 2008 le contexte de la guerre en Afghanistan change. La première période,
qui couvre les premières années de l’engagement et que nous bornons entre 2002 et 2006 est
relativement peu couverte dans les média. En 2003, l’intervention américaine en Irak et le
veto français déplacent les attentions. Par ailleurs, les groupes « terroristes » combattants en
Irak, liés à Al-Quaeda, sont connectés à ceux qui rejoignent l’Afghanistan. Ils y importent, à
partir de 2006, des techniques de guérilla nouvelles, parmi lesquelles les attentats suicides ou
les mines artisanales placées au bord des routes, ou IED. Jusque là, les combats sont limités
au Sud de l’Afghanistan. C’est là que les Américains surtout y enregistrent leurs principales
pertes. Le pays connaît pendant cette période des tentatives de reconstruction politique et
économique, assistée par les forces multinationales. La France est limitée dans son
intervention à la capitale et ses troupes ne doivent pas être employées au combat. C’est une
restriction d’emploi posée par le Président de la République alors en exercice, Jacques Chirac.
Toutefois, le veto au Conseil de sécurité de l’ONU ayant quelque refroidi les relations franco-
américaines, le président consent à ce que soient déployées les forces spéciales dans le sud,
dans la région de Kandahar. C’est au cours de ces missions secrètes que la France connaît ses
premières pertes au combat en Afghanistan. Kaboul, pourtant, est alors plutôt calme.
De 2006 à 2008, un tournant s’affirme en Afghanistan, du fait notamment des
nouvelles tactiques opérées par les groupes insurgés, mais pas seulement. Le conflit s’étend
progressivement à tout le pays et il n’est pas impossible que la population ressente une
lassitude face à une situation économique qui ne bouge guère. La corruption, les trafics et
l’insécurité demeurent. Ils entravent considérablement le fonctionnement normal de la société,
et paralysent l’initiative de l’Etat. Dans certaines régions, celui-ci est absent. Seule l’armée
peut prétendre le représenter. C’est le cas de la région Kapisa, que les Français reçoivent en
responsabilité en 2007, à l’est de Kaboul. Dangereuse et complexe, la région est un nouveau
défi pour les armées. Dans le district de Surobi, frontalière de la région et proche de Kaboul,
la situation se tend. Le président Sarkozy n’est pas sur la même ligne politique que son
prédécesseur. Il fait réintégrer la France à l’OTAN en 2009 et veut augmenter le poids de la
71
France dans les opérations en Afghanistan. C’est une cause et une conséquence du nouveau
contexte. Celui-ci, inexorablement, expose les Français à des pertes plus élevées. C’est ce qui
arrive en août 2008 lors de l’embuscade d’Uzbeen. Nous disons embuscade mais, au regard
des moyens déployés et de la durée des affrontements – de 15h30 le 18 à près de midi le
lendemain – cela ressemble fort à une véritable bataille.
De ce contexte, comment les images de l’ECPAD rendent compte ? Quelles sont les
lignes de la communication ? Quel est le contenu de ces archives audiovisuelles, qui suivent
chaque année les troupes en Afghanistan ? Il s’agit d’interroger les deux logiques inhérentes à
ces archives : la production, d’une part, que ce soit des films ou des photographies;
l’utilisation, d’autre part, de ces documents, ou l’image disponible qu’ils proposent. Le
contexte correspond-t-il aux images produites ? La réflexion se poursuit en suivant les deux
phases identifiées : un premier moment, de 2002 à 2006, « tranquille » ; un second, plus
tendu, qui lui succède jusqu’à sa maturité, en 2008, avec le choc dramatique d’Uzbeen.
72
Chapitre 4. Paix temporaire (2002-‐2006)
La France commence ses opérations en Afghanistan en novembre 2001 par l’arrivée
des militaires du 21e RIMa à Mazar-e-Charif. L’installation y est rustique et provisoire : dès
janvier 2002, les soldats français rejoignent Kaboul et son aéroport. L’ECPAD accompagne
tous ces premiers moments et couvre presque intégralement cette première année
d’engagement. Des frappes aériennes et des primo-arrivants, nous n’avons en revanche
aucune image : lorsque les premières sont tournées, les talibans sont déjà partis, les combats
ont cessé. Est-ce donc une image de paix qui domine ? Il est vrai que les tournages ne sont pas
exhaustifs par nature : les équipes ne voient pas tout, par devoir, par contrainte, mais aussi par
choix. En ressort donc une construction : comment celle-ci s’articule-t-elle pour ces premières
années ? Ce témoignage audiovisuel transmet jusqu’à nous un tableau auxquelles n’échappent
pas certaines nuances. Nous verrons dans un premier temps qu’elles présentent des Français
bien accueillis, que ce soit par la réouverture d’aides bilatérales ou dans la rencontre avec les
populations ; que cette tranquillité est relative, au lieu d’abord, mais aussi au choix des
images, qu’elles appartiennent aux patrouilles, toujours sans incidents, ou à la vie
quotidienne, montrée de façon partielle ; et que, enfin, cette paix n’exclut pas d’autres formes
de combats, qui, passant par les défis de la reconstruction, cherche à transformer une victoire
militaire rapide en succès durable.
4.1. Le bon accueil des Français
4.1.1. Réouverture de l’axe Paris-‐Kaboul
Une image de « libération » ? Plutôt une image de « normalisation », en 2002 et 2003,
premières années des Français à Kaboul. Normalisation de relations « historiques », entre la
France et l’Afghanistan, entretenues par des coopérations académiques, scientifiques,
culturelles, humanitaires, et ce depuis des décennies. Une coopération que le régime des
talibans aurait mise entre parenthèses, ce qui rend logique que la France retrouve sa place
amicale. Cette image se manifeste surtout par une mobilisation d’images de civils français,
assez remarquable pour le début d’une opération ; celles-ci commençant, habituellement, par
l’évacuation des ressortissants français plutôt que par leur retour. Ce qui renvoie la guerre au
passé. Lorsque Bernadette Chirac se rend en Afghanistan en 2003 – et on connaît le rôle tout
73
politique que s’est donné la première dame – elle souligne plusieurs points de la coopération
historique entre Paris et Kaboul. L’ECPAD est alors à ses côtés pour filmer ses déplacements
et ses différentes actions, dont certaines, comme la visite d’une école dans le quartier de
Qasaba à Kaboul, ont été préparées en amont. La plupart de ces images sont des mises en
scène, ce qui renforcerait, en premier lieu, l’idée d’un discours construit. Elle souhaite par
exemple donner de la voix à un projet de coopération soutenu en France par des personnalités,
Muriel Robin –comédienne - et Marine Jacquemin – grand reporter - : la construction d’un
hôpital de la mère et de l’enfant à Kaboul, financée par Bouygues. Elle souligne à cette
occasion la participation permanente des ONG françaises à l’assistance aux Afghans,
notamment pendant la guerre des années 1980, opposant les moudjahidines à l’Union
soviétique.
« La réalisation de ce projet s'inscrit dans ce qui est devenu aujourd'hui une tradition, presque une épopée, je vous rendrai hommage à toutes ces ONG médicales françaises, animées par ceux qu'on a appelé les French Doctors, qui dès 1980, dans les heures les plus sombres de la guerre ont été aux côtés des Afghans : Aide médicale internationale, MSF, Médecins du monde, tout comme Action contre la Faim, Handicap international, MRCA et tant d'autres. Ces milliers de volontaires ont toujours été du côté des Afghans libres, certains y ont laissé leur vie. Cet hôpital, signe de renouveau, signe de liberté retrouvée et qui bientôt accueillera les enfants et les mères de Kaboul, leur est dédié. Aujourd'hui, l'Afghanistan vit une nouvelle ère, la confiance et l'espoir sont revenus, même si certains vrais problèmes demeurent. La France est et restera au côté de l'Afghanistan. »157
Suivent toutes sortes de réception dans des lieux où la France ou des Français ont
participé à la rénovation, notamment l’inauguration de la bibliothèque de la Délégation
archéologique de la France en Afghanistan (DAFA), collaboration historique qui date du
début du vingtième siècle. Elle prononce un nouveau discours à l'ambassade de France, dans
le parc, en début de soirée.
« Entre la France et l'Afghanistan, quelle relation exceptionnelle ! Souvenons-nous que par la volonté du roi Amanullah, il y a plus de quatre-vingt ans, nos archéologues furent les premiers étrangers autorisés à séjourner de manière permanente dans cette ville. Mais si la France a dans ce pays une longue tradition de présence, l'Afghanistan est aussi présent dans nos cœurs. Par l'héroïsme de sa résistance contre un ennemi gigantesque et déterminé, qui fut finalement défait. L'Afghanistan évoque en nous tant de symboles et tant de rêves, la passion de la liberté et de l'honneur. Le courage devant la mort et devant la vie. La beauté des paysages et des hommes. (…) Le courage que vous manifestez à venir partager avec les Afghans les plus pauvres une foi dans l'avenir »158.
157 Référence 03.9.55, cassette n°19, bande son à partir de TC 09 :53. 158 Idem, TC 30 :50.
74
La bande son de la cassette fait apparaître un discours qui n’a jamais été exploité par la
suite – dans les médias ou dans un film coproduit par l’ECPAD. Pourtant, son verbatim
illustre la représentation que d’une part des élites françaises réunie alors à l’ambassade – en
présence de quelques uns des officiers qui accompagnent Bernadette Chirac dans son périple.
Les personnes devant lesquelles elle s’exprime sont tous des Français travaillant en
Afghanistan, pour une majorité des civils, dans l’humanitaire notamment. Dans son discours,
elle en appelle aux « rêves » qu’évoquerait l’Afghanistan, qui ont mobilisé les premiers
archéologues et, en filigrane, le symbole de la résistance contre « l’ennemi », l’Union
soviétique, « gigantesque et déterminé », et le « courage devant la vie », c’est-à-dire, devant la
misère. La présence de Bernadette Chirac, ses déplacements où elle est accueillie par des
jeunes Afghans, ses discours surtout, apparaissent dans les archives de l’ECPAD comme des
documents inédits. Elle semble venue pour faire le lien entre les efforts civils et militaires de
la France. « Je ne manquerai pas de rappeler au Président de la République la très belle
manière dont vous servez votre pays »159, dit-elle au bataillon français qu’elle vient visiter à
l’aéroport de Kaboul. A la fin de la cassette, on voit la première dame signer un autographe à
un soldat sur son fanion de régiment. Outre cette visite, les relations diplomatiques
anciennes sont aussi symbolisées par le lycée français Istiqlal de Kaboul160. M. Lagorce, alors
proviseur du lycée, est interviewé par l’équipe image.
« Le lycée a été fondé dans les années 1920, par la France, à la demande du gouvernement afghan. Il y avait des missions archéologiques, dont la France a eu l'exclusivité mais en contrepartie, le gouvernement afghan a demandé l'ouverture de l'établissement. (…) On enseigne le programme afghan, le dari, le pachto, les mathématiques, la science, mais aussi des cours de français. (…) Il y a six enseignants français, qui travaillent sur les deux établissements (Isteqlal et Malalai). La base de leur travail c'est la formation des enseignants, de français, des personnels administratifs, des instituteurs. (…) Les enseignants sont détachés de l'éducation nationale pour l'AEFE (agence de l'enseignement français à l'étranger) du ministère des affaires étrangères (…) pour des contrats de deux ans et demi. »
L’image des lycées français est une empreinte qui, en 2002, reste relative, tant le
retour semble encore compliqué. La bande son et les images l’attestent : la bibliothèque est
vide de ses ouvrages, la rénovation est en cours. Après la guerre, le proviseur a trouvé le lycée
dans un état délabré. « Il y avait une douzaine d'impacts de roquettes sur le toit, les verrières
159 Idem, TC 51 :46. 160 Concernant le lycée Istiqlal, référence 02.9.96, cassette n°18.
75
étaient détruites. (…) Sous les talibans, c'était une madrasa (école coranique) avec 6000
étudiants environ ». Que des civils français apparaissent beaucoup dans les rushes de ces
premières années est frappant : humanitaires, personnalités – car, en plus de Bernadette
Chirac, Bernard-Henri Lévy l’a suivi, préparant un rapport au Président de la République – et
même des fonctionnaires français. Les images tournées dans l’ambassade sont, sauf erreur de
notre part, absolument uniques. Sur les images mises en ligne, seuls deux civils français
apparaissent en 2007 et 2008 : les ministres de la Défense.
Cet axe Paris-Kaboul prend aussi des formes inattendues. En juin 2002 toujours, un
jeune français se présente, avec une 2 CV rouge et verte au camp français. L’image est assez
surréaliste : on le voit présenter son passeport français au militaire de garde, puis entrer
tranquillement dans le camp161. Les militaires français le regardent un peu étonnés ! L’ECPAD
est présente sur le moment. Les images sont d’ailleurs tellement bonnes qu’on a du mal à
croire au hasard. Interviewé par l’ECPAD, le jeune homme explique son parcours : parti de
Paris pour rouvrir la route Paris-Kaboul en 2 CV, et imiter les raid qui se faisaient dans les
années 1970. « 8 500 kilomètres, une petite trotte de Paris jusqu'à Kaboul. La route
d'Afghanistan reste quand même la plus éprouvante », dit-il. Après avoir raconté ses
péripéties, l'interview s'arrête rapidement pour laisser place à des échanges plus informels
avec les militaires français, curieux. Il explique alors que l'accueil a été bon à Hérat, la grande
ville de l’ouest proche de la frontière iranienne. Il a eu quelques frayeurs jusqu’à Kandahar,
dans le sud, mais n’a pas eu de problèmes. Concernant la population, il raconte que
rapidement la 2 CV a fait le travail pour lui : amusés, les enfants venaient monter dessus, puis
les parents arrivaient et, hospitaliers, lui proposaient rapidement à manger puis un lit pour la
nuit. Il explique aussi qu'arrivé en Afghanistan, il a fait quelques plateaux de télévision
afghane pour expliquer son parcours. On l'a très bien accueilli, interrogé sur son geste. Pour
lui, c'est l'occasion de montrer qu'on peut faire le voyage « s'intéresser à ce pays. C'est ça le
sens du geste. C'est pour eux surtout. » L’image est trop belle, et les rushes, rapidement,
montrent que l’ECPAD perd toute prise sur l’image : le jeune pilote suscitant la curiosité des
soldats français, il décroche de l’interview pour préférer le ton de la conversation. Les
nombreux changements de plans, improvisés, montrent que le sujet n’a pas été construit à
l’avance. La nature décousue de l’interview ajoute au caractère inattendu. Donc, même en
dehors de la mise en scène des déplacements officiels, l’exemple montre que des civils
français sont sur le retour plutôt que le départ. Et cette image fait sens : la présence
161 Référence 02.9.96, cassette n°19, TC 03 :27.
76
remarquable de civils français à l’image, la mise en valeur d’actions humanitaires ou de
coopération entre Paris et Kaboul formalisent l’idée d’une paix retrouvée. Certes, les civils
français sont minoritaires dans les images de l’ECPAD ; mais la « normalisation » se
manifeste par d’autres moyens visuels, ce qui, pour les militaires, signifie la rencontre avec
les civils Afghans.
4.1.2. A la rencontre des populations
Le contact avec les populations pourrait être le premier témoin d’un bon climat
général dans le pays. Plus celui-ci est facile, moins les tensions sont apparentes. Un bon
contact donne aussi l’image d’une intervention douce, bien accueillie, voire même souhaitée.
Interrogé sur le contact avec la population, les opérateurs ont eux-mêmes lié les bons rapports
avec les Afghans au calme du pays. L’adjudant Vincent Larue en a fait le récit, expliquant
que les Français étaient vus comme des « libérateurs ».
« On était les libérateurs. On était comme si on était les sauveurs. On venait de libérer quelque chose. […] Au tout début, 2002 les gens pleuraient, et nous invitaient à boire le thé en nous remerciant. Les gens nous racontaient des parcours étonnants avec leurs études, notamment au lycée français. C'était touchant ce qu'ils avaient pu vivre, ce pays, qui sortait de trente ans de guerre… La population était enchantée de nous voir. Tout doucement la situation s'est dégradée. On était plus forcément les bienvenus. Par endroits on se prenait des cailloux. Ca s'est dégradé doucement, pas en une seule fois. »162
Il faut noter qu’initialement Vincent Larue, en 2002, n’est pas encore reporter mais
travaille dans le renseignement. Il remarque ainsi que, lors des recherches auprès de la
population, certains témoignaient d’eux-mêmes de la présence de talibans ici ou là, et d’autres
montraient moins de regrets. « Tout le monde ne pleurait pas les talibans », rapporte-t-il. Du
« temps » des talibans, il y avait, certes, moins de racket et l’Etat était plus organisé, plus
présent. Cette sécurité relative que le régime avait instaurée explique que les Afghans
n’adhèrent pas en bloc au sauvetage de l’Afghanistan par la communauté internationale. Il ne
faut certes pas voir dans l’image d’un Afghanistan libéré la représentation partagée par tous
les Afghans. Mais, de la part des Français, le début de la période marque une sorte « d’état de
grâce ». L’adjudant-chef Jannick Marcès, présent lui en tant que reporter ECPAD en 2002,
témoigne de ce qu’il a réussi à faire, avec la population, lors de l’arrivée des Français.
162 Entretien avec l’adjudant Vincent Larue, janvier 2012.
77
« En 2002 j'ai fait des portraits de femmes. J'ai réussi à faire ça ! J'étais passé par des interprètes, j'avais réussi à négocier des choses. J'avais discuté avec un Afghan qui travaillait à l'ambassade, à Kaboul, et j'avais pu prendre en photo sa femme. Ce sont des moments privilégiés. On avait fait le gars, dans le village, etc. Ils aimaient bien les Français, on n'est pas perçu comme des Américains. Les Américains sont très agressifs, dans leur comportement. L'armée française, dans notre culture, on a ça. On a toujours eu le contact avec la population, sachant que c'est important. […] J'ai vécu des trucs, quand on est allé sur des points où il y avait des relèves par des soldats allemands. Les Français étaient là depuis un certain temps et sont relevés par un contingent allemand sur cette position, en Afghanistan mais c'est valable partout dans le monde. Dans les passations de consigne, entre officiers français et allemand, le Français dit à l'Allemand : « et si vous voulez acheter des produits locaux, un mouton, une poule, que sais-je, vous pouvez contacter machin dans le village »… Et là, je vois l'officier allemand qui se braque, et qui dit à l'officier français : " Quoi ? Acheter un mouton ? Acheter des poules ? Mais ça va pas ou quoi ?". Les différences de culture ! Les Français on est toujours dans cet esprit là : quelque part on investit de l'argent dans ces populations, et du contact, et du temps et de l'énergie. […] Les quelques Afghans qu'ils ont vu ce sont ceux qui sont venus vers eux, et ils n'ont jamais acheté ni mouton ni poule. Les Américains c'est le même état d'esprit. Ca change la donne sur place, un petit peu. »163
Il introduit l’idée que les Français particulièrement bénéficient d’une image différente
des autres pays de la Coalition, plus ouverts, plus proches des populations.
Le moment qui représente certainement le mieux ce contact entretenu avec la
population est celui du thé. Les Français, au cours de leur patrouille et lorsqu’ils rencontrent
des Afghans, sont régulièrement invités à déjeuner ou à prendre une collation en compagnie
des autorités locales – le malek, ou « chef de village », dans certaines légendes – auquel se
joignent d’autres hommes adultes et quelques enfants. Rarement, en revanche, on aperçoit de
femmes à ces rencontres. En 2002, à la suite d’une patrouille – composée de trois véhicules
blindés léger – les militaires du 4e Régiment de Chasseurs (RCh) sont invités à déjeuner. Ils
sont très bien reçus au village : on leur dresse un tapis pour manger. Le déjeuner se compose
de fromage, de pains, de riz ou de blé cuit. La bande son aussi nous renseigne ; L'ECPAD
pose la question : « Est-ce que c'est toujours comme ça ? » au capitaine Dirou, qui commande
la patrouille. « Quasiment (…) il y a deux jours on était invité à déjeuner avec le gouverneur
d'Estalek, de façon impromptue. Ils nous ont sorti un festin similaire. », répond-il. « L'accueil
afghan est quelque chose ? - L'hospitalité est apparemment une tradition bien ancrée chez eux.
A chaque fois, les patrouilles de l'escadron ont toujours été accueillies de la même façon dans
la zone. »164 L’hospitalité des populations se vérifie sur toute la période, mais est surtout
marquée dans les images entre 2002 et 2007. Chaque image de sortie est ponctuée de ce genre 163 Entretien avec l’adjudant-chef Jannick Marcès, janvier 2002. 164 Référence 02.9.96, cassette n°26.
78
de rencontres sympathiques, et prend toutes les formes : du simple thé au véritable festin. En
2003, les ACM (Actions civilo-militaires) sont invitées à une petite collation chez un
commerçant165. En 2004, les images personnelles, reversées aux archives, du commandant
Olivier de la Bretesche, alors officier communication – chargé, notamment, des relations avec
les journalistes et supervisant la politique de communication sur le théâtre – montrent les
Français prenant le thé dans la plaine de Shamali, avec des Afghans, sur un tapis. Ils sont
cinq, un seul porte son Famas, le fusil d’assaut. Ils ne portent pas leur casque. Ils ont des
lunettes de soleil. Avec eux, des hommes et des enfants afghans ; en arrière plan, on croit
distinguer des tentes de nomades. Et l’image ignore tout véhicule. Les Français posent avec
les hommes et des enfants afghans devant le tapis où a été servi le thé - on note la présence du
pain afghan traditionnel, d’une théière, au premier plan. Les hommes sont souriants, de tous
âges. Seule une arme, à moitié hors champs, est posée et se remarque à gauche de la photo.
Tout indique de la décontraction.166 En 2004 encore, cette remarque dans la bande son d’une
cassette, de la part d’un officier français, note que « La tradition du thé c'est très important, ça
prouve qu'on est pas pressés, qu'on a le temps, ça prouve qu'on est bien accueillis167 […] Si on
ne prend pas le temps ici, on ne pourra jamais rien faire. L'unité de temps n'est pas ici la
même qu'en Europe. Les minutes doivent être un peu plus longues ici que chez nous. »168 Le
temps s’écoule plus lentement pour les Afghans, comme le dirait ce proverbe qui leur est
souvent attribué : « Les Occidentaux ont la montre, nous (les Afghans), on a le temps ».
Façon de dire que le rythme coutumier afghan s’est imposé aux Français qui ont voulu faire
l’effort d’aller à la rencontre des populations, entrer en contact nécessitant de s’adapter aux us
pachtounes. Celui-ci se manifeste par une hospitalité légendaire, qui d’ailleurs n’implique pas
forcément une adhésion quelconque. Voir dans les déjeuners et le thé offerts une preuve
d’amitié serait un peu forcer le trait, mais la pratique a quelque chose de chaleureux qui, peut-
être, a surpris les premiers arrivants Français. Qu’elle soit aussi présente à l’image – elle
revient de manière chronique – dénote aussi une attention portée par les reporters à ces
cérémonies. Et le conseiller en communication – ici en la personne du commandant de la
Bretesche – s’y prête volontiers. La tradition perdure : jusqu’en 2007 on relève des images de
la cérémonie du thé169. Elle met en image l’entente toute cordiale avec la population, ce 165 Référence 03.9.55, cassette n°7, TC 42 :50. 166 Référence D190-2, photos 46, 61 et 62 notamment. 167 Souligné par nous. 168 Référence 04.9.168, cassette n°3, TC 48 :00 et au délà. 169 Référence 05.9.97, cassette n°9 ; référence 07.9.21, cassette n°5.
79
contact privilégié, reflet d’une stratégie basée sur la connaissance du terrain et l’isolement des
insurgés. La sympathie de la population afghane à l’égard des troupes françaises peut
apparaître comme un argument de choc pour démontrer le pacifisme des opérations : ces
images se raccrochent tout à fait à un discours de communication militaire par leurs aspects
stratégiques. Mais, en retour, par la convivialité apparente des échanges et des rencontres, se
dénude aussi le sentiment de sérénité dans lequel évoluent les Français à Kaboul.
Ces images déchargent la notion guerrière de l’intervention française en Afghanistan,
en lui substituant les notions de coopération, d’entraide, et même de fraternité. Oriane Barat,
jeune chercheur rattaché à l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM),
estime que « la France n’a pas de volonté politique explicite concernant l’intervention en
Afghanistan, ce qui entraîne, pour les forces armées, un engagement assez limité »170. Si la
mission des forces est mal définie, ce qui est dû essentiellement aux lacunes du
renseignement, cela ne veut pas dire qu’elle ne cherche pas de cohérence. Et surtout dans son
image : l’intervention n’est-elle pas pensée comme humanitaire bien plus que militaire ? Ne
s’agit-il pas de substituer aux opérations militaires des actions envers les civils ? Comment,
dans la couverture des missions, se traduit cette image de paix ?
4.2. Une tranquillité relative
4.2.1. Une présence limitée
La présence des Français est théoriquement limitée, à partir de janvier 2002, aux
environs de la capitale, Kaboul. C’est la seule zone d’intervention de la Force internationale
d’assistance à la sécurité (FIAS)171, créée par la résolution 1386 du 20 décembre 2001. La
participation de la France à cette force est alors de 500 militaires, sur trois mille hommes
déployés. Auparavant, d’octobre 2001 à janvier 2002, des militaires du 21e RIMa ont été
envoyés à Mazar-e-Charif, grande ville du nord de l’Afghanistan. « Cette force composée de
170 BARAT-GINIES, Oriane. Op. Cit, p. 20. 171 Le sigle anglo-saxon ISAF est aussi couramment utilisé, pour International Security Assistance Force.
80
trois nationalités - Français, Américains, Jordaniens - a comme mission de sécuriser la zone
aéroportuaire de Mazar-e-Charif pour permettre sa réparation et créer des conditions
favorables au travail des organisations non-gouvernementales. »172 La FIAS, initialement
créée pour six mois, est l’une des deux forces opérantes en Afghanistan avec les missions
d’Enduring Freedom, qui, sous leadership américain, conduisent les opérations de contre-
terrorisme, essentiellement dans le sud du pays. La France y participe par des missions
confiées à l’armée de l’air, basée à Douchanbé, au Tadjikistan, et par une présence de la
marine dans l’Océan indien – mission Héraclès porte sud. L’hybridation de ces deux
structures rend la lecture des opérations militaire très complexe. En ce qui concerne la FIAS,
il faut attendre octobre 2003 pour que le mandat initial soit prolongé jusqu’au 20 décembre
2004, par la résolution 1510. La force multinationale peut alors agir en dehors de Kaboul.
2003 est aussi l’année où sont déployées les forces spéciales françaises dans le sud pour des
opérations « entourées du plus grand secret »173. Sous le nom ARES, ces missions ont été
filmées par l’ECPAD dans la région de Spin Boldak, mais sont classifiées par l’Etat-major
des armées. Passée sous tutelle de l’OTAN le 11 août 2003, l’Afghanistan est entièrement
sous la responsabilité de l’ISAF en octobre 2006. Sous la bannière d’OEF, les Français
interviennent, jusqu’en 2007, dans la région de Kandahar au sud, pour les missions des forces
spéciales et les missions de l’armée de l’air. A partir de 2006, les choses deviennent plus
lisibles puisque OEF et ISAF ne sont plus véritablement deux missions distinctes : la dernière
opérant sur tout le territoire. De plus, en prenant en charge la région de la Kapisa, les Français
sortent de Kaboul pour des missions plus exposées. A ces divers lieux il faut enfin ajouter
Bagram, située au nord de Kaboul, qui est la grande base aérienne par laquelle transitent les
contingents qui arrivent et ceux qui repartent. Bagram fait office de grand quartier général.
Les missions de l’ECPAD correspondent à ces espaces, concentrés jusqu’en 2006 dans des
pôles urbains ou des bases aériennes. Sont donc couverts les aéroports de Douchanbé et de
Kaboul : ce dernier accueille, au camp de Karsauzon, les premiers détachements français
envoyés sur place et limités à quelques centaines d’hommes. Madame Michèle-Alliot Marie,
alors ministre de la Défense, y effectue une visite en 2002, les 3 et 4 juin, peu après leur
déploiement sur le site. Les films témoignent des conditions de vie et de l’implantation. On y
voit surtout l’arrivée des hommes et leurs conditions d’installation : ils ont aménagé des tentes
pour les personnels. La caméra nous emmène au service de santé, qui bien que sous tente
172 « Les miitaires du 21e RIMa sont à pied d’œuvre », Armées d’aujourd’hui, n° 266, décembre 2001. Pp. 8-9. 173 BARAT-GINIES, Oriane. Op. Cit.
81
aussi, bénéficie d’installations qui permettent la chirurgie174. Le ministre visite les lieux et
s’entretient avec des soldats – une douzaine à l’écran – sur les conditions de vie, notamment
les rapports avec la famille. Les rushes font également ressortir quelques remarques sur les
petites difficultés au démarrage, notamment l’approvisionnement de pièces de rechanges.
Puis, lors d’une conférence de presse, la ministre s’explique : « Je tenais à venir en
Afghanistan pour voir dans quelles conditions se passaient cette mission importante », visiter
les troupes en opération extérieure, après avoir été « il y a dix jours en Bosnie »175. « Les
troupes françaises sont au nombre de 480, […] [j’ai pu] constater ce matin votre rapide
intégration au sein de la FIAS, unanimement salué ». L’ECPAD, présente dès les débuts à
Mazar-e-Charif, suit l’installation des Français à Kaboul et le déploiement de l’armée de l’air
à Douchanbé, au Tadjikistan, à Manas, au Kirghizstan, ainsi qu’à Kandahar. L’année 2002
voit les missions de l’établissement s’y succéder, passant par tous ces lieux. En 2003 et 2004,
les missions sont plus espacées les unes des autres : avril et décembre en 2003 ; avril,
septembre et décembre en 2004176, et se limitent à Kaboul et Douchanbé. En 2005, une équipe
est envoyée à Spin Boldak pour couvrir les forces spéciales. Elle tourne aussi à Kaboul auprès
du détachement français. En 2006, en juillet, les forces françaises s’installent au camp de
Warehouse, plus important, et jusqu’ici sous responsabilité allemande. Le camp est à Kaboul,
et devient le principal camp français en Afghanistan. L’ECPAD est alors sur place pour
filmer. Les photos mises en ligne sur le site de l’établissement font apparaître la même
représentation géographique : en 2002, 49% des photos montées ont été prises à Kaboul ou
ses environs, 44% au Kirghizstan, 7% à Mazar-e-Charif. En 2003, la part des photos de
Kaboul grimpe à 92%. Entre les photos disponibles et celles publiées, il y a donc une
constante : Kaboul domine, même si, soucieux de faire apparaître la diversité des opérations,
l’ECPAD tourne ses images dans tous les endroits où sont représentés les Français. On serait
donc en droit d’attendre que les images montrent un paysage très urbain. Pourtant, les
premières patrouilles françaises vont au delà de la ville de Kaboul, dans la plaine de Shamali.
Et les actions civilo-militaires concernent des quartiers de la capitale mais aussi des villages
environnants, tels que Saydobad, en 2003. La bande son d’une cassette permet de nous situer,
le lieutenant en charge des ACM précisant dans son interview le lieu : « Actuellement on se
trouve dans le village de Saydobad qui se situe à peu près à une heure de route de l'aéroport
174 Référence 02.9.96, cassette n°3, TC 13 :00 à TC 21 :15 175 Idem. 176 Voir chronologie.
82
de Kaboul où nous sommes basés. »177 Les équipes se déplacent ensuite dans la région sur un
autre site. A chaque fois, les paysages sont plutôt ruraux qu’urbains. En fait, les images de
ville, à proprement parler, sont plutôt rares, ce qui tient à la réalité même du tissu urbain
afghan autant qu’à l’acception large entendue par Kaboul, qui inclut en fait la ville et ce que
nous pourrions comprendre par sa banlieue. Les Français, entre 2002 et 2006, ne sont donc
filmés que dans un territoire géographique limité à quelques espaces, essentiellement près des
aéroports, à savoir les villes de Douchanbé, Manas, Kaboul et Kandahar. Parmi celles-ci, deux
ne sont pas en Afghanistan et ne sont pas susceptibles d’être en territoire « à risque ». Quant à
Kandahar, toute mission qui s’aventure hors de ses murs, comme à Spin Boldak, est
estampillée forces spéciales. L’image qui reste de l’Afghanistan jusqu’en 2006 est donc
limitée à Kaboul et sa banlieue, qui même si elle est riche de nuances, ne saurait répondre de
la réalité afghane dans son entièreté. Toute image sur cette période répond donc de cette
limite géographique, conditionnant par là le climat général, d’aspect plutôt détendu.
4.2.2. Des patrouilles sans incidents
La mission des Français à Kaboul relève de la sécurité. C’est une partie de la mission
confiée par l’ONU à la FIAS, en décembre 2001, « aider l’autorité intérimaire afghane à
maintenir la sécurité dans Kaboul et ses environs »178. Afin de remplir cette tâche, les
militaires ont donc en charge d’effectuer des patrouilles qui visent plusieurs objectifs :
connaître le terrain, notamment pour collecter du renseignement, et cela implique une
rencontre avec la population ; assainir la région, ce qui implique majoritairement des actions
de déminage et de dépollution, tant les munitions non explosées et les mines sont nombreuses
en Afghanistan.
En premier lieu, les images ne montrent pas des Français s’entourant d’une carapace
blindée. L’équipement est toujours léger : en patrouille, les Français portent un gilet pare-
balles, mais on ne remarque ni casque, ni gant. L’arme n’est pas non plus portée
ostensiblement. Il faut attendre 2007 pour que l’équipement s’alourdisse, en protection
comme en armement. Nous avons ainsi classé l’équipement des soldats, dans l’échantillon des
photos en ligne, selon trois critères : léger, c’est-à-dire sans surprotection ni renfort d’armes ;
moyen, où l’arme est bien apparente et le soldat porte son casque ; soutenu, où l’image fait 177 Référence 03.9.55, cassette n°7, TC 20 :23. 178 D’après « Les principaux évènements de 2001 à 2008 », Doctrine, n°17, 2009.
83
apparaître un renfort de matériel, de munitions et une véritable carapace. Entre 2002 et 2006,
les Français apparaissent majoritairement sur ces photos avec un équipement « léger ». Les
Français n’utilisent qu’à partir de 2007 et 2008 des équipements plus renforcés. Il en va ainsi
lors des reconnaissances. L’étude des archives photographique fait ressortir la même image :
prenons pour exemple la reconnaissance du 10 janvier, effectuée par des marsouins du 21e
RIMa (Régiment d’Infanterie de Marine) et des parachutistes du 17e RGP (Régiment de Génie
Parachutiste), à Talakel, village présumé « pro-taliban », au nord de Kaboul179. Un soldat
français apparaît entouré d'hommes civils afghans. Il est souriant. Les civils se montrent assez
accueillants. L’équipement très simple : l’arme n’est pas visible, il ne porte pas de casque
mais simplement son béret. La planche présente ensuite des portraits d’afghans, la progression
du véhicule dans le village jusqu’à ce qu’il s’éloigne, accompagné par des enfants qui courent
à ses côtés. On voit même un jeune parachutiste au béret rouge, aux commandes du véhicule,
échanger avec deux jeunes afghans qui portent la coiffe traditionnelle. La scène, quasiment
identique, se reproduit à la planche n°17, où une trentaine de photos montre la reconnaissance
par les véhicules blindés léger du 1er régiment de Spahis de la région de Kaboul. On voit ainsi
les Français arriver dans un village, s’entourer rapidement des enfants, souriants et amusés,
sous le regard ou neutre ou bienveillant, mais jamais agressif, des adultes. Les enfants sont
très présents dans les images de l’ECPAD : dès qu’une photo montre des civils, il est rare de
ne pas les apercevoir. Ils se montrent facilement, et les reporters, manifestement, aiment en
prendre des portraits. La photographie des véhicules, enfin, témoigne d’un usage très modéré
de la force : les véhicules blindés léger (VBL), ne sont pas de gros blindés imposants. Ils sont
à taille humaine. On les voit d’ailleurs se faufiler dans la circulation. Le 19 janvier 2002, la «
reconnaissance de l'axe est Kaboul-Bagram par une patrouille du 1er RPIMa »180, montre
quatre véhicules Peugeot de l’armée française… et un 4x4. Les véhicules sont alors très
ouverts, sans protections évidentes, sans blindage, sans tourelle, sans armement. Et le 4x4
n’est autre que le véhicule de l’ECPAD. La pauvreté de l’équipement sert notamment à la
rencontre des civils. C’est cette « particularité française » dont témoignait l’adjudant-chef
Marcès. Les Français, à l’inverse des autres contingents de la FIAS, viendraient à la rencontre
des populations parce qu’ils savent mettre de côté les attributs ostensibles de la force
militaire : le gant, le casque et surtout l’arme. De fait, on les reconnaît à leur treillis, mais sur
les images de patrouille, entre 2002 et 2003, l’image du soldat en arme est considérablement
179 Référence 01 2002 036, selon la légende des photos 09 à 26. 180 Référence 01 2002 036, planche n°4, photos 15 à 35. Informations selon légende.
84
atténuée. La patrouille est donc surtout l’occasion d’aller à la rencontre des civils et même de
rentrer chez eux pour prendre le thé. L’impression donnée est donc celle, bien sûr, de la
convivialité, mais de l’assurance aussi. Les soldats ne montrent pas de méfiance particulière.
Les hommes ne sont pas montrés en déplacement obéissant à des consignes de sécurité
extrêmement strictes, qui impliquerait une fouille des civils qui s’approchent, ou des distances
réglementaires à respecter, par exemple. Ainsi, en 2003, lors d’une patrouille avec la police
locale, un soldat porte son fusil au bras. Le soldat a la manche retroussée jusqu’à l’épaule,
porte son fusil d’un autre bras, le béret sur la tête, un civil en arrière plan181 : s’en dégage un
sentiment de confiance.
Les rushes de 2004 apportent une légère nuance d’un tableau où la confiance la plus
totale dominerait. Les patrouilles dans Kaboul ne font pas abandonner la vigilance. Toutefois,
ces rushes concernent des reversements du SIRPA Terre, et en l’absence d’une feuille de
dérushage complète, on n’a guère d’éléments sur le contexte de cette patrouille ou son lieu
précis182. Ce sont les rushes du film « Une politique de Défense », réalisé en septembre 2005
au profit de la Délégation à l’Information et la Communication de la Défense (Dicod)183. Les
images du film tranchent avec le climat perceptible dans les archives jusqu’à présent. Alors
que les patrouilles donnaient le sentiment d’une certaine tranquillité dans les archives
audiovisuelles, la production de 2005 situe un de ses passages consacrés à l’Afghanistan dans
le registre de l’action. Deux séquences de ce film de 22 minutes prennent pour sujet
l’Afghanistan. La première, une séquence d’une minute, fait enchaîner l’interview du
lieutenant-colonel Thiébaut, commandant en second de l'escadron de chasse 2/3, de l’armée
de l’air, qui évalue son intervention en Afghanistan, en 2001 : « Il fallait pouvoir intervenir
rapidement (dans les grottes) avant que l'ennemi ne s'échappe ». Il fait explicitement référence
aux combats d’Enduring Freedom, la mission de contre-terrorisme lancée après les attentats
du 11 septembre sur l’Afghanistan, et en l’occurrence de frappes aériennes. Sont montées à la
suite de cette interview des images de soldats français, équipés avec gants, gilets, bérets et
Famas, intervenant aux côtés d'Afghans dans l’arrestation et le contrôle d'un camion. La
bande sonore introduit une petite musique militaire en fond, à peine perceptible, qui donne du
rythme et accentue l’idée d’action184. La deuxième séquence est moins surprenante185 : la voix 181 Référence N2003-111, planche n°3, photos 18 à 23. 182 Référence 04.9.168, 4 cassettes de rushes. 183 Enregistré sous la référence 05.7.016 184 Référence 05.7.016, TC 04 :49 à 05 :50. 185 Idem, TC 09 :25 à 10 :18.
85
off nous indiquant, « agir pour prévenir : telle est la mission principale des forces armées ». A
l’écran, des soldats français descendent d’un village en hauteur, plan auquel succède des
soldats français surveillant la circulation dans Kaboul : on voit les Français au milieu de la
population, non plus face à elle, comme c’était le cas dans la première séquence. Ensuite, les
images présentent les actions de dépollution, de formation de l’armée afghane, et enfin
d’actions civilo-militaires, ACM, avec une femme militaire entrant dans un village et se
tenant à côté de femmes afghanes. La séquence se termine par l’interview du colonel
Marquez, du groupement interarmées des actions civilo-militaires, expliquant qu’ « On ne
règle pas une crise uniquement avec une force déployée sur un théâtre, on règle une crise en
permettant à un pays de retourner à une certaine normalité. » - donc que le militaire n’est pas
la solution unique, qu’il peut et doit s’hybrider avec des actions en faveur de la population. La
séquence se clôt avec des images de soldats français aidant à la mise en place d’une
installation d’eau. Comment comprendre toutefois que le film fasse succéder, à partir des
mêmes rushes, une première séquence qui met en scène l’action et l’autre qui insiste sur les
actions en faveur de la population ? Qui semble opposer d’un côté patrouille et sécurité, de
l’autre action envers les civils, alors que leur imbrication est plus complexe ? Il faut remettre
ces séquences dans la globalité du film, qui prend pour point de départ les attentats du World
Trade Center, et place l’Afghanistan comme le centre des nouveaux conflits. La première
séquence semble poser le « problème » de sécurité, qui est à contre-sens des images tournées
jusque là, la seconde veut y apporter la « réponse », des actions en faveur de la population, et
l’accompagnement de l’Afghanistan dans sa reconstruction. Cette deuxième séquence s’insère
dans la logique d’un certain nombre d’images d’archives.
Les images démontrent qu’une forme de tranquillité – sans aller jusqu’à employer les
termes de sécurité ou de stabilité, qui sont absolus – s’observe dans la plupart des patrouilles
jusqu’en 2006. Si on a bien en tête que les patrouilles sont généralement l’occasion de
connaître les lieux et de rencontrer les populations bien plus que de faire la chasse aux
insurgés, une autre remarque atteste de cette tranquillité relative. Il n’y aucune image de
combat entre 2002 et 2006. Notons tout de même que des Français se battent peut-être à Spin
Boldak, dans le sud, près de Kandahar. Ce sont les forces spéciales. Les images, nous l’avons
dit, ne sont pas déclassées. Des Français participent aussi à des combats, via les missions de
l’armée de l’air. Enfin, les quelques patrouilles qui auraient pu rencontrer une certaine
agressivité de la part de la population – jet de cailloux, par exemple – ne se devinent que dans
les bandes sons d’autres cassettes de rushes, notamment quand on cherche à définir le rôle des
ACM, mais ne sont pas filmées en tant que telles. Peut être que l’ECPAD n’a pas connu de
86
situations de ce genre ? Plus probablement, l’image de la tranquillité est en partie construite.
Le tableau qui présenterait des patrouilles sans incidents où l’on rencontre la population
quotidiennement n’est recevable que pour la région de Kaboul, eu égard à l’incertitude où
nous place la méconnaissance des images de la mission ARES ou la mise de côté, volontaire
ou non, des images de patrouilles plus délicates. De ces images de patrouille à Kaboul,
relevons donc que leur exploitation a permis de mettre en scène de l’action, mais que leur
grande majorité n’appartient pas à ce registre.
4.2.3. La vie des soldats à Kaboul
Dans les conflits contemporains, la vie du soldat est minoritairement consacrée aux
opérations de combat. Les images de l’ECPAD évacuent même complètement le combat,
missions ARES mise à part, jusqu’en 2007. A peine est-il suggéré. La situation à Kaboul est
effectivement calme durant les premières années, et les patrouilles filmées ne témoignent
d’une tension en aucun point perceptible. L’image tend à montrer que l’occupation des soldats
est ailleurs, et cela semble assez proche des réalités pour Kaboul. Outre le déminage, les
Français sont occupés par toutes les tâches, indispensables, de logistique,
d’approvisionnement, de soutien de l’homme. Celles-ci impliquent divers travaux, notamment
l’aménagement du camp de Kersauson, à l’aéroport de Kaboul, qu’ils occupent jusqu’en
2006. En dehors de ces besognes, comment les soldats occupent-ils leur vie quotidienne ?
Ont-ils des loisirs ? L’analyse des images sur ce point apporte plusieurs enseignements.
Les Français sortent dans Kaboul. En 2002, ils vont même y faire quelques courses,
dans les rues, s’arrêtant au bazar186. Les reporters déambulent dans les rues, photographiant la
vie locale. Ces images sont vraiment particulières à cette période. On peut voir sur ces photos
les commerçants dans les rues, la vitrine d’une librairie, « Ariana Book Store », des enfants
qui portent des pains sur la tête, un magasin de moto187. On est en janvier, au tout début de
l’intervention. Ce genre de documents s’estompe vite, pour disparaître presque complètement
après 2005. La vie quotidienne, par la suite, n’incluant pas de sorties dans les rues. En soi, les
loisirs sont sous-représentés dans le fonds d’archives. En 2004, on trouve une trace d’un
match de volley188. Les Français y rencontrent des compétiteurs allemands. Un barbecue, avec
186 Référence 01 2002 036, Planche n°6, photos 10 à 21. 187 Idem, Planche n°11, photos 16 à 20. 188 Référence D190-4.
87
brochettes, merguez et soda, est dressé. Les images sont belles : il fait beau, l’ambiance est
détendue, les soucis semblent loin. On croirait à des photos de vacances. En dehors du temps,
seuls Noël et le jour de l’an sont des moments de détente réellement pris en photo et filmés. A
ce titre, le ministre de la Défense fait d’ailleurs régulièrement le voyage pour se tenir à côté
des hommes en ces moments là. En décembre 2002, 2004 et 2006, Michèle Alliot-Marie vient
à la rencontre des hommes qui opèrent en Afghanistan pour les fêtes de fin d’année. Les
images font apparaître les hommes en groupe, au dîner, décorant leur sapin de Noël. La visite
des locaux est régulièrement une manière de présenter successivement les différents lieux
fréquentés par les militaires ou les services susceptibles de leur être rendus., avec notamment
la restauration. Le reportage photographique de 2003 nous emmène dans les cuisines, sous la
légende « Vie au BAT-FRA. Mécaniciens – Cuisines ». On voit travailler les boulangers189.
Un sujet semble-t-il apprécié, puisqu’il illustre bien un trait de la vie de campagne. Il revient
en 2004, cette fois sous l’œil du SIRPA Terre. Vingt minutes d’une cassette de rush montre
un boulanger préparant son pain190. L’opérateur filme les différents appareils utilisés, pour
pétrire, faire la pâte, découper les petits pains, rouler des baguettes, mettre au four. Les plans
présentent l’installation de la boulangerie, avec tous les équipements nécessaires et, en prime,
sorti du four, alors que le pain est à peine cuit, la bande son ne manque pas de capter les
craquements de la croûte. En 2006, enfin, lorsque les Français s’installent à Kersauson,
l’ECPAD couvre le chantier d’installation et rapporte les conditions de vie. Ils interrogent le
Lieutenant-colonel Bechman, « chef de projet pour la montée en puissance sur le camp de
Warehouse ». « Il faut monter un restaurant, et prendre en charge des fonctions dites
multiservices pour le camp et ses résidants de diverses nationalités. Fournir l'eau, l'énergie, la
maintenance des bâtiments, de la voirie, le blanchiment, [tout ce qui est] lié au soutien de
l'homme. »191 Le restaurant est prévu pour deux mille personnes – il peut en accueillir, en
2006, environ huit cents. Le camp accueille des Français, des Américains et des Afghans. Puis
la cassette montre les travaux à l’intérieur du camp, notamment dans les cuisines, travaux
partagés entre Français et Afghans. En effet, ceux-ci sont recrutés dans les régions de Kaboul.
En lien avec le bureau d’action civilo-militaire, il permet de donner du pouvoir d’achat dans
les familles. Les rémunérations dans les forces, élevées, sont d’ailleurs attractives. Qui plus
est, l’objectif est aussi de diffuser des savoir-faire. Enfin, l’ECPAD visite les tentes, premier
189 Référence N2003-111, planche n°28, photos 18 à 37. 190 Référence 04.9.168, à partir de TC 39 :11. 191 Référence 06.9.110, cassette n°2.
88
lieu de vie, s’il en est, des personnels. La tente accueille 11 personnes. Chaque individu
dispose d’un lit entouré d’une moustiquaire. Les espaces personnels sont de fait assez réduits.
On voit divers bureaux, on devine une télévision. Le soldat est interviewé : « la journée on
peut pas rester la journée, on n’a pas de clim. Le frigo c'est de la récup. Ce qui nous manque
le plus c'est la clim. Des fois la journée on a une pause pour faire la sieste, mais on peut pas il
fait trop chaud. […] Et 1 à 2 semaines pour [faire] venir le courrier ». Pour téléphoner ou
avoir Internet, les Français ne sont pas encore en place, ils vont chez les allemands – qui
occupent une partie du camp - pour le téléphone, et chez les roumains pour internet. « Pour
ceux qui sont arrivés en précurseurs, ils ont rien prévu ici », conclut celui qui est interviewé,
constatant que les conditions en Afghanistan sont plus difficiles qu’au Kosovo ou au Gabon,
où il a également servi. Il désigne son matériel et explique qu’une grande partie provient de la
récupération. De ces différents sujets, distinguons d’abord ceux qui sont consacrés à la
communication – la boulangerie, l’installation à un nouveau camp – des paroles plus
relâchées du soldat interviewé dans sa tente. Surtout, ces quelques images récupérées sont
uniques dans notre échantillon. Avec la boulangerie de campagne, les salles de restauration,
les extraits consacrés à la vie quotidienne sont donc assez minces. Ils permettent d’apercevoir
des installations difficiles, avec une logistique compliquée qui nécessite d’envoyer, à
plusieurs milliers de kilomètres de la France, du matériel. Que ce soit en 2002 ou en 2006, les
camps ont augmenté en taille, la rusticité est demeurée relativement la même. Aller débusquer
ces images nous laisse perplexe : on voit rarement les hommes à leur repas, en train de
bouquiner le soir, ou se levant le matin. La journée qui est filmée, c’est en fait la journée des
opérations. Le reporter, qui se conçoit militaire comme les autres, pose sa caméra quand les
autres posent tout leur équipement. Le soir, il est vrai, il doit faire tout son travail. Mais
jamais une caméra n’est venue filmer les soirées privées des soldats. On ne le voit jamais
jouer aux cartes. S’agit-il d’un tabou ?
Un dernier élément de la vie quotidienne réside dans l’événement incontournable en
Afghanistan qu’est le buzkachi. Ce sport national équestre, rendu légendaire par les récits
d’aventure de Kessel, oppose des cavaliers qui se disputent une carcasse de mouton. Les
cavaliers portent toutes sortes de tuniques et de vêtements, des plus traditionnels aux plus
modernes. Certains ont le torse découvert. Les cavaliers font preuve d’une grande adresse
pour se pencher au flanc de leur cheval ramasser la carcasse, tandis que le cheval se raidit ou
s’entrechoque avec une autre bête. Tiré par les rênes, celui-ci découvre sa gueule et les dents.
Les poses sont uniques. Les hommes se couchent sur le cheval. Les chevaux se mêlent dans
89
une cohue incompréhensible, enveloppés de poussière générée par leurs mouvements192.
Toutes ces images sont d’une beauté esthétique certaine, mais révèlent surtout l’intérêt visuel
des Français pour les loisirs afghans, qui dans son caractère exceptionnel semble évacuer tout
loisir banal d’hommes en opérations extérieures. Les loisirs classiques, les moments triviaux,
les habitudes quotidiennes les plus élémentaires, quand ils n’ont pas de caractère
exceptionnel, ne sont pas représentés dans notre échantillon. Après recherche, nous n’en
avons pas trouvé sur toute la période. Il est difficile pourtant d’établir un constat dans l’absolu
– les remarques sur le fond Afghanistan sont plus que jamais obligatoires ici, celui-ci étant en
perpétuelle construction. Mais la tendance générale semble dessiner une frontière derrière
laquelle l’intimité des hommes n’est pas représentable visuellement, ligne de démarcation qui
distingue le travail des reporters de l’ECPAD des journalistes du civil, friands, eux, d’images
triviales et quotidiennes, et prompts à les monter dans leur reportage. Ce n’est pas que
l’ECPAD ne s’y intéresse pas, au contraire. Les reporters ont révélé leur attrait pour les
images de vie quotidienne, mais celles-ci, compte tenu de l’insertion au cœur des personnels
qui doit tenir compte de l’intimité, puis de la somme de travail déjà réalisée dans la journée,
sont peut être les plus difficiles à réaliser. Un aperçu montre certes les conditions de vie
rustiques, mais pas les moments. Les images, sans ces parts de vie, ne se résumeraient plus
qu’à des activités purement militaires, uniquement orientées vers les objectifs stratégiques.
4.3. D’autres formes de combat
4.3.1. Le rêve d’un Afghanistan nouveau
La reconstruction de l’Afghanistan est la mission impérieuse que s’est confiée la
communauté internationale. Sur place, quelques éléments essaient de lui donner une réalité.
En visite en Afghanistan, la ministre de la Défense Alliot-Marie se félicite du déroulement de
la Loya Jirgah, sensée donner une Constitution à l'Afghanistan. « Mes interlocuteurs
rencontrés aujourd'hui disent que les nominations se passent très bien »193. La cassette n°9, sur
l’année 2002, est d’ailleurs entièrement consacrée au premier moment de la reconstruction
politique de l’Afghanistan : la Loya Jirgah est une sorte de Congrès national très élargi, où les
dépositaires de pouvoirs locaux sont représentés. Les images tournées par l’ECPAD, au
192 Référence D190-3, photos 1 à 23, avril 2004. 193 Référence 02.9.96, cassette n°3, TC 21 :15.
90
milieu de bien d’autres filmées par des journalistes, révèlent la grande symbolique qui entoure
cette journée, consacrée à des cérémonies et des discours, sensées représenter l’investiture du
nouveau pouvoir. Il suffit de lire la feuille de dérushage pour s’en donner un premier aperçu :
« K7-9 : Site de la Loya Jirga (Afghanistan)- Nouveau gouvernement afghan - Entrée de la Loya Jirga - Tente de sécurité - Arrivée de 1500 afghans - Intérieur ancienne école polytechnique, bâtiments et allées - Tentes extérieures - Début des délibérations entre afghans - Site principal de la Loya Jirga, fermé pour une semaine - Début de la cérémonie d'ouverture et prière - Groupe musical traditionnel afghan - Défilé des différents représentants de groupes ethniques afghans - Formation du drapeau Afghanistan - Chant d'enfants, public - Discours du président par intérim Hamid Karzaï - Discours de M. Brahimi, sous Secrétaire général aux Nations unies. »194
Les rushes livrent un panorama intéressant de cette journée très politique. Des officiels
afghans entrent progressivement à l'intérieur d'une tente de sécurité, passant sous un panneau
qui marque l’interdiction de venir armé, représentant une kalachnikov barrée d’une croix
rouge. Ils rentrent dans l'intérieur d'une ancienne école polytechnique. Ils sont entourés et
encadrés pour la sécurité par des militaires de la coalition. De premières images font
apparaître des discussions, où des responsables sont regroupés en cercle, à genoux, sous une
tente, avec la présence de quelques femmes. Certains ont un chapelet à la main. Le lieu de la
cérémonie est le grand hall d’un ancien bâtiment. Plusieurs centaines de personnes sont
réunies. La cérémonie s’ouvre par un temps de prière, de chant. Les délégués sont assis aux
premiers rangs dans la salle, les militaires de la force internationale au fond. Deux écrans
géants retransmettent en haut d’une scène l’événement qui s’y déroule. On y a monté une
grande carte de l’Afghanistan. Tandis que des musiciens commencent à chanter, des
représentants des groupes ethniques de l’Afghanistan – un couple d’un jeune garçon et d’une
jeune fille, parfois des enfants – vêtus de costumes traditionnels, défilent sur l’estrade. Ils
viennent, chacun, coller sur la carte de l’Afghanistan le morceau qui représente leur lieu
d’origine. Qui le sud, qui l'ouest, qui le nord. Ainsi les Pachtounes, les Hazaras, les
Baloutches, les Tadjik, les Ouzbeks se succèdent. La dernière à être posée est celle de Kaboul.
Au final, chaque morceau de couleur assemblé finit par composer, tous ensemble, les couleurs
du drapeau de l'Afghanistan. Une fois le drapeau constitué, quatre hommes présents sur la
scène s'agenouillent devant lui et l'embrassent. Cette cérémonie terminée, les enfants
entonnent l’hymne afghan. Un plan ultime montre la salle où, tous les délégués, se tenant la
main, chantent ensemble. Il est intéressant de lire dans cette cérémonie l’assemblage de
194 Référence 02.9.96, cassette n°9.
91
différents groupes composant l’Afghanistan, comme entérinant de fait la multiplicité
« ethnique » du pays. Si on lit Olivier Roy195, la société afghane est sociologiquement
éminemment complexe et on ne saurait y faire reposer la construction du droit. Il nous invite
plutôt à lire une double dimension : « le mythe de l’unité afghane », et « la réalité de la
segmentation » ethnique. La cérémonie, ici, conjugue ces deux éléments dans une approche
assez pragmatique de construction nationale. Le temps de prière n’oublie pas de mentionner le
caractère islamique de la nouvelle République. La dimension internationale est complètement
présente : la cérémonie se clôt par un discours de M. Brahimi, sous secrétaire général aux
Nations unies. La présence des Nations unies, et de nombreuses délégations étrangères, ne fait
pas que donner un sceau de légitimité au nouveau pouvoir. La communauté internationale, ne
serait-ce qu’en vertu de la mission d’assistance qu’elle s’est confiée, fait intégralement partie
du jeu politique. Il n’est donc pas anormal de la voir constamment présente à l’image.
Les Français s’incluent dans les images de reconstruction politique comme des
assistants, en premier lieu sur le terrain. Cette assistance passe d’abord par la sécurité.
D’autres cérémonies politiques ont ainsi été couvertes par l’ECPAD. D’abord avec les
élections législatives en septembre 2005 : le 35e Régiment d’Infanterie a participé à la
sécurisation de nombreux bureaux de vote à Kaboul196. Une cassette de rush illustre le travail
effectué : patrouille dans un district de police dans Kaboul, visite des représentants officiels
de l’armée française à certains bureaux de vote, et, bien sûr, les électeurs Afghans eux-mêmes
appelés aux urnes. Les élections sont même le cœur de l’actualité de l’année 2005, formant
une part non négligeable des photos mises en ligne sur le site de l’ECPAD pour illustrer cette
année là : pas moins d’une douzaine de photos, sur la trentaine que compte le portfolio
internet. L’image de Français assistant la démocratisation du pays entre complètement dans
l’objectif de communication. Il valorise l’engagement militaire et le légitime. Ensuite, avec
aussi une présence française, l’Afghanistan célèbre sa fête d’indépendance en 2006. La
France y a participé d’une certaine manière, puisque des maîtres-chiens ont inspecté, à la
recherche d’explosifs notamment, toutes les salles du stade olympique de Kaboul197. Celui-ci
prête le lieu pour fête, discours et défilés d’associations patriotiques et sportives. Beaucoup de
jeunes gens en costumes traditionnels se succèdent, avec musique et danses, sous un portrait
immense du commandant Massoud et d’autres figures « nationales ». La fête voit aussi le 195 ROY, Olivier, « De la stabilité de l’État en Afghanistan », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2004/5-6, 59e
année, p. 1183- 1202. 196 Référence 05.9.97, cassette n°19. 197 Référence 06.9.110, cassette n°13.
92
passage au pas de membres de l’armée afghane avec sabre à la main, mais aussi de défilés
d’ouvriers, de femmes, de l’équipe de football…
Au moins trois moments de fêtes et de vie politique afghanes ont été suivis par
l’ECPAD entre 2002 et 2006. Ce, sans compter les rencontres entre le ministre de la Défense
et Hamid Karzaï, ou les diverses photos des haut dignitaires du nouveau régime, qu’on
pourrait ranger dans la même catégorie. Si les équipes images sont envoyées pour couvrir ces
évènements politiques, c’est qu’il y a un enjeu certain autour de la construction politique
nouvelle de l’Afghanistan. Ces images ont trouvé leur voie dans la communication en étant
représentées dans les supports internet, notamment de l’ECPAD lui même ou de l’Etat-major
des armées.
4.3.2. Les actions civilo-‐militaires : reconstruire le pays
Pour aider sur le terrain l’émergence d’un nouvel Afghanistan, et donc accompagner
sa reconstruction, les forces de l’ISAF ont accordé une part importante aux actions civilo-
militaires. L’idée étant de « faire évoluer la victoire militaire sur les talibans vers un succès
politique »198. Au début de la période, ces actions CIMIC semblent facilitées par un contexte
favorable : en témoigne les premières images consultées, qui permettent d’esquisser une
première analyse. D’abord, il n’y a pas de combats, ensuite, et en conséquence, l’accès aux
civils est grandement facilité. Ce sont les deux grandes lignes que nous avons déjà
développé : elles se mettent en cohérence dans les missions ACM ou CIMIC, qui, en
approchant la population, cherchent à mener des projets concrets. L’ECPAD les a suivi ;
retenons la mission de 2003.
C’est le lieutenant de vaisseau Favé, une jeune femme, qui dirige l’équipe ACM. Nous
sommes en avril 2003. Une première scène filmée dans les rushes présente une réunion entre
le lieutenant de vaisseau et l’ONG française « Sports sans frontières »199. L’ONG présente son
projet, et si on ne récupère que quelques informations parcellaires – la caméra ne tourne pas
en continu, on constate la synergie entre l’organisation civile et l’équipe militaire. Sur le
terrain, le contact simple et sans mesures de sécurité extraordinaires se confirme. Se
retrouvant entourée d'hommes, civils, dont l'un lui tend un papier et parle, en anglais, d'un
hôpital et de Pol-E-Sharki, elle tente de résoudre une situation, qui ne lui paraît pas critique. 198 Doctrine, n°13, septembre 2007. P. 104. 199 Référence 03.9.55, cassette n°7.
93
Elle y fait face avec calme. L’Afghan avec lequel elle s’entretient parle d'un patient à son
village, lui demande de le prendre pour l'emmener à l'hôpital. Se forme rapidement un
attroupement, qui dure plusieurs minutes. En fait, les Afghans semblaient demander un
médicament. Une fois une solution trouvée, elle s’en va. Cette scène montre que toute
rencontre avec les civils se fait sans difficulté, sans mesures de sécurité qui créeraient, entre
les ACM et la population, une porte coupe-feu ; elle montre aussi la patience de l’équipe, en
particulier de son chef, pour tenter de trouver une solution. Une manière, nulle doute, de
susciter chez les Afghans des sentiments de sympathie. Les tournées dans les villages font
apparaître d’autres caractéristiques des ACM. Toujours avec un équipement allégé, les
équipes s’entretiennent avec les autorités locales et font l’inspection des projets lancés.
L’interview du capitaine Favé livre quelques enseignements.
« Nous notre priorité c'est de concentrer nos efforts sur les zones sensibles. Notre première mission c'est de faire en sorte d'intégrer les forces françaises au premier abord. C'est ça donc quand on voit qu'il y a des zones un peu sensibles, qui pourraient être gênantes pour les missions des patrouilles françaises, c'est là qu'on oriente notre action, ça peut être une école, mais ça peut être aussi ce qui est santé, ce qui est puits. On s'adapte en fonction de l'environnement, en fonction des problèmes de chaque village. La priorité, c'est faciliter le travail des patrouilles françaises pour qu'elles ne soient pas l'objet de pierres ou d'agression particulière, ou d'agressivité. C'est cibler notre action. »200
Interviewée directement sur le terrain, elle livre aussi quelques éléments de réponse
sur le montage d’un projet et son financement. On apprend ainsi que les financements peuvent
être pris soit sur l’Etat-major des armées, jusqu’à cinq mille euros, soit, si ce budget est
dépassé, via la FIAS. Le projet est alors examiné par un officier projet au CIMIC. Outre ces
caractéristiques pratiques, l’interview nous donne des renseignements sur les conditions
locales et nuancent l’idée de la tranquillité totale. Le reporter l’interroge ensuite sur sa
différence par rapport aux patrouilles, « vous ne semblez pas avoir de protection
particulière ? » :
« Volontairement, on ne mélange pas les gens. Quand on quitte le campement, on a le casque à portée de main, la frag (gilet), dès lors qu'on arrive sur les pistes, ou à proximité des villages, on enlève les frag parce que c'est plus convivial pour les villageois. Ils associent moins le militaire guerrier, il n'y a pas cette barrière, ce côté un peu imposant. Quoiqu'il en soit, lorsque nous repartons sur le trajet, on la remet, c'est évident. »
200 Idem, TC 18 :00
94
Il y a donc, d’une part, un « ciblage » des opérations CIMIC dans des zones
« sensibles », que rien ne laisserait deviner comme telle à l’image. Elle fait aussi référence à
des « pierres » ou des formes d’ « agressivité ». Certains villages seraient donc moins
accueillants. De ces formes d’agressivité, on ne pourrait avoir aucune idée sans ces précieuses
bandes son où l’officier livre son témoignage. D’autre part, pour répondre à cette agressivité
potentielle – on ignore comment elle est mesurée – les forces françaises choisissent de se
mettre en avant par des actions clairement identifiables, « mettre les forces françaises en
avant », au bénéfice de la population. L’objectif est donc d’obtenir le calme en se montrant
généreux. Ces deux enseignements sont fondamentaux. Derrière eux, pointe l’idée que le
calme n’est pas « acquis », comme pourrait nous le laisser croire les images décontractées que
nous avons présentées jusqu’ici. Le tableau est plus complexe. Si les images de l’ECPAD ne
filment pas des traces d’agressivité – comme des jets de pierre – c’est sans doute, pour une
part, parce que l’ECPAD n’est pas sur place à ce moment là. Être au bon endroit au bon
moment ne va pas de soi. Mais aussi, et peut être surtout, parce que ça ne colle pas aux
objectifs de communication. Voir des images d’une partie de la population qui rejette l’arrivée
des Français pourrait faire mauvais genre. L’adjudant Larue nous avait bien rappelé que la
situation s’était dégradée « progressivement », notamment par des cailloux, et que, pour
certains Afghans, les talibans n’étaient pas regrettés. Le tableau ne peut pas être unique sur
l’Afghanistan, même en 2003. Elle précise à ce sujet la diversité des endroits et des
situations : « On a l'interprète, lui il est capable d'arriver dans un village, et de dire "non on
n’y va pas", il sent la température. Si c'est bon, on lui explique les objectifs. L'interprète fait
partie de l'équipe, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils connaissent nos moyens. » Rappelons que
ces images sont tournées juste avant la visite de Bernadette Chirac, qui donnait l’impression
d’une situation radieuse. Les choses, dans la réalité, sont plus complexes et les missions
CIMIC ont un objectif tout stratégique de conquête « des cœurs et des esprits », selon
l’expression consacrée. Pourtant, les images semblent livrer un message en dehors de ce
contexte. En attestent les distributions de fourniture scolaires, maintes fois photographiées.
Sur l’échantillon, ces images se répartissent d’ailleurs uniformément sur toute la période.
Comme si ces actions ponctuaient régulièrement l’activité sur place. En 2004, un exemple
illustre ce fait. Le matériel comprend des stylos, des crayons de couleur, un carnet et un
cahier. Les militaires font la distribution201. Les enfants sont photographiés. Les scènes,
globalement, se rapprochent de l’action humanitaire désintéressée dans leur image, alors que
201 Référence D190-3.
95
ce n’est pas le cas. Les CIMIC sont une manière de combattre, en plaçant l’adhésion de la
population au cœur d’une préoccupation stratégique. On constate donc une nuance entre la
réalité des faits et les images qui, parce que partielles et partiales, viennent construire,
notamment par le prétexte des ACM, une réalité subjective où prédomineraient paix et
tranquillité.
4.3.3. Epauler la nouvelle armée afghane
Reconstruire une armée afghane est un des objectifs directement affirmé par la
ministre lorsqu’elle se rend en visite en Afghanistan en 2002. C’est une réalité e dès les
débuts. La formation de l’armée afghane commence le 3 avril 2002 par la formation du 1er
bataillon de la garde nationale afghane par la FIAS. Son premier déploiement opérationnel
intervient en octobre 2003 pour la sécurisation, aux côtés des forces de la coalition, de la Loya
Jirgah constitutionnelle. Les premières OMLT (Operationnal Mentoring Liaison Team)
interviennent en 2006 : auprès de l’Etat-major du 201e corps de l’Armée nationale Afghane
(ANA). La France accompagne progressivement cette montée en puissance, mais avec la
retenue qui caractérise l’engagement français sur cette période. Pourquoi former une armée
afghane, quand les images démontrent une situation proche de la paix ? Comment, compte
tenu de l’environnement visuel que nous venons de décrire, la France explique son rôle dans
la formation de l’armée afghane ? L’ECPAD interviewe en juin 2002 un ancien général de
l’armée afghane passé par les stages de commando en France. Il explique : « L'Afghanistan
est passé par une guerre terrible, et aujourd'hui on reconstruit une armée. » Le reporter
propose une remarque, n’est-il en effet, selon ses mots « pas plus urgent de faire des
architectes que des combattants ? ». Remarque à laquelle il répond que « d'abord il faut la
paix en Afghanistan, ensuite les autres choses suivront. »202 Façon d’admettre, d’abord qu’il
n’y a pas la paix en Afghanistan en 2002, ensuite que la formation d’une armée est prioritaire
sur tous les autres sujets de reconstruction. Préparer ses forces est le combat prioritaire.
Pour les Français, la formation de l’armée afghane est limitée. Cela se passe d’abord
en classe ou en exercice. Les français donnent cours aux soldats afghans, aux côtés d’un
traducteur. Il y a une mise en scène du transfert de savoirs plus que de savoirs faire (photo 37
et 38, photo de dos en plongée des afghans prenant des notes sur leur cahier). C’est l’école de
202 Référence 02.9.96, cassette n°3.
96
la guerre203. Que ces photos en classe, en grand nombre dans les archives, aient plutôt disparu
de l’échantillon mis en ligne par l’ECPAD nous interroge. Celles-ci retiennent plutôt les
exercices de mises en situation réelles, par contre bien exploitées par la vidéo. C’est le DIO,
Détachement d’Instruction Opérationnelle, qui se charge de ces formations. Les Français ont
hérité de la formation des officiers. En avril 2003, le lieutenant-colonel Soudieu explique que
« le DIO vient de terminer la formation des officiers du 8e BANA (Bataillon de l'Armée
nationale Afghane). A l'issue des 10 semaines, il a fallu mettre sur pied un exercice pour
former ce bataillon, former la cohésion, et l'assembler. Nous les Français avons en charge la
formation des officiers, les Anglais la formation des sous officiers, les Afghans forment eux-
mêmes leurs soldats. Cet exercice est un exercice de cohésion. Pour la première fois le 8e
bataillon manœuvre ensemble. »204 Les vidéos montrent les Afghans en diverses situations :
pour exemples, en assaut, en évacuation de blessé, en tir de mortier, initiation au camouflage
ou, bien sûr, au maniement des armes205. Les Afghans ont ainsi appris, en plusieurs mois, un
socle de connaissance rudimentaire sur le combat. Dans les interviews, les questions des
reporters font ressortir plusieurs axes : l’expérience des combattants, une partie d’entre eux
ayant déjà combattu dans la résistance ; le degré de réception des Afghans aux formations que
les Français leur dispensent ; le déroulement concret des exercices. Les réponses cherchent à
montrer que les Afghans, souvent expérimentés, sont tout de même réceptifs. « Pour avoir
discuter avec eux, leur demande est de leur apprendre à défendre leur pays. Ils perçoivent la
France comme une aide. Ils veulent défendre leurs frontières, ont une animosité féroce envers
le Pakistan. », répond l’un des formateurs. Il est intéressant de noter que les mots de
« talibans » ne sont alors que rarement prononcés. Le danger perçu, semble-t-il, par les
Afghans, est plutôt extérieur.
Dans les rushes, il est aussi intéressant de remarquer la position des Français, et de
noter que, même s’ils sont dans une position d’enseignants, ils n’en demeurent pas moins en
retrait : les consignes sont données aux cadres qui les répercutent au niveau de leurs unités. Et
lorsqu’ils mettent en œuvre un exercice, les Français observent scrupuleusement ce retrait, lui
203 N2003-111, planche 13 légende : « instruction par le DIO (Détachement d’Instruction Opérationnelle) à
l’armée afghane.
« 01 à 15 et 35 à 49 : Instruction par les instructeurs français du DIO aux militaires de l’armée afghane. Photo de
groupe des militaires de l’armée afghane devant le bâtiment d’instruction du PIO. »
204 Rérence 03.9.55, cassette n°8, TC 07 :16. 205 Notamment, référence 02.9.96, cassette n°15.
97
même étant ensuite répercuté à l’écran, lors de la captation audiovisuelle. Lors de l’exercice
final, le commandant Chauvié a « donné ses ordres » au commandant Afghan. « Lui même a
réparti ses groupes, donné ses ordres à ses chefs de groupe. On n’attend plus que l'officier de
sécurité donne ses ordres pour que l'exercice commence. » Il explique alors son rôle dans
l’exercice. « Je suis le conseiller, je suis à la fois directeur d'exercice parce que j'ai aidé à
monter l'exercice, et conseiller auprès du commandant d'unité et des chefs de section. Eux
mêmes dirigent leur manœuvre comme ils l'entendent. Nous sommes là pour l'aspect sécurité
des tirs, et pour conseiller. »206 Les Français et les Britanniques, qui supervisent l’exercice,
suivent les Afghans dans leur progression – ils simulent un assaut – avec des drapeaux de
couleur. On entend, en sonore, les claquements de tir tandis qu’ils tirent sur des cibles à
quelques centaines de mètres ; un Français intervient tout juste pour aider lorsqu’une
mitrailleuse s’enraye. Une nouvelle interview du colonel Soudieu précise le cadre
d’intervention des Français. Il explique qu’à partir de janvier 2003, la formation académique
des officiers afghans serait prise en charge par les Français. Il parle de l'opération EPIDOTE.
« EPIDOTE, contribution française au CTAG (Combined Training and Advisory Group, le
groupe exécutif de formation de l’armée afghane), oriente depuis plusieurs années ses efforts
vers la formation des officiers subalternes et supérieurs ; elle dispense également
ponctuellement des cours au profit des officiers du renseignement militaire. La formation des
officiers subalternes est réalisée au Kaboul Military Training Center (KMTC), grand camp
militaire situé à la sortie Est de Kaboul. Sur ce site se côtoient les militaires du rang
fraîchement recrutés, les sous-officiers et les officiers en phase de formation initiale. »207
EPIDOTE est la mission française de formation des officiers, mais dispensée dans un cadre
fermé qu’est le KMTC. Le colonel Soudieu expliquait à l’écran que, quand ils quittent l'école
militaire, les Afghans sont ensuite pris en charge par les Américains, par des embedded
training team, et vont jusqu'au terrain. Mais les Français ne vont pas au delà de l'ISAF
(Kaboul) et donc la Kaboul Military Training Center. Le mandat est strict, pas d'engagement
en dehors de Kaboul, pas d'équipe qui encadre sur le terrain pendant des opérations208. Donc,
pas de participation à des opérations de combat en situation réelle. Toutefois, une objection
est à faire. Sis vis pacem para bellum : on ne construit pas une armée si ce n’est pour préparer
des combats futurs. La France n’entend pas participer à ces combats directement, 206 Référence 03.9.55, cassette n°8, TC 21 :37. 207 « Epidote : facette complémentaire ou pierre angulaire du dispositif français en Afghanistan ? », Doctrine,
n°17, juillet 2009. 208 Référence 03.9.55, cassette n°8, TC 44 :11.
98
l’implication doit rester limitée. Les images d’exercice, de formation, cherchent à mettre en
scène cette réalité par une présence française aux côtés des Afghans jusqu’à un certain seuil,
en se gardant bien de le franchir.
Les images présentent les débuts de l’intervention en Afghanistan comme la
réouverture de relations franco-afghanes basées sur la coopération et l’entraide. Se succèdent,
dans cette démonstration, les images de grands projets, les déplacements officiels qui en
soulignent l’enjeu politique, et les preuves d’un climat paisible sur le terrain, entre la
réouverture du raid en 2 CV, plutôt amusant, et l’accueil favorable des populations. Limités à
Kaboul et sa région, les Français ne sont pas, théoriquement, en première ligne entre 2002 et
2006. Les images de patrouille ne montrent pas d’incidents. Dans la vie quotidienne, bien
qu’entourées d’inconnues, les images montrent les Français dans les rues de Kaboul.
Mais à ce tableau uniquement dominé par la paix et la tranquillité, d’autres indices
dans les archives audiovisuelles viennent apporter de la nuance, de la contradiction, dans
lesquelles s’affirme toute la complexité de la réalité en Afghanistan. Que les patrouilles ne
connaissent pas d’incidents révèlent certes un climat serein, mais tient aussi du fait que les
quelques incidents ne sont probablement pas filmés. Ce qui est une donnée de poids. On ne
peut limiter l’analyse des images sans en connaître le contexte, sans deviner les objectifs
stratégiques, sans considérer les buts de communication. D’ailleurs, on devine que si la
France limite volontairement son intervention, par prévention de dégâts potentiels, elle
entreprend le combat par d’autres moyens : reconstruction politique, actions auprès des civils,
formation de l’armée afghane. L’armée se filme mais ne se filme pas n’importe comment et
dans n’importe quelle situation. La communication domine. L’intérêt, c’est de voir comment
va réagir cette doctrine face au changement de contexte et à la dégradation de la situation.
Voir si les images vont fléchir. S’il y a l’image d’une paix en 2002, elle n’est que temporaire,
elle n’est que relative, et s’estompe dès 2006.
99
Chapitre 5. Le retour progressif de la guerre
La guerre ne revient pas d’un coup lorsque tombent les dix Français en Uzbeen. Si
retour de la guerre il y a, celui-ci est diffus et progressif. Le changement de contexte en
Afghanistan intervient à la suite d’une succession complexe de causes diverses, notamment,
en ce qui concerne Kaboul, le regain d’activités des moudjahidines fidèles à Gulbuddin
Hekmatyar et son Hezb-e-Islami, groupe qui a combattu les Soviétiques dans les années 1980
et qui a participé à la guerre civile des années 1990. Parce qu’il n’est pas admis dans le
nouveau jeu politique afghan, il reprend le chemin des armes. D’autres groupes deviennent
actifs et le redémarrage de l’escalade guerrière est encore difficile à fixer dans le temps.
D’autant plus qu’il est difficile d’identifier qui sont les « insurgés » : parmi eux, des talibans,
des membres d’Al-Quaeda sans doute, mais aussi des bandits ou des paysans sans le sou.
L’échec de la coalition multinationale, emmenée par les Américains, est peut-être aussi
l’échec du nouveau système politique dirigé par le président Karzaï, manifestement corrompu
et instable. Les dernières équipes image qui rentrent d’Afghanistan, en 2011 et 2012, ont
ramené avec elle des films impressionnants des TIC, pour Troop in contact, des affrontements
avec ces insurgés, invisibles à l’écran, où la furie des armes est assourdissante. L’image
montre des tapis de balles au sol, témoignant de la violence de l’affrontement209. L’image de
guerre à proprement dite est rarement directe : il faut la deviner. D’une image de paix qui
domine en 2002 au choc d’Uzbeen en 2008, l’évolution est diffuse et le retour de la guerre se
fait progressivement. C’est ce retour, dans l’image, que nous interrogeons. Il se manifeste
d’abord par une dégradation sécuritaire, qui inclut de nouvelles mesures de sécurité, de
nouvelles tactiques employées par « l’ennemi » alors que la population, qui reste présente à
l’image, devient plus difficile à approcher. 2007 fait intervenir un changement de contexte
important pour les Français : nouvelle responsabilité en Kapisa, nouvelles missions avec les
OMLT. Enfin, surtout, Uzbeen force l’image à coller à une réalité nouvelle : la mort.
5.1. La dégradation sécuritaire
209 De telles images sont visibles dans le film « Derrière le mur : Le 126e RI en Afghanistan ».
100
5.1.1. Camps retranchés et premiers décès
La situation ne se dégradant pas en un seul coup, il est difficile de véritablement
identifier un moment pivot. Progressivement, de nouvelles mesures de sécurité se mettent en
place. Elles concernent surtout le nouveau camp de Warehouse, à Kaboul, où les Français
s’installent à partir du 14 juillet 2006. Alors que le camp de Kersauson, à l’aéroport de
Kaboul, paraissait plus petit et moins encadré par des mesures de sécurité, les films de 2006
témoignent de conditions plus strictes et plus procédurières. La feuille de dérushage nous
indique :
« Compagnie de protection du camp de Warehouse, 126e régiment d'infanterie de Brive la Gaillarde : les équipes de contrôles sont à l'entrée du camp pour vérifier l'accès à l'enceinte avec l'aide d'équipe cynophile. Les chiens et leurs maîtres contrôlent les camions et les véhicules, contrôle de camions citerne. Images du camp de Warehouse, passerelle et circulation d'un VAB à l'intérieur du camp »210
Les images de l'entrée du camp font apparaître des conditions de sécurité drastiques.
Le soldat français, qui passe le détecteur de métaux sur des civils qui se présentent à l'entrée,
a l'air jeune et semble prendre très au sérieux sa mission : une expression sévère, dure, est
imprimée sur son visage. La zone d’entrée est entourée de plusieurs sacs de sables et
comporte plusieurs zones successives pour contrôler le flux des entrants. Un long corridor
surmonté de fils barbelés mène jusqu’aux divers portiques de sécurité. Les civils sont fouillés
au corps par des soldats211. Derrière leur poste de contrôle, on voit que les soldats ont des
photos de personnes recherchées. Ces images permettent également de nous emmener aux
côtés d’un maître chien – l’équipe cynophile. Ils réalisent l’inspection d’un camion : le maître
indique de la main là où il souhaite que le chien, obéissant, aille sentir. Le camion est
entièrement passé en revue. Une fois inspecté, le camion redémarre pour entrer dans le
camp212. Les voitures sont inspectées à l’aide de miroirs, placés au bout de perches, pour
sonder les châssis des véhicules. Les véhicules passent ainsi devant deux lieux d’accès
différents, le dernier étant gardé par un binôme qui contrôle les autorisations d’accès. Le flux
des entrants est donc soigneusement maîtrisé et contrôlé. La sécurité du camp est enfin
assurée par des patrouilles régulières.
210 Référence 06.9.110, cassette n°11. 211 Idem, TC 02 :46. 212 Idem, TC 07 :20 à 11 :50.
101
L’ECPAD interroge une de ces équipes chargées de patrouiller : « Pour la sécurité du
camp de Warehouse, on effectue des patrouilles pour voir si il y a des trous dans le grillage.
[…] On se met en poste de surveillance pour voir les villages alentour. [Il y a] 2 patrouilles
de nuit et 1 d'après midi, la nuit on a un maître chien. »213 Ces images n’interdisent pas de
penser que le camp de Kersauson était entouré de procédures de sécurité similaires, mais les
civils afghans y entraient avec moins de difficultés, et, en règle général, les allées et venues
étaient plus fluides. En témoignent les diverses prises de vues prises lors des départs en
patrouille ou en ACM des soldats français. Ce qui est remarquable, c’est que l’image, ici,
s’arrête bien volontairement sur des mesures de sécurité particulières qui impliquent des
fouilles approfondies des véhicules et des hommes. En fin de compte, les deux cassettes nous
montrent que, s’il y a quelque chose à défendre, il est « bien » défendu.
Tous les soldats sont bien entendu équipés d’une arme. A ce sujet, notons que tout
soldat qui entrent au camp décharge son arme. On les voit ainsi descendre des blindés pour
s’assurer que leurs armes ne sont plus chargées214, en les vidant près d’un mur prévu à cet
effet. D’une certaine façon, on peut deviner qu’ils sont amenés à s’en servir à l’extérieur.
Lorsque l’on voit les soldats français enlever leur équipement, à comparer avec les images
précédentes, la différence est frappante. L’équipement est bien plus lourd : casques, armes
toujours présentes, le gilet (ou frag). Sur l’échantillon des photos en ligne, l’équipement des
hommes est de niveau « moyen » ou « soutenu », en moyenne, surtout à partir de 2007. 67%
des photos sont de ce niveau sur l’année 2007, 79% en 2008. Sur l’année 2008, 50% des
photos font apparaître des équipements « soutenus », notamment parce qu’il est beaucoup
question de camouflage, que sont mis en scène des tirs de mortiers, même s’il s’agit
d’exercice, et, surtout, parce que 2008 est la seule et première année où sont publiées des
photos tirées du combat. A l’inverse, en 2002, 92% des photos montrent un équipement plutôt
léger, sans casque ou gants, 76% en 2003, 60% en 2004, 51% en 2005215. De la même
manière, significativement, il y a plus de photos prises où l’on voit une arme en 2007 et 2008
qu’auparavant : 67% des photos en 2007, 79% des photos en 2008. La construction des
portfolios tend à montrer une image où la fonction combattante est bien plus illustrée sur la
fin de la période ; et l’image du militaire armé s’oppose à l’image d’un militaire sans ou avec
peu de protections entre 2002 et 2005.
213 Référence 06.9.110, cassette n°12, TC 40 :34. 214 Référence 06.9.110, cassette n°11, TC 16 :10. 215 Le tableau est reproduit en annexe.
102
Progressivement aussi apparaissent les images des premiers blessés et des premiers
décès. Le ministre de la Défense effectue une visite, le 4 novembre 2005, aux blessés
d’Afghanistan à l’hôpital Percy, de Clamart, dans les Hauts-de-Seine 216 . L’ECPAD
l’accompagne. Ni l’image ni la légende ne disent où et comment les hommes ont été blessés ;
par hypothèse on suppose qu’ils l’ont été durant les opérations des forces spéciales. Les
premières images d’un décès interviennent en mars 2006, avec les obsèques du maître
principal Loïc Lepage des commandos marine217. Les obsèques ont lieu en présence du
général Bismullah Khan, « des forces armées d’Afghanistan ». Une procession militaire en
présence du ministre de la Défense Alliot-Marie, et du Chef d’Etat-major des armées Henri
Bentégéat, de nombreux officiers de la marine ou de l'armée de terre, rend honneur au défunt.
A l’intérieur de ce qui semble être une grande salle de la caserne de Lann-Bihoué, une messe
catholique est célébrée en sa mémoire. Loïc Lepage est décédé dans la région de Kandahar
des résultats d’un tir ennemi, selon les informations du site icasualties.org qui recense les
décès en Afghanistan et en Irak. Avant lui, Cédric Crépel était décédé des mêmes causes, la
même année, à Spin Boldak. Tous deux opéraient pour les forces spéciales. Ces premières
images de cercueil viennent rappeler une réalité de la guerre, pourtant inconnue sur le terrain.
Jannick Marcès a couvert les missions ARES à la FOB Kogiani. Un autre a été à Spin Boldak.
L’adjudant-chef raconte que « quand [il est] arrivé, sur cette mission dans ce contexte là [,] ils
venaient de perdre un infirmier sur un IED. » 218 Mais il affirme ne pas avoir vécu
d’accrochages avec eux. A Kaboul, en 2005 et 2006, les choses restent encore relativement
calmes mais on perçoit déjà, dans quelques images, une résurgence des tensions. Elle est
perceptible dans les nouvelles conditions de sécurité, dans la différence des équipements que
portent les soldats. L’OTAN, à Kaboul, s’adapte à un ennemi qui connaît une nouvelle
vigueur.
5.1.2. Où est l’ennemi ?
La « menace » des insurgés ne revient à Kaboul qu’à partir de 2006, expliquant en
partie les nouvelles mesures de sécurité. « Dès 2006, la situation sécuritaire se dégrade, y
compris à Kaboul, avec l’apparition des attentats suicides et des IED, deux techniques
216 Référence N2005-368 ; 23 clichés. 217 Référence N2006-073 ; 108 clichés. 218 Entretien avec l’adjudant-chef Jannick Marcès, janvier 2012.
103
importées d’Irak »219. Ainsi, tel que l’estime Oriane Barat, en Afghanistan ce sont ces deux
nouvelles tactiques des insurgés qui modifient le contexte sécuritaire en Afghanistan. Les
forces françaises y réagissent : c’est essentiellement cette réaction qui apparaît dans les
images de l’ECPAD. Dans son édition de 2008, le Livre Blanc de la Défense mentionne, dans
le volet « Intervenir » que « la possibilité de pertes significatives est une réalité que la France
et ses armées doivent être prêtes à assumer. » En conséquence, il suggère ce qui suit :
« La protection des forces suppose en particulier : – un investissement dans des matériels dont la protection a été renforcée, notamment en ce qui concerne les véhicules terrestres et les hélicoptères, les moyens de brouillage et de détection anti-IED, ainsi que les dispositifs contre les missiles tactiques et les équipements de protection NBC [Nucléaire, Bactériologique et Chimique].»220
Le renforcement des protections intervient notamment pour prévenir les fameux
Engins Explosifs Improvisés (EEI), dont le terme, plus courant, est anglais : Improvised
Explosive Device. Il s’agit de bombes artisanales placées au bord des chemins, qui explosent
au passage des convois. Cette technique a pour objectif de maximiser les dégâts, de
compliquer les déplacements de la coalition, et ce dans une totale asymétrie des forces
puisque les poseurs de bombes peuvent être en nombre et équipements très réduits.
« Constamment, chacun se rehausse en fonction des techniques que les autres mettent en place. Je l'ai vécu avec les forces spéciales : les IED c'était des techniques simples avec des contacts avec des lames de scie - quand des véhicules passaient le contact se faisait et l'engin explosait - mais cela pouvait être impopulaire dans le sens où ils ne géraient pas quel véhicule passait dessus. De temps en temps, ce n'était pas des véhicules de la force qui passait mais des véhicules civils. Ca a été relativement impopulaire à un certain moment. Ils ont adapté les techniques, en déclenchant en mettant quelqu'un, ou en déclenchant avec les téléphones portables. Quand on a vu ces techniques mises en place, on a mis les brouilleurs. »221
Par postulat, on admet que si brouilleur il y a sur les véhicules, c’est donc par réponse
aux IED. A partir de quel moment voit-on apparaître, dans les images, les premiers
brouilleurs sur les véhicules ? En 2006, au détour d’une remarque faite par un soldat sur les
véhicules à l’entrée du camp de Warehouse, on comprend que les VAB sont équipés de
brouilleurs222. C’est surtout en 2007 qu’on les voit apparaître. Un officier français présente au
219 BARAT-GINIES, Oriane, Op. Cit., p. 64. 220 Défense et Sécurité nationale, Le Livre Blanc, Paris : Odile Jacob/La Documentation française, 2008. P. 202. 221 Entretien avec l’adjudant-chef Jannick Marcès, janvier 2012. 222 Référence 06.9.110, cassette n°11, TC 20 :10.
104
CEMA en visite les particularités des opérations sur le terrain. Il lui parle des brouilleurs
GSM installés sur les véhicules, créant une bulle électromagnétique qui retarde le
déclenchement de la bombe223. Ces brouilleurs ont un impact sur les vidéos : les brouilleurs
perturbent à un tel point la prise de son qu’ils la rendent parfois impossible. Les interférences,
dont se plaint l’opérateur dans ses feuilles de dérushage, sont presque systématiques quand ils
montent en véhicule. Sur les photos, la trace de ces brouilleurs est moins évidente. Il s’agit
d’antennes disposées en cône sur le dos des véhicules. C’est surtout en 2007 et 2008 que ces
sortes de cônes apparaissent. En revanche, aucune image faisant référence aux IED n’est
présente, ni sur l’échantillon en ligne, ni dans les archives, et jusqu’en 2008. Si leur menace et
leur réalité apparaît manifestement en 2006 dans tout le pays, s’affirme concrètement sur les
troupes en 2007, il n’y a aucun film ou aucune photographie d’un IED ou d’un véhicule ayant
sauté sur un IED. Pourtant, il suffit de taper « IED » sur Internet pour trouver des images sans
équivoque. Les reporters que nous avons interrogés n’en ont pas vécu directement, ou sous
leurs yeux. Cette absence est en fait un impératif de communication. « La guerre est une
guerre de l’information. Omniprésents, Internet, les portables, les MP3. Les blogs talibans,
qui répercutent les images d’horreur et d’atteinte à l’islam, mènent « la guerre psychologique
du pauvre ». Les armes des guérilleros sont les engins explosifs improvisés (ied : improvised
explosive devices), la guerre est une guerre des mines. »224 En nous proposant ses réflexions,
Gilbert Meynier, soulève un point qui mérite d’être rappelé. L’image d’un IED qui explose,
l’image d’un véhicule défoncé par la mine, servent la propagande des « guérilleros ». Dans les
images ECPAD, on ne peut que deviner les traces des nouvelles forces des insurgés, pas les
voir. C’est parce qu’il y a « des problèmes de sécurité où volontairement on ne veut pas
montrer soit les équipements, soit les gens, soit le point d'appui avancé, pour pas que les gens
aient des détails sur la manière dont c'est orchestré. »225 En clair, l’ECPAD ne peut pas tout
filmer, notamment dans le cas où les images montrent de manière explicite l’organisation des
troupes françaises, parce que cela pourrait nuire à leur réussite sur le terrain. L’ennemi, lui,
peut-on le filmer ? « Rarement. Il n'y a pas d'interdiction à le filmer si on le voit. Si on le voit,
c'est bien. On ne le voit presque jamais »226, répond le capitaine Daney. On ne sait pas si les
images des IED sont censurées, mais c’est probable. Des insurgés, nous n’en avons pas vu un 223 Référence 07.9.177, cassette n°6, TC 56 :00. 224 MEYNIER, Gilbert, « Réflexions sur la guerre d'Afghanistan », ���Guerres mondiales et conflits contemporains,
n° 243, 2001. p. 121-131. 225 Entretien avec l’adjudant-chef Jannick Marcès, janvier 2012. 226 Entretien avec le capitaine Daney, janvier 2012.
105
seul dans les archives du Fort d’Ivry. Pas de prisonniers non plus. Certaines zones sont donc
inaccessibles aux reporters. Outre les IED, il y a les attentats.
« A partir de 2003, 2004 il a commencé à il y avoir des attentats. Même au début, ces suicide bombers ce n'était pas concevable. Des interprètes nous expliquaient que ce n'était pas possible que ce soit des Afghans mais plutôt des gens enrôlés de l'extérieur. »227
Il semble qu’il y ait eu des attentats en septembre 2002 à Kaboul, à en croire la
conférence de presse du général Zorlu, commandant la FIAS228. Sinon, ce sont les films « Une
politique de Défense », en 2005, et « Politique de la France : effort de Défense », en 2006, qui
y font référence. Mais ils s’appuient essentiellement sur les images très médiatisées des
attentats à New York, Londres ou Madrid. Des attentats ou des conséquences d’attentats
filmés à Kaboul ? Il n’y en a aucun.
Il est difficile d’apprécier les insurgés par les archives de l’ECPAD. Elles montrent sur
ce sujet leur limite. Elles n’ont d’ailleurs pas vocation d’information pour les contemporains.
Leur objectif de communication ou même de mémoire ne prend comme objet que les forces
françaises. L’ennemi, s’il n’est pas interdit de le filmer, demeure hors-champ. Il est toujours
difficile de le voir : « d’où partent les coups ? » s’interrogent les hommes sur place, et les
reporters. Même dans les films non institutionnels, qui prennent théoriquement plus de liberté
de ton, l’insurgé n’apparaît pas à l’écran229. Des films documentaires comme Armadillo,
projeté au cinéma en 2010 et qui suit, caméra sur le casque, des troupes danoises, osent
montrer des cadavres de combattants insurgés. On peut faire la même remarque sur les IED et
les attentats, à cause la difficulté technique de les filmer – et la probabilité même de s’y
trouver confronter. Toutefois, dans les images de l’ECPAD, de réelles différences
apparaissent, même si les causes paraissent incertaines et relativement ignorées. Le tournant
qui s’amorce en 2006 devient mature dès 2007 : les opérations changent de nature, le contexte
est modifié.
227 Entretien avec l’adjudant Vincent Larue, janvier 2012. 228 Référence 02.9.56, cassette n°16. 229 Notamment dans le film C’est pas le pied la guerre.
106
5.2. Changement de contexte, changement d’image
5.2.1. Le début d’une escalade
Le changement de contexte du conflit qui est déjà perceptible en 2006 ne devient
évident pour les Français qu’à partir de 2007. C’est d’ailleurs la date que nous livre le
capitaine Daney :
« Comment s'est ressenti le changement de contexte en Afghanistan ? - En soi, c'est le recul qui nous fait dire on a changé de contexte. Mais sur le coup, on est de plus en plus dans le dur. 2007, ça a commencé. Moi j'ai commencé cette première mission qui, au final nous parait pas si énorme que ça ! Compte tenu de ce qu'on a vécu après, en 2009 et 2010. «
« C’est le recul » : la perception des évènements implique que, a posteriori, il y a du
changement à partir de 2007. Surtout parce que les missions qu’ils ont pu effectuer depuis –
en 2009 et en 2010 notamment – induisent une telle réflexion, parce que ce sont des missions
où les combats étaient bien plus présents. Les opérateurs ne sont-ils pas convaincus sur le
moment de ce changement ? « Autant en 2002, on arrivait à avoir du contact avec la
population. Autant en 2006, 2007, la courbe des accrochages et des explosions et des IED et
compagnie sur les routes, c'est exponentiel »230 estime Jannick Marcès.
A quoi tiennent ces modifications ? La première d’entre elles concernt l’extension de la
zone de responsabilité des Français et la modification de leur politique d’intervention. Alors
qu’ils étaient limités à la région de les Français se voient confier la responsabilité de la
Kapisa, région clef puisqu’elle est le verrou de la capitale de l’Afghanista, et le district de
Surobi, proche de Kaboul. La Kapisa connecte effectivement Kaboul aux zones frontalières
du Pakistan, base arrière des combattant hostiles à la coalition. Kapisa est une province située
sur les contreforts de l’Hindukush, voisine de la Kohe Safi, toute proche donc des hauts
sommets frontaliers du Pakistan. La vallée de Tagab, en Kapisa, concentre en outre les
principaux axes de circulation. La Kapisa est densément peuplée avec 360 000 habitants,
surtout concentrés dans les fonds de vallée où l’installation agricole et la vie sont possibles le
long des walid (cours d’eau). 90% des habitants vivent dans des bourgs ou à la campagne,
10% en ville et d’abord à Mahmood-e-Raqi, la capitale de la province. Guillaume
Lasconjarias231 estime que la résurgence des tensions commence véritablement en 2004 quand
230 Entretien avec l’adjudant-chef Jannick Marcès, janvier 2012. 231 LASCONJARIAS, Guillaume, «Kapisa, Kalachnikovs et Korrigan», Les cahiers de l’IRSEM, n°9, 2011.
107
le Hezb-e-Islami de Hekmatyar se montre hostile à la coalition dans les districts de Tagab et
d’Alasay. C’est lui qui revendique l’attaque en Surobi qui, en août 2008, a couté à la vie à dix
soldats français. La Kapisa est, pour les insurgés, une zone de transit. Les talibans y auraient
même installé des camps d’entraînement. La présence de Qari Baryal, un chef taliban, dans le
secteur en 2007 atteste de l’intérêt porté par les insurgés à la région. En fait, il y a une
difficulté réelle de compréhension de l’espace socio-culturel : les groupes insurgés peuvent
être rivaux et les conflits d’origine clanique ou tribale sont latents. La rébellion ne fournit pas
une armée bien organisée, bien commandée ou permanente ; il cite à ce propos le colonel
Aragonès, interviewé par le quotidien La Voix du Nord :
« Il n’y a pas un ennemi en Kapisa qui est peuplée de Tadjiks au nord et de Pachtouns au sud. Il y a, en fait, un millefeuille d’insurgés. Des intermittents qui combattent contre quelques billets quand l’activité agricole décroît. Des trafiquants en tout genre, notamment de drogue, qui font régner une insécurité criminelle. Et puis, on trouve des groupes de combattants plus déterminés comme le HIG ([parti] proche d’Al-Quaïda mais ennemi des talibans), des talibans d’autres provinces et de véritables étrangers. L’insurrection est opportuniste. S’ils ont des intérêts communs, ils coopèrent entre eux. S’ils ont des rivalités, ils peuvent se battre entre eux. On a pu le constater. Il n’y a pas de général en chef qui mène la manœuvre contre les forces de la coalition.»232
La situation en Kapisa est donc d’une grande complexité. A ce nouveau lieu, comment
s’adaptent les équipes images ? Un premier reportage photographique, d’octobre à décembre
2007, est situé en Kapisa : « Actions des OMLT en province de Kapisa »233. Il comporte des
photos des FOB (Forward Operating Base ou bases opérationnelles avancées) de Tagab et
Nijrab. L’armée française assure, sur le terrain, « des missions à la fois de formation (de
l’armée afghane) mais aussi d’intervention », indique la légende de la notice. Le reportage
couvre également une visite du Président de la République, Nicolas Sarkozy, à Kaboul. En
Kapisa, les soldats sont regroupés au sein d’un GTIA, Groupement tactique interarmes, qui
est une sorte de reconstitution d’armée. Un reportage vidéo donne des éléments plus visibles
et plus concrets des nouvelles conditions données par la région Kapisa. Ce sont surtout des
images de combat : parmi les premières que l’ECPAD tourne en Afghanistan. La feuille de
dérushage nous indique que « ce rushe nous entraîne dans le village de Jalokheil où une
section du 8e RPIMa est prise à partie lors d'une mission de reconnaissance (TC
11.16.32) »234. La patrouille a lieu en vallée de Tagab, au sud. Lorsque la patrouille arrive au
232 Interview du colonel Aragonès, La Voix du Nord, 8 mars 2009, également cité par l’auteur. 233 Référence N2007-273. 234 Référence 08.9.145, cassette n°11.
108
niveau du village, celui-ci est désert. A TC 16 :32, de premiers échanges de feu se font
entendre. Ils sont dans un long couloir, dans le village, entre deux murets bordés de
végétation. Les soldats progressent. Les choses s’animent. Le capitaine explique à la caméra
que les insurgés sont en train d’essayer de les couper du véhicule, donc ils vont essayer de
leur couper la route et de les déborder. Puis, il demande l’appui d’hélicoptères (TC 21 :13).
Quelques instants après, l’hélicoptère passe, l’opérateur le filme. On voit alors des tirs nourris
contre ce qu’on suppose être les positions adverses : lorsque le capitaine est de nouveau
interviewé, il explique qu’il a demandé un appui aérien. Quand l’hélicoptère est passé, il a
repéré un ennemi et tiré sur lui, au canon, et à la roquette. En fin de cassette, le chef adjoint de
la 2e compagnie explique à l’opérateur le déroulé des évènements : il y a eu des mouvements
de population, qui ont pris la fuite, avant d’être pris à parti au niveau d’un village. L’ennemi a
alors tenté de s’imbriquer dans son dispositif pour le couper de son appui avec les véhicules.
Ces images montrent un fort usage du feu, qui est complètement nouveau. Cet échange
a eu lieu le 19 août 2008. C’est-à-dire le lendemain de l’embuscade d’Uzbeen. Il s’agit d’une
section du 8e RPIMa, le régiment déployé sur Tagab à ce moment. Avec Kapisa, les images
découvrent une réalité nouvelle : des combats aux échanges de feu nourris. Toute la
démonstration de la puissance de feu est alors couverte par les reporters : avions, hélicoptères,
tirs de mitrailleuses depuis les véhicules, ripostes des hommes au sol, tirs de mortiers. Ces
plans ne laissent place à aucune équivoque sur leur sens. Ce qui était deviné dans les
équipements renforcés, l’emploi de véhicules blindés, les traces des nouvelles tactiques des
insurgés surgit crûment à l’écran par des scènes de combat. L’échantillon des photos en ligne
fait apparaître la même perception : sur 7 images de combat recensées entre 2002 et 2008, 6
ont été prises en 2008. Sur ce même échantillon, 40% des photos que nous avons considérées
comme faisant directement référence à une image « de guerre », c’est-à-dire ne laissant pas de
place au doute et étant réellement évocatrices d’un conflit, sont partagées entre 2007 et 2008.
17% de ces « images de guerre » avaient été prises en 2005 – pour la plupart d’entre elles, il
s’agit de photos déclassées concernant les opérations des forces spéciales ou les frappes
aériennes, donc des photos d’avions de chasse en formation235. Ce qu’ont pu vivre les forces
spéciales dans le sud concerne désormais le contingent qui est basé à Kaboul et en Kapisa.
C’est le résultat d’un changement de lieu : la capitale étant, en quelque sorte, un cas
235 Ces photos appartiennent aux références N2005-278 et 263, concernant respectivement l’opération
Serpentaire, de l’armée de l’air, « en attente de validation EMA » ; et une visite de la ministre Michèle Alliot-
Marie en Afghanistan.
109
particulier. Et la Kapisa n’est manifestement pas Kaboul. C’est aussi la conséquence d’un
changement de contexte, où l’empreinte française a été modifiée, amenée vers de nouvelles
opérations. Alors qu’elle était restreinte jusqu’ici à des formations de l’armée afghane en
classe, à ne pas participer, sous le mandat de Jacques Chirac, directement à des opérations de
combat, la levée de telles restrictions conduit l’armée française à connaître le feu des combats.
Les patrouilles changent, considérablement, passant de patrouilles en ville sans incidents
majeurs à des missions de contrôle de zone où les belligérants se disputent très concrètement
un territoire. Une nouvelle mission a contribué à modifier cette empreinte française, et donc
l’image : les OMLT. « 2007, c'était le début de tout ce qui concernait Uzbeen », estime
Jannick Marcès, qui a été parmi les premiers à couvrir le déploiement de ces équipes de
formation. En fonction de cet événement malheureux, les reporters ont sans doute pris
conscience, plusieurs mois après ces missions de 2007, qu’ils avaient assisté à une escalade.
5.2.2. OMLT : Les mentors
Du retournement de 2006 aux combats de 2008, la différence dans les images
s’apprécie donc graduellement, mais la couverture des OMLT est un moment clef. L’entretien
avec Jannick Marcès livre de précieuses impressions :
« Sur le tournage de 2007, on a eu un problème. C'était le début des OMLT, et il ne fallait surtout pas aborder la mort comme problème. On a quand même fait des interviews où on parlait de ça. Cela a été difficile de le faire passer, et ça n'est passé que parce que le film qui a été fait était à vocation interne : pour la formation des gens qui allaient partir en Afghanistan, dans le cadre des OMLT. Pas de diffusion média etc. Et puis est arrivé Uzbeen, dix gars d'un coup on a été obligé de communiquer. - Ca a changé quelque chose ? - Ah oui ! Là pour le coup, la mort on a été obligé d'en parler. Et des images, on a commencé à en voir, un peu partout. Le sujet est devenu moins tabou, et on a parlé des blessés et d'autres choses. Je savais que ça allait finir comme ça à un moment donné.236 C'était tabou, parce qu'il ne fallait pas inquiéter les gens en France. »237
L’opérateur fait référence à une scène bien particulière de son film sur les OMLT. De
nuit, avant un départ en mission, il questionne les hommes sur l’engagement « ultime ». Les
réponses sont claires : « On y pense, c'est la finalité », « ça fait un moment qu'on y pense » ou 236 Souligné par nous. 237 Entretien avec Jannick Marcès, janvier 2012.
110
encore « La même chose. Ca fait partie des choses envisagées. Mais le but c'est de ne pas y
rester. Moi comme les autres »238. Le thème est bien présent en 2007, tel que nous l’indiquait
l’adjudant-chef. 2007 et les OMLT ont été un pivot. Ils amorcent le début d’une nouvelle
séquence. Uzbeen est un élément qui le révèle au grand public : mais le climat, y compris
dans les images, d’une véritable guerre, avec ses morts, est déjà présent sur le terrain. Le film
auquel Jannick Marcès fait référence s’intitule OMLT : Les mentors. Ce film, à diffusion
interne des armées uniquement – et classé confidentiel défense - illustre parfaitement la
rupture de 2007239. Dans le cas de ce film, les reporters ont pris eux même l’initiative de le
réaliser, puis l’ont soumis au commandement pour validation. Ils savaient qu’ils avaient la
matière, ils ont voulu l’exploiter. Le film a été finalisé dans sa réalisation en juillet 2008. Il
devait servir à la formation des personnels qui allaient partir en Afghanistan dans les missions
des OMLT, en leur apportant un aperçu des conditions sur place et de la mission qui leur est
demandée. Il est censé donner au public des futurs partants quelques éléments de contexte. Le
film a été écrit par Louis-Dominique Butor, et réalisé par le capitaine Jean-Daniel Daney,
l’officier image de l’équipe à laquelle participait l’adjudant-chef Marcès, déployée en
Afghanistan en 2007. C’est cette équipe qui a donc fourni les rushes du film240. Il a été réalisé
en juillet 2008, à peu près un an après que les images aient été tournées. Lorsqu’ils ont
procédé au montage et à la réalisation, ils ignoraient tout de ce qui allait arriver en Uzbeen. Ils
ne s’attendaient pas non plus à réaliser un grand format de cinquante-deux minutes :
l’existence et la forme longue de ce film attestent en tout cas d’une certaine attente. Quand ils
commencent à tourner, les hommes sont déjà sur place depuis trois semaines. La séquence
d’ouverture est un discours du président de la République, en 2007, qui rappelle qu’il veut
« accentuer nos efforts en Afghanistan », par « la présence de nos formateurs ». Ces
formateurs, ce sont les OMLT. Quelques secondes après, la voix-off nous indique que « nous
allons suivre une de leurs équipes pendant plus de deux mois ». Les OMLT, ce sont, en
français, des équipes de liaisons et de mentoring opérationnelle. Il s’agit de réaliser
l’instruction de l’armée afghane, y compris en l’accompagnant sur le terrain ; leur apporter les
238 OMLT : Les mentors, enregistré sous la référence D 2082741 V. 239 Nous attirons volontairement l’attention du lecteur sur le caractère encore confidentiel de ces images au
moment où nous écrivons ces lignes. Si il nous a été gracieusement permis de le visionner, nous nous plions aux
volontés exprimées par l’Etat-major des armées dans sa politique de confidentialité, surtout par respect des
personnes que nous avons rencontrées à l’ECPAD et qui nous ont donné accès à ce film. Toutefois, rien de ce
pourrait trouver place dans notre propos d’historien ne fut écarté. 240 Les rushes du film sont, en partie, enregistrés sous la référence 07.8.177.
111
appuis terrestres et aériens de la coalition ; de favoriser l’acquisition, par l’armée afghane, de
savoir-faire, aussi bien par les personnels combattants que par le commandement, dans la
réussite des opérations.
« Le concept OMLT, pour un faible coût, montre en outre à nos alliés de l’OTAN et aux Afghans, la réalité de l’engagement français sur ce théâtre, exposant au plus juste la vie de nos hommes et contribuant de manière visible à l’effort international. Par l’intégration de ses soldats au sein de l’armée afghane, il évite à nos forces d’apparaître aux yeux de la population locale comme des troupes d’occupation. Ce concept, enfin, par l’exigence de formation, de rigueur et de niveau de compétence, par la confrontation des hommes aux réalités du combat, est sans nul doute un excellent révélateur, non seulement, du niveau de nos unités de toutes les armes mais aussi de celui des officiers d’état-major. »241
La mission est claire, il s’agit de mener de front une formation de l’armée afghane qui
puisse permettre de tisser un lien avec la population qui passe par un rapport Afghans-
Afghans et non plus Français-Afghans. Surtout, les OMLT permettent la « confrontation des
hommes aux réalités du combat », les hommes étant entendus ici comme les hommes de
l’armée française. Le film OMLT Les mentors propose une plongée dans ces nouvelles unités
qui émergent à partir de 2007. L’image a ici son double sens : elle est à la fois gorgée
d’informations, mais elle est également actrice, vis-à-vis de son public militaire, d’un rôle de
formation. On peut donc attendre que, préparant les Français à leur futur déploiement, il n’y
ait pas de mise en valeur particulière, l’objectif n’étant pas à la communication envers le
grand public. Dès les premières images – une patrouille dans Kaboul – la voix off livre un
renseignement déterminant : « Chaque véhicule trop proche représente un risque potentiel »
(TC 2 :09). Les conditions de sécurité renforcées sont tout de suite évoquées, le film se place
dans un registre de menace permanente. Il comporte plusieurs séquences. Il s’introduit avec la
formation, par des instructeurs américains sur place, au « Challenge Dubs », dans un camp
aménagé près du Palais de la Reine, à quelques kilomètres de Kaboul. Ils sont testés en une
journée sur plusieurs ateliers pratiques : évacuation des blessés, tirs en situation réelle,
rencontre de civils afghans. Dans ce dernier cas, le rush242 nous indique, lors du debriefing de
la simulation, qu’en présence d’un civil, la patrouille doit le fouiller, faire éteindre son
téléphone portable, espacer les hommes les uns des autres et bien surveiller ce qui se passe.
241 Colonel GIRAUD, « Les OMLT : concept pertinent », Doctrine, n°17, juillet 2009, pp. 88-90. Le colonel
Giraud commande les OMLT françaises de février à juillet 2008. 242 Référence 07.9.177, cassette n°1, TC 22 :00.
112
Une suspicion entoure les relations à entretenir avec les civils, ce qui est à l’inverse
des relations détendues qui étaient présentées dans les premières années. Puis, interviennent
en première partie, des images du camp « qu'ils partageront pendant trois mois avec les
soldats afghans et américains. C'est pour eux l'occasion de renforcer la cohésion au sein du
groupe »243. Interviewé, le capitaine Goldsmith, chef du Coy 1244, argumente : « renforcer les
liens est un élément essentiel de la mission ». Les images montrent la vie quotidienne, du
camp, des cantines, ponctuées de sourires sur les visages de soldats. Suit une autre séquence
où les hommes du mandat précédent donnent leurs consignes à leurs remplaçants245. Parfois en
totale liberté de ton on les voit échanger sur le matériel, les véhicules, les conditions sur le
théâtre… Le montage fait suivre peu après des images de nuit où les soldats français
regardent sur leur VAB des impacts de balle. Le plan est suivi d’interviews à chaud avec les
hommes qui parlent des départs de coup, des RPG qu’ils ont manqué. On voit sur le blindage
des impacts de gros calibre. La séquence ici pose le contexte après les différentes remarques
données par la voix-off. Cette petite séquence d’à peine une minute contient plusieurs points
d’importance. L’adjudant-chef Marcès, qui a filmé les images, raconte les circonstances :
« J'étais à bord du VAB, ça s'est passé très vite. On a entendu l'explosion devant, on a vu par les trappes ouvertes les rafales avec des balles traçantes passer au dessus de nous et puis tout de suite les gens avec qui on était, comme ils étaient depuis longtemps sur le territoire, ils ont eu tout de suite de bonnes réactions. Le chauffeur ne s'est pas posé de questions : il a enfoncé le pied sur l'accélérateur (...). Le gars qui était en tourelle à l'arrière, il a rafalé tout de suite. Coup de bol, personne n'a été touché. (…)Moi j'ai filmé après. Le VAB s'est arrêté cinq bornes plus loin donc j'ai filmé les gens en train de regarder le impacts et puis je les ai filmé ensuite à la FOB, et puis j'ai interviewé les gens. »246
Les rushes ne montrent pas beaucoup de différence avec les images qui ont été
montées247. Elles précisent tout de fois le contexte. Les Français prennent les blindés, dans la
journée, pour aller en renforts de soldats américains dans la région de Jalez. Le convoi inclut
des Français et des Afghans, qui montent dans leur pick-up (TC 11 :17). Il est difficile
d’apprécier le temps qui passe dans des rushes tournés bout à bout : brutalement, à TC 13 :38,
l’opérateur filme, de nuit, les images citées plus haut : des hommes regardant les impacts sur
243 OMLT Les mentors, TC 05 :35 à 06 :00. 244 « Coy » est le nom donné aux équipes. 245 TC 07 :00 à 08 :00. 246 Entretien avec Jannick Marcès, janvier 2012. 247 Référence 07.9.177, cassette n°10.
113
leur véhicule. Par la suite, les Français et les Afghans rentrent à la FOB. L’opérateur suit les
discussions entre les officiers : les Afghans, manifestement, n’ont pas envie d’y retourner.
C’est filmé auprès des discussions, dans une ambiance toute à l’action après les combats.
L’insertion de cette scène rapidement dans le montage du film, alors qu’elle s’est passée
plusieurs jours après l’arrivée de l’équipe OMLT sur le théâtre, nous interroge. Il s’agit de
donner au film un propos très rythmé, et de poser le contexte, pour montrer, rapidement, toute
la réalité du terrain. Les images sont sorties de leur contexte pour donner au récit toute sa
dimension dramatique.
Les séquences suivantes alternent les plans de fraternisation et d’entraînements avec
l’armée afghane248. Puis viennent les images d’une opération : sur le départ, le capitaine
s’inquiète du nombre d’Afghans présents. Seulement trente, sur soixante-dix annoncés, sont
venus. « C’est coutumier », dit-il. Concernant l’opération, les officiers afghans taisent la date
de départ, manifestement par peur des fuites. « Entre 6 et 10% de l'ANA serait infiltrée par les
talibans », « une statistique qui fait de la confiance un élément très important ». Par la suite,
un officier s’adresse à ses troupes : « Vous changerez pas tout, vous pouvez pas (…) Je ne
veux aucune mésentente avec les acteurs. » (TC 18 50) Le message, par la caméra, est
transmis à son public. C’est comme si l’officier s’adressait à ceux qui regardent le film, au
delà de ses propres hommes. Le film accentue son propos sur les combats, dont on voit
d’autres images à TC 28, filmées par la vitre arrière du VAB. Des Afghans sortent de leur
pick-up, lance-roquettes à la main, pour riposter, ou à la fin du film, TC 49, avec
l’intervention d’avions A-10 – équipés de canons dans le nez de l’appareil – et cette phrase en
voix-off : « pour moi je ne vais pas mourir ici. Je vais pas prendre de risque inconsidérés ».
Le film revient aussi sur la vie quotidienne : images dans le dortoir (TC 31), interview d’un
infirmier qui soigne un soldat afghan (TC 37), d’Afghans en train de prier et de Français sur
internet, en lien avec chez eux (TC 41). Il évoque plusieurs fois les relations avec les Afghans
et les difficultés de monter une opération. Il rappelle les consignes de sécurité : le véhicule
doit s’arrêter à 100 mètres, le civil à 50 mètres. Le film se clôt sur l’image d’un soldat afghan,
fusil sur les genoux, qui chante. C’est un vrai plan séquence bien réalisé, il porte un micro-
cravate sur lui. Les opérateurs aiment aussi ces images : difficiles à faire, mais très humaines.
OMLT Les mentors fonctionne comme un vrai manuel de formation. Il donne des clefs de
compréhension, articule images de terrain et interviews. Le choix des images semble s’être
fait surtout sur celles qui étaient les plus évocatrices des éléments qui étaient successivement
248 Idem, TC 09 :10 à TC 16 :21.
114
présentées. Elles fonctionnent comme des exemples, qui s’insèrent dans une démonstration
d’ensemble. Autour de ces OMLT gravite la nouvelle donne de l’armée française en
Afghanistan : une mission promise, au niveau politique, comme la seule issue possible ; sur le
terrain, d’une difficulté réelle, tant les relations avec l’armée afghane sont compliquées et tant
la violence est de plus en plus présente. Le film résume toutes les différences entre les images
prises avant et après 2007 : des rapports avec les civils, des lieux occupés, de la situation
sécuritaire et, en point d’orgue, des combats.
5.3. Uzbeen, le choc
5.3.1. Polémique autour des 18 et 19 août
Les 18 et 19 août, en vallée d’Uzbeen, dix soldats français tombent au combat. La
bataille fut livrée autour du village de Sper Kunday, dans le nord du district de Surobi, à
cinquante kilomètres à l’est de Kaboul. Par ailleurs, vingt-et-un soldats français ont été
blessés. Entre dix et une centaine d’insurgés auraient été tués, et probablement de vingt à
quarante civils. La patrouille qui, le 18 août 2008, quitte la base avancée de Tora est
composée de soldats du 8e RPIMa, la section Carmin 2, et la section Rouge 4 du RMT,
Régiment de marche du Tchad. Sont également présents une section de l’armée nationale
afghane et des hommes des forces spéciales américaines. C’est à treize heure trente, et alors
qu’une partie de la section de Carmin 2 et un légionnaire du RMT effectuent une
reconnaissance vers les crêtes, que les soldats français sont pris à partie. Près de cent vingt
combattants insurgés tenteraient alors un encerclement. La bataille dure jusqu’au lendemain,
midi. L’armée française subit avec l’embuscade d’Uzbeen un choc. Il fut comparé à celui de
l’attentat du Drakkar en 1983, à Beyrouth, alors qu’il fut, en termes de morts, bien plus
élevé249. Le lendemain, le Président de la République se déplace en Afghanistan. Il est filmé
par une équipe de l’ECPAD250, notamment pour le discours qu’il exprime au camp français de
Warehouse. Il dit notamment aux soldats français de « relever la tête ». Même s’il loue leur
« professionnalisme », l’ont-ils baissé un instant, la tête ? Les images le contredisent. Rien ne
semble indiquer que les soldats français à Kaboul baissent la tête. Elles montrent au contraire
249 L’attentat du Drakkar a fait, en 1983 à Beyrouth, 58 morts parmi les soldats français. 250 Référence 08.9.64
115
la présentation des cercueils devant les troupes, le Président et les ministres de la Défense et
des Affaires étranges, messieurs Morin et Kouchner (TC 45 :30)251. Les cercueils sont ensuite
montés sur des véhicules de l’avant-blindé pour un ultime hommage, en forme de convoi
funèbre, dans le camp de Warehouse. Les plans montrent les saluts des militaires de toutes les
nationalités. La reconnaissance des hommes qui ont été leurs compagnons est très forte. Ces
images, malgré leur infinie tristesse, ne sont toutefois pas tournées comme des images de
défaite. Car l’enjeu, dans ces pertes élevés, et dans un espace temps très court, tourne autour
de l’image, a posteriori, de la bataille.
L’équipe image vient à Warehouse, pour couvrir un discours du général Stollsteiner, le
22 août252. Il venait de prendre, le 6 août, le commandement de la Région capitale. Il
s’exprime, à chaud, sur ce qui s’est passé, devant les soldats rassemblés à Warehouse. Au
milieu d’eux, s’exprimant avec une voix forte et décidée, il tient discours.
« Ce que je vais dire, comprenez le bien, entendez le bien, et retransmettez le. Que ce message
soit diffusé. Nous sommes dans une opération multinationale, avec des alliés qui sont à côté de
nous dans ce moment : ceux qui sont à leur contact, retransmettez leur. Un des buts de cette
rencontre, c’est que je puisse répondre à des questions légitimes. (…) J’avais deux possibilités.
Réunir les différents chefs, les adjoints et leur demander de retransmettre. J’ai préféré ce
contact, pour que le maximum d’entre vous, soldats français, servant en Afghanistan, sache le
maximum qu’il doive savoir pour contribuer au maintien de la cohésion, du moral de la force,
après la claque que nous nous sommes tous pris. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été fait,
tout ce qui a été dit. Nous avons rendu [hommage] de manière remarquable aux morts. Le
président de la République a dit ce que nous pensions tous, et a rendu l’honneur de la France,
et nous en faisons partie, aux morts dans les missions qu’elle lui a données. »
Le général Stollsteiner, de fait le plus haut gradé français en Afghanistan à ce moment
précis, délivre dans la première partie de son discours deux de ses choix de communication.
Le premier, c’est qu’il veut apparaître au milieu de ses hommes pour qu’ils soient les
premiers relais de la communication. Le second, c’est qu’il vient livrer, même s’il se défend
de donner la parole officielle de l’Etat-major des armées, les éléments de langage appropriés
pour répondre aux journalistes. Son discours vient contredire certains éléments parus dans la
251 Idem. 252 Référence 08.9.145, cassette n°12. Trente-cinq minutes environ, uniquement consacré au discours du général
Stollsteiner.
116
presse française et qui commencent à faire naître une polémique. C’est le journal Le Monde le
21 août 2008, qui lance une première salve de critiques. Selon la conférence de presse du
Chef d’Etat-major des armées, « le schéma d’embuscade [était] classique (…) sur un terrain
favorable à l’ennemi », et qui plus est, « les appuis aériens étaient apportés par la coalition ».
Le journal contrebalance ces arguments par le « les témoignages de soldats français blessés
dans l'embuscade et rencontrés par Le Monde mercredi matin à Kaboul. »253
« Le nombre de victimes s'expliquerait notamment, selon ces soldats, par la lenteur de la
réaction du commandement et de sérieux problèmes de coordination. L'unité de
reconnaissance chargée d'approcher le col à pied est restée sous le feu ennemi « pendant près
de quatre heures sans renfort ». « Nous n'avions plus de munitions pour nous défendre avec
d'autres armes que nos Famas », raconte un blessé.
A ce premier point, le discours du général Stollsteiner est sans ambiguïté et le message
des autres officiers sur les plateaux de télévision est clair. On peut d’ailleurs remarquer qu’il
tient une feuille à la main lorsqu’il s’exprime aux soldats. Il ne la lit pas dans son discours, on
peut émettre l’hypothèse qu’il s’agit de l’article en question : «Je vais prendre les points qui
sont sortis du théâtre et se sont retrouvés dans les lignes de ce journal». Aux manques de
munitions, le général répond : « Quand on monte on emmène pas toute la dotation ! La
section Carmin 2 s’est retrouvée au bout de 3h à court de munitions. Quand on en a renvoyé,
c’était pour compléter. On ne raconte pas, on a envoyé des munitions, c’est donc que les gars
n’en avaient pas. Ils en avaient ! » Certes, mais pas assez pour soutenir un feu nourri de
plusieurs heures, d’où la question des appuis. « Il y avait la base d’appui avec les VAB et les
tireurs (…) donc la question des appuis ne se pose pas », balaie-t-il. L’article continue sur
l’intervention aérienne. « Les frappes aériennes de l'OTAN censées permettre aux soldats
assaillis de sortir du guet-apens ont par ailleurs, selon les blessés, raté leur cible et touché des
soldats français, de même que des tirs venant des soldats afghans positionnés en aval. » Là
aussi, le général répond que les avions qui interviennent utilisent du très gros calibre, des obus
de 40 et du 106mm. Selon lui, s’il y avait eu effectivement tir fratricide, les blessés « ne
seraient pas là pour en parler » (TC 23 :17). Il enchaîne sur la réactivité du commandement,
« Que les gens n’aient pas été réactif, ce sont les gens qui ne connaissent pas le terrain qui 253 « Les soldats blessés racontent l'embuscade, les combats, les erreurs... ». Article paru dans l'édition du 21 août
2008, Le Monde, reproduit en annexe.
117
disent ça ! ». Surtout, il insiste sur des éléments non mentionnés par l’article, comme la
rotation, effectuée pendant dix-huit d’heures d’affilée, par les hélicoptères Caracal français,
qui emmènent des munitions et ramènent les blessés. Ce qui est intéressant, c’est que les
sources des journalistes semblent être des blessés, alors que lui accuse des militaires, là-bas à
Kaboul, d’avoir rencontré des journalistes. Il prétend même que « Les blessés en avaient
marre d’entendre les journalistes », et invite ses troupes à « ne pas vider son sac devant les
journalistes : c’est le B.A. Ba ». La polémique prend en tout les cas une tournure politique
puisqu’un débat est mis à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, en septembre, et que le
président du groupe socialiste à l’assemblée, alors Jean-Marc Ayrault, demande des
éclaircissements sur la mission des Français en Afghanistan. Ce qui est questionné dans
l’opinion publique, c’est d’ailleurs davantage la légitimité de la présence en Afghanistan plus
que les conditions de l’embuscade en elle-même. Enfin, le général Stollsteiner revient à
plusieurs reprises dans son discours sur « « On est à la guerre, on a un ennemi qui est
valeureux. En face, ce sont des combattants ». La guerre. Pour la première fois, le mot est
prononcé.
5.3.2. Quelles images pour Uzbeen ?
Comment l’ECPAD est amenée à réagir ? Tout nous laisse penser qu’une équipe
image est envoyée sur place spécialement, avec comme opérateur vidéo Simon Guesquière,
pour couvrir le déplacement du président. Une équipe du SIRPA Terre est aussi présente, avec
le 8e RPIMa, en vallée de Tagab254 – dans la région de Kapisa. Enfin, il y avait, d’ores et déjà
une équipe sur place, qui couvrait notamment les activités du 8e RPIMa en Surobi, ce depuis
le 29 juillet. Ils étaient sur une autre mission, à Jalokheil, dont nous avons parlé plus haut, et
qui a donné lieu, elle aussi, à un accrochage, bien moins sérieux255. Le jour même, les 18 et
19, aucun opérateur ne se trouve avec Carmin 2. Il n’y a donc pas d’image sur l’embuscade,
même si un doute est permis concernant les images américaines. Des avions A-10 et des
hélicoptères blackhawk sont envoyés sur zone en fin d’après-midi, le 18 août. Des drones
viennent, la nuit, guider les tirs. Il n’est pas impossible que des images venant de ces appareils
existent, montrant notamment une vue aérienne des crêtes sur lesquelles ils tirent. La violence
des combats dans les premières minutes, toutefois, semble n’avoir laissé aucune trace 254 Les images du SIRPA Terre ont été reversées aux archives de l’ECPAD sous la référence REV2008-SITER. 255 Référence 08.9.145, cassette n°11.
118
audiovisuelle. Sur quelle base d’images va donc reposer la communication sur cet événement
clef ? Le journal de 13 heures du 19 août s’ouvre sur l’information Le sujet est lancé avec une
carte de l’Afghanistan, puis des images d’une embuscade. « C’est dans ce genre d’attaque que
les soldats français sont tombés en embuscade (…) Ce type d’attaques fait partie de leur
quotidien ». Dix secondes pendant lesquelles se succèdent des images d’archive d’une
embuscade, sans qu’elles aient été inscrites au conducteur, qui récapitule la succession des
séquences telles qu’elles doivent être enchaînées à l’écran256. Les images ont donc été insérées
en dernière minute. Suivent une interview d’Eric de la Varenne, correspondant à France 24,
qui parle aussi sur des images d’archives, puis Nicolas Bertrand, envoyé spécial de France 2,
qui s’exprime sur une carte et donne des éléments de contexte. A 20 heures, le journal détaille
l’information par un reportage à la base militaire française de Kaboul et à Castres, où est
implanté le 8e RPIMa. A 20h10, le journal propose un récapitulatif de la présence française en
Afghanistan, où cette fois ce sont des images d’un reportage réalisé, quelques semaines plus
tôt, par des journalistes français à Kaboul – et non dans les vallées de Surobi ou de Kapisa,
insistant dans les commentaires sur les mots « nord est de Kaboul, zone dangereuse », « au
check point, tout peut arriver » ou encore « l’Afghan a la gâchette facile ». D’où proviennent
les images d’archives utilisées au journal de treize heures ? De toute évidence, il s’agit des
images du SIRPA Terre concernant un accrochage ayant lieu le 31 juillet 2008257. La notice
précise en légende : « Archives des envois Serte du mardi 19 août concernant les événements
en Afghanistan du lundi 18 août 2008 ». La cassette de rush indique qu’il s’agit d’une version
validée par l’EMA. A peine quelques plans de ces images ont été réutilisés par les médias
pour commenter des images de combat à la suite de l'accrochage du 18 août. Il n'est pas
difficile de s'imaginer toutefois que l'accrochage fut autrement plus violent, compliqué et long
que celui présenté dans ces images. Les forces en présence et la configuration du terrain
étaient également complètement différentes. De plus, les images du rush ne font pas sens sans
les commentaires de l'officier qui vient expliquer à renfort de détails techniques les opérations
qu'il a mené pendant l'accrochage et développe ses décisions tactiques et l'emploi de ses
hommes. Sans ce son, les images sont une succession anarchique de plans non cadrés sur les
hommes qui se servent de leurs armes à plusieurs reprises. Le film est surtout un extrait de
neuf minutes, qui rend difficile toute comparaison de temps écoulé. Combien de fois le
caméraman a coupé ? L’accrochage a duré plusieurs minutes ou plusieurs heures ? Que se
256 Conducteur du journal télévisé de France 2 du 19 août 2008. Documentation numérique de l’INA. 257 Référence REV2008-SITER-002.
119
passe-t-il avant, et après ? Au niveau du contenu, on ne voit presque pas les soldats tirer. On
les entend surtout, mais on les voit se déplacer, ce qui donne le sentiment de l’action. A
quelques reprises on les voit tout de même en position de tir. Même chose pour les véhicules
filmés à l'arrêt ou en déplacement - alors qu'il est possible de les filmer en usage et de mettre
en valeur leur utilisation intensive, comme lorsque sont faits des films dans les VAB et que
l'on filme les douilles qui tombent à l'intérieur du véhicule. Les images à elles seules ne
fournissent aucun support de détail réel sur les circonstances du combat ou les forces en
présence. On ne voit pas ou ne comprend pas ce qui se passe par les images en elles-mêmes.
Seule une utilisation ultérieure des images avec montage et une superposition de son avec
commentaire permettra de donner sens à ces images : ce sera le cas dans les JT. Le JT a
sélectionné dix secondes sur une première séquence, vingt secondes une autre, sur les neuf
minutes disponibles. Il s’agit des secondes les plus consacrées à l’action. Sur ces images de
rush, les avis subjectifs sur l’intensité du combat représenté peuvent diverger ; il n’en
demeure pas moins que leur utilisation hors de contexte, avec une citation marginale - le logo
« Archives », seulement, pendant le sujet de France 2 – et la sélection des plans les plus
dynamiques concourent à extrapoler la représentation du combat.
Le SIRPA Terre filme également le retour des blessés, le 20 août, à l’aéroport
d’Orly258. C’est la seule caméra qui rentre dans une ambulance, et établit un contact direct et
immédiat avec un blessé qui a participé aux combats. Après avoir filmé le comité d’accueil,
avec le ministre, interviewé les médecins qui étaient à bord du vol, l’opérateur monte dans
une ambulance. Il filme pendant le trajet. Le médecin qui est dans l’ambulance s’entretient,
par quelques mots, avec le soldat. Celui-ci demande si ses camarades étaient avec lui. Il
répond aussi, laconiquement, qu’il a été opéré, à Kaboul. Puis l’opérateur essaie de poser des
questions au soldat qui tourne ses yeux vers lui. « Est ce que ça vous embête si je vous pose
des questions, sur le kit Morphée, la prise en charge à bord, etc. »259 ? Le soldat répond
simplement : « Tout est bien fait ». « Vous avez été opéré sur place c'est ça ? » le soldat
répond juste par « Oui » et tourne la tête. Le reporter conclut par un compréhensif « bon bah
écoutez je vous embête plus avec ça » qu'il murmure à moitié. La séquence est étrange : on
croise le regard du blessé à peine une seconde, et le regard est dur, impressionnant, marqué.
C’est l’image de l’'homme qui y a été et qui en revient. Le médecin essaie de savoir de quelle
section il est et comment se sont passés les combats. Le soldat répond simplement qu’il est
258 Référence REV2008-SITER-002. 259 Idem, TC 33 :40.
120
content d’avoir eu du renfort, mais clôt rapidement l’entretien par « je ne peux pas en dire
plus », qu’il répète deux fois. Manifestement, il a été briefé. Le caméraman suit les différents
évènements et cherche surtout à avoir des informations sur la prise en charge des blessés et
prend des films dessus. Il ne s'agit pas d'interroger le blessé : son angle c'est la chaîne de prise
en charge jusqu’aux hôpitaux, le système mis en place, la logistique, bien plus que les blessés
eux-mêmes. Face aux réponses, l’opérateur s’incline rapidement et n’insiste pas. Les images
en rapport avec Uzbeen se terminent par deux cassettes où l’équipe ECPAD sur place
interroge des militaires français pour recueillir leurs témoignages sur les journées des 18 et 19
août 2008260. Sont interrogés les pilotes des hélicoptères Caracal qui ont fait les allers-retours
pour ramener les blessés, le médecin chef qui les a reçu à Kaboul, le chef de section du RMT
qui était avec Carmin 2 pendant l’embuscade, un chef de groupe spécialité mortier, le chef de
la section Carmin 3, qui est arrivée en renfort, un caporal du 8e RPIMa qui commandait un
trinôme de combat. Est aussi interrogé le général Stollsteiner. A chaque fois les questions
visent des éléments précis sur la chronologie des évènements, les rôles particuliers qu’ont
joués chacun de ces hommes, et uniquement leur rôle. Ils se gardent bien de donner un avis
d’ensemble, se limitant au contraire à donner des éléments factuels sur la manière dont ils ont
accompli leur mission. A chacun toutefois l’ECPAD demande s’ils ont « quelque chose à
ajouter ». Certains répondent par la négative. Le caporal parachutiste estime que « tout le
monde a très bien réagi ». Le chef de section du RMT livre sa surprise de voir les ennemis si
nombreux. « Ce qui m’a surpris c’est la puissance de feu. Dès la prise à partie, ça a été la
puissance de feu de l’ennemi. On a pris 30 ou 40 roquettes, toute la nuit. Ils étaient
absolument partout. Ils étaient 80 ou 100, ce qui est rare. D’habitude, ils sont une quinzaine
de personnes. »261 Seul le médecin chef se démarque.
« Je voulais parler des décédés, ça, ça a été dur, ça a été très dur, je sais pas comment on pourrait dire. ECPAD : c’est vrai que dire on a été fiers de prendre en charge des blessés, je sais pas si... Médecin : Non ça on ne peut pas le dire. Ce que je voulais dire : on a eu, le lendemain, sont arrivés les soldats décédés tous pris en charge pour la toilette mortuaire et la suite... »262
Les rushes font apparaître que les opérateurs lui font répéter des « éléments de
260 Référence 08.9.145, cassettes n°17 et 18. 261 Idem, cassette n°17, TC 18 :30. 262 Idem, cassette n°18, TC 10 :57.
121
langage », notamment lorsqu’il choisit de parler d’ « évènements ». L’ECPAD le corrige et
signale qu’il faut dire « combats ». « On dit les combats. On essaie de lutter en terme
d’image contre ce traitement comme un fait divers dans les médias. » lui explique
l’opérateur. Même avec le général Stollsteiner, les entretiens sont très guidés en terme de
mots choisis. Il s’agit de donner, non pas une version particulière des faits – les personnels
interrogés n’ont pas non plus un texte sous les yeux – mais une manière de les présenter.
Enfin, la communication se place aussi du côté des hommes, des soldats, de leur vécu.
Même si les témoignages sont souvent techniques, l’image qui transparaît est finalement de
dimension humaine, avec tous les échelons de la hiérarchie et des rôles représentés.
5.3.3. Mourir en Afghanistan
L’ECPAD dit vouloir « lutter contre le traitement comme un fait divers dans les
médias». Danièle Hervieu-Légier, sociologue et ancienne présidente de l’EHESS, livrait un
entretien à Libération le 12 mars 2008 où elle estimait que la façon dont était traitée la mort
des dix soldats français à Uzbeen se rapprochait du traitement d’un fait divers. « J’ai été
frappée par le fait que la manière dont ces dix soldats sont morts n’aurait pas été
substantiellement différent s’ils étaient morts dans un accident d’autocar !»263. Elle parle de
« privatisation » du corps du soldat. Cette nouvelle approche de la mort par l’opinion, qui
transforme le décès d’un militaire, censé avoir accepter le sacrifice suprême, en fait divers
émotionnel, pose un défi à la communication de Défense. L’embuscade d’Uzbeen, moment
entêtant qui revient dès lors que nous parlons de l’engagement français en Afghanistan, révèle
que l’opinion a un regard nouveau sur la mort des soldats, qu’elle ne conçoit plus comme un
sacrifice mais comme un accident, voire une faute. C’est un problème pour la Défense. Leur
mort est pourtant une mort publique parce qu’elle a un sens public. Le journaliste Jean-
Dominique Merchet estime que « s’attaquer à eux, ce n’est pas s’attaquer à des individus,
c’est s’attaquer à un pays, le nôtre en l'occurrence. Renoncer à cette idée, c’est renoncer à
toute idée de la chose publique et du destin commun.» Comprendre le rôle joué par la mort,
c’est avoir en tête une partie de ce qui se joue en terme d’image de guerre en Afghanistan.
Oriane Barat-Ginies dresse trois conséquences à l’embuscade d’Uzbeen.
Premièrement, les Français réalisent que le pays est en « guerre »264, citant l’analyse du 263 Citée par MERCHET, Jean-Dominique, Op. Cit. 264 MERCHET, Jean-Dominique, Op. Cit., p. 127.
122
journaliste Jean-Dominique Merchet, et souhaitent le retrait des forces selon un sondage
publié par le Nouvel Observateur au 23 août 2008. Secondement, les officiers sont la cible de
critiques. Et, troisièmement, « l’impact de la bataille de communication ». Elle rappelle les
photos publiées par Paris Match des talibans s’exhibant avec les gilets pare-balles et les effets
personnels des soldats français, comme des trophées265. Elle stipule que le voyage présidentiel
et la cérémonie d’hommage national laisse aussi supposer une défaite française, donc une
victoire des groupes insurgés. La communication a-t-elle cherché à tordre l’idée d’une défaite
en Uzbeen ? Sur le papier, il n’y a pas de défaite militaire. Stollsteiner rappelle lui la
destruction, le lendemain, d’une base des talibans en Surobi, qui aurait causé trente pertes
parmi les insurgés, et souligne leurs pertes le 19 août, qu’il chiffre à quatre-vingt morts et des
blessés en nombre inestimable. « La mission a été dure, mais en face, et ça il faut le dire, les
gars en face ils l’ont payé. Le sergent a dit : je m’en suis fait deux. L’autre, je m’en suis fait
trois. »266 A peine les armes tues, s’engage donc la deuxième partie de la bataille : elle se
déroule sur le terrain médiatique. « Dès le lendemain, pour moi, ça a été un combat plus dur
que de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ca a été le combat de la communication ! La
communication est un combat !» Le général Stollsteiner remplit une mission de combat : la
communication. Pour lui, maîtriser ce terrain est indispensable pour continuer à mener la
guerre. La question de la défaite ou de la victoire laisse des incertitudes. Si les personnes
interrogées donnent un avis, celui-ci est, nous l’avons vu, pétri de nuances. D’après les
témoignages recueillis, chacun a en effet vécu l’embuscade à son niveau. Du rôle et de
l’efficacité de l’armée française, ils ont quand même tous donné un avis positif. En fait, ils
laissent entendre que cela aurait pu être pire, sans décider de savoir si ça aurait pu être mieux.
La réponse à cette question n’appartient en fait pas tant aux images qu’à ceux qui les
reçoivent, ou recevront, seuls capables de répondre dans un débat contradictoire. Les seules
images filmées, dont la référence est très clairement Uzbeen, ont été filmées après Uzbeen.
Nous avons vu tout ce qu’elles contiennent comme source d’information historique. Nous
apercevons maintenant toute la charge symbolique dont elles peuvent être revêtues, des
« agents de l’histoire » qui veulent jouer un rôle. Ces images sont des pièces à conviction
livrées au jugement public, des preuves proposées aux générations futures. Le capitaine
Daney résumait cette position :
265 Reportage dans Paris Match le 3 septembre, par Eric de la Varenne et Véronique de Viguerie. 266 Référence 08.9.145, cassette n°12. TC 04 :00 à TC 09 :10.
123
« Il faut avoir une haute idée du reportage, en général. Ces images vont directement nourrir les
documentaristes qui feront des produits dans quinze, vingt ou quarante ans. Il faut qu'on puisse
leur proposer tout ce qu'on peut proposer. (…) Dans vingt ans, (…) s'ils veulent reconstituer ce
qui s'est passé en Uzbeen, peut-être entre tous les éléments qu'ils auront plus les images qu'on
aura, il finira par raconter vraiment ce qui s'est passé réellement. Même si ce ne sont pas les
images, qui se sont passées le jour même. Ce jour là il n'y avait pas de reporter, il aurait pu y
en avoir. Pour une raison ou une autre, on aurait pu être dans cette mission, on aurait eu les
vraies images, et probablement un mort ou deux. On essaie de penser tout le temps, on ne reste
pas strictement dans la communication pure et dure du moment, on essaie de prendre un peu
de hauteur. Ca m'est arrivé, même à Harmattan, de reposer des questions avec une vision plus
lointaine. On n’en a absolument pas besoin aujourd'hui. Mais un jour peut être quelqu'un en
aura besoin. Un chef de la base. Le chef de corps, "mon colonel vous avez déjà fait cette
mission là, quel est votre sentiment aujourd'hui ? Et demain qu'est ce que ça va être ? On s'en
servira pas mon colonel, c'est pour savoir un petit peu ce que vous pensez aujourd'hui". Peut
être qu'un jour quelqu'un aura besoin du sentiment du chef. Tel date tel jour il disait ça. Il avait
vu là, c'était juste. C'est le documentariste qui dira, c'est pas nous. Ca fait partie de la
dimension de l'équipe. »
Les reporters se voient comme des relayeurs d’images dans une mission de devoir de
mémoire. Qui exploitera les images d’Uzbeen, et qu’en fera-t-il ? Les reporters eux n’y
pensent peut-être pas. « Il faut avoir une haute idée du reportage », ce qui signifie que les
impératifs de la communication peuvent laisser le pas à une conception en dehors du temps,
où l’image est conçue comme une preuve, une construction mémorielle. Dans cette logique, le
destinataire est anonyme. Mais Uzbeen a révélé une partie du sens des images. Il y a une
communication, et pour lui servir, toute image qui peut donner à voir comment fonctionne
l’armée sur le terrain, comment elle réagit à une situation critique, est une image qui veut
porter une démonstration. Mais mourir en Afghanistan, c’est d’abord une réalité ; l’ECPAD
l’a mis en image, qui est nécessairement une image pleine d’enjeux, notamment politiques.
C’est par ces contours qu’elle dépasse son stade d’archive pour atteindre celui de symbole ou
d’acteur. Quelle image d’Uzbeen sera conservée ? Quelle image fera mémoire ? Celle des
combats sur le terrain, ou celle des cercueils faisant le tour du camp de Warehouse ?
On ne dira pas qu’il y a eu des précédents à Uzbeen, mais dès 2006, l’image de
l’Afghanistan change. Si le mot n’est pas encore employé dans le langage de la
124
communication, la guerre est montrée. Perceptibles avec le changement de contexte qui voit
une modification de mesures sécuritaires pour s’adapter aux nouvelles forces adverses,
l’image prend un tournant en 2007. C’est surtout le film OMLT Les mentors qui marque un
tournant, car tout en présentant la nouvelle empreinte française des OMLT et la nouvelle
région où doivent opérer les Français, en Kapisa, il aborde des thèmes nouveaux : les
combats, l’insécurité, et la mort. Si ce film est restreint au cadre interne des armées, c’est en
fonction de la politique de confidentialité de l’Etat-major des armées et non pas du travail des
reporters de l’ECPAD. Ceux-ci, présents sur le terrain, ont filmé la nouvelle donne en
Afghanistan. Uzbeen fonctionne ensuite comme un choc visuel pour l’opinion publique
française qui n’imaginait pas que son armée était engagée en guerre. Si de nouvelles images
viennent, rapidement, construire un ensemble disponible pour établir une mémoire a
posteriori, ce n’est pas tant du défaut des armées que l’image de guerre est découverte en
2008. Le retour de la question au cœur du débat public est tardif. Il faut probablement en
chercher les causes dans le désintérêt partagé conjointement par les médias et cette même
opinion à propos d’un engagement long, difficile et complexe en Afghanistan.
125
Conclusion
L’ECPAD fournit des archives audiovisuelles qui, pour leurs contemporains, ont une
double vocation. La première est de fournir à l’Etat-major des armées des ressources
audiovisuelles afin de pouvoir communiquer sur ses différentes actions, la seconde de
constituer une mémoire en image. Pour répondre à ces enjeux, s’active tout un réseau de
journalistes de la Défense, de rédacteurs, de réalisateurs, d’opérateurs, de photographes. Ils
permettent la production d’images telles que la Défense souhaite les exposer. La
communication s’articule donc autour de compétences. L’ECPAD apporte une maîtrise
d’œuvre en matière filmique et photographique, il assure aussi la conservation des images et
met en place un service de production. Grâce à lui, les images sont proposées aux média, sans
montage. Elles peuvent aussi faire l’objet d’une réalisation, sous forme de films de vingt deux
ou cinquante deux minutes. Depuis quelques années, les sites internet se chargent d’être des
diffuseurs d’images. Les chaînes LCP et Public Sénat sont aussi des partenaires réguliers.
Sans ces diffuseurs, que deviendraient-elles ? La communication suppose en effet un vecteur.
Pour que les images soient réunies dans une production, il faut un projet, un financement, un
réalisateur. Il manque peut-être à l’ECPAD un « rédacteur en chef », qui piloterait des projets
périodiques audiovisuels, à destination des medias ou, pourquoi pas, du cinéma. Il manque
une ligne de production : sans elle, les images sont exploitées soit de manière marginale, soit
au seul bon vouloir de l’EMA. C’est probablement ce qui explique que l’exploitation des
images de l’Afghanistan, en regard de la quantité de sources disponibles, soit encore maigre.
On pourrait opposer l’argument suivant : les images ont été moins exploitées parce que
l’événement est proche de nous.
Dans ce cas, que signifie alors communication ? L’histoire de l’ECPAD nous a montré
que les premiers Services cinématographique et photographique des armées étaient nés d’un
partenariat avec les industries cinématographiques. Que leurs images étaient exploitées
immédiatement et diffusées à grande échelle via le principal support d’information de
l’époque : le cinéma. Désormais, la diffusion des images a diversifié ses supports, mais
semble avoir quelque peu baissé en quantité. Deux réponses expliquent ces différences
d’approche. La première réponse tient à la différence de contexte elle-même. Les conflits
mondiaux ne sont pas les opérations extérieures post-guerre froide. Pour l’Afghanistan,
l’ennemi est insaisissable, le pays est complexe et lointain. L’environnement est aussi
126
complètement international : les alliés sont interconnectés, et même s’il y a une prédominance
américaine persistante et le public est, potentiellement, à échelle mondiale. La seconde, c’est
qu’en 1917, la doctrine dominante était la « propagande » : influencer par les images les
opinions soit de sa propre opinion publique, soit des opinions étrangères neutres, qu’il
convenait de rallier à sa cause. La doctrine a évolué au cours du vingtième siècle pour
privilégier une communication moderne, dont l’axe principal est de proposer à la
communauté nationale la transparence sur l’activité de ses armées. Celui qui s’intéresse donc
à ces images en fait le choix. Il est fort envisageable qu’une diffusion, aujourd’hui, dans les
salles, de la progression d’une patrouille en Afghanistan avant la diffusion du film créerait
polémique. Pour les images d’actualité, les journalistes eux-mêmes, enfin, préfèrent toujours
leurs propres images aux images d’archives. Une image d’archive vient illustrer leur sujet,
quand celle des envoyés spéciaux est justement le prétexte. Dans l’analyse, cette frontière
déontologique est plus un schéma de pensée qu’une réalité. En Afghanistan, par leurs images,
les reporters étaient des envoyés spéciaux et leurs images une forme d’enquête systématique.
Les reporters de l’ECPAD sont toutefois des militaires. Ils portent une caméra, mais
aussi une arme. S’il le faut, ils s’en servent. L’enquête ne peut donc être considérée en dehors
de sa fin, ce même si les moyens sont similaires aux journalistes. Toutefois, les reporters de
l’ECPAD ne sont pas exempts des difficultés imposées par la situation. On ne voyage pas
simplement en Afghanistan, tout transport exige du temps et une préparation. De plus, un
homme avec une caméra doit se faire accepter par le groupe qu’il va suivre. Être militaire
peut être un plus, mais les relations avec le commandement sont parfois plus difficiles
qu’avec les hommes. La tactique des batailles continue, un peu, de sous-estimer l’image de la
guerre. Des militaires, donc, qui peuvent se frayer un chemin dans les opérations pour
rapporter des images inédites, mais qui sont aussi soumis aux intérêts du commandement. Des
hommes qui, même s’ils peuvent tourner au cœur de l’appareil militaire, obéissent aux
besoins pragmatiques, les plus élémentaires parfois : qui monte dans l’hélicoptère ? Le
photographe, ou le combattant ? Le choix n’est pas simple. Ils ne peuvent donc pas tout voir.
Quand ils sont trois pour couvrir les opérations sur une zone, que l’on y ajoute trois autres
personnels du SIRPA Terre, et ce même s’ils se transportent sur tous les lieux où sont
présents les Français, six hommes ne suffisent pas à filmer l’intégralité de ce qui se passe. Les
archives de l’ECPAD ne sont donc ni exhaustives ni dénuées d’intérêt. Elles sont le résultat
d’un choix de communication, mais aussi d’une pensée plus haute.
Car à la communication s’ajoute la mémoire, comme deux facettes d’une même
mission. Ce volet mémoriel de l’action des reporters de l’ECPAD, tout l’établissement y
127
appuie sa logique. On ne saurait le négliger dans toute analyse des images de l’établissement.
Il y a l’aspect communication, qui répond à des ordres parfois immédiats, des besoins parfois
urgents ; à lui répond l’aspect mémoriel, qui, sans connaître son réel public, commande un
sens du devoir non pas en fonction du présent, mais en direction de l’avenir. Ils ne pensent
pas leurs images nécessaires comme une source d’information pour l’opinion publique. Ils
répondraient que c’est le travail des journalistes. Ils les pensent indispensables d’abord pour
les hommes qu’ils accompagnent, à qui ils le doivent : « sans nous, personne ne saura ce
qu’ils ont fait » ; ensuite pour que les générations futures se souviennent de ce que le corps
militaire a fait, et que ses actions appartiennent aux souvenirs de la République, et à la
mémoire de tout son corps social. Sans cette impérieuse nécessité, le travail de l’ECPAD ne
prend pas tout son sens. Communication et mémoire sont deux logiques complémentaires
constamment pensées par les hommes et les femmes qui travaillent à l’ECPAD, et en premier
lieu par les reporters.
Ces images d’Afghanistan sont en grand nombre. Nous nous étions donné plusieurs
mois pour en visionner un échantillon représentatif : faire un visionnage intégral était
impossible. Il fallait, pour proposer une analyse, une méthodologie particulière. C’est en
grande partie par elle que l’on répond à l’une des questions posées : comment l’image peut
faire source pour l’histoire ? Il faut comprendre sa double nature. L’image, le film, la photo,
leur légende, contiennent des informations évènementielles comme n’importe quelle archive.
Les interviews, les lieux, les personnes contiennent ce qui, qui sous le regard de la critique,
contribue à former des éléments de connaissance. Bien sûr, ceux-ci sont partiaux. Il faut les
confronter à d’autres sources. Mais l’image est aussi un acteur en soi, un « agent de
l’histoire » selon les mots de Marc Ferro. Ne voyons-nous pas, autour de nous, tant d’images
qui sont devenues des symboles, et qui font l’histoire ? La chute du mur de Berlin, les chars
place Tian’anmen, les visages des nouveaux présidents de la République, la victoire de
l’équipe de football au Mondial, et tant d’autres exemples, montrent qu’une image peut
s’enregistrer comme élément de la mémoire collective. Fin mai 2012, très proche de nous, des
images d’enfants syriens tués à Houla ont été diffusés sur le web. L’image ne dit pas qui, elle
ne dit pas où, elle ne dit pas pourquoi. Mais elle provoque l’indignation, elle appelle une
réaction. Ce deuxième sens de l’image ne doit pas être oublié. C’est dans ces deux cas, celui
de sa production et de son utilisation, de son contenu ou de son action, en communication
comme en mémoire, que l’image est un reflet de la réalité. La méthode que nous avons
proposé ne devait donc être ni sémiologique, ni biaisée par un mauvais échantillon, mais
globale. Afin de répondre à ces deux objectifs, il convenait de proposer une étude qui soit en
128
relation avec la chronologie, pour montrer les évolutions de l’image et de son exploitation.
Nous avons proposé un échantillonnage photographique chronologique et une sélection de
films sur des bases thématiques. Nous savons donc que le corpus n’est pas exhaustif, mais ce
n’était pas notre prétention. C’est aux lignes de force et aux mouvements de période que nous
nous intéressions. Vient toutefois la question de l’histoire que nous avons écrite. S’agit-il de
l’histoire de l’image, ou d’une histoire par l’image ? C’est-à-dire, choisit-on de travailler sur
l’évolution historique de l’image, ses modifications de sens, de production, d’utilisation ; et
d’un autre côté, sur ce que l’image apporte pour l’histoire comme nouvelle source
d’informations ? D’autres historiens ont démontré, avant nous, qu’il ne fallait pas s’enfermer
dans l’un ou l’autre de ces champs d’étude. Marc Ferro, Pierre Sorlin ou François Garçon,
pour ne citer qu’eux, n’étudient pas les évolutions de l’image d’un côté, et d’un autre côté son
contenu. Il n’y a pas de cloison hermétique : il faut accepter d’envisager les choses dans leur
complexité.
La méthode étant établie, quelle image « de guerre » montre l’ECPAD de
l’Afghanistan ? C’est, ici aussi, que la chronologie répond à cette question. Elle contribue
surtout à définir le sens de l’image de guerre. Entre 2002 et 2006, l’image dominante est
plutôt celle d’une paix relative. Les lieux et les missions des Français ne permettent guère de
voir des images de guerre, c’est-à-dire de combat ou d’hostilité. Les images des forces
spéciales, par la qualité de leur équipement, les missions de combat qui leur sont confiées,
sont sans doute plus proches de ce type d’image. En leur absence, parce que classées
confidentielles, on peut constater un tableau de tranquillité, mais on le qualifie de relatif. En
revanche, les images suggèrent que les combats continuent sur d’autres terrains. Si la guerre a
disparue, assez artificiellement, ses stigmates perdurent. Il faut reconstruire un pays à genoux,
gagner la confiance des populations et assurer à l’Etat afghan d’être respecté et de pouvoir se
défendre par une armée. Les Français participent à ces actions. Jusqu’en 2006, la guerre n’est
donc qu’une ombre. La communication transmise alors semble dire : « nous faisons notre
travail, de bons résultats sont là ». L’image se conforme à ce tableau.
La guerre se constitue en 2006, ou plutôt, à partir de 2006. L’image montre qu’elle se
rapproche dès lors que l’on voit apparaître de nouvelles mesures de sécurité ou que les
militaires font face à de nouvelles tactiques employées contre eux. Un nouveau contexte
transforme aussi la situation. C’est le début d’une escalade. Les Français changent de mission,
étendent leur lieu d’action à la région Kapisa. Le film sur les OMLT ne fait pas que nous
renseigner sur la nouvelle empreinte française en Afghanistan. Il montre que, en 2007,
combats, violence et même l’idée de la mort sont représentés à l’écran. Pour les soldats qui
129
regardent ces images comme une formation avant leur départ, le film fonctionne-t-il comme
un avertissement ? Il établit en tout cas certainement une idée dans leur esprit : l’Afghanistan,
ce n’est pas tranquille tous les jours. 2008 est le stade où bascule réellement la France dans la
« guerre ». Les officiels, les journalistes, les familles des disparus emploient désormais ce mot
pour qualifier la situation en Afghanistan. L’image montre que le basculement ne s’est pas
fait aussi vite, aussi simplement, qu’avec le décès de dix soldats dans la vallée d’Uzbeen. Il
fut progressif et diffus, à l’inverse du réveil brutal du 21 août. Ce jour là, les cercueils des dix
soldats sont alignés dans la cour d’honneur des Invalides pour une cérémonie d’hommage
national. C’est probablement cette image qui fera date. Ces quelques plans sont des acteurs
historiques : ils signalent à la France le coût de ses opérations. L’opinion ne veut pas qu’on se
batte davantage en Afghanistan pour les honorer. A partir de ce moment, les sondages
semblent indiquer qu’elle souhaite le retrait. L’image de la guerre dépend donc en partie de ce
qui est produit, mais aussi de ce qui est vu. Après 2008, une nouvelle séquence d’images
s’engage en Afghanistan. C’est celle des combats plus réguliers, alors que la perspective du
retrait s’approche. L’image de guerre n’est plus en construction : après cette date, elle est
établie.
130
Sources
Notice descriptive des Archives de l'ECPAD « Fonds Actualité » ; « Fonds
contemporain »
Intitulé/analyse : fonds d'archives Actualité
���Lieu de conservation : ECPAD (Etalissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense), 2 à 8, route du Fort, 94205 Ivry-sur-Seine Cedex, France
Dates : 2001-2011 (en cours de constitution)
Niveau de description : Archives
���Importance matérielle Fonds Actualité : 225 000 photographies, 1 500 titres de films
réalisés depuis 2005
Importance matérielle Fonds Contemporain : 2,2 millions de photographies et plus de 8
000 titres de films réalisés entre 1946 et 2004.���
Modalités d'entrée : versements internes (rushes et photographies) réalisés par des
reporters en opération extérieure ou produits finis commandités par des clients extérieurs
(médias publics) ; versements externes des images d'autres organismes relevant de la défense
et dons.
Présentation du contenu :
- Films et reportages auprès des unités sur le terrain (sous format cassette ou DVD) : produits
finis
- Films et reportages auprès des unités sur le terrain (sous format cassette ou DVD) : rushes et
produit brut
1. Photographies classées selon date, ou mission de reportage (format numérique)
2. Documents relatifs aux images («feuilles de dérushage»)
3. Documents de suivi des transferts aux clients (chaînes nationales)���
Conditions d'accès : libre ou conventionné (selon documents)���
Conditions de reproduction : Photocopies et imagettes en nombre limité gratuit à titre
gracieux. Reproduction des archives audiovisuelles payante, soumise à autorisation.
Langue des documents : français
���Instruments de recherche : base de données ���
131
Sources complémentaires :���- Fonds Opérations extérieures (ECPAD)���- Fonds INA (Institut
national de l'audiovisuel, BNF, Paris) pour les images des chaînes nationales ���
Règles ou conventions : notice descriptive conforme à la norme ISAD(G)���
Date(s) de la description : mise à jour en 2012
Liste chronologique des archives de reportages filmique ou photographique de
l’ECPAD en Afghanistan
Les sources audiovisuelles de l’ECPAD se trouvent au Fort d’Ivry. Les photos se consultent à
la médiathèque sur des postes informatiques, les vidéos au « pôle archive » dans des cabines
de visionnage. Chaque année répertoriée contient des notices de film et de photos. Nous
indiquerons, après le numéro de la notice, le nombre de cassettes ou le nombre de clichés, la
date et le nom du reporter.
2002
Référence 01 2002 036 ; 976 clichés par Thomas Sanson, du 5 janvier au 16 mars
Référence 02.9.96 ; 32 cassettes de rushes Betacam SX. Cassettes 14, 17, 21 et 28 : pas de
feuilles de dérushage.���Cassette 30 : Sujet classifié. Par Gilquin Olivier et Telliez Christophe
(OpSon) et Salmon David (OpV). Du 3 juin au 18 juillet.
2003
Référence N2003-111 ; 1410 clichés par Johann Peschel, du 19 avril au 26 mai
Référence 03.9.55 ; 20 cassettes de rushes. Cassette 1 : pas de feuille de dérushage. Par
Franck Debras. Du 28 avril au 28 mai.
2004
Référence D190-1 à D190-4 : Extrait notice : « De février à juin 2004, le commandant Olivier
de La Bretesche est CONSCOM (conseiller communication) PAMIR VII auprès du colonel
Morel commandant le bataillon français en Afghanistan.���Ses missions sont les suivantes :
rédaction de communiqués de presse, relations avec les médias, interviews et relations avec
les journalistes.������ Réparties dans 5 reportages (D190-1 à D190-5) correspondant chacun à un
mois (février à juin), les 668 photographies du commandant de La Bretesche, prises avec un
appareil numérique Sony DSC P72, illustrent les activités militaires du bataillon français à
132
Kaboul et dans la plaine de Shamali (patrouilles, actions civilo-militaires, aide médicale) mais
témoignent également de la vie quotidienne de la population afghane. L'habitat rural et urbain,
l'agriculture (élevage, cultures) ainsi que les coutumes comme le bouzkachi sont ainsi
immortalisés lors de patrouilles à pied et motorisées. Le fonds comprend également les visites
d'autorités civiles et militaires avec l'inauguration le 23 mai du cinéma Ariana de Kaboul par
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication, et une
inspection sur le terrain du général Bentégeat, chef d'état-major des armées, le 2 juin.��� », 668
clichés de février à juin.
Référence 04.9.168 ; extrait notice : « 3 cassettes de rushes. Pas de feuille de
dérushage.���Rushes versés par le chargé de production E.Paté (BE n°2901/ECPAD/PC le
30/07/2008). Images provenants du SIRPA TERRE, utilisées pour le film 06.5.008 : Politique
de Défense (affaire D 2053124 M). » par Christian Bousquet, avril.
Référence 04.9.169 ; 1 cassette de rushe, « interview d’un traducteur afghan ».
2005
Référence 05.7.016, film Une politique de Défense, de Martinez, Brigitte, réalisé en
septembre 2005.
Référence N2005-368 ; 23 clichés par Roland Pellegrino, 4 novembre.
Référence 05.9.97 ; extrait notice : « 24 cassettes de rushes Betacam SX. ATTENTION :
Mention Ne pas diffuser pour une séquence de la K7-14.���K7-24 : Pas de feuille de
dérushage. » ; par Thierry Anne, du 1er septembre au 3 octobre.
Référence 05.9.152, Confidentiel défense.
Référence 05.9.151, mission ARES 6, par Thierry Anne. Confidentiel défense.
2006
Référence 06.9.110, 16 cassettes de rushes par Vincent Basso-Bondini, juillet-août.
Référence N2006-073, « Obsèques du maître-principal Loïc Lepage des commandos marine,
décédé en Afghanistan. », 108 clichés par Eric Le Pichon.
2007
Référence N2007-141, 1269 clichés par Evrad Taquet, du 12 juin au 26 août.
Référence 07.9.177, 81 cassettes de rushes, par Jean-Daniel Daney et Jannick Marcès, octobre
à décembre 2007. Plusieurs cassettes Confidentiel défense.
133
OMLT : Les mentors, enregistré sous la référence D 2082741 V, extrait notice :
« Classification : diffusion restreinte pour les supports 01 et 02 et confidentiel défense pour
les supports 03 et 04. Demande préalable à faire à l'EMA/CAB/COM pour l'utilisation de ces
images. Les supports 05 et 06 ne sont pas classifiés. ». Réalisé par Jean-Daniel Daney, images
de Jannick Marcès, le 8 juillet 2008.
2008
Référence 08.9.145 ; extrait notice : « 17 cassettes de rushes versées au PA en 2009 par
monsieur Autesserre (BE n°808/DEF/ECPAD/PP le 14/08/2009). Les cassettes 1-18 et 19/20
sont manquantes. Les cassettes n°2, 3, 9, 12 et 16/20 ne sont pas dérushées. », par Nicolas
Chéné, du 29 juillet au 22 septembre.
Référence 08.9.146 ; extrait notice : « 8 cassettes de rushes versées au PA par monsieur
Autesserre (BE n°808/DEF/ECPAD/PP le 14/08/2009). Les cassettes n°1, 2, 6, 7 et 8 ne sont
pas dérushées. », par Nicolas Chéné, juillet-septembre.
Référence 08.9.64 ; « déplacement du président de la République en Afghanistan », 2
cassettes, par Simon Ghesquière, le 20 août.
Référence D 2083364 V, images de la cérémonie d’hommage national aux soldats tués en
Afghanistan, extrait notice : « Confidentialité : diffusion interne aux armées Note :
Réception par le SERTE des images de France 2 », le 21 août 2008.
Référence REV2008-SITER-001, images SIRPA Terre, « Retour des blessés d’Afghanistan »,
par Christian Bousquet, le 20 août.
Référence REV2008-SITER-002, images SIRPA Terre, extrait notice : « Accrochage du 31
juillet 2008 (8e RPIMa). ���Archives des envois Serte du mardi 19 août concernant les
événements en Afghanistan du lundi 18 août 2008. » ; le 31 juillet (vallée de Tagab).
Sources télévision, radio et cinéma :
« Fonds Massoud », 460 notices de film, INAthèque de France, INA, Bibliothèque nationale
de France.
« Mourir pour Kaboul ? » In : Un Oeil sur la planète. France 2. 2007.
« Journal télévisé de 13h ». In : France 2. 19 août 2008.
« Entretien avec Jean-Louis Georgelin ». In : France inter. 24 août 2008.
HISSBACH, Fred. C’est pas le pied la guerre ? In : France 2. 29 septembre 2011.
134
METZ, Janus. Armadillo. 2010. Version originale en danois sous-titrée en français. Version
française. - Copyright : Fridthjof film, cop. 2010. - Durée du film : 1 h 41 min. - Format
image : 1,85, 16/9 compatible 4/3. - Grand prix de la semaine de la critique, Cannes : 2010 :
France. - Prix du meilleur documentaire BFI London Film festival : 2010 : Royaume-Uni
Sources périodiques et imprimés :
CDEF (éd.). L’emploi des forces terrestres en Afghanistan. In : CDEF (éd.), Doctrine. juillet
2009, n° 17, 120p.
DANEY (CNE), Jean-Daniel. Les actualités d’aujourd’hui seront les archives de demain.
S.l. : s.n., 2010. Diplôme de qualification militaire
ÉTABLISSEMENT DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
DE LA DÉFENSE. Images défense: la lettre institutionnelle de l’ECPAD [Etablissement de
communication et de production audiovisuelle de la Défense. Ivry-sur-Seine : ECPAD, 2003.
026.355 00944.
« Interview de Monsieur Jacques Taranger ». In : Objectif Défense. avril 2001, n° 102, p. 5.
« La suspension de la conscription ». In : Armées d’aujourd’hui. août 2001, n° 262, p.6.
« Les militaires du 21e RIMa sont à pied d’œuvre ». In : Armées d’aujourd’hui. décembre
2001, n° 266, pp. pp. 8-9.
Défense et sécurité nationale, Le Livre Blanc. Paris : Odile Jacob/La Documentation
française, 2008.
« Les soldats blessés racontent l’embuscade, les combats, les erreurs... » In : Le Monde. 21
août 2008.
« Interview du colonel Aragonès ». In : La Voix du Nord. 8 mars 2009.
Décret no 2001-347 du 18 avril 2001 portant statut de l’Etablissement de communication et
de production audiovisuelle de la défense, texte paru au JORF/LD page 6231. S.l. : s.n.
Rapport d’information Afghanistan, un chemin pour la paix. Paris : Assemblée nationale,
2009. [Impressions], n° 1772; Documents d’information, 37 2009. Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale le 23 juin 2009.
Sites internet
icasualties.org.
135
Site américain recensant, par nationalité, année et lieu, les pertes enregistrées par la coalition
en Irak et Afghanistan.
« Reportage en Afghanistan... » In : Site de l’ECPAD [en ligne]. [Consulté le 20 mai 2012].
Disponible à l’adresse : www.ecpad.fr.
www.longwarjournal.org
www.nato.int
www.isaf.nato.int
Site de l’OTAN et site de l’ISAF en Afghanistan.
http://sylvielasserre.blog.lemonde.fr/
Blog de la grand reporter Sylvie Lasserre, du Figaro.
http://secret-defense.over-blog.fr
Blog du journaliste Jean-Dominique Merchet.
www.cdef.terre.defense.gouv.fr/
Site internet du CDEF.
136
Bibliographie
Histoire de l’Afghanistan
Ouvrages généraux
ALEKSIEVIČ, Svetlana Aleksandrovna (éd.), Les cercueils de zinc, Paris : C. Bourgois,
2006.
AMITIÉ FRANCO-AFGHANE. [Recueil. Documents d’information], Paris : Afrane, 1986.
ASAS, Naïm. La représentation afghane, Thèse de doctorat, 2011. 4.
BACHELIER, Eric. L’Afghanistan en guerre la fin du grand jeu soviétique, Lyon : Presses
universitaires de Lyon, 1992. Conflits contemporains.
BARRY, Mike. Le royaume de l’insolence : l’Afghanistan, 1504-2011, Paris : Flammarion,
2011.
Afghanistan: dix années terribles, 1977-1987, Paris Paris : Internationale de la Résistance
Union nationale inter-universitaire, 1988.
CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène. Ni paix ni guerre le nouvel Empire soviétique ou du bon
usage de la détente, Nouv. éd. augm. Paris : Flammarion, 1987.
CENTRE D’ÉTUDES D’HISTOIRE DE LA DÉFENSE (éd.). Les crises en Afghanistan
depuis le XIXe siècle, Paris : IRSEM, Institut de recherche stratégique de l’École militaire,
2010. Études de l’IRSEM, n° 1. Issu d’une journée d’études organisée le 29 avril 2009 par le
Centre d’études d’histoire de la défense. Contient une contribution en anglais. En appendice,
une chronologie. Bibliogr. p. 155-160.
DORRONSORO, Gilles. La révolution afghane : des communistes aux tâlebân. Paris : Éd.
Karthala, 2000
DUPAIGNE, Bernard et ROSSIGNOL, Gilles, Le carrefour afghan, Paris : Gallimard, 2002.
GRAU, Lester W et FRANÇOIS, Philippe (éd.). Tactiques de l’Armée rouge en Afghanistan.
Paris : Economica, 2010.
KHAN, Akbar. L’Aide de la France au niveau du développement culturel scientifique et
technique de l’Afghanistan de 1921 à 1979. Thèse de doctorat. 2001. Publication non
autorisée par le jury.
LEFEBVRE, Maxime, ROTENBERG, Dan, GAUCHON, Pascal et WAJSMAN, Patrick, La
genèse du nouvel ordre mondial de l’invasion de l’Afghanistan à l’effondrement du
communisme, Paris : Ellipses, 1992.
137
LÉVESQUE, Jacques et LABELLE, Gilles, L’URSS en Afghanistan, 1979-1989 de l’invasion
au retrait, Bruxelles [Évry] : Éd. Complexe [diff. Presses universitaires de France], 1990.
MCVICKER, Mercedes. L’Afghanistan : isolement, interventions, et (non)-développement.
Mémoire, 2003.
MOLESWORTH, G. N. Afghanistan, 1919. An account of operations in the 3rd Afghan war.
London : Asia publ. house, 1962.
NOJUMI, Neamatollah, The rise of the Taliban in Afghanistan mass mobilization, civil war,
and the future of the region, Basingstoke : Palgrave, 2002.
RAFFNAY, Meriadec, Afghanistan : les victoires oubliées de l’armée rouge, Paris :
Economica, 2010.
RASHID, Ahmed. L’ombre des taliban. Paris : Editions Autrement, 2001.
ROUXEL, Morgane. Mission humanitaire en Afghanistan : mise en place et organisation de
la pharmacie d’un hôpital de Kaboul. Thèse d’exercice. [S.l.] : [s.n.], 2006.
ROY, Olivier. De la stabilité de l’Etat en Afghanistan. In : Annales. Histoire, sciences
sociales. 6, 59e année 2004, pp. 1183-1202.
PHILIPPE (COLONEL), François (trad.). Tactiques de l’armée rouge en Afghanistan. Paris :
Economica, 2010.
La Seconde guerre d’Afghanistan (2001-‐2008)
1.
BARAT-GINIES, Oriane, L’engagement militaire français en Afghanistan de 2001 à 2011 :
quels engagements militaires pour quelles ambitions politiques ? Paris : L’Harmattan, 2011.
BENGA NDJEME, Arthur, La contribution de l’Europe au processus de résolution de la
crise de l’État en Afghanistan, Thèse de doctorat. [S.l.] : [s.n.], 2009.
BERRY, Xavier. Etats de stress post-traumatique au retour d’Afghanistan : comparaison de
deux auto-questionnaires de dépistage et intérêt pour le médecin d’unité. Thèse d’exercice.
[S.l.] : [s.n.], 2010.
BESNARD, Véronique, Mise en images du conflit afghan: rôles et utilisations de la
photographie dans la presse internationale, Paris Budapest Torino : l’Harmattan, 2005. Texte
issu d’un travail universitaire réalisé à l’Institut d’études politiques de Grenoble. Bibliogr. p.
245-249.
BRAEM, Yann, Géopolitique des relations militaires-humanitaires : comparaison des
interventions au Kosovo et en Afghanistan, Thèse de doctorat. [S.l.] : [s.n.], 2007.
138
CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène, Ni paix ni guerre le nouvel Empire soviétique ou du bon
usage de la détente, Nouv. éd. augm. Paris : Flammarion, 1987.
CHALIAND, Gérard. Le nouvel art de la guerre. Paris : Pocket, 2009.
CHALIAND, Gérard. L’impasse afghane. La Tour d’Aigues : Ed. de l’aube, 2011. L’Urgence
de comprendre.
CLAUSEWITZ (VON), Carl. De la guerre. Paris : Perrin, 2006.
DESPORTES, Vincent. La guerre probable : penser autrement. Paris : Économica, 2007.
Stratégies & doctrines.
DJERIDI, Kaltoum. Die Berichterstattung über die Taliban in der arabischen Presse : eine
Darstellung am Beispiel der arabischen Wochenzeitung al-Wasat. Berlin : Lit, 2008. Univ.,
Magisterarb.—Giessen.
DUPAIGNE, Bernard. Afghanistan, rêve de paix. Paris : Buchet Chastel, 2002. Au fait.
GAUTIER, Guillaume (1986-). Du 11 septembre 2001 à l’accord de Bonn : les cent jours de
la campagne d’Afghanistan. Mémoire. [S.l.] : [s.n.], 2008.
GIRARD, Renaud. Retour à Peshawar. Paris : B. Grasset, 2010.
GOYA, Michel. Res militaris: de l’emploi des forces armées au XXIe siècle. 2e éd. Paris :
Economica, 2011. Stratégies & doctrines.
HADDAD, Rayan. Les processus d’insertion de conflits exogènes dans un espace public
communautarisé : captations libanaises des crises du Kosovo, du 11 septembre,
d’Afghanistan, et d’Irak. Thèse de doctorat. [S.l.] : [s.n.], 2007. Publication autorisée par le
jury.
HALIMI, Serge et VIDAL, Dominique. L’opinion, ça se travaille: les médias & les guerres
justes Kosovo, Afghanistan, Irak. 5e éd. actualisée & augmentée. Marseille : Éd. Agone,
2006. Éléments.
HAQUANI, Zalmaï, BRABANT, Sébastien, HECKER, Marc et PRESSET, Paul. Une vie
d’Afghanistan: entretiens avec Sébastien Brabant, Marc Hecker, Paul Presset. Paris Budapest
Kinshasa [etc.] : l’Harmattan, 2006. Inter-national.
HUBAC, Olivier et ANQUEZ, Matthieu. L’enjeu afghan: la défaite interdite. Bruxelles
[Arles] : A. Versaille [Actes Sud diff.], 2010. Enjeux.
JAUFFRET, Jean-Charles. Afghanistan 2001-2010 : chronique d’une non-victoire annoncée.
Paris : Autrement, 2010.
JUNGER, Sebastian. Guerre: être soldat en Afghanistan. Paris : de Fallois, 2011.
139
LASCONJARIAS, Guillaume. « Kapisa, Kalachnikov et Korrigan ». In : Les cahiers de
l’IRSEM. 2011, n° 9.
LEPRI, Charlotte. « Afghanistan : 10 ans de conflit ». In : Colloque des 16èmes Conférences
stratégiques annuelles de l’IRIS. S.l. : s.n., septembre 2011. p. 13.
MAHJOOR, Ahmad Seyer. Approche sociologique de la transition en Afghanistan, 2002-
2005 : entre tradition et modernité. Thèse de doctorat. [S.l.] : [s.n.], 2009. Thèse
confidentielle jusqu’en 2025.
MERCHET, Jean-Dominique. Mourir pour l’Afghanistan. Paris : Jacob-Duvernet, 2009.
MERCHET, Jean-Dominique. Journal du bourbier afghan. Paris : J.-C. Gawsewitch, 2011.
MEYNIER, Gilbert. « Réflexions sur la guerre d’Afghanistan ». In : Guerres mondiales et
conflits contemporains. 2001, n° 243, pp. 121-131.
MICHELETTI, Éric. Forces spéciales en Afghanistan: 2001-2003 guerre contre le
terrorisme. Paris : Histoire et collections, 2003.
QUENTIER, Ariane. Afghanistan, au coeur du chaos. Paris : Denoël, 2009.
TORABI, Yama. State-, nation- et peace-building comme processus de transactions :
l’interaction des intervenants et des acteurs locaux sur le théâtre de l’intervention en
Afghanistan, 2001-08. Thèse de doctorat. [S.l.] : [s.n.], 2009.
VENIARD, Marie (1978-. ..). La nomination d’un évènement dans la presse quotidienne
nationale. Une étude sémantique et discursive : la guerre en Afghanistan et le conflit des
intermittents dans Le Monde et Le Figaro. Thèse de doctorat. [S.l.] : [s.n.], 2007.
[Recueil. Attitudes des Français face aux attentats du 11 septembre 2001 et leurs suites.
Tracts]. Lieux divers : éd. divers, 2001. Ill. [formats divers. Rassemble des documents relatifs
aux attentats ainsi qu’à la politique étrangère américaine qui s’ensuivit, notamment
l’intervention en Afghanistan fin 2001. Voir aussi au recueil consacré à la guerre d’Irak.
Rangement selon un classement systématique dont le plan est joint.
L’Afghanistan et nous, 2001-2009 [exposition, 31 octobre 2009-26 février 2010, Musée de
l’armée-Hôtel des invalides]. Paris : Nicolas Chaudun, 2009.
140
Cinéma et photographie des armées
Cinéma et photographie
BESNARD, Véronique (1981-. ...). Mise en images du conflit afghan : rôles et utilisations de
la photographie dans la presse internationale / Véronique Besnard ; préface de Didier
Lefèvre. In : [en ligne]. 2005. [Consulté le 13 janvier 2012]. Disponible à l’adresse :
http://catalogue.bnf.fr/servlet/NoticeBib?allerA=3&noPage=1&idNoeud=1.4.1.2.1.1.1&host=
catalogue.
BOROT, François. L’Armée et son cinéma, 1915-1940. Thèse. S.l. : université de Nanterre,
1986.
CHALLÉAT, Violaine. « Le cinéma au service de la défense », 1915-2008. In : Revue
historique des armées. 15 septembre 2008, n° 252, pp. 3-15.
CHALLÉAT, Violaine, GUILLOT, Hélène, BEUVIER, Miguel et ETABLISSEMENT DE
COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE DE LA DÉFENSE
(FRANCE). Images de Verdun : 1916-1919 : les archives de la Section photographique de
l’armée. Ivry-sur-Seine : ECPAD, 2006.
DARRET, André. « Le cinéma au service de la défense, 1915-2008 ». In : Revue historique
des armées [en ligne]. [Consulté le 2 mars 2012]. Disponible à l’adresse :
http://rha.revues.org/index2983.html#tocto1n5.
DENIS, Sébastien. L’Etat, l’armée et le cinéma pendant la guerre d’Algérie. Thèse. S.l. :
université Paris I, 2004.
ÉTABLISSEMENT DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
DE LA DÉFENSE. Images de 90 ans d’ECPAD. Ivry-sur-Seine : ECPAD, 2005.
L’image de guerre et son utilisation: séminaire, École militaire, Paris, 20 janvier 1996.
Paris : Centre d’études d’histoire de la défense, 1996.
GUILLOT, Hélène. « La section photographique de l’armée et la Grande Guerre ». In : Revue
historique des armées. 15 mars 2010, n° 258, pp. 110-117.
LAUNEY, Stéphane. Le service cinématographique de l’armée de Vichy, 1940-1944.
maîtrise. Paris : université Paris IV, 2005.
LE SEIGNEUR, Jacques et MOUNIER, Claude. L’image au service de l’histoire ; histoire du
cinéma aux armées. S.l. : ECPA, 1975.
LEMOINE, Hervé et CALLU, Agnès (dir.). Présentation de l’ECPAD. In : Patrimoine sonore
et audiovisuel français : entre archives et témoignages. Paris : Belin, 2004.
141
PINOTEAU, Pascal. La décolonisation française au prisme du cinéma militaire. DEA. S.l. :
université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 1987.
VÉRAY, Laurent. Les films d’actualités français de la Grande Guerre. Paris : éd.
SIRPA/AFRHC, 1995.
Communication de Défense
1.
COMBELLES-SIEGEL, Pascale et CENTRE D’ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES DE
LA DÉFENSE (PARIS). La communication des armées : bibliographie commentée. Paris :
Centre d’études en sciences sociales de la défense, 1998. Les Documents du C2SD.
DEPARDON, Bruno. Entre contraindre et convaincre : être militaire à l’ère numérique.
Mons-en-Montois : Le Fantascope ; Paris : Éditions de l’EMS, 2011. Collection des
chercheurs militaires.
LCL SALLÉ, Jérôme. « La communication opérationnelle en Afghanistan : relever le défi de
la « guerre » de la communication ». In : Doctrine Tactique. juillet 2009, n° 17, pp. 68-70.
RATTE, Philippe. Armée et communication, une histoire du SIRPA. S.l. : SIRPA/ADDIM,
1989.
RODIER-CORMIER, Béatrice. Aux origines de la communication de défense ?: Indochine
1945-1954. Châteauneuf-Val-de-Bargis : les Éd. des Riaux, 2002. Perspectives.
WEBER, Claude et CENTRE D’ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES DE LA DÉFENSE
(PARIS). La filière communication au sein de la défense : typologie, recrutement, formation
et carrière. Paris : Centre d’études en sciences sociales de la défense, 2002. Les Documents
du C2SD.
Méthode histoire du film
1.
CAYLA, Véronique, MITTERRAND, Frédéric et CENTRE NATIONAL DE LA
CINÉMATOGRAPHIE (FRANCE). 1969-2009 : les archives françaises du film : histoire,
collections, restaurations. Paris : CNC, 2009. ISBN 2-912573-42-4.
DELPORTE, Christian, GERVEREAU, Laurent et MARÉCHAL, Denis. Quelle est la place
des images en histoire ? Paris : Nouveaux monde éd., 2008. Textes issus du colloque
international intitulé « Quelle est la place des images en histoire ? », organisé par le Centre
142
d’histoire culturelle des sociétés contemporaines, l’Institut national de l’audiovisuel et
l’Institut des images, tenu à l’Inathèque de France, Centre Pierre-Sabbagh et à l’Institut des
images, Paris, 27-29 avril 2006
FERRO, Marc. Cinéma et histoire. [Paris] : Gallimard, 1993. Collection Folio. Histoire.
GARÇON, François. De Blum à Pétain, cinéma et société française, 1936-1944. Paris : Éd.
du Cerf, 1984. Septième art.
OFFENSTADT, Nicolas. Les mots de l’historien. Toulouse : Presses universitaires du Mirail,
2006.
SORLIN, Pierre. Sociologie du cinéma: ouverture pour l’histoire de demain. Paris : Aubier
Montaigne, 1977. Histoire. ISBN 2-7007-0073-2.
SORLIN, Pierre. Esthétiques de l’audiovisuel. Paris : A. Colin, 2005.
SORLIN, Pierre. « Clio à l’écran ou l’historien dans le noir ». In : Revue d’histoire moderne
et contemporaine. n° 4-6/1974, pp. 252-278.
WEBER, Alain. Ces films que nous ne verrons jamais. Paris : L’Harmattan, 1995. Champs
visuels.
Guide de la conservation des films. Paris : Commission supérieure technique de l’image et du
son, 1995.
Le cinéma et les archives. Paris : Association des archivistes français, 1997.
143
Annexes
Sont présentés en annexe : chronologie de l’ECPAD en Afghanistan, carte du relief,
des régions et du déploiement français, décret portant statut de l’ECPAD, et les entretiens
réalisés avec les opérateurs. Les images analysées dans le mémoire n’étaient pas
reproductibles.
1. Chronologie de l’ECPAD en Afghanistan La chronologie de la colonne de droite est principalement issue de l’Annexe B
« Chrolonologie des évènements » in BARAT-GINIES, Oriane, L’engagement militaire
français en Afghanistan de 2001 à 2011 : quels engagements militaires pour quelles
ambitions politiques ? Paris : L’Harmattan, 2011. pp. 151-159. La colonne de gauche présente les déploiements des équipes ECPAD sur le terrain.
Présence de l’ECPAD (films) Evènements Afghanistan 2001
11 septembre : attentats du WTC 28 septembre résolution 1373 du CSNU
qui autorise les Etats dans le cadre de la LD individuelle et collective d'agir pour prévenir les actes terroristes
7 octobre : lancement de l'OEF 8 octobre : mise en place d'un officier de
liaison français à CENTCOM Tampa, Floride
17 octobre : première mission maritime OEF avec la frégate Courbet
23 octobre : première mission de reconnaissance avec un mirage IV
144
25 novembre : déploiement du groupe aéronaval du CDG en océan Indien
5 décembre : conférence de Bonn qui rassemble les principaux interlocuteurs afghans, définit une autorité de transition pour gouverner l'Afghanistan, préparer les élections et permet le déploiement d'une force de sécurité internationale (ISAF) sous mandat de l'ONU.
Mission de l’ECPAD de décembre 2001 à janvier 2002 (notice 02.9.80) à Mazar-e-Charif
6 décembre : déploiement d'une compagnie de combat à Mazar-e-Charif (220 militaires).
19 décembre : première mission des Mirages déployés à Manas.
20 décembre : résolution 1386, déploiement d'une force multinationale, l'ISAF, à Kaboul.
2002
Janvier à Mars 2002 (notice 02.9.31) à Kaboul, Bagram et Douchanbé. Par Basso-Bondini Vincent (OpV) et Le Goupil Laurent (OpSon).
9 janvier : première patrouille du BATFRA de l'ISAF qui comptera 530 militaires français sur 5 000 au total.
21 et 22 janvier : la conférence internationale sur l'assistance à la reconstruction de l'Afghanistan à Tokyo, première conférence internationale sur l'Afghanistan après la chute des talibans, permet d'établir les secteurs prioritaires de l'aide internationale. Les donateurs s'engagent à donner 3 milliards de dollars.
27 février : déploiement d'un détachement aérien à Manas (350 militaires, 6 M2000 et 2 C135à jusqu'en octobre 2002.
Mars à Mai 2002 (notice 02.9.31). Douchanbé ; Kaboul ; Mazar e Sharif ; Kandahar. Par Bertin Vincent (OpV) et Guilquin Olivier (OpSon).
29 mars : résolution 1401 du CNSU, faisant suite à l'accord de Bonn, décide la création de la mission de l’ONU en Afghanistan (UNAMA) qui coordonne les efforts de la communauté internationale
145
en matière d’aide humanitaire de reconstruction et de développement
3 avril : formation du 1er bataillon de la garde nationale afghane (garde présidentielle) par la FIAS
1er mai : début de la mission EPIDOTE pour la formation de l’armée nationale afghane avec 60 militaires français aux côtés des militaires américains.
Juin-Juillet 2002 (notice 02.9.96) à Douchanbé ; Kaboul ; Mazar e Sharif ; Kandahar. Par Salmon David (OpV) et Gilquin Olivier ; Telliez Christophe (OpSon).
13 juin : Karzaï est élu à la tête de l’autorité afghane de transition
20 juin : la Turquie prend le commandement de la FIAS
Août-Octobre 2002 (notice 02.9.56) à Kaboul. Par Basso-Bondini Vincent (OpV) et Casanova Philippe (OpSon).
Octobre-Décembre 2002 (notice 02.9.79) à Kaboul et Douchanbé. Par Bussat Alain (OpV) et Le Goupil Laurent (OpSon).
Décembre 2002 (notice 03.9.4) à Kaboul Par Arnaudy Jérémy (OpV) et Germain Haris (OpSon).
Décembre 2002 (notice 02.9.71) à Kaboul, visite du ministre de la Défense. Par Vilain Jean (OpV) et Isnard Georges (OpSon).
2003 Avril 2003 (notice 03.9.55) à Kaboul par Debras Franck et Lagarde Bernard.
Février : l’Allemagne et le Pays-Bas prennent le commandement conjoint de la FIAS.
5 juillet : déploiement des premières unités de l’OTAN à Kaboul
Août : la France déploie un détachement de force spéciale (200 militaires) dans le sud-est de l’Afghanistan
11 août : l’OTAN prend le commandement de la FIAS
Octobre : premier déploiement opérationnel de la 1ère brigade d’infanterie afghane pour la sécurisation de la Loya Jirga constitutionnelle.
13 octobre : résolution 1510 CNSU autorisant l’expansion de la FIAS
Décembre 2003 (notice 03.9.69) à Kaboul et Douchanbé. Visite du ministre de la défense. Par Vilain Jean (OpV).
31 décembre : début de l’expansion de la FIAS avec prise en compte de la PRT de Kunduz.
146
2004 4 janvier : la Loya Jirga adopte une
nouvelle Constitution pour l’Afghanistan 31 mars : conférence internationale sur
l’Afghanistan réaffirme le soutien de la communauté internationale à la reconstruction de l’Afghanistan. Les promesses de dons s’élèvent à 8,2 milliards de dollars.
Avril 2004 (notice 04.9.168 et 169) à Kaboul, compilation de rushes du Sirpa Terre. Par Bousquet Christian.
Avril : déploiement du groupe aéronaval CDG en océan Indien dans le cadre d’AGAPANTHE 04, soutien aux opérations OEF et FIAS sur le territoire afghan.
Septembre 2004 (notice 04.9.60) à Kaboul et Douchanbé. Visite du ministre de la défense. Par Vilain Jean.
9 août : le général français Py prend le commandement de la FIAS pour 6 mois
1er octobre : la phase 1 de l’expansion de l’OTAN est achevée vers le nord et une partie Nord ouest
7 octobre : premières élections présidentielles afghanes remportées par Karzaï
Décembre 2004 (notice 04.9.105) à Kaboul et Douchanbé. Visite du ministre de la défense. Par Vilain Jean.
2005 10 février : phase 2 de l’expansion de la
FIAS vers l’ouest. La FIAS compte alors 8 500 militaires et OEF 17 000.
Juillet 2005 (notice 05.9.57) à Kaboul, Kandahar et Douchanbé. Visite du ministre de la Défense. Par Vilain Jean.
3 août : déploiement de 6 Mirage à Douchanbé et renforcement du dispositif français en Afghanistan (+300 militaires) en prévision des élections
Septembre-Octobre 2005 (notice 05.9.97) à Kaboul, Douchanbé et Shamali. Par Anne Thierry (OpV) et Le Goupil Laurent (OpSon).
17 septembre : Décès du premier soldat français par cause hostile (Cédric Crupel) à Spin Boldak, province de Kandahar.
Octobre-Novembre 2005 (notice 05.9.152 et 151) Mission ARES forces spéciales. Confidentielles.
18 septembre : premières élections législatives en Afghanistan depuis 30 ans. La FIAS déploie 2 000 hommes en renfort temporaire pour la sécurisation des élections. Les effectifs de la FIAS s’élèvent à 10 500 hommes.
10 décembre : l’OTAN adopte un plan d’opérations révisé pour l’Afghanistan entérinant l’extension de la FIAS à l’ensemble du pays en établissant les
147
commandements régionaux et l’envoi de troupes supplémentaires.
2006 31 janvier-1er février : la conférence de
Londres établit une feuille de route, l’Afghan compact, pour les 5 années suivantes, définissant les principes de la coopération entre la communauté internationale et le gouvernement afghan, notamment dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance, des droits de l’homme et du développement économique et social.
Juin 2006 (notice 06.9.119) rushes divers SIRPA Terre. Kaboul.
Mai : troisième déploiement du groupe aéronaval du CDG en Océan Indien dans le cadre de l’opération AGAPANTHE 05, soutien aux opérations OEF et FIAS sur le territoire afghan.
Juillet 2006 (notices 06.9.52, 06.9.53 et 06.9.110) à Kaboul, Douchanbé. Par Basso-Bondini Vincent (OpV) et Duponcel Serge. Inclut visite du ministre de la Défense.
14 juillet : la France prend la responsabilité de l’emprise de Camp Warehouse à Kaboul où le BATFRA s’installe en septembre.
31 juillet : phase 3 de l’expansion de la FIAS qui prend la responsabilité du RC-South. 8 000 militaires passent sous commandement de la FIAS dont les effectifs s’élèvent alors à 19 000 militaires provenant de 37 pays.
Août : mise en place des premiers éléments de la 1ère OMLT française. Auprès de l’état major du 201e corps de l’ANA.
6 août : création de la première région de commandement de la FIAS avec le RCC dont la France prendre le commandement pour 8 mois avec le général Le Bot.
5 octobre : dernière phase de l’expansion de la FIAS qui prend la responsabilité du RC-East. Près de 12 000 militaires américains passent sous commandement de la FIAS. Les effectifs de la FIAS s’élèvent alors à 31 000 militaires, ceux de l’OEF à 8 000.
28-29 novembre : sommet de l’OTAN de Riga. Le président Chirac annonce l’adoption du dispositif français avec le renforcement du BATFRA et la mise en place d’un détachement d’hélicoptères à
148
Kaboul, le maintien d’un détachement d’avion de combat à Douchanbé et le déploiement d’OMLTs supplémentaires. Par ailleurs, tous les caveat sont levés sur le dispositif militaire français.
Décembre 2006 (notice 06.9.97) à Douchanbé, Kaboul. Visite du ministre. Par Vilain Jean (OpV).
9 décembre : le général français Pierre de Villiers succède au général Le Bot à la tête du RCC jusqu’en avril 2007.
2007 Janvier : retrait des forces spéciales
françaises de l’opération OEF. Mars-Mai 2007 (notices 07.9.21 et 07.9.27) à Kaboul. Par Laurent Sébastien (OpV) et
Mi-mars : déploiement du groupe aéronaval CDG en océan Indien.
6 avril : la France transfert le commandement du RCC à la Turquie et maintient son dispositif en place. Mise en place d’une seconde OMLT (50 militaires français.)
Mai : ouverture de l’Afghan Commando School à laquelle participe une vingtaine d’instructeurs des forces spéciales françaises.
Août-Octobre 2007 (notices 07.9.50 et 07.9.76) à Kaboul, Douchanbé, Mazar-e-Charif et Kandahar. Par Duponcel Serge (OpV) Septembre 2007 (notice 07.9.49) à Kaboul et Douchanbé. Visite du ministre. Par Vilain Jean (OpV).
Septembre : redéploiement du détachement d’avions de combat de Douchanbé à Kandahar. Environ 180 militaires français sont déployés à Kandahar.
Octobre-Décembre 2007 (notice 07.9.177) par Marcès Jannick (OpV) et Daney Jean-Daniel (Officier image).
Nov/Déc : mise en place de 2 OMLTs supplémentaires
2008 Décembre 2007-Mars 2008 (notice 07.9.96) Kaboul, Bagram, Roissy, Istres (France), par Ratel Rémi (OpV) et Daney Jean-Daniel (Officier image). Mars-Avril 2008 (notice 08.9.117) à Kaboul, Bagram. Par Chavey Sébastien (OpV).
3 et 4 avril : le sommet de l’OTAN à Bucarest établit les principes de la présence de la communauté internationale : engagement à long terme des alliés ; soutien des autorités afghanes pour leur permettre de prendre en charge leur propre sécurité ; coordination des efforts militaires et civils ; coopération régionale, en particulier avec le Pakistan. Le président français annonce le renforcement du dispositif français avec le déploiement d’un GTIA en RC-East. La FIAS compte 47 000 militaires de 40 pays.
149
Juillet 2008 (notice REV2008-SITER-002) reversement du SIRPA Terre, accrochage du 31 juillet 2008 du 8e RPIMa. Juillet-Septembre 2008 (notices 08.9.145 et 146) à Kaboul, Bagram. Par Chéné Nicolas (OpV).
12 juin : conférence internationale de soutien à l’Afghanistan de Paris, 68 pays et 17 organisations internationales s’engagent à soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement pour l’Afghanistan (ANDS). Les promesses des dons s’élèvent à 20 milliards de dollars.
Août 2008 (notices 08.9.64 et REV2008-SITER-001) par Bousquet Christian et Guesquière Simon, (OpV).
6 août : le général Stollsteiner prend le commandement du RCC pour un an.
9 août : la France prend la responsabilité de la province de Kapisa en RC-East
18 et 19 août : Décès de dix soldats français à Uzbeen
21 août : Cérémonie aux Invalides & hommage national aux soldats tués en Afghanistan
20 août : déploiement d’une OMLT française en Oruzgan, RC-South. L’OMLT compte 70 militaires dont un détachement logistique et porte les effectifs des OMLTs françaises à 290
28 août : la France met en œuvre la 1ère phase du transfert de la responsabilité de la sécurité aux Afghans dans la zone de Kaboul
22 septembre : vote au Parlement français de la poursuite de l’engagement français en Afghanistan. Annonce de la mise en place de moyens complémentaires avec des hélicoptères, des drones et des mortiers.
Octobre-Novembre 2008 (notices 08.9.130 et 135) Kaboul ; Sper Kunday ; Surobi ; Tizin ; Waka ; Uzbeen. Par Guesquière Simon (OpV).
6 octobre : début du processus d’enregistrement des électeurs en vue des élections nationales présidentielles en 2009, sécurisé conjointement par les forces de sécurité afghane et la FIAS qui compte alors 51 000 militaires.
150
2. Carte du relief de l’Afghanistan267
267 Carte issue de Doctrine, n°17, juillet 2009. P. 6.
DOCTRINE N° 17JUILLET 2009
6
PRÉSEN
TATIOND
EL’A
FGHA
NISTA
N
Présentation de l’Afghanistan
PARLE
LIEU
TENAN
T-COLO
NEL
PASCAL
PHILIPPEAU
DE
LAD
REX/CD
EF
L’Afghanistan en chiffres, principales données
Surface:652!090 km
2(1,2 fois la France)Altitude m
oyenne!:1 800 mPopulation!:environ 25 m
illionsTaux d’alphabétisation!:hom
mes : 43%
- femm
es : 22%Langues!:D
ari : 55% - Pachtou : 40%
- Ouzbéke et Turkm
ène : 4% - Autres : 1%
Espérance de vie!:44 ansCapitale!:Kaboul (environ 3 m
illions d’habitants)Villes principales!:Kandahar, H
érat, Mazar-é-Charif
Population active!:17 millions de personnes (services 30%
, industrie 21%, agriculture 49%
)Ressources naturelles!:gaz naturel, charbon, cuivre, pierres précieuses et sem
i précieuses
151
Qarah B
aghK
has Uruzgan
Spin B
uldak
Chehar
Borjak
Deh S
hu
Kadesh
Anar D
arreh
Shindand-
Ow
behK
arokh
Tow
raghondi
Qeysar
Tokzar
Andkhvoy
Dow
latabad
Keleft
Jeyretan
Shulgarah
Kholm
Khanabad
Rostaq
Farkhar
JormEshkashem
Qala-I-P
anjeh
Dow
shi
Now
Zad
Dow
lat Y
ar
Kajaki
Delaram
Jalalabad
Sharan
Ghazni
Qalat
Tirin K
ot
Kandahar
Baghlan
Chaghcharan
Farah
Lashkar Gah
Taluqan
Fayzabad
Pul-e-A
lam
Zaranj
Khost (Matun)
Sari P
ul
Kunduz
Maydan
Shahr
Gardez
Mehtarlam
Kabul
FA
RA
H
NIM
RO
Z
HIL
MA
ND
KA
ND
AH
AR
ZA
BU
LPA
KT
IKA
GH
AZ
NI
UR
UZ
GA
N
LO
GA
R
KH
OST
TA
KH
AR B
AD
AK
HSH
AN
BA
GH
LA
N
BA
LK
H
JAW
ZJA
N
SAR
I PUL
FAR
YA
B
BA
DG
HISG
HO
R
PAR
WA
N
PAN
JSHE
R
KA
BU
LW
AR
DA
K
PAK
TY
A
LAGHMAN
KU
ND
UZ
NU
RIST
AN
NA
NG
AR
HA
R
KA
PISA
Hirat
Bam
yan
HIR
AT
KU
NA
RB
AM
YA
N
DA
YK
UN
DI
Zhob
Cham
anQuetta
Zabol
Zahedan
Gushgy
Kiroya
Kerki
Dusti
Khorugh
Qurghonteppa
(Kurgan-T
yube)
Mary
Mardan
Peshaw
ar
Raw
alpindi
Termiz
Gilgit
Taybad
Tank B
annu
Islamabad
TU
RK
ME
NIST
AN
TA
JIKIS
TA
N
PA
KIST
AN
UZ
BE
KIST
AN
INDIA
Jamm
u
and
Kashm
ir CHINA
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Farah
Hilm
and
Gow
d-e Zereh
Harut
Khash
Rowd-e Lurah
Arghandab
Gushgy
Murghob
Darya-ye
Amu Darya
Tedzhen
Harirud
Indus
Pamir
Tarnak
Morghab
Murgab
Helm
and
Kunar
Zhob
Cham
anQuetta
Zabol
Zahedan
Gushgy
Kiroya
Kerki
Dusti
Khorugh
Qurghonteppa
(Kurgan-T
yube)
Mary
Mardan
Peshaw
ar
Raw
alpindi
Termiz
Gilgit
Taybad
Tank B
annuQ
arah Bagh
Khas U
ruzgan
Spin B
uldak
Chehar
Borjak
Deh S
hu
Kadesh
Anar D
arreh
Shindand-
Ow
behK
arokh
Tow
raghondi
Qeysar
Tokzar
Andkhvoy
Dow
latabad
Keleft
Jeyretan
Shulgarah
Kholm
Khanabad
Rostaq
Farkhar
JormEshkashem
Qala-I-P
anjeh
Dow
shi
Now
Zad
Dow
lat Y
ar
Kajaki
Delaram
A
sad Abad
Jalalabad
Sharan
Ghazni
Qalat
Tirin K
ot
Kandahar
Nili
Aybak
Baghlan
Shiberghan
Maym
ana
Qala-e-N
aw
Chaghcharan
Farah
Herat
Lashkar Gah
Bam
yan
Taloqan
Fayz Abad
ChaharikarP
ul-e-Alam
Zaranj
Khost (Matun)
Sari P
ul
Mazar-e-Sharif
Kunduz
Poruns
Maydan
Shahr
Mahm
ud-e-R
aqi
Gardez
Mehtarlam
Bazarak
Kabul
Islamabad
Hi
nd
u
K
us
h
Peyw
ar Pass
Khyber Pass
FA
RA
H
NIM
RO
Z
HIL
MA
ND
KA
ND
AH
AR
ZA
BU
LPA
KT
IKA
GH
AZ
NI
UR
UZ
GA
N
DA
YK
UN
DI
LO
GA
R
KH
OST
TA
KH
AR B
AD
AK
HSH
AN
BA
GH
LA
N
BA
LK
H
JAW
ZJA
N
SAR
I PUL
BA
MY
AN
FAR
YA
B
BA
DG
HIS
HE
RA
TG
HO
R
PAR
WA
N
PAN
JSHE
R
KA
BU
LW
AR
DA
K
KU
NA
R
PAK
TY
A
LAGHMAN
SAM
AN
GA
N
KU
ND
UZ
NU
RIST
AN
NA
NG
AR
HA
R
KA
PISA
TU
RK
ME
NIST
AN
TA
JIKIS
TA
N
PA
KIST
AN
UZ
BE
KIST
AN
INDIA
Jamm
u
and
Kashm
ir CHINA
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AF
GH
AN
ISTA
N
Map N
o. 3958 Rev. 7 U
NIT
ED
NA
TIO
NS
June 2011D
epartment of F
ield Support
Cartographic S
ection
National capital
Provincial capital
Town, village
Airports
International boundary
Provincial boundary
Main road
Secondary road
Railroad
0 050
100150
200250 km
50100
150 mi
The boundaries and nam
es shown and the designations
used on this map do not im
ply official endorsement or
acceptance by the United N
ations.
Dotted line represents approxim
ately the Line of Control
in Jamm
u and Kashm
ir agreed upon by India and Pakistan.
The final status of Jam
mu and K
ashmir has not yet been
agreed upon by the parties.
AFG
HA
NISTA
N
36°
34°
32°
30°
64°
66°
68°
70°
72°
74°
36°
34°
32°
30°
62°64°
66°68°
70°72°
74°
3. Carte des régions268
268 Carte des Nations Unies, 2011.
152
4. Afghanistan : carte du déploiement269
269 Carte issue de Doctrine, n°17, juillet 2009. P. 11.
OEF
Depuis 2001, la com
munauté internationale est présente m
ilitai-rem
ent en Afghanistan au travers de l’opération «EnduringFreedom
»(O
EF). Cette coalition sous comm
andement am
éricaina pour objectifs principaux, la lutte anti-terroriste et la form
a-tion de l’arm
ée afghane. Ses effectifs sont aujourd’hui d’environ10!000 hom
mes,17 pays participant à la coalition.
FIAS
En 2003,
l’Alliance com
plète l’action
d’OEF.
La «Force
Internationale d’Assistance à la Sécurité» (FIAS) regroupeactuellem
ent environ 60 000 militaires,de 40 pays.Il s’agit de
la plus importante opération de l’O
TAN hors d’Europe depuis la
création de l’Alliance.
Le pays est divisé en 5 comm
andements régionaux
(RegionalCom
mands
): - le com
mandem
ent régional Nord - nation leader Allem
agne -H
Q M
azar-e Sharif,- le com
mandem
ent régional Ouest - nation leader Italie - H
QH
érat,-le com
mandem
ent régional Sud - nation leader Grande
Bretagne - HQ
Kandahar,- le com
mandem
ent régional Est - nation leader les Etats-Unis
- HQ
Bagram,
- le comm
andement régional Centre -nation leader France -
HQ
Kaboul.
La mission de la FIAS est la «stabilisation par l’appui aux autorités
légitimes!
afghanes». O
pération m
ajeure de
l’organisationatlantique, son succès constitue un enjeu pour l’avenir del’Alliance
et un défi pour l’unité entre alliés, régulièrement m
ise àl’épreuve. La zone de responsabilité de la FIAS, initialem
entlim
itée à la région de Kaboul et au nord du pays, s’est étendue à100%
du territoire en octobre 2006. Les Etats-Unis sont les
premiers contributeurs
de l’ISAF, la France arrivant au 4èm
erang.
Le déploiement français en Afghanistan!:
Le comm
andement du Regional Com
mand Capital
(RC.C/FIAS)
•Le com
mandem
ent régional de la capitale de Kaboul est placésous responsabilité française depuis le 5 août 2008 pour unedurée de douze m
ois, date de la prise de fonction duG
BR STOLLSTEIN
ER (REP France théâtre). Ce comm
andement
est tournant entre la France, l’Italie et la Turquie. L’effectif desFrançais au sein de l’état-m
ajor est de 80hom
mes.
•Cette
prise de
comm
andement
donne à
la France,
laresponsabilité d’une zone supplém
entaire située à l’est deKaboul qui couvre le district de Surobi appelé le Com
bined JointO
perational Area.
JUILLET 2009DOCTRINE N° 17
11
P PR R
É ÉS SE E
N NT TA AT TI IO O
N ND D
E EL L’ ’A A
F FG GH H
A AN N
I IS ST TA A
N N
Les différentes composantes sur le terrain
153
5. Décret no 2001-‐347 du 18 avril 2001 portant statut de l'Etablissement de
communication et de production audiovisuelle de la défense
Texte paru au JORF/LD à la page 6231
156
6. Entretien avec l’adjudant-‐chef Jannick Marcès, opérateur vidéo de l’ECPAD,
janvier 2012
« Est-ce que vous avez effectué la mission « Ares » des forces spéciales, du début à la fin ? « Non, non, par contre j'ai des collègues qui l'ont fait. Moi j'étais à Djelalabad, et puis la FOB Kogiani. J'ai un collègue avant moi, parti en 2005, qui a fait un autre point sur une autre zone (Spin Boldak). Il n'a pas vécu d'accrochages, comme moi. Par contre il est passé là où il y a un IED, il y a eu un mort. Moi aussi, quand je suis arrivé, sur cette mission dans ce contexte là. Ils venaient de perdre un infirmier sur un IED. Il y a quelqu'un du 13e RDP qui n'a eu de cesse que de mener son enquête pour retrouver les gens. Ils en ont topé un, moi j'étais parti sur une base américaine quand ça s'est passé. Mais, c'était le début, je ne pense pas qu'ils auraient accepté de nous emmener. Il y a un relationnel à mettre en place, un processus de mise en confiance qui fait qu'on n’arrive pas comme ça comme une fleur avec une caméra pour tourner. Ca ne se passe pas comme ça, encore moins avec les forces spéciales. Concrètement, quand vous arrivez arrives, vous dites "il faut mettre un relationnel en place". Il faut établir un lien de confiance ? Ca se passe par des petites choses, aller faire des séances de tir avec eux, aller faire du sport avec eux, en commençant par tourner des choses simples des briefings, de la vie courante. Ca passe par ces petites choses là qui ont l'air de rien, mais sont ultra importantes pour que les gens voient comment tu es, comment tu évolues. Dans les choses les plus chaudes que j'ai vécu sur l'Afghanistan, on s'est retrouvé bloqués dans de petits villages avec les convois. Les blindés ne sont pas adaptés à certaines missions en Afghanistan. On a même un peu abîmé des murs en passant. On s'est retrouvé avec un mec… La loi de l'emmerdement maximum ça existe même avec les forces spéciales. Le gars s'est blessé, parce que le convoi était bloqué, il s'est blessé avec une trappe de blindé… C'était rocambolesque cette histoire. Par contre j'ai assisté en direct aux conséquences d'un IED. Il y a un convoi de soldats afghans qui venaient ramener du matériel et qui a sauté sur un IED aussi. Le gars a été en partie soigné par les médecins des forces spéciales puis évacué en hélicoptère. Tout ça j'avais tourné j'avais fait une petite séquence. Voilà quoi. Par contre en 2007 mon VAB a été clairement shooté. On s'est ramassé une rafale tout le long du blindé en rentrant de mission, des RPG-7 ont pété juste devant le VAB. Autant en 2002, on arrivait à avoir du contact avec la population. Autant en 2006, 2007, la courbe des accrochages et des explosions et des IED et compagnie sur les routes, c'est exponentiel. Comment on se sent, d'abord en tant qu'homme, quand on est attaqué ? L'accrochage de nuit ça a été extrêmement intense, extrêmement rapide. On roulait, les gens étaient au sol, en gros c'était une embuscade. On a eu le coup de bol que le RPG-7 est tombé juste devant, ça n'a pas touché le blindé. Par contre il a été pris à parti par une arme automatique de gros calibre. J'étais à bord du truc, ça s'est passé très vite. On a entendu l'explosion devant on a vu par les trappes ouvertes les rafales avec des balles traçantes passer au dessus de nous et puis tout de suite les gens avec qui on était, ils étaient depuis longtemps
157
sur le territoire , ils ont eu tout de suite de bonnes réactions. Le chauffeur ne s'est pas posé de questions : il a enfoncé le pied sur l'accélérateur, on a roulé comme des brank. Le gars qui était en tourelle à l'arrière, il a rafalé tout de suite. Coup de bol, personne n'a été touché. A partir de là je me suis dit en plus en ayant vu ce que j'avais vu en 2006, pour l'instant les Français on n’a pas beaucoup de pertes, mais si ça continue comme ça c'est évident qu'on va ramasser. Je suis rentré en décembre 2007, et 2008 il y a eu Uzbeen. Est-ce que tu as eu le temps de prendre ta caméra de filmer quelque chose ? Moi j'ai filmé après. Le VAB s'est arrêté cinq bornes plus loin donc j'ai filmé les gens en train de regarder le impacts et puis je les ai filmé ensuite à la FOB, et puis j'ai interviewé les gens. [Rentre un autre opérateur. Marcès s'interrompt et l'interpelle] Tiens mais lui il a été à Spin Boldak avec les forces spéciales ! Ce sont toujours des missions privilégiées avec les forces spéciales. Le problème qu'on a, c'est que c'est peu médiatisé, donc on tombe plus pour les archives pour la mémoire que pour l'actualité. Parce que c'est tellement compliqué d'exploiter les images des forces spéciales où il faut flouter les visages, le commandement n’est pas toujours d'accord. J'ai fait des montages, mais pour les forces spéciales, pour les gens. Ils ne sont pas sortis. En 2007, quand on a été au cœur des OMLT, on est restés avec eux il y a eu d'autres convois où on a été, pareil, il y a eu des accrochages. Par contre mon VAB n’était pas concerné ces autres fois. [Nous sommes interrompus par la télévision qui annonce - nous sommes le 20 janvier 2012 - le décès de quatre soldats français, tués par un soldat afghan, à l'intérieur d'une base et pendant l'entraînement] Les sniper c'est un vrai problème ça. On forme les gens à être tireurs d'élites (nda : les Afghans) mais on les forme jusqu'à quel niveau ? Sachant que dans les gens qu'on va former, il y en a, allér, cinq à dix pour cent qui vont rejoindre le côté taliban. Parfois ils rejoignent pas pour la cause, mais aussi à cause de pressions, pour l'argent… Il peut y avoir plein de motivation. Le problème, c'est que ces gens là, si on les forme et qu'ils exploitent cette formation contre nous après ça devient compliqué le système. Volontairement ils ne sont pas aller jusqu'au bout de la formation des sniper. Pour être pointus, il leur manquait quelque chose. Si le principal rôle de l'armée française c'est de former l'armée afghane pour passer le relais, la question c'est un peu comment établir la confiance ? C'est tout le problème : là tu vois ce qui se passe maintenant, c'est un peu nouveau. Que des mecs en tenue de l'armée afghane, au sein des OMLT et compagnie je suppose, ça se trouve ce sont des mecs qui sont là depuis deux à trois mois et qui d'un coup basculent côté talibans, sans préavis pour les Français qui les encadrent. "C'est même prémédité, suggère un autre opérateur présent dans la salle." Le mec, effectivement, comme il dit, il est peut être rentré dans l'armée afghane dans ce but. "Surtout qu'il y a pas mal de drogués dans l'armée afghane."
158
L'Afghanistan est le premier producteur mondial d'opium. Il y en a qui consomment sur le terrain. L'actualité on la suit toujours un peu de près. Reprenons. Quels ont été vos mandats ? 2010, j'y suis allé en fin d'année. On a eu la chance d'aller en Oruzgan, c'est un secteur où on va assez peu. C'est un secteur où étaient les Néerlandais, Je ne sais pas si ils sont toujours là d'ailleurs. 2007, c'était le début de tout ce qui concernait Uzbeen. On allait à Tagab et à Nijrab. Moi j'ai fait tout le début de la montée en puissance des OMLT à Nijrab, qui est devenue maintenant une sacrée base ! Après, quand vous me disiez qu'est ce qu'on devient en tant qu'humain… Je dirais qu'en 2007, on est arrivés l'unité OMLT venait de perdre un sous-officier suite à un véhicule piégé. Il a foncé contre le blindé, chargé de charges explosives. L'adjudant-chef en tourelle, le VAB a explosé donc… Les gars du détachement français étaient super à crans dans Kaboul. Chaque déplacement était très tendu. A l'époque, ils appliquaient une tactique c'était : ne jamais s'arrêter, dans Kaboul, circuler tout le temps. Ca a généré des comportements finalement dangereux. Un blindé lancé à toute allure en ville dans une circulation qui est complètement débile. Eux, ça leur a permis sans doute d'échapper à des choses mais ça a généré d'autres problèmes de circulation. Ils sont revenus en arrière après en calmant un peu le jeu. Le moindre véhicule, à l'époque, qui s'approchait alors qu'on lui faisait signe de s'arrêter, il y avait des tirs devant. A l'époque les insurgés étaient partis sur ces techniques là et du coup ça a du coup freiné ses techniques. Constamment, chacun se rehausse en fonction des techniques que les autres mettent en place. Je l'ai vécu avec les forces spéciales : les IED c'était des techniques simples avec des contacts avec des lames de scie - quand des véhicules passaient le contact se faisait et l'engin explosait - mais cela pouvait être impopulaire dans le sens où on gérait pas quel véhicule passait dessus. De temps en temps, ce n'était pas des véhicules de la force qui passait mais des véhicules civils. Ca a été relativement impopulaire à un certain moment. Ils ont adapté les techniques, en déclenchant en mettant quelqu'un, ou en déclenchant avec les téléphones portables. Quand on a mis ces techniques en place on a mis les brouilleurs. Comment ça se passe, avec la caméra, est-ce qu'on peut filmer des combats ? C'est une très bonne question. Qu'est ce qu'on fait à ce moment là ? Est-ce qu'on utilise son arme, parce qu'on est armés, ou est-ce qu'on prend sa caméra ? Là, je dirais que c'est un peu en fonction de la personnalité de chacun et de ce qui se passe autour de soi. Moi je pars du principe que je suis là bas avec une caméra pour témoigner de ce qui se passe et que mon rôle premier c'est pas le combat, parce que je suis pas un technicien du combat, j'ai quelques formations mais je suis pas un technicien du combat, moi mon premier réflexe sera de tourner. Mais j'ai des collègues ici et même dans nos cadres qui travaillent avec nous, les Officiers images, il y a des points de vue différents là dessus. D'autres diront, mieux vaut poser la caméra et participer au combat avec les gars. Moi je sais que dans un premier temps je tournerai, et si je vois que ça devient extrêmement chaud pour les gars autour de moi, oui je vais être obligé de poser la caméra pour les aider. Avez-vous tourné des images de combat ? Moi j'ai tourné des images tout de suite après les combats, comme je te disais pour le convoi où on voit encore les douilles au sol etc. J'ai tourné des investigations de village mais
159
on ne m'a pas autorisé à rentrer avec l'unité combattante dans le village donc clairement, on voit et on entend les explosions dans le village, mais moi je suis sur un point haut avec des véhicules et je ne suis pas au cœur de l'action. Cela a été une grosse frustration pour la mission. Le chef de corps était d'accord pour que j'y aille, et le commandant d'opération au dernier moment a préféré retirer le caméraman. Pour revenir aux IED par rapport à ma mission de 2007, les gars étaient à cran donc quand on a plein de monde à cran autour de soi on récupère cette tension. On la prend aussi en pleine poire. Tous les déplacements qu'on faisait, on partait du gros camp de Warehouse à Kaboul pour aller vers le palais de la reine et cie, où il y avait les OMLT, on passait dans Kaboul c'était obligatoire. Tous ces trajets se faisaient avec une extrême tension. Il y a deux solutions : les premiers trajets je les ai fait avec la peur au ventre - il n'y a pas de secret, on est humain. Au bout d'un moment, tu peux pas vivre pendant deux mois avec la peur au ventre. Tout le monde a ses mécanismes de défense psychologique après moi j'ai commencé à me dire "bon ok, tu peux pas, c'est ton boulot, faut lâcher prise, relativiser. Tu t'occupes en tournant." Tourner a été une façon d'évacuer ? Oui, parce que tu es occupé à l'esprit. Tu penses à ton cadre, à tes images, tes enchaînements d'image. C'est une façon d'évacuer la chose. Tu es au travail, tu n'es plus le sac de patates qu'on transporte et qui peut subir n'importe quoi. La contrepartie, quand tu tournes, c'est que tu demandes à sortir à la trappe et tu t'exposes. Tu prendrais un peu moins de risque à rester assis dans le machin. Ce sont des choix. Sur une opération qui concernait des otages, en Afrique, à un moment donné j'arrivais pas à tourner ce que je voulais, j'ai choisi de monter sur le toit du blindé, j'ai pu faire les images que je voulais. C'est évident que sur le toit du blindé, si à un moment ça frittait, j'étais plus exposé. que à l'arrière du blindé. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire une image qui explique bien les choses ou une image bateau où on comprend pas bien. A l'époque, j'étais en photo, j'ai fait ce choix. Le cadreur qui était avec moi ne l'a pas fait. Il ne l'a fait que beaucoup plus tard dans les missions pour faire de meilleurs images. Ce sont des choix personnels, intimes. C'est chacun avec son ressenti, son vécu. Quand tu regardes les images que tu as fait, quelle impression en as-tu ? Moi je suis toujours déçu quand je rentre ! Je suis toujours déçu de ce que j'ai fait, au premier jet comme ça. Je sais ce qui me manque, ce que je n'ai pas réussi à faire. Après, cette espèce de frustration de pas n'avoir pu faire ci ou ça, de n'avoir pu être au bon moment, elle passe. Je vois un peu les bonnes choses. Dans un premier temps, je suis déçu. Je dis ça, mais il m'est arrivé de rentrer en me disant : pouah, j'ai un bon truc là ! Il me faut un temps pour relativiser, et me dire "ce n'est pas si mal, on va pouvoir faire de bons trucs." C'est pareil, c'est personnel. Par exemple ? J'ai eu trucs où en Bosnie, j'ai fait des bornes et arrivé au bout je n'ai pas eu grand chose. Au bout d'un moment, j'ai eu une situation où un petit chiot est venu se mettre au pied d'un légionnaire. J'ai fait cette image, je savais que j'avais une image sympa. Du coup, j'étais content et j'ai un peu ignoré le reste qui était un peu nul. Parfois, des situations se présente où tu te dis : "j'ai un bon truc quand même". Sur l'Afgha, il faut que je me remémore… J'ai un blanc là. Sur la mission du Ponant (en 2006), j'étais le seul cadreur. Tout ce que tu tournes, il
160
n'y a que toi qui es là pour le fournir au média, donc ça a été vu partout, diffusé partout. Il y a ce côté là quand c'est vachement exploité derrière tu es très content. Sur la mission de 2007, ils ont fait un film - pareil, j'étais content du boulot qu'on a fait, d'avoir suivi les gars, on a réussi à faire un film très sympa qui raconte une histoire. Notre plus grande frustration en photo ou en vidéo, c'est quand on a une belle image et que cette image ne sort pas. C'est ultra frustrant. Quand on sait que ça ne sort pas… pour des raisons diverses : parce qu'il n'y a pas de besoin des médias à ce moment là, on est confrontés au phénomène de l'actualité il y a des moments où on a des bons trucs mais ça n'intéresse pas parce que l'actualité du moment c'est Strauss-Kahn ! Mais c'est valable pour tous les reporter qui travaillent sur l'actualité. Ils font des bons trucs, que soit mili ou civil, et ça ne va intéresser personne parce qu'il n'y a pas de place dans les JT. En Afghanistan, êtes vous les seuls à tourner là bas ? C'est vrai que c'est compliqué là bas. Les journalistes qui y vont sont généralement les journalistes accrédités défense, ils partent là bas… Il y en a assez peu qui partent là bas par les vols civils - il y en a - la plupart partent avec les vols militaires. Ca limite le flux des journalistes civils là bas sur place. Quand il y a eu le kidnapping des deux - Ghesquière et Taponnier - je suis arrivé avec eux dans le même avion militaire. J'ai assisté à leur premier tournage, ils ont travaillé avec l'armée française pendant quinze jours, trois semaines et après ils ont été kidnappés. Là, par contre le flux des journalistes civils en Afghanistan s'est complètement tari. L'Etat major a fermé les portes. Si les journalistes civils sont venus, ils y sont allés par leur propre moyen - par vol civil - ils n'ont pas été encadrés par l'armée, qui ne voulait plus du tout encadrer tant que ces gens là n'étaient pas retrouvés. Comment compares-tu le travail des journalistes civils avec celui des reporters de l'ECPAD ? J'ai beaucoup d'admiration pour leur boulot. Nous on est très rarement seuls. Ca m'est arrivé à certains moments de me retrouver seul pour des raisons diverses. On n’est pas sereins ! Eux, la vraie différence, d'ailleurs ce qui s'est passé pour Taponnier et Ghesquière, à un moment donné ils ont quitté l'armée et ils se sont fait kidnappé. En même temps ils voulaient absolument avoir le point de vue taliban. A force de les chercher les autres les ont trouvé. Quelque soit le conflit, en généralisant, globalement, nous on est rarement seuls, on est toujours avec des collègues qui ont des armes. Notre boulot c'est de rendre compte de leur boulot, on est avec eux. On est sûrs d'avoir une ration, d'avoir à manger. Les journalistes civils il faut reconnaître qu'ils peuvent se retrouver vraiment seuls, un peu loin de tout. D'ailleurs, souvent, ils finissent par se raccrocher avec les soldats français. C'est ce qui se passe en général. Eux sont tout seul, vraiment, tout seul. Et puis ils vont voir de l'autre côté du problème. Ils vont faire des images de l'autre côté. On a le cas du journaliste de France 2 qui est allé à Homs récemment, et qui est mort. Même si nous on est confrontés à la mort et aux blessures, c'est vrai que je pense que eux dans leur boulot ils n'ont pas des petits copains avec eux en arme pour les aider. Est-ce que le but est le même pour un reporter civil comme pour un militaire ? Nous on est plus dans la communication que dans l'information. Ce ne sont plus les mêmes données. L'Etat-major montre les images qu'ils ont envie de montrer. Il y a des moments il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on montre. Cela mettrait en péril nos soldats, notre sécurité. Parfois, je cautionne un peu moins, mais ça fait partie de notre boulot.
161
Par exemple ? Sur le tournage de 2007, on a eu un problème c'était le début des OMLT, et il ne fallait surtout pas aborder la mort comme problème. On a quand même fait des interviews où on parlait de ça. Cela a été difficile de le faire passer, et ça n'est passé que parce que le film qui a été fait était à vocation interne : pour la formation des gens qui allaient partir en Afghanistan, dans le cadre des OMLT. Pas de diffusion média etc. Et puis est arrivé Uzbeen, dix gars d'un coup on a été obligés de communiquer. Ca a changé quelque chose ? Ah oui ! Là pour le coup, la mort on a été obligés d'en parler. Et des images, on a commencé à en voir, un peu partout. Le sujet est devenu moins tabou, et on a parlé des blessés et d'autres choses. Je savais que ça allait finir comme ça à un moment donné. C'était tabou, parce qu'il ne fallait pas inquiéter les gens en France. Au delà des problèmes de sécurité où volontairement on ne veut pas montrer soit les équipements, soit les gens, soit le point d'appui avancé, pour pas que les gens aient des détails sur la manière dont s'est orchestré. Il y a des choses, je suis d'accord sur le fait qu'on ne les montre pas. Quand arrive Uzbeen, la population française découvre quelque chose ? Je pense que la population française s'est pris une grosse claque. C'était déjà comme ça sur le terrain avant, mais c'était un gars, de temps à autre. C'était complètement aléatoire. Là, c'est dix huit d'un coup. Que pensez-vous de ce pays ? On est tous amoureux de ce pays. L'Afghanistan et les gens sont beaux, ils ont des vraies gueules de prince. C'est vraiment un pays qu'on aime et qu'on respecte beaucoup, en dehors de ce qui se passe. On adore ce pays - il y a de beaux paysages, des gens qui sont admirables, malgré tout il y a tout le reste autour qu'on ne peut pas cautionner. C'est un pays avec une belle culture. Quand tu tournes des films, quel est le circuit, que se passe-t-il, quel est le public ? Quand on est en Afghanistan, on envoie une sélection d'images à Paris. Il y a déjà un chargé de communication sur place qui oriente les sujets. Il y a des sujets qu'on monte nous même, qu'on propose. En dehors de l'actualité on a un devoir de mémoire, conserver une trace de tout ce que font les soldats français notamment en opérations extérieures. Tout ça c'est archivé ici, et c'est disponible et ça pourra servir pour les historiens pour plein de chose, pour les gens qui font des thèses, pour des journalistes qui veulent faire des articles… Après, il y a la partie communication où on montre des choses qui se passent là bas par le canal de l'Etat-major des forces, via leur site internet, les reportages qu'on tourne là bas sont mis en ligne. Aussi, on met à disposition plein d'images pour les médias. Ce sont des images plutôt brute, il n'y a pas de montage, c'est une sélection d'images, eux ils en font ce qu'ils veulent. On envoie nos images après. Quand on est sur de l'actu, ça part par internet à l'EMA, ça peut partir par satellite via l'IMARSAT (?). Est-ce que tu as une proportion des images filmées qui finissent par avoir un support ?
162
C'est une minorité. On a beaucoup plus d'images qui partent aux archives que d'images exploitées. C'est certain et c'est le côté frustrant de notre boulot. Parfois, on est étonnés, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été exploités et qui le sont un an après, par exemple. [interruption de quelques minutes. L'adjudant Marcès parle alors du rôle de l'équipement] Un gilet pare-balle ça fait une bonne quinzaine de kilos, plus l'armement, plus les munitions, plus le casque, et notre matériel pour travailler. Vous n'êtes pas allégés, en conséquence de votre mission spécifique ? Normalement on est sensé être équipé comme les combattants, sauf qu'on a en plus notre matériel pour travailler. Après, il y a ceux qui prennent tout et ceux qui prennent pas tout. Le problème, c'est que plus on est lourds, moins on est mobiles. Pour faire notre boulot, ça devient très compliqué. On fait de moins bonnes images quand on est moins mobiles ? Evidemment, parce qu'on bouge moins vite, on fatigue plus vite… Il y a des gars qui se sont allégés de manière quasi drastique. Moi je suis jamais allé jusque là, mais par exemple c'est de prendre pas tous mes chargeurs pour m'alléger un peu quand je savais que ça allait beaucoup bouger. Revenons sur Uzbeen. C'est un moment pivot… J'ai le sentiment qu'effectivement, la population civile s'est dit " c'est la guerre là bas !". Avant on employait jamais ce mot, de "guerre", jamais ce mot de " mort". Est-ce que les pratiques de l'ECPAD ont changé par la suite ? Ce qui est certain, c'est qu'on a fourni beaucoup plus d'images qu'avant des cercueils etc. Sur mon dernier séjour en 2010, j'ai vu passer quatre cercueils et il y en a même un qui est rentré avec nous dans l'avion. Quand tu les filme, ça veut dire que tu les montre. Parce qu'on fait aussi des montages pour les familles ce qui est plutôt bien je trouve, ça leur laisse une trace même si ça nous prend du temps. Ca montre que les gens sur place leur ont rendu honneur avant qu'ils rentrent en France. Mais, pour nous c'est un peu lourd, quand tu fais un montage les images tu les regarde, tu les re-regarde, les sons tu les entend à nouveau, etc. Il faut prendre le temps pour assembler ces images et tu passes du temps avec des images de cercueil. Après il faut aller boire une bonne bière, parce que c'est un peu lourd. Comment tu choisis les images au montage ? C'est un travail collectif avec l'officier image. On a tendance à plutôt prendre des images esthétiques, parce qu'on est amoureux de l'image. Parfois, il y a des plans un peu moins bien mais très informatif, et qu'on va prendre aussi parce que notre but c'est de communiquer et d'informer sur certaines choses. C'est valable dans l'actualité. Ce qui s'est passé pour moi sur le Ponant, j'étais dans un hélico quand ils ont arrêté les pirates. L'hélico ça bouge, et quand t'es à fond de zoom - l'hélico s'étant reculé par crainte des tirs de kalachnikov - moi il fallait que je zoome. Donc Zoom plus hélice ça fait des images qui bougent. Mais, c'est informatif. C'est une image qui importe une vraie information, où les gens apprennent
163
quelque chose de fort dans l'actualité. Là c'était le cas, et les médias n'avaient que ça, parce que j'étais seul. Pour l'ECPAD, ça a été un coup énorme parce qu'on a arrosé les chaînes du monde entier. C'était la première fois que des militaires qui travaillaient sur place, avec tout l'équipage - une bonne dizaine de personnes - on récupérait les otages et une partie de la rançon, et on arrêtait les pirates. On était au cœur de l'actualité. On a eu des images surexploitées. Les images que j'ai le plus vu dans les rushes, c'est surtout de la vie courante. Tu es aux côtés des troupes. Ils sont en train de se raser. Les images avec un évènement particulier sont plus rares. Y a-t-il un intérêt à ces images de vie quotidienne ? Moi j'adore, c'est vachement bien. C'est l'éternel problème aussi d'être au bon endroit au bon moment. Il faut voir un truc essentiel : l'Afghanistan, c'est très difficile de se déplacer. Ca, ça génère plein de problèmes. Il y a énormément de reliefs, les routes ne sont pas bonnes, elles sont infestées d'IED… On prend des mesures compliquées qui essaient d'assurer la sécurité des convois mais compliquent énormément les déplacements. Il y a des trucs où tu vas faire, sur certaines missions dans des zones qui n'ont pas été très investies jusque là, dans certaines vallées on va mettre pour faire trois kilomètres une demie journée ! Parce que les démineurs sont devant, pour sonder le terrain… Tu peux aussi passer à l'aller sans aucun problème, et puis au retour, ils peuvent avoir poser quelque chose entre temps. On essaie de varier les itinéraires. C'est difficile d'être au bon endroit quand il se passe quelque chose. Il y a le facteur chance, il y a le facteur autorisation. Les gens qui vont quelque part, veulent-ils emmener une équipe ? Parce que c'est lourd, pour eux, d'emmener une équipe. Ces plans de vie quotidienne, qu'ont-ils d'important ? Je ne sais pas, un mec qui se rase dans le rétro d'un blindé. Ce n'est pas une scène que les civils connaissent beaucoup. Moi je trouve que ça peut être marrant de montrer les conditions de vie. C'est pas super enthousiasmant quand on le fait, il faut être honnête. Mais, quand on est avec les gars, il faut le faire. Parce qu'ils aiment bien être pris dans des situations de vie courante. Par contre, ça j'en suis convaincu, c'est des images qui vont prendre un charme énorme en vieillissant. Prenons les poilus. Les images des poilus dans les tranchées, on les a vu, on les voit à chaque 11-novembre. Ce qu'on voit beaucoup moins, c'est la vie courante. Je peux t'assurer, va voir les fonds d'archives, voir la vie courante des poilus dans les tranchées, ça a un charme incroyable ces images en vieillissant. Voir le petit gars qui est avec ses bandes au mollet, en train d'écrire ses lettres dans la tranchée, moi j'adore ces images là. Je trouve ça très sympa. J'en suis ultra convaincu. Ce sont des images qui ont pris beaucoup de charme en vieillissant. Moi j'aime bien : c'est humain, profondément humain. C'est rustique, il faut le montrer. J'ai pris des douches en Afrique avec vue sur les étoiles, le pommeau c'était relié à un sceau, je trouve ça drôle. Quand je le vis, je trouve ça drôle, ça peut l'être de le montrer aux gens aussi. Ca fait partie du cheminement, de mise en confiance. Le gars doit s'habituer à la caméra. Au début, il est un peu en retrait il n'aime pas bien. A force il l'oublie, et c'est là qu'on prend des trucs supers. Parfois, le relationnel se passe mal ? Ca arrive évidemment. Dans ces cas là, on essaie de faire notre boulot et neuf fois sur dix les gens reconnaissent que c'est utile mais après. Et parfois même ceux qui nous engueulent parce qu'on tourne sont les premiers à nous demander nos images. Ca nous arrive assez souvent.
164
Vous connaissent-ils bien ? Oui, ils connaissent l'ECPA. Ils connaissent le SIRPA Terre. Mais on est une charge pour eux. On est des boulets pour eux, parce qu’on n’est pas des vrais combattants. L'air de rien, il faut libérer une place dans un VAB. Et on est trois nous. Bien souvent, on doit exploser l'équipe : un tel prend la place, l'autre nous rejoindra plus tard… Qui prend-on ? Le photographe ? Le caméraman ? L'officier image ? Il y a des débats dans l'équipe à ce moment là. Il ne faut pas croire, ce n'est pas simple. Et ce n'est pas parce qu'on est militaire que les portes nous sont grandes ouvertes, voire même c'est plus compliqué pour un cadreur militaire de tourner dans le milieu militaire parce que pourquoi les chefs ne sont pas bêtes : ils savent très bien qu'un journaliste civil c'est de grosses retombées médiatiques derrière. Certains chefs sont de gros malins, accueillent plein de journalistes civils, et qui accueillent un peu moins souvent les journalistes militaires. C'est un système qui peut être un peu pervers. Par contre, l'ancienne génération et la nouvelle. Les anciens sont moins portés sur les médias, alors que la nouvelle génération de chef eux ils savent très bien que c'est bon de se vendre, ça amène du monde, ça montre ce que les gens de l'unité font, donc eux les jeunes sont plus sensibles à ça. Ok, ça va compliquer notre dispositif, mais on aura un souvenir, des images et notre travail sera montré. Il y a aussi ça. Les anciens sont plus fermés à ça. La génération actuelle fait qu'on est multimédia, l'ancienne l'est beaucoup moins. Ca joue aussi dans les comportements. Les images sont-elles moins bonnes quand la personne qui est filmée est mauvais client ? Evidemment, c'est valable pour les civils comme les militaires. Quand on arrive, c'est un peu agressif quand même d'avoir un caillou sous le bout du nez toute la journée. C'est gênant. Quand le gars il est pris, après, dans sa mission, qu'il a complètement oublié le truc, c'est là qu'on fait les plus belles images. Au début ça le gêne. Et puis, il y a le bon client et le mauvais client. Il y a le gars coincé, quand on le filme ça ne va pas et quand on fait des interviews aussi. Il y a le mec qui va réussir à passer au delà et il y a celui qui va être complètement tétanisé. Moi je préfère être derrière la caméra que devant ! Si on me demande de choisir, le choix est vite fait. Je ne suis pas à l'aise non plus. Quand t'es bien reposé, à la limite. Penses-tu que tes images contribuent à un devoir de mémoire, mais est-ce que cela rend l'armée plus sympathique ? On est militaire, on est du métier, donc on ne montrera jamais des images où les gens vont passer pour des ridicules. On participe à l'image que la défense a dans le milieu civil, par notre travail. Si tu fais partie d'une équipe de foot, tu ne va pas aller taper dans les mollets de tes copains. On est là pour mettre en valeur leur boulot, et comme on est avec eux, c'est comme n'importe quel milieu. Il y a des choses bien et moins bien, on va éviter de les filmer. Ca nous arrive, mais on va éviter de les montrer. On joue collectif quoi ! Mais par contre je suis conscient du fait, que si la défense a une bonne image dans le civil, c'est aussi grâce à notre travail. Parce qu'on montre les gens dans le quotidien. Il y a plein de gosse que ça fait rêver. L'Afghanistan est une destination privilégiée. On va rarement dans des club med : quand on tourne nos images, on va dans des destinations particulières. On a un collègue qui est parti sur les terres australes. C'est une chance immense ! Cette maison, il y a des travers qui me plaisent pas, il faut reconnaître par contre qu'on est privilégiés. J'essaie de le garder, au delà du reste qui parfois est gênant.
165
Dans les choses qu'on adore faire aussi dans notre travail, c'est montrer la culture locale. Et c'est aussi hyper important. On ne peut pas faire de montage si au delà des images des militaires français sur place, on ne montre pas le pays, ses habitants, sa culture. C'est humain. Tous autant qu'on est, on adore l'humain. L'humain ça ne trompe pas. C'est la vie courante. J'adore ces séquences là. Quand j'étais en photo, j'adorais aussi. L'humain moi ça me touche. L'Afghanistan, les premières années on avait cet humain là, local. On allait boire le thé avec les gens. On s'enrichissait de leur culture, en discutant avec ces gens j'ai appris plein de choses. Le problème, c'est que maintenant avec toutes ces tensions, avec les attentats, les pièges sur les routes, les embuscades, de plus en plus on se coupe de la population. Rentrer dans une maison, c'est risqué pour nous et pour eux. Cet enrichissement que j'adore, et beaucoup ici sont dans mon cas, on l'a un peu perdu. Ca devient compliqué de rencontrer les Afghans : est-ce qu'il a pas sur lui une charge… etc. Tout ça, ça met de la distance entre eux et nous. Même si moi je suis d'un tempérament à aller vers les gens. Maintenant je pense toujours au truc. Est-ce qu'il n'a pas sur lui un truc qu'il a caché ? Il y a tellement de mec qui se sont fait piéger connement au bout d'un moment t'es ultra prudent. Et les enfants ? Les enfants effectivement, moins. Comme on a moins de contacts avec eux, les enfants se cachent aussi plus facilement. Avant on arrivait avec deux trois conneries, à les attirer à les faire sourire. Maintenant, quand on arrive à être au contact de la population ce sont vraiment des moments encore plus privilégiés qu'avant. Parce que c'est rarissime. Comment se comportaient-ils avant, quand il y avait un contact ? Eux aussi sont curieux, ont envie de discuter, même si il y a toujours le problème des femmes qui sont cachés et relativement en retrait. Mais en 2002 j'ai fait des portraits de femme. J'ai réussi à faire ça ! J'étais passé par des interprètes, j'avais réussi à négocier des choses. J'avais discuté avec un Afghan qui travaillait à l'ambassade, à Kaboul, et j'avais pu prendre en photo sa femme. Ce sont des moments privilégiés. On avait fait le gars, dans le village, etc. Ils aimaient bien les Français, on n'est pas perçu comme des Américains. Les Américains sont très agressifs, dans leur comportement. L'armée française, dans notre culture, on a ça. On a toujours eu le contact avec la population, sachant que c'est important. Je vais te raconter une anecdote. J'ai vécu des trucs, quand on est allé sur des points où il y avait des relèves par des soldats allemands. Les Français étaient là depuis un certain temps et sont relevés par un contingent allemand sur cette position, en Afghanistan mais c'est valable partout dans le monde. Dans les passations de consigne, entre officiers français et allemand, le Français dit à l'Allemand : et si vous voulez acheter des produits locaux, un mouton, une poule, que sais-je, vous pouvez contacter machin dans le village… Et là, je vois l'officier allemand qui se braque, et qui dit à l'officier français : " Quoi ? Acheter un mouton ? Acheter des poules ? Mais ça va pas ou quoi ?". Les différences de culture ! Les Français on est toujours dans cet esprit là : quelque part on investit de l'argent dans ces populations, et du contact, et du temps et de l'énergie. Les Allemands, à mon avis vu l'attitude de leur officier, sont restés dans leur position. Les quelques Afghans qu'ils ont vu ce sont ceux qui sont venus vers eux, et ils n'ont jamais acheté ni mouton ni poule. Les Américains c'est le même état d'esprit. Ca change la donne sur place, un petit peu. Vis-à-vis des Français, les Afghans ont-ils un sentiment de confiance, encore aujourd'hui, ou sont-ils désormais gagnés par la crainte ?
166
A partir du moment où on s'est investi plus fort et plus dur, forcément il y a un peu de recul. Ca devient plus difficile de parler avec eux, ça devient plus difficile sur plein de choses. Même si je pense qu'ils continuent de ne pas nous percevoir comme d'autres armées qui ont des comportements plus agressifs. Les Américains ne rigolent pas par exemple ; en même temps, ils ont eu énormément de pertes donc ça joue dans leur comportement. Il y a leur culture : eux, c'est des bases américaines, l'empire McDo, c'est des villes dans la ville. Nous on est toujours un peu chiche là dessus, on essaie de travailler avec le local et je pense qu'on a ça dans notre culture. Les troupes de marine ont l'habitude d'aller sur le terrain et de parler avec la population. Comment ça se passe avec les Américains ? Les Américains arrivent et vivent en autarcie. Ils n'achètent pas de la bouffe locale. Au delà, il y a un risque sanitaire certes, imaginons que le mouton il ait une maladie ou quoi. Il faut savoir le choisir un peu. Ils ne savent pas faire. Ils ne prennent pas ce risque la. Mais on a des gens qui savent faire, des gens qui savent dépecer un mouton, je suis pas sûr que dans toutes les armées il y ait des gens qui ait encore ce savoir faire ! L'Afghanistan, est un pays où il y a une vraie présence multinationale… Oui, avec des différences pour chacun. Les Américains par exemple n'ont pas la culture de négocier. Mais un truc bête, tu va sur un marché il faut un négocier le tarif si tu veux acheter un petit souvenir. Sinon, le mec il le prend mal. Nous on ne les achète pas à des prix exorbitants, on négocie. Les Américains ils arrivent, c'est inflation sur les prix. Les Afghans ne les respectent pas : il n'y a pas de négociations, pas de palabre. En Afrique, c'est hyper important la palabre, il faut que ça dure des heures avant d'acheter le truc. On a plus ça dans le côté français. Moi je joue ça : "je suis Français, tu me fais un tarif de Français et pas d'Américain !". Dans nos missions, en Afghanistan, c'était le rêve pour ça. Même le mec habillé en guenilles a une gueule de prince ! C'est un pays photogénique. Par les paysages, par les gens, tu sens encore le Moyen-Âge, c'est ultra photogénique. C'est pour ça qu'on aime ce pays nous gens d'images. Il y a des pays comme ça où tu vas voir les fonds Indochine, c'est magnifique. Ca fait partie des pays, qui nous Européens, nous font rêver. Ils sont très forts dans l'irrigation. Leur terre là-bas est riche. Dès que tu amènes de l'eau, ça pousse, ça pousse… ! J'ai vécu ça avec les forces spéciales, tu vas marcher, crapahuter, pendant des heures, il n'y a rien, tout est sec. On arrive en haut d'une colline, et derrière, c'est un oasis de verdure, simplement parce qu'ils y ont amené l'eau et qu'ils travaillent la terre. Chez les étrangers des autres forces, y a-t-il des équipes image ? Les Anglais et les Américains ont, les autre ont. Les Américains font beaucoup venir des journalistes civils, qui sont "embedded" comme ils disent. Ils ont du coup ces scènes de vie courante, autant les belles choses, que les drames. Nous on adore être avec eux, et rester avec eux au quotidien. C'est le plus fort et on est loin des sphères administratives. Sur le terrain avec eux, c'est le plus beau même si on y prend plus de risques. Quand on retourne à Kaboul, c'est le gros camp, il faut faire attention à sa tenue, ses chaussures cirées et tout ça. Tu retrouves des travers qui sont plus chiants. C'est comme les opérations : le début de chaque opération extérieure c'est là où on bosse le mieux.
167
Tout n'est pas encore ultra organisé, le matériel arrive. Au fil du temps, ils dépannent plein de choses. As-tu envie d'y retourner ? Oui, bien sûr. Même si, à certains moments, j'aurai le ventre noué. Mais tous autant qu'on est, on a envie. Notre seule hantise, c'est de se retrouver scotché trop longtemps à Kaboul, de ne pas aller ailleurs sur le terrain voir ce qui se passe autour. Voir le pays ? A Kaboul, c'est le pays civilisé, mais tout autour. Quelque chose à ajouter ? L'Afghanistan c'est le parfait multinational. Je dirais qu'il faut qu'on augmente notre niveau d'anglais dans notre boulot. En 2002, on a quand même tourné un mec, le pays se réouvrait, et on a retoruvé un type qui avait fait le voyage en Dosche. Dans les années 1970, il y avait des hippies qui venaient, je sais pas, pour l'opium. C'était la route des Indes en gros ! Et ce mec, en 2002, quand le pays a été un peu libéré, il s'est retapé la route Paris-Kaboul. On l'a accueilli, on lui a donné à manger. Il y a des choses comme ça, des moments un peu privilégiés, avec la population comme avec des gens qui arrivent d'horizon divers. Ce que je garde de ce métier c'est l'humain. Surtout, comme ça, à l'étranger. Et on a les sens à fleur de peau. C'est pour ça que nous on s'est battus pour ne pas rester longtemps sur place. Le commandement s'est battu pour ne pas faire des mandats de six mois. Parce qu'au bout de six mois tu fais partie des murs. Quand on fait des mandats courts, tu sais que tu va passer un moment court donc tu as soif de plein de choses. Tu va déborder d'énergie. Quand tu arrives sur six mois, il y a la fatigue, il y a l'altitude. Ca fait partie des choses qui fatiguent : Kaboul on est déjà à 1 800 mètres. Le commandement s'est battu pour qu'on reste sur des mandats courts. Si on reste longtemps, on n'a plus l'œil aiguisé, l'œil du novice, l'œil du candide. Parce que tu es dans le système. Tu es trop resté dans le système. Le mandat court permettait de partir au moment où ton œil de candide commence à trop s'habituer aux choses. Juste au moment où tu fatigues de tout ce que tu as fait sur deux mois. Pour moi c'était le bon dosage, après il y a d'autres impératifs. C'est vrai que ça coûte cher de faire des relèves à deux mois. Il y a beaucoup d'hommes qui font des mandats de six mois, on s'est calé sur leur fonctionnement mais on a pas le même métier. Eux peuvent s'habituer aux choses : nous il faut que ces choses continuent de nous étonner, qu'on garde l'oeil affûté. Dans ce grand pays, il n'y a qu'une équipe de trois personnes ? Il y a une deuxième équipe qui est plutôt Sirpa Terre, qui est à une heure et demie d'hélico, dans la vallée d'Uzbeen dans un gros camp, à Nijrab. Parfois on se croise, nous notre point de chute c'est Kaboul pour l'instant. On essaie de rayonner ensuite autour. Pas juste trois personnes pour tout couvrir ? Oui mais on le couvre en continu. Ce n'est pas comme une équipe de journaliste qui vient de temps en temps. Et tout ça a un coût : la Défense pense aussi finance, et l'argent reste
168
le nerf de la guerre. Il y a des moments où on va passer à côté de choses. Ce qui nous sauve, c'est que les troupes on peut y avoir accès : il y a des avions français à Kandahar, avec une rotation de deux ou trois heures on y est. Avec ces deux équipes on arrive à gérer, même si je ne dis pas qu'on a pas loupé des choses. On arrive à s'organiser. Tu dis qu'il y a beaucoup d'images qui passent dans les médias. Comment ça se passe concrètement ça ? J'en reviens aux durées de mandat : nous quand on rentre, c'est le début du travail. On a fait la partie la plus intéressante, mais la partie la plus chiante, numériser, enregistrer sur les ordis, faire les montages. Quand les soldats rentrent pour se reposer, nous on rentre et on se met au boulot. C'est aussi pour ça qu'il faut tenir compte de la particularité de notre métier. Si on a des choses intéressantes pour les médias, on va faire une sélection d'images, on va préparer une bande élément. C'est différent d'un montage : un montage est écrite, une bande élément c'est une succession d'images qu'on va mettre bout à bout, 1 min 30 ou 2 min d'images. Et on va choisir les plans pour que les gens puissent raconter leur histoire à leur façon. Les médias civils n'exploitent jamais nos montages à nous : ils se disent "c'est de la com. Nous on veut de l'information". Dans le cas où ils n'ont pas leurs équipes sur place, on est d'accord : on leur donne cette matière, eux la montent comme ils veulent, avec les mots qu'ils veulent entre temps, ils auront téléphoné sur place, ils auront pris les infos pour avoir d'autres sons de cloches. Puis ils racontent leur histoire, à partir des images, qu'on envoie via deux réseaux. Soit par serveur ftp, dans une zone avec débit internet suffisant, soit par IMARSAT, par satellite, si on est dans une zone où il n'y a rien autour de nous, si il y a un besoin très urgent. Dans les choses qui ont changé dans notre boulot, il y a la rapidité d'exploitation. Pour nous tous, c'est un peu une verrue. Quand tu rentres tu as envie de te poser un peu ou quoi, et les gens veulent tout de suite les images alors que tu es à peine rentré. Tu va y passer la nuit alors que t'es crevé. Oui, il ne faut pas croire : il y a plein de moments où on bosse la nuit pour aller plus vite. C'est vraiment la vie du reporter civil, exploitation immédiate quand il y a un besoin très urgent. On rejoint leur métier dans ces moments là. Moi j'ai connu l'époque où on avait du film en photo, quand on rentrait le soir avec les gars, on posait notre sac comme eux, et on restait avec eux après l'effort. Ca participait à la cohésion. Quand on est passé au numérique je rêvais moins mes images parce qu'on était tellement dans l'exploitation tout de suite et tout que. Ce côté magique est tout de même intéressant ; tu peux être au bout du monde et trois heures après c'est au JT. C'est un exploit incroyable. Mais le côté pervers de la chose, c'est que tu rentres on te demande tout. Ce côté là, j'ai un peu de mal. Quand tu vois tes images sur les médias, c'est valorisant. Quand ils sont sympa, les médias mettent que les images viennent de l'ECPA, quand ils sont moins sympa ils oublient. Ca dépend du journaliste qui va faire le montage, si il connaît ECPAD, il va le mettre. Contrairement à ce qu'on pense, sur l'Afghanistan, il y a beaucoup d'images que les gens voient qui viennent de chez nous. Mais on ne le sait pas, personne ne le sait. Comme les gens peuvent exploiter ces images pendant un mois gratuitement, dès qu'on est dans l'acte, les images qu'on leur fournit ils peuvent les exploiter gratuitement. Au bout d'un mois ça devient payant.
169
7. Entretien avec l’adjudant Vincent Larue, photographe puis opérateur vidéo,
janvier 2012
« J'étais dans une petite équipe et notre boulot premier était de faire un petit état des lieux, un point de situation. On devait faire un petit bilan. C'était étonnant, et je suis retourné plusieurs fois en Afghanistan, j'ai du faire cinq passages depuis, à chaque fois j'ai vécu une situation qui se dégradait de plus en plus. Tu parlais d'Uzbeen mais ça a été un grand grand bouleversement et ça a changé beaucoup de choses cet évènement malheureux. Mais il faut voir qu'aussi qu'au niveau politique on était pas impliqué de la même façon, je ne veux pas faire de la politique mais on s'était pas impliqués de la même façon, les OMLT n'existaient pas avant cela, notre ministre de la Défense c'était Alliot-Marie et la France n'avait pris de position aussi importante. On avait la zone de responsabilité de Kaboul mais on avait pas de PRT (Pronvincial Reconstruction Team), on était pas si nombreux, si impliqués que ce qu'on l'est maintenant. Dans les actions entreprises avec l'Afghanistan qui se reconstruisaient, ce que je vois c'est que quelque part, il y avait EPIDOTE, la formation, mais on avait une petite zone de responsabilité. On se limitait à Kaboul, et la zone de Shamali. On n’avait pas la Kapisa, on n’avait pas Tora, ces vallées à problème qui sont extrêmement complexes. Non seulement cette zone de responsabilité n'était pas la même. L'époque faisait qu'il y avait moins de tensions. Je t'avoue que au début où on était arrivés, je me souviens de gens qui nous accueillaient en pleurant, en nous disant merci. C'était hyper touchant. On était les libérateurs. On était comme si on était les sauveurs. On venait de libérer quelque chose. Il y avait des témoignages. On cherchait des gens qui pouvaient nous amener de informations sur des zones ou des points. On nous disait "il y a quelques semaines encore, il y avait des talibans là". Les gens se confiaient, nous racontaient les malheurs qu'ils avaient pu vivre. Tout le monde ne pleurait pas les talibans, tout le monde n’était pas tout le temps content. Tout le monde ne critiquait pas non plus les Talibans, parce qu'ils disaient "Du temps des talibans, au moins, il y avait plus de racket, il y avait une certaine sécurité." Avant, ils ont du vivre une situation un peu plus rock'n'roll avec des gens haut placés, c’était encore plus tribal… C'était étonnant, moi je m'attendais à une critique forte des talibans. Pour certains non. Au début, le plus marquant, c'était l'accueil : les gens nous faisait coucou, les gens nous souriaient. C'était absolument émouvant, fort. A quel moment est-ce ça s'est dégradé ? La sécurité était là, parce qu'il y a des imbrications terribles. Ce pays est complexe, de par les ethnies, de par les mélanges, de par les renversements de régime, retournements de veste des hommes importants, gens opportunistes on va dire. A partir de 2003, 2004 il a commencé à il y avoir des attentats. Même au début, ces suicide bombers ce n'était pas concevable. Des interprètes nous expliquaient que ce n'était pas possible que ce soit des Afghans mais plutôt des gens enrôlés de l'extérieur. L'Afghan il a une fierté. Au niveau des images, je suis passionné d'images, et là c'était fascinant. C'est un pays merveilleux, il y a plein de beautés, aussi bien au niveau des paysages que des gens que l'on rencontre. Avant on était dans un climat plus serein, d'abord parce qu'on était pas autant engagés, ensuite parce qu'on était vus comme les libérateurs. Après, ils ont vite vu la corruption, dans Kaboul le quartier des ambassades avec des grosses villas, somptueuses qui se créaient, l'argent n'arrivait pas comme prévu. Il y avait de la corruption partout, notamment dans la police de nouveau. La France s'est impliqué dans la police, qui a été reprise vers 2005. Avant on laissait vivoter le système mais c'était sommaire. Ca a complètement changé l'implication française avec les OMLT - je ne fais pas de politique pour autant, je ne veux pas m'impliquer, dire si c'est bien ou pas - on avait moins
170
d'implications dans des actions offensives. Celles-ci se sont mises en place lorsqu'on a mené au combat les Afghans. Epidote c'était la formation de l'armée afghane, mais on n’était pas sur l'idée d'aller jusqu'au combat. L'OMLT on les menait et on leur montrait comment on menait des opérations. EPIDOTE c'est formation en classe, et OMLT sur le terrain, l'arme à la main ? On les accompagne l'arme à la main. Au départ, la théorie, les éléments de langage c'était l'armée française est en retrait, le soldat afghan est en tête. Nous on est là derrière pour les conseiller. Mais sur le terrain, l'Afghan est paniqué, désorienté, si bien que quand ça devenait sérieux c'était les OMLT qui prenaient la tête des opérations et montraient à l'Afghan comment ça se passait. C'est vrai que j'ai pris la suite de Janick et j'ai vu des choses intéressantes avec le général de Villiers qui est maintenant major général des armées. Il avait monté une opération, Auckab Magnet. L'opération était de redonner confiance à la population en ses forces de police et ses forces armées. De là, on venait de récupérer pour la première fois Surobi, Uzbeen est à côté. Le général Villiers était à la fin de son mandat et cela allait passer sous la responsabilité des Turcs. C'était en 2007. Il fallait absolument couvrir ça, il a fait appel à une équipe et on est partis en urgence. Pour pouvoir communiquer là dessus. Et on a eu la chance de partir dans des zones complètement où les Français n'étaient jamais allés. C'étaient des zones très dangereuses, mais sans altercations, zéro mort, il n'y a rien eu. Des tas de projets se sont construits avec des villageois. A l'époque on se baladait même, il n’y avait pas forcément des blindés avec nous. Il y avait un contact avec la population. Chose que maintenant au vu de ces toutes tensions, de ces problématiques, on limite le contact avec la population. Comment le contact avait lieu ? Au tout début, 2002 les gens pleuraient, et nous invitaient à boire le thé en nous remerciant. Les gens nous racontait des parcours étonnants avec leurs études, notamment au lycée français. C'était touchant ce qu'ils avaient pu vivre, ce pays, qui sortait de trente ans de guerre… La population était enchantée de nous voir. Tout doucement la situation s'est dégradée. On était plus forcément les bienvenus. Par endroits on se prenait des cailloux. Ca s'est dégradé doucement, pas en une seule fois. C'est un ensemble qui fait. C'est aussi un manque de plein de choses. Il y avait la corruption, ces aides qui ne venaient pas, on leur avait promis des tas de choses, et la misère était toujours là. Le contraste entre riches et pauvres était encore plus marqué. Ils perdaient confiance dans leur gouvernement. Les Américains dans leurs actions, il y avait de plus en plus de morts chez les Afghans. Le climat se dégrade doucement et puis les attentats sont arrivés. De plus en plus on vivait dans un climat de tension, on se protégeait de plus en plus. On est plus pareils après pour le contact, avec l'arme à la main, prête à servir. On se comporte plus de la même façon de par le risque encouru. Il faut voir ce grand changement entre le moment où la volonté politique a fait qu'il a fallu suivre les actions des Américains. La France s'est un peu plus impliquée dans ces opérations. Au départ, en 2007, Auckab Magnet, avec le général de Villiers, en y réfléchissant on a eu beaucoup de chance. On est passé dans des tas d'endroits c'était merveilleux - la beauté des paysages, la beauté des images on se disait même il y a des gens qui paient pour voir des choses pareilles. On rencontrait des gens, c'était fascinant de par le parcours des gens. Il y a eu un grand changement avec ces OMLT. Cela apparaît sûrement dans son film. Il y avait des moments de doute, moments de doute dans ces OMLT, parce que OK on se suit, on fonctionne comme les Américains, avec la liaison 21 autour, pour pouvoir mener à bien les
171
opérations. Mais on se rendait compte que nous, Français, on avait pas le matériel adéquat pour mener à bien ces missions. Les premières personnes qui s'en sont rendus compte, c'étaient les gens dans ces OMLT. Ils réclamaient des munitions, de l'équipement, il y en a qui amenait des choses, c'était vraiment un gros souci. Il y a eu des gens qui, ça se voit dans les interviews, disaient "il y aura des morts". Ils le savaient. Le premier chef des OMLT le dit, je me rappelle de cette ITV. "Il y aura forcément des morts". Parce qu'on allait s'exposer cette fois un peu plus, dans des actions offensives avec l'armée afghane, et forcément il fallait avoir un minimum d'équipement. A l'époque, l'équipement n'était pas là de suite. Il a fallu attendre un peu. Les évènements d'Uzbek, malheureusement, ont un peu accéléré ce processus. C'est comme si les gens avaient ouvert les yeux. Ca a été un évènement déclencheur ? Oui, c'est ça. C'est vrai des grands discours, des gens qui disaient que les rangers, la coiffe, la treillis suffisaient largement à faire ça et que eux ils avaient fait l'Algérie ou telle opération et que c'était suffisant. Mais il faut voir que par rapport à ce qu'on demandait à ces OMLT, en montagne, avec beaucoup de charge à porter, il fallait un autre type d'équipement. Beaucoup de gens achetaient, tu le verras ou l'entendra surement, de leurs propres deniers, du matériel pour répondre à leur mission : des lasers, des sacs, … Après tout ça de par Uzbeen, d'un coup il y a eu une prise de conscience. Que ce qui était dit ce n'était pas pour répondre à des enfants gâtés, mais c'est parce qu'il y avait un besoin. Ils se sont rendus compte que ces OMLT il y avait une condition physique, de vie, assez rustiques. Les premières OMLT vivaient avec pas grand chose. Ils se construisaient de bric et de broc leurs petits trucs. Avec les Afghans, ils disaient qu'ils découvraient un peu plus ce que c'était que l'armée afghane. Tu as commencé dans le renseignement, tu es devenu opérateur à quel moment ? J'ai rejoint l'ECPAD en 2006. J'ai rencontré leurs équipes là bas sur place déjà, et nos propres moyens, j'avais beaucoup d'équipement en photo, vidéo. Pour pouvoir fournir du matériel : la preuve par l'image pour pouvoir remplir des dossiers. Ce qui nous amenait souvent en contact, parce qu'on cherchait des informations et j'avais une certaine liberté d'action, de mouvement, qui nous permettait de faire des images dans différents quartiers, différentes zones. La photo et la vidéo, l'image a toujours été ma passion. L'Afghanistan aussi a été un élément déclencheur, pour moi, pour que je puisse intégrer l'ECPAD. J'avais pas mal vadrouillé dans le monde, de par les équipes que j'avais pu croiser j'avais envie d'intégrer ce service de communication. Parce que je me dis que c'est un métier formidable, de pouvoir témoigner par l'image. Moi j'étais un peu frustré dans mon travail, on me demandait de faire des images, essentiellement des trucs techniques. J'en faisais plein à côté, des cartes postales qui me servaient d'ailleurs de monnaie d'échange parce que j'avais la chance d'aller dans tel endroit. J'aurai aimé communiqué un peu mieux dans cette communication audiovisuelle. Au bout de quatre ans, ils m'ont laissé partir, j'ai demandé à intégrer les reporters et j'ai été intégré ici. j'étais reporter photo au départ, et j'ai fait pas mal de photos. Tu es retourné en Afghanistan en tant que reporter ? En 2007, en 2008, l'opération Hawkeye Magnet c'était en 2007. Puis en 2008-2009, avec cette fois un travail sur les OMLT où on voyait la constitution de cette armée afghane qui se créait. Toute cette action civilo-militaire, j'ai appris que ça aussi c'était fait par des Afghans, ils ont un OMLT qui s'occupe de la formation des aides civilo-militaires. A l'époque, c'était au départ que des fantassins. Les premières OMLT c'était aller au contact quoi. Et puis on a vu des
172
OMLT arriver, des OMLT de soutien, comme si toute une armée, une armée complète, on formait cette armée à tout type de mission pour devenir autonome. D'ailleurs, c'est l'idée. Tout à l'heure j'étais en relation avec l'équipe en place, ils me disaient que justement au vu des derniers évènements malheureux qui se sont produits ce week-end, on évite de plus en plus le contact. Lors d'opérations l'ANA, fait l'opération, les Français sont bien loin derrière. Ce ne sont plus les mêmes types de missions. On est moins au contact que ce qui se faisait avant. Il n'empêche que tous les problèmes de sécurité sont là quand même, tout ce qui est IED par exemple. J'ai vu des gens, qui, psychologiquement, c'est difficile. T'es dans le VAB, tu vis ça, ça peut t'arriver n'importe comment. Comment tu vis ça ? Est-ce que ça t'est arrivé ce genre de situations extrêmes ? J'ai pas vécu d'IED là avec cette unité, pas directement impliqué. C'était toujours après… On en parlait entre nous avec les différents OpV c'est souvent après, de ce que tu en fais de cette pensée. C'est ce qui fait une hantise, une psychose, des gens qui ont très mal vécu ces moments. Ensuite, je me dis qu'on a la chance de faire un travail qui nous permet de restituer par l'image l'intensité de ce que peut vivre certaines personnes. C'est ça qui est formidable. Tu dois mesurer la chance que tu as. Tu dois toujours faire ça en sécurité. Ne pas remettre en question l'opération, ne pas sortir ton appareil photo à n'importe quel moment, pouvoir immortaliser les choses tout en sachant qu'il y a une opération militaire en cours. Et, que tu dois pas d'un coup perturber l'opération parce que tu va commettre une action qui va mettre ta vie en danger, et comme tu te mets en danger, quelqu'un va vouloir te protéger, il y a un effet boule de neige. Ta priorité, c'est la caméra, ou c'est le fusil ? Je me suis retrouvé avec des chefs qui étaient en train de mener une opération, et en préparation de mission ils acceptent de t'intégrer dans la mission à condition que tu respectes leurs règles : que la mission se passe bien, en aucun cas que tu viennes les gêner. On n’est pas là pour faire un show, la communication n'est pas, dans les phases opérationnelles, une priorité. Si toi, tu es intégré dans une opération. Je ne parle pas de grosses opérations médiatiques, mais de caméraman ou de photographes intégrés dans une opération. On te le fait comprendre, on te teste, pour savoir si tu ne va pas commettre de gestes malheureux. Voilà, pour savoir quelle est la priorité. C'est faire en sorte que tu respectes les règles, à faire attention que tu viennes pas gêner, commettre une faute, qui pourrait remettre en cause la mission ou mettre en danger la vie d'autrui. En tant qu'agent communicant, c'est facile de se faire accepter ? Non, non justement, ce n'est pas forcément évident. C'est bien d'être fendu d'image, de vouloir mener à fond, de réussir, d'être là, tu as plein de belles images à montrer et tout, mais un grand grand chef qui a la tête sur les épaules et qui va monter une action ça peut faire peur, l'homme qui veut réussir une image, un cliché. Après, il y a différentes postures. C'est du relationnel, il faut réussir à se faire accepter dans une mission. C'est ça qui est intéressant. C'est bien techniquement, c'est bien l'image, il y a plein de choses mais ça ne s'arrête pas là. Il faut justement réussir à se faire accepter dans des groupes opérationnels pour pouvoir mener à bien, respecter leur mission et toi te faire petit, discret et réussir à ramener cette intensité, ce qu'ils vivent quoi. De là, tu arrives à faire ça, il y a des instants, c'est sublime. C'est vrai que les OMLT, ce qu'a vécu Janick, il a longtemps demandé à un colonel de la légion et jamais il n'a pu intégrer une opération, malheureusement pour lui, du temps où il a fait ce film. Moi je
173
suis venu juste après, et là il m'a amené avec lui en opérations. Parce que toutes les fois où il se sentait redevable, il avait promis et donc, moi il m'a emmené en opération. Là, j'ai vu plein de choses. J'ai ramené des images de gens qui se font tirer dessus. C'est très fort et c'est humainement parlant… C'est la première fois que je réentendais cette expression "frère d'arme", c'était des choses, ça fait vieille armée. De nouveau ça reprenait son sens. Les gens, qu'importe la spécialité, on était tous ensemble dans un moment fort où chacun avait ce qu'il avait à faire mais on est tous revenus ensemble. Il y avait ce côté frère d'arme. C'est génial quand tu arrives à faire oublier que tu n'es qu'un photographe, mais que tu fais partie de ce groupe et saisir des instants comme ça. C'est ça qui est, voilà moi je me dis j'avais la chance de vivre ça. Il faut aussi relativiser, parce que nous on est juste communicants on doit toujours faire attention à ce qu'on fait, ne pas s'imaginer que ton image est plus importante que ce que eux font. il faut bien respecter ces consignes de sécurité. C'est tout un travail de relationnel. On est quand même dans l'armée, il y a tout un truc. Le chef ne t'embarquera pas s'il n'a pas confiance en toi. Quels sont les meilleures images, tu parlais d'instants magiques ? C'est peut être une mauvaise expression, je dis la même chose quand il y avait le tremblement d'Haïti. C’est magnifique, non c'est l'horreur. Visuellement il y a des choses qui sont intenses. Ce sont des choses que tu ressens, quand tu t'approches de ce que tu as ressenti, quand tu arrives à l'avoir en image, c'est bien. En photo, je me suis dit que par exemple c'est beaucoup plus complexe que la vidéo pour ces témoignages, ces expressions. La photo fige un instant. Le relationnel est là, tu peux saisir plus de choses. C'est deux types de média, de vision mais la vidéo est intéressante. L'opération sur laquelle j'étais photographe, on s'est fait tirer dessus, je retrouve des choses mais pas aussi fort que ce que j'aimerai. C'est pas pour moi, mais pas rapport à ces gens, cette énergie, ce sacrifice, ce dépassement de soi, ce sont des choses qu'on ressent, ces échanges, on participe) des choses qui sont très fortes. Et, il faut du temps pour t'imprégner du groupe en photo. En vidéo, tu peux, de par le son, de par les échanges qui peuvent se produire, réussir à saisir plus de choses, plus de témoignages voilà. Ne serait-ce que ça. Un portrait c'est plus complexe. Un instant saisi c'est plus difficile, il faut plus de temps. La vidéo, m'aurait amené des choses sur ces instants, les échanges que j'entendais entre les mecs. Après, ce sont des instants intenses, je ne dis pas sublime, je ne dis pas magnifique, mais ce sont des instants forts en émotion. Oui, t'es témoin de ça. Tu as la chance d'avoir une caméra ou un appareil photo. Si tu as bien fait ton travail, tu as la chance de te faire la petite souris et de réussir à capter ces petites expressions, ces petits échanges, de faire passer de l'émotion, de l'intensité, aux gens qui vont regarder les photos après. Comment ça se passe, une fois que les images sont prises, quel est leur avenir ? Je pense qu'il ne faut même pas y penser. Je pense au devoir de mémoire, je pense à des choses comme ça, avec des propos élogieux. A cette idée que, je vais sortir du cadre Afghanistan mais, en Haïti, de par cette intensité, cette volonté d'entraide, on a fait beaucoup de témoignages. On avait des gens en pleine action, en recherche de corps, en déblaiement. On voit tout ça, j'étais caméraman et c'était important de les faire témoigner. C'est ça qui est bien : récupérer les propos, pour que tout cet investissement, ce dépassement de soi, que tu arrives à garder un témoignage, ce sont des moments au delà de l'individu, des moments qui dépassent, qui font la beauté de l'humanité. Des sentiments forts. Ce n'est pas pour moi que je veux garder une trace, tu n'es pas le médiateur mais tu es le moyen de, tu as la caméra, l'appareil photo, et c'est pour ça : un énorme travail de relationnel. Tu essaies de convaincre la personne que tu a en face de toi, de l'importance que ça a, mais ce n'est pas pour lui non plus
174
quelque part, c'est pour cette intensité qu'il fait. Cela dépasse le côté individualiste. On est dans une entraide, dans une belle humanité. Peu importe si les images vont être vu, dans une semaine, dans un an, dans dix ans ? De mon côté, je fais abstraction de ça. Ca me dépasse, je ne peux pas agir là dessus. Bien sûr, j'aimerais. Des fois, tu sais que tu as une mine d'or dans les mains, tu as quelque chose qui est élogieux, qui va permettre pour l'armée française de mettre en avant les actions entreprises… Ce n'est pas toi qui décides, ce serait même un peu prétentieux. Tu sais que tu as une mine d'or, tu peux le signaler, tu peux le mettre dans ton montage. Mais ce n'est pas nous malheureusement, on a une hiérarchie militaire, il y a tout un système de communication, et si il n'y a pas de volonté de communiquer sur ce sujet de ce côté là. Il ne faut pas non plus se faire du mal bêtement. Il y a plus intérêt à aller récupérer, convaincre la personne pour capter quelque chose. Et puis un jour, peu importe si c'est mis dans une boîte, un jour un étudiant comme toi, un historien, quelqu'un tombe dessus, il y a quelque chose ça dépasse mon petit travail, et ça dépasse la personne qui témoigne. Ca permet de faire le lien. C'est ça qui est génial comme boulot. On a la chance de faire un boulot extraordinaire. Il y a la technique, plein de problématiques logistiques, mais le premier truc c'est l'humain et le relationnel pour réussir à te faire accepter. Tu n'es pas un opérationnel pur, tu n'es pas une priorité immédiate dans un dispositif qui est mis en place pour sauver des vies, pour amener une aide quelqu'elle soit. Te faire accepter là dedans, puis réussir à faire témoigner ces gens de ce qu'ils font, c'est tout un boulot. Les gens ils ont tendance à minimiser leur travail. Les gens ne veulent pas forcément témoigner. Les gens qui font ces opérations, là c'est beau, dans l'intensité de leurs actions, c'est au delà de leur vie, dans le dépassement de soi. Les images de combat, qui sont très rares, des moments exceptionnels, est-ce que c'est la majorité des images que tu tournes ? Non, non, ce n’est pas la majorité. Il ne faut pas aller chercher celles-là particulièrement. Des images du combat beaucoup de gens sont déçus parce qu'ils ne vivent pas l'intensité, et si tu ne le vis pas c'est tant mieux quelque part. Après, ça peut être des choses très belles c'est à toi de faire en sorte de trouver, de chercher à obtenir cet investissement ces liens particuliers qui existent entre un maître chien et son chien démineur, ça peut être des sujets anodins au départ mais derrière ça tu peux trouver une beauté, des choses qui sont chouettes. Je ne dis pas que tout est tripant à faire. Non une prise d'armes ce n'est pas si intéressant que ça. Plein de gens aimeraient partir, faire des opérations. Mais il ne faut pas partir avec une idée en tête parce que tu es souvent déçu. Là, plein de gens ont vécu des choses en Afghanistan. Le contexte fait que la situation a changé, les opérations ne sont plus les mêmes, et il ne faut pas y aller avec une idée. Tu vis ce que tu vis, tu fais ce que tu as à faire, mais il ne faut pas courir après quelque chose… Dans tes images tu va avoir, des images, cette diversité de ce qu'on peut vivre là bas ? La plupart des sujets qu'on nous demande de faire, j'ai vu ça à l'ECPAD, c'est quand même de par la chaîne hiérarchique de communication qui est mise en place dont on parlait tout à l'heure, toutes les petites opérations sont filmées et parfois il y a comme une routine qui s'est mise en place, avec construction d'un pont, les aides à la population, travail de déminage à tel endroit, et parfois je t'avoue avant il y a quelques années on était dans un truc, où tu prenais des images, tu changeais les bérets, tu changeais l'unité qui faisait l'opération, tu retrouvais la même un an après. Il y avait certaines personnes qui partaient là bas et qui
175
voyaient toujours à peu près la même chose. Ce qui a changé, c'est l'arrivée des OMLT : à partir de là la France a été impliquée dans des actions beaucoup plus exposées. De là, malheureusement, toute l'insécurité a grandi aussi. Tu essaies du coup de faire des images sur la vie quotidienne ? La vie au camp ? Oui, la construction de camp. Au niveau du dispositif, on a multiplié par je ne sais combien… Au départ je crois qu'on était 300, 400 en Afghanistan, et là on est plusieurs milliers. C'est devenu important. Il a fallu construire, mettre en place la logistique pour soutenir ces gens. Si tu vas plus loin, la complexité pour toutes les chaînes logistiques, pour l'armement, tout peut devenir intéressant. La problématique de par l'approvisionnement en essence, l'insécurité - plein de mesures à mettre en place - donc oui il y avait des tas de sujets. Il y avait toujours quelque chose à faire. On peut faire un bon sujet avec n'importe quel sujet ? Oui je pense qu'on peut faire un bon sujet avec n'importe quel sujet si tu as… Il faut savoir que tout ça est soumis à validation. On a un conseiller en communication, on a des éléments de langage, "on travaille pour la ligne du parti". Notre travail, sans vouloir, n'importe quel journaliste a une ligne éditorial, celui du Canard enchaîné a une ligne éditoriale, celui du Figaro va travailler sur autre chose, nous notre but premier c'est de mettre en valeur le travail des Français en Afghanistan. On travaille dans ce sens là. On le sait. Quelqu'un qui est reporter photo, qui a envie de faire ou qui comprend pas pourquoi, c'est qu'il a pas compris. Ce serait quelque part faire preuve de mauvaise foi. On ne peut pas montrer telle chose. Même si la plupart des gens qu'on suit te demande cette objectivité. Tu ne peux pas leur assurer, ce n'est pas toi qui décides. Les mecs des OMLT au début voulaient qu'on vienne faire des photos de leur matériel, de leur machin, de leur truc, pour montrer qu'ils étaient sous-équipés. As-tu pu les faire ? Oui, on les a fait, pour eux, ces images. En même temps, c'est technique. Mauvais position de blindage, mauvais équipement. Les gens qui disaient que le gilet pare-balle n'était pas adapté à ta position de tir. Tu ne peux pas tirer, tu ne peux pas te défendre. Tu n’as pas de liaison 11 pour communiquer en cas d'accrochage avec la chasse pour qu'ils viennent te soutenir. On faisait des choses, mais vu qu'il y a cette chaîne hiérarchique, c'est plein de problèmes. On est dans une institution, tous ces problèmes ont été résolus depuis mais il a fallu du temps. Alors les gens demandent à ce que tu viennes : " il faut montrer ça, c'est comme ça qu'on vit ". Oui, mais je suis désolé il faut quand même que tu sois en tenu, on est là pour mettre en valeur ton travail on est pas là pour dégrader le machin, en disant les sales conditions de vie, regardez, où vivent les Français. On ne se tire pas une balle dans le pied quoi. Est-ce que les images que tu fais vont avoir tendance à aller chercher des trucs, peut-être pas aller chercher d'autres ? Est-ce qu'il y a des images que tu t'es refusé à faire ? Non, non, non. Non, ça ne va pas jusque là. Parce que ce serait des choses dégradantes et ça n'a jamais été jusque là. Mais par contre d'accentuer des choses oui, ou d'expliquer au mec qu'on passe tout ça, il n'y a qu'aujourd'hui que je puisse faire ce reportage, l'hélicoptère le machin le truc, toi tu es mon acteur ce serait mieux si tu… Tu fais un rappel sur le pourquoi tu
176
es là. Et puis il y a les éléments de langage, au début on devait chercher le contact avec la population donc on accentuait ce contact là. Ou alors j'ai besoin d'une poignée de main et il est sensé le faire - je pense le Congo, là bas etc. Il y en a certains tu n'a pas besoin de leur demander ils vont le faire. D'autres sont très réticents. Tu ne peux pas mettre en valeur avec quelqu'un qui fuit la caméra. Et dans une interview ? Si tu n'as pas un bon client, tu peux tourner dans tous les sens le truc, des fois c'est pas un bon client tu peux chercher, reformuler tes questions. Si tu n'a pas un bon client c'est un peu râpé c'est pas forcément la personne la plus… Le chargé de communication dernièrement au grand palais, n'était pas la personne la plus. C'est parfois le manu qui est content parce qu'il a participé, il a fait plein de truc. Donc ça sublime. On est toujours un peu là dedans, pas sublimer mais valoriser. Pas fausser, chercher tous les éléments en ta faveur pas pour obtenir le cliché que tu veux, mais tu le sais un peu ce que tu veux. Quel est l'impact des conditions de travail : tu as pu arriver là ? Oui, c'est important. Mettons, mauvaise météo, « on ne peut pas reporter » parce que toi tu as besoin, c'est bien d'avoir l'hélicoptère mais si tu as un fond tout laiteux alors qu'on passe au dessus de Kaboul c'est un peu con. « On ne peut pas trouver un autre créneau ? » Tu ne va pas voler souvent donc autant essayer de mettre toutes les chances de ton côté : ça tu peux le faire. Après, il y a des moments où tu es intégrée dans un truc et tu pars, tu cherches même pas. Quand, tu es là, t'es en train de construire, t'as tes aptitudes, tu sais ce qui est bien ou pas, quand tu as l'occasion autant essayer de pouvoir valoriser. Sinon un hélice qui vole sur un fond blanc et ça peut être n'importe où. Alors que si tu vois des montagnes afghanes et la ville en dessous et voilà : on est en Afghanistan. L'image parle d'elle même. Il faut que ce soit le plus représentatif possible de ce que tu vis. C'est important. Le montage, est-ce que c'est un moment important ou est ce que c'est un moment technique obligatoire ? Au niveau montage, pur ? Par rapport à des séquences ou des produits ? Il faut voir deux choses. Le produit sur les OMLT est un produit qui a été fait ici avec tout un travail de fond, un réalisateur qui a été détaché pour ça - Louis-Dominique - et tout un tas de choses. Le montage terrain, on est là pour répondre à des besoins de l'EMA com, parfois des besoins opérationnels, enfin en communication du moins, on a beaucoup moins de temps, on a moins de pratiques, d'heure, de matériel. On est plus sur une histoire de bout à bout. On va chercher à mettre en avant les propos tenus, qui sont intéressants, et puis les images représentatives du sujet que tu traites. Il faut que visuellement on sache ce que c'est, et que les propos soient explicites. C'est quand même technique, on est toujours pareil dans l'idée de c'est plus facile si tu as beaucoup récupéré en amont sinon tu dois passer plus de temps dans le montage, pour travailler… Ici on fait on s'est mis à l'ECPAD des obligations techniques et sur le terrain on a eu des grosses pressions, donc on a des logiciels peu convivial et on est dans des choses plus complexes. Il faut une certaine pratique. Quand tu fais de la caméra, tu n'a pas forcément le temps d'être tout le temps derrière ton ordinateur de montage. Ce n'est pas qu'on bâcle pour autant mais on est pas pour autant dans des actions aussi finies. Chaque personne, après, a son degré de connaissance. Il y en a c'est des graphistes, d'autres sont plus des monteurs, il y a des chefs d'équipe qui sont un peu réalisateurs, un peu graphistes. D'autres sont justes des chefs pour faire le lien avec la hiérarchie, et ce n'est pas toi qui t'en occupe.
177
As-tu l'exemple d'une scène intense, particulière, qui t'a marqué en Afghanistan ? Quand j'ai pris la suite de Janick, comme je t'ai dit il avait insisté lourdement pour essayer de se faire accepter lors d'opérations que menaient les OMLT et malheureusement pour lui ça n'a jamais pu se faire, il n'a jamais pu voilà. Il est rentré frustré de tout ça, il avait un peu les boules. Suite à ça, ce chef nous a convoqué toute l'équipe, et c'était une nana qui avait remplacé le chef d'équipe qui avait eu un incident. Elle ne pouvait pas partir en opération, c'était inconcevable pour eux, pas de fille, donc pas de chef d'équipe. Le caméraman n'a pas voulu parce qu’il ne se sentait pas de faire ces choses. Le colonel se faisait un plaisir de nous montrer des scènes d'accrochage pour nous montrer : "alors vous êtes prêts à vivre ça ?". Moi j'étais photographe et oui, ça me plaisait, pour essayer d'immortaliser, de figer des instants dont on parlait tout à l'heure. Montrer ce qui vivait ces gens sous le feu. On disait que ça allait de chauffer, on risquait de… La mission venait de se faire on allait faire du tout venant, le petit chien qui s'était cassé la patte, le maître chien s'en occupait il a passé le scanner le machin, il a suivi… Le chien revit bien, c'était des scènes supers mais il manquait quelque chose par rapport à ce que vivait l'Afghanistan, ce que vivaient ces gens. C'est important je pense que les gens le sentent aussi comme ça. On ne t’amène pas, c'est frustrant. Toi, tu as la chance de pouvoir être là, de pouvoir illustrer ce qu'ils vivent… Enfin illustrer, pouvoir montrer, témoigner de cette intensité, de ce que vivent ces gens. Donc il m'a amené, il m'a mis un baby sitter, c'est Shrek. C'était un grand légionnaire, barbu, il lui manquait des dents. Les consignes, il insiste sur la double dotation, il explique comment l'opération allait se mener et donc je ne devais pas quitter Shrek d'une semelle et il ferait toujours attention à moi. Quand on progressait dans le village, ces petits murets ça me faisait penser à Doom [un jeu vidéo]. Tu ne voyais rien, ça pouvait partir à gauche ou à droite. D'un coup on a vu des femmes et des enfants qui partaient. C'est la première fois que je vivais ce truc avec eux et les mecs qui étaient habitués à vivre là bas, et ils me disent : "ça va partir là, ça va chauffer". Quelque temps après, en effet, on s'est fait tirer dessus (dit ça en rigolant). Je dis ça en rigolant… (rit). C'est étonnant parce que le moment à la débandade, les Afghans qui se cachaient, qui couraient, nous aussi on se cachait mais les Afghans nous montraient où est-ce que c'était alors que normalement c'est eux qui étaient sensés aller au contact etc ! Toute la section avec qui on était on a couru, sous le feu. C'est là que tu vois le truc de rester groupé. Shrek je pensais qu'à lui, je restais à côté de lui, je suis resté à côté de Shrek et on s'est planqué. Ces Afghans nous faisaient signe en nous disant c'est par là c'est par là, et eux ils restaient en arrière. Moi je suivais Shrek qui avançait. Vite fait, tu te retrouves il n'y a plus grand monde avec toi. Tu es avec un mec, et puis voilà tu es deux, deux-trois. C'est assez hallucinant, des situations extraordinaires, assez particulières. Tu n'y penses pas, c'est après. Moi j'en rigole, je pense à la tête de ces Afghans, et en plus ils rigolaient ils étaient cachés et ils nous faisaient signe que c'était par là que ça se passait, dans un ensemble de maisons au loin. Il y a une demande d'appui qui est fait. La grosse section qui avait ses appuis qui étaient mis en haut de la colline qui commence à nous appuyer, à envoyer des mortiers et tout. Là, c'est les Afghans qui contrôlent la situation. C'est leur opération, ils en étaient les chefs. Et bien l'armée afghane décide : "on arrête, on s'en va". On était à 200m de la maison, les légionnaires, Shrek le premier, voulaient y aller (il rit). Le gros Shrek voulait le résultat, mais c'est normal, on va leur faire la peau quoi ! (il rigole toujours en repensant à ces moments). Et donc ba ok les Afghans on fait demi-tour. Je ne t'ai pas dit, avec nous les OMLT il y avait à Nijrab, à proximité de Tagab, il y avait une grosse opération qui était menée, Tagab venait de se créer. Il y avait des américains dans le groupe. L'Américain suit le retrait, on est sensés plier. On fait demi-tour. Les légionnaires frustrés, l'américain, un petit peu. L'Américain fait une demande d'appui. On a marché, marché, marché… Et là j'ai vu une bombe de 250 kg qui est venue
178
péter dans le village où il y avait la maison. Et là tu dis "wah" (fait mine un peu choqué). Là il y avait des gens qui disaient "belle journée", des propos bizarres c'était un peu décalé. J'ai trouvé ça étrange. Le lendemain des opérations d'aide à la population étaient menées juste à côté, où les gens étaient en train d'enterrer leurs morts. Etrange. Voilà. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. En même temps c'est comme ça. A qui la faute après ? Les Afghans ? Mais c'est leur pays, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident. Dans ces moments là tu avais ta caméra, ton appareil photo ? Non mon appareil photo. Les propos de l'Américain étaient pour moi décalés "on a passé une bonne journée", de voir la bombe péter quoi. "On allait pas les laisser partir comme ça". Peut être avait-il raison, mais je trouvais ça décalé, certes il y a des gens qui nous tiraient dessus mais j'ai trouvé ça disproportionné. Avec l'appareil photo j'ai des trucs, tu peux les retrouver. Avec Shrek qui regarde l'explosion au loin… Ce n'est pas aussi intense que ce que j'aurai pu avoir je pense avec une caméra parce que maintenant j'ai vu que je pouvais faire parler les gens… Est-ce que tu as vu de ta part ou d'autres opérateurs des films forts, intenses ? Oui, forts, intenses, qui décrivent des hommes sous le feu oui. Un photographe, depuis peu les appareils photos peuvent faire la vidéo, Sébastien Dupont, qui est maintenant au labo, a vécu des choses intenses et il les a filmé. Il a eu les félicitations Reuters pour ça, pour ces images. C'est extraordinaire, ça retranscrit bien l'intensité d'un combat. Ce ne sont pas des choses comme ça que j'ai vécu. Moi, c'était un peu la débandade. Là, tu sais une violence, une intensité. Mais quand tu es dans ce dédale de baraquements, de murets, tu peux te dire que ça peut arriver à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Ce sont des choses que tu ressens dans ces images vidéos. Il est passé en mode vidéo et il suit un groupe qui s'est fait prendre sous le feu. Il progresse en dessous, et il y a tout le monde qui est en train de tirer, il va près de quelqu'un qui est en train de recharger pour continuer son tir. C'est vraiment fort. Ces images ont servi au film qu'a fait le commandant, qui a voulu montrer, faire un témoignage d'une opération. A mon avis, c'est UNE opération, de là pour illustrer je te dis l'intensité des opérations il s'est servi de ces images, de ces opérations. Il a eu les félicitations Reuters de par l'intensité qui s'en dégage. Est-ce que tu a vu le film qui a été montré sur France 2, "C'est pas le pied la guerre" ? Qu'en a tu pensé ? Je n'ai pas tout vu. C'est compliqué. On ne peut pas tout généraliser, enfin chaque personne a son ressenti. On peut décrire ça de milliards de façon. Ce sont des expériences qui, oui, … Je ne veux pas dénigrer. Alors que ce que j'ai vu c'est un peu dénigrer… Moi ce que je retiens ce n'est pas de faire de la propagande, un truc trop élogieux, ce que je retiens c'est l'intensité, presque cette beauté qui s'en dégage. L'intensité dans la relation avec les autres. Cette volonté de s'entraider, de vouloir sauver des vies au dépens de la tienne. Ce côté frères d'armes, ces gens qui vivent des situations intenses quelque part ça ressert des liens. C'est là que tu voies vraiment les gens comment ils sont là. Là c'est bien. Ce ne sont pas des choses que j'ai pu ressentir dans le reportage. Moi c'est ça qui est le plus intense. Ce que j'en ai pensé alors, c'est un peu facile et tu pourras en trouver plein. Au vu de ma mission en interne, c'est bien de faire un film d'une équipe qui rentre, mais l'équipe qui rentre maintenant elle n'a pas vécu ce que l'équipe d'avant a vécu et ce sont deux ressentis différents. C'est plus intéressant de faire quelque chose sur l'ensemble des
179
opérations, ici en tout cas parce qu'on a la chance d'avoir vécu tous des moments différents donc c'est intéressant de faire un film comme une rétrospective. Ce serait bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça qui fait la richesse de notre travail. Cette diversité de mission. Côtoyer cette force qui se dégage dans certains personnages; Il y a des personnages, qui s'en dégagent, de ces moments intenses. Ce n’est pas forcément les plus forts physiquement. C'est là que tu vois les vraies valeurs des gens. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est beau. Je suis conscient d'avoir la chance de faire un boulot qui permet de témoigner.
180
8. Entretien avec le capitaine Daney, officier image, janvier 2012
Est-ce que vous pouvez présenter ? Votre parcours, grade, âge, missions en Afghanistan ? Je suis le capitaine Daney, cela fait cinq ans que je suis à l'ECPAD. Je suis dans ma sixième année, j'ai fait cinq ans d'officier image 2006-2011. J'ai fait quatre fois l'Afghanistan durant ces cinq années. Je suis marié, j'ai quarante-sept ans, j'ai deux enfants et j'habite à Angers. En Afghanistan j'y suis allé quatre fois pour des durées de trois mois. J'ai fait en 2007 la même mission que Marcès, lui il est rentré entre Noël et premier de l'an 2007. Moi j'ai poursuivi jusqu'au 21 janvier. J'ai fait un mois de plus parce qu'il y a eu un problème de relève. Ensuite, j'y suis retourné en 2009, j'ai fait avril-juillet et septembre-décembre. Et en 2010 j'ai également fait septembre-décembre. Est-ce que ces périodes particulières ont une incidence ? Non. Mais l'ECPAD a une équipe depuis le début en Afghanistan, depuis 2001. De 2001 à 2005 on n’y était pas de manière permanente. En revanche, de 2006 jusqu'à aujourd'hui il ne s'est pas passé un jour sans qu'il y ait une équipe en Afghanistan. On a toujours une équipe là-bas en permanence de trois personnes depuis 2006. Et autrement, par intermittence, entre 2001 et 2006. Est-ce que vous pouvez nous préciser le rôle précis de l'officier image ? Il est divers et varié. On a déjà un rôle de management. Ca, c'est évident. On est peut être pas nombreux, on est peut être que deux à manager, plus trois avec l'officier image, on a un vrai rôle de manager. Ce sont des missions qui sont longues, il peut y avoir des baisses de moral dans l'équipe, des petits soucis, donc on a ce rôle de surveillance du moral, de la santé, si tout va bien, les contacts réguliers avec la famille… Il faut s'assurer de tout ça quoi. Tout ça qui participe au bon moral. On a la partie écriture des sujets. On propose l'écriture des sujets, on est corrigé par le conseiller en communication. On a également la sécurité, quand on est dans une situation compliquée, il faut qu'on s'assure que les deux personnels qu'on a charge sont soit bien intégrés dans une force, une section, un groupe ou une compagnie et ils sont vraiment en sécurité, ou si on est avec eux, on peut être amenés à assurer la sécurité pendant la prise de vue. J'ai le fusil dans les mains, je suis des yeux le caméraman qui lui a les yeux dans le viseur. Donc cette mission sécurité elle est importante. Ensuite, dans la partie montage, ils nous proposent des montages. Là on est là aussi comme réalisateur du sujet. On a une partie technique, côté management, côté sécurité. On a trois volets, ça peut se résumer ainsi. Vous avez, en proposant des sujets, le rôle de valoriser des sujets ? Oui. Ca se passe de plusieurs manières. Soit le commandement a une idée précise de communication, donc, ça s'est Paris. Paris le dit au théâtre, sur le théâtre c'est le conseiller en communication. Il a dans sa main plusieurs personnes pour porter la communication du théâtre. Dans ses équipes, il y a une équipe image, nous, des officiers de communication, et un chef du centre presse. Dans ces cas là, ils nous donnent l'ordre, le chef il souhaiterait qu'on fasse sur telle opération, un reportage mettant en avant les Afghans. Nous on part avec cette idée, et avec la mission, on essaie de tourner nos images en fonction du sujet que l'on va réaliser. Là, on est vraiment la boîte à outil, le bras armé audiovisuel pour faire le boulot.
181
On a une force de proposition après. On voit des choses que Paris ne voit pas. Il y a des choses qui sont porteuses pour la posture de la France, des soldats, mettre en avant le travail qui est réalisé au quotidien par nos soldats. On a la main sur une proposition de sujet, on explique ça à notre chef, du théâtre et lui soit de son niveau nous dit "en avant", on fait la mission parce que c'est intéressant et on va proposer ce sujet monté, fini ou quand il est pas sûr il redemande à Paris pour être sûr que ce soit porteur. Parce que en communication, il y a des périodes dans lesquelles on va être amenés à ne pas parler de certaines choses. Nous on est pas dans l'information, on est dans la communication. Prenons le cas. On veut faire un sujet sur les ravitailleurs en vol des avions de l'OTAN. Huit jours avant, vous avez le Rafale qui tombe dans l'eau alors qu'il est pas dans la mission, suite à un ravitaillement. Alors, vous n'allez pas parler des ravitailleurs. Ce n'est pas la bonne période. Vous en parlerez dans six mois. Donc le sujet tombe à l'eau. Il peut y avoir des périodes où on ne va pas communiquer sur telle ou telle chose. Mais plutôt sur telle ou telle autre, parce que la conjoncture est favorable. Ca, ce n'est pas nous qui décidons, c'est le conseiller en communication du ministère, dans la partie opération donc le colonel Bourqa (vérifier). Si le sujet qu'on propose est validé là haut, allez c'est parti, on prend les affaires et on y va. C'est des sujets complets, fermés, clefs en main. On a aussi un rôle de montrer, d'être présent à des endroits où il se passe des choses simplement pour témoigner de la bonne posture de la France. On peut nous demander de partir pour une mission sans avoir une idée de reportage derrière. Simplement, d'être présent, de filmer ce qui va se passer. C'est la caméra qui observe. En fonction de là où on va la poser, on verra telle ou telle chose. C'est pour ça que l'équipe image, il faut qu'elle soit cohérente aussi bien en nombre qu'en capacité. Sa capacité, c'est que le photographe il sache aussi faire des images animées, que le caméraman il soit capable de prendre un boîtier, et que le chef équipe image il soit là si il y a besoin d'avoir une capacité de captation. On doit être capable de ne pas revenir secs. Parfois, on a pas la possibilité de monter tous les trois dans le même véhicule, ou tous les trois dans la même mission. Quand un effectif d'une mission est complet, les véhicules sont pleins. C'est un schéma hein. Donc il faut faire de la place. C'est assez rare que l'on fasse débarquer quelqu'un de l'infanterie pour pouvoir embarquer, mais c'est déjà arrivé. C'est arrivé qu'on dise, on prend le caméraman, mais on est obligé de laisser un pacs (?) derrière. On aime pas ça, nous, parce que la mission c'est quand même pas une mission audiovisuelle, c'est une mission opérationnelle. Mais nous, on est là aussi pour porter cette opération. Sans nous, personne ne verra ce qu'ils ont fait. Parfois, quand il faut débarquer, ils le font. Pareil pour un hélice. Quand on met des gens sur des points hauts, la capacité de l'hélico c'est tant. Le groupe de combat c'est tant, normalement il y a un groupe de combat en haut. Quand on est bien rentrés dans le groupe, on peut être amené à avoir une place en haut avec les gens. On a la mission, la bonne. Il faut avoir cette capacité, d'interchangeabilité, dans l'équipe. C'est ça qui donne de la force à l'équipe. Cela permet d'avoir au même moment ce qui se passe dans l'équipe, et ce qui se passe ailleurs, toujours du même côté. Notre vocation, ce n'est pas de voir les insurgés nous tirer dessus. Notre vocation c'est de montrer la bonne attitude, les faits, ce qui se passe vraiment. Quoiqu'il en soit, les sujets peuvent être très variés ? Très variés. On peut par exemple montrer qu'un nouveau véhicule va arriver sur le terrain et il va avoir telle fonction, et c'est telle personne qui va s'en occuper pour le mettre en œuvre. C'est de l'information, de la communication. On met des sous, mais voilà comment ils sont utilisés. Cela va être montrer le ravitaillement, ça fait partie de la stratégie globale. On ne peut pas laisser des gens sur le terrain, pour nous le terrain c'est l'Afghanistan, aussi loin de la France, sans avoir une liaison de courrier, une liaison de pièces détachées, une liaison de
182
munitions… Tout ce cordon logistique il faut qu'on le montre aux Français. Voilà, les sous, ça coûte cher, mais voilà ce qu'on en fait. C'est, sur l'opération, quand ça cartonne, quand la communication dit ce sont des combats violents, que l'on puisse voir que ce sont des combats violents. Pour faire des combats violents, il faut y être. Il ne faut pas mettre des robots, il faut y être. Ce sont toutes ces attitudes là. On a aussi une mission de formation de l'armée afghane, et régulièrement on fait des missions où on voit des Français qui font de la formation avec l'armée afghane, qui leur montre leur expertise, que ce soit en combat, en maniement d'armes, en règlement… Tout ça c'est la mission. Egalement, c'est ne pas oublier personne. Il y a une composante air à Kandahar il faut qu'on la montre régulièrement. On va à Kandahar régulièrement pour faire des sujets sur les 2000, sur même le Rafale, parce qu'il a déjà servi là bas, sur comment ça fonctionne, on va au devant, on montre les pilotes, on fait un peu de maintenance, un peu de logistique, un peu la base arrière. On essaie d'être exhaustif. On ne l'est jamais. Entre les besoins de communication, les propositions qu'on peut faire et toutes les composantes sur le terrain, notre travail est sans arrêt et sur tous les sujets, toutes les composantes. C'est ce qui fait la richesse des sujets. Côtoyer un aérien, et le lendemain être avec l'infanterie, un artilleur, et se battre à côté d'eux. Vous parliez des difficultés qui peuvent être liées de monter dans une véhicule, un hélicoptère. Comment une équipe image se fait accepter ? Quel est votre rôle ? On a un rôle primordial. Le chef d'équipe dans l'approche qu'il a. Il faut être modeste. Et humble. Pour se faire accepter, ce sont les premières qualités je pense qu'il faut avoir. Il faut chaque fois, moi j'y suis allé quatre fois, à chaque fois que j'ai du aller à prendre contact avec les unités, pour pouvoir m'insérer avec mon équipe, la personne qui est en face de vous vous prend dans les premières fois comme un élément étranger d'abord à son unité. Nous prend en disant bon, vous avez pas l'expérience du combat, pas l'expérience de ça, donc on est obligés de dire "oui, on a pas…". Ce n'est pas tout à fait ça. On a un gros travail d'explication de notre métier, un gros travail pédagogique à faire avec les chefs qui commandent les unités. Bien souvent ils ont tellement la tête dans la formation, dans leur préparation de mission, qu'un élément supplémentaire, ça leur fait se poser des questions - il nous connaît pas bien au départ - de quoi ils sont capables ? comment ils vont se comporter ? Est-ce qu'ils ont bien les réflexes d'un combattant ? Eux raisonnent combat. On avance toujours un peu sur la pointe des pieds pour se faire accepter parce que la confiance ça s'acquiert, ça ne se donne pas forcément tout de suite comme ça. Il faut bien mener ses premiers rendez-vous, ses premières discussions, de manière à crédibiliser. Toujours faire une petite mission au départ. On ne va jamais dans une mission complexe dès le départ. Il faut avoir une bonne attitude sur une petite mission, et en général, ils repèrent très vite. Ca se voit. C'est des codes. Ils repèrent très vite que vous n'êtes pas né de la dernière pluie. A ce moment là, ils vous donnent un peu plus. Il faut savoir que celui qui est filmé il vous donne. Soit il vous donne beaucoup, soit il donne peu. Il peut être sous la contrainte pour vous emmener. Le chef a dit "vous l'emmenez", pas de problème vous montez. Mais une fois arrivé sur le terrain, il dit "tu restes dans le VAB ou à proximité du VAB". Les mecs font leur mission. Toi, tu vois rien. Quand tu rentres, tu rentres. Toi, tu as vu le VAB, les mecs autour. Une petite interview de rien. Tu n'as rien. Et bien il faut acquérir cette confiance. Ce n'est jamais plié d'avance. Il faut y aller tranquille. C'est dans le temps que ça se fait. Nous on a cette chance, qu'ils n'ont pas forcément les journalistes civils, on a la chance d'avoir le temps, même si des fois on ne l'a pas trop, de s'insérer dans les unités, et essayer d'aller de plus en plus ion avec les unités, pour aller jusqu'au bout ensuite et être ensuite au milieu du combat. Nous on a fait des missions qui sont arrivés plutôt bien en temps, après qu'on soit arrivés, donc après un mois de présence. Là, c'est bien, on a bien
183
discuter, bien parler, on a fait plein de petites missions avec eux. Ils ont vu notre aptitude à se défendre, notre aptitude à bien comprendre la manœuvre. L'opération, c'est une manœuvre réelle et donc des fois il faut comprendre la manœuvre complète. Il y a des troupes qui se déplacent là bas donc il y a des troupes qui vont se déplacer là, il y a un groupe de combat qui est ici. Avoir une culture militaire nous sert pour bien comprendre la manœuvre et pouvoir positionner nos gens et après pour relater, capter ce qu'on a à capter. Une des qualités c'est une bonne connaissance de l'armée. C'est bien, que celui avec qui vous parlez, que ce soit un artilleur, un gars de l'infanterie, un aérien, quand ils vous parlent de son avion, de son canon, de son char, de sa mission d'infanterie, c'est bien quand en face il a quelqu'un qui connaît, qui sait de quoi il parle. Quand il parle d'avion, il faut que vous sachiez de quoi il parle pour pouvoir poser des questions un peu plus pointu. Et là, il vous donne. Plus vous en apportez, plus il vous en donne. Une bonne culture militaire vous amène à des discussions derrière plus poussées et quand on a la confiance après on obtient tout ce qu'on veut obtenir. Est-ce que ça peut aller à des choses positives, ils vous appellent pour aller en mission, ou dans l'autre sens "vous êtes en train de filmer, tu coupes" ? Tout à fait, la confiance est là. Nous, on a la capacité de ne pas faire sortir les images. Ils le savent. On est dans une chaîne de commandement, dans la chaîne de communication opérationnelle, nos images peuvent être vues n'importe quand par n'importe qui, de la chaîne hiérarchique. On peut les bloquer. Elles ne sortent pas. C'est un confort, pour le commandement, de ne pas avoir à se dire, "si je dis ça maintenant…" Ca m'est arrivé de m'entendre dire "tu filmais ?" "oui" "ça, tu le mets pas". D'accord, fini. On ne le mettra pas. Soit le propos est un peu décalé. Soit il a fait une blague qui pourrait hors du contexte être mal placée. Si on entend tout, c'est une blague rigolote. Sorti du contexte, comme souvent les journalistes le font, ça devient du buzz. C'est du n'importe quoi. Et ça dessert la force. Quand ils font des signes des trucs comme ça, on sait, il n'y a pas de soucis. On peut même filmer des choses qui n'étaient pas filmables. Prenons le cas, ce n'était pas l'Afghanistan, j'ai fait Harmattan en Libye, avec un photographe et un caméraman. Il y avait une salle objectif, où il y avait les objectifs dedans. Ca, c'est interdit de rentrer. Pourtant, on a tous une habilitation secret défense. A la fin du mandat, on rentrait dedans comme si c'était chez nous. Tous les obs rentraient dedans, et nous, avec la caméra. On a falsifié, et puis voilà. La confiance est arrivée. On est rentrés. Même des interviews à l'intérieur à chaud, des gens qui rentraient d'avoir frapper sur la Libye. La confiance c'est qu'à un moment donné, notre récompense c'est ça : quand le chef raisonne avec nous dans son raisonnement, c'est que on a gagné la confiance. Quel est le public de ces images ? On fait beaucoup plus d'images que d'images qui sont vus. Beaucoup d'images qui ne vont pas servir, mais qui ne vont pas servir tout de suite. C'est ce que j'ai écrit dans un mémoire il n'y a pas très longtemps, l'équipe image a une mission qui est donnée par le commandement donc dans la chaîne communication. Si on écoute que le commandement, on fera toujours le même type d'images. C'est grâce à ce que nous, on élargit, quand on est sur place, les officiers images, nous qui élargissons toute cette captation. Les images deviennent plus riches. Ce sont nous qui demandons à filmer le soir au coin du feu les gars qui chantent. D'aller voir le mécano dans la merde qui est en train de réparer le camion ou la roue. C'est nous qui faisons l'effort. Parce que le commandement ne nous demande pas d'aller filmer le
184
changement d'une roue en opération. Seulement, la vraie vie, ce n'est pas que l'opération, l'avion qui se pose, le VAB qui se déplace. La vraie c'est tout, moi j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, si on était pas vigilants, on pourrait avoir des manques dans notre banque d'images pourtant très importante, dans certains secteurs. Eh oui. Là, on a un vrai rôle, qui nous dépasse un peu. Je suis là, à tel endroit, pour faire telle mission, mais j'en profite pour élargir, pour faire plus d'images dans des secteurs qu'on a pas demandé pour alimenter la banque d'images ici à l'ECPA. Il y a une vraie prise d'initiatives ? Oui dans le domaine. Qui se fait en direction des archives et de l'histoire. Essentiellement dans le témoignage. Les conditions de vie. Aujourd'hui, je prends une photo de 14-18, où le photographe a décidé de photographier ce jour là la cantine. En 1915, je ne suis pas sûr que cette photo ait beaucoup de sens, peut être regardez les soldats mangent au front. Après on passe à autre chose. Aujourd'hui on a fait le tour des missions de guerre, ça a été repris, on a presque un siècle de recul. Aujourd'hui, ce qui nous interpelle davantage, ce sont les conditions de vie naturelle du combattant de 14-18. La cuisine, comment s'était foutu. Les locaux. Leur armement. Des choses, des fois c'est couillon. On se dit, ah comment ils étaient à l'époque. Les combats on les a vu. Les trois quart du temps c'était des reconstitutions en plus. On remonte l'affaire. Nous aujourd'hui, quand on a conscience de ça, moi je vais à la cantine et je filme la cantine. Les gens nous disent parfois "rien à foutre de faire la cantine". Non non, nous on fait la cantine, on va pas expliquer on va pas perdre notre temps. Dans cinquante ans, si on arrive à trouver des supports pérennes, celui qui s'intéressera à trouver comment on mangeait, et ce qu'on mangeait, les logements, la festivité du soir, les petites choses simples de la vie, les jeux de carte… Mais on a pas tout. C'est pour ça, je disais tout le temps, il faut avoir une haute idée du reportage, en général. Ces images vont directement nourrir les documentaristes qui feront des produits dans quinze, vingt ou quarante ans. Il faut qu'on puisse leur proposer tout ce qu'on peut proposer. Des cartes. Ah ! Confidentiel ! Ouais, bouges pas je te fais la photo, je te fais l'image, et je n'y touche plus et je la mets aux archives. Dans vingt ans, quand ils se demanderont "qu'est-ce qu'ils avaient comme carte ?" ou s'ils veulent reconstituer ce qui s'est passé en Uzbeen, peut être entre tous les éléments qu'ils auront plus les images qu'on aura, il finira par raconter vraiment ce qui s'est passé réellement. Même si ce ne sont pas les images, qui se sont passées le même jour, quand on a pas la matière, ce jour là il n'y avait pas de reporter, il aurait pu y en avoir. Pour une raison ou une autre, on aurait pu être dans cette mission, on aurait eu les vraies images, probablement un mort ou deux. On essaie de penser tout le temps, on ne reste pas strictement dans la communication pure et dure du moment, on essaie de prendre un peu de hauteur. Ca m'est arrivé, même à Harmattan, de reposer des questions un peu plus, avec une vision plus lointaine. On en a absolument pas besoin aujourd'hui. Mais un jour peut être quelqu'un en aura besoin. Un chef de la base. Le chef de corps, "mon colonel vous avez déjà fait cette mission là, quel est votre sentiment aujourd'hui ? Et demain qu'est ce que ça va être ? On s'en servira pas mon colonel, c'est pour savoir un petit peu ce que vous pensez aujourd'hui". Peut être qu'un jour quelqu'un aura besoin du sentiment du chef. Tel date tel jour il disait ça. Il avait vu là, c'était juste. C'est le documentariste qui dira, c'est pas nous. Ca fait partie de la dimension de l'équipe. Une fois que l'équipe est avec des soldats qui sont accrochés, comment est-ce qu'on filme ça ? Quels sont les choix qui sont faits ? Est-ce qu'on va porter la caméra ou le fusil d'abord ? Si jamais des images qui sont faites, quel va être leur public ? Est-ce que c'est intéressant ?
185
Je vais vous répondre sur des questions que, évidemment, on s'est posé. C'est pour ça, ce qui change c'est de l'avoir vécu. Celui qui ne l'a pas vécu il pourra toujours se poser la question, mais il n'apportera pas forcément une réponse. A partir du moment où on l'a vécu, évidemment on s'était posé des questions avant, et après on a des certitudes. Des certitudes d'avoir des bonnes réponses ou d'avoir été complètement à côté de la plaque. Pour moi, il n'y a aucune image qui mérite qu'on y laisse la vie. C'est déjà un postulat. Je ne veux pas, je me l'applique et je l'applique à mes équipiers, je ne veux pas que des gens prennent des risques inconsidérés pour essayer d'aller chercher une image. Ca ne vaut pas le coup, à mon avis. C'est le premier postulat. Les risques, il faut qu'on en prenne, il faut qu'ils soient mesurés, il faut les calculer le plus possible. Si ces risques nous dépassent, si on doit se transformer en combattant et de laisser des images de côté, et bien on se transforme en combattant parce qu'il en va de la vie des gens avec lesquels on est. Alors après, les situations sont diverses. Soit il y a des déplacements, soit il y a des positions fixes. Quand on est sur une hauteur… On est plutôt bien en haut, on est mieux qu'en bas. Là, a priori, on peut continuer à filmer, on est tranquilles. Mais en même temps on n’a pas de déplacement. Ce qui est dangereux dans un combat, c'est tout ce qui est déplacement. Evidemment, vous êtes cachés et vous allez devoir vous déplacer et donc prendre un risque pour pouvoir soit tirer soit filmer. Le risque est le même. Tout ce qui est déplacement et mouvement va devenir compliqué ou dangereux. C'est là qu'il faut évoluer. Chacun, en son âme et conscience, quand on est sur le terrain, quand on voit un groupe qui manœuvre, si vous n'êtes pas dans le bon groupe, et que vous êtes pris à parti, il va falloir se défendre, ou faire les images, ou les deux. Voilà. On ne choisit pas l'instant auquel on doit s'arrêter de filmer, parce que ça s'impose. Il ne faut pas oublier qu'on est d'abord des militaires, ensuite on décline quatre cent métiers. On a un point commun, c'est d'être militaire. Le fait d'être militaire, c'est qu'on a déjà un tas de chose, on a une arme, on sait tirer, on sait se déplacer, on sait se couvrir, on a tout le code militaire. A partir de là, on peut être mécano. On peut être fantassin. On peut être artilleur. On peut être caméraman, on peut être reporter. Cette base là, c'est la base solide. Après le public, c'est le monde civil. C'est le monde militaire mais c'est le monde civil. Quand on a des images fortes on peut peut-être intéresser du monde. Aujourd'hui, il faut toujours du sensationnel. Nous on est pas dans cette logique. On est dans une logique de communication, et le fait de pas être dans une logique d'information c'est complètement différent. On peut se permettre de dire quand ça chauffe trop, on prend le flingue et on continue, on a suffisamment de matière pour illustrer les combats violents. Le reporter civil il est pas armé. Nous on a choisi le camp, on est armés. On a la caméra mais le flingue. A un moment donné, quand ça s'impose, on met la caméra de côté, les mécanos ils mettent la clef de côté et ils prennent le flingue. Nous on choisit, c'est le flingue et on s'arrête. Le public, on sait même pas à qui on s'adresse quand ça cartonne. Ca va dépendre du contexte. Le chef peut dire, ces images là, on ne pas s'en servir. Et le lendemain, si, finalement, on va s'en servir. Il est arrivé telle chose, il faut qu'on fasse voir qu'on s'est défendu, ou qu'on s'est bien déplacé, ou qu'on était dans les bonnes tenues. La communication est un appui de la mission de la force. C'est l'appui communication. Aujourd'hui, il n'y a pas de communication sans image. Donc on est au milieu de tout ça. Comment on filme ça ? Quand il y a un combat, comment on va filmer, qu'est-ce qu'on va chercher en priorité, dans un aspect communicationnel ? Il faut résonner tout le temps dans la panoplie du reportage. Si on rentre dans le détail, il nous fait des gros plans, des plans larges. Quand c'est très chaud, il faut laisser tourner. Je fais une séquence qui bouge, qui va partout parce que on est à la fois…on ne regarde pas ce
186
qu'on fait. On déclenche parce qu'il se passe beaucoup de trucs. Tellement qu'il va falloir se planquer, qu'il va falloir se déplacer. Donc je laisse tourner. Dès que ça s'arrête, hop, on fait un plan. On a une continuité sonore. On a le blocage, pour donner un peu d'air. Sinon c'est pas regardante si on laisse quinze minutes en courant partout. Il faut qu'on ait le réflexe tout le temps… La continuité sonore bon il faut clairement dissocier l'image et le son. Le son, quand on en a dix minutes, on peut mettre du son sur d'autres images et faire croire que… Nous on fait pas. Mais, on a la matière. Le son. L'image, il se passe quoi ? Il se passe un truc là bas, je tourne. Je fais des gros plans. A l'expérience, on sait qu'il faut des gros plans pour montrer certaines peurs, l'engagement, il faut des visages. On filme des humains avant de filmer des machines, qui soient des chars ou des avions. Ce sont les gens qui sont importants, on est près d'eux. Donc ils tirent. Ca peut être le doigt qui tire. Ca peut être le plan du visage qui vise. Si on a le temps de penser à tout ça. Mais l'aboutissement c'est d'avoir suffisamment d'expérience pour se dire quand je vais faire des images, je dois penser aux règles de l'audiovisuel. C'est peut être un beau discours. Pas forcément les règles, mais je pense à faire des plans, sinon ça devient n'importe quoi. Donc je fais des plans, donc je bloque. Je fais des petits mouvements. C'est pour ça que je parle de règles, parce que ce sont des règles audiovisuelles qu'on doit s'appliquer même en situation de crise. La première fois que ça arrive, normalement, on rate tout. Presque tout. C'est après tout, qu'on se dit, j'aurais pu faire ci, si j'avais su. La deuxième fois, vous êtes un peu meilleur. Puis, au bout de quelques fois, vous avez des images qui ressemblent vraiment à quelque chose, qui peuvent raconter quelque chose. Comme moi j'écrit et que je filme, j'essaie un maximum de le faire. Le cadreur lui qui a une grosse culture image, il est déjà dans cette sensibilité là. Il sait qu'il va devoir alterner les plans, les mouvements, les distances, un coup le tir… Mais il faut savoir le but aussi des fois, donc il faut savoir où il a tiré. Donc on va essayer de filmer en gros plans, donc on va prendre des risques. Enfin des risques, pas pour ma vie, mais des risques, le canon est là, ça fait deux fois qu'il tire dans le mur là bas, je fous ma caméra et puis je déclenche. Pendant ce temps, ça tire de partout. Je me dis, je vais avoir un plan avec un gros obus qui va tomber. Manque de peau il a changé de direction il tape plus loin. Pareil pour l'avion. On entend show force à la radio. Show force ça veut dire c'est l'avion qui va passer à très grande vitesse et qui va passer très ras pour faire peur à tout le monde. C'est l'idée, de se dire oh putin. Tu sais d'où il arrive, t'essaies de cadrer, et les 3/4 du temps ton plan est pas bon. Si tu dézoome, t'as une petite mouche qui passe dans l'écran, si tu es trop serré, il va tellement vite qu'il sort de l'écran en deux secondes. Ton plan est mort. Il y a un juste milieu. Il repasse pas tous les matins… Je pense que les gens qui vont en Afghanistan, les équipes en général, ont un niveau suffisamment élevé d'expérience pour pouvoir instinctivement appliquer toutes les règles de l'audiovisuel, alterner les plans, alterner les séquences, les choses… Parce qu'ils sont aguerris à ça, tranquille en temps de paix, qu'ils ont suffisamment d'expérience, qu'ils peuvent passer quelque chose de plus compliqué parce que c'est plus par le réflexe. C'est ça qui va faire un peu la différence, c'est le bon réflexe. Des opérations se terminent parfois par des moments un peu chauds, entrer dans une maison où il y a des personnalités, des arrestations, est-ce que ça se filme ? L'ennemi, on le filme ? Rarement. Il n'y a pas d'interdiction à le filmer si on le voit. Si on le voit, c'est bien. On ne le voit presque jamais. Les coups arrivent bien de quelque part. Eux n'ont pas de gilet, de casque. Ils ont leur arme. Ils ont une mobilité dix fois plus grande que la nôtre. Du coup, ça complique. C'est des méthodes guérilla contre une armée. Ils sont très furtifs. Que ce soit avec nos moyens, ils arrivent à les identifier. On a des moyens de surveillance, les caméras techniques et tout ça.
187
Mais à l'œil nu, quand le coup part, ça vient d'où ? C'est difficile. Mais ça arrive. Le travail qui a été réalisé aboutit à des arrestations. Là c'est filmé, il n'y a pas de limites. Quels sont les rapports entre les équipes de l'ECPAD et les reporters civils ? Quel va être le rapport entre vous et les médias ? C'est le point commun. Eux viennent chercher des images, et nous on en a. Les nôtres n'ont pas un intérêt immédiat. Ils pensent qu'ils vont aller faire les images. Et puis quand ils viennent des reportages, ils sont venus avec un axe, une idée. Parfois ils arrivent à faire l'ensemble de leurs travaux, et tant mieux. Comme ça ils peuvent monter l'ensemble de leurs sujets et porter les sujets devant le public. Parfois il leur en manque un peu. "Ah bah tiens j'aurai bien aimé avoir telle situation et je l'ai pas". A ce moment les images, on peut éventuellement proposer les nôtres pour qu'ils prennent quelques plans, trois quatre plans ça suffit… Elles sont validées au niveau du théâtre par le chef, l'autorisation nous est donnée et à ce moment là on leur donne. Mais ce n'est pas… Ils le font volontiers pour certains, d'autres se l'interdisent. Il y en a qui veulent pas, ils veulent que ce soit fait que par eux au nom de la déontologie du journalisme. Tout ça n'a pas beaucoup de sens des fois mais je leur laisse. Moi j'ai entretenu de très bonnes relations avec toutes les équipes qu'on a pu rencontrer, France Télévisions, les grandes radios, les grands journaux… Vraiment on a pas de problèmes. On a déjà donner des images à l'AFP. Ce jour là, le photographe était à Dash, leur journaliste ailleurs. On avait des choses à donner. On les fait valider et on les donne. Parce que c'est de l'information. Quand c'est de l'information, elles sont gratuites les images, donc on les donne au titre de l'information. L'information est un droit, en France. On a l'image, ils en ont besoin pour de l'information, on fait valider, si c'est bon on la donne, ils ne nous doivent rien. On est plutôt parce que là on est dans le concret. C'est ça qui est cherché comme image, on lui donne. On est dans la com' même si lui il va traiter ça comme une info. On est là aussi pour les aider. Si ils ont un problème technique on peut les aider, moi je ne vais pas… Ils font leur métier, nous on fait le nôtre mais on est pas des ennemis. On est des amis, il n'y a pas de problèmes. Après les rapports bien sûr, on s'entend mieux avec Paul et Jacques, ça dépend comment il nous prend. Parfois il nous prend de haut. Si il a pas besoin de nous, on se met en retrait. Si ils sont plus abordables on discute avec eux. On leur donne un coup de main à ce moment là. C'est des échanges professionnels. Ce sont des images. Le public ? Le public, au départ, c'est un peu une frustration. Les opérateurs vous l'ont peut être déjà dit. On sait qu'on a des images qui pourraient faire mieux parfois. Encore une fois on est inscrit dans le temps. Quand il y a des magazines comme M6, tourné en Afghanistan, ils financent leur affaire, ils ont un temps, ils ont demandé l'autorisation à Paris pour y aller, ils font leur mission pendant dix ou quinze jours. Ensuite, ils rentrent. Pendant cette période, il faut qu'ils engrangent ce qu'ils ont besoin pour faire leur film. Nous on est là bas tout le temps. Quand nous on y est plus, il y a nos collègues. Donc on a une richesse importante. Mais comme il n'y a pas de commanditaire au départ, et qu'on y va que pour la com', notre mission est d'abord de réussir notre mission de com'. Et ensuite, toutes ces images qu'on fait en plus, parce qu'on a besoin pour les archives de varier, de diversifier, et bien on a pas un écho immédiat. Les images sont plutôt peu vues. C'est un peu notre frustration parfois, mais quand on remet dans leur contexte, c'est obligé que ce soit comme ça. Mais c'est le système qui est comme ça. Il faudrait qu'on ait des commandes de documentaire en même temps que de la documentation. Si on avait les deux, est-ce qu'on aurait le temps de faire les deux ? Moi je réponds plutôt que non. Parce que si on veut faire du documentaire, il faudrait mieux
188
envoyer un caméraman seul avec une liste, avec un schéma, et qu'il aille faire ses images, avec le temps, trois semaines, un mois deux mois… Et quand il a fini et qu'il a ses images, il rentre. Et là on pourrait couvrir toutes les panoplies qui sortent. J'ai proposé moi, qu'on puisse envoyer des gens séparés des opérations. Que le gars, quand il part là bas, il va pas en opération. Il fait que de la base arrière, ou que des images que la com n'a pas le temps de faire. On essaie d'en faire un maximum, mais on est pas complet. Mais c'est un coût, il faut envoyer quelqu'un en mission. On limite. Les films qui peuvent être faits sont faits a posteriori ? Par exemple ce film sur les OMLT ? C'est une initiative personnelle. En se disant, je sais que j'ai la matière, donc je le fais. En même temps, il y avait une demande en face, il n'y avait pas de finance. "Moi j'ai découvert tout ça pendant que j'étais en le faisant, c'est con de pas faire un film, puisque vous avez la matière, et qu'on ne le dise pas aux autres" (à propos des OMLT). Du coup, on s'est autosaisi du film. On l'a fait valider par les acteurs, le commandement et ceux qui ont bien voulu qu'on les accompagne. Comment ça se passe pour tourner des images avec les Afghans ? Comment on procède ? On essaie de s'appliquer à peu près la même règle qu'avec les soldats français. Il faut d'abord convaincre le chef qu'on va leur apporter quelque chose. En face c'est pareil. Quand le chef français nous accepte dans son équipe, il a forcément des homologues afghans. Il n'y a plus qu'à lui dire, je viens avec une équipe. Et on s'approche des gens et on les filme. On leur pose même des questions, on a toujours un traducteur, un interprète, avec nous. il pose des questions. On comprend rien, il nous traduit, et voilà on a le témoignage. On pose deux questions, de tout. Du ressenti, comment il sent les choses etc. Ca se passe exactement de la même manière. A partir du moment où le chef est au courant, on pose des questions. Celui qui ne veut pas répondre, il ne répond pas, pourquoi pas. mais ils ont un drôle de rapport avec l'image. ils aiment qu'on ait des appareils photo, vidéo. C'est drôle parce que les musulmans sont parfois hostiles à ça, les Afghans eux ils aiment bien se voir sur le petit moniteur. Parfois on leur refait voir les images. Ils sont super heureux. Ils rigolent comme des enfants. On a fait un petit film pour l'ambassade qui avait besoin de faire un peu de recrutement, on a monté ce petit film avec l'ambassade, on les a mis en scène un peu pour avoir des images de gens à l'entraînement dans un camp en face du camp français. C'est une grande sécurisée. On peut faire des exercices, là ils étaient en exercice de combat. On pouvait les faire manoeuvrer un peu comme on voulait, les faire arriver de gauche vers la droite, leur faire sauter des murs, les faire intervenir à travers les fenêtres. Nous on positionnait la caméra, on faisait une fois ou deux, quand on voyait que c'était bien on filmait. Là, ils se sont super biens, ils ont joué le jeu. C'était de vrais acteurs. Là c'était de l'imitation, on faisait le truc. Les rapports sont plutôt bons. Ce qui montre aussi avec les évènements récents qu'on aurait pu avoir un suicide bomber à côté de nous et on serait pas là pour raconter. Le risque, ce n'est pas anodin de partir en opération. Dès la première minute, où on pose les pieds sur le sol afghan, il faut rentrer dans une phase concrète de sécurité. On s'y prépare avant mais une fois qu'on est dedans il y a des règles, il y a plein de choses. Puis, il y a la fatalité, on aurait pu y rester. On a eu de la chance. De la prudence mais aussi de la chance. Cet été il y a un gars de la photo qui est décédé, mais il était à côté d'eux. Il faisait son boulot. Comme nous on faisait le nôtre. Ca nous rappelle qu'il faut rester humble. Pas de problème particulier avec eux. C'est rare qu'on ait pas pu les filmer. La confiance c'est important. Comment s'est ressenti le changement de contexte en Afghanistan ?
189
En soi, c'est le recul qui nous fait dire on a changé de contexte. Mais sur le coup, on est de plus en plus dans le dur. 2007, ça a commencé. Moi ma première mission j'ai commencé cette première mission qui, au final nous paraisse pas si énormes que ça ! compte tenu de ce qu'on a vécu après, en 2009 et 2010. Donc, on fait encore plus attention en déplacement, on fait encore plus attention quand on se prépare pour partir, on augmente l'entraînement physique. On se parle beaucoup avec l'équipe, on néglige rien. On se prépare vraiment pour des situations qui peuvent être compliquées. On fait davantage attention à tout, tous les détails, de son équipement, caméra, de ses batteries. Si il m'arrive telle chose je fais telle chose, voilà on se fait des scénarios de réaction. Si j'ai besoin de changer des batteries, je sais qu'elles sont là, et que j'en ai deux, voilà… Tout est très très professionnel jusqu'au bout du détail. On se parle aussi de nos familles. De comment on veut que ça soit annoncé. Ca ce sont des moments très difficiles. Enfin très difficiles… Ce sont des moments que, quand on est en train de préparer une mission où on sait qu'il va y avoir beaucoup de difficultés, on se parle de manière différente. C'est très humain. On est tous les trois et on se parle chacun à notre tour. On est dans le management encore, mais au delà. C'est la fraternité qui prend le dessus. On est égaux devant le danger, donc il n'y a pas le capitaine qui est plus… Si le capitaine est touché, il pourra pas être mort parce qu'il est capitaine : ça existe pas ça. Donc on est tous bien, c'est l'être humain qui reprend le dessus, avec sa fragilité, sa capacité d'analyse. En même temps, ce n'est pas le désespoir. C'est simplement on pousse le raisonnement, on pousse les limites du groupe beaucoup plus loin que quand on est avec une équipe de foot à faire du foot, ou bien dans une équipe de hand, pour faire du hand… On a une vraie complicité. Il y a des choses qui se sont dites là bas et qui ne se rediront jamais ici dans l'équipe. C'est sûr. Quand on se regarde au mess, on ne se regarde plus de la même manière. Il y a beaucoup de respect dans l'équipe. Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens et je pense que c'est la même chose, on voit bien. Il y a des choses, en trois mots, j'ai compris ce qu'il veut me dire. Plus vous vivez des choses fortes avec l'équipe, plus vous avez une complicité naturelle, humaine. Ca le fait avec les gens avec qui on s'est le plus engagé. Parce qu'on partage des moments forts. On est contents de l'avoir fait. On est contents d'être vivants pour venir le raconter. Quand on commence à parler avec l'équipe "moi je veux pas ce soit untel qui annonce à ma famille je voudrais plutôt que ce soit untel", tu te dis "putin tu commences à pousser un peu la mécanique !". Sans dramatiser, toujours avec professionnalisme hein, calme, pas de précipitation. On sait pourquoi on y est. On a bien réfléchi à nos engagements. Pas de soucis, on va pas faire l'image de trop qui nous exposera et qui finalement on en prendra une. On conjugue tout ça. Dans ces moments graves, il y a de l'humour ? Non, on est nous même. Si le gars a l'habitude de dire des bêtises, il va en dire aussi. On n’a pas la larme à l'œil. Mais on est graves. On est conscient aussi. Il y a des consciences dans les consciences, parce que si on est vraiment conscient à un moment donné on y va plus. Donc il faut garder une part d'inconscience et d'aventure. Il y a de l'adrénaline quand même, et ça vous tient tout ça quand même. C'est tout un amalgame de sentiments. Je reste persuadé que ça change les hommes, ça change les gens quand il y a des évènements aussi intenses. Vous prenez du recul sur les choses graves de la vie et les choses qui sont moins graves. Vous replacez la vie au centre de certaines préoccupations. Quand vous avez un découvert de cinq cent euros, au final c'est pas grave quoi. Quand vous avez le gamin qui joue avec la flotte dans la salle de bains puis qu'il en met partout, c'est même rigolo. Vous avez le curseur des choses qui bougent. On prend du recul sur des choses essentielles. Tout ce qui est accident de la route, ça nous parle plus. On a un rapport avec notre entourage qui est différent, qui prend
190
du sens encore plus. On a pas le même regard sur l'ensemble des choses de la vie. on a pris un peu de recul. C'est plutôt sain dans la vie de tous les jours. Vous repartiriez en Afghanistan ? Non. J'estime avoir fait quatre missions et que je suis fatigué et que je n'ai plus envie d'y aller. Maintenant, si le commandement me dit, ça peut être que vous demain, il faut partir, je dirais bon ba laissez moi deux mois, je me prépare, je me remet en forme et j'y vais. Si on me demande mon avis, j'y vais pas, si on me dit il faut y aller, j'y vais. J'ai fait ce que j'ai à faire. Si on me demande d'y aller, je reprend mon équipement, je me réentraîne, je me met en situation de réussir la mission, et après je la fais. Il n'y a aucun problème. Mais ce ne sera pas de mon initiative. En revanche, si il y a d'autres théâtres, je peux aller au Kosovo demain, le Tchad après-demain, il n'y a pas de soucis. L'Afghanistan, de mon expérience, si je peux éviter d'y retourner ça me va bien. Des choses à ajouter ? Ici on est dans un monde passionné. Quand on est jeune et passionné, et on peut être fougueux et il faut faire attention à ne pas aller trop loin. Une de mes missions a été de gérer un jeune fougueux. Il faut faire attention. Je pense qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus d'expérience, il est moins fougueux. Il est donc mature. Il pouvait peut être faire l'image de trop. Je pense qu'il n'est plus dans cette dynamique aujourd'hui… C'est mon avis. Certains vont peut être vous dire que l'image vaut la vie, moi j'estime que non. C'est un monde de passionné, d'engagement, il faut se préparer physiquement. Il vaut mieux le faire à trente ans qu'à quarante, parce que c'est dur. Il faut vraiment avoir la foi. Se dire, oui je peux le faire. On a peur, mais on peut se maîtriser et faire sa mission. On est pas tout seul. C'est une expérience qui est extra-ordinaire, vraiment. 2007 était une mission finalement moins complexe, dure physiquement parce qu'on a crapahuté à droite à gauche, mais moins compliquée que après, quand on est vraiment face au danger, encore plus fort… J'ai fait quatre missions, quatre fois pas la même chose. Complètement différent, les acteurs sont différents, les missions sont différentes. Ca suffit pour que tout soit différent. Il ne faut pas oublier pourquoi on est là bas. On a toujours la frustration de pas être bien vu derrière, mais on met à la disposition des gens. Un jour, nos images sortent pour faire des documentaires. Des gens viennent et consultent. Voilà notre métier.
191
Table des matières
IMAGES DE L’AFGHANISTAN EN GUERRE 1
GLOSSAIRE 4
INTRODUCTION 5
PREMIERE PARTIE : L’HISTOIRE PAR L’IMAGE 18
CHAPITRE 1. L’ETABLISSEMENT DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE DE LA DEFENSE, DES ORIGINES A NOS JOURS 20 1.1. DU SCPA A L’ECPAD : HISTOIRE DE L’ETABLISSEMENT AUDIOVISUEL DE LA DEFENSE 20 1.1.1. GENESE DES SERVICES CINEMATOGRAPHIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE DES ARMEES 20 1.1.2. LA LONGUE MISE EN PLACE D’UN ETABLISSEMENT UNIFIE 23 1.1.3. DE PROPAGANDE A COMMUNICATION 25 1.2. L’ECPAD : UNE INSTITUTION DE LA DEFENSE 26 1.2.1. 2001 : NOUVEAU STATUT ADMINISTRATIF ET FIN DU SERVICE NATIONAL 26 1.2.2. QUEL PUBLIC ? 29 1.2.3. CONSERVATION DES IMAGES 31
CHAPITRE 2. LES REPORTERS DE GUERRE : L’ECPAD SUR LE TERRAIN 35 2.1. A LA FOIS TEMOINS ET ACTEURS 35 2.1.1. DES JOURNALISTES MILITAIRES 35 2.1.2. COMPOSITION DES EQUIPES IMAGES 37 2.2. L’ECPAD SUR LE TERRAIN, EN CONTEXTE AFGHAN 39 2.2.1. AGGRAVATION DES RISQUES : DES CONDITIONS DE PLUS EN PLUS DIFFICILES 39 2.2.2. INSERTION AU CŒUR DES PERSONNELS 41 2.3. MISSIONS DES REPORTERS 43 2.3.1. LES REGLES DE LA COMMUNICATION 43 2.3.2. PRATIQUES AUTONOMES DES REPORTERS 46 2.3.3. PENSER LE REPORTAGE EN OPERATION EXTERIEURE 48
CHAPITRE 3. DES SOURCES AUDIOVISUELLES POUR L’HISTORIEN 51 3.1. PARTICULARITES DES IMAGES DE L’ECPAD 52 3.1.1. UN CORPUS IMPORTANT 52 3.1.2. PLUSIEURS NIVEAUX DE SOURCES 54 3.1.3. DES IMAGES REELLES ? 57 3.2. FAIRE SENS A PARTIR DE L’AUDIOVISUEL 61 3.2.1. UNE ARCHIVE NOUVELLE, SOURCE POUR L’HISTOIRE 61 3.2.2. SELECTIONNER LES IMAGES 64 3.2.3. TRAITEMENT DES DONNEES 67
SECONDE PARTIE : L’AFGHANISTAN VU PAR L’ECPAD (2001-‐2008) 70
CHAPITRE 4. PAIX TEMPORAIRE (2002-‐2006) 72 4.1. LE BON ACCUEIL DES FRANÇAIS 72 4.1.1. REOUVERTURE DE L’AXE PARIS-‐KABOUL 72 4.1.2. A LA RENCONTRE DES POPULATIONS 76
192
4.2. UNE TRANQUILLITE RELATIVE 79 4.2.1. UNE PRESENCE LIMITEE 79 4.2.2. DES PATROUILLES SANS INCIDENTS 82 4.2.3. LA VIE DES SOLDATS A KABOUL 86 4.3. D’AUTRES FORMES DE COMBAT 89 4.3.1. LE REVE D’UN AFGHANISTAN NOUVEAU 89 4.3.2. LES ACTIONS CIVILO-‐MILITAIRES : RECONSTRUIRE LE PAYS 92 4.3.3. EPAULER LA NOUVELLE ARMEE AFGHANE 95
CHAPITRE 5. LE RETOUR PROGRESSIF DE LA GUERRE 99 5.1. LA DEGRADATION SECURITAIRE 99 5.1.1. CAMPS RETRANCHES ET PREMIERS DECES 100 5.1.2. OU EST L’ENNEMI ? 102 5.2. CHANGEMENT DE CONTEXTE, CHANGEMENT D’IMAGE 106 5.2.1. LE DEBUT D’UNE ESCALADE 106 5.2.2. OMLT : LES MENTORS 109 5.3. UZBEEN, LE CHOC 114 5.3.1. POLEMIQUE AUTOUR DES 18 ET 19 AOUT 114 5.3.2. QUELLES IMAGES POUR UZBEEN ? 117 5.3.3. MOURIR EN AFGHANISTAN 121
CONCLUSION 125
SOURCES 130 NOTICE DESCRIPTIVE DES ARCHIVES DE L'ECPAD « FONDS ACTUALITE » ; « FONDS CONTEMPORAIN » 130 LISTE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES DE REPORTAGES FILMIQUE OU PHOTOGRAPHIQUE DE L’ECPAD EN AFGHANISTAN 131 SOURCES TELEVISION, RADIO ET CINEMA : 133 SOURCES PERIODIQUES ET IMPRIMES : 134 SITES INTERNET 134
BIBLIOGRAPHIE 136 HISTOIRE DE L’AFGHANISTAN 136 OUVRAGES GENERAUX 136 LA SECONDE GUERRE D’AFGHANISTAN (2001-‐2008) 137 CINEMA ET PHOTOGRAPHIE DES ARMEES 140 CINEMA ET PHOTOGRAPHIE 140 COMMUNICATION DE DEFENSE 141 METHODE HISTOIRE DU FILM 141
ANNEXES 143 1. CHRONOLOGIE DE L’ECPAD EN AFGHANISTAN 143 2. CARTE DU RELIEF DE L’AFGHANISTAN 150 3. CARTE DES REGIONS 151 4. AFGHANISTAN : CARTE DU DEPLOIEMENT 152 5. DECRET NO 2001-‐347 DU 18 AVRIL 2001 PORTANT STATUT DE L'ETABLISSEMENT DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE DE LA DEFENSE 153 6. ENTRETIEN AVEC L’ADJUDANT-‐CHEF JANNICK MARCES, OPERATEUR VIDEO DE L’ECPAD, JANVIER 2012 156 7. ENTRETIEN AVEC L’ADJUDANT VINCENT LARUE, PHOTOGRAPHE PUIS OPERATEUR VIDEO, JANVIER 2012 169
194
Index
8
8e RPIMa, 52, 116, 123, 126, 128, 141, 157
A
Actions civilo-‐militaires, 4, 44, 71, 85, 89, 92, 93, 100,
102, 109
ARES, 59, 87, 93, 110, 140, 154, 165
C
Chirac, Bernadette, 80, 81, 82, 102
Combat, 4, 9, 25, 47, 50, 60, 69, 77, 93, 97, 103, 104,
105, 106, 109, 116, 119, 122, 127, 128, 130, 136,
152, 156, 167, 168, 180, 184, 188, 191, 192, 193,
195, 196, 198, 202
D
Douchanbé, 59, 87, 152, 153, 154, 155, 156
E
Ecole militaire, 13, 14, 16, 86, 115, 144, 147
EMA, 4, 33, 40, 41, 42, 48, 117, 127, 133, 141, 171, 186
F
Ferro, Marc, 3, 15, 67, 68, 135
Forces spéciales, 147
I
IED, 4, 14, 43, 44, 46, 77, 110, 111, 112, 113, 114, 165,
167, 168, 172, 182
Interview, 47, 68, 69, 70, 82, 89, 92, 101, 105, 122,
126, 140, 186, 193
J
Jacques Chirac, 77, 117
Jalokheil, 116, 126
Jannick Marcès (Adc), 32, 33, 43, 47, 51, 52, 54, 62, 65,
71, 84, 91, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 120, 121,
141, 156, 165, 166, 171, 190, 203
Jean-‐Daniel Daney (Cne), 29, 32, 38, 42, 43, 44, 45, 46,
49, 50, 52, 53, 62, 113, 114, 119, 131, 141, 156,
157, 190, 203
K
Kaboul, 4, 7, 10, 12, 14, 17, 43, 59, 60, 77, 79, 80, 81,
82, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 105, 106,
107, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 120, 122,
124, 125, 126, 128, 140, 142, 145, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 167, 168, 174, 176, 177, 179,
186, 202
Kandahar, 12, 49, 59, 77, 82, 87, 93, 110, 152, 153,
154, 156, 177, 192
Kapisa, 13, 14, 77, 87, 107, 114, 115, 116, 126, 132,
137, 147, 157, 179
Kersauson, 94, 95, 108, 109
M
Massoud, 10, 13, 61, 66, 67, 75, 99, 142
Mazar-‐e-‐Charif, 10, 12, 79, 87, 152, 156
Merchet, Jean-‐Dominique, 14, 49, 130, 143
Mort, 9, 46, 66, 80, 107, 118, 129, 131, 132, 137, 165,
169, 170, 171, 180, 194, 196, 199
N
Nicolas Sarkozy, 17, 78, 116
Nijrab, 115, 167, 177, 188
O
OMLT, 4, 8, 13, 32, 47, 52, 63, 72, 103, 107, 115, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 132, 137, 141, 155, 156,
157, 166, 167, 168, 170, 179, 180, 181, 182, 183,
185, 186, 187, 198, 202
195
ONU, 4, 10, 26, 77, 89, 152
OTAN, 10, 14, 26, 78, 87, 110, 119, 125, 143, 153, 154,
155, 156, 157, 191
P
Pakistan, 12, 13, 104, 114, 157
Pamir, 10
Patrouille, 60, 61, 71, 84, 90, 91, 93, 99, 106, 109, 116,
120, 123, 134, 152
S
SCA, 21, 25, 26, 27, 34
SIRPA, 5, 26, 28, 29, 40, 41, 52, 65, 91, 94, 126, 128,
134, 140, 141, 149, 155, 157, 173
Sorlin, Pierre, 67, 136
Stollsteiner (gal.), 123, 124, 128, 129, 130, 157
Surobi, 77, 114, 122, 126, 130, 158, 180
T
Tadjikistan, 59, 87
Tagab, 52, 115, 116, 126, 141, 167, 188
Taliban, 10, 13, 115, 145, 166, 169
U
Uzbeen, 9, 16, 18, 27, 44, 49, 63, 78, 107, 116, 118,
122, 126, 128, 130, 131, 132, 137, 157, 158, 166,
167, 170, 171, 177, 179, 180, 181, 194, 202
V
VAB, 5, 47, 108, 112, 120, 121, 122, 125, 127, 165,
166, 167, 173, 182, 192, 194
VBL, 5, 91
Vincent Larue (Adj), 40, 43, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 62,
69, 83, 102, 113, 179, 203
W
Warehouse, 88, 95, 108, 109, 112, 123, 132, 155, 168
196
Remerciements
Je voudrais remercier ici très chaleureusement l’adjudant Vincent Larue, l’adjudant-
chef Jannick Marcès et le capitaine Jean-Daniel Daney de m’avoir reçu aimablement pour
mener les entretiens qui furent indispensables à la réussite de mon travail. Je remercie
également Monsieur Jean-Paul Bigorgne, du Pôle production, qui m’a permis de rentrer en
contact avec les opérateurs.
Je voudrais remercier également le personnel de l’Accueil, de la Médiathèque, du Pôle
Production et du Pôle Archive de l’ECPAD. Chacun d’entre eux, par leur sympathie, leur
accueil et leurs réponses, m’ont rendu les archives accessibles et le travail confortable. Je leur
en suis très profondément reconnaissant.
Je remercie mes professeurs, Messieurs Hugues Tertrais, mon directeur de recherche,
et Pierre Singaravélou, de m’avoir orienté vers ce sujet passionnant et d’être restés attentifs à
mes difficultés. Je remercie mes correcteurs, Julien et Cécile, d’avoir donné de leur temps
précieux pour relire ce mémoire. Je remercie aussi tous ceux qui m’ont soutenu, et ils sont
nombreux à pouvoir se reconnaître.
J’exprime ici une pensée particulière pour Magdalena Mazaraki, responsable des
actions culturelles et pédagogiques, qui fut ma principale interlocutrice et dont je regrette la
disparition.
Je voudrais enfin rappeler ici le souvenir éternel qui est dû aux morts, Français ou
Afghans, de la guerre en Afghanistan.












































































































































































































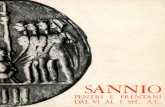










![Pierre-Ernest de Mansfeld: l’homme de guerre [2007]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6332561c83bb92fe98045d0d/pierre-ernest-de-mansfeld-lhomme-de-guerre-2007.jpg)

