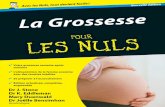MODELISATION THERMIQUE DYNAMIQUE DU RAFRAICHISSEMENT PASSIF DUPERRON Océane
Pour une lecture dynamique des manuscrits médiévaux
-
Upload
johnshopkins -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Pour une lecture dynamique des manuscrits médiévaux
Stephen G. Nichols Version automne 2013 Dept. of German & Romance Languages & Literatures Johns Hopkins University 3400 North Charles Street Baltimore, MD 21218-2685 [email protected]! !!
POUR UNE LECTURE DYNAMIQUE DES MANUSCRITS MÉDIÉVAUX :
LE CAS DU ROMAN DE LA ROSE ! !« La pensée du texte devient une pensée de lecture ».
J. Cerquiglini-Toulet !!En maître de l’art d’interroger la littérature, Jacqueline Cerquiglini-Toulet, avec son élégance
habituelle, pose des questions qui sondent les ténèbres et la profondeur de la littérature française
du Moyen-Âge. On parle beaucoup du fameux « mot juste » chez Flaubert. Avec Jacqueline
Cerquiglini-Toulet, le mot juste va de soi ; c’est plutôt « la question troublante » qui impose : un
point d’interrogation qui, tout comme le fil d’Ariadne, nous permet de traverser un espace
intellectuel déconcertant. Aborder une de ses méditations sur la littérature médiévale, c’est partir
pour une aventure sinon à la quête du saint graal, sinon à la découverte des secrets de la forêt de
Brocéliande, alors certainement et avec enivrement à la quête de « l’engin si soutil » qui a créé
telles merveilles de l’esprit humain.
Prenons le cas de sa ‘nouvelle histoire’ de l’écriture médiévale qui commence par
contester l’idée même d’une historie de la littérature à cette époque. « Est-il légitime, » se
demande-elle, « de penser et d’écrire une histoire de la littérature française du Moyen Âge »? Il y 1
a de fortes raisons d’en douter à commencer par le sens véritable du mot ‘littérature’ « qui désigne
en ancien français les lettres latines, voire le sens littéral d’un mot ». En l’occurrence, l’on doit 2
reconnaître la vulnérabilité, sinon l’absurdité de bien d’idées reçues à l’égard de notre discipline.
Ce pas franchi, l’on comprendra pourquoi « La littérature médiévale s’offre à nous comme une
! Jacqueline Cerquiglini-Toulet, « Littérature médiévale »?, Jacqueline Cerquiglini-Toulet, Frank 1
Lestringant, Georges Forestier et Emmanuel Bury, La littérature française: dynamique & histoire 1, PARIS : Gallimard, « Folio », 2007, p. 27.
! Ibid., p. 27. 2
! 2Nichols « Pour une lecture dynamique… »
énigme». Mais comment écrire l’histoire d’une énigme, si ce n’est d’entrer dans le paradoxe qui 3
consiste à « écrire une histoire de la littérature avant l’âge de la littérature »? Parfaitement 4
nuancée, la dialectique interrogatoire chez Jacqueline Cerquiglini-Toulet retourne l’énigme contre
la méthode scientifique qui prétend l'élucider. Ainsi fait-elle de l’énigme une contre-méthode
susceptible d’ouvrir de nouvelles perspectives.
Dernièrement, elle a posé une question encore plus déconcertante dont la portée est
lourde de conséquences pour l’œuvre littéraire dans son contexte manuscrit. Avec aplomb sinon
nonchalance, Jacqueline Cerquilini-Toulet met en question le composant principal de notre
littérature : le texte. Sa question est simple, directe, et étonnante dans la mesure où il semble
tautologique. N’est-ce pas qu’un texte est un texte est un texte, comme disait Gertrude Stein à
propos de la rose? Conformément à la leçon que voulait nous apprendre Gertrude Stein, la chose 5
n’est pas si simple. Jacqueline Cerquiglini-Toulet nous en instruit lorsqu’elle demande : « Mais
qu’est-ce qu’un texte et comment l’appréhender dans la culture manuscrite du Moyen Age » ?
Pour souligner le sérieux de la chose, elle ajoute : « Plus radicalement, on est en droit de se
demander : dans le manuscrit, où est le texte ? Comment s’opère son individuation factuelle et
matérielle, comment se réalise son identité littéraire » ? 6
Si la question a de quoi surprendre, c’est pour la bonne raison que nous sommes habitués
à trouver « le » – ou du moins « un » – texte d’une œuvre médiévale carrément sous les yeux
chaque fois que nous ouvrons son édition. Tant que nous accédons aux écrits médiévaux par le
truchement de l’édition critique, le texte va de soi. Il est tel que l’éditeur le rend présent à nos
yeux. Certes, est-il toujours possible de critiquer des aspects de son jugement quant au choix du
manuscrit de base, ou de proposer une lecture variante de certains passages, ou d’en déplorer tel
! Ibid., p. 197. 3
! Ibid., p. 197. 4
! « Rose is a rose is a rose is a rose/ Loveliness extreme ». Gertrude Stein, « Sacred Emily » [1913], 5
Geography and Plays, Boston : The Four Seas Company, 1922, pp. 178-188 (citation, p. 187).
! Jacqueline Cerquiglini-Toulet, « La pensée du texte au Moyen-Âge », Philology, History, Theory : 6
Rethinking the New Medievalism, Edited by Joachim Küpper et al., Baltimore : Johns Hopkins University Press, « Rethinking Theory », 2014, p. 2.
! 3Nichols « Pour une lecture dynamique… »
autre traitement. Mais le fait est que l’édition critique ne met pas en question « le texte » en tant
que tel. N’est-ce pas là la raison que l’on parle de « critique textuelle » ?
Nous en sommes tellement habitués à cet état des choses que c’est à peine si l’on le
reconnaît comme une pratique moderne. Ou plutôt, est-il plus juste de dire que l’on souscrit à
l’édition comme résultat heureux d’une science moderne de critique textuelle. Mais, comme le
remarque Jacqueline Cerquiglini-Toulet, le texte clos – c’est-a-dire, le texte qui se veut arrêté –de
l’édition critique est un leurre, une illusion propagée par sa méthodologie :
Or toute la technique de l’édition des textes avait tenté de minimiser le rôle de l’éditeur
comme sujet. Pour les lachmanniens par un transfert de la décision à une mécanique de
règles, pour les disciples trop appliqués de Bédier par un effacement imaginé derrière la
reproduction paresseuse d’un seul manuscrit. Ce faisant était coupé le lien entre amont et
aval, critique textuelle et critique littéraire. Mais qu’est-ce qu’un texte et comment
l’appréhender dans la culture manuscrite du Moyen Age ? 7
Si, comme elle dit, « le texte n’est jamais clos », c’est que « le retour au manuscrit pose la
question des frontières ». Bien que les manuels de rhétorique ou ars dictaminis codifiaient des 8
marqueurs littéraires pour délimiter les bords de texte, les aléas de la mise en manuscrit ou
d’usage pourraient les modifier au point de masquer ou brouiller son identité. Ajoutons à ces
hasards le fait que la zone du texte dans un manuscrit – à la différence d’une édition – n’est pas
exclusive. Le texte littéraire partage la feuille de parchemin avec d’autres systèmes de
représentation – en effet, d’autres « textes » – telles que la rubrique, l’illumination peinte, la lettre
historiée ou décorée, les éléments de décor, la glose marginale en l’occurrence, des ajouts en bas-
de-page, et ainsi de suite. Le feuillet d’un manuscrit médiévale est, en effet, un phénomène
complexe et surtout visuel.
A partir de cet aperçu, l’on commence à comprendre le rôle fondamental que joue
l’activité cognitive non seulement pour « penser le texte », mais – bien avant de cela – pour
discerner comment les composants du feuillet manuscrit s’accolent dans un réseau expressif
! « La pensée du texte au Moyen-Âge », p. 2.7
! Ibid. 8
! 4Nichols « Pour une lecture dynamique… »
intentionné. Si le rôle de la vue prime ici, cela relève de deux caractéristiques particulières de
l’espace manuscrit. : d’abord, le choix du graphisme et de l’image peinte comme modes de
représentation ou plutôt de visualisation. Texte et image opérant dans le même champ expressif
sollicitent un travail de comparaison de la part du lecteur. Or avant de les comparer, il faut
d’abord repérer les éléments pertinents des deux registres qui se confrontent.
Mais dans la mesure où les éléments du graphisme et de l’image ont leur rôle à jouer dans
un récit – en tant qu’ils contribuent à la construction d’une œuvre poétique – le repérage en
question exigera la saisie d’un sens et d’une idée du rapport de ce sens avec le déroulement du
récit. Et ce qui plus est, dans la mesure où les deux registres de texte et d’image vont figurer
différemment le sens qu’il contribue chacun, le repérage rendra non pas un sens unique, mais
deux distinctes perceptions dont le décalage mérite commentaire et comparaison. On voit alors
qu’il s’agit d’un effet de parallaxe dont chaque registre offre une perspective divergente. De ce
fait découle la grande variation dans le programme d’enluminure que l’on constate d’un
manuscrit à un autre, et surtout d’une époque à une autre. Plus on avance dans le moyen âge,
moins l’enluminure d’une œuvre donnée ressemble à celle qui la précède. De toute évidence, la
mimésis médiévale ne se définit pas par un sens de stricte ressemblance.
Cette remarque nous emmène à la seconde caractéristique de l’espace manuscrit qui
relève, celle-ci, non pas de la phénoménologie, mais plutôt de la rhétorique. Pour bien
comprendre l’étonnante virtuosité et variété des versions d’une « même » œuvre – tel le Roman
de la Rose, par exemple, dont on compte plus de 250 manuscrits conservés—produits du XIIIe au
XVe siècle—on doit reconnaître la dynamique reproductrice présidant sur la production des
« copies » des œuvres littéraires en ancien et moyen français. Si les copies d’une œuvre se
différencient les unes des autres, ce n’est pas un résultat du pur hasard. On pourrait très bien
s’imaginer que le prestige des œuvres littéraires fut en partie lié à leur capacité de se renouveler
de décennie en décennie par une transmission dynamique figurant un processus de « répétition
différenciée ». La différentiation des copies vient en partie de la nature génératrice de l’espace
manuscrit lui-même. A la manière de ce que les biologistes ont identifié comme une cellule
pluripotente – c’est à dire une cellule capable de se différencier en plusieurs types de cellules
! 5Nichols « Pour une lecture dynamique… »
spécialisées – l’espace manuscrit se prêt à de nombreuses transformations de l’œuvre en cours de
transmission. Cette capacité pluripotente se manifeste en gros et en détail : d’abord par le
foisonnement de nouvelles versions, et puis au niveau du manuscrit individu par le traitement
varié de l’enluminure, du texte, de la rubrication, des figures en bas-de-page, et du traitement de
certains personnages ou épisodes. 9
La force motrice de la capacité pluripotente manuscrite est connue au Moyen Âge sous le
nom d’« energeia (ἐνέργεια) », une propriété qui transforme ce qu’elle transmet, grâce à sa
capacité d’évoluer dans des directions multiples. Ce terme d’ « energeia » nous est connu 10
aujourd’hui comme désignant un principe de la rhétorique médiévale. Tout en étant vrai dans
l’ensemble, une telle étiquette risque d’induire en erreur le lecteur moderne. Dans la mesure où la
rhétorique en tant que discipline s’est largement éclipsée, nous avons du mal à comprendre le
prestige philosophique – voire métaphysique – que les penseurs anciens lui accordaient, et
notamment Aristote. Pour celui-ci, et par conséquence pour les penseurs médiévaux qui le
suivaient, l’energeia constituait un aspect vital de chaque être et objet. Il en parle ainsi, par
exemple, dans le chapitre 8 du livre IX : « L’œuvre [έργον] est, en effet, la fin [τελος], et l’acte
[ένέργεια], c’est l’œuvre ; c’est pourquoi le mot « acte » [ένέργεια], dérive d’ « œuvre » [έργον],
et « acte » tend à signifier la même chose qu’ « entéléchie » [έντέλεχεια](1050a22-23) ». 11
Pour le Stagirite, qui a inventé le mot, l’energeia (« force en action », « énergie » ou
« acte » en français) désigne la compétence génératrice ou pluripotente chez un objet – ou chez
un être ! – qui exerce sa capacité pour effectuer une transformation en vue d’un but particulier.
Selon Aristote, le sens primitif d’energeia (ἐνέργεια) c’est « l’acte en tant qu’exercice d’une
! Pour une étude récente de la représentation de personnages qui varient selon l’orientation « politique » 9
d’une version manuscrite, voir l’article de Timothy L. Stinson, « Illumination and Interpretation: The Depiction and Reception of Faus Semblant in Roman de la Rose Manuscripts », Speculum 87.2 (April 2012), 469-98.
! Le philosophe américain, David Bradshaw, parle de un aspect étonnant d’energeia comme : « …it’s 10
capacity for development in multiple directions ». Aristotle East and West : Metaphysics and the Division of Christendom (Cambridge : Cambridge University Press, 2004), p. 1.
! Aristote, La Métaphysique, tome II (Livres H-N), Traduction nouvelle et Notes par Jules Tricot, 2e 11
édition (Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 1948), Θ8, p. 47.
! 6Nichols « Pour une lecture dynamique… »
capacité par opposition à sa seule possession ». Pour Aristote, l’exercice d’une capacité définit 12
le but, la raison d’être de l’objet au point où il en fait de l’idée une vertu principale. On trouve
cette idée énoncée sans ambages au Livre 2.1 de l’Éthique à Eudème : 13
Tous les biens en somme sont ou extérieurs ou intérieurs à l’âme, ces derniers
étant préférables […]. En effet la sagesse [φρόνησις], la vertu et le plaisir sont dans 14
l’âme; et on les reconnaît universellement, l’un ou l’autre, ou les trois ensembles, 15
comme la fin. Or, dans l’âme, il y a d’une part des « habitus » ou puissances [δύναµεις],
d’autre par des actes [ένέργειαι] et des mouvements [χίνησις]. Posons donc ces
distinctions comme point de départ et, en outre, que la vertu est la meilleure disposition,
ou le meilleur « habitus » [ἕξις], ou la meilleure puissance de tout ce qui a quelque 16
usage ou fonction. (1218b31-42).
Or, le travail de l’energeia ne se borne pas au changement de l’objet qui en résulte.
L’exercice de la capacité innée se dirige toujours vers une fin précise, un but qui cherche à
perfectionner l’eidos ou image-de-soi que possède l’être ou l’objet de lui-même. Le but de ce
travail continu c’est de perfectionner la « vertu » ou qualité de l’habitus ou disposition de l’objet,
tel qu’il existe dans le monde. C’est encore chez l’Éthique à Eudème qu’Aristote s’explique :
! « So the simplest meaning of energeia in the Aristotelian corpus, that of activity, turns out not to be the 12
earliest meaning. The earliest meaning is activity considered specifically as the exercise of a capacity in contrast to its mere possession » [c’est moi qui souligne]. Bradshaw, p. 3.
! Aristote, Éthique à Eudème, trad. par Vianney Décarie (Paris :Librairie J. Vrin, 1978), pp. 79-80. 13
! « Phronêsis : sagesse théorique ou pratique ; voir la même énumération à I.1 1214a33. Selon les 14
contextes, il a l’un ou l’autre sens ». Sur le sens large (et problématique) de « phronêsis », voir la note 20 à la page 49-50 où V. Décarie passe en revue des traductions possibles du mot avec leurs nuances.
! V. Décarie trouve que « connaissance sera la bonne traduction de phronêsis ici puis qu’elle permet de 15
caractériser les trois vies par « la connaissance (ou vie de penser), l’action et le plaisir, et de réserver à σοφία le sens de sagesse qu’il a traditionnellement en français ».
! Décarie rend ici « ἕξις par habitus, pour le distinguer du mot précèdent: « disposition » ; d’après 16
les catégories, 8b 25-9a 13 l’habitus est une disposition ferme et stable, par exemple la vertu ». [Ajoutons que le lexique philosophique anglophone rend « hexis » selon le contexte soit par « disposition », soit par « possession », « state », ou « active condition »]. !
! 7Nichols « Pour une lecture dynamique… »
[…la vertu est la meilleure disposition, ou le meilleur ‘habitus’, ou la meilleure 17
puissance de tout ce qui a quelque usage ou fonction. […] par exemple, un manteau, il a
une vertu, puisqu’il a une certaine fonction et un certain usage, et le meilleur état du
manteau est sa vertu ; et il en est de même pour un bateau, pour une maison, pour le
reste et, en conséquence aussi, pour l’âme : il y a une fonction de l’âme. Admettons aussi
qu’au meilleur habitus appartienne la meilleure fonction ; et les dispositions auront entre
elles la même relation que les fonctions qui en découlent. Et la fonction de chaque chose
est sa fin. Dès lors, il s’ensuit clairement que la fonction est supérieure à la disposition,
puisque la fin est le meilleur comme fin ; en effet on a posé comme principe que le bien
le meilleur et dernier est fin, ce en vue de quoi tout le reste existe. Il est donc évident que
la fonction est supérieure à l’habitus et à la disposition (1218b38-1219a13, c’est moi qui
souligne). 18
Le lecteur aurait remarqué ici combien Aristote est soucieux de prôner l’importance,
voire la supériorité de l’usage d’un objet – sa fonction dans le monde – par rapport à son habitus,
c’est à dire l’objet en repos, ou l’objet « en chôme », pour ainsi dire. C’est qu’Aristote manifeste
une préférence marquée pour l’objet en mouvement, l’être animé en train de réaliser sa fin. Dans
son traité De l’Âme II.1, le Stagirite représente l’energeia comme ayant deux sens dont l’un actif
et l’autre passif, qu’il compare à veille et au sommeil :
Mais l’entéléchie est prise en deux sens : soit comme la science, soit comme
l’exercice actuel de la science. Il est donc clair que l’âme est entéléchie au même
titre que la science. Car le fait d’être animé comporte les deux états de veille et
de sommeil : la veille correspond à l’exercice de la science, le sommeil à la
possession de celle-ci sans l’exercice. Or l’antériorité dans l’ordre de devenir, et
pour un même sujet, revient à la science. Aussi l’âme est-elle l’entéléchie
! « Nous rendons ici έξις par habitus, pour le distinguer du mot précédent : ‘disposition’ ; d’après les 17
Catégories, 8b 25-9a13 l’habitus est une disposition ferme et stable, par exemple la vertu. Mais Aristote ne s’en tient pas toujours à cette distinction.
! Aristote, Éthique à Eudème, éd. Vianney Décarie (Paris : J. Vrin, 1978), pp. 80-81.18
! 8Nichols « Pour une lecture dynamique… »
première d’un corps naturel possédant la vie en puissance : tel est le cas de tout
corps organisé (412a22-28). 19
Ainsi voit-on que l’energeia d’Aristote ne manque pas de portée dans des domaines
divers. Ceux-ci comprennent, ainsi que nous l’avons vu, la rhétorique, l’éthique, et la
métaphysique pour rester dans le domaine de la philosophie. Mais son influence s’étend bien au-
delà. Dans le domaine du manuscrit, par exemple, « la vie en puissance » joue un rôle primordial.
Or, c’est le but de la lecture dynamique des manuscrits d’en mettre à jour les ressorts. Pour en
prendre le cas du Roman de la Rose comme exemple, l’energeia nous aide a comprendre et à
déchiffrer la circulation pluripotente de ses plus de 250 versions manuscrites.
Son cas s’y prête bien. D’une part, la structure interne de la Rose—son eidos ou forme—
est conforme à la capacité pluripotente d’energeia si ce n’est que par la contingence de sa
création. Produit par deux auteurs travaillant à une intervalle de près de cinquante ans de distance,
une première partie, écrit vers 1235 par un nommé Guillaume de Lorris, consiste d’un modeste
quatre mille et quelques vers, tandis que la deuxième partie, composée par Jean de Meun vers
1280-85, prend des proportions gigantesques (par rapport à son devancier) de plus de 18, 000
vers.
D’autre part, Jean de Meun annonce longuement son intention de compléter et parfaire le
poème commençait naguère par le feu Guillaume. Dans la mesure ou les deux poètes ont un but
très différent l’un de l’autre, les energeiai de chaque partie actualisent une réalisation complexe
du poème à deux sens, dont l’un progressiste et l’autre rétrospectif, voire —du point de vue de la
seconde partie—désuet. Ce sont les energeiai qui appellent « l’hôpitalité »—dans le sens de venir
et à-venir de Derrida— qui annonce dans l’espace manuscrit le renversement du rôle et du monde
de l’Amant ainsi que Guillaume les avait conçus. La Rose selon Jean de Meun est donc un futur
qui répète (en le transformant) un passé. Autrement dit, c’est un travail pluripotent.
Ce travail met en évidence les trois aspects de la forme identifiés par Aristote comme la
vision, la réflexion, et la production, autrement dit, voir, penser, faire. « Seeing, thinking,
! Aristote, De l’Âme, éd. A. Jannone et E. Barbotin (Paris : « Les Belles Lettres », 1966), p. 30.19
! 9Nichols « Pour une lecture dynamique… »
building, understanding, living well, and flourishing are examples of energeiai because each is an
end where the end resides within it (La Métaphysique IX.6, 1048b 18-34) ». Les facteurs de 20
l’espace manuscrit que met en motion l’energeia sont l’incarnation matérielle dans cet espace de
la triade « voir, penser, faire » que nous reconnaissons sous les noms: peinture, écriture, mise-en-
page. Mais dans un sens réel, ces facteurs-ci ne sont que des dispositifs de l’espace générateur
qu’est le feuillet du manuscrit lui-même.
Passons maintenant à l’acte, pour ainsi dire, en regardant de près des exemples « de la
vie en puissance » d’une œuvre littéraire comme la Rose. Je dis bien des exemples car c’est grâce
à la lecture de nombreux manuscrits du Roman de la Rose que nous serons en mesure de nous
rendre compte à quel point les ressources numériques ont transformé notre lecture des œuvres
médiévales. Il ne suffit plus de consulter une seule version du poème à moins de vouloir se
borner à ne considérer que cette version-là comme un témoin parmi de nombreux autres de ce
poème aussi protéiforme qu’il est massif. Grâce à des « bibliothèques numériques » comme notre
Digital Library of Medieval Manuscripts à Johns Hopkins University, on a la possibilité de
comparer quelques 150 manuscrites de la Rose. Il y a non seulement les versions les plus connues
du poème, mais une grande quantité qui sont presque inconnues. C’est parmi cette catégorie-ci
que je vais en choisir des exemples dans ce qui suit.
L’enluminure constitue un domaine fertile pour l’exercice de la capacité pluripotente. À
bien y réfléchir, la peinture montre parfaitement combien la matrice qu’est le feuillet du
manuscrit appelle la triade de puissances motrices—voir, penser, construire—actualisées par
l’energeia. Incontestablement visuelle, l’enluminure provoque le lecteur à penser le rapport texte/
image dans deux sens: d’abord en reconnaissant que le dessin met à jour la latence de l’image
dans le texte écrit, et inversement, en relevant les traces de la parole dans l’image peinte. Chemin
faisant, le lecteur prend conscience des techniques diverses requises pour « construire » une page
manuscrite répartie entre la peinture et le décor du peintre, et l’écriture et la rubrique du copiste.
Or comme le dit Jacqueline Cerquiglioni-Toulet: « Le texte implique la glose. Il est senti comme
! Bradshaw, Aristotle East and West, p. 8.20
! 10Nichols « Pour une lecture dynamique… »
une autorité ». C’est certainement le cas pour Le Roman de la Rose où le récit poétique pratique 21
un style très imagé, tandis que les images constituent un commentaire ou glose visuelle. Et
pourtant, en dépit d’une mise-en-page qui situe l’image en proximité du texte poétique qu’elle
doit enluminer, les deux systèmes cognitifs en donnent des représentations peu ressemblantes. Il
s’agit là-encore de l’effet de parallaxe où deux perceptions d’une même scène en donnent des
vues diverses.
Il n’y a là rien de surprenant. Lorsqu’on y pense, la feuille à parchemin facilite ou même
appelle un format poly-représentatif. N’est-ce pas que l’on y trouve plusieurs modes
d’expression? On y voit, par exemple, le texte poétique, l’enluminure à grand ou à petit format,
les lettres historiées ou décorées, la rubrique (nommant un personnage ou scène dans une
peinture, ou bien nommant l’action d’un personnage ou d’une scène du récit), le décor en
feuillage, des dessins en bas-de-page ou marginaux, des gloses intercalées dans le récit ou bien
encadrant le récit et son enluminure, et ainsi de suite.
Évidemment, une telle agrégation de signes cognitifs couchés sur parchemin fait une
impression considérable sur la page. Et du coup, on reconnaît que cette même agrégation de
signes cognitifs s’imprime pareillement sur l’esprit du lecteur. On pourrait dire donc que la page
du manuscrit figure en quelque sorte comme une allégorie de l’esprit de celui que la regarde.
Ainsi se fait-il qu’en pensant les implications de l’impression de la page venue à son esprit, le
lecteur se rend comte que l’ensemble des signes sur parchemin représente, non pas l’œuvre en
soi, mais la conception de l’œuvre que s’est faite le copiste qui l’interprète à sa façon bien des
années après la mort du poète qui en est responsable. Or, dans la mesure où les composants d’un
manuscrit de la Rose—texte poétique, enluminure, rubrique, décor—sont postérieurs au 13e
siècle, ils témoignent le pouvoir de l’energeia non seulement de transmettre l’œuvre, mais de la
repenser en la renouvelant. De ce fait, le manuscrit pourrait être considéré comme témoin d’une
rupture avec le poème du début…et qui dit rupture entend perte. C’est contre la perte, donc, que
luttent la lecture dynamique et l’energeia.
! Jacqueline Cerquiglini-Toulet, « La pensée du texte au Moyen Âge », à paraître dans Philology, History, 21
Theory: Rethinking the New Middle Ages (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014), pp. 00-00.
! 11Nichols « Pour une lecture dynamique… »
Pour illustrer cette réflexion, prenons quelques exemples saisis des manuscrits peu
connus. Le premier vient d’un manuscrit du 14e siècle produit à Paris mais conservé aujourd’hui
à la Bibliothèque municipale de Lyon, MS. 763, f. 12r (Fig. 1). En l’étudiant, on verra très bien
comment l’enluminure nous aide à penser le récit poétique.
Et l’une des premières tâches de l’image c’est de nous aider
à lire attentivement le récit. Il y a toute une catégorie
d’images dont le rôle c’est d’offrir une lecture littérale,
strictement au pied de la lettre, pour mettre en relief le
langage métaphorique du poète. Comparons par exemple le
rapport entre le passage repris par la peinture à la page Lyon
763 f. 12r avec la mise-en-scène de l’image. Voilà le texte
du récit:
Li dieu d’amors, qui, l’arc tendu,
Avoit toute jour atendu
A moi porsivre et espier,
Si iere aresté lez .i. fier;
Et quant il out aperceü
Que j’avoie ainsint esleü
Ce bouton, qui plus me ploisoit
Que nus des autres ne faisoit,
Il a tantost pris une floiche,
Quant la corde fu mise en coiche,
Il entesa jusqu’a l’oreille
L’arc, qui estoit for a merveille,
Et trait Amor par tel devise
Que parmi l’eil m’a ou cuer mise
Figure 1. Bibliothèque municipale de Lyon, MS. 763, f. 12r
Paris, 14e siècle
! 12Nichols « Pour une lecture dynamique… »
La saiete par grant roideur. 22
(Le dieu d’amour qui, l’arc tendu, m’avait toujours poursuivi, guetté, et épié, s’est
arrêté à côté d’un figuier; et s’apercevant que j’avais ainsi choisi le bouton du
rosier qui me plaisait le plus—bien plus que ne me plaisaient les autres—il a tout
de suite pris une flèche; et quant la corde fut mise en coche, Amouir tendait l’arc
jusqu’à l’oreille, qui était fort à merveille, et il tirait si bien que la flèche, avec
beaucoup de force, m’a atteint au coeur, en passant par l’oeil.)
Sciemment et en bon poète, Guillaume de Lorris
raconte une scène de chasse dont les détails sont précis,
imagés, et évidents pour un public de nobles. Ce public
n’aurait pas bronché non plus à la comparaison de l’amour
avec la chasse – un lieu commun de la poésie lyrique dont
ils étaient initiés depuis le 12e siècle. Là où la scène
commence à sortir des normes, c’est en désignant l’Amant –
plutôt que la femme – comme gibier. Cela rappelle le
mythe d’Actéon des Métamorphoses d’Ovide, une histoire
qui recouvre le personnage du chasseur/amant d’une ambiguïté
d’autant plus troublant qu’elle est vraie. Ensuite, la pièce de
résistance de cette scène c’est le contraste spectaculaire entre la description on ne peut plus
réaliste de l’acte de tendre l’arc par Amour, et le trajet des flèches dès qu’elles sont lancées. Là,
brusquement, on passe du réel au surréel. Car les flèches sont censées atteindre le cœur à travers
l’œil, sans laisser de blessure visible, et surtout sans nuire à la vue, attribut essentiel pour l’amour
dans ce poème.
Or pour le poète, il n’y a pas de problème. Passer du registre réel à
l’évocation d’un monde ailleurs ne le trouble guère armé qu’il est de sa batterie
rhétorique. N’est-ce pas que langage poétique se spécialise au passage du visible
! MS B.M. de Lyon 763, f. 12r, ce passage correspond aux vers 1681-1695 de l’édition de Langlois. Le 22
Roman de la Rose, publié d’après les manuscrits par Ernest Langlois, t. 2 (Paris: Firmin-Didot, 1920).
Figure 2. B.M. Lyon, MS. 763, f. 12r (détail)
! 13Nichols « Pour une lecture dynamique… »
à l’invisible, d’autant plus que le visible parlé est déjà une illusion ? Le peintre,
pour sa part, doit trouver un moyen de frayer un chemin entre le visible matériel
et l’ineffabilité du monde intérieur…tout en restant du côté de la visibilité.
Pour ce qui concerne le peintre de notre miniature (Fig. 2), Guillaume de
Lorris lui a fourni une scène de chasse concrète, dont il n’avait qu’à choisir la
costume des personnages, les détails du paysage, et les diverses couleurs pour
mettre le lecteur dans la scène. Cependant, le peintre a agi tout autrement. Si le
poète a commencé par une image « réaliste » de la scène de chasse pour en venir
à un tableau troublant pour le lecteur et terrifiant pour l’Amant, le peintre refuse
toute référence à la chasse, et surtout rejette-t-il toute référence à la nature.
Reconnaissant que Guillaume de Lorris se sert de la nature pour
dissimuler une action en transformation, le peintre rejette toute référence
naturalisant pour nous présenter une scène qui a lieu dans un espace autre qui
montre en relief non pas le cadre du récit mais son essence. Il dessine une scène
de pure agression ayant lieu dans un cadre irréel. L’arc tendu par Amour doit
avoir une capacité de tir rapide, puisqu’il y en a déjà deux qui volent vers l’œil
de l’Amant, d’une part, et vers son cœur de l’autre part, avec une troisième
cochée.
Cette mise en scène le peintre la fige-t-il à son moment le plus cruel, c’est-
à-dire, à l’instant où la vie précédente de l’Amant sombre devant une fusillade de
flèches, non moins fatales pour être allégoriques. Il n’y a pas de doute que le
peintre a tout compris du récit, et a voulu assurer que le lecteur pourrait lui-aussi
se figurer littéralement cette scène de crise. Et le peintre a su représenter non
seulement la crise, mais aussi la transformation irréversible de l’Amant qu’elle
annonce. Ce sont les flèches figées en pleine volée qui obligent l’Amant à
reconnaître sa situation de menace…bien qu’il ne la comprenne pas encore .
Ainsi qu’Actéon réagissant avec horreur à sa transformation en cerf chez Ovide,
le geste d’inquiétude que fait l’Amant devant la fusillade tirée par Amour nous
apprend qu’il est conscient du danger de sa situation. C’est ainsi que l’energeia, 23
dans une distillation des idées philosophiques qui sous-tendent la Rose, ici fait un
! Ovide, Les Métamorphoses, Livre III, traduites par Jean-Pierre Néraudau (Paris : Gallimard, « Folio », 23
1992), vv. 192-225.
! 14Nichols « Pour une lecture dynamique… »
punctum visuel qui montre plus vivement que ne fait le
récit les forces en train d’engloutir l’Amant.
Que l’on accepte ou non l’interprétation
proposée ci-dessus de la « scène de chasse à l’Amant »
par Amour donnée par le MS. Lyon 763, il n’y a pas de
doute que sans l’accès aux manuscrits accordés par leur
numérisation, la plus grande partie des versions du
Roman de la Rose restera encore inaccessible. Qui dit «
inaccessible » dit « inconnu ». Inconnue aussi serait,
donc, la capacité pluripotente d’une oeuvre dont
‘existence médiévale en fut riche précisément dans la
mesure qu’elle était littéralement mouvementée. Et sans
avoir le possibilité d’étudier ce mode d’existence
pluripotent, nous serons privés d’une perception
fondamentale quant à la nature de la littérature médiévale.
Pour terminer ces réflexions, abordons maintenant un autre exemple des trouvailles que fournissent les manuscrits du Roman de la Rose moins étudiés, mais qui sont maintenant à portée de notre écran. Il s’agit du MS. 525 de la Bibliothèque Municipale de Dijon (Fig. 3). Comme on le voit, le manuscrit est fort endommagé. Aux premiers abords, les dégâts produits par le vandalisme sont à quoi décourager une étude approfondie. Le sentiment de désespoir ne s’apaise pas lorsque l’on continue à tourner des pages (Fig. 4 a-b). Inutile de spéculer sur les raisons pour des actes pareils. Mais en dehors de nous confirmer à quel point on mésestimait le livre médiéval autrefois, les espaces déchiquetés nous font mieux comprendre – ou du moins mieux apprécier – le rôle complémentaire de l’image dans la lecture d’un manuscrit.
Là où, naguère, une image brillait, il n’y qu’un vide qui parle…pour nous dire quoi exactement ? D’abord, ces vides nous font parler à nous mêmes. Ou du moins ils nous obligent de poser la question : « Pourquoi nous dérangent-ils ? » La réponse vient immédiatement : ils nous agacent en empêchant notre lecture, non seulement parce que la coupure enlève du texte avec l’image, mais aussi parce que l’image qui accompagne le texte
Figure 3. B.M. Dijon 525, f. 4r Roman de la Rose
Mathias Rivalli, copiste
Figure 4 a-b. B.M.Dijon 525, ff. 5r-v
! 15Nichols « Pour une lecture dynamique… »
est un aspect intégral de notre lecture. En cette partie du Roman de la Rose, Guillaume de Lorris entreprend à représenter par des descriptions détaillées à l’instar de la peinture neuf portraits des « vices » anti-courtois. Il s’élance dans des descriptions lyriques très imagées, qui ont très tôt suscité la concurrence de véritables peintres.
De toute évidence, la concurrence entre peinture et poésie a été particulièrement fructueuse dans Dijon 525, à en juger par le parchemin abondamment troué. Obligés de confronter ces vides, on a du mal à lire les passages poétiques décrivant les scènes autrefois représentées par les peintures enlevées. Ces lacunes brutales nous obligent de nous rendre compte de la dimension cognitive complémentaire apportée par l’image. Devant “l’oeil crevé” qu’est le vide dans le parchemin, il est difficile de prendre le seul texte poétique comme suffisant. C’est que la blessure dans le manuscrit provoque un sentiment de rupture dans notre rapport avec le poème.
Bien que le langage de ces passages est ressemblant d’un manuscrit à l’autre, les portraits peints pour les accompagner sont assez variables surtout d’une période à l’autre (Figs. 5, 6). Les différents styles de peinture nous aident à situer la réception du poème et ainsi de mieux comprendre sa présentation et son traitement du texte.
Cette pensée m’amène à une autre réflexion suscitée par les coupures opérées dans le manuscrit 525 de Dijon (Fig. 4 a-b). Ce n’est pas de déplorer une atteinte à l’esthétique du livre. Cet aspect du vandalisme va de soi. C’est plutôt qu’en regardant le parchemin « aveuglé », pour ainsi dire, qu’on est frappé de constater des traces de la capacité pluripotente, qui se manifeste, par exemple, dans la double représentation de texte et image que l’on trouve dans les passages atteints. Curieusement, c’est dans l’absence des peintures arrachées que l’on peut se rendre compte pleinement du travail collaboratif des deux systèmes.
Texte et image dans ces passages modèlent une
Figure 5. Düsseldorf Kunstakademie MS AB142, f. 11v (Paris, 14e Siècle)
Figure 6. Phila. Museum of Art MS 1945-65-3, f. 3v (Paris, 1440-1480)
! 16Nichols « Pour une lecture dynamique… »
perception double braquée sur une seule scène: l’entrée dans le récit de l’Amant. N’oublions pas à cet égard que l’Amant est lui-même un double personnage: à la fois l’acteur (le poète à vingt ans) et le poète (le même personnage cinq ans plus tard). Celui-ci, mûri et éprouvé par l’expérience, est maintenant devenu poète de talent. Le poète, lui, se sert de cette entrée sur scène de l’Amant pour élaborer la première « leçon » du long apprentissage prévu pour l’Amant dans les arcanes de la fin’amors. C’est précisément cet apprentissage, rappelons-nous, qui fournit la matière du poème. Or, cette première leçon porte sur les exclus du monde raffiné du Jardin de Déduit, c’est à dire, sur les « vices » anti-courtois—Haine, Vilainie, Convoitise, Avarice, Envie, Tristesse, Vieillesse, Papelardie, et Pauvreté.
Guillaume de Lorris les introduit sous la forme de « portraits » peints sur l’extérieur du mur qui entourent le Jardin de Déduit. Comme on le sait bien, l’imitation de la peinture par la poésie appartient à la figure de rhétorique connue sous le nom grec d’ekphrasis, ou l’imitation des arts plastiques par la poésie. Tout cela est le domaine du poème. Mais le poème n’existe pas sans support matériel, qui en l’occurrence est le manuscrit. Or, si manuscrit et poème partagent le même espace représentatif, ils n’ont pas les mêmes origines. Le poème, en tant qu’œuvre, existe avant et indépendamment du
manuscrit. Celui-ci, par contre, est le moyen par lequel le poème prend forme dans telle
version. C’est là la leçon de l’energeia. Ainsi, est-il possible pour le manuscrit d’apporter à la représentation de l’œuvre des suppléments qui participent dans et enrichissent l’expérience de la lecture du poème sans lui appartenir. C’est le cas de l’enluminure, par exemple, qui, à bien y réfléchir, appartient au manuscrit et non pas au poème.
Autrement dit, le manuscrit ressuscite l’œuvre dans un cadre sciemment critique où l'enluminure fonctionne comme un instrument d’interprétation. À chaque fois qu’une peinture représente un passage du poème, elle donne une interprétation inspirée par, mais différente de celle offerte par le poème. Tel étant le cas, faut-il croire que l’endommagement de Dijon 525—« aveuglé » par l’arrachement brutal des peintures des vices courtois—met fin à l’activité d’interprétation et de critique de la sorte offertes naguère par les images? Autrement dit, le vandalisme met-il fin au travail de l’energeia? Il me semble que non. Assurément, la présence des vides là où il y avait des desseins intentionnés change tout à fait le sens de la critique. À la place du commentaire par l’image sur un passage particulier, on trouve plutôt une attaque qui vise plus loin. On y arrivera, mais disons simplement ici que dans la mesure où l’antipathie contre les vices anti-courtois appartient à la doctrine de la fin’amors que préconise Guillaume, c’est celle-ci que le vandalisme met en cause. Chose étonnante, il y a lieu de croire que, comme
! 17Nichols « Pour une lecture dynamique… »
nous allons voir, le but du vandalisme s’accorde curieusement avec celui de la totalité du manuscrit.
Ce qui est sûr et certain, c’est que le parchemin aveuglé de Dijon 525 (Figs 3, 4a-b) rompt la dialectique habituelle entre poème et peinture. Et pourtant, les traces en restent sous forme des rubriques : « Avarice », « Tristese », « Vieillesse ». Grâce à ces étiquettes, on sait au moins lesquelles des personnifications le spoliateur a effacées. Nous devinons aussi que celui qui a « défiguré » ce livre, ne considérait pas ces mots « hors-texte » comme faisant partie de l’image supprimée. Mais toujours est-il que ces trois étiquettes nous laissent sur notre faim : surtout celle d’ « Avarice » avec son écriture bigarrée peu commune. Est-ce que la représentation de ce personnage allégorique aurait été aussi singulière que sa rubrique ?
Si nous n’avons pas le moyen de répondre à cette question, le manuscrit lui-même en fournit une réponse à sa façon. Voyons comment cela se fait. En tant que recueil, le livre contient d’autres œuvres qui sont mises en rapport avec la Rose, visiblement l’œuvre principale. Pour bien concevoir la structure du recueil, on peut envisager un manuscrit de 223 feuillets dont les premiers 112 feuillets représentent le Roman de la Rose, et les derniers 111 feuillets contiennent de textes divers dont les thèmes touchent d’une façon ou une autre sur ceux articulés par la Rose.
De cette manière, si on ne peut aller jusqu’à dire que Dijon 525 ne pratique pas l’auto-lecture, on voit quand même qu’il s’organise autour d’une lecture du Roman de la Rose. Et la lecture qui en résulte n’est pas du tout neutre. Au contraire, le choix des textes inclus dans le recueil implique une attitude plutôt de désapprobation envers l’oeuvre principale. Elle penche sans ambiguïté du côté de la philosophie morale au point où le recueil se constitue comme une sorte de « querelle de la Rose avant la lettre ». Toujours est-il que le recueil Dijon 525 montre comment la lecture de la Rose au 14e siècle suscitait d’autres œuvres inspirées par et dialoguant avec elle. Cela est une opération que Pierre-Yves Badel nous a bien montré dans son livre magistral, Le Roman de la Rose au XIV siècle. En ce cas cependant, on trouve le phénomène structurant un 24
seul et même manuscrit.
! Pierre-Yves Badel, Le Roman de la Rose au XIVe siècle: étude de la réception de l’œuvre (Genève: Librairie Droz, 24
1980).
Figure 7. B.M. Dijon 525, f. 113r L’Epistre des femmes
Mathias Rivalli, copiste
! 18Nichols « Pour une lecture dynamique… »
La riposte de ce recueil à la Rose ne se limite pas seulement à quelques œuvres. Au contraire, elle appelle un nombre de récits assez courts que l’espace ne me permet pas d’énumérer ici. Notons simplement (Fig. 7) que celui qui suit immédiatement la fin de la Rose, c’est L’Espistre des femmes – qui appartient à une série de textes cités dans la table de matières sous la rubrique: apres est prosa mulierum. Suivant les textes sur les femmes, on trouve Le Testament de Jean de Meun qui fist le Romans de la Rose, et puis plusieurs autres récits peu connus de nos jours, mais toujours prônant des vertus morales. Éventuellement, on arrive à l’œuvre qui nous aide à comprendre pourquoi le feuillet 5r avait de l’intérêt à distinguant le portrait d’« Avarice », de façon particulière, tandis que les noms des autres « vices » s’écrivent simplement en rouge comme d’habitude.
L’œuvre en question est Le roman de Fauvel introduit par cette belle miniature qui a survécu à la main du vandale…ou peut-être que le spoliateur a délibérément mis en vedette par la suppression des peintures dans la Rose (Fig. 8). Quoi qu’il en soit, ceux qui ont fait le manuscrit n’auraient pas pu envisager l’endommagement que leur livre subirait dans l’avenir. Mais en choisissant de mettre Fauvel en rapport avec la Rose, ils ont fait en sorte que cette œuvre nous fasse comprendre la politique du regard qui les lie l’une à l’autre tout en les distinguant comme des œuvres antinomiques quant à leur attitude envers la philosophie morale. Car, si le Roman de Fauvel lance une critique cuisante contre le regard ambigu qui dissimule l’objet de la perception – notamment par l’hypocrisie – la Rose, elle, encourage une vive ambiguïté à cet égard. Guillaume de Lorris n’en est pas exempt de cette tendance, mais Jean de Meun va beaucoup plus loin jusqu’à en prendre plaisir à brouiller les pistes de la perception nette par des personnages comme Faux Semblant, la Vieille, Genius, Nature, et bien d’autres, y compris Raison. Toujours est-il que la Rose, d’une part, et Fauvel, d’autre part, jouent sur le principe de parallaxe dans la perception.
Or, la perception en parallaxe, on le sait, se produit par le changement de position d’un observateur sur ce qu’il perçoit. Et bien, si nos deux œuvres jouent sur l’effet de parallaxe dans leur politique de perception, elles le font différemment. Et cette différence,
Figure 8. B.M. Dijon 525, f. 160r Gervais du Bus
Roman de Fauvel Mathias Rivalli, copiste
Paris, 1355-1362
! 19Nichols « Pour une lecture dynamique… »
on pourrait la montrer d’abord par le rôle que jouent les vices anticourtois, et après par la position que ces « vices » occupent dans les deux œuvres. Chez la Rose, comme on le sait, les « vices » sont exclus du jardin mais mis en évidence par des portraits fort détaillés (l’ekphrasis) peints sur l’extérieur de la muraille du jardin de Déduit. Or dans Dijon 525, les images peintes – précisément ce que l’on voit – ont été arrachées dans un acte que l’on pourrait qualifié comme acte de censure.
Pour le roman de Fauvel par contre, les vices anti-courtois constituent la matière première de l’œuvre tout en construisant – littéralement – son personnage principal (Fig. 9). En fait, l’idée du roman est de déplacer les vices anti-courtois des marges au centre de l’histoire, ou plus exactement, de les combiner tous en un seul personnage, un cheval qui porte e nom de « Fauvel ». Cette transposition souligne une lecture critique du tableau de Guillaume de Lorris – lecture déjà pratiquée par Jean de Meun, d’ailleurs – dans la mesure où il est impossible de marginaliser des émotions comme « envie », « jalousie », « hypocrisie », etc. de la vie affective, surtout lorsqu’il s’agit du désir, un inévitable aspect de toute histoire d’amour.
De ce fait, on construit un personnage allégorique composé de vices différents – un véritable monstre en fait et dans le vrai sens étymologique de « ce qui est contre la nature ». Or ce cheval dissimule sous la fausse apparence du symbole de la courtoisie – 25
le chevalier se désigne par son « destrier » (« cheval de combat ») – des mots révélateurs de sa vraie nature. Pour rendre parfait la circularité entre parole et image, le nom de Fauvel—qui paraît sous forme de graphisme— se compose des mots-images (comme on verra) qui cachent et révèlent simultanément la facticité du personage. Pour éviter que les courtisans ne cherchent pas à y regarder de trop près, on les demande de s’occuper par « étriller » Fauvel, c’est à dire de brosser et d’apprivoiser la bête. Le métier du courtisan et de l’amant consiste, selon ce roman, d’un aveuglement volontaire à travers des actes
! « Monstrum, -i, n. (monestrum de moneo…tout ce qui sort de la nature, monstre, monstruosité… ». 25
Dictionnaire Gaffiot, p. 993. http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=monstre.
Figure 9. Dijon 525, f. 160r (dét.) Gervais du Bus
Roman de Fauvel Mathias Rivalli, copiste
! 20Nichols « Pour une lecture dynamique… »
d’hommage. Surtout, il ne faut jamais chercher à trouver une autre perspective par où regarder la scène.
Et, en fait, ce n’est qu’en se déplaçant pour prendre une perspective différente que l’on peut déconstruire le leurre de l’illusion composée de parole et d’image. Et pour accomplir ce déplacement de perspective, il faut revenir à la parole-image bigarrée « Avarice », signalée dès le feuillet 5r de notre manuscrit (Fig. 4a). Or, pour cela on doit se rappeler qu’une perspective en parallaxe peut aussi prendre la forme du regard oblique – loucher, ce qui est la vue préférée d’Envie, l’un des vices anti-courtois mis en valeur par Guillaume de Lorris.
Dans le cas du roman de Fauvel, la vue en parallaxe ne prend pas la forme de l’œil louche, mais d’un regard bi-axial qui sait lire la parole-image du nom de Fauvel à la fois horizontalement – la forme de l’illusion imagée – et verticalement en acrostiche Figs. 10, 11). C’est en voyant les deux axes à la fois – l’un, horizontal, qui cache le vrai sens des lettres composant le nom, l’autre, vertical, qui révèle le véritable sens des lettres – que l’on arrive à y voir clair:
Flaterie Avarice Vilainie Varieté Envie Lascheté
!C’est cette vue bi-axiale qui remet le lecteur bien dans
le domaine du Logos – et du coup dans celui de la gnose. Le regard en parallaxe ainsi pratiqué, démasque le leurre de la parole-image qui voudrait dissimuler la face réelle de l’hypocrisie et de l’illusion des codes d’amour courtois.
Voilà quelques exemples de ce que j’appelle la lecture dynamique du Roman de la Rose, que les banques de données numériques des manuscrits nous ont mis à portée de
Figure 10. B.M. Dijon 525, f. 161r
Roman de Fauvel
Figure 11. B.M. Dijon 525, f. 161r (dét.)
Roman de Fauvel Mathias Rivalli, copiste
! 21Nichols « Pour une lecture dynamique… »
la main. Grâce à l’accès sans précèdent que nous fournissent les ressources numériques, nous avons la possibilité d’étudier l’étonnante vitalité des versions du Roman de la Rose. Il nous est possible de suivre les aléas du travail de l’energeia qui renouvelle en cherchant à parfaire cette œuvre omniprésente au moyen âge, constamment lu et vu au moyen âge, et fréquemment mal compris au moyen âge…comme aujourd’hui. Autrement dit, est ainsi rejointe l’énigme signalée par Jacqueline Cerquiglini-Toulet et citée au début de cet essai: comment entrer dans le paradoxe qui consiste à « écrire une histoire de la littérature avant l’âge de la littérature »? 26
!Stephen G. Nichols
Johns Hopkins University
! Ibid., p. 197. 26