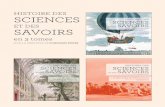\"L’évolution de la réglementation du marché vinicole, contexte juridique essentiel pour une...
-
Upload
lamaisondilona -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of \"L’évolution de la réglementation du marché vinicole, contexte juridique essentiel pour une...
L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATIONDU MARCHÉ VINICOLE :
CONTEXTE JURIDIQUE ESSENTIEL POURUNE APPROCHE DE LA COMPRÉHENSION DES AOCDU MILIEU DU XXE SIÈCLE AU SEUIL DU XXIE SIÈCLE
Le droit viti-vinicole contemporain, par l’ampleur des domaines qu’ilembrasse et la complexité dont il est l’objet, nécessite peut-être plus quetoute autre branche du droit d’être analysé à l’aune des contexteséconomique, politique et social dans lesquels il se construit. Cette démarche,évidente pour quiconque s’intéresse à un droit sans cesse mouvant, nesaurait pour autant se départir d’une approche historique non moinsessentielle afin de circonscrire les enjeux d’une réglementation longtempsmarquée par un empirisme symptomatique des aléas conjoncturels de lafilière. À ce titre, l’appréhension de l’édification de l’arsenal juridiqueprotecteur de la qualité en matière vinicole ne peut se faire qu’en regarddes dispositions prises, dans le même temps, sur le plan de régulation dumarché des vins. Les AOC et l’INAO demeurent donc indissociables, surle plan viti-vinicole, du contexte juridique dans lequel ces institutions ontpu s’épanouir entre le milieu du XXe siècle et le tout début du XXIe. Il esteffectivement une certitude en ce domaine particulier : si la préservationde la qualité en matière vinicole passe par la systématisation de la protectionde l’origine géographique entendue comme gage d’un savoir-faire, detraditions et de typicité territoriale, elle ne peut se faire, en amont commeen aval, que par un contrôle strict des quantités de vins de consommationcourante. Historiquement, c’est en luttant contre l’anarchie viti-vinicoleque les pouvoirs publics, en France, ont réussi à préserver le bel édificereprésenté par les appellations d’origine. C’est, notamment, en définissantjuridiquement le vin comme le produit de la fermentation des raisins fraisgrâce à la loi Griffe du 14 août 18891 et en luttant contre les tromperies ou
129-138 Serra_Intro chap.1 12/03/15 14:27 Page129
Epreuv
es de
contr
ôle
EUD
les falsifications vinicoles entre les années 1890 et la loi du 1er août 1905 quele législateur a enfin réussi à circonscrire l’essence du vin naturel2. De làla possibilité de mettre en valeur, dans un second temps, l’originalité des vinsde France à travers leurs qualités substantielles, garanties par l’appellationd’origine simple, dès 19193, puis contrôlée à partir de 19354. Les années1930 sont surtout celles de la recherche, permanente, d’un ajustementde l’offre à la demande. La surproduction nationale et algérienne – déjàmanifeste depuis les premières années du XXe siècle – devient effectivementconsubstantielle au marché vinicole durant tout l’entre-deux-guerres.Aussi le législateur met-il en place un vaste édifice destiné à assainir lemarché, comme la production, entre 1931 et 1935 : le statut de laviticulture5. Ce pivot de la politique viti-vinicole française doit permettre,à terme, de rétablir un équilibre dans la production des vins deconsommation courante, tandis que l’AOC triomphe au même moment.La distinction cardinale entre vins de qualité et vins de consommationcourante tend, dès lors, à marquer l’activité législative et réglementaire6.Une loi du 18 décembre 1949 consacrera néanmoins une catégorieintermédiaire, celle des vins délimités de qualité supérieure (VDQS7).Apparus à l’initiative du Comité national des appellations d’origine(CNAO) pendant la Seconde Guerre mondiale afin de faire échappercertains vins de qualité aux règles contraignantes propres aux vins deconsommation courante contenues dans le statut de la viticulture, les VDQSsont caractérisés par une procédure originale de labellisation par le syndicatviticole de la région intéressée. Ils ont pour vocation à accéder, à plus oumoins long terme, à la prestigieuse catégorie des vins d’AOC8. Ces deuxcatégories juridiques de vins de qualité seront prises en compte par le droit
130 L’évolution de la réglementation du marché vinicole : contexte juridique essentiel…
1. Codifiée par le décret du 1er décembre 1936, avant que l’ordonnance du 6 mai 2010 nel’abroge expressément en son article 8 (Ordonnance n° 2010-459 modifiant les Livres Ier,V et VI du Code rural). Toutefois, le droit communautaire en a repris la définition et entendpar vin « le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisinsfrais, foulés ou non, ou de moûts de raisin » (règlement n° 479/2008 du 29 avril 2008, annexeIV, devenue annexe XI ter du règlement n° 1234/2007 du 22 octobre 2007).
2. Sur l’ensemble de cette question, qu’il nous soit permis de renvoyer à notre étude, Lelégislateur et le marché vinicole sous la Troisième République, Thèse droit, UniversitéMontesquieu-Bordeaux IV, 2012, p. 117 à 187.
3. La délimitation géographique des aires d’appellation trouve sa source dans les lois du1er août 1905, 5 août 1908, 6 mai 1919 et 22 juillet 1927 (ibid., p. 193 à 338).
4. Décret-loi du 30 juillet 1935 « relatif à la défense du marché des vins et au régime économiquede l’alcool » (JORF du 31 juillet 1935).
5. Sur cette question, cf. BAGNOL Jean-Marc, Le Midi viticole au Parlement. Édouard Barthe et lesdéputés de l’Hérault (années 1920-1930), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée,2010, 462 p. ; notre étude, Le législateur et le marché vinicole…, op. cit., p. 439 à 506.
6. Même si elle est déjà initiée depuis que le législateur cherche à défendre l’origine desvins à partir de 1905.
7. Loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 (JORF du 21 décembre 1949).8. Les Côtes du Roussillon et les Côtes de Provence en sont des exemples patents. Un aviset un accord de l’INAO – moyennant généralement une réduction sensible de l’airedélimitée de production – est toutefois nécessaire (DENIS Dominique, La vigne et le vin.Régime juridique, Paris, Sirey, 1989, n° 194, p. 89).
129-138 Serra_Intro chap.1 12/03/15 14:27 Page130
Epreuv
es de
contr
ôle
EUD
communautaire à partir de 1970, dans le cadre de l’Organisation communedu marché (OCM) viti-vinicole, pour être intégrées au sein des vins dequalité produits dans des régions déterminées (VQPRD1). Ces derniers,distincts des vins de table, correspondent aux vins d’AOC et d’AOVDQS.Ils doivent subir un examen analytique et organoleptique en sus desconditions de délimitation, d’encépagement, de rendement, de pratiquesculturales ou de titrage alcoométrique2. Quant aux vins de table– historiquement vins de consommation courante – ils demeurent presqueexclusivement réglementés par le droit communautaire et, par conséquent,les OCM viti-vinicoles3. Certains d’entre eux se verront toutefois appliquerune réglementation particulière en raison de l’importance prise par lecritère géographique au moment de leur commercialisation. Ces vins ditsde pays4 se trouvent dès lors soumis à des conditions de productionparticulières tant sur le plan de l’encépagement que de l’aire géographique5,mais ils disparaîtront – tout comme les vins de table en général – au seinde l’OCM viti-vinicole de 2008 pour être remplacés par les vins avecindication géographique6.
Olivier Serra 131
1. Règlement n° 817/70 du 28 avril 1970 (JOCE du 5 mai 1970).2. Il s’agit là d’une différence substantielle avec les dispositions nationales dispensant alorsles vins d’AOC de tout contrôle de la qualité du produit fini. L’harmonisation entre droitcommunautaire et droit interne se fera, dès lors, par le biais du décret du 19 octobre 1974confiant à l’INAO le contrôle qualitatif des vins d’AOC (VIALARD Antoine, « L’idée dequalité dans le droit viti-vinicole du XXe siècle », dans Le vin à travers les âges. Produit dequalité, agent économique, Bordeaux, Féret, 2001, spéc. p. 129 à 132).
3. Cette summa divisio entre VQPRD et vins de table subsistera jusqu’à l’OCM viti-vinicolede 2008 distinguant les vins avec et sans indication géographique. Les vins d’AOVDQSdisparaîtront au même moment. L’art. L. 644-12 du Code rural issu de la loi du24 décembre 2007 dispose, en effet, que les syndicats viticoles de défense des VDQSdoivent présenter une demande de transformation en AOC ou en vins de pays avant le31 décembre 2008, avec période transitoire jusqu’au 31 décembre 2011 (BAHANS Jean-Marc et MENJUCQ Michel, Droit de la vigne et du vin. Aspects juridiques du marché vitivinicole,Bordeaux, Féret, Paris, LexisNexis, 2010, n° 195, p. 80-81).
4. Apparus au sein de la loi du 1er janvier 1930, ils seront par la suite déclinés en vins decanton par le décret du 31 août 1964 avant que cette dernière catégorie ne disparaissedéfinitivement suite au décret du 13 septembre 1968 distinguant vins de pays dedépartement et vins de pays de zone.
5. Les conditions de délimitation ne sont toutefois pas parcellaires comme dans les AOC.L’art. 4 du décret du 12 juin 2001 pris pour application de l’art. 51 du règlementn° 1493/1999 portant OCM viti-vinicole prévoit ainsi la possibilité de commercialiserdes vins de pays suivis du nom d’un département (sauf si ce dernier crée une confusionavec une AOC) ou d’une zone spécifique de production. En 2003 existaient encorequarante-quatre dénominations départementales (ex. : Vins de pays de l’Aude ou Vins depays de l’Ardèche), quatre-vingt-quinze dénominations de zones spécifiques (ex. : Vinsde pays des Côtes du Tarn, Vins de Pays d’Allobrogie, Vins de Pays des Cévennes) et cinqdénominations régionales (Vins de pays d’Oc, du Jardin de France, du Comté Tolosan,des Comtés Rhodaniens et des Portes de Méditerranée). Sur l’ensemble de cettequestion, cf. BAHANS Jean-Marc et MENJUCQ Michel, Droit du marché viti-vinicole,Bordeaux, Féret, 2003, n° 160 à 171, p. 98 à 101.
6. La catégorie des vins de tables rejoint, pour sa part, celles des vins avec ou sans indicationgéographique.
129-138 Serra_Intro chap.1 12/03/15 14:27 Page131
Epreuv
es de
contr
ôle
EUD
Quel que soit le domaine du droit viti-vinicole étudié – droit des signesdistinctifs géographiques, répression des fraudes ou régulation dumarché – une constante ressort de l’activité des pouvoirs publics : celle d’uninterventionnisme croissant afin de soutenir une branche de l’agriculturedevenue, au fils des années, structurellement déséquilibrée. La crise desurproduction endémique et la concurrence des viticultures européennespoussent effectivement le législateur français et, à partir de 19621, lesinstances communautaires à trouver les moyens de mettre en place unepolitique éminemment dirigiste afin de tenter, à terme, de stabiliser les coursdu marché et assainir le potentiel productif. Si les modalités de cette actionsont multiples et recoupent, in fine, l’ensemble du droit de la filière, deuxexemples permettent toutefois d’apprécier l’ampleur du dispositif mis enplace sur une cinquantaine d’années afin de maîtriser le marché.Symptomatique de l’interventionnisme des pouvoirs publics, laconnaissance du potentiel viticole demeure, à ce titre, la condition préalableà un efficace encadrement de la production vinicole.
La connaissance du potentiel viticole
À l’image de la Grande Guerre, le second conflit mondial provoque unassainissement du marché, en raison d’une baisse brutale de la productionmétropolitaine et algérienne2. Entre 1940 et 1944, la situation de pénuriefait que la plupart des dispositions du statut de la viticulture sontabandonnées au profit de mesures destinées à assurer le ravitaillementde la population. Certaines tendances sont même renversées en supprimantles mesures restrictives en matière d’irrigation, de cépages interdits ou deplantations, mais la plupart de ces mesures de circonstance seront abrogéesen 19493. Les démons de la surproduction réapparaissent toutefoisrapidement si bien que le marché sature à nouveau au tournant des années19504. La loi du 11 juillet 1953 sur le Redressement économique etfinancier donne au président du Conseil Joseph Laniel des pouvoirsspéciaux afin de combattre la grave crise économique et sociale menaçantune nouvelle fois la viticulture française. Le décret-loi n° 53-977 du30 septembre 19535 met alors en place une véritable charte de l’économie
132 L’évolution de la réglementation du marché vinicole : contexte juridique essentiel…
1. Règlement n° 24 du 4 avril 1962 « portant établissement graduel d’une organisation communedu marché viti-vinicole » (JOCE du 20 avril 1962).
2. VIDAL Michel, Histoire de la vigne et des vins dans le monde. XIXe-XXe siècle, Bordeaux, Féret,2001, p. 109-110.
3. Décret n° 49-1223 du 6 septembre 1949 (JORF du 8 septembre 1949).4. La production du vignoble métropolitain passe de 28,6 millions d’hl en 1945 à61,5 millions d’hl en 1950 et 57 millions d’hl en 1953. Celle du vignoble algérien passede 9,5 millions d’hl en 1945 à 14,3 millions d’hl en 1950 et 18,3 millions d’hl en 1953(LACHIVER Marcel, Vins, vignes et vignerons. Histoire du vignoble français, Paris, Fayard, 1988,p. 583-584 et p. 587).
5. JORF du 1er octobre 1953.
129-138 Serra_Intro chap.1 12/03/15 14:27 Page132
Epreuv
es de
contr
ôle
EUD
viti-vinicole destinée à orienter la production et assainir, à terme, le marchénational. L’une des dispositions les plus importantes demeure sans nul doutela création, en vertu de son article 23, d’un Institut des vins deconsommation courante (IVCC) chargé de la coordination et del’orientation de la production vinicole de masse. Il deviendra, par fusionavec le Fonds d’orientation et de régulation des marchés agricoles(FORMA), l’Office national interprofessionnel des vins de table(ONIVIT1), puis l’Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS2),avant de disparaître au sein de l’Office national interprofessionnel des fruits,des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR3). Dès son origine,l’Institut veille à l’application des prescriptions gouvernementales relatives àl’assainissement de la production telles que la surveillance des plantations etdes arrachages, mais également la détermination des pieds de vigne dont lesbois et plants peuvent être utilisés. À ce titre est prévu l’établissement d’uneliste des cépages recommandés, autorisés, tolérés temporairement etinterdits. D’une portée locale – un cépage recommandé à un endroit donnépeut être interdit ailleurs – cette classification n’est toutefois mise en œuvreque pour les vins de qualité, c’est-à-dire d’AOC et d’AOVDQS et se fait viales décrets de contrôle propres à chaque appellation. À partir de 1962, lesautorités communautaires créeront des catégories plus larges etdistingueront notamment les vignes selon leur objet4. Les classifications desdifférents États membres seront finalement regroupées au sein du règlementn° 3800/81 du 16 décembre 19815 régulièrement modifié au gré desnouvelles adhésions6.
Olivier Serra 133
1. Décret n° 76-302 du 7 avril 1976 (JORF du 8 avril 1976).2. Décret n° 83-244 du 18 mars 1983 (JORF du 29 mars 1983). La création de cetétablissement public à caractère interprofessionnel s’avérera difficile, les professionnels dela filière de qualité voyant d’un mauvais œil qu’un organisme puisse coiffer l’ensemble de lafilière viti-vinicole. Plusieurs projets de 1981 instituent, en effet, des offices d’interventionpar produit dans le secteur agricole conformément au programme électoral deFrançois Mitterrand. La principale crainte consiste, dès lors, à devoir subventionner à plusou moins long terme une branche structurellement déséquilibrée : celle des vins de table.D’autre part, ces mêmes professionnels font prévaloir qu’ils possèdent déjà leur propreinstitution – l’INAO – ainsi que leurs propres organes de régulation à traversl’interprofession. Aussi la loi du 6 octobre 1982 exclura-t-elle d’emblée les vinsd’appellation d’origine des attributions de l’ONIVINS (DENIS Dominique, La vigne et levin…, op. cit., n° 70, p. 38-39). Sur le fonctionnement de l’ONIVINS, dont la compétencesera étendue aux cidres et aux vinaigres en 1984, cf. GAUTIER Jean-François, « Fonctions etfonctionnement de l’ONIVINS », Revue de droit rural, n° 187, novembre 1990, p. 461-467.
3. Décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 (JORF du 1er janvier 2006). L’ordonnancen° 2009-325 du 25 mars 2009 entraînera la fusion de Viniflhor avec quatre autres officespour donner naissance à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de lamer ou FranceAgriMer. Sur le fonctionnement de cet établissement public administratif,cf. BAHANS Jean-Marc et MENJUCQ Michel, Droit de la vigne et du vin…, op. cit., n° 32-33,p. 15-16.
4. Raisins de cuve et raisins de table par exemple.5. JOCE du 31 décembre 1981.6. DENIS Dominique, La vigne et le vin…, op. cit., n° 21, p. 13-14.
129-138 Serra_Intro chap.1 12/03/15 14:27 Page133
Epreuv
es de
contr
ôle
EUD
Organe d’étude et de conseil en matière d’orientation de la production,l’IVCC doit surtout établir un recensement général du vignoble, c’est-à-direun classement des terroirs en « régions qualifiées pour la viticulture » – autrementdit aptes à produire des vins de qualité et généralement définies par leurantériorité – ainsi qu’en « régions de reconversion » – celles dans lesquelles estenvisagée la substitution à la vigne de cultures plus rentableséconomiquement1. Le complément indispensable d’un tel classement consisteen la création d’un cadastre viticole permettant aux pouvoirs publics deconnaître le plus minutieusement possible l’état du vignoble français.La connaissance de ce dernier demeure effectivement fragmentaire etimprécise malgré une grande diversité des sources d’information telles que lesdéclarations de récolte, de stocks et de superficie, mais aussi les enquêtespar sondages, les monographies locales ou encore les estimations del’administration2. D’autre part, au sortir de la guerre, les conditionsde production telles que l’âge, les cépages ou les distances de plantation sontencore loin d’être satisfaisantes, et ce en raison d’erreurs inévitables de la partdes producteurs en matière de déclarations de récolte mais aussi des difficultésd’appréciation effective des superficies eu égard aux cultures intercalaires.Une vaste enquête est alors menée sur l’ensemble du vignoble entre 1956 et1958 mobilisant 12 000 enquêteurs répartis sur 21 000 communes,79 départements, 8 millions de parcelles et 1,5 millions d’exploitations.Les réponses données par les viticulteurs permettent d’élaborer des fasciculesdépartementaux précisant l’importance du potentiel viticole, la répartitiondes exploitations selon leur superficie ou les modes de faire-valoir,l’implantation géographique du vignoble, la structure de ce dernier selonl’âge des vignes ou encore l’encépagement détaillé. Ce vaste ensemble doitpermettre, dès lors, d’influer sur la future politique viticole de la France.Un classement des terroirs en vue d’une implantation rationnelle desvignobles apparaît, in fine, ainsi qu’une réduction des superficies cultivées afinde mettre en œuvre une politique de la qualité. Ce modèle allait influer surle droit communautaire, l’article 1er du règlement n° 24/62 du 4 avril 1962prévoyant l’objectif d’un cadastre tenu par les États membres réunissant denombreuses données telles que la superficie totale cultivée en vigne, les modesde faire-valoir des exploitations, leur répartition selon leur superficie oul’encépagement d’après l’année de plantation. Une mise à jour annuelle estprévue ainsi qu’une refonte tous les dix ans3. Vouloir recenser toutes lescatégories de vignes en Europe s’avérera néanmoins par trop ambitieux.Les raisons de l’inapplicabilité d’une telle disposition ressortent notammentdes pratiques culturales de certaines régions viticoles, au premier chef desquels
134 L’évolution de la réglementation du marché vinicole : contexte juridique essentiel…
1. ROZIER Jacques, Code du vin, Paris, Librairies techniques, 1957, n° 324 à 328, p. 201 à 208.2. Des descriptions très exactes existaient déjà en Bourgogne et en Val de Loire– notamment pour le vignoble de Vouvray – au XIXe siècle (DENIS Dominique, La vigneet le vin…, op. cit., n° 18, p. 12).
3. Sur l’ensemble de cette question, cf. BARTHE René, L’Europe du vin. 25 ans d’organisationcommunautaire du secteur viti-vinicole (1962-1987), Paris, Cujas, 1989, p. 235 à 238.
129-138 Serra_Intro chap.1 12/03/15 14:27 Page134
Epreuv
es de
contr
ôle
EUD
l’Italie du Sud où la notion de vignoble est mal connue, la vigne poussantlibrement au milieu d’autres cultures1. Il faudra attendre vingt-quatre ans pourque l’idée d’un casier viticole communautaire soit relancée2 et l’arrêté du4 avril 20053 pour que soit enfin établi un casier viticole informatisé enFrance. Constitué, mis à jour et géré par la Direction générale des douanes etdroits indirects, son objet consiste à assurer le bon fonctionnement de l’OCMviti-vinicole – notamment les régimes d’intervention et de plantation, ainsique les mesures de contrôle – grâce à la collecte et au traitement desinformations permettant de connaître le potentiel viticole. Les statistiques ainsiobtenues doivent être transmises à la Commission européenne et mises à ladisposition des « organismes associés » susceptibles d’y trouver une sourceprécieuse dans leurs différentes missions d’application des réglementationsnationale et communautaire4.
Connaître le vignoble demeure la condition essentielle d’une bonnemise en œuvre d’une politique d’envergure tendant à réguler, à terme, lemarché national des vins et, en amont, l’appareil productif en son entier.
L’encadrement de la production vinicole
L’édifice contraignant mis en place par le décret-loi de 1953 restaurede manière significative le malthusianisme économique institué, vingt ansplus tôt, par le statut de la viticulture. Les rendements importants sonteffectivement plus lourdement frappés qu’avant guerre, tandis que desblocages prévisionnels sont envisagés à la propriété suivis d’éventuelsblocages définitifs. Une distillation obligatoire d’une partie des quantitésbloquées est également prévue5. On tend également à relever la qualitédes vins mis sur le marché en généralisant les prestations d’alcoolvinique – c’est-à-dire la destruction des sous-produits de la vinification telsque les lies et les marcs, ce qui permet de faire disparaître les vins de pressedont la commercialisation s’avère néfaste tant au point de vue de ladégradation des prix que de l’altération de la qualité des produits – et enélevant le degré minimum des vins de consommation courante légaux,loyaux et marchands.
Olivier Serra 135
1. DENIS Dominique, La vigne et le vin…, op. cit., n° 19-20, p. 12-13.2. Règlement n° 2392/86 du 24 juillet 1986 (JOCE, 31 juillet 1986). Sur ce point, cf.BARTHE René, L’Europe du vin…, op. cit., p. 242 à 246.
3. JORF du 26 avril 2005.4. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;Direction générale des impôts ; INAO ; ONIVINS ; services du ministère de l’agriculture,de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité. Sur la mise en place de cet outil, cf.ASCIACH Jean-Michel, « Le casier viticole informatisé », dans HINNEWINKEL J.-C. etLE GARD C., Les territoires de la vigne et du vin, Bordeaux, Féret, 2002, p. 169 à 176.
5. Une distillation prévisionnelle sera même envisagée par l’art. 6 du décret du14 septembre 1954 (JORF du 24 septembre 1954) lorsque les prévisions feront apparaîtreun excédent important des disponibilités par rapport aux récoltes (ROZIER Jacques,Code du vin…, op. cit., n° 321, p. 198-199).
129-138 Serra_Intro chap.1 12/03/15 14:27 Page135
Epreuv
es de
contr
ôle
EUD
Une série de mesures libérales prises durant les années 1960 tendnéanmoins à adoucir les effets de ce dispositif. Il s’agit, en effet, d’adapter peuà peu l’économie française aux principes de la politique viti-vinicolecommune1. Pour ce faire, le pays adopte une réglementation plus souple quela précédente en instituant des mécanismes non plus forcément coercitifsou d’assistance, mais incitatifs, à l’image du système des prix directeurs instituépar décret du 18 septembre 19572. L’offre doit ainsi être mieux adaptée à lademande par le jeu subtil de prix d’objectifs, indicatifs ou de campagne3.Ce libéralisme se manifeste fort logiquement sur le plan communautaire dansle cadre de l’OCM viti-vinicole de 1970, véritable loi-cadre de la politiqueviti-vinicole européenne. Y sont définis les notions essentielles ainsi queles principaux mécanismes de régulation du marché, notamment quelquesmesures spécifiques en cas de crise afin de soutenir les cours telles les aidesdu Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) austockage privé4. La distillation est également prévue, pour la première fois surle plan communautaire, et doit alors être vue comme une mesure de secourssupplétive lorsque le stockage privé s’avère inefficace.
Pour autant, cette OCM viti-vinicole se révèle rapidement insuffisante carles quantités produites restent très largement supérieures à la consommation5.Deux récoltes fortement excédentaires en 1973 et 19746 débouchent, eneffet, sur un grave conflit entre producteurs français et italiens, le paroxysmede la crise étant atteint le 4 mars 1976 lors du drame de Montredon, près deNarbonne7. La réaction communautaire ne se fait dès lors pas attendre.Un net infléchissement par rapport à la politique libérale de 1970 apparaîtainsi au travers de neuf règlements du 17 mai 19768. Tandis que le blocage
136 L’évolution de la réglementation du marché vinicole : contexte juridique essentiel…
1. Trois grands principes encadrent le projet viti-vinicole communautaire : libéralisation deséchanges au sein de la CEE ; préférence communautaire ; mise en place d’une OCMviti-vinicole afin d’assurer un minimum de revenu aux producteurs en adaptant lesressources aux besoins tant sur le plan quantitatif que qualitatif (BARTHE René, L’Europedu vin…, op. cit., p. 115 et sq.)
2. Décret n° 57-1017 du 18 septembre 1957 (JORF du 19 septembre 1957).3. BARTHE René, L’Europe du vin…, op. cit., p. 66-69.4. Le stockage peut être de long terme – 9 mois – lorsque le bilan prévisionnel faitapparaître un excédent, ou de court terme – 3 mois – à l’occasion de déséquilibrespartiels et provisoires en cours de campagne. Ce dernier type de contrat sera néanmoinssupprimé en 1984 dans la mesure où son impact reste illusoire dans un marchéstructurellement déséquilibré.
5. Et ce, d’autant que l’entrée dans la CEE au 1er janvier 1973 du Royaume-Uni, del’Irlande et du Danemark – pays peu consommateurs de vin – ne laisse pas présager d’unerésorption significative des excédents (VIDAL Michel, Histoire de la vigne et des vins…,op. cit., p. 113-114).
6. L’on passe ainsi de 58,5 millions d’hl en 1972 à 82,4 millions d’hl en 1973 et75,5 millions d’hl en 1974 (LACHIVER Marcel, Vins, vignes et vignerons…, op. cit., p. 584).
7. Sur le contexte social languedocien, cf. GAVIGNAUD-FONTAINE Geneviève, Le Languedocviticole, la Méditerranée et l’Europe au siècle dernier (XXe), Montpellier, Publications del’Université Paul Valéry-Montpellier III, 2e éd., 2006, p. 309 à 351.
8. Il s’agit des règlements n° 1160/76 à n° 1168/76 (JOCE du 24 mai 1976).
129-138 Serra_Intro chap.1 12/03/15 14:27 Page136
Epreuv
es de
contr
ôle
EUD
des nouvelles plantations est expressément prévu, l’octroi de primes dereconversion ou d’abandon est également envisagé, les vignobles desCharentes et du Languedoc étant particulièrement visés. Malgré ces tentativesde régulation du potentiel viticole, la saturation du marché tend à devenirconstitutive de la filière, si bien qu’une troisième OCM viti-vinicole doit êtreprise au début de l’année 19791. Si ce document constitue à n’en point douterune synthèse nécessaire d’un corpus de règles symptomatiques de dix annéesde politique viti-vinicole communautaire, il n’en demeure pas moins le gagedu renforcement de la politique de soutien du marché, notamment enmatière de distillation. La destruction des surplus devient désormais le pivot– malgré son coût – de la régulation du marché vinicole et devient pourla première fois obligatoire sur le plan communautaire2. Le régime initial ainsimis en place prévoit huit types de distillation qui seront tantôt abandonnés,tantôt restaurés ou modifiés au gré des futures OCM3. La distillation devientmême, à partir de 19824, un mode de gestion des crises de surproductionstructurel et non plus conjoncturel, par la mise en place d’une nouvellemodalité – la distillation obligatoire liée aux excédents – tandis que lepotentiel de production est abaissé par la mise en place d’un nouveau régimede plantation et que les mesures de stimulation à la reconversion avecabandon temporaire ou définitif de la culture de la vigne se multiplient5.Mesur viticulteurs d’y avoir recours. Les prix payés demeurant assez attractifspour certains d’entre eux – notamment ceux du Mezzogiorno – ces derniersn’hésitent pas à augmenter leurs rendements, quitte à produire des vinsde qualité certes exécrable, mais destinés à être distillés à des prixsuffisamment rémunérateurs au vu de la quantité produite6. Tandis quel’Espagne et le Portugal, gros producteurs, frappent à la porte du marchécommun pour y entrer au 1er janvier 1986, les récoltes excédentaires desannées 1982 à 1984 alarment les autorités européennes qui trouventfinalement un accord à l’issue de la réunion de Dublin des 3 et4 décembre 1984. Parmi les mesures adoptées – et reprises pour une largepartie au sein de l’OCM viti-vinicole du 16 mars 19877 – figurentnotamment l’aide au stockage privé ainsi qu’à l’arrachage, la réglementationdes plantations nouvelles et son corollaire, le contrôle strict des droits de
Olivier Serra 137
1. Règlement n° 337/79 du 5 février 1979 (JOCE du 5 mars 1979).2. Soixante opérations de distillation auront ainsi lieu entre 1971 et 1988 (BARTHE René,
L’Europe du vin…, op. cit., p. 188).3. Distillation préventive ; distillation des vins sous contrat de stockage à long terme ;distillation des vins aptes à produire des eaux-de-vie ; distillation exceptionnelle ou desoutien ; distillation provisoire liée au prix minimal ; distillation supplémentaire liée auxprestations viniques ; distillation obligatoire des vins issus de raisins de table ; distillationspéciale des vins importés.
4. Règlement n° 2144/82 du 27 juillet 1982 (JOCE du 3 août 1982).5. Des primes de cessation d’exploitation sont ainsi instaurées en France et en Italie par lerèglement n° 457/80 du 18 février 1980 (JOCE du 29 février 1980).
6. DENIS Dominique, La vigne et le vin…, op. cit., n° 490, p. 194-195.7. Règlement n° 822/87 (JOCE du 27 mars 1987).
129-138 Serra_Intro chap.1 12/03/15 14:27 Page137
Epreuv
es de
contr
ôle
EUD
plantation, ainsi que la distillation obligatoire à bas prix. Il s’agit, dans cedernier cas, de sanctionner les viticulteurs produisant les plus gros rendementsmalgré le contexte de crise endémique du marché1.
Le dirigisme économique des OCM viti-vinicoles des années 1980portera ses fruits durant la décennie suivante, une baisse significative de laproduction lors des campagnes de 1994 et de 1995 permettant un certainrééquilibrage du marché. Il s’agit là néanmoins d’un court répit, la criseendémique connue par le vignoble français reprenant effectivement très vitele dessus. L’ensemble des dispositions mises en place durant un demi-sièclesera dès lors repris au sein du règlement du 17 mai 1999 portant OCM viti-vinicole2. Un net recul du dirigisme communautaire semble toutefoistransparaître dans l’OCM viti-vinicole du 29 avril 2008 – dernière dunom – avant son incorporation au sein de l’OCM unique3. Une plus grandeliberté des États membres dans la mise en œuvre des mesures desoutien transparaît effectivement à l’image du choix des programmes d’aideen matière de restructuration et de reconversion des vignobles, del’amélioration de la compétitivité et de la qualité de la production, mais aussien matière de gestion des situations de crise, ainsi que dans l’emploi desressources, via le système des enveloppes nationales4.
Olivier SERRA,Université Montesquieu-Bordeaux IV
138 L’évolution de la réglementation du marché vinicole : contexte juridique essentiel…
1. Sur les accords de Dublin, cf. VIDAL Michel, Histoire de la vigne et des vins…, op. cit., p. 116-117.
2. Règlement n° 1493/99 du 17 mai 1999 (JOCE du 14 juillet 1999). Cette OCM viti-vinicole prévoit seulement quatre types de distillation : celle obligatoire desprestations viniques ; distillation obligatoire des cépages « double fin », c’est-à-dire classésà la fois en raisins de cuve et raisins de table ; distillation facultative d’alcools de bouche ;distillation facultative de crise (BAHANS Jean-Marc et MENJUCQ Michel, Droit du marchéviti-vinicole, Bordeaux, Féret, 2003, n° 281 à 286, p. 153 à 156).
3. Règlement n° 479/2008 du 29 avril 2008 (JOUE du 6 juin 2008). Il sera effectivementabrogé le 1er août 2009 et ses dispositions intégrées à droit constant dans le règlementn° 1234/2007 du 22 octobre 2007 (JOUE du 16 novembre 2007) créant OCM uniqueen application du règlement n° 491/2009 du 25 mai 2009. Sur la notion d’OCMunique, cf. BIANCHI Daniele, La politique agricole commune (PAC). Précis de droit agricoleeuropéen, Bruylant, Bruxelles, 2e éd., 2012, n° 76 à 78, p. 228 à 234.
4. MENJUCQ Michel, « La nouvelle réglementation communautaire du marchévitivinicole », dans Histoire et actualités du droit viticole. La Robe et le vin, Bordeaux, Féret,2010, p. 41 à 53 ; BAHANS Jean-Marc et MENJUCQ Michel, « La nouvelle OCMvitivinicole : une réforme communautaire sous l’inspiration de l’OMC », Revue de droitrural, octobre 2008, spéc. p. 17 et sq. ; ROUSSEL Franck et AGOSTINI Éric, « La gestiondu potentiel de production dans la nouvelle OCM vitivinicole », Revue de droit rural,octobre 2008, p. 21 à 27.
129-138 Serra_Intro chap.1 12/03/15 14:27 Page138
Epreuv
es de
contr
ôle
EUD