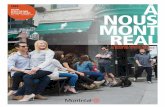“L’Éthique à Nicomaque au XIIIe siècle : une lecture du Commentarium Abrincense in Ethicam...
Transcript of “L’Éthique à Nicomaque au XIIIe siècle : une lecture du Commentarium Abrincense in Ethicam...
L’Éthique à Nicomaque au XIIIe siècle: une lecture du Commentarium abrincense
in Ethicam Veterem à la lumière des Catégories
1
Traductions latines de l’Éthique
• → Burgundio de Pise – 1150 environ Cette traduction, qui incluait les dix livres, a circulé de façon incomplète:
*Ethica vetus : Livres II et III (incomplet) En circulation à la fin du XIIe siècle *Ethica nova: livre I et fin du livre III En circulation au début du XIIIe siècle
Source: BOSSIER, F., « L’élaboration du vocabulaire philosophique chez Burgundio de Pise », dans J. HAMESSE (éd.), Aux origines du lexique philosophique européen, Louvain-la-Neuve, Fédération internationale des instituts d'études médiévales, 1997.
2
• → Robert Grosseteste - 1248 environ Traduction complète (livres I à X) Circulation intégrale
Source: R. A. GAUTHIER et J. Y. JOLIF, « L’exégese de l’Éthique: histoire littéraire », dans R. A. GAUTHIER et J. Y. JOLIF, Éthique à Nicomaque. Introduction, traduction et commentaire, Paris, Béatrice-Nauwelaerts, 1970, vol. I.
3
Premiers commentaires (avant 1248)
• Ethica vetus: Commentaire anonyme d’Avranches
• Ethica nova: Commentaire anonyme de Naples
• Nova et Vetus: Commentaire anonyme de Paris, Pseudo-Peckham, Robert Kilwardby
4
Le Commentaire d’Avranches
Avranches, Bibliothèque Municipale, 232, fol. 90r- 125 v (= A)
→ Fol. 123r, l. 21 à fol. 125v → Texte correspondant au Commentaire du Pseudo-Peckham → Commentaire de type parisien (Cf. O. WEIJERS, « La structure des commentaires philosophiques à la faculté des arts: quelques observations », dans G. FIORAVANTI et al. (éd.) Il commento filosofico nell’occidente latino, Turnhout, Brepols, 2002)→ Structure: Prologue + 14 Leçons
5
Septima lectioTexte commenté: EN, II, 8« Il existe ainsi trois dispositions: deux vices, l’un par excès et l’autre par défaut, et une seule vertu consistant dans la médiété; et toutes ces dispositions sont d’une certaine façon opposées à toutes. En effet, les états extrêmes sont contraires à la fois à l’état intermédiaire et l’un à l’autre, et l’état intermédiaire aux états extrêmes. » (1108 b10-15, trad. TRICOT)
Commentaire d’Avranches
« Ensuite, il peut être demandé relativement à cela que <Aristote> dit : Toutes <les dispositions> s’opposent à toutes. En effet, il note par cela qu’un <élément> est opposé à plusieurs de façon contraire [...] Et ainsi un <élément> s’oppose à de nombreux <éléments>, ce qui est contre cela qui est dans la Métaphysique. En effet, il dit qu’un <élément> est opposé à un <seul> de façon contraire, en ce que la qualité est la distance parfaite dans le même genre. » « Deinde potest queri de hoc quod dicit : omnes omnibus aduersari. Notat enim per hoc unum opponi pluribus contrarie [...] Et sic unum opponitur multis, quod est contra hoc quod est in Methaphysica. Dicit enim unum uni oppositum <esse> contrarie, eo quod qualitas est perfecta distantia in eodem genere. » (A, fol. 107r)
6
Deux conditions à satisfaire
• Un contraire n’a pas plus qu’un contraire.
( Mét., X, 4, 1055 a 19 )
• La contrariété est la distance maximale entre les deux extrêmes d’un même genre.
(Cat. VI, 6 a 18, Éth. Nic. II, 8, 1108 b 34-35)
7
Une citation des Catégories
Aristote, Catégories, XI« Et il est nécessaire que tous les contraires existent dans le même genre, ou dans des genres contraires, ou qu’ils soient eux-mêmes des genres. En effet, le blanc et le noir appartiennent au même genre (car leur genre est la couleur) ; la justice et l’injustice appartiennent à des genres opposés (le genre de l’une est la vertu, et celui de l’autre est le vice) ; et le bien et le mal n’appartiennent pas à un genre, mais se trouvent être eux-mêmes les genres de certaines réalités. » ( Cat. XI, 14 a 19-25, Trad. P. PELLEGRIN et M. CRUBELLIER)
Commentaire d’Avranches« En plus, Aristote dit que, relativement au nombre des contraires, certains sont des genres contraires, certains sont dans des genres contraires, tandis que certains <autres> sont dans un même genre qui n’a pas de contraire. » « Preterea dicit Aristotiles quod quedam sunt, de numero contrariorum, genera contraria, quedam sunt in contrariis generibus, quedam vero sunt in eodem genere non habente contrarium.» (A, fol. 106v)
8
Première formulation
• Intention morale
« Et haec sunt plura genera » (A, fol. 106v)
La première condition n’est pas satisfaite.
indigentia
illiberalitas
medietas
liberalitas
superabundantia
prodigalitas
9
• Intention logique
L’opposition entre les trois éléments est réduite à l’opposition entre le vice et la vertu; celle-ci n’a donc
qu’un seul contraire: première condition satisfaite.
viceilliberal
itasprodigalitas
vertu
liberalitas
10
Mais Aristote dit« Il est nécessaire que tous les contraires existent dans le même genre, ou dans des genres contraires, ou qu’ils soient eux-mêmes des genres. En effet, le blanc et le noir appartiennent au même genre (car leur genre est la couleur) ; la justice et l’injustice appartiennent à des genres opposés (le genre de l’une est la vertu, et celui de l’autre est le vice) ; et le bien et le mal n’appartiennent pas à un genre, mais se trouvent être eux-mêmes les genres de certaines réalités. » (Cat. XI, 14 a 19 - 25, Trad. P. PELLEGRIN et M. CRUBELLIER)
11
Le vice et la vertu sont, selon le chapitre XI des Catégories, des genres différents; la deuxième condition n’est pas satisfaite ; à cause de cela « […] il peut être demandé pourquoi le moyen terme [i.e. la vertu] est dit être opposé aux extrêmes [i.e. le vice], étant donné qu’il n’est pas dans le même genre <que ceux-ci>. »«Deinde potest queri quare medium dicatur opponi extremis, cum non sit in eodem genere.» (A, fol. 107r)
12
Jean le Page (1230-35)Rationes super Praedicamenta
« <Aristote> dit que les <choses> contraires sont dans des genres contraires. <Mais> dans le chapitre sur la qualité il a dit que <les contraires> sont dans le même genre. Donc, il s’oppose à lui-même ici et là.Et il faut dire que double est le genre, à savoir prochain et éloigné. Il faut dire donc que les <choses> contraires sont dans des genres contraires prochains; parce que le genre prochain de la justice est la vertu et le <genre> prochain de l’injustice est le vice, et ici il parle de cette façon; mais <celles-ci> sont dans le même genre éloigné, comme dans la qualité, et de cette façon il parle ci-dessus. » « Dicit quod contraria sunt in contrariis generibus. In capitulo qualitatis dixit quod sunt in eodem genere. Ergo sibi contrariatur hic et ibi. Et dicendum quod duplex est genus, scilicet proximum et remotum. Dicendum <ergo> quod contraria sunt in contrariis generibus proximis; nam genus proximum iustitiae est virtus et proximum iniustitiae est vitium, et sic loquitur hic, sed sunt in eodem genere remoto, ut in qualitate, et sic loquitur superius. » (éd. H. HANSEN, p. 256)
Source: H. HANSEN, John Pagus on Aristotle's Categories, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2012
13
Commentaire d’Avranches « <La contrariété> sera la distance du bien à l’égard du mal dans le genre de l’habitus; <et> là peut être compris le genre sujet dans lequel <le bien et le mal> sont <aptes> par nature à être contraires [...] Étant donné qu’il y a en effet un genre prochain et un genre éloigné, le genre prochain n’est pas <ce> en quoi les extrêmes et le moyen terme ont des rapports ; tandis que le genre éloigné, à savoir l’habitus, est <ce> en quoi les extrêmes et le moyen terme ont des rapports. » «<Contrarietas> erit distantia boni a malo in genere habitus; ibi potest intelligi genus subiectum in quo nata sunt esse contraria […] Cum enim genus proximum et est genus remotum, genus proximum non est in quo communicant extrema et medium, genus uero remotum, scilicet habitus, est in quo communicant extrema et medium […]» (A, fol. 107v)
14
Deuxième formulationDeuxième condition satisfaite
habitus(genus
remotum)
vice(genus
proximum)
illiberalitas
(indigentia)
prodigalitas(superabunda
ntia)
vertu(genus
proximum)
liberalitas(medietas)
15