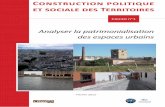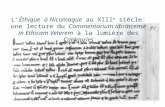« Analyse de l’action chez Blondel à la lumière du Vinculum substantiale de Leibniz»
-
Upload
univ-grenoble-alpes -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of « Analyse de l’action chez Blondel à la lumière du Vinculum substantiale de Leibniz»
1
TEXTE DE PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE DU 18 AVRIL 2014
Par TOUKO Arinte
I- INTRODUCTION
La mondialisation, les communautés économiques et politiques, la genèse des sociétés ont
pour terme commun l'individu. Le progrès des peuples se fait souvent en s'appuyant sur le
génie ou le talent d'un individu qui apparaît opportunément selon les moments. Toute histoire
d'une société quelle qu'elle soit se construit autour du charisme d'une personne, source
d'inspiration, catalyseur et canalisateur d'énergies. Les charismes individuels influencent des
peuples entiers pour fonder ou nourrir des civilisations. Il y a un flux continuel entre l'individu
et une communauté (politique, économique, scientifique, culturelle, etc.). Nous nous trouvons
ramené à l'éternelle question de l'un par rapport au multiple, de leur principe, de leur solidarité
et de leur collaboration, de la place de l’individu dans cette multiplicité et de la façon dont il
s’affirme ou existe. Maurice Blondel s’est penché sur la question et a trouvé que l’Action est
ce par quoi l’individu est. Mais en même temps, elle pose les problèmes du sens, de sa place
par rapport à la société, à leur finalité. Ce questionnement le conduit à élaborer un système
intégral qui se veut une logique et une science de la vie.
II- MAURICE BLONDEL ET SON OEUVRE
A- MAURICE BLONDEL, TRAÎTRE DES DEUX BORDS
‘’L’Action’’ a vu le jour en pleine crise moderniste, crise qui fera des victimes et des mises à
l’index : Laberthonnière, Lagrange, Teilhard de Chardin entre autres. Cette crise qui oppose
l’autorité ecclésiale aux penseurs (historiens, philosophes, théologiens, etc.) qui remettent en
cause les autorités philosophiques et religieuses voit aussi émerger des esprits qui comme
Blondel, vont tenter une synthèse, une science intégrale, par la méthode d’immanence en vue
de réconcilier le naturel et le surnaturel, la pensée et la vie. En effet, pour Blondel « l'homme
ne peut recevoir que ce qui correspond à quelque chose qui est en lui et à son désir
métaphysique d'infini. C'est ainsi qu'il ouvre l'existence humaine sur la possibilité de l'accueil
2
de la Révélation chrétienne »1. Mais peine perdu il sera considéré de part et d’autre comme un
traitre. Comme lui-même le dit : « à gauche, on m’accusait de ne réserver la part de l’homme
et de tout surnaturaliser. À droite on m’a reproché d’abord de ne pas réserver la part de Dieu
et à tout naturaliser, même la grâce et l’ordre surnaturel »2. Mais lui, rejette l’une et l’autre
accusation : « Je tendais à maintenir, à manifester dans leur étendue ces deux parts, - sans
nulle abdication de la raison qui conserve son droit de regard et son droit de coopération
jusqu’aux sommets où saint Jean de la Croix parle de notre passivité active - sans nul
empiétement sur le terrain théologique, puisque le transcendant peut compénétrer notre vie et
devenir immanent à notre action en gardant tout son caractère gratuit et, à vrai dire,
innaturalisable »3. Ce dédain de toute part ne l’empêchera pas d’aller au bout de son œuvre.
Car, non seulement il savait ce qu’il voulait dès le départ, mais aussi d’où il venait et où il
allait : il était foncièrement catholique et voulait une philosophie chrétienne, respectueuse de
l’immanence des rationalistes, immanence par laquelle l’autonomie de la raison est garantie.
Mais son zeste personnel est qu’il voulait d’une immanence qui ouvre sur la transcendance en
« sondant les prétentions des êtres contingents et finis »4. Pour ce faire, il table sur une
dialectique de l’incomplétude humaine, incomplétude qui pousse l’homme à sortir de lui-
même (extase) pour rechercher ce qui lui manque, le complète et qui en même temps le
transcende. De la sorte, Blondel débouche ainsi sur l’hypothèse nécessaire de la
transcendance. « Sa méthode représente la démarche qui permet d’accéder du singulier à
l’universel, de l’expérience à la science, de l’existence à la philosophie »5, dans un premier
moment; dans un second autre, cette connaissance complète la connaissance parcellaire que
l’on avait du singulier et permet de le mieux connaître comme être avec et pour autrui. Le
titre de sa thèse pour le moins insolite, veut contester l’hégémonie de la pensée pour en faire
une étape de l’action. Par ailleurs, chrétien, il se sent appelé à une vocation universitaire dans
1 VIRGOULAY, René, La Philosophie de l’Action. Maurice Blondel (1861-1949), in Esprit et Vie n°205-6 -
décembre 2008.
2 LEVÊFVRE, Frédéric (1889-1949), L’itinéraire philosophique de Maurice Blondel, Document numérique,
Collection Les classiques des ciences sociales, 1928, p.49.
3 Cf. supra
4 COLLECTIF, Maurice Blondel et la philosophie française, 2007, p 209
5 VIRGOULAY, René, l’Action de Maurice Blondel -1 893- Relecture pour un centenaire, B.A.P., Beauchesne,
Paris, 1992, p.9
3
un milieu acquis à la cause du rationalisme. « S’il réagit contre la mentalité rationaliste, il ne
le fera pas directement au nom de sa foi religieuse mais au nom de la philosophie elle-même.
S’il relativise d’une certaine manière la pensée, c’est pour en briser l’autonomie fermée,
ruineuse de la métaphysique véritable »6. Bien plus, il instaure une corrélation entre la pensée
et l’action, et de la sorte se démarque d’Aristote dont il ne nie pas l’influence sur lui mais qui
« déprécie et subordonne la pratique à la pensée, qui détache et exalte l’ordre pratique »7.
Pour Maurice Blondel, « Pensée et pratique ne peuvent être mises exclusivement en
dépendance l’une de l’autre ; elles entretiennent entre elles un rapport médiatisé par l’action
qui reste le centre de la philosophie comme de la vie »8.
Traitre des deux bords aussi, parce que ses adversaires, d’une part les thomistes, l’accuseront
de « méconnaître le pouvoir de la raison, de déprécier la valeur de l’intelligence et du
concept, d’affaiblir d’une manière dangereuse la consistance propre de l’ordre
intellectuel »9, d’autre part les rationalistes « qui considèrent l’entreprise d’une philosophie
chrétienne comme contradictoire et en soi détestable »10.
Par rapport à son recours permanent de la théologie catholique, ses adversaires se posent la
question de savoir s’il ne part pas de ses convictions de croyant, de sa connaissance et de on
adhésion à la foi catholique, et si ses présupposés n’orientent pas secrètement et de manière
tendancieuse sa démarche11. Sa réponse est qu’il tente de vérifier, de manière critique et
philosophique la vérité du christianisme: « L’inspiration de mon travail, (dit-il), n’est
nullement théologique. Je me suis efforcé d’aller aussi loin que la raison peut et doit aller,
sans empiéter sur aucun domaine étranger (…) Jai tenté l’examen philosophique de
problèmes dont, en France plus peut-être qu’ailleurs, l’on s’est trop souvent détourné par
scrupule ou par quelque motif que ce soit. Cette abstention, dont l’Angleterre et surtout
6 VIRGOULAY, René, l’Action de Maurice Blondel – 1893 – Relecture pour un centenaire, B.A.P.,
Beauchesne, Paris, 1992, p. 10
7 Ibid., p.16
8 Ibid., p. 17
9 TRESMONTANT, Claude, Introduction à la métaphysique de Maurice Blondel, Seuil, Paris, 1963, p. 17
10 Ibid.
11 Ibid. p. 126
4
l’Allemagne sont loin d’avoir imité l’exemple, me paraît périlleuse, parce qu’en l’absence de
toute discussion rationnelle sur les questions qu’on ne supprimera pas, le champ reste ouvert
au conflit violent des zèles contraires. Écarté. par ceux qui répugnent à l’entreprise d’une
philosophie de la nature délaissée par ceux qui se désintéressent de la métaphysique
proprement dite et de l’ontologie, Blondel a de plus été attaqué et dénoncé par ceux qui
pourtant étaient le mieux placé pour comprendre le sens de son entreprise, les thomistes.
C’est ainsi que l’œuvre de Blondel s’est trouvé isolée de toute parts »12.
B- MAURICE BLONDEL, MÉDIATEUR ET MODÉRATEUR D’UNE
QUERELLE SANS MERCI
Ce rejet de toute part sera le moteur de Blondel, car en ne le souhaitant pas, cette situation lui
permet de jouer son rôle de médiateur entre les deux camps. En effet, son projet d’une science
globale et d’une logique de la vie a pour but de concilier les deux bords : « préserver à la fois
la consistance propre de l’ordre créé, et l’aspiration de tout le créé vers sa fin »13. Blondel à
cet égard assume le rôle du chaînon manquant entre les deux parties. Pour ce faire il élabore,
sans toutefois verser dans la philosophie du devenir d’Héraclite d’Éphèse, un système in via
où la création toute entière est entrain de se faire. Son système s’intéresse aussi bien aux
données physiques qu’aux données psychologiques. L’œuvre de Blondel est de la sorte une
œuvre englobante qui part de la genèse de la Pensée à son extériorisation en des actions
concrètes et de l’insertion de ces dernières dans un schéma global. L’œuvre Blondélienne est
ainsi toute à la fois une œuvre philosophique, psychologique, épistémologique, éthique,
esthétique, politique, sociologique, etc. Elle est vraiment une synthèse intégrale qui permet de
dresser un pont à l’instar de l’action entre les différents groupes en conflit :
- entre la Raison et la Foi ;
- entre les théologiens et les philosophes ;
- entre la modernité et l’église à travers son magistère.
- Entre la volonté voulante et la volonté voulue, respectivement source de l’action et
l’action accomplie,
- entre l’ébranlement qui a commencé à l’intérieur de l’homme, celle-ci invisible, et qui
s’extériorise par des actes concrets qui sont eux visibles.
12 COLLECTIF, Maurice Blondel Et la philosophie française, note 15, Op. Cit., p. 137
13 Cf ; supra, p. 80
5
Cette adéquation entre les deux bouts n’est pas aisée. Elle n’est pas non plus automatique, car
elle n’exclut pas la liberté. En effet, il y a toujours « difficulté (…) d’harmoniser nos désirs
intimes, d’égaler le résultat effectif de l’acte à l’ambition du vouloir »14.
Médiateur il l’est enfin par ce désir de rétablissement de l’unité de la personne humaine
malgré les différents états d’être et le défilement du temps et de l’espace qui portent la
personne. En effet, « chez tout homme, il y a antagonisme interne zizanie de tendances
opposées ou tout au moins divergentes. Jeté dans cette multitude d’appétits et de désirs
comme une pierre dans une eau populeuse, l’acte ne paraît d’abord servir qu’à exaspérer les
oppositions et les contradictions. En face de la résolution déclarée, toutes les puissances
hostiles se réveillent, se groupent, et de la défensive tendent à l’offensive. On dirait qu’il
suffise de vouloir pour qu’aussitôt on ne veuille plus »15. Comment assumer ses
responsabilités dans ces conditions ? L’action, dès lors, « a pour effet de coordonner et de
subordonner l’ensemble des énergies intérieurs »16. Elle fait l’unité de l’être pour l’ouvrir à
d’autres actions et à d’autres êtres. Cela ne peut être possible que grâce au ‘’vinculum’’
leibnizien qui arrive opportunément pour soutenir son hypothèse. L’action dès lors exprime
l’être et est sa synthèse. Elle est ce par l’être s’affirme et un pont vers l’altérité.
III- LE CONTEXTE DE L’ÉCRITURE DE LA THÈSE
Le contexte de l’écriture de la thèse de Maurice Blondel correspond à celui du modernisme et
de la crise moderniste. Le modernisme fut un mouvement culturel et intellectuel entre le XIX°
siècle et le XX° siècle en occident. Il s’étendit sur plusieurs domaines, tels l’architecture, la
musique, la littérature, la théologie, la philosophie. Quant à la crise moderniste, elle fut une
des conséquences du modernisme. Dans le catholicisme, elle se caractérise par le relativisme
vis-à-vis des valeurs de l’Église et une tendance à la sécularisation. Elle sera condamnée par
le Pape Pie X dans son Encyclique, Pascendi Dominus Gregis (1907). Cette période a opposé
particulièrement les philosophes et les théologiens d’une part et les philosophes et certains
théologiens progressistes contre le magistère de l’Eglise, d’autre part.
C’est dans ce contexte que Maurice Blondel écrit sa thèse sur l’Action, à la fois Vinculum
14 Paul Archambault, Vers un réalisme intégral, op.cit., p.22
15 Ibid., p.23
16 Cf. supra
6
substantiale et Vinculum substantiali dans une démarche elle-même médiatrice pour
réconcilier les différents bords qui s’affrontent durant la crise moderniste. Pour amener les
partisans de l’immanence et ceux de la transcendance au dialogue, il affirme que la raison
humaine tout en conservant son autonomie (immanence) sent d’elle-même la nécessité d’une
ouverture à une transcendance qui est en lui. L’action est ce par quoi l’homme exprime son
autonomie et son ouverture à l’altérité. Dans sa démarche, Maurice Blondel ne tente pas
d’expliquer l’action en dehors de la dimension. Il va chercher les sources de l’action dans
l’homme, rejoignant en quelque sorte un certain Saint Augustin qui disait : «je te cherchais
au-dehors et tu étais au-dedans de moi ! »17
.
La connaissance de l’être par les méthodes propres à Blondel est une Ontologie blondélienne.
Elle lui permet d’asseoir une science globale de l’être dans sa relation avec les autres êtres
d’une part et sa source principielle d’autre part. C’est une méthodologie spécifique
d’acquisition de la connaissance : ni positivisme pur ni dogmatisme éthéré, mais une science
du possible pour unifier toutes les dimensions existentielles de l’être et tous les êtres. Cette
unification est une réponse aux différentes quêtes permanentes de l’être: la science positive, la
poésie, la métaphysique bien comprise, l’ascèse, la mystique18
, clefs d’accès à la Voûte, la
Réalité qui lui échappe encore19
. L’Ontologie blondélienne est ainsi une démarche qui évolue
à partir d’une phénoménologie vers un réalisme intégral.
IV- DU SYSTÈME INTÉGRAL
La philosophie antique a connu des systèmes explicatifs de la réalité et tenté de proposer un
sens global de la vie.
Chaque système intégral est spécifique à l’histoire personnelle du philosophe qui s’y attelle. Il
est aussi en rapport avec le contexte sociétal et intellectuel du moment. Ces Contextes
charrient des interrogations que les contemporains se posent. Quant à Maurice Blondel sa
préoccupation est si : « oui ou non la vie a-t-elle un sens ? ». Il partira de l’Action pour
résoudre son énigme.
17
Saint Augustin, Confessions X, 27, 38
18 Cf. S.A., Blondel, entre l’Action et la Trilogie, Lessius, 2003, p.230
19 Ibid., p.229.
7
V- L’ACTION COMME FONDEMENT DE SON SYSTEME INTEGRAL
Maurice Blondel devait partir de quelque part, d’un point de départ qui soit simple et concret
mais qui ne soit pas une simple donnée empirique. Il choisit de partir de « l’Action ». Car
l’action contient une nécessité qui lui est propre, une logique immanente20
. Elle obéit aux
critères de scienticité et on peut en tirer une méthode21
. Elle échappe à la contingence
empirique et aux variations individuelles et permet d’établir des lois, des enchaînements
rigoureux, des déterminismes22
. De la sorte, l’action a une ouverture sur l’universel et peut
donner de trouver « une solution au problème de la vie, solution qui s’impose nécessairement,
et qui soit valable pour tous et communicable à tous. ‘’Car, il ne faut pas que mes raisons, si
elles sont scientifiques, aient plus de valeur pour moi que pour autrui, ni qu’elles laissent
place à d’autres conclusions que les miennes (A, XVII)’’ »23
. La méthode qui s’impose donc à
l’analyse de l’action demeure incontestablement la méthode scientifique qui part de ce que
l’on peut affirmer et vouloir, le phénomène, l’objet des sciences positives.24
L’Action est entièrement ancrée au centre de la préoccupation fondamentale de l’homme et
Blondel en fait le point de départ de sa recherche. Elle impose des questionnements sur la
nécessité de l’engagement, de son efficacité, et sur la destinée de l’homme, questions
auxquelles Blondel veut tenter de répondre. Ces questions impliquent que l’être pensant est un
fait problème. Problème qui ne se poserait pas devant un être inerte sans pensée et sans
conscience. Il n’y a de problème que devant une pensée qui pense et se pense.
Blondel choisit de partir du thème de « l’Action » parce que ce thème lui permet après analyse
d’arriver à asseoir un système intégral qui établit une unité foncière de toutes les actions
singulières et pris ensemble dans leur rapport à l’Action première. Le sens et la logique de la
vie sont alors trouvés: la vie consisterait, dans la perspective blondélienne à une tentative de
la jonction des actions singulières à l’action première qui a fait advenir l’être dans le temps et
l’espace. C’est à cette condition que les actions singulières ont du sens. Par la participation à
20
Cf. VIRGOULAY, René, L’Action de Maurice Blondel – 1893 – Relecture pour un centenaire, op.cit., pp. 10-
11
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid., pp. 12-13
24 Ibid., p. 15
8
l’action première de la création, l’homme achève dans sa vie l’œuvre universelle de la
création. Cette œuvre englobe « tout l’ordre sensible, scientifique, moral et social »25
.
Il y a donc dans une action une logique et une orientation vers un sens déterminé, ce qui fait
dire à Maurice Blondel qu’« à partir du premier éveil de la vie sensible jusqu’au plus hautes
formes de l’activité sociale, se déploie en nous un mouvement continu dont il est possible de
manifester à la fois l’enchaînement rigoureux et le caractère foncièrement volontaire»26
.
Cette orientation est un effort d’adéquation des actions singulières à une autre, celle-là
lointaine, intérieure, immanente que Maurice Blondel appelle ‘’la volonté voulante’’.
L’objectif de la thèse de 1893 est de dégager la logique, la progression et les étapes de cette
orientation27
. Ce mouvement ou amorce d’un retour à la source première selon Blondel ne naît
pas comme par génération spontanée. Blondel va pousser loin son investigation pour en
trouver sa source, cette clef de voûte vers laquelle tendent toutes les singularités en voulant la
reproduire. En cela Blondel est platonicien quand il pose l’hypothèse d’un monde autre que
visible, Modèle et Norme. Mais aussi Blondel, héritier du christianisme se démarque de Platon
en ne séparant pas les deux mondes : la pensée et l’action, un monde de contemplation et un
monde d’action. C’est pour lui un même monde qui se continue en deux moments, l’un
immanent qui appelle inexorablement un autre, le transcendant. Ils sont unis, selon Coïntet,
à leur source commune « par un vinculum substantiale caritatis »28
.
Le multiple pose le problème dont seul l’unité peut être la solution. La thèse latine de Blondel
qui traite de l’union substantiel est ce par quoi l’unité et le lien interpersonnel est possible.
C’est en cela qu’elle n’est pas une autre thèse mais une suite logique, une nécessité de la thèse
de 1893. En effet, la diversité des êtres, et conséquemment des actions va poser le problème
de leur participation à la même source. D’où, à l’instar de Leibniz, cette trouvaille de Blondel
du ‘’lien substantiel’’ qu’il perçoit comme une unité concrète en chaque être et qui assure sa
25
VIRGOULAY, René, L’Action de 1893, Relecture pour un centenaire, op.cit., p. 45
26 BLONDEL Maurice, l’Action , t. 2, (édition numérique), op ;cit., p75
27Cf. VIRGOULAY, René, L’Action de Maurice Blondel. Relecture pour un centenaire, op.cit., p. 45
28 COINTET, Pierre (de) Le Concret, d’après la Trilogie de Maurice Blondel, Mémoire DEA, Lyon, octobre
1994, p. 35
9
communion avec tous les êtres29
.
Blondel, sans perdre de vue les conclusions de ses devanciers, pense que le principe premier,
par son action créatrice, est ce lien substantiel vers lequel convergent toutes les actions
humaines. L’action devient alors un objet scientifique d’analyse afin qu’émerge une loi
universelle, une logique de la vie. La méthode de travail de Blondel consistera «à transformer
le point de départ en un point d’arrivée »30
. Le point de départ étant l’action, l’immanence, la
volonté voulue, et le point d’arrivée, la volonté voulante, la transcendance, la clef de voûte.
VI- DE LA NECESSITE DU LIEN SUBSTANTIEL
La substance est ce par quoi un corps composé ou complexe acquiert une unité foncière.
L’être étant complexe, son action est ainsi loin de revêtir le caractère de la perfection parce
que ne possédant pas une unité parfaite. L’être humain, s’il est per se, l’est à un certain degré
seulement. N’étant pas causa sui il ne peut être que par un autre qui possède la totalité de
l’être et qui a une unité foncière plus parfaite. On ne peut donc pas parler d’unité foncière en
considérant l’action humaine que par analogie. Et du reste, la vie de l’homme est à ce point
compartimentée et son état psychique instable et inconstant pour que l’homme assure une
présence totale dans chacune de ses actions au point qu’à tout moment son action puisse être
parfaite. La vie de l’homme, dès lors, a-t-elle un sens dans ces conditions ? D’où l’idée d’une
Caution d’être, d’un Parrain, immanent à l’être et qui assure la continuité d’être même dans
ses moments de déficit d’être. La responsabilité implique que l’auteur des actes possède la
totalité du savoir et préempte sur les incidences de son acte. Or l’être contingent a une vision
tronquée ou partielle des incidences futures de ses actes. Son degré de responsabilité sera en
rapport avec les ‘’lumières’’ dont il bénéficie.
VII- DE L’ORIGINE DU LIEN SUBSTANTIEL
29
Cf. Blondel Maurice, Itinéraire philosophique, op.cit. , p. 36
30 VIRGOULAY, René, L’Action de Maurice Blondel. Relecture pour un centenaire, cp.cit., p.46
10
Dans sa recherche d’explication du principe d’unité d’un corps complexe, Blondel ne pouvait
pas rester insensible au contenu de la correspondance entre Leibniz et Des Bosses,
correspondance au cours de laquelle le terme de ‘’vinculum’’ fut utilisé « pour désigner la
réalité du composé en tant que composé, partout où il y a organisme, synthèse unum per se
dans une multiplicité apparente ». Le Vnculum permet de comprendre et d’expliquer la
théorie de l’un et du multiple, de la forme et de la matière. Il a permis surtout de répondre à la
théorie mécaniciste cartésienne de la cohabitation du corps et de l’âme. Quant au terme
transsubstantiation qui a conduit opportunément au terme ‘’vinculum’’, il est le mode selon
lequel, Jésus, le Christ selon la dogmatique catholique, transformerait les espèces composées
du pain et du vin en son corps et en son sang, composés totalement différents des produits
initiaux. Cette transformation n’est possible que par le rôle actif du nouvel être, le Vinculum,
introduit par Leibniz. C’est lui qui assurerait le lien inter-substances dans les nouveaux
composés que sont le corps et le sang sous les apparences du pain et du vin.
La plupart des interprètes de Leibniz, connaissant son aptitude à la conciliation, sont
persuadés qu’il a accommodé sa pensée au dogme catholique et à la foi inquiète du prêtre
jésuite Des Bosses. Quoi qu’il en soit, Maurice Blondel a choisi de forger son système
intégral en partant du christianisme dont les vérités répondent aux normes de critiques
positives. Parlant du système intégral de Blondel, Dartigues dans un article intitulé “René
Virgoulay, philosophie et théologie chez Blondel”, y souligne «le rôle éminent de la
christologie qui, à travers le thème leibnizien du vinculum subtantiale, répond
théologiquement au concept philosophique de médiation jusqu’à se traduire par un
“panchristisme”. »31 En effet, dans la perspective chrétienne, le Christ est celui qui fait le
lien entre tous les hommes, donne la consistance à tout le réel et rassemble tout en lui pour le
porter à son Père32. On remarquera une sorte d’analogie du vinculum selon qu’on se trouve au
niveau atomique, sociétal ou spirituel. À tous les niveaux, il est ce par quoi l’unité se fait.
Leibniz trouve dans son dialogue avec Des Bosses une occasion d’aller au-delà de la
monadologie. Blondel ne pouvait trouver meilleur allié s’il voulait répondre à la question
31 DARTIGUES, René Virgoulay, Philosophie et Théologie chez Maurice Blondel, In « archives de recension de
l’Institut catholique de Toulouse ».
32 Cf. supra
11
qu’il s’est assignée, « oui ou non la vie a t-elle a un sens ? » et faire jouer à l’action le
principe d’unité de l’être humain en particulier et de toute l’humanité.
Sans un principe d’unité, comment la vie pouvait avoir un sens avec la myriade d’êtres
soumis à leur liberté ou à leur déterminisme respectif ? Comment la vie peut-elle avoir un
sens quand ce qu’on considérait comme un être est en fait un complexe d’instants
psychologiques et physiologiques. L’hypothèse du vinculum récupéré par Blondel permet de
franchir cet écueil. Blondel attribut à l’action les fonctions du vinculum. Dès lors, l’action par
laquelle l’homme est ou s’exprime, n’est plus un acte isolé. Une sorte de monade. Elle
s’inscrit dans la continuité de sa vie. Elle est aussi ouverte vers la vie des autres hommes.
Bien plus, elle est en rapport avec les actions des autres humains. La vinculum, du lien
substantiel, passe chez Blondel au lien interpersonnel. L’action dès lors est un élément de
l’ensemble. C’est un instantané d’être qui place ce dernier sur un diagramme par rapport aux
autres êtres et par rapport à l’Acte Normée, l’Exemplaire, le sommet de la Voûte vers laquelle
s’élance comme des colonnes toutes les actions individuelles.
Blondel s’approprie le concept vinculum et l’intègre à sa métaphysique pour en faire une
pierre d’achoppement dans la construction de son système intégral. Le vinculum renvoie aux
thèmes néotestamentaires ‘’Sel de la terre’’ ( ), ‘’levain de la terre’’ ( ), ingrédients
immergés dans des matières qu’ils soulèvent. Ces thèmes sont le fondement d’une
ecclésiologie communionnelle qui s’imposera au Concile du Vatican II. En effet, par
métaphore, le sel de la terre, le levain de la pâte représentent le Christ qui anime de l’intérieur
son église et lui donne vigueur tout en faisant le lien (mystique ou spirituel) entre les membres
du corps. Cette union mystique qui connaît deux moments : l’anabase, le lien mystique entre
croyant et le Christ, la catabase, le lien mystique entre les membres appartenant au même
corps, requiert la coopération de ces derniers pour que leurs actions portent du fruit en
abondance33 (ex opero operantis).
C’est lui qui réalise l’unité de la personne malgré ses différents états existentiels ; C’est aussi
lui qui réalise l’unité de toutes les actions humaines en vue d’un projet commun.
33 Cf. Jn 15, 1-3
12
Le lien substantiel au sein de la matière composée énoncé par Leibniz dans son dialogue avec
Des Bosses, Blondel le transpose au sein de l’humain pris individuellement et au sein de la
race humaine, faisant ainsi de ce lien substantiel, le principe de solidarité et de communion. Il
permet l’unité de deux substances différentes, comme dans le cas de la transsubstantiation où
se rencontrent le pain et le vin d’une part et la nature humano-divine de Jésus d’autre part.
Blondel récupère la théorie leibnizienne du «vinculum» pour expliquer comment la personne
humaine demeure la même malgré les différents états qu’elle traverse, donc responsable de
tous les actes qu’elle pose. Les actions, dans la perspective blondélienne, ne seraient pas
éparses, c’est-à-dire posées cote-à-côte comme des briques sans lien de continuité. Le
Vinculum constitue le chaînon qui les relie entre elles.
Pour Blondel, héritier du christianisme, l’action est «la participation» de l’être second à
l’acte premier de création. Ce qui fait de l’être second un co-créateur. On comprend pourquoi
la thèse française de Blondel ne pouvait se compléter que par et dans la thèse latine : «Une
énigme historique, le Vinculum Substantiale d’après Leibniz et l’ébauche d’un réalisme
supérieur »34 qui traita du Vinculum, principe de synergie et de continuité entre le premier
acte créateur et les actions postérieures des co-créateurs.
Le vinculum comme principe d’unité des êtres entre eux et enfin comme ce par quoi les deux
bouts de la création se trouvent réunis, Blondel le réalise, dans sa vie, dans le rôle de
modérateur et de médiateur qu’il a assumé dans le conflit entre théologiens et philosophes-
rationalistes au cours de la crise du modernisme.
VIII- HYPOTHÈSE : DE L’ACTION INTÉRIEURE À L’ACTION EXTÉRIEURE ; ACTION, SYNTHÈSE DE
l’ÊTRE
L’Action qui est aussi Pensée se découvre passivement par la conscience et l’homme ne sait
pas d’où elle vient ni où elle va. Elle vient en l’homme d’un ailleurs qui laisse songeur. Dans
son extase (sortie) elle peut être amenée à collaborer ou à être en conflit avec d’autres actions.
Le vinculum blondélien permet à la monade leibnizienne, (l’action individuelle chez Blondel),
de franchir les limites qui l’isolaient de l’altérité. Il cimente les actions des hommes pour faire
34 BLONDEL, Maurice (1861-1949, Une énigme historique, Le Vinculum Substantiale d’après Leibniz et
l’ébauche d’un réalisme supérieur, 2° édition, Beauchesne, Paris, 1930
13
d’eux des citoyens du monde embarqués dans une même aventure, fondant de la sorte l’action
politique. L’action blondélienne tends vers une réalisation, selon une loi que Blondel appelle
la « Normative »35, interne à chaque étant. Par elle les actions individuelles sont orientées vers
la réalisation d’un objectif ou d’un destin commun grâce à la synergie et à la complémentarité
des actions individuelles. Le monde entrevu de la sorte par Blondel est à l'instar de Leibniz,
une harmonie. En effet, le monde leibnizien n'a de sens que « s'il se rattache à une dimension
qui n'est pas inscrite en lui-même »36 .
L'Action considérée à l’état brut pouvait être assimilée à la monade leibnizien. Il fallait à
Blondel démontrer qu’elle est soumise à un déterminisme, la Normative, qui la conduit à faire
toute chose nouvelle, selon un Exemplaire, un Modèle ou Norme. Et la spécificité de cette
Normative est de tout récapituler par une démarche d’unification et de solidarisation. Le
vinculum, « une tentative sérieuse de la part de Leibniz pour redresser, à la fin de sa vie, son
idéalisme et l'orienter vers un réalisme supérieur »37, jouera le rôle du lien dynamique et
synergique entre les différentes étapes de l'action. Les notions de cocréation, de coaction, de
coopération, interaction, communion, ne sont possibles que par ce lien interpersonnel sans
lequel les hommes et leurs actions demeurent isolées, compartimentées à l'instar du sens que
donnait Leibniz de la monade38.
Il y a un sens analogique entre l'Action et le vinculum substantiale de telle sorte que l'action
est ce par quoi il existe un lien mystérique entre les hommes
Selon Faber, « Du fait même de la pluralité humaine, dans le milieu de laquelle elle s’inscrit,
toute action a des répercussions dans l’ordre éthique »39
. Elle contraint le sujet à articuler
moyen et fin40
d’où cette permanente question d’ordre éthique : « la fin justifie-t-elle les
35 BLONDEL, Action, t.1, (édition numérique), op.cit., p.238
36 BRUN, Jean, Vinculum substantiale, in "la dramatique de la modernité", p.129
37 VAN RIET, Georges, Maurice Blondel, le lien substantiel et la substance composée d'après Leibniz, in Revue
Philosophique de Louvain, 1972, Volume 70, Numéro 7 p. 488
38 Cf. Alain LETOURNEAU, Maurice Blondel, les deux thèses, op.cit., p. 202.
39 COLLECTIF, L’action dans la philosophie contemporaine, , éditions Ellipses, Paris, 2004, p. 170
40 COLLECTIF, L’action dans la philosophie contemporaine, op.cit., p. 177
14
moyens ? » ; y’a-t-il une proportionnalité entre les moyens et la fin poursuivie ou les causes ?
A quel moment parle t-on du mal, du péché? Ces questions nous permettront d’aborder les
thèmes de la Normative et de Norme par rapport auxquels le Bien et le Mal peuvent être
définis. Pour Maurice Blondel en effet la ‘’Normative’’est « une science de l’universelle et un
rattachement ontologique de nos êtres à l’être»41
parfait, norme, référence et modèle de toute
action. L’adhésion à cette norme ou l’effort de rattachement de l’être à l’Être est une
participation libre de l’être, ce qui n’amoindrit pas ce dernier, au contraire. C’est une donation
de l’être second à l’Être pour un plus être. C’est un «holocauste en esprit et en vérité qui
réalise et consacre en lui l’excellence de son être en le faisant participer, sans le confondre,
avec la Perfection subsistante »42
.
L’action quelle qu’elle soit a des répercussions sociales. Elle vient organiser ou désorganiser
quelque chose en s’inspirant, consciemment ou non des « Idées, valant pour des normes, des
étalons de mesure, de nature à inspirer des règles de conduite »43
. Notre recherche en cette
matière veut être une analyse concrète sur les conditions de réalisation de l’être dans sa
tension entre un terme qui sert de norme (la volonté voulante) et un autre qui est une forme
d’ersatz de la première (la volonté voulue) pour montrer que l’action est ce par quoi l’être fini
tente de retrouver le chemin de retour vers sa source principielle et à qui elle veut
correspondre. Tous les êtres participeraient par leurs actions à cette quête nostalgique de leur
origine par l'art, la politique, la contemplation...
Par la métaphysique blondélienne, l’on touche ce que l’humanité partage en commun, la
raison. Phénoménologique, elle est aussi immanente de par le domaine d’intervention de
l’action éclairée par la raison qui peut se satisfaire d'elle même, prendre sa source dans l'être
et y finir sa course.
L'analyse de L'Action se fera à la lumière du vinculum autour des notions diverses qu’on peut
considérer comme une terminologie spécifique à Blondel. Il s’agit de transcendance,
immanence, normative, responsabilité, coaction, cocréation, participation, coopération,
41
BLONDEL, Maurice, l’Être et les êtres, op.cit., p.464
42 Ibid.
43 COLLECTIF, L’action en philosophie contemporaine, op.cit., p. 148
15
médiation, conciliation, union, synthèse, solidarité, communion, transfiguration,
transsubstantiation, panchristisme.
Loin d’aborder un sujet qui ne serait pas de la préoccupation de l’homme, nous partirons à la
suite de ce dernier, sur ses chantiers battus pour montrer avec Blondel que son engagement, à
chaque instant est le résumé de sa vie : un homme en voie de se réaliser, un être fini en quête
de l’infini, un homo viator44. En effet, pour Maurice Blondel, toutes les actions des hommes
sont marquées par un inachèvement essentiel, en attente d’un sens à venir qui pourtant les
habite déjà à leur insu45
.
Pouvant certes figurer dans la rubrique de la Philosophie des religions, par certains des thèmes
abordés, l’analyse de l’action de Blondel est une démarche intellectuelle et rationnelle qui,
veut montrer que toute action quelle qu’elle soit est un fidèle miroir de l’homme écartelé entre
deux pôles et appelé à composer avec les autres. Notre travail veut dévoiler l’homme à travers
son action comme un être fini habité par l’infini dont l’action quoique limitée dans le temps et
l’espace a souvent la prétention de se pérenniser par la mémoire, expression de l’éternité en
lui. Enfin, nous démontrerons avec Blondel que la vie de l’homme n’a de sens que si elle est
adossée au principe médiateur et d’unité qui l’habite et le fait sentir si tant ses limites et son
incomplétude d’être.
L’Action, l’œuvre majeure de Blondel qui, en son temps, avait pour but « de maintenir le
rapport de la philosophie au christianisme, mais sans compromettre l’identité de la
philosophie et l’autonomie de la raison »46
sera son appui pour asseoir une telle métaphysique
générale qui interroge la raison pour comprendre l’être à partir de l’action et inversement.
Cette métaphysique qui se veut intégrale ne pourrait laisser aucun secteur de la connaissance
inexploré. Elle revisitera les conditions d’une démarche scientifique pour fonder une théorie
de la connaissance qui pourrait laisser une chance à l’inexpliqué, au mystère. Car comme le
dit, Yvette Périco, un de ses commentateurs, « la vie humaine n’est point tout entière
circonscrite dans ce que la science positive ou la spéculation rationnelle peuvent exactement
déterminer : un inconnu, peut-être un inconnaissable, semble nous envelopper et nous
44Cf. Gabriel, Marcel, Paris, Aubier, 1945
45 Cf. BLONDEL, Maurice, L’Être et les êtres, op.cit., p.321
46BROUILLARD, Henri, Blondel et le christianisme, in COLLECTIF, L’Action, Introduction générale, étude
approfondie du sujet, éditions Sedes, coll. impulsion, Paris 2007, p. 94
16
pénétrer »47
. L’action banale aussi soit-elle, enveloppe un mystère qui ne peut être dévoilé
entièrement. Car on a beau remonter à sa source, il est impossible à la raison d’en déterminer
de façon certaine son principe.
Maurice Blondel ne contournera pas l’obstacle parce qu’il est insurmontable. Bien plus, il ose
porter son analyse sur le seuil énigmatique et polémique entre la foi et la raison, affrontant de
front «les questions ultimes qui se posent à tout homme (…): le sens de cette vie, le bien et le
mal, la souffrance, la mort, l’au-delà »48
pour lesquelles la Raison Reine, Mère de la
Modernité, n’apporte pas toujours toutes les réponses. Questions ultimes qui sont à l’origine
de la crise moderniste parce que pour les uns, (philosophes rationalistes) seule l’immanence
est gage de scienticité et d’objectivité, alors que pour les théologiens, seule la révélation
révèle à l’homme la pure vérité, vérité qui n’est pas toujours accessible à la raison. Les uns
ont opté de ne pas songer à l’impuissance de la Raison de tout élucider, d’autres partent du
principe que seule la foi donne de la consistance à ce qui est.
La métaphysique blondélienne, sans prétendre suppléer aux sciences positives et humaines
dans la recherche des réponses définitives, voudrait plutôt apporter sa complémentarité. Son
domaine « ne recouvre pas ce en quoi l’Être est manifeste au monde…(Mais) ce en quoi
l’Être est radicalement caché au monde: c’est-à-dire le domaine de son intimité »49
. Son objet
à son terme « demeure objet de désir. Et la dernière démarche de la raison, c’est de
reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent »50
. Ainsi l’inquiétude de
l’action humaine trouvera un début d’explication qui demeure pour l’instant dans l’ordre du
mystère.
L’action blondélienne s’étend entre cette frontière ténue, l’expliqué et l’inexpliqué,
l’immanence et la transcendance, pour établir la source de l’action, point nœudal de toutes les
opérations de l’homme, dont celles plus intérieures comme la pensée, la volonté, le désir, la
contemplation, la création artistique, et l’organisation de la société. 47
PÉRICO, Yvette, Maurice Blondel, Genèse de sens, Paris, Editions Universitaires - Philosophie Européenne, 1991, p. 6
48 COINTET (De), Pierre, Exigences philosophiques du dialogue religieux, in communication donnée au
XXVIII° Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française, Bologne, septembre, 2000,
p.1
49 GENUYT, F. M., Le mystère de Dieu, Tournai, Desclée, 1963, p.10
50 Ibid., p.9
17
La démarche de Blondel est la démarche d’un humble chercheur qui se laisse trouver par les
réponses aux questions qu’il se pose. Sa démarche est une nouvelle méthode épistémologique
qui propose l’humilité comme « condition de connaissance, fruit et germe de
connaissance…ouvrant l’esprit et purifiant le regard. » 51
Elle « implique le renoncement à la
volonté propre»52
, « la purification de l’égoïsme »53
. Pour ce faire le chercheur doit « se
placer en deçà de l’intelligence et de la volonté, à leur source commune, dans ce dynamisme
originaire de l’être où elles puisent leur force d’agir »54
. L’humilité ici est au service de la
vérité au point de nécessiter que l’on se dépouille de « l’autolâtrie » naturelle de son
intelligence pour éviter de se faire le centre des choses55
. Sa méthode prend aussi en compte
« le tout de l’homme », évite des «procédés d’investigation que comportent les recherches
expérimentales et les lois positives de la nature »56 qui poursuivent l’être où il ne peut être
atteint57
.
L’analyse complète de l’action par Blondel l’amène à s’intéresser à la corrélation entre
l’action extérieure et l’action intérieure (tantôt pensée, tantôt contemplation), moment ultime
et noble de l’être de raison58
et expression de la finitude de l’être en recherche d’un plus être
que lui. Blondel pose ainsi le problème de la consistance des êtres dont la volonté ne coïncide
pas toujours avec l’être, ni l’essence avec leur existence.
En tant que science intégrale, la métaphysique rationnelle blondélienne « reconnaît et exerce
toutes les possibilités de la raison et (…) en parcourt tout le champ, un champ qui n’a
d’autres limites que celle du tout. Elle examine le monde, y compris la matière dans
l’intelligibilité de la pensée cosmique »59
afin d’établir une cohérence entre l’être, la pensée et
51
COINTET (De), Pierre, Exigences philosophiques du dialogue religieux, op.cit., p.3
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Cf. COINTET (De), Pierre, Exigences philosophiques du dialogue religieux, op.cit., p.3
56BLONDEL Maurice, l’Être et les êtres, op.cit., p. 27
57 Ibid.
58 Cf. COLLECTIF, L’action en philosophie contemporaine, op.cit., pp. 118-119
59 COLLECTIF, Maurice Blondel et la philosophie française, op.cit., p. 296
18
l’action pour n’en faire qu’un seul organisme60
. Dans son entreprise, la raison découvre ses
propres limites et la transcendance devient alors une hypothèse plausible, voire un recourt
possible. L’action rationnelle devient alors une médiatrice entre l’immanence et la
transcendance. L’action fait exploser les différents compartiments pour les mettre en relation
les uns avec les autres. Les compartiments monadiques que sont l’immanence et la
transcendance ne sont plus des monades fermées, autonomes, elles ont besoin les uns des
autres, bien plus, elles communient entre elles parce qu’elles appartiennent à une même
substance grâce au vinculum.
IX- METHODE DE TRAVAIL
L’objectif de notre thèse est de démontrer que l’action est une synthèse de l’être. Par
synthèse, nous entendons l’instantané que l’être présente de lui, dans une action aussi minime
soit-elle, comme être unifié malgré le morcellement et l’étalement dans le temps et l’espace
de ses états de conscience. Cette unification n’est possible que par un principe que Leibniz a
appelé le « Vinculum ». L’action joue cette fonction unificatrice de l’être chez Blondel.
Notre méthode usera tout à la fois de la méthode d’immanence pour montrer les limites de
l’action et partant de l’être secondaire qui nécessite pour sa survie d’un plus que lui. Cela
nécessitera de remonter jusqu’au principe de l’action. Il nous faudra aussi chercher la cause
finale de toute action et les conditions de son achèvement. Notre démarche veut en déduire
une métaphysique communionnelle qui rende compte de la destinée commune des êtres et
notamment de la synergie des actions individuelles.
La métaphysique blondélienne toute ancrée dans l’étant en quête de son principe ne tombe pas
des nues. Bien que sa thèse, par son titre, introduisait un nouveau concept dans le vocabulaire
philosophique de son époque, Blondel ne venait pas faire œuvre nouvelle. C’est un homme de
son temps, formé à la discipline et à la tradition des anciens, qui puisera abondamment dans le
vivier que lui a légué sa formation universitaire et sa culture de tradition chrétienne catholique
Nous mettrons sa vision ontologique en confrontation avec celle de certains penseurs qui
avaient les mêmes préoccupations.
60
Ibid., p. 296
19
Par sa méthode d’immanence, Maurice Blondel veut asseoir une science intégrale qui prenne
en compte le tout de l’homme, l’expliqué comme l’inexpliqué, le phénomène comme le
noumène. Comme il le dit, « on ne peut pas exclure la métaphysique que par une critique
métaphysique... (Et) il serait donc étrange qu’il fut scientifique d’exclure ce qu’il n’est pas
scientifique d’admettre: comme si la preuve négative n’était point, par elle-même, plus
difficile à établir que la preuve positive »61
. Sa méthode n’est pas pour cela dépourvue de
rigueur scientifique car il propose que les questions métaphysiques soient « confrontées avec
les profondes exigences de la volonté, (afin) d’y découvrir, si elle s’y trouve, l’image de nos
besoins réels »62
.
Au regard des objectifs que nous nous sommes fixés, notre travail s’étalera sur trois parties:
Dans la première partie, nous analyserons la méthode blondélienne et les problèmes
qu’engendre le recours à la terminologie de Leibniz dans sa thèse latine. Dans une deuxième
partie, nous ferons un parcours rétrospectif de certains systèmes intégraux dont Blondel est
tributaire et de ce qu’on peut appeler les racines philosophiques de l’action parmi lesquelles
ses héritages asiatiques, helléniques, français, judéo-chrétiens, et allemands. Dans la
troisième partie, nous analyserons le concept de l’action à la lumière du vinculum, sa
fonction chez l’être pensant d’une part, sa fonction unitive entre les êtres, son rôle médiateur,
de principe d’unification et de solidarisation d’autre part. Enfin, en considérant la contingence
des êtres, nous analyserons les conditions de leur achèvement.
XI- CONCLUSION
Maurice Blondel tente, dans l’écriture de ses deux thèses une plaidoirie pour la prise en
compte d’une métaphysique intégrale centrée sur l’action de l’être « en tant que celui-ci
apparaît de façon problématique dans le monde ”63
. Établir une science métaphysique
intégrale de l’être, c’est affirmer l’insuffisance de la science à donner toute seule sens au
monde. C’est aussi reconnaître la complémentarité entre la science et la métaphysique de telle
sorte que chaque partie constitue un seuil pour l’autre
61
BLONDEL, Maurice, l’Action, op.cit. p.390
62 Ibid., p.391
63 GENUYT, F. M., Le mystère de Dieu, op.cit., p.10
20
Les deux thèses constituent les deux pendants de l’être : l’immanence et la transcendance, sa
finitude et son infinitude, sa matérialité et sa spiritualité, sa temporalité et son éternité.
L’écartèlement de l’être entre les deux pôles est source pour lui de l’inquiétude qui lui révèle
son incomplétude ontologique et sa contingence. Toutefois, cette contingence est une
opportunité d’ouverture vers Autrui et l’infini. Ce désir de s’ouvrir vers l’Autre, de connaître,
de progresser, l’inquiétude de mourir et de tomber dans l’oubli, les rites de commémoration
des disparus par des monuments funéraires pour faire mémoire sont l’expression de quelque
chose en lui qui se refuse à mourir. Ce quelque chose comme un horizon l’attire
inexorablement vers un idéal, une béatitude et une plénitude de sens. Cet horizon est
équivoque et problématique. Mais il se fabrique dans le présent immédiat, lieu où l’être se
réalise et où l’infini vers lequel l’être contingent tend n’est pas absent. Maurice Blondel nous
propose dans l’action une métaphysique de l’espérance comme fondement de la société.