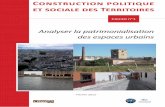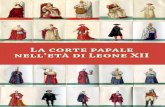Service européen pour l’action extérieure et printemps arabes
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Service européen pour l’action extérieure et printemps arabes
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
1
Samuel BAYLET
Du Service européen pour l’action extérieure aux printemps
arabes, quelles reformulations de la politique européenne de
voisinage dans l’espace euro-méditerranéen ?
Etudes des relations bilatérales de l’Union européenne avec la Tunisie et l’Egypte
Mémoire de fin d’études
Parcours Magistère Relations internationales et action à l’étranger
3e année
Préparé sous la direction de M. Marc GERMANANGUE
Université de Paris 1 PANTHEON-SORBONNE
Septembre 2014
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
3
SOMMAIRE
INTRODUCTION ................................................................................................................................. 5
PARTIE I ............................................................................................................................................................................... 9
CHAPITRE I : MISE EN PERSPECTIVE, DU PARTENARIAT EUROMED A LA PEV ........................ 10
1. Le cadre multilatéral ou l’absence d’une véritable politique étrangère européenne ....................................... 10
2. La politique européenne de voisinage et la bi-latéralisation du partenariat euro-méditerranéen ................... 13
3. Le dilemme sécurité-démocratie ....................................................................................................................... 16
CHAPITRE II : REFORME INSTITUTIONNELLE, LE SEAE VERS UNE POLITISATION DE LA PEV ?
............................................................................................................................................................... 21
4. La genèse du SEAE vers une redéfinition des relations extérieures de l’Union européenne ? ......................... 22
5. Vers une « communautarisation » de la diplomatie des droits de l’Homme ..................................................... 28
CHAPITRE III : LES PRINTEMPS ARABES - L’UNION EUROPEENNE FACE AUX BOULEVERSEMENTS
POLITIQUES ........................................................................................................................................... 34
6. Les bouleversements des printemps arabes et la réaction de l’Union .............................................................. 35
7. Vers un dépassement du dilemme « démocratie-stabilité » ? ............................................................................ 41
PARTIE II ........................................................................................................................................................................... 50
CHAPITRE IV : LA PEV, UNE POLITIQUE ADAPTEE AUX PROCESSUS TRANSITIONNELS ? .......... 51
8. La PEV – Du cadre politique au cadre programmatique : La réforme de l’Instrument européen de voisinage :
vers un instrument plus politique et plus flexible ? ............................................................................................... 52
9. Politique commerciale et Politique migratoire. ................................................................................................ 59
CHAPITRE VI : L’EVOLUTION DE LA PEV EN TUNISIE ET EN EGYPTE : DEUX TRAJECTOIRES
TRANSITIONNELLES, DEUX PEV.......................................................................................................... 63
11. L’UE la Tunisie – Un dialogue politique approfondi et une coopération riche ......................................... 64
12. La politique européenne de voisinage en Egypte et le dilemme démocratie-sécurité ..................................... 71
CONCLUSION ........................................................................................................................................ 77
TABLE DES MATIERES ......................................................................................................................... 81
BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................................... 83
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
5
INTRODUCTION
L’espace euro-méditerranéen constitue un objet d’étude complexe et riche qui peut être abordé sous
différents angles. La diversité des relations euro-méditerranéennes est un élément intrinsèque à cet
espace multiculturel qui a toujours été travaillé par des échanges intensifs, des rivalités économiques,
des conflits, des relations de domination et de dépendance, que ce soit en méditerranée occidentale ou
orientale. Ainsi le processus d’intégration communautaire, le développement d’une politique
européenne de sécurité commune et l’émergence d’un nouvel acteur, l’Union européenne, sur la scène
régionale dans un contexte postcolonial de redéfinition des équilibres géopolitiques vont entrainer la
naissance d’une nouvelle forme de coopération. Cette coopération, qui prend corps à travers l’adoption
de cadres économiques et politico-institutionnels, censés matricer au niveau régional et bilatéral la
politique de l’Union européenne à sa périphérie, ne va cesser de se redéfinir à l’aune des changements
internes à l’UE et de l’évolution du contexte géopolitique.
Dans un premier temps, la constitution d’un espace économique intégré au nord de la méditerranée va
amener la communauté économique européenne à formuler et redéfinir ses relations avec les pays
méditerranéens. C’est la naissance de la Politique Méditerranéenne Globale dans les années 1970 qui se
décline à travers l’adoption d’accords commerciaux et de coopération avec les Pays Tiers
Méditerranéens (PTM), avec déjà une différenciation entre les pays du Nord (Malte, Chypre, Grèce,
Turquie), où l’adhésion à la communauté et à l’Union douanière est envisagée, et les pays du Sud1où il
s’agit d’établir des accords préférentiels selon les secteurs2. L’adhésion de l’Espagne et du Portugal dans
les années 1980, le renforcement de l’intégration économique, la marche vers la monnaie unique, et le
processus d’élargissement à l’Est après la chute du mur de Berlin vont pousser l’Union européenne à
redéfinir le cadre de ses relations avec les PTMs. En 1990 la Commission élabore la politique
méditerranéenne rénovée, mais c’est surtout avec l’adoption du Processus de Barcelone en novembre
1995 entre les 15 Etats membres et les 12 PTMs3 que les relations euro-méditerranéennes vont s’inscrire
durablement dans l’agenda politique européen.
Si la composante économique reste dominante, il s’agissait de créer une zone euro-méditerranéenne de
libre-échange qui regrouperait plus de 800 millions d’habitants. L’UE va élargir le champ de sa
coopération au domaine politique à travers l’objectif ambitieux d’instaurer une zone de prospérité et de
paix. Il ne faut pas, de manière rétrospective, sous-estimer la portée du Processus de Barcelone. Dans
1 La Lybie n’est pas concernée par ces accords, Israël bénéficiera d’un statut particulier. 2 Il convient de différencier le secteur industriel qui bénéficiait alors de concession du secteur agricole où les barrières tarifaires
pour l’entrée sur le marché européen restaient assez élevées. 3 Algérie, Chypre, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, Autorité palestinienne.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
6
un contexte de relance du processus de Paix au Moyen-Orient et de promotion du modèle d’intégration
européenne, le Processus de Barcelone ouvrait un nouvel espace de coopération politique entre les deux
rives de la Méditerranée. Mais le Processus de Barcelone c’est aussi l’émergence d’un nouvel acteur -
l’Union européenne - sur la scène régionale. C’est un élément fondamental dans une région où les
relations sont encore imprégnées de la domination coloniale européenne. Au niveau régional,
l’émergence de l’UE comme un acteur politique à part entière s’inscrivait dans une démarche qui
correspondait à institutionnaliser ses relations avec des «blocs régionaux» à travers la création
d’embryons institutionnels comme le Conseil euro-arctique de Barents, le Conseil des États de la mer
Baltique, la Coopération économique de la mer Noire et des organisations régionales comme l’Initiative
centre-européenne (ICE), le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est et enfin le Processus de
Barcelone. Il s‘agissait alors pour l’UE de « créer ou de soutenir l’émergence à ses marges des
institutions auxquelles elle est partie prenante » 4. Ce passage d’une coopération essentiellement
économique à une coopération plus large et plus institutionnelle (coopération sectorielle, coopération au
développement, développement des échanges culturels, gestion des flux migratoires) reflète la
redéfinition des relations euro-méditerranéenne sur le plan multilatéral. Sur le plan interne le Processus
de Barcelone est né d’une volonté de rééquilibrer les relations extérieures de l’UE avec le Sud dans un
contexte d’élargissement à l’Est.
L’étude du régionalisme euro-méditerranéen et de la dimension multilatérale du Processus de Barcelone,
appelé aussi Partenariat euro-méditerranéen, pourrait faire l’objet d’un travail spécifique. Mais notre
approche se focalise sur le renouveau, à partir des années 2000, du bilatéralisme dans les relations euro-
méditerranéennes. C’est dans cette perspective que nous avons voulu traiter de la Politique Européenne
de Voisinage (PEV) élaborée au début des années 2000.
Concrètement, la politique européenne de voisinage se définit par l’adoption de cadres politico-
juridiques – les Accords d’Association, les Plans d’Action - qui ont vocation à structurer les relations
entre l’UE et ses partenaires. Dans le cadre de ces accords, l’UE va développer toute une série de
politiques – économique via des accords commerciaux, migratoire avec des accords sur la gestion des
flux migratoires et la facilitation de visa, culturelle avec le développement de programmes d’échange et
de coopération universitaire, sectoriel avec des programmes dans le domaine de l’énergie, de la gestion
de l’eau ou encore des transports – qui doivent matérialiser le rapprochement de l’UE avec les autorités
des pays partenaires. En appui à ces différentes politiques, la PEV se traduit aussi par un transfert
financier et technique à travers la mise en œuvre de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat
(IEVP). Ce qui caractérise donc la PEV en premier lieu c’est la diversité des politiques déployées. En
4 Le Gloannec Anne-Marie, « Chapitre 18. La politique de voisinage », in Renaud Dehousse , Politiques européennes Presses
de Sciences Po « Les Manuels de Sciences Po », 2009 p. 369-388.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
7
d’autres mots, la politique européenne de voisinage est une politique globale. Cette transversalité fait de
la PEV un objet d’étude particulièrement riche et stimulant qui favorise une approche pluridisciplinaire
mais elle illustre aussi toute la difficulté d’appréhender l’évolution de cette politique fondamentale pour
l’Union européenne. Chacune des politiques développées au sein de la PEV pourrait faire l’objet d’une
thèse. La première difficulté consiste donc à quadriller notre approche afin de bien définir notre objet
d’étude et le fil conducteur de notre exercice.
Dans cette optique, le point de départ de notre étude est justement d’évaluer comment la formulation de
cette nouvelle forme de coopération avec les pays tiers méditerranéens crée un espace de politisation
des relations extérieures de l’Union européenne, qui tend à s’affirmer comme un acteur diplomatique à
part entière au niveau bilatéral. Le fil conducteur de notre mémoire est d’évaluer la capacité de l’Union
européenne à influencer ses partenaires sur le plan politique via la promotion de normes fondées sur
l’Etat de droit, la démocratie et le respect des libertés fondamentales. Si la PEV est par nature
multidimensionnelle, son objectif fondateur vise à instaurer aux frontières de l’Europe un « cercle
d’amis » partageant des valeurs réciproques. La PEV a donc une visée performative. C’est dans cette
visée qu’il faut comprendre selon nous le passage d’une coopération essentiellement économique tout
au long des années 1980 et 1990, à une coopération plus politique à partir des années 2000. Et c’est dans
cette perspective que notre première partie s’attachera à étudier le processus de politisation de la
politique européenne de voisinage à la lumière, non seulement des changements institutionnels internes
avec l’adoption du Traité de Lisbonne et la création du Service européen pour l’action extérieure
(SEAE), mais aussi des bouleversements politiques entrainés par les printemps arabes.
Sept ans après le lancement de la PEV, les printemps arabes ont révélé avec force les limites de cette
politique telle qu’elle avait été conçue au début des années 2000. Il nous faudra donc développer notre
analyse à partir des éléments qui sont à l’origine même de l’impact limité de la PEV sur le plan politique.
Ainsi nous chercherons à démontrer d’une part, que le cadre institutionnel et le processus de
programmation de l’aide ne sont pas propices à une politisation des instruments de la PEV et, d’autre
part, que le dilemme démocratie-stabilité a subordonné l’objectif de promotion des valeurs
démocratiques à une approche avant tout sécuritaire. Ce faisant, nous essaierons de montrer que c’est la
cohérence même des politiques qui façonnent la PEV qui est en jeu. Partant de là, il s’agira dans un
premier temps, d’étudier l’apport du SEAE en termes de coordination et de cohérence des politiques
extérieures. L’idée étant de partir d’une approche institutionnaliste, qui s’appuie sur l’émergence de
nouveaux dispositifs comme le SEAE ou le renforcement des délégations de l’UE, pour évaluer la
capacité de l’UE à reformuler les objectifs de la PEV via une hiérarchisation des priorités politiques. Si
la littérature s’est avant tout penchée sur l’impact du SEAE et du Traité de Lisbonne sur la Politique de
Sécurité et de Défense Commune (PSDC), il s’agît plutôt d’évaluer l’apport du SEAE dans le cadre
d’une politique moins soumise aux logiques gouvernementales. La PSDC qui représente la composante
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
8
militaire, le « hard power » de la politique étrangère de l’UE, constitue par définition un objet d’étude
privilégié à l’heure d’évaluer la politisation des relations extérieures de l’UE. Néanmoins notre objectif
est plutôt d’analyser justement comment le SEAE, face aux défis historiques induits par les printemps
arabes, arrive à politiser une politique qui est restée cantonnée à la dimension économique et
programmatique. En ce sens, la réforme de la PEV engagée en 2011 à travers l’adoption d’une « stratégie
nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation » et d’un «Partenariat pour la démocratie et une
prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée» et le rôle de l’Union européenne dans les processus
transitionnels constituent une porte d’entrée intéressante.
La PEV étant par nature une politique différenciée, les relations bilatérales s’inscrivant dans un contexte
économique, géostratégique et politique spécifique selon chaque partenaire, les réponses de l’UE aux
printemps arabes ne peuvent pas être analysées de manière homogène. Ainsi, du «partenariat privilégié
» avec la Tunisie aux menaces de suspension de l’aide européenne en Egypte, en passant par le « statut
avancé » accordé au Maroc, l’évolution de la PEV n’obéit pas aux mêmes logiques. Ainsi, il nous
semble que l’étude comparée de l’évolution des relations bilatérales de l’Union européenne avec la
Tunisie et l’Egypte représente un point d’entrée pertinent pour appréhender le renouveau de la PEV. De
la recherche d’un compromis politique dans la construction du consensus en Tunisie à la « reformulation
successive de l’autoritarisme » en Egypte, nous chercherons à montrer comment l’Union européenne
s’est positionnée au regard de situations spécifiques évoluant rapidement.
L’objectif sous-jacent étant d’analyser dans quelles mesures l’UE a su se positionner comme un acteur
moteur des processus transitionnels, qui offraient la possibilité à l’UE de concrétiser la réorientation de
la PEV initiée en 2011. Aussi chercherons-nous à montrer comment en Tunisie l’UE a su déployer sur
le terrain tous les instruments de la PEV et jouer un rôle vecteur dans le processus de consolidation,
alors qu’en Egypte c’est plutôt la continuité qui tend à définir l’évolution des relations bilatérales. Mais
avant d’analyser les réalisations concrètes de la PEV, il nous faudra analyser de manière détaillée
l’évolution du cadre même de cette politique globale. Ainsi, nous reviendrons sur le processus de
programmation, la réforme de l’Instrument européen de voisinage, ses modalités de mise en œuvre, sa
flexibilité et son ouverture aux acteurs de la société civile. Pour être complet, nous nous focaliserons
aussi sur la politique économique et migratoire. Nous essaierons autant que possible de dégager des
ruptures mais aussi de montrer en quoi ces politiques non pas fondamentalement évoluées depuis les
printemps arabes.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
9
PARTIE I
Politisation des relations extérieures de l’UE : l’évolution de
la Politique européenne de voisinage du partenariat Euro-
méditerranéen aux printemps arabes.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
10
CHAPITRE I : Mise en perspective, du partenariat EUROMED à la PEV
1. Le cadre multilatéral ou l’absence d’une véritable politique étrangère européenne
Le processus de Barcelone est à la fois un projet à dimension régional et bilatéral, fondé sur une approche
transversale - coopération économique, institutionnelle, politique, sectorielle, culturelle - des relations
entre l’UE et ses partenaires du sud de la méditerranée. Le processus de Barcelone ou partenariat euro-
méditerranéen (Euromed) est le fruit de logiques de rééquilibrage des relations extérieures de l’UE entre
l’Est et le Sud5, voulues notamment par la France, l’Espagne et l’Italie et de logiques institutionnelles
et économiques qui reflètent la diffusion du modèle d’intégration régionale de l’UE. Etudier le
partenariat Euromed nécessite donc de clairement quadriller le champ d’application des travaux. La
dimension régionale n’est pas l’objet de notre mémoire, qui s’intéresse exclusivement aux instruments
déployés par l’UE dans le cadre bilatéral, celui de la Politique européenne de voisinage, sous l’angle de
la politisation des relations extérieures de l’UE. Pour autant, nous faut-il justifier la pertinence de ce
choix et expliquer en quoi la dimension régionale du partenariat Euromed ne constitue pas une porte
d’entrée pertinente pour étudier la politisation des relations extérieures de l’Union européenne.
L’objectif étant de montrer qu’au niveau multilatéral l’UE n’a pas été en mesure de s’affirmer comme
un acteur politique à part entière et s’est vite retrouvée marginalisée, dépassée dans un contexte
géopolitique extrêmement complexe et conflictuel.
1.1) L’échec du processus de Barcelone
Vingt ans sont suffisants pour dresser un bilan du processus de Barcelone et analyser ses réalisations. Il
a fallu moins de 15 ans pour que les pays de l’Europe de l’Est n’intègrent l’Union européenne, moins
de 20 ans pour que les six membres fondateurs de l’UE se dotent d’une structure institutionnelle durable
et supranationale, pour autant, en 20 ans de partenariat euro-méditerranéen, les progrès en matière
d’intégration économique régionale, d’institutionnalisation des relations et de création d’un «zone de
paix prospère» sont quasiment nul. Il existe un certain consensus sur l’échec du processus de Barcelone6.
En premier lieu l’échec du processus de Barcelone se traduit par l’incapacité de l’UE à répliquer la
méthode Monet afin de résoudre des conflits en faisant « s’assoir à la même table » les élites des pays
partenaires pour les faire converger par des solidarités de faits à travers l’intégration économique,
l’institutionnalisation du dialogue politique et l’approfondissement des relations dans plusieurs champs
de coopération. Et inversement, la dimension régionale et structurante du conflit Israélo-Palestinien a
bloqué les avancées du processus de Barcelone.
5 Moratinos Miguel Angel, « Barcelone, entre bilan et relance », Politique étrangère 3/ 2005 (Automne), p. 523-534 6 Moisseron Jean-Yves, « Vers la fin du processus de Barcelone ? », Confluences Méditerranée 4/ 2005 (N°55), p. 165-178.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
11
Le processus de paix au proche Orient étant un élément structurant du Processus de Barcelone7 (lancé
dans un contexte favorable de reprise des négociations, cf Accord d’Oslo), l’incapacité de l’UE et à
fortiori celle des Etats membres à promouvoir une reconnaissance et une normalisation des relations
Israélo-Palestinienne, constitue en quelque sorte le nœud gordien du partenariat Euro-méditerranéen. La
seconde intafada (2000), les opérations militaires successives israéliennes (opération Arc-en-ciel
(2004), opération pluies d’été (2006), opération plomb durci (2008), opération bordure protectrice
(2014)),) l’échec des négociations multilatérales, les tensions permanentes (blocus de Gaza,
construction d’un mur) ont continuellement entravé le Processus de Barcelone. Mais la dimension
conflictuelle de la méditerranée dépasse le conflit Israélien. La guerre en Irak, la guerre contre le
terrorisme, la montée de groupes extrémistes au Moyen-Orient et dans le Nord-sahel et aussi le
conflit du Sahara occidental sont autant de dossiers sur lesquels l’UE s’est retrouvée dépassée par
la dimension politico-militaire. Sur le dossier Irakien la désunion des Etats-membres va faire voler
en éclat la Politique Etrangère et de Sécurité Commune (PESC). Sur le Sahara occidental l’UE va
progressivement se cantonner à un rôle humanitaire tout en excluant ce dossier de ses relations
bilatérales avec le Maroc8.
Force est de constater que l’UE, n’a pas su réaliser l’objectif d’instaurer une « zone de paix et de
prospérité ». On ne peut pas critiquer l’ambition initiale du projet. En revanche on peut souligner
l’écart entre le discours et les réalisations et la faiblesse structurelle de l’UE dont la politique
extérieure, sur des dossiers aussi sensibles, reste fondamentalement limitée par les prérogatives des
Etats membres. En d’autres mots, si l’UE a su lancer des initiatives comme le Quartet9, le cadre du
processus de Barcelone s’est révélé inefficace sur le plan politique. C’est la puissance de l’UE à
jouer le rôle d’intermédiaire et d’influencer ses partenaires qui est remise en cause sur le plan
régional. Le glissement vers un renforcement du cadre bilatéral via la création de la Politique
européenne de voisinage est d’ailleurs, en quelques sortes, le fruit de cette incapacité à peser au
niveau multilatéral. Par ailleurs, comme nous le verrons, la réponse aux printemps arabes, s’inscrira
aussi dans un renforcement des partenariats au niveau bilatéral. Sur le plan économique les résultats
du processus de Barcelone sont aussi extrêmement limités. Malgré la multiplication des accords
régionaux, initiés en marge du Processus de Barcelone - Union du Maghreb Arabe (UMA), Greater
7 Même si au début le Processus de Barcelone n’a pas été conçu comme une initiative complémentaire aux accords d’Oslo, ni
comme un partenariat pour la paix, très vite il est devenu impossible d’éviter le conflit Israélo-Palestinien. 8 Aoun Elena, « L'Union européenne en Méditerranée », Politique européenne 1/ 2013 (n° 39), p.89. Par ailleurs l’ouverture du
marché européen aux ressources halieutiques du Sahara occidental dans le cadre des accords commerciaux (Accord de pêche
entré en vigueur en 2012 et renouvelé en 2014) au titre de la PEV est régulièrement critiquée par les ONG mais aussi par l’ONU
comme une atteinte au droit international. Voir notamment l’article : « L'UE viole le droit international au Sahara Occidental »,
Western Sahara Resource Watch, Mis à jour le: 25.10 – 2012. Par ailleurs en 2011 le parlement avait rejeté cet accord de pêche
en raison de la situation des droits de l’Homme au Sahara Occidental. 9 Sous la houlette de l’UE, initiative pour reprendre les pour parlers entre Israël et l’Autorité palestinienne.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
12
Arab Free Trade Area (GAFTA), Communauté des États Saélo-Sahariens (CEN-SAD), Accord
d’Agadir – le commerce infrarégional ne s’est jamais développé. Ainsi le Maghreb (Algérie, Maroc,
Tunisie) constitue-t-il l’ensemble régional le moins intégré au monde. Alors que les échanges
intrarégionaux s’élèvent à 64% dans l’UE, 48% dans l’ALENA, 15% dans le Mercosur, ils stagnent
à 3% dans les pays maghrébins10.
1.2) L’Union pour la Méditerranée, l’avènement de la coopération programmatique sans vision politique
Dans la perspective d’un échec sur les plans politiques et économiques, le processus de Barcelone s’est
progressivement replié sur la dimension sectorielle et technocratique de la coopération euro-
méditerranéenne. La dimension politique de l’Union pour la Méditerranée, créée en 2008, avec
l’ambition de relancer le Processus de Barcelone s’est très vite heurtée aux mêmes difficultés. En 2008,
toute les réunions de l’Union pour la Méditerranée, qui s’est substituée au cadre régional du
Processus de Barcelone, sont reportées en raison des événements à Gaza. Dans ce cadre, l’UpM a
redéfini ses prérogatives et son mandat en 201011 sur l’identification, la promotion et la coordination
de projet régionaux autour de six axes sectoriels : (i) la dépollution de la Méditerranée ;(ii) les
autoroutes de la mer et les autoroutes terrestres ; (iii) la protection civile ; (iv) Les énergies
renouvelables: le Plan solaire méditerranéen ; (v) l’enseignement supérieur et la recherche: l’Université
euro-méditerranéenne ; (vi) L’initiative méditerranéenne de développement des entreprises.
Il ne s’agît pas de porter un jugement négatif sur l’évolution de la coopération euro-méditerranéenne.
La réalisation de projets phares comme l’autoroute Trans-maghrébine ou le Plan solaire méditerranéen
ou de projets-pays, financés avec l’appui de la Banque européenne d’investissement, comme la
construction d’un parc éolien à Gabal El-Zeit en Égypt, la création du premier fonds de capital-risque
palestinien ou le projet d’assainissement au Liban12, sont des initiatives qui ont un impact concret et
sûrement à valoriser. Il s’agît de prendre acte du retrait du politique au profit d’un glissement vers une
coopération programmatique, vers une « Méditerranée de projets » pour reprendre l’esprit d’un rapport
parlementaire remis en 2013 au Président de la République française13.
10 Labaronne Daniel, « Les difficultés de l'intégration économique régionale des pays maghrébins », Mondes en développement,
2013/3 n° 163, p. 9 11 Adoption des statuts le 3 mars 2010 12 Voir le rapport de la BEI « Union pour la Méditerranée, Rôle et vision de la BEI » / voir aussi la liste des projets sur le site
de l’UpM 13 Rapport de Michel VAUZELLE remis au Président de la République « Avec la jeunesse méditerranéenne, maîtriser et
construire, notre communauté de destin », janvier 2013
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
13
2. La politique européenne de voisinage et la bi-latéralisation du partenariat euro-méditerranéen
2.1) L’émergence d’une politique européenne étrangère – La politique européenne de voisinage (PEV)
La Politique européenne de voisinage n’a pas vocation à remplacer le Processus de Barcelone. Elle
s’inscrit en complémentarité du cadre régional via l’approfondissement des relations de l’UE sur la base
d’Accord d’Association (AA) et de Plan d’Action (PA) avec ses partenaires du Sud. La PEV va pourtant
profondément redéfinir la nature même du partenariat Euromed au niveau stratégique (redéfinition des
objectifs) et géopolitique à travers un processus assumé de bilatéralisation de l’engagement de l’UE en
méditerranée. Et c’est justement ce processus qui nous intéresse en premier lieu dans la mesure où c’est
au niveau bilatéral que l’UE va pouvoir développer tout un ensemble d’instruments qui vont lui
permettre d’exprimer sa «puissance normative ».
Le recours à la notion de puissance normative nous fournit un cadre théorique pertinent à travers lequel
penser la politisation des relations de l’UE comme la capacité d’user de moyens non militaires pour
influencer et aligner ses partenaires sur ses objectifs et ses priorités. Afin d’éviter un débat étymologique
sur la notion de puissance nous partons d’une approche assez large de la puissance normative qui
recoupe celle de puissance civile et de soft power. Le choix d’exclure la composante militaire, la
Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC), de notre étude de la politisation des relations
extérieures peut être discuté. Il ne s’agît pas de nier l’importance de la PSDC dans l’affirmation de l’UE
comme un acteur « qui compte » sur la scène internationale et régionale. Seulement la Politique
européenne de voisinage constituant un cadre qui articule des moyens non militaires – accords
commerciaux, politique migratoire, instruments de coopération, assistance technique, etc. – nous faisons
le choix d’articuler notre approche autour de la notion de puissance normative. Par ailleurs, tenant
compte du fait que la PSDC relève encore fondamentalement de logiques gouvernementales, il semble
plus judicieux, à l’heure d’étudier l’UE comme un acteur en tant que tel, de partir d’instruments
obéissant d’avantage à une logique communautaire comme la politique commerciale ou la coopération
au développement14. La spécificité de la politique étrangère de l’Union européenne revient à penser la
puissance hors du cadre étatique et celui de la puissance militaire (ou traditionnel).
Avant de développer le lien bilatéralisation,- politisation, arrêtons-nous sur l’origine même de la
Politique européenne de voisinage. Il a souvent été question du contexte géopolitique pour définir la
naissance de la PEV. D’une part le processus d’élargissement et les nouvelles frontières à l’Est
poussaient l’Union à définir ses relations avec son « nouveau voisinage ». D’autre part dans un contexte
de guerre d’Irak, de guerre contre le terrorisme et de nouveaux défis sécuritaires tout autour du pourtour
méditerranéen, l’UE s’est vue contrainte de formuler une stratégie, une politique étrangère qui jusqu’à
présent ne s’était développée que dans le cadre de l’élargissement dans les années 1990. La PEV est
14 Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
14
donc née des nouveaux enjeux géopolitiques de ce début de XXIème siècle qui caractérisaient
l’aboutissement du processus d’élargissement et l’après 11 septembre. Mais il est un autre facteur qui
nous intéresse tout autant et qui se situe au niveau institutionnel. La PEV n’est pas seulement une
réponse de l’UE aux nouveaux défis, mais aussi la résultante du processus d’institutionnalisation de la
PESC avec le Traité d’Amsterdam et l’instauration d’un Haut représentant en la personne de Javier
Solana (souvent dénommé comme Monsieur PESC). Sur ce point, il semble que les recherches soient
relativement moins fournies et que l’émergence de la PEV n’ait pas été encore été assez analysée comme
le fruit d’un processus de communautarisation de la politique extérieure de l’Union européenne, qui
cherche à s’émanciper des politiques nationales en approfondissant ses propres relations bilatérales.
C’est la rencontre des éléments politiques externes et des mutations institutionnelles internes qui sont à
l’origine de la PEV, et de l’énonciation d’une « stratégie globale » qui dresse les enjeux, les objectifs et
définit les moyens pour y parvenir. En d’autres mots, la naissance de la PEV c’est la formulation d’une
politique étrangère, au fond assez classique, de stabilisation de la périphérie qui vise l’instauration d’un
« cercle d’amis » afin de consolider la sécurité interne. Mais c’est par la promotion de valeurs - Etat de
droits, démocratie, économie de marché - et de coopérations –, accords sur le contrôle des frontières,
sur la lutte contre le terrorisme, etc. – que la PEV fait de la « géopolitique avec des normes »15. En ce
sens, dès lors que la PEV s’inscrit dans un cadre régional hétérogène mais prend corps au niveau
bilatéral, on peut déjà faire le lien entre bilatéralisation et politisation.
2.2) Bi-latéralisation et politisation : les vecteurs de la puissance normatives
Dans le cadre de la PEV ou de la bilatéralisation du partenariat Euromed, l’Union européenne va se
doter d’un cadre juridico-politique à travers la signature d’Accords d’Association (juridique) et de Plan
d’Action (politique)16 qui va lui permettre d’institutionnaliser ses relations et de fixer les différents axes
de sa coopération. En quoi ce cadre est-il un vecteur de politisation et comment permet-il l’expression
de la puissance normative ? Partant de l’analyse de Ian Manners17 on peut distinguer six vecteurs de
promotion des normes: (i) la contagion qui définit l’attractivité du modèle européen ; (ii) l’information
ou le discours qui prend corps à travers les communiqués de presse, les communications de la
Commission et du Conseil de l’UE, etc ; (iii) les procédures qui tendent à institutionnaliser les relations
avec l’UE ; (iv) la transmission qui traduit les échanges de l’UE à différent niveaux ; (v) la présence
physique à travers les délégations de l’UE ; (vi) culturel à travers l’apprentissage et l’adaptation aux
normes. Dans cette perspective, la PEV apparaît comme l’instrument de la puissance normative de l’UE
15 Zaki Laïdi,op. cit., p.174 16 En 2004 des Plans d’Action ont été signé avec le Maroc, Israel, la Tunisie, l’Autorité Palestinienne, le Liban et la Jordanie.
Il faudra attendre 2007 pour que l’Egypte signe un Plan d’Action. L’Algérie ne dispose pas à ce jour de Plan d’Action. 17 Ian Manners, «Normative Power Europe:A Contradiction in Terms? », p.45
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
15
en ce qu’elle regroupe tous les vecteurs définis par Manners. L’institutionnalisation (vecteur iii) via
l’établissement de procédures étant un élément transversal consubstantiel à la mise en œuvre de la PEV.
Sur le plan programmatique la PEV se traduit par une assistance technique financière à travers des
instruments financiers spécifiques, MENA puis en 2007 l’Instrument européen de voisinage et de
partenariat (IEVP) obéissant à des procédures de programmation assez lourdes et chronophages : 1 -
définition d’un « Country Strategy Paper » (CSP) qui fournit une analyse de la situation du pays et
définit en conséquence les domaines prioritaires pour les cinq ou les sept années à venir ; 2 - élaboration
d’un Plan Indicatif National qui traduit les priorités identifiées dans le CSP en programmes budgétés ;
3 - élaboration de plans d’action annuels qui détaillent les projets qui seront développés. Sur le plan
économique la PEV se décline par différents types d’accords commerciaux, préférences commerciales
(baisse tarifaire), système paneuromédierranéen d’origine, des accords plus sectoriels de reconnaissance
des normes « accords de reconnaissance de produits industriels ». L’attraction du modèle européen,
l’intégration au marché européen, constituant les principaux éléments du soft power de l’UE (cf vecteur
contagion). En conclusion, «toutes les normes que l’Europe ne parvient à faire reconnaître au plan
mondial, elle s’efforcerait de les arracher sur le plan bilatéral »18 en développant les vecteurs de la
puissance normative dans le cadre de la PEV. Ce faisant l’UE est en mesure d’établir un dialogue
politique continu et stratégique avec ses partenaires, ce qu’elle n’était pas en mesure d’atteindre au
niveau régional.
Pour autant il ne suffit pas de montrer en quoi la PEV constitue l’expression de la puissance normative
pour justifier le lien entre politisation et bilatéralisation. Pour ce faire, il est indispensable de prendre en
compte l’asymétrie des relations qui offre à l’UE un levier d’action considérable au niveau bilatéral. La
puissance, quel que soit sa nature, suppose un rapport de force, l’un des partenaires disposant de plus de
ressources (matérielles et immatérielles, capacité d’attraction, etc.) et pouvant influencer les choix de
l’autre (de manière coercitive ou, comme pour la PEV par les normes). L’asymétrie des relations est au
fond une des conditions nécessaire à l’expression de la puissance normative de l’UE. Dans ce cadre la
nouveauté de la PEV n’est pas tant de fournir les instruments nécessaires à l’expression de sa puissance
normative (des Accords d’associations ont été ratifiés avant sa création) mais d’instaurer une forme de
conditionnalité politique positive19. Les Accords d’Association ratifiés dans le cadre du Processus de
Barcelone contenaient déjà une « clause droits de l’Homme ». Cependant, cette dernière était fondée
avant tout sur une approche négative de la conditionnalité, vue sous l’angle de la sanction. Alors qu’avec
la PEV, l’idée est d’inciter, de récompenser les Etats qui feront le plus de progrès. L’intégration au
marché intérieur, l’aide européenne, la coopération sectorielle représentant en quelque sorte «la carotte»
18 Zaki Laïdi op.cit, p. 165 19 Raffaella A. Del Sarto and Tobias Schumacher, “From EMP to ENP: What's at Stake with the European Neighbourhood
Policy towards the Southern Mediterranean?” European Foreign Affairs Review 10: 17-38, 2005.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
16
pour inciter ses partenaires à entreprendre des réformes structurelles, et plus spécifiquement sur le plan
de la consolidation de l’Etat de droits et du respect des libertés fondamentales. Si l’asymétrie est la
condition de la Puissance normative, la conditionnalité positive en est un moyen, un levier d’action. La
notion de moyen et de levier d’action nous amène au cœur de notre analyse, à savoir, dans quelles
mesures l’UE est effectivement parvenu à influencer ses partenaires ?
A ce stade de la réflexion, nous avons voulu montrer que le cadre bilatéral et que la PEV offre un espace
de politisation des relations extérieures (géopolitique par les normes, dialogue politique continu,
asymétrie des relations), mais nous n’avons pas encore abordé la capacité de l’UE a effectivement
réaliser le potentiel de la PEV. Après 10 ans de politique européenne de voisinage, si l’UE a su
approfondir ses relations bilatérales notamment sur le plan économique (entre l’Egypte et l’UE les
relations ont pratiquement doublé après la signature du Plan d’Action en 2005) en revanche peu
d’avancées ont été obtenues sur le plan politique. Aussi, les printemps arabes sont-ils révélateurs de
l’incapacité de l’UE à promouvoir une quelconque démocratisation des régimes autocratiques au sud de
la méditerranée. Pour appréhender l’écart entre les ambitions, le discours et les réalisations nous devons
revenir aux origines de la PEV pour mettre en lumière le dilemme démocratie-stabilité. Ce faisant nous
rejoignons le fait que Puissance normative n’équivaut pas à « force du bien », « pourvoyeur de paix »,
mais qu’il existe un conflit de normes (économique et politique) pris dans un contexte sécuritaire qui
pousse l’UE, sous l’impulsion notamment de logiques étatiques (puissance militaire), à subordonner
tout un pan de ses objectifs à la realpolitik.
3. Le dilemme sécurité-démocratie
3.1) De l’Europe élargie à la stratégie européenne de sécurité
Le dilemme sécurité-démocratie ou stabilité-démocratie est sûrement l’élément le plus visible de
l’évolution de la PEV ces dix dernières années. Il est à l’origine de l’incapacité de l’UE à user de la
conditionnalité positive (carotte) comme négative (bâton). Le dilemme stabilité-démocratie est le
résultat d’un conflit entre deux approches qui vont matricer de manière duale l’évolution de la PEV et
façonner les relations bilatérales de l’UE avec ses voisins. C’est à travers une dualité permanente entre
une Union européenne qui cherche à exporter son modèle et ses valeurs fondées sur l’Etat de droit, la
démocratie et une Union européenne qui cherche à sécuriser ses frontières et établir une politique
sécuritaire prédominante sur les autres dimensions que va se développer au niveau du partenariat
méditerranéen le dilemme sécurité-démocratie-stabilité. Dans son discours du 26 novembre R. Prodi
décelait déjà remarquablement bien cette dualité, « Nous avons le choix entre deux possibilités très
différentes l’une de l’autre […]. La première consiste à considérer la Méditerranée principalement en
termes de sécurité. Il s’agit alors de la frontière méridionale de l’Union, sur laquelle il faut se placer
pour gérer les flux migratoires, combattre l’éventuelle diffusion du terrorisme international (…). C’est
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
17
l’approche du flanc sud longtemps chère à l’OTAN (…) La seconde consiste à considérer la
Méditerranée principalement comme un nouveau domaine de coopération, où il convient d’établir des
relations spéciales dans le cadre d’une politique plus large de voisinage »20. Dans un premier temps la
Politique européenne de voisinage a été pensée selon la deuxième approche.
C’est l’esprit de la première communication relative à la PEV «L’Europe élargie – Voisinage : un
nouveau cadre de relations avec nos voisins de l’Est et du Sud »21. Cette communication conçois la PEV
comme une politique de dialogue ayant vocation à œuvre pour le développement de 4 espaces communs :
(i) un espace de Liberté de sécurité et Justice, (ii) un espace économique, (iii) un espace de sécurité
extérieure, un espace de culture et d’échange. L’immigration ici n’est pas vue comme une menace mais
comme un vecteur d’enrichissement mutuel, s’inscrivant dans le brassage des cultures qui a toujours
marqué l’espace méditerranéen. Cette approche qui conçoit la PEV comme un processus de construction
du «vivre ensemble » est en fait issue des travaux du groupe des sages présidé par R.Prodi et dont les
membres sont socialement positionnés hors des arènes communautaires et étatiques22. Ainsi, la
récupération de cette nouvelle politique par les services de la Commission et ceux du Haut Représentant
pour la PESC, Javier Solana, va-t-elle substantiellement dénaturer cette approche au profit de l’approche
du flanc sud de l’OTAN.
C’est à travers un document fondamental de la PESC, la Stratégie Européenne de Sécurité, que Javier
Solana va redéfinir les orientations de la PEV23. Dès sa conception, ce document diffère de la précédente
en ce qu’il part des menaces existantes, des défis, du contexte d’insécurité global, de la «montée des
périls », bref, de ce qui sépare plutôt que de ce qui rassemble. Il s’agit de sécuriser le voisinage plus que
de coopérer à la création d’espace commun. Cette stratégie va clairement influencer la deuxième
communication de la Politique européenne de voisinage 200424: « L’importance d’une politique de
voisinage est également mise en évidence dans la stratégie européenne de sécurité […] qui déclare qu’il
appartient à l’UE d’apporter une contribution à la stabilité et à la bonne gouvernance dans notre
voisinage immédiat et à promouvoir un cercle de pays bien gouvernés à l’est de l’Union européenne et
sur le pourtour méditerranéen ». Le document d’orientation fondateur de 2004 qui reprend aussi l’esprit
du Processus de Barcelone et de la Communication de 2003 « L’Union a pour objectif de promouvoir
20 Prodi R., L’Europe et la Méditerranée : venons-en aux faits, Louvain-la-Neuve, 26 novembre 2002. 21 Commission européenne, L’Europe élargie – Voisinage : un nouveau cadre de relations avec nos voisins de l’Est et du Sud,
Bruxelles, COM(2003) 104 final, 11 mars 2003, 22 Julien Jeandesboz propose une analyse sociologique intéressante pour comprendre l’origine de la PEV : « Définir le voisin.
La genèse de la Politique européenne de voisinage », Cultures & Conflits [En ligne], 66 | été 2007, mis en ligne le 17 novembre
2007 23 Solana J., Une Europe sûre dans un monde meilleur. Stratégie européenne de sécurité Document adopté par les chefs d’Etat
et de gouvernement, réunis en Conseil européen à Bruxelles, le 12 décembre 2003, disponible en ligne : http://www.iss-
eu.org/solana/solanaf.pdf 24 Commission européenne, Politique européenne de voisinage. Document d’orientation. Bruxelles, COM (2004) 373 Final, 12
mai 2004,
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
18
la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union
affirme et promeut ces valeurs. » (Ibid) renferme donc déjà le dilemme démocratie-stabilité.
3.2) De la PEV à l’inefficacité de la conditionnalité politique
Si, dans les textes, la PEV apparaît comme la synthèse de ces deux approches, dans la pratique la
stabilité, vue sous l’angle de la sécurité, prend le pas sur une politique plus volontariste en matière de
droits de l’Homme. Ce débat en soit n’est pas nouveau, il a toujours sous-tendu les politiques extérieures
avec la critique quasi permanente d’une subordination des droits de l’Homme aux intérêts économiques
et sécuritaire de l’Etat. Ce qui est relativement nouveau c’est qu’il se déplace progressivement au niveau
de l’Union européenne, dont la nature spécifique de sa puissance normative et/ou civile tendait justement
à dépasser l’approche étatique de la puissance traditionnelle (hard power) où c’est la force (économique,
militaire, énergétique) qui est l’élément structurant premier. L’UE a donc mené une politique
traditionnelle en assumant implicitement que le maintien de régime autoritaire était un gage de stabilité
au Sud de la Méditerranée. Dans cette perspective, la mise en œuvre de la PEV tend à dénuer la puissance
normative des attributs pacificateurs qu’on lui prête et qui restent cantonnés au niveau discursif.
Le dilemme démocratie-stabilité est à l’origine de la - non - mise en œuvre de la conditionnalité
politique censée justement donner corps à la puissance normative. En fait la conditionnalité n’a jamais
été utilisée pour les pays au sud de la Méditerranée. Déjà avant la PEV, l’UE n’a pas su user de la
conditionnalité. C’est le cas connu du professeur de sociologie Sa'ad Eddin Ibrahim qui s’est fait arrêter
par les autorités égyptiennes alors même qu’il conduisait des projets de coopération dans le domaine
des droits de l’Homme au titre des instruments de la PEV ! L’instauration d’une conditionnalité positive
n’y changera rien, le processus de démocratisation au Sud de la Méditerranée sera fondamentalement
limité25. La difficulté d’opérationnaliser la conditionnalité positive, qui devait constituer un des apports
de la PEV par rapport au Processus de Barcelone, n’est pas seulement du ressort du dilemme démocratie-
stabilité, mais relève aussi du cadre institutionnel et procédural des instruments de la PEV.
D’une part la lourdeur et la rigidité du processus de programmation rend difficile la
réorientation/réallocation des fonds. L’allocation des enveloppes par pays au titre de l’IEVP est décidée
sur une base de 5 à 7 and dans le cadre de la programmation budgétaire pluriannuelle de l’UE. Cela rend
d’autant plus délicat de revenir sur une allocation qui est le fruit d’un compromis entre les Etats. Ces
difficultés sont couronnées par le processus de décision : la conditionnalité étant soumise à l’unanimité
au Conseil sur demande de la Commission, le consensus est rendu presque impossible26. D’autre part,
25 Bruno Reis, “Political Change in the Mediterranean”, EuroMesco n°70, Lisbon, 2008 26 Charles Thépaut “Can the EU Pressure Dictators? Reforming ENP Conditionality after the Arab Spring”, EU diplomacy
paper n°6/11, College of Europe, 2011, p. 6-7/ voir aussi chapitre I
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
19
le manque de clarté des Plans d’Action27, qui déclinent plusieurs axes de coopération assez larges
(« liberté de presse », « démocratisation de la vie politique ») sans jamais proposer de mesures concrètes,
ne semble adaptés et laisse trop de marge de manœuvre aux partenaires : aucun critère d’évaluation à
mi-parcours et ex post fondé sur les avancées démocratiques n’est défini, aucune échéance n’est
mentionnée…Par ailleurs, la programmation de l’IEVP se déroulant essentiellement dans le cadre de
l’appui budgétaire28, qui revient à déléguer au gouvernement en place la gestion des fonds, les acteurs
de la société civile ne jouent qu’un rôle marginal dans la transparence du processus de programmation
et la gestion des fond, alors qu’ils sont pourtant des acteurs clé des processus de démocratisation.
Enfin on peut relever un autre élément qui peut expliquer le manque d’efficacité de la conditionnalité.
C’est la «carotte» elle-même. En effet, dans quelles mesures l’offre de l’UE est-elle suffisamment
intéressante pour inciter des régimes autoritaires à ouvrir, libéraliser le champ politique (autrement dit,
partager le pouvoir…). L’aide financière est clairement une moteur incitatif, mais dès lors que pour les
raisons susmentionnées, la crédibilité et l’opérationnalité de la conditionnalité sont mises à mal, dans
quelles mesures les gouvernements peuvent-il être incités à prendre des mesures ? De plus, au niveau
des accords commerciaux (ouverture des marchés aux entreprises européennes plus compétitives et aux
produits agricoles européens subventionnés) et des accords de réadmission (externalisation de la gestion
des flux migratoires clandestins) il semble que ce soit l’UE qui ait le plus à gagner de manière absolue.
En ce sens la PEV a souvent été qualifiée d’euro-centrée.
L’indifférence, inversement proportionnelle à la crédibilité de la conditionnalité, est un élément
important. Par exemple, alors que la Tunisie et l’UE ont signé leur premier Accords d’Association en
1995, il a fallu attendre 2007 pour que l’UE parvienne à « imposer » la création d’un sous-comité droit
de l’Homme29 chargé de suivre les avancées de l’AA dans ce domaine. Par ailleurs, alors qu’un
programme de soutien à la société civile avait réussi à être programmé dans le Plan Indicatif National
de 2001, jamais il ne verra le jour. Le rapport de 2010 du Réseau euro-méditerranéen des droits de
l’Homme dresse un bilan sévère de l’incohérence des politiques européennes en matière de promotion
des droits de l’Homme en Tunisie, avec un approfondissement des relations alors même que le régime
de Ben Ali adoptait des lois liberticides sur la liberté d’association et d’expression30.
27 Rosa Balfour, “Reassessing the European Neighbourhood Policy, promoting human rights and democracy in the EU’s
neighbourhood : tools, strategies and dilemmas” EPC Issue Paper No.54 June 2007 28 60% de l’IEVP a ainsi été déboursé sous forme d’appui budgétaire pour la période 2007-2013 en Egypte selon le rapport de
la Cours des Comptes européennes. 29 Decision No 1/2007 of the EU-Tunisia Association Council of 9 November 2007 setting up a Subcommittee on Human
Rights and Democracy. Retrieved June 15, 2012 from
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22007D0754:EN:NOT 30 Rapport du Réseaux Euro-méditerranéen des droits de l’Homme, REMDH, « Les incohérence des politiques européennes
face aux violations des droits de l’Homme en Tunisie », Copenhague, septembre 2010
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
20
Tout au long de ce premier chapitre introductif nous avons voulu montrer que la Politique européenne
de voisinage, qui traduit une bilatéralisation du Partenariat euro-méditerranéen a permis de donner corps
à l’expression de la puissance normative européenne. Néanmoins, dans un contexte géopolitique
belliqueux, le dilemme démocratie-stabilité s’est substitué aux objectifs ambitieux de la communication
« pour une Europe élargie ». Dans ce cadre, les vecteurs de la puissance normative (attraction du modèle
européen, harmonisation des règles, institutionnalisation, accords commerciaux, etc.) n’ont pas opéré de
manière efficace sur le plan des réformes politiques dès lors qu’ils n’étaient plus subordonnés à une
forme de conditionnalité négative et positive (incitation, accès au marché européen, aide financière et
technique…). Ce faisant c’est la cohérence même de la politique européenne de voisinage qui est remise
en question. C’est tout d’abord au niveau du « Speech-Act gap » (écart entre le discours et les réalisations
concrètes) que s’illustre au mieux l’inconsistance de la politique européenne de voisinage. En second
lieu, le manque de coordination entre différentes politiques œuvrant parfois à des objectifs
contradictoires alimente l’incohérence de la PEV et, par-là, son efficacité. Pour certains auteurs la
cohérence est un élément fondamental de la puissance normative. Sans cohérence, sans objectifs
communs, la PEV, écartelée et fragmentée entre différents enjeux, est de facto limitée dans sa capacité
d’influencer les décisions des partenaires.
Nous l’avons vu, la PEV est née d’une évolution institutionnelle interne et de l’évolution du contexte
régional, aussi bien au Sud qu’à l’Est. Et c’est justement ces deux éléments qui vont être réunis de
nouveau avec d’une part, la création du Service Européen pour l’Action Extérieur, et, d’autre part, les
printemps Arabes. L’objectif est donc d’étudier si ces évolutions ont permis d’aller d’une part vers une
meilleure cohérence des politiques extérieures de l’UE, vers une reformulation des objectifs et un
renouveau de la conditionnalité politique comme levier d’action de la puissance normative. Le premier
élément à prendre en compte c’est l’inscription avec le Traité de Lisbonne (consolidation du TFUE et
du TUE) d’un fondement juridique à la PEV (article 16) : « L’Union développe avec les pays de son
voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé
sur les valeurs de l’Union (…) ». Alors que la PEV s’est toujours développées sans base juridique solide,
de manière ad hoc au fil des communications, le Traité de Lisbonne confère à l’UE une compétence
claire et impérative (l’UE développe) d’approfondir ses relations avec les pays de la PEV. Si l’UE a
toujours su user du juridique pour élargir son champs d’action (surtout à partir des compétences qui lui
sont dévolues par les traités en matière de concurrence) il est intéressant d’évaluer comment l’UE a su
mettre à profit ce fondement juridique, qui légitime la Commission et le SEAE pour réformer la PEV.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
21
CHAPITRE II : Réforme institutionnelle, le SEAE vers une politisation de la PEV ?
Comment définir le processus de politisation de la politique européenne de voisinage ? L’UE en
soutenant implicitement les régimes dictatoriaux en Egypte et en Tunisie, ne faisait-elle pas déjà de la
politique ? Affirmer le contraire serait sans doute faire preuve de mauvaise foi. Cependant, entre faire
de la politique « implicitement », à travers des accords commerciaux, une assistance technique et
budgétaire et développer, de manière consciente, une stratégie définissant des objectifs et des moyens, il
existe un écart qualitatif considérable. L’étude de la capacité de l’Union européenne à influencer ses
partenaires à travers le processus de bi-latéralisation ne suffit pas à définir ce que nous entendons par
politisation de la politique européenne de voisinage. Il faut aller plus loin et compléter l’approche de la
politisation fondée sur la notion de «soft power» et/ou de « puissance normative ». Il faut partir de la
reformulation des objectifs (quelle est la finalité de la PEV) mais aussi des moyens dont dispose l’UE
pour politiser la PEV.
Dans cette perspective, la création du Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE) constitue un
saut « qualitatif » vers l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique étrangère qui dit son nom :
« maintenant on dit à nos partenaires : on fait de la politique »31. Il ne s’agît pas d’adopter une démarche
binaire, échecs et réussites du SEAE, mais de comprendre, en tenant compte de la jeunesse de cette
institution, son rôle et ses missions pour évaluer comment elle contribue à politiser les relations
extérieures de l’Union européenne. Dès lors, nous essaierons d’appréhender l’influence du SEAE sur
les différentes politiques extérieures et sur les autres organes façonnent la PEV (Direction Générale,
Conseil des Affaires étrangères, Conseil européen). L’analyse du travail des délégations de l’Union
européenne et l’étude de leurs nouvelles prérogatives contribueront aussi à étayer l’évolution des
moyens dont dispose l’Union européenne pour s’affirmer comme un acteur politique, au-delà de son
statut de « bailleur de fonds » sur le plan bilatéral.
Concernant la reformulation des objectifs de la PEV, si nous y reviendrons plus longuement dans le
cadre de l’analyse des réponses politico-institutionnelles de l’UE aux printemps arabes32, nous
chercherons à montrer aussi en quoi l’intégration transversale des droits de l’Homme et des
problématiques liées à l’Etat de droit via le SEAE nourrit le processus de politisation des relations
extérieures de l’UE. Cette approche s’inscrit dans une démarche plus globale et résolument prospective.
Nous essaierons de mettre en lumière une dynamique de communautarisation de la diplomatie des droits
de l’Homme au profit du SEAE qui tend à prendre le « lead » sur les Etats membres dans la formulation
des politiques liées à la promotion de l’Etat de droit, à la gouvernance démocratique et à la gestion des
31 Expression utilisée par représentant du SEAE pour répondre à ma question « comment définir l’impact politique du SEAE
sur relations extérieures de l’Union européenne. 32 Voir le chapitre III « L’Union européenne face aux bouleversements politiques et géopolitiques. »
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
22
crises. Pour donner corps à cette dynamique nous analyserons le rôle central des délégations de l’Union
européenne sur le terrain.
4. La genèse du SEAE vers une redéfinition des relations extérieures de l’Union européenne ?
4.1) l’impact du SEAE sur la PEV, cohérence, coordination, politisation.
Suivant une démarche institutionnaliste et une approche juridico-normative, les changements
institutionnels successifs des dispositifs de l’action extérieure de l’UE auraient des effets performatifs -
explicites ou implicites – sur sa politique étrangère33. De telle sorte que dans cette dynamique
permanente d’accrétion institutionnelle, l’accumulation de nouvelles compétences externes, l’extension
tendancielle du champ de la coopération de la diplomatie à la sécurité, la multiplication des procédures
de concertation dans un cadre institutionnel défini et la socialisation diplomatique contribueraient à
l’affirmation de l’UE comme un acteur politique à part entière sur la scène internationale. Les dispositifs
du traité de Lisbonne, l’institution d’un Haut représentant aux affaires étrangères et d’un service
diplomatique indépendant du Conseil de l’Union et de la Commission s’inscrivent pleinement dans cette
dynamique d’autonomisation de l’action extérieure de l’UE.
Les études jusqu’à aujourd’hui se sont focalisées sur l’apport du SEAE dans le cadre de la Politique de
Sécurité et de Défense Commune (PSDC) et de l’approche globale de la gestion de crise de l’Union
européenne. Notre visée ici n’est pas d’entrer dans le débat sur l’impact du SEAE sur la nature de la
puissance européenne (puissance normative, puissance civile…) ni de pointer du doigt les faiblesses
matérielles et humaines34 et le décalage entre les capacités institutionnelles et les concrétisations en
matière de sécurité défense35, mais d’adopter une approche « institutionnaliste » pour comprendre les
avancées en matière de coordination dans la définition d’une approche stratégique (plus politique) dans
un cadre spécifique, la politique européenne de voisinage et la promotion de l’Etat de droit et des droits
de l’Hom0me.
En la personne du Haut représentant aux affaires étrangères aussi Vice-président de la Commission
européenne (HRVP), sorte de fusion entre l’ancien M. PESC et le Commissaire aux relations extérieures,
il apparait que la continuité de la présidence du Conseil des Affaires étrangère (CAE), mais surtout des
différents groupes de travail, comme le United Nations Working Party (CONUN) ou le
Mashreq/Maghreb Working Party (MAMA)36 présidés par un représentant du SEAE, a largement
33 Petiteville Franck, « Les mirages de la politique étrangère européenne après Lisbonne », Critique internationale 2/ 2011 (n°
51), p. 95 34 Le Budget du SEAE repose sur le principe de neutralité, via à un transfert des fonds anciennement alloués aux directions
compétentes dans le domaine des relations extérieures. 35 La Crise Libyenne est à cet égard assez criante. 36 Certains groupes de travail et comité restent cependant encore présidés par la présidence tournante du conseil de l’Union
européenne : le groupe des conseillers pour les relations extérieures, le groupe de travail sur le développement, le groupe de
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
23
contribué à l’émergence d’une planification stratégique à plus long terme. Cette continuité se retrouve
aussi dans la présidence des sous-comités chargés du suivi des Accords d’Association établis dans le
cadre de la PEV. Si l’on peut débattre des conséquences en termes de retrait des Etats membres dans le
travail de ces groupes, et de la perte de dynamisme liée à une présidence continue37. Les prérogatives de
la présidence - proposer un agenda et coordonner les positions - confèrent une certaine marge de
manœuvre au SEAE pour s’affirmer et être force de proposition : stratégie pour les droits de l’homme,
communications et rapports par pays dans le cadre de la PEV, stratégie pour le Sahel ou stratégie pour
les Caraïbes, mandats de négociation d’accords internationaux, documents de position et travaux
préparatoires pour les sommets et autres réunions de dialogue politique de haut niveau, documents
stratégiques pour la programmation de l’aide extérieure, recommandations sur la dimension extérieure
de politiques intérieures38.
Pour mieux appréhender l’impact du SEAE sur la politique extérieure il convient de distinguer ici deux
phases : la phase de programmation et la phase de mise en œuvre des instruments :« le SEAE contribue
tout au long du cycle de programmation et de gestion des instruments (…) sur la base des objectifs
politiques qui sont fixés dans lesdits instruments (…) Il est chargé de préparer les décisions de la
Commission ci-après relatives aux mesures stratégiques pluriannuelles dans le cadre du cycle de
programmation :affectations par pays destinées, déterminer l'enveloppe financière globale pour chaque
région (…) »39. Si dans les textes, le SEAE doit jouer un rôle tout au long du cycle de programmation et
de gestion, il s’avère que dans la pratique la mise en œuvre et le suivi des instruments de coopération40
reste encore une prérogative de la Commission et de la DG DEVCO. En ce sens un des enjeux majeurs
du processus de politisation de la politique extérieure, comme l’a souligné le Directeur général
administratif du SEAE, David O'Sullivan, lors de la commission Développement du Parlement européen
du 22 juillet 2014, consiste pour le SEAE à jouer un rôle accru dans la mise en œuvre des instruments
de coopération, pour les rendre plus réactifs à l’évolution du contexte politique.
Dans le cadre plus restreint de la PEV on peut aussi poursuivre cette démarche institutionnaliste. La
création d’une sous-direction au sein du SEAE spécialement chargée de la reformulation de cette
travail Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), le groupe de l’Association européenne de libre-échange (AELE), le groupe de
travail sur la lutte contre le terrorisme (COTER), le groupe de travail sur le droit international public (COJUR) et le comité
Athena. 37 « The Organisation and functioning of the European External Action Service: achievements, challenges and opportunities »,
Etude de la direction des Affaires étrangères du Parlement européen, EXPO/B/AFET/2012/07, 2013 p40-p44. 38 Revue Annuel et Examen 2013 du SEAE 39 Article 3.3 de la Décision du Conseil (2010/427/UE) du 26 juillet 2010 « fixant l'organisation et le fonctionnement du service
européen pour l'action extérieure » 40 L’instrument de la coopération au développement ; le Fonds européen de développement ; l'instrument européen pour la
démocratie et les droits de l'homme ; l'instrument européen de voisinage et de partenariat ; l'instrument de coopération avec les
pays industrialisés ; l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire ; l'instrument de stabilité.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
24
politique, « IV.1 European neighborhood Policy »41, de suivre l’évolution au niveau régional et bilatéral,
de coordonner les recommandations des directions géographiques et des « country desks » et de proposer
des recommandations au HR/VP et aux Etats membres, semble profiter à une réflexion plus stratégique
et à plus long-terme. Les communications de 2011 sur une « nouvelle politique européenne de
voisinage » et un « partenariat pour une prospérité commune au sud de la méditerranée » vont dans ce
sens. Le renforcement de la PEV à travers le SEAE ne peut pas se limiter à la création d’une sous-
direction spéciale. Il convient aussi de prendre en compte le rôle des directions géographiques et plus
spécialement des « country desk » qui s’occupent de centraliser et de transmettre au groupe de travail
du Conseil compétent le travail des délégations sur le terrain. Ainsi, par analogie, les « country desk »
rempliraient le rôle des Conseillers pays de la direction politique du Ministère des Affaires étrangères
(MAE). L’entretien réalisé auprès du « conseiller Tunisie » du SEAE42 a fait ressortir leur rôle dans la
coordination des différentes politiques. Il faut bien comprendre que la complexité de la PEV réside dans
l’articulation de plusieurs politiques faisant interagir différents acteurs. Les besoins en termes de
coordination sont donc d’autant plus importants pour assurer une certaine cohérence. Les « conseillers
pays », d’un point de vue institutionnel et de gouvernance, remplissent cette fonction indispensable au
bon fonctionnement de la PEV, écartelée entre différentes logiques (commerciale, assistance technique,
politique migratoire, appui budgétaire…).
La montée en puissance de la PEV au sein du SEAE peut aussi être appréhendée à la lumière des priorités
politiques qui ont émergé au fur et à mesure que cette jeune institution se développait. Ainsi, lors du
dernier Examen annuel du SEAE (2013), la PEV a-t-elle était érigée comme la priorité n°1 : « Après les
deux premières années d’activité, trois axes essentiels de la politique étrangère de l’UE apparaissent au
grand jour: I) le voisinage, où l’UE peut recourir à l’ensemble des politiques et des instruments dont elle
dispose pour opérer un changement durable; II) l’approche globale (…) »
Cette concrétisation s’explique aussi par le fait que c’est à travers la PEV que le principe de cohérence,
qui tend à justifier la mise en place d’un service diplomatique européen43, s’exprime de la manière la
plus évidente. Alors que le SEAE a souvent été analysé sous l’angle de la communautarisation de la
PSDC et/ou du rôle du HR/VP, la PEV constitue un objet de recherche privilégié pour appréhender la
plus-value du SEAE dans la cohérence des politiques extérieures. Dans cette perspective, afin de saisir
ce « renouveau » dans la gouvernance de la PEV, il faut évaluer la relation spécifique du SEAE avec les
différentes DG de la Commission.
41 Dans le cadre des entretiens avec des représentants officiels du MAE, j’ai eu l’occasion de m’entretenir de manière
approfondie avec un agent de la sous-direction ENP du SEAE. Voir l’organigramme du SEAE en Annexe. 42 Entretien SEAE (1) : Direction IV.A Afrique du Nord, Moyen Orient, Péninsule Arabique, Division IV.A.4 Maghreb,
Country Desk Tunisia – 27 mai 2014, Bruxelles 43 Voir notamment Stephan Keukeleire, Michael Smith, SophieVanhoonacker, “The Emerging EU System of Diplomacy: How
Fit for Purpose?”, The Diplomatic System of the European Union, Policy Paper 1, march 2010.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
25
4.2) Le SEAE dans le système diplomatique de l’UE
La création du SEAE a souvent donné lieu à des analyses en termes de conflits interinstitutionnels avec
les services de la Commission. Comment pouvait-il en être autrement dès lors qu’il était établi que le
SEAE fonctionnerait comme un organisme indépendant44, ce qui automatiquement traduirait une perte
de compétence pour les services de la Commission. Les analyses ont beaucoup porté sur la relation du
SEAE avec la DG DEVCO étant donné que les acteurs chargés de la mise en œuvre des instruments de
coopération ont du mal à accepter que leur expertise soit moins valorisée lors de la phase de
programmation45. Aussi, pour éviter un blocage en période de programmation, la Commission et le
SEAE ont signé des « accords de services » pour mieux encadrer les rôles et les fonctions de chacun46.
Ces conflits ne sont pas exclusifs au système diplomatique de l’UE. En France les relations entre l’AFD
et le MAE, notamment dans la mise en œuvre des programmes sur les droits de l’Homme, ne sont pas
toujours évidentes47.
Au niveau de la gouvernance de la PEV, il semble que la refonte institutionnelle engagée par Lisbonne
n’est pas été menée jusqu’à son terme. La persistance d’une DG ELARG chargée de la PEV semble
contradictoire avec la montée en puissance du SEAE dans la gestion de cette politique. Cette décision
semble d’autant plus préjudiciable que la PEV, comme nous l’avons vu, demande un besoin de
coordination particulièrement élevé. La multiplication des acteurs qui vient s’ajouter au fait qu’il existe
déjà plusieurs DG impliquées dans la PEV semble donc, à première vue, contraire aux missions
assignées au SEAE dans la « coordination politique » (Art3 Décision établissant le SEAE) des
instruments qui composent la PEV. Il ressort des entretiens que les relations entre le SEAE et la DG
ELARG sont relativement complexes mais qu’elles fonctionnent assez bien. La coordination avec la DG
ELARG est souvent montrée en exemple de coopération interinstitutionnelle48. En effet, il apparaît que
le Commissaire chargé de la PEV a joué un rôle déterminant dans la coordination du SEAE avec les
autres DG dans le cadre de la reformulation de la PEV et la mise en œuvre de Task Force après les
printemps arabes49. Cependant, les réflexions en cours au sein du SEAE penchent vers un transfert total
44 Article 12 Décision du Conseil 2010/427/UE du 26 juillet 2010 « fixant l'organisation et le fonctionnement du service
européen pour l'action extérieure ». 45 « The Organization and functioning of the European External Action Service: achievements, challenges and opportunities,
op.cit. p 40. ; voir aussi Van Vooren, B., “A Legal Institutional Perspective on the European External Action Service”. 46 Entretien DG DEVCO (2) (Commission) : Direction F voisinage, Division F.1 coordination géographique Sud, Country Desk
Tunisia – 18 juin 2014, Bruxelles. European Commission (2012), SEC (2012)48, Working Arrangements between Commission
and the European External Action Service, (EEAS), 13 January 2012. 47 Ayant effectué un stage de six mois au sein de la direction générale de la mondialisation j’ai pu assister à plusieurs réunions
entre le Mae et l’AFD dans le cadre de la sélection de projet dans le programme « initiative de la société civile ». Les postes
concernés par la zone géographique du projet donnaient leur avis qui pouvait parfois diverger de ceux de l’AFD. Globalement
si la cooperation entre l’AFD et le MAE semble bien fonctionner, le processus de transfert des compétences en matière de
droits de l’Homme est déjà bien avancé. 48 “The Organization and functioning of the European External Action Service: achievements, challenges and opportunities »,
p.48 : “Coherence coordination between the EEAS and the Commission is assessed positively in the field of the European
Neighbourhood Policy”. 49 Entretien SEAE (3) : Direction IV Afrique du Nord, Moyen Orient, péninsule Arabique, Division Politique européenne de
voisinage – 1 juillet 2014, Bruxelles
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
26
des compétences PEV vers le SEAE50. Ce processus permettrait de limiter le nombre d’acteurs en charge
de la PEV mais surtout d’officialiser le fait que SEAE ait déjà pris le lead sur cette politique : « The
Commissioner responsible for the ENP ‘works for’ the EEAS inside the walls of the Commission »51.
Par ailleurs, une simple analyse de l’organigramme52 de la DG ELARG suffit à conforter cette vue dans
la mesure où aucun service de la DG ne travaille explicitement sur les relations de voisinage. Enfin, la
persistance de la PEV au sein de la DG ELARG contribue à alimenter la confusion entre deux politiques
bien distinctes, surtout pour les partenaires de l’Est où les Accords d’Association et les Plan d’Action
peuvent être perçus comme des instruments menant au chemin de l’adhésion.
La PEV qui encadre la politique commerciale, énergétique ou encore migratoire, reflète la dimension
extérieure des politiques internes de l’Union européenne. En ce sens le principe de cohérence lui est
consubstantiel. La politique migratoire, avec la négociation de « partenariats pour la mobilité »53, la
politique commerciale, avec les négociations d’Accords de Libre Echanges Complets et Approfondis
(ALECA), la politique énergétique liée aux enjeux de diversification et de sécurisation des sources
d’approvisionnement, affectent profondément les relations bilatérales et la formulation des Plans
d’Action de la PEV. Aussi la question de la planification, de la priorisation et de la hiérarchisation des
acteurs dans la prise de décision des politiques qui façonnent la PEV revêt-elle une importance
particulière pour mieux saisir le rôle du SEAE dans le jeu diplomatique complexe inhérent à la PEV.
Les relations sont-elles transversales ou horizontales entre le SEAE et les DG compétentes (DG HOME
pour la politique migratoire, DG TRADE pour la politique commerciale et DG ENER pour la politique
énergétique) ?
Au niveau de la politique commerciale, la création du SEAE ne semble pas avoir impacté
significativement le poids prépondérant de la DG TRADE54. Le caractère exclusif de la compétence de
l’UE en ce domaine, la longue expérience de la DG TRADE dans les relations extérieures et l’expertise
des agents de la Commission qui en résulte55 sont probablement des facteurs déterminants pour expliquer
la prédominance ou l’absence de sa mise sous tutelle politique via le SEAE. D’un point de vue
institutionnel, au niveau du Conseil, les comités traitant des relations commerciales (Trade Policy
50 Ibid. Voir aussi Revue Annuel et Examen 2013 du SEAE, p10. 51 Market Law Review, Vol. 48 (2011), p. 477; Niklas Helwig Paul Ivan Brant Kostanyan, “The new EU foreign policy
architecture reviewing the first two years of the EEAS” Centre for European Policy Studies (CEPS) Brussels, 2012, p49. 52 Voir Annexe organigramme de la DG ELARG 53 En Mars la Tunisie a signé un mémorandum pour un partenariat pour la mobilité avec l’Union européenne qui devrait aboutir
à un accord politique contraignant sur les accords de réadmissions et la facilitation d’obtention de visa. 54Entretien SEAE (3) : Direction IV Afrique du Nord, Moyen Orient, péninsule Arabique, Division Politique européenne de
voisinage – 1 juillet 2014, Bruxelles 55 Il faut aussi prendre en considération que les délégations de l’UE sont nées dans le cadre de la politique commerciale de
l’Union européenne dans leur rôle de représentation de la Commission et non de l’Union européenne. Autrement-dit les
délégations de l’UE n’avaient mandat que pour les politiques qui rentraient dans le champ du premier pilier de Maastricht et
de la méthode de coopération communautaire : Voir notamment James Moran and Fernando Ponz Canto « Taking Europe to
the world 50 years of the European Commission’s External Service », Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg, 2004.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
27
Committee (TPC)) continuent d’être présidés par la Présidente tournante du Conseil. La DG TRADE
continue de représenter la Commission dans 9 des 38 groupes de travail qui composent le Conseil
Affaires Etrangères (CAE)56. L’absence du SEAE et de la HR/VP dans les enceintes qui traitent des
questions de commerce internationale est assez révélatrice de la faible intégration de la dimension
économique dans le travail du SEAE. Enfin, contrairement à ce qui s’est passé avec la DG DEVCO, le
SEAE n’a pas signé d’ « accord de service » avec la DG TRADE.
Ce qui est intéressant ici, c’est de comparer les relations entre le SEAE et la DG TRADE dans le cadre
des partenariats stratégiques (Etats-Unis, Chine, Russie) et de la PEV. Selon des études menées auprès
des représentants de la Commission57 sur les rapports de suivi des Partenariats stratégiques élaborés sous
l’égide du SEAE, la coordination avec la DG TRADE faisait défaut alors que pour les ALECA, élaborés
dans le cadre de la PEV, les relations semblent être plus « fluides » et mieux coordonnées : « At the
same time, one interviewee in the EEAS states that in the ENP, the relationship with DG Trade also
proved to work very well »58. Néanmoins, du point de vue des partenaires, il s’avère parfois délicat de
négocier avec des acteurs dont les logiques diffèrent considérablement. Un diplomate tunisien a ainsi
pointé du doigt les différences de logique et d’agenda : Le SEAE aurait une vision plus globale, plus
compréhensive, qui s’inscrit dans le temps long de la construction des relations diplomatiques. Les
représentants de la Commission auraient tendance à vouloir accélérer les négociations sur le volet
économique59.
Dans le champ de la politique migratoire le SEAE semble « exclu » du jeu au sein duquel la DG HOME
coopère en priorité avec les Ministères de l’Intérieur des Etats membres. Cet état de fait pose
évidemment une question de fond substantielle à la cohérence des politiques qui façonnent la PEV :
comment définir une PEV cohérente quand la politique migratoire touchant aux droits de l’Homme, qui
constitue une des pierres angulaires des relations bilatérales développées par le SEAE60, est du ressort
des Etats membres dont l’approche sécuritaire peut rentrer en contradiction avec les « valeurs » prônées
par l’UE ? On touche là un point névralgique de la PEV dont la capacité à formuler des propositions
politiques dans un domaine aussi sensible reste fondamentalement limitée. Le processus de politisation
via la refonte du paysage institutionnel et la promotion de l’Etat de droit ne concerne que dans une
56 Niklas Helwig Paul Ivan Brant Kostanyan, “The new EU foreign policy architecture reviewing the first two years of the
EEAS”, op. cit., p43. 57 Ibid, p44. 58 “The Organization and functioning of the European External Action Service: achievements, challenges and opportunities »,
op. cit., p55. 59 Entretien Officiel Ambassade de Tunisie a Bruxelles 60 Voir : The Council of the European Union (2012), EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and
Democracy, 11855/12, Luxembourg 25 June. On retrouve notamment cette priorisation des droits de l’Homme et de l’Etat dans
les communications de 2011 sur la reformulation de la PEV et du partenariat Euro-méditerranéen : Commission européenne, «
stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation », COM(2011), 303. Commission européenne, « Partenariat pour la
démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée », COM(2011), 200 final.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
28
moindre mesure la politique migratoire pourtant au cœur des enjeux géopolitique, sécuritaire et des
droits de l’Homme en Méditerranée.
En somme, le SEAE a su se positionner comme l’acteur central dans la coordination et la cohérence des
politiques qui façonnent la PEV à l’exception cependant de la politique migratoire et de la politique
européenne de l’énergie. Il a su créer une dynamique institutionnelle favorable à une politisation du
cadre général de la PEV en élargissant notamment les marges de manœuvre de l’UE dans la formulation
et la proposition de stratégies à moyen-long terme. La PEV gagnerait néanmoins à ce que le SEAE
puisse jouer un rôle croissant dans la valorisation et la coordination de la dimension extérieure des
politiques internes de l’UE. Ci-dessous, un extrait du rapport du SEAE est révélateur de cet enjeu crucial
pour l’avenir de la PEV : « La protection de l’environnement et le changement climatique, les
migrations, la lutte contre le terrorisme, la régulation financière et la gouvernance économique mondiale.
On attend de plus en plus du SEAE qu’il soumette des idées et des propositions politiques sur ces sujets
au Conseil «Affaires étrangères». Après la répartition des responsabilités et des ressources lors de la
création du SEAE, la quasi-totalité de l’expertise et des capacités à gérer les aspects extérieurs de ces
politiques sont toutefois restées au sein des services de la Commission. Le SEAE ne remet pas en
question la primauté de la responsabilité des services de la Commission dans ces matières, mais sachant
que leur importance politique et leur incidence potentielle sur le programme plus large de la politique
étrangère ne cessent de grandir, le SEAE devra continuer de renforcer ses capacités à les traiter à
l’avenir. »61
5. Vers une « communautarisation » de la diplomatie des droits de l’Homme
5.1) Pas de cohérence sans objectif commun : le rôle du SEAE dans la reformulation des objectifs de la PEV
5.1.1) Définir la notion de cohérence
La notion de cohérence occupe une place particulière dans la littérature dédiée à la politique extérieure
de l’Union européenne. Evoquer la cohérence des politiques extérieures de l’Union européenne du seul
point de vue du rôle du SEAE sans aborder la question des objectifs commun à ces politiques ne
représente aucun intérêt. Cela reviendrait ni plus ni moins à étudier une «coquille vide». Pour
appréhender la notion de cohérence au-delà de la coordination des moyens, il faut avant tout savoir par
rapport à quoi cette notion fait référence.
Dans son ouvrage, A Paradigm for Coherence in EU External Relations: The European Neighbourhood
Policy, B. Van Vooren fait référence au concept de « sécurité humaine » pour développer son analyse
61 Examen du SEAE 2013, op.cit, p 11.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
29
de la cohérence de la PEV62. Tout d’abord l’auteur postule que le concept de cohérence est relativement
vague et qu’il est difficile, à partir de cas de pratique, d’en examiner la matérialisation concrète. L’auteur
cherche donc à rattacher la notion de cohérence à celle de synergie entre différents acteurs, politiques,
instruments. Partant de là, il pose d’entrée de jeu le problème des objectifs communs. Selon lui les
synergies entre les stratégies, les normes, les acteurs et les instruments ne peuvent aboutir que s’il existe
un but commun sur lequel repose les efforts déployés à mettre en œuvre ces synergies. Ainsi devons-
nous essayer de définir quel est l’objectif commun de la PEV à partir duquel nous pourrons développer
notre analyse. Tâche au combien difficile car elle est confrontée au risque de s’enfermer dans
construction essentiellement discursive fondée sur une approche téléologique des textes.
Nous ne partirons par du concept de « sécurité Humaine »63 rattaché par B. Van Vooren à la Stratégie
Européenne de Sécurité. Comme nous l’avons vu dans le précédent chapitre, la SES est à l’origine même
du dilemme démocratie-sécurité consubstantiel au développement d’une PEV tiraillée entre des objectifs
contradictoires.
5.1.2) Vers une reformulation axée autour des droits de l’Homme et la gouvernance démocratique
Le mandat du SEAE tend à se définir progressivement, à « tâtons ». Les politiques européennes se sont
toujours développées et renforcées à partir d’un cadre ou d’une base juridique solide. C’est là un moteur
puissant de l’intégration communautaire et il en va de même pour les politiques extérieures. Dans cette
perspective, il semble que l’Article 2164 du Traité de Lisbonne, qui fixe les principes régissant les
politiques extérieures de l’UE, ait largement joué son rôle de matrice de l’action du SEAE. Pour autant,
portant sur la promotion des droits de l’Homme, la démocratie et l’Etat de droit, en quoi cet article
constitue-t-il une avancée ou une reformulation de la politique extérieure de l’UE, qui semble toujours
s’être développée autour de ces valeurs fondatrices ?
62 B. Van Vooren, “A Paradigm for Coherence in EU External Relations: The European Neighbourhood Policy”, Doctoral
Thesis, European University Institute, Florence, 2010, Chapitre VI: Coherence as synergy in the ENP. 63 Rapport remis au Haut Représentant de la PESC sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité - Assurer la
sécurité dans un monde en mutation, Bruxelles, 11 décembre 2008, S407/08 p.2 : « Faisant appel à un éventail d'instruments à
nul autre pareil, l'UE contribue d'ores et déjà à un monde plus sûr. Elle s'est efforcée de renforcer la sécurité humaine en
réduisant la pauvreté et les inégalités, en promouvant la bonne gouvernance et les droits de l'homme, en apportant une aide au
développement et en s'attaquant aux causes profondes des conflits et de l'insécurité ». La notion de sécurité Humaine a été
développée au sein du PNUD et des nations Unies elle renferme une approche assez globale (sociale, économique, santé
alimentaire, droits civiques, etc.) de la sécurité basée sur les individus et les capacités de ses derniers à évoluer dans un
environnement stable et sécurisé. 64 « L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement
et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et
l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et
de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international. »
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
30
S’il est vrai que l’UE a dès les années 90 l’UE intégré les droits de l’Homme dans sa politique de
coopération au développement65 à travers une « clause droits de l’Homme »66 et que le nombre de
communications relatives à l’importance des droits de l’Homme ne se compte plus67, l’article 21 du
Traité de Lisbonne marque un saut qualitatif important qui vient consacrer l’expérience de l’UE dans ce
domaine. Selon le rapport de 2011 sur le soutien à la promotion des droits de l’Homme de la Commission
européenne68, il apparait que les droits de l’Homme sont trop souvent traités comme une politique à part
sans être suffisamment intégrés aux autres instruments extérieurs (« ghettoisation of human right ») 69.
Le même rapport révèle que malgré les efforts déployés par la Commission à partir des années 2000 et
plus spécifiquement 2010 pour intégrer les droits de l’Homme aux niveaux sectoriels (droit à la santé,
sécurité alimentaire, éducation, etc.) et élaborer des cadres politiques pour les droits spécifiques (droits
des femmes, droits sexuels et reproductifs, etc.), ces initiatives souffrent avant tout d’un manque de
soutien au plus haut niveau de la chaîne hiérarchique (political back-up) et de mécanisme de suivi et de
coordination qui faciliteraient l’intégration transversale des droits de l’Homme et l’opérationnalité des
cadres politiques. Le manque de leadership politique et de ressources humaines constituent les facteurs
majeurs de l’incohérence et de la faiblesse de l’UE dans ce champ d’action. Par exemple, selon le rapport
seul 12% des délégations de l’UE pensent que l’intégration des droits de l’Homme est « d’une
importance élevée »70.
Sans nier le « Speech-Act gap » qui caractérise la politique extérieure de l’Union européenne en matière
de droits de l’Homme, il ne faut pas non plus oublier la relative « jeunesse » de la Politique Etrangère
et de Sécurité Commune (PESC) qui tend, justement, de plus en plus à se définir par rapport aux valeurs
énoncées dans l’article 21 du TUE. C’est donc dans une démarche prospective que s’inscrit notre
approche selon laquelle la cohérence de l’action extérieure l’UE tend à se définir exclusivement par
rapport à l’intégration transversale des droits de l’Homme et de l’Etat de droit (les deux facettes de la
gouvernance démocratique). Ce qui nous intéresse c’est de montrer comment le SEAE a su matérialiser
cette « consécration » des droits de l’Homme, notamment via le modèle onusien de la « diplomatie des
65 Résolution sur les droits de l’homme, la démocratie et le développement, Article J.1, paragraphe 2 du Traité de Maastricht,
etc. 66 Pour un développement approfondi sur l’intégration progressive de la clause « droits de l’Homme » dans les accords de
coopération de l’UE voir : Mercedes Candela Soriano, « l’Union Européenne et la protection des droits de l’homme dans la
coopération au développement : le rôle de la conditionnalité politique », Revue Trimestrielle droits de l’Homme, Faculté de
droit de l’Université de Liège, 2002, p 875-900. 67 Se lancer dans un travail de comptable pour essayer de compter le nombre de déclaration, résolution, communication portant
sur la politique extérieure et les droits de l’Homme est une tâche extrêmement ardue. 68 “Thematic evaluation of the European Commission support to respect of Human Rights and Fundamental Freedoms”,
Rapport commandé par la Commission européenne, EVA 2007- Lot 2, Volume 1, 2011. 69 Ibid. p.12 et p.15: «On the whole, the progress on mainstreaming human rights in EC/EU action appears to have been limited.
While the political discourse in favor of human rights, the overall awareness among staff and the development of new policies
with a stronger human rights focus (e.g. in the area of food and access to health) have increased substantially, coherent action
on mainstreaming remains ad hoc, unsystematic and insufficiently supported from the hierarchy” 70 Ibid, p.20
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
31
droits de l’Homme » (représentants spéciaux, rapports annuels, rapports par pays, mécanismes de suivi
et d’alerte, mainstreaming, etc.).
Une des hypothèses sous-jacentes à notre approche consiste aussi à mettre en évidence une forme de
« communautarisation de la diplomatie des droits de l’Homme » qui a commencé dans les années 1990
après la chute du mur de Berlin et s’est accentuée dans le cadre de la politique extérieure de l’UE.
Autrement-dit, le processus d’institutionnalisation de la PESC reposerait sur un transfert de compétences
en matière de promotion de l’Etat de droit et des droits de l’Homme vers l’échelon communautaire tandis
que les Etats se concentreraient sur la diplomatie économique71. Cette hypothèse s’inscrit pleinement
dans la notion de « puissance civile » utilisée pour définir la nature de la politique extérieure de l’UE
qui se verrait « cantonnée » au rôle de pourvoyeur de démocratie et d’Etat de droit sans disposer d’un
« hard power » propre à la composante militaire des politiques étrangères étatiques. Par ailleurs, au
niveau de la PSDC (composante militaire de la PESC) les études mettent souvent en avant la
prédominance des missions civiles et la persistance des logiques fondamentalement gouvernementales
qui régissent cette politique72.
Ainsi faisons-nous l’hypothèse, discutable par nature, que l’UE se spécialiserait dans la promotion de
l’Etat de droit et des droits de l’Homme (approche du développement basée sur les droits de l’Homme)
et que ce même mouvement serait encouragé par les Etats membres cherchant à mutualiser leurs
ressources face à la complexité de la gestion des crises mais aussi, de manière un peu cynique, à se
décharger d’actions qui pourraient entraver leurs relations avec des partenaires stratégiques et/ou
économiques. Le recul des Etats membres sur les droits de l’Homme crée un espace politique en faveur
du SEAE pour s’approprier ce pan de la diplomatie publique et politiser une diplomatie auparavant
essentiellement économique.
La communication conjointe du SEAE et de la Commission, Human Rights and democracy at the heart
of EU external action – Towards a more effective approach, adoptée le 12 décembre 2011 est révélatrice
de la « montée en charge » des droits de l’Homme au sein d’une institution en pleine genèse qui cherche
à définir ses prérogatives et ses domaines d’action prioritaires. Au-delà des aspects déclaratoires, ce
document est intéressant en ce qu’il ouvre la voie à un processus de redéfinition stratégique au sein
duquel le SEAE sera amené à jouer un rôle moteur. L’adoption en décembre 2012 d’un cadre stratégique
pour les droits de l’Homme, EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and
71 En France, le MAE a fait de la diplomatie économique sa priorité. Par ailleurs cette thèse se retrouve renforcer dans la mesure
où à l’intérieur même de l’échelon national l’on assiste déjà à un processus d’externalisation de la politique de droits de
l’Homme vers les agences de développement. En France l’AFD est désormais compétente pour mener à bien les instruments
de coopération, FSP, qui traitent des droits de l’Homme. 72 Malgré les avancées du traité de Lisbonne, la majorité qualifiée est exclue pour toutes les questions stratégiques et surtout
pour toutes les questions ayant des implications militaires ou en matière de défense.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
32
Democracy73, peut être analysé comme l’aboutissement de ce processus de redéfinition. Tout d’abord
parce que le SEAE et la HR/VP ont joué un rôle moteur pour l’adoption de ce document important mais
surtout parce qu’il met en place un ensemble d’outils diplomatiques qui faisaient défaut74.
Déclinant 36 actions concrètes, ce cadre stratégique met au cœur de ces moyens le SEAE, qui sera chargé
exclusivement de présenter un rapport annuel sur les droits de l’Homme et la démocratie dans le monde
(Action 3 : Regular assessment of implementation) et d’inclure la violation des droits de l’Homme dans
la mise en œuvre d’un système d’alerte européen pour la prévention des crises. Le SEAE en lien avec la
Commission devra aussi intégrer les droits de l’Homme dans toutes les politiques sans exception (Action
9 : integrating human rights into all areas of the EU’s external relations without exception, including
trade and investment), développer un réseau de points focaux droits de l’Homme et démocratie au sein
des délégations et des missions relevant de la PSDC (Action 5 : A culture of human rights and democracy
in EU external action) et élaborer des stratégies et des rapports par pays (Action 31 : Continue to develop
local human rights country strategies).
On assiste donc à une multiplication d’outils basés sur le schéma onusien, comme le fameux Examen
Périodique Universel sur les droits de l’Homme, qui jouit d’une certaine médiatisation et d’un impact
diplomatique non négligeable. La nomination d’un Représentant spécial pour les droits de l’Homme est
aussi révélatrice de l’influence du système onusien sur le développement de la politique européenne en
faveur de la démocratie et des droits de l’Homme. Par ailleurs, notre hypothèse d’un processus de
communautarisation et d’une spécialisation « droits de l’Homme/démocratie » de la politique extérieure
de l’UE se trouve renforcée par l’analogie avec le système des agences onusiennes et des opérations de
maintien de la paix.
5.2) Les délégations de l’Union européenne – nouvelles prérogatives, vers des délégations plus politiques75
Avant d’aller plus loin dans l’étude des outils diplomatiques dont s’est dotée l’UE pour donner corps à
la redéfinition de sa politique extérieure autour de l’axe central DH/démocratie, il est nécessaire de faire
un point sur la notion de politisation. Ce qu’il est important de bien comprendre c’est qu’il faut
considérer cette montée en charge des thématiques DH/démocratie comme le reflet de la politisation des
relations extérieures de l’UE : « The EU will place human rights at the centre of its relations with all
third countries »76. Le rapport de 2011 sur les DH présentait les droits de l’Homme comme un sujet trop
73 The Council of the European Union, EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy, 11855/12,
Luxembourg, 2012. 74 Voir le rapport “Thematic evaluation of the European Commission support to respect of Human Rights and Fundamental
Freedoms”, op. cit., p12-20. 75 Drieskens, E., ‘What’s in a Name? – Challenges to the Creation of EU Delegations’, The Hague Journal of Diplomacy, Vol.
7 (2012), pp. 51-64. 76 The Council of the European Union, “EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy”, op. cit.,
p.3
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
33
sensible et trop politique pour que l’UE puisse jouer un rôle de leadership77. Ainsi, de manière
symétrique, l’appropriation des DH/démocratie par le SEAE reflète-t-il ce processus de politisation à
l’œuvre. Pour que ce processus ait un véritable impact tout l’enjeu est d’arriver à « opérationnaliser »
les cadres politiques. L’adoption de cadres stratégiques, de communication, la création d’une direction
spécifiquement dédiée aux droits de l’Homme, la nomination d’un Représentant spécial permettent de
combler, dans une certaine mesure, l’absence de soutien politique au plus haut de la chaîne de hiérarchie.
Cependant, si l’UE n’arrive pas à traduire cette reformulation sur le terrain et dans ses relations
bilatérales, les efforts seront vains et le processus de politisation restera un effet discursif alimentant le
« Speech-Act gap ».
L’étude de l’évolution du rôle des délégations est donc d’un intérêt central. Avec la création du SEAE
elles ont acquis de nouvelles compétences et se sont positionnées au cœur du processus de politisation
de la Politique européenne de voisinage. Tout d’abord les délégations représentent l’UE et non plus
seulement la Commission ce qui impact directement l’autorité et le rôle des chefs des délégations qui
ne sont plus des haut fonctionnaires détachés mais qui agissent comme de véritables « ambassadeurs »
ayant des responsabilités politiques. La fin de la présidence tournante traduit aussi un rôle accrue pour
les délégations désormais chargées de coordonner et d’organiser des réunions mensuelles avec les
ambassades des Etats membres. Ce faisant, elles se positionnent de facto au cœur du jeu diplomatique
dans les pays tiers. Et ce d’autant plus qu’il s’agit de pays « fragiles » où la coopération au
développement, l’aide humanitaire, la coordination avec d’autres acteurs multilatéraux (Banque
mondiale, Agences onusiennes, Banque européenne pour le développement et la reconstruction, etc.)
constituent un élément déterminant des relations diplomatiques avec les pays membres de l’UE78. Là
encore nous retrouvons, sur le terrain, l’hypothèse selon laquelle l’UE tend à se spécialiser, à travers un
processus de mutualisation des moyens, sur les thématiques DH/démocratie.
Ce processus traduit aussi l’asymétrie des moyens financiers (Fonds européen pour le développement,
Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDH), Instrument pour la stabilité,
dont dispose l’UE par rapport aux Etats membres. « The substance of the work of EU Delegations has,
in most cases, changed from a strong focus on trade and/or aid to include more political work, supported
by the diplomats coming from member states and including, in some cases, more security-related work.
In other words, although overall staffing levels have not significantly increased, the competences, range
of issues dealt with and role within the EU and in representing the EU has seen notable changes. » 79
77 “Thematic evaluation of the European Commission support to respect of Human Rights and Fundamental Freedoms”, op.
cit., 78 Entretien DG DEVCO (2) (Commission) : Direction F voisinage, Division F.1 coordination géographique Sud, Country Desk
Tunisia – 18 juin 2014, Bruxelles 79 Rosa BALFOUR, “The role of EU delegations in EU human rights policy”, Directorate-General for External Policies of the
Union Policy Department, 2013
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
34
L’élargissement des compétences des délégations de l’UE est sûrement l’élément le plus important pour
notre étude. Les prérogatives en matière de droits de l’Homme avant peu développées au sein des
délégations80 font aujourd’hui partie des compétences des agents. La mise en place d’un réseau de points
focaux « droits de l’Homme » dans les délégations et l’élaboration, par les délégations elles-mêmes,
d’un document stratégique par pays sur les droits de l’Homme « Human Rights Countries Strategies »81
sont deux des réalisations les plus visibles de cette réorientation du travail des délégations. Au niveau
de la PEV, les délégations jouent un rôle accru dans toute les phases de la mise en œuvre de l’Instrument
européen de voisinage (IEV), de la préparation des documents stratégiques (Plan d’Action, Single
Support Framework) à la mise en œuvre (allocation des fonds, aide budgétaire) en passant par le suivi
(rapport mi- étape sur les avancées en matière de droits de l’Homme et de démocratie) et l’évaluation.
Autrement dit l’expertise des délégations tend à être davantage valorisée qu’elle ne l’était et ce, au profit
d’une intégration transversale des droits de l’Homme.
Tout au long du chapitre II, nous avons étudié la politisation des relations extérieures sous plusieurs
angles : institutionnel à travers le rôle du SEAE dans la cohérence et la coordination des politiques
extérieures de l’UE et thématique à travers la reformulation des priorités via une montée en charge de
l’axe DH/démocratie. Ainsi avons-nous analysé la politisation via les nouveaux moyens dont dispose
l’UE (SEAE) et la reformulation de ses objectifs. Il nous reste donc à évaluer l’impact de
l’environnement géopolitique dans le processus de politisation de la PEV. En janvier 2011, lorsque le
régime de Ben Ali tombe sous la pression de la rue et que les soulèvements se propagent rapidement
aux autres pays de la région, les mutations institutionnelles qui façonnent la politique extérieure de l’UE,
et plus spécifiquement la PEV, se retrouvent de nouveau confrontées à un contexte politique mouvant
face auquel aucune chancellerie européenne n’était préparée. Dans ce cadre, le processus de politisation,
sous l’angle de la reformulation des priorités politiques, est aussi une conséquence directe des printemps
arabes, qui va obliger l’UE à redéfinir et dépasser le dilemme démocratie-sécurité pour mettre au cœur
de la PEV la promotion de l’Etat de droit, la démocratie et les droits de l’Homme.
CHAPITRE III : Les printemps arabes - L’Union européenne face aux bouleversements politiques
La réponse de l’UE aux printemps arabes peut être analysée selon trois niveaux. Le premier, celui des
mesures d’urgence (gel des avoirs, aide humanitaire) et des communiqués de presse où l’UE se
repositionne en faveur des mouvements. Le deuxième correspond à la réorientation stratégique du volet
80 Voir le rapport : “Thematic evaluation of the European …”, op. cit., selon lequel seul 12% des délégations de l’UE pensent
que l’intégration des droits de l’Homme est « d’une importance élevée » 81 Ces documents sont classés confidentiels, ils sont néanmoins élaborés en consultation avec les principals ONG actives dans
le domaine des droits de l’Homme.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
35
politique de la PEV. Le troisième correspond au volet programmatique de la PEV avec l’élaboration
d’un nouveau programme régional (le programme SPRING) ayant vocation à traduire les engagements
de l’UE dans le soutien aux processus de « transition démocratique ». Les deux derniers niveaux sont
concomitants et se rejoignent au niveau de la mise en œuvre, dans la mesure où la reformulation du volet
politique (conditionnalité, redéfinition des objectifs communs) a vocation à déterminer le volet
programmatique – aide financière, prêts, assistance technique, support budgétaire, etc.
A chaque niveau l’objectif est donc d’évaluer comment l’UE a su mettre à profit ses nouveaux outils
diplomatiques (SEAE, délégations, etc.). Cette approche nous permettra de confronter l’hypothèse d’une
politisation croissante des relations extérieures de l’UE à la réalité des faits et la capacité de l’UE à
améliorer sa visibilité dans le jeu diplomatique. La notion de visibilité est importante des lors qu’elle
constitue un des objectifs clé pour le SEAE inscrit dans le traité de Lisbonne. Elle est d’autant plus
importante dans le cadre du premier niveau d’analyse, celui du discours et des communiqués de presse,
qui correspond à la réaction immédiate de l’UE. La visibilité de l’action extérieure de l’UE n’est pas un
gage d’efficacité ni de cohérence mais reflète plutôt la capacité de l’UE à se positionner au cœur du jeu
politique – pour donner de la résonnance et du poids à son discours. Aussi a-t-on souvent employé
l’expression de « premier test » pour définir la réponse du SEAE sur ce dossier. Nous analyserons aussi
le rôle croissant joué par le Parlement européen. Enfin, toute la deuxième partie de notre chapitre sera
consacrée à la réponse politico-institutionnelle et programmatique de l’UE dans l’optique d’évaluer si
ces réponses s’inscrivent dans un dépassement du dilemme-démocratie. Ici nous verrons la réponse de
l’UE au niveau général, sans entrer au niveau bilatéral qui fera l’objet de notre 4ème chapitre.
6. Les bouleversements des printemps arabes et la réaction de l’Union
6.1) La réaction immédiate de l’Union européenne
Sans entrer dans une approche factuelle des printemps arabes, qui n’apporterait rien à notre exercice,
rappelons brièvement la violence et la rapidité inouïe avec laquelle les mouvements se sont propagés.
En moins de deux mois, la chute du régime de Ben Ali en Tunisie puis le départ de Moubarak vont
générer un tremblement politique au voisinage de l’UE. La Libye puis la Syrie vont entrer en guerre
civile tandis qu’au Maroc et en Jordanie les monarchies sont aussi confrontées à des mouvements
populaires. L’Algérie aussi devra faire face à des contestations massives. Il n’existe cependant pas un
mais des printemps arabes qui s’inscrivent dans une histoire propre où les acteurs politiques,
institutionnels et religieux jouent un rôle différent. Cependant, les causes profondes de ces révoltes se
rejoignent sur des référents essentiellement socio-économiques (chômage endémique, corruption, etc.)
et sociétaux (liberté d’expression, Etat de droit, etc) qui cimentent ces mouvements touchant aussi la
péninsule arabique, au Bahreïn et au Yémen. Au Yémen la situation dégénère en guerre-civile sur fond
de conflits tribaux qui viennent se greffer sur les manifestations « pacifistes ».
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
36
Une analyse minutieuse des communiqués de la HR/VP, Catherine Ashton, montre que l’UE a réagi
relativement rapidement aux événements - 7 communiqués au mois de janvier de la HR/VP, 14 en
février. Le 10 janvier une déclaration conjointe avec le Commissaire à l’élargissement « déploraient les
violences à l’égard des manifestants pacifistes » juste avant la chute du régime de Ben Ali82. En 2011,
les communiqués relatifs aux printemps arabes représentaient environs 27% des communiqués de
Catherine Ashton83. En revanche elle montre aussi que ces réactions sont restées relativement « timides »
et « attentistes ». Pour les représentants de la société civile, l’UE n’a pris la mesure des événements en
cours que tardivement84, après que les violentes répressions ne l’aient poussée, notamment sous la
pression de l’opinion publique, des médias et de la société civile, à prendre une position plus ferme.
La faiblesse du « contenu diplomatique » de ses communiqués, qui ne condamnaient pas directement
les régimes en place, couplée avec des réactions divergentes des Etats membres, n’ont pas permis à
l’UE, en tant que telle, d’acquérir dans l’immédiat une certaine visibilité. La dispersion des réponses
avec par exemple le positionnement ambigu de la France, qui a dans un premier temps proposé de l’aide
au régime de Ben Ali pour faire face aux manifestations (la Ministre des Affaires étrangères française
alors en poste avait émis l’hypothèse devant l’Assemblée Nationale de mettre au service de la Tunisie
« le savoir-faire, reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permet de régler des situations
sécuritaires de ce type »)85 ont aussi contribué à brouiller le positionnement de l’UE. Ici il nous faut
rajouter que la notion de visibilité est donc aussi intimement liée à celle d’unité.
Il ne suffit pas en effet de disposer de tous les outils diplomatiques, encore faut-il être en mesure
d’accorder les différents Etats membres pour jouir d’un mandat clair et ainsi parler d’une voix forte et
audible. Néanmoins, malgré la complexité inhérente au système diplomatique de l’UE (jeu à double
niveau en interne entre les Etats au sein du Conseil des Affaires étrangères et entre les institutions
Conseil, Commission, SEAE, Parlement), qui rend difficile l’unité (l’UE n’est pas un seul Homme…),
les printemps arabes ont représenté une « fenêtre d’opportunité » pour le SEAE. Comment étudier la
politisation partant des communiqués et des déclarations ? Exercice purement sémantique ou passage
obligatoire pour essayer de saisir le positionnement de la diplomatie européenne ? Sans accorder une
valeur toujours performative aux discours, en diplomatie chaque mot est pesé, mesuré, calculé car
chaque mot compte. C’est par les mots les expressions, « préoccupé », « gravement préoccupé », « appel
82 Déclaration du 10 janvier sur la Tunisie « Statement by the Eu high representative Catherine Ashton and European
Commissioner for Enlargement Stefan Fule on the situation in Tunisia », Brussel, 10 janvier 2011, A010/11. 83 Voir l’étude statistique “The four seasons of the “Arab Spring How EU institutions dealt with the Arab Spring in 2011”,
Palorma, 2011, qui propose une base de donnée classifiée qui reprend tous les communiqués des institutions européennes
relatifs aux printemps arabes en 2011. 84 Entretien réalisé avec la coordinatrice du Réseau Euroméditerranéen pour les droits de l’Homme (REMDH), Emilie Dromzé,
Bruxelles le 19 juin 2014. 85 Voir par exemple : « Tunisie : les propos "effrayants" d'Alliot-Marie suscitent la polémique », Le Monde.fr | 13.01.2011 à
18h23 • Mis à jour le 14.01.2011
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
37
à », « exhorte à », « condamne », « supporte », « se félicite », que les acteurs du jeu diplomatique
envoient des signaux quant à leur degré de préoccupation et leur positionnement. L’expression utilisée
par un officiel du SEAE « maintenant on dit qu’on fait de la politique »86 prend ici tout son sens.
Ainsi est-il frappant de constater que le nom des anciens leaders Tunisiens et Egyptiens n’apparaissent
presque jamais dans les déclarations de la Commission et de la HR/VP (Ben Ali ne sera même jamais
cité directement, c’est moins vrai pour le Colonel Kadhafi et le Président Bachar Al-Assad)87. On peut
aussi relever l’absence ou le faible usage du verbe « condamner » auquel est préféré celui de
« supporter ». Autrement dit, si l’UE « supporte » les mouvements se réclamant des valeurs censées
définir le rôle de l’UE sur la scène internationale, elle ne se positionne pas non plus de manière offensive,
plus politique, à travers le rejet de l’ordre existant. Des nuances entre les institutions sont cependant
perceptibles. Les communiqués du SEAE sont plus enclins à utiliser le verbe « condamner » quand ceux
de la Commission l’utilisent moins, le Parlement européen étant l’institution « condamnant » le plus
souvent dans ses communiqués88. Dans cette optique, la création du SEAE n’aurait donc pas eu un
impact clair en termes de message politique envoyé ? Le contenu restant avant tout « attentiste » avec
un support apporté mais sans réelle condamnation. En fait, comme l’a fait remarquer un représentant du
Ministère des Affaires étrangères tunisien89 le SEAE n’était pas encore suffisamment outillé pour faire
de la politique et ne jouissait pas d’une reconnaissance suffisante de la part du Conseil des Affaires
étrangères pour prendre une position franche contre les anciens régimes.
Si l’on peut critiquer le « manque de fermeté » de l’UE, force est de constater qu’après la chute de Ben
Ali et l’intensification des répressions mortelles en Egypte, le SEAE et l’UE vont « durcir » leur
position90 et prendre des mesures d’urgence qui vont refléter selon nous une certaine politisation, via le
gel des avoirs91 des présidents et des proches des présidents déchus. En Libye l’UE s’est positionnée
plus rapidement. En mai 2011, la HR/VP fut la première officielle de l’UE à se rendre en Libye pour
discuter avec les nouvelles autorités des modalités de soutien de l’UE et procéder à la création d’un
Bureau de représentation de l’UE à Benghazi, puis d’une délégation, inaugurée en novembre 2011 à
86 Entretien SEAE (3) op.cit 87 “The four seasons of the “Arab Spring How EU institutions dealt with the Arab Spring in 2011”, op. cit., p.10. 88 Ibid., p.14-15. 89 Entretien réalisé le 29 avril 2014. 90 Voir notamment le communiqué de Catherine Ashton du 10 février 2011, Brussels, 10 February 2011 A 051/11, voir aussi
le discours de Catherine Asthon du 23 février où la question de la fin du dilemme démocratie-sécurité est clairement abordé :
European Union, « Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton at the Senior Officials’ meeting on Egypt and
Tunisia », Brussels, 23 February 2011, A 069/11.
“Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Egypt following the speech of President Mubarak” 91 Le gel des avoirs est une compétence de l’UE. Lors du Conseil du 31 janvier les chefs de la diplomatie sur demande des
autorités de transitions avaient gelés les avoirs de Ben Ali et 48 de ses proches (Council Decision 2011/72/CFSP on 31 January
2011) de même pour Moubarak deux mois plus tard (Decision 2011/172/CFSP on 21 March 2011). Cependant le recouvrement
des avoirs est du ressort des Etats membres qui suivent leurs procédures. Aujourd’hui la question du recouvrement constitue
un enjeu de taille qui pèse sur les relations bilatérales de l’UE avec ces partenaires : voir notamment : « Andreas KETTIS and
Pekka HAKALA “Recovering Tunisian and Egyptian assets: Legal complexity challenges states in need”, directorate-general
for external policies, policy department, AFET-EXPO »
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
38
Tripoli. Sur le plan politique la Lybie constitue par ailleurs l’exemple typique des limites du SEAE
quand l’action se situe au niveau politico-militaire régi par une logique gouvernementale92. Une fois la
phase de conflit passée (durant laquelle l’UE s’est cantonnée à un rôle de pourvoyeur d’aide
humanitaire93), l’UE a repris un rôle plus central, notamment à travers la tentative de créer une mission
dans le cadre de la PSDC. Cette mission ne verra jamais le jour et sera vécue comme un « échec cuisant
pour l’UE » faisant cette fois-ci ressortir les limites de la coordination institutionnelle face à la
multiplication des acteurs impliqués dans la PSDC94. Ce détour par Tripoli nous permet de justifier le
choix de porter notre attention sur la Tunisie et l’Egypte plutôt que sur la Libye ou la Syrie. En effet, si
la composante militaire de l’action extérieure constitue, par essence, le champ privilégié de la
politisation de la politique étrangère de l’UE, il nous semble qu’elle est encore trop soumise à la logique
gouvernementale. Alors que les analyses se sont focalisées sur l’évolution de la PSDC, notamment dans
le cadre de la gestion de crise et de la coopération civilo-militaire, nous essayons de voir comment l’UE,
dans des domaines où la contrainte gouvernementale est moins présente, arrive à formuler une politique
extérieure dans un cadre bilatéral.
Ce qu’il faut retenir de la réponse immédiate de l’UE aux printemps arabes c’est qu’elle a permis de
donner corps à une nouvelle donne diplomatique européenne. On peut critiquer la personnalité de
Catherine Ashton et son approche de la « diplomatie silencieuse » mais il n’en reste pas moins que le
SEAE a su « faire parler de lui ». Durant le mois de février, la HR/VP a su acquérir une certaine visibilité
92 Lors d’un sommet spécial le 11 mars 2011 sur la Libye qui réunissait les chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union
européenne, les Etats membres de l’UE sont apparus divisés sur la demande de l’instauration d’une zone exclusive aérienne
soutenue en premier plan par la France et le Royaume Uni puis la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, le Danemark, la Finlande
et la Grèce. Or l’Allemagne en tête de file, suivi ensuite par une majorité des pays membres dont la Pologne, la Bulgarie,
Chypre, l’Italie se sont montré hostile (pour emprunter les termes diplomatiques) à cette option qui aurait des implications en
termes militaires pour l’Europe de la défense : Les conséquences de cette désunion pour l’Europe de la défense sont avant tout
d’ordre politiques et diplomatiques puis militaires ce dernier aspect étant soumis au consensus politique en amont : Tout
d’abord, cette absence de volonté commune a rendu caduque toutes opérations militaire possible de l’Union européenne.
Deuxièmement, la crise libyenne a cruellement mis en évidence l’incapacité des organes (SEAE) et des institutions
communautaires à peser sur les logiques gouvernementales dans le champ de la PSDC. Le fait que Catherine Ashton se soit
abstenue ne serait-ce que de faire des propositions d’engagement militaire de l’Union au Conseil européen, alors qu’elle aurait
très bien pu le faire, est révélateur. Enfin troisièmement, alors que L’Europe de la défense dispose de certains outils politique
avec le COPS et militaires - certes limités - mais qui auraient pu être utilisés (même juste en appui de la machinerie de l’OTAN)
la crise libyenne à révéler cruellement que les efforts d’institutionnalisation, de l’émergence de structure de coopération
permanentes n’ont pas abouti dans la pratique en terme d’opérationnalité. 93 80,5 millions d'euros déboursés pour la fourniture d'une aide humanitaire lors de la phase de conflit, en 2011 en Libye. Voir :
Conseil de l’Union « Réponse de l'UE au «Printemps arabe»: état des lieux deux ans après », Bruxelles, le 8 février 2013, A
70/13. Voir aussi le discours de Catherine Ashton pour qui le rôle de l’Union européenne, c’est « de faire du soutien humanitaire
avec des moyens militaires ». 94 L’exemple de la « première mission virtuelle » EUFOR-Libye est édifiant : la liaison avec le Bureau des Affaires
Humanitaires de l’ONU (BCAH/OCHA) et la mise en place d’un quartier opérationnel de commandement (OHQ) établi de
façon ad hoc et non rattaché dans le processus de décision au SEAE, a mis en évidence l’inefficacité de la chaîne décisionnelle
et le manque de coordination entre les échelons politique, institutionnel et militaire. D’autre part, ce manque d’unité et de
lisibilité dans la chaîne de commandement ont sensiblement limité et impacté la bonne coordination avec les partenaires de
l’Union européenne. L’action extérieure de l’UE en matière de gestion de crise bénéficierait d’une centralisation accrue de
l’ensemble de la chaîne de commandement sous l’égide du SEAE. Cette logique va dans le sens du rapport de Ministère des
affaires étrangères de 2013 sur le SEAE qui confirme « le bien-fondé des ambitions et l’intérêt d’une approche plus cohérente
des relations extérieures de l’Union européenne, dont le SEAE est le principal instrument » (Rapport du Ministère des affaires
étrangères sur le SEAE, 2013). Voir aussi l’organigramme de la PSDC en Annexe pour la multiplication des acteurs dans la
PSDC.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
39
auprès de ses partenaires lors de plusieurs déplacements en Tunisie, Egypte, Liban, Jordanie95. Bien
entendu cela ne constitue pas un objectif en soi mais cela a contribué d’une certaine manière à
positionner favorablement l’UE auprès des acteurs de la révolution alors qu’elle avait soutenu tacitement
pendant des dizaines d’années les régimes en place. Mais la véritable plus-value du SEAE se mesure
plus à sa capacité à apporter une réponse stratégique, politico-institutionnelle deux mois après les
premiers soulèvements et à jouer le rôle de coordinateur de l’aide européenne via notamment la création
de Task-Force.
6.2) Le rôle du Parlement européen
Le Parlement européen a toujours « milité » pour la promotion de la démocratie et des droits de l’Homme
comme principe fondateur de la politique extérieure de l’UE. Depuis les années 1980 le Parlement
européen a participé à plus de 120 missions électorales dans plus de 60 pays96. En 2008 il a créé l’office
de promotion de la démocratie parlementaire pour élargir son champ d’action. La sous-commission
droits de l’Homme du Parlement européen constitue aussi un organe actif œuvrant à leur intégration
transversale et à leur respect dans toutes les politiques de l’UE. En 2012, le Parlement a joué un rôle
moteur dans la nomination d’un « Haut représentant spécial pour les droits de l’Homme », M.
Lambrinidis, ancien député européen et ancien vice-président du Parlement, pour améliorer la visibilité
et la cohérence de l’UE dans ce domaine d’action97. Cette demande du Parlement européen n’est pas
sans rapport avec les événements du printemps arabes qui vont lui permettre d’accentuer sa pression sur
la Commission, le SEAE et le Conseil pour prendre des mesures ambitieuses. Ainsi va-t-il se montrer
particulièrement réactif tout au long des soulèvements populaires, en essayant, dans la mesure de ses
compétences, d’influencer les prises de position du SEAE.
Il n’est pas évident cependant de saisir l’impact du Parlement européen sur la politique extérieure de
l’Union européenne. Toujours est-il que depuis le Traité de Lisbonne le Parlement est amené un rôle
accru dans la définition des priorités et dispose de plus de leviers de pression sur le SEAE et la HR/VP,
chargée de rendre des comptes et de prendre en considération les résolutions du Parlement européen.
Dans ce cadre, le Parlement européen a su impacter les décisions et le positionnement du SEAE. Tout
95 “EU High Representative Catherine Ashton chairs Middle East Quartet Ministerial meeting in Munich,” Brussels, 4 February
2011, A 044/11; “Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton at the Senior officials’ meeting on Egypt and
Tunisia,” Brussels, 23 February 2011, A 069/11; “Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the end of her visit
to Egypt,” Cairo, 22 February 2011, A 067/11; “Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the end of her visit
to Lebanon,” Brussels, 16 February 2011; “Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton during her visit in
Jordan,” MEMO/11/93, Brussels, 16 February 2011; “Remarks by the High Representative/ Vice President Catherine Ashton
at the end of her visit to Tunisia,” 14 February 2011: Voir aussi pour un développement plus approfondi sur la presence de la
HRVP sur la scène politique méditerranéenne, Erwan Lannon,“The Lisbon Treaty and Euromed Relations The New
Architecture of the Treaty of Lisbon: Implications for Euro-Mediterranean Relations”, IeMed, 2011, p 39-40. 96 “Strengthening Parliaments Worldwide: the European Parliament and the promotion of democracy”, OPPD. Retrieved June
15, p.8 97 Voir « Un Monsieur Droits de l’Homme pour l’Europe : Stavros Lambrinidis », Info EU-logos, 6 septembre 2012 : « M.
Lambrinidis a salué "les demandes constantes du Parlement pendant des années" en faveur de la création de ce poste. ».
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
40
d’abord dans ses résolutions du 3 février et du 17 février les députés européens ont clairement condamné
les régimes en places en Tunisie et en Egypte et ont appelé la HR/VP à entreprendre le plus rapidement
possible des mesures adéquates de solidarité et de soutien aux mouvements démocratiques.
Par ailleurs, au niveau de la responsabilité des dirigeants devant les députés européens il n’est pas anodin
de constater que le parlement européen a su se mobiliser pour organiser pas moins de 10 auditions98, au
plus haut niveau du SEAE et de la Commission. L’analyse des résolutions du parlementent européen
fait ressortir un discours beaucoup plus offensif, politique et direct (les députés s’adressant directement
aux autorités en place) qu’on ne retrouve pas dans les communiqués du SEAE et de la Commission99.
Plus spécifiquement, dans sa résolution du 3 février concernant la Tunisie, ce sont les députés européens
qui ont en premier lieu émis la nécessité de créer une Task force pour la Tunisie (qui sera effectivement
mise en place durant l’année 2011)100.
Au-delà des recommandations qui peuvent être faites au SEAE et à la Commission l’impact du
Parlement semble plus se situer au niveau des perceptions et de l’image. Concrètement le Parlement a
su mobiliser les médias et l’attention de l’opinion publique, il a su aussi se faire la caisse de résonnance
de la société civile pour pousser les institutions européennes à durcir leurs positions101. Mais il ne faut
pas seulement concevoir le rapport SEAE/Commission-Parlement européen comme conflictuel102. En
effet, la fermeté des prises de position du parlement européen a aussi conféré au SEAE une certaine
légitimité face au Conseil des Affaires étrangères pour aller plus loin dans la condamnation des régimes
et le support apporté aux soulèvements. C’est là un point essentiel dans la mesure où le Parlement
européen a toujours eu tendance à privilégier la logique communautaire plutôt que gouvernementale
dans son approche des relations extérieures de l’UE. L’action du Parlement ne se limite pas à des
résolutions ou à l’organisation d’auditions, mais déborde aussi sur le deuxième niveau de notre analyse
des réponses de l’UE aux printemps arabes, celui de la reformulation des cadres de coopération103.
98 “The four seasons of the “Arab Spring How EU institutions dealt with the Arab Spring in 2011”, op. cit., p.3. 99 European Parliament resolution of 3 February 2011 on the situation in Tunisia ; European Parliament resolution of 17
February 2011 on the situation in Egypt : “2.Strongly condemns the violence and disproportionate force used against protesters
and deeply regrets the resulting considerable loss of l ife and the high number of injuries; 3. Calls for the immediate and
unconditional release of all peaceful demonstrators, prisoners of conscience, Egyptian and international human rights
defenders, journalists and lawyers;urges in this respect the Egyptian authorities to immediately disclose the whereabouts of
those detained and to ensure that they are protected from all forms of torture or other ill-treatment;” 100 European Parliament resolution of 3 February 2011 on the situation in Tunisia 8. Calls on the High Representative to promote
the: establishment of a task force, involving Parliament, to meet Tunisia’s needs in terms of assistance for its democratic
transition 101 Voir notamment l’article paru dans le Monde du 3 février 2011 : « Catherine Ashton sous le feu des critiques au Parlement
européen », Le Monde.fr avec Reuters | 03.02.2011 à 19h10. 102 Entretien SEAE (3). Sur la question du Budget aussi le Parlement européen constitue un allié de taille pour le SEAE et la
DG DEVCO. Par ailleurs le Parlement européen a notamment joué un rôle majeur dans l’augmentation de l’enveloppe allouée
à l’instrument européen de voisinage. 103 Voir la Résolution du 14 Décembre 2011 du Parlement européen sur la Politique européenne de voisinage/ voir encore par
exemple la Résolution du Parlement européen, « stratégie de l'Union européenne en matière de commerce et d'investissements
pour le sud de la Méditerranée après les révolutions du Printemps arabe », 10/05/2012, (2011/2113(INI)).
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
41
7. Vers un dépassement du dilemme « démocratie-stabilité » ?
Face aux défis historiques des printemps arabes, l’UE s’est retrouvée contrainte de reconnaître l’échec
de ses politiques menées dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. Au niveau régional, mais
surtout au niveau bilatéral où l’UE a délégué au second rang les préoccupations relatives aux droits de
l’Homme. Au fond, ce qui est en jeu dans la réponse de l’UE c’est bien un changement de paradigme
pour dépasser le dilemme « démocratie et stabilité régionale» qui prévalait en mettant au premier rang
une approche de la stabilité fondée sur la promotion de l’état de droit, la liberté d’expression et le soutien
à la société civile. La puissance du «souffle démocratique» engendré par les printemps arabes en Tunisie
et en Egypte ouvrait de nouveaux Horizons pour les politiques euro-méditerranéennes trop longtemps
engluées dans le statut quo des régimes autocrates vieillissants sur fond de conflits régionaux complexes
et multiples. Les printemps arabes ont permis à l’UE de reformuler son offre politique et
programmatique.
7.1) La réponse politico-institutionnelle de l’Union européenne
La réponse politico-institutionnelle de l’Union européenne s’est effectuée en deux temps. Tout d’abord,
l’UE s’est dotée d’un «Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la
Méditerranée »104 le 8 mars 2011, puis a engagé une réforme de la PEV à travers la communication «
stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation»105 adoptée le 25 mai 2011. Pris dans l’urgence
des procès en légitimité et des crises politiques et institutionnelles, on mesure encore mal la portée de
ce revirement stratégique, qui pose les bases d’un glissement vers un dialogue politique approfondi au
niveau bilatéral entre l’UE et ses partenaires.
7.1.1 Le Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée
La publication de la Communication conjointe SEAE/Commission «Partenariat pour la démocratie et
une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée » va permettre de dépasser le stade de la réaction
immédiate et des mesures d’urgence afin de poser les bases d’une nouvelle approche pour les politiques
méditerranéennes dans plusieurs domaines. Les principaux axes du nouveau partenariat reposent sur un
pilier politique et un pilier économique. Le pilier politique s’articule autour de deux propositions
majeures :
«Une transformation démocratique et un renforcement des institutions» (libertés fondamentales,
les réformes constitutionnelles, la réforme du système judiciaire et la lutte contre la corruption;
104 Communication conjointe de la Commission européenne et de la HR/VP « Partenariat pour la démocratie et une prospérité
partagée avec le sud de la Méditerranée », COM(2011), 200 final. 105 Commission européenne, « stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation », COM(2011), 303.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
42
«un partenariat renforcé avec les populations » (appui à la société civile et augmentation des
possibilités d’échanges et de relations interpersonnelles, facilitation des visas, etc)
Le pilier économique se traduit par un engagement en faveur d’une « croissance et un développement
économique durables et inclusifs » (soutien aux petites et moyennes entreprise (PME), à la formation
professionnelle et scolaire, amélioration des systèmes de santé et d’enseignement et développement des
régions peu favorisées, etc). Au fond, seul le premier axe « transformation démocratique et un
renforcement des institutions » constitue quelque chose de relativement nouveau dans le sens où l’action
de l’UE est « recontextualiée » et « priorisée » dans un cadre bien précis, celui des transitions
démocratiques. Pour l’UE cette nouvelle stratégie doit « représenter un changement fondamental dans
les relations avec ceux de ses partenaires qui s’engagent dans des réformes spécifiques (…) »106. L’UE
entend établir « une coopération politique plus étroite qui impose de tendre vers des normes plus élevées
en matière de droits de l’homme et de gouvernance »107.
Le deuxième axe du pilier politique, l’appui à la société civile recoupe le premier, celui de la
« transformation démocratique ». L’UE entend établir un mécanisme de voisinage en faveur de la société
civile et organiser un Forum du dialogue social108. La communication contient aussi des éléments plus
programmatique (mise en place de nouveaux instruments financier) qu’on retrouve aussi au niveau
économique (augmentation de 1 milliards d’euros de la facilité euro-méditerranéenne de prêts accordés
par la BEI, élargissement du mandat de la Banque européenne de reconstruction, programme de soutien
au développement agricole et rural).
A terme, cette communication consiste à (i) « réviser et adapter la politique européenne de voisinage »,
(ii) « progresser vers un statut avancé dans les accords d’association » et (iii) « renforcer le dialogue
politique ». Pour y arriver la Communication pose les bases des principes de différenciation et de
conditionnalité censés donner corps à la politisation et à l’approfondissement des relations bilatérales
autour des avancées démocratiques. Pour autant, difficile de voir une quelconque évolution par rapport
à l’ancienne PEV, qui reposait déjà sur ces deux notions sans être parvenue à des résultats concluants.
Pour certain représentant du SEAE la Communication du 8 mars 2011 reprend trop « l’esprit de
Barcelone », à travers l’utilisation de termes comme « prospérité partagée », « accord de libre-échange
approfondie », « conditionnalité » sans pour autant proposer une nouvelle approche109. La nouveauté
réside plutôt dans une approche plus stricte de la conditionnalité positive « more for more ».
106 « Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée », op, cit., p.5 107 Ibid., p.5 108 Ibid., p.6 109Entretien SEAE (3) et voir notamment : « The Organisation and functioning of the European External Action Service:
achievements, challenges and opportunities », op., cit, p.55 : “As one EEAS official mentioned, language such as ‘sharing
prosperity’ and ‘deep and comprehensive FTAs’ goes back to the nineties and the Barcelona Process, and is therefore a wholly
inadequate response to today’s challenges.”
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
43
C’est sous cet angle que nous devons comprendre « le changement fondamental » voulu par l’UE dans
ses relations bilatérales. L’innovation pour Erwan Lannon, qui a beaucoup travaillé sur les politiques
euro-méditerranéennes, réside dans le fait que la conditionnalité positive - pouvant induire des
pénalités/sanctions (aides « réallouées » et recentrées ») - est mise en avant ce qui n’était pas le cas dans
les communications précédentes110. Le rôle central joué par le SEAE dans la communication de Mars111
est aussi un élément censé redonner de la crédibilité à la conditionnalité (cf « maintenant on dit qu’on
fait de la politique »112).
7.1.2 Vers une nouvelle PEV et de nouveaux instruments diplomatiques
La réforme de la PEV avait été engagée en 2010 avec la reprise en main par le SEAE de cette politique
fondamentale pour l’UE. Dans ce processus quelque peu bureaucratique, qui s’inscrivait avant tout dans
le cadre de la future période de programmation 2014-2020, les printemps arabes ont résolument changé
la nature de l’exercice au profit d’une approche plus politique. Les premières pages de la communication
de mai 2011 peuvent être analysées comme un mea culpa113, une remise en question des logiques sous-
jacentes à la PEV (qui n’aurait pas forcément vue le jour si les printemps arabes n’avaient pas obligé la
Commission et le SEAE à retarder l’examen de la PEV). Globalement, la Communication de mai 2011
reprend les grandes lignes de celle de mars, en intégrant les partenaires de l’Est et en clarifiant les
principes de conditionnalité et de différentiation.
La conditionnalité constitue le cœur de la « nouvelle stratégie à l’égard d’un voisinage en mutation. Elle
est fondamentalement reliée aux avancées dans le domaine des droits de l’homme et de l’Etat de droit.
La Communication dresse cinq critères censés donner corps au principe de conditionnalité : (1) des
élections libres et régulières; (2) la liberté d'association, d'expression et de réunion, ainsi que la liberté
de la presse et des médias; (3) l'administration de l'État de droit par un pouvoir judiciaire indépendant
et le droit à un procès équitable; (4) la lutte contre la corruption; (5) la réforme du secteur de la sécurité
et du maintien de l'ordre (y compris la police) et l'établissement d'un contrôle démocratique des forces
armées et de sécurité. On retrouve ici clairement la tendance procédurale de la PEV, définir des
indicateurs sur lesquels l’UE pourra évaluer les avancées de la PEV. Evaluations elle-même intégrées
110 Erwan Lannon, « L’union européenne et la nouvelle donne géopolitique en Méditerrannée ; bilan des premières réponses
de l’UE et perspectives dans un contexte en mutation », EuroMesco paper, 2011, Bruxelles, p.16. 111 Voir chapitre précédent sur le rôle du SEAE dans le système diplomatique européen et ses relations avec la DG ELARG.
Pour les officiels du SEAE les communications conjointes de mars et mai 2011 sont un exemple de bonne coordination avec
les services de la Commission, voir « The Organisation and functioning of the European External Action Service… », op., cit,
p.54-56. 112 Entretien SEAE (3) 113 Commission européenne, « stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation », op. cit., p.1 : « Les récents événements
et les résultats de l'examen ont montré que le soutien de l'UE aux réformes politiques entreprises dans les pays voisins n'avait
porté ses fruits que de manière limitée » ; « La nouvelle approche doit être définie sur la base d'une responsabilité mutuelle et
d'un attachement commun aux valeurs universelles des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit. » p.2
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
44
au cadre règlementaire de l’Instrument européen de voisinage. Dans ce contexte, Erwann Lannon parle
alors d’européanisation du volet Sud de la PEV via un rapprochement avec la politique européenne
d’adhésion fondée sur une conditionnalité forte (voir les critères de Copenhague)114.
Cependant l’on pourrait aussi arguer que la conditionnalité « soulève plus de problème qu’elle n’apporte
de solution ». Tout d’abord la conditionnalité, même augmentée sous sa forme positive et incitative
(more for more), ne semble pas constituer un élément novateur de la PEV. Elle a toujours été présente
et sa reformulation se heurte aux mêmes dilemmes. Comment concilier l’approche différenciée et la
conditionnalité sans favoriser une diplomatie des droits de l’Homme (universels) à géométrie variable
sans véritable consistance ou continuité. Quel est le juste milieu à trouver entre sanctions et incitations
selon les avancées de chacun ?
La conditionnalité soulève aussi la question de la légitimité de l’UE d’une part et sa capacité d’influence
d’autre part. Cette dernière limite d’autant plus l’efficacité de la conditionnalité que « l'initiative
appartient au pays partenaire et le soutien de l'UE sera adapté en conséquence. ». Autrement dit, l’UE
ne cherche pas à imposer mais s’engage à soutenir/accompagner les pays qui souhaitent s’avancer dans
cette direction. C’est là, une évolution dans la rhétorique diplomatique européenne. L’UE semble
prendre une posture « d’écoute » qui reflète en quelques sorte le mea culpa : L’UE n’aurait pas de leçon
à donner aux nouveaux acteurs de la scène politique des pays partenaires, mais se tient à leur disposition
pour toute aide dans le cadre de l’approche more for more. C’est l’approche « listening » mise en avant
par Rosa Balfour dans la réponse de l’UE115. Selon cette approche, la conditionnalité, limitée par la
« bonne volonté » des pays partenaires à s’engager dans la voix des réformes, pose frontalement la
question des incitations et du pouvoir d’attraction de l’Union européenne. En d’autres mots qu’est-ce
que l’UE propose à ses partenaires ?
Ce que l’UE offre repose sur ce que l’on appelle désormais les « 3M » pour Money, Market, Mobility.
Le premier élément fait référence à l’assistance budgétaire mais aussi technique et englobe la
coopération au développement. Le deuxième, qui s’inscrit dans le moyen-long terme, correspond à
l’approfondissement des relations bilatérales via la négociation d’Accord de Libre Echange Complets
et Approfondis (ALECA). Le troisième repose sur la négociation de Partenariat de Mobilité. Pris
ensemble, ces trois éléments façonnent en grande partie l’offre de l’Union européenne. Cependant, cette
114 Erwan Lannon, « L’Union européenne et la nouvelle donne géopolitique en Méditerranée : bilan des premières réponses de
l’UE et perspectives dans un contexte ne mutation », Barcelone, Institut de la Méditerranée - Euromesco, PapersIEmed n°11
avril 2012, p.24-25. 115 Balfour Rosa, “EU conditionality after the Arab Spring, Barcelone, European Institute for the Mediterranean” ; EuroMesco,
PapersIEMed n° 16, 2012, p.7-9, p.24 : “Much emphasis has been placed, in speeches and in re-inventing the European
diplomatic narrative towards the region, on the EU’s new “listening mode”, and on its “humility” and “modesty” in its
dealings with reforming Arab leaders.” Voir aussi Rosa Balfour, « Changes and Continuities in EU-Mediterranean Relations
after the Arab Spring » in An Arab Springboard for EU Foreign Policy?, Egmont Paper n°54, January 2010, p27-34.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
45
approche ne semble pas marquer une rupture avec « l’ancienne PEV ». L’ouverture du Marché européen
reste conditionnée à une standardisation règlementaire élevée et couteuse116. Les accords de mobilité
recouvrent plusieurs domaines dont celui des accords de réadmission117 qui cherchent à déléguer le
contrôle des frontières aux partenaires. De plus la facilitation de visas s’apparenterait bien plus à une
politique de migration choisie à destination des étudiants, des employés qualifiés sans réelle ouverture
des frontières européennes.
Par ailleurs, la Communication dresse toute une série de politique sectorielle (affaires maritimes,
énergie, changement climatique, développement durable, enseignement supérieur, recherche
innovation) qui reprend « l’esprit catalogue » des Plans d’Action ratifiés dans le cadre de la PEV sans
qu’il n’y ait de véritable priorisation des domaines de coopération bilatérale. En fin de compte, si l’offre
de l’Union européenne en fait un partenaire stratégique, la conditionnalité se retrouve d’une certaine
façon limitée par l’étendue de cette offre.
D’un point de vue politique les communications de mars et de mai manquent de crédibilité et restent
donc confrontées à leur mise en œuvre sur le terrain. La conditionnalité n’est pas un gage de dépassement
du dilemme démocratie-sécurité. Si dans le discours on assiste bien à un changement de paradigme, où
la sécurité présuppose une « démocratie solide et durable », la capacité de l’UE à inciter ses partenaires
et à opérationnaliser la conditionnalité politique fait défaut. Aussi peut-on conclure que la
communication de mai ne conforte pas l’UE dans une « posture de puissance »118. Face à l’échec de ses
politiques et au reniement de ses valeurs supposées définir sa puissance normative, l’UE a cherché à
réorienter sa politique en se positionnant plus comme un accompagnateur des processus transitionnels
que comme un acteur moteur.
Il ne s’agit pas de nier l’engagement volontaire du SEAE et de la HR/VP, notamment au niveau
multilatéral avec de nombreuses rencontres avec les acteurs régionaux comme la ligue arabe et l’Union
africaine, mais de replacer les communications de mars et mai 2011 dans la continuité des précédentes
communications. La reformulation de la PEV peut être perçue comme le fruit des instruments, des
procédures et de son héritage plutôt que la conséquence des enjeux et des défis des printemps arabes.
En somme, comme l’explique Aoun Elena dans son article « L'Union européenne en Méditerranée »
publié en 2013, il semble que « bloquée par une dépendance au sentier au niveau de ses approches
institutionnelles et politiques, l’UE soit incapable d’innover de manière à accompagner
116 Communication « vers une stratégie nouvelle… » op. cit., p.11 : « Les accords sur l'évaluation de la conformité et
l'acceptation des produits industriels visent à couvrir tous les secteurs où la réglementation est alignée sur celle de l'UE. Un
partenaire ayant atteint ce stade adhérerait de fait à une zone de libre-échange pour les produits industriels entre l'UE, l'EEE
et la Turquie. Une coopération étroite avec les organisations et les organes européens dans les domaines de la normalisation,
de l'évaluation de la conformité et de la métrologie peut faciliter la mise en œuvre de ces accords. » 117 118 Aoun Elena, « L'Union européenne en Méditerranée », Politique européenne 1/ 2013 (n° 39), p. 76-104
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
46
significativement les transformations induites par la révolte des peuples arabes. »119. La notion de path
dependence ou dépendance au chemin qui s’attache au poids des institutions et des procédures établies
dans le passé sur les décisions présentes est remarquablement bien adaptée à la PEV. Par sa nature
institutionnelle et procédurale, la PEV serait d’autant plus difficile à réformer. Ainsi le SEAE est-il
confronté à la dépendance au chemin qui rend la PEV trop rigide pour s’adapter de manière
proportionnée à des bouleversements politiques significatifs.
La désignation d’un représentant spécial de l’UE (RSUE) pour le sud de la Méditerranée en la personne
de Bernardino León constitue un élément à souligner dans l’apport du SEAE en termes diplomatique.
L’utilité de cette initiative réside essentiellement dans le renforcement de la présence diplomatique de
l’UE et la diversification des canaux diplomatiques avec un RSUE dont la fonction qui « peut être à
modularité variable, entre le super-ambassadeur itinérant et le missi dominici discret entre la diplomatie
et le politique, en ayant un lien direct à la fois avec la Haute représentante et les Etats membres. »120
7.2) La réponse programmatique de l’Union européenne
L’objet de cette sous-partie n’est pas d’évaluer l’impact de la réponse programmatique de l’UE, qui fera
l’objet d’un chapitre spécifique, mais de répertorier les différentes initiatives de l’UE afin de mieux
saisir sa réponse aux printemps arabes. La réponse programmatique de l’UE s’est faite en plusieurs
étapes et à différent niveaux. Il est difficile de mesurer l’impact des programmes mise en œuvre pour
répondre aux printemps arabes. En tous cas, la réponse de l’UE au niveau programmatique a été assez
riche et a conforté l’UE dans son rôle de principal bailleur aussi bien en Tunisie qu’en Egypte, du moins
lors des premiers mois qui ont suivi la chute des régimes. L’UE s’est dotée d’un nouveau programme
d’aide au partenariat, aux réformes et à la croissance (SPRING), d’une rallonge budgétaire au titre de
l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), d’un renforcement des prêts accordés par
la Banque européenne d’investissement et d’un élargissement du mandat de la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement (BERD).
Les communications de mars et de mai 2011 contenaient déjà des éléments programmatiques : la
création d’une facilité société civile, dotée d’un budget de 26,4 millions pour la période 2011 (22
millions d’euros 2012-2013), et d’un Fonds Européen pour la Démocratie (FEDEM) ayant vocation à
soutenir les partis politiques, les ONG et les syndicats non enregistrés, constituent peut-être les éléments
les plus novateurs de la communication de mai.121. Au-delà de l’urgence de la situation, ces instruments
répondent à la réorientation politique vers une coopération renforcée avec la société civile. Avec le
FEDEM et la facilité de société civile, l’UE entend ainsi rééquilibrer son aide en faveur des acteurs non-
119 Ibid., p.29 120 Nicolas Gros-Verheyde, “Bientôt de nouveaux représentants spéciaux de l'UE », Bruxelles2, juin 2011 121 « L’Union européenne et la nouvelle donne géopolitique en Méditerranée… » op., cit p.27
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
47
gouvernementaux de manière plus flexible et plus autonome par le biais d’appel d’offre et de convention
de subvention qui peuvent directement être adressés au secrétariat du FEDEM122.
Mais c’est surtout l’annonce du programme SPRING le 14 juillet 2011 au Caire par le Président de la
Commission européenne qui marque le début de la phase programmatique. Le programme SPRING,
doté de 350 millions d’euros (65 millions pour 2011, 285 million pour 2012) n’est pas un projet en soi
mais consiste à réallouer des fonds, au niveau bilatéral, à des programmes en cours et à de nouveaux
projets en mettant l’accent sur deux axes : (i) « Consolidation of democratic reform and institution »
(40% de l’enveloppe) (ii) « Sustainable and inclusive growth and economic development » (60% de
l’enveloppe)123. Concrètement la grande majorité du programme sera gérée sous forme d’appui
budgétaire et l’autre partie au niveau de la Commission et des délégations via des appels d’offre. Aussi,
le programme SPRING constitue-t-il en quelque sorte la « vitrine » de la réponse de l’UE sans pour
autant constituer un programme ad hoc nouveau. Les projets existants, financés par l’IEVP, seront
labélisés « programme SPRING ». Dans la continuité de cette initiative, la création de Task Forces
chargées de coordonner l’aide et le suivi des différents programmes « post révolutions », constitue aussi
une étape importante qui va permettre à l’UE de se positionner comme un acteur moteur des processus
transitionnels.
7.2.1) Les Task Force : un instrument diplomatique de coordination
L’engagement de l’UE va s’articuler à la croisée du programmatique et du politique en cherchant à jouer
un rôle catalyseur au sein de la Communauté internationale. Le véritable apport du SEAE est d’avoir
réussi à réunir autour de la table à travers les Task Force UE-Tunisie et UE-Jordanie un large éventail
d’acteurs privés (une vingtaine d’acteurs venus de Tunisie, de France et d’Espagne représentant
différents secteurs du Gaz à l’Aide public au développement en passant par les PME et les grandes
institutions financières internationales124, etc.) et public. En Egypte, où l’UE dispose de moins de leviers
d’action, la constitution d’un tel instrument de coordination ne verra le jour qu’à la fin de l’année 2012.
Les réunions des Task Forces ont permis à l’UE d’apparaitre comme un « acteur global », mais aussi
d’accroitre sa crédibilité en tant qu’interlocuteur capable de catalyser la Communauté internationale.
C’est à travers cette Task Force que la Tunisie a présenté les préparatifs pour les élections de
l’Assemblée constituantes et la « stratégie de développement économique et social 2012-2016 ("Plan
122Site internet du FEDEM : https://www.democracyendowment.eu/fr/
Fiche de technique de la facilité : http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2011/af_aap-spe_2011_enpi.pdf 123 Action Fiche du programme SPRING : http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2011/af_aap-spe_2011_enpi-s.pdf 124 Les institutions internationales ayant participées à la réunion de la Task-Force : The European Investment Bank, EIB; The
European Bank for Reconstruction and Development, EBRD; The World Bank, WB; The International Monetary Fund, IMF;
The Islamic Development Bank, IDB; North Africa Region; The African Development Bank, AfDB; Union for Mediterranean,
UfM; Anna Lindh Foundation; Economic Cooperation Council
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
48
Jasmin") ». Autrement dit, l’UE apparaît dans ce cadre comme l’interlocuteur privilégié entre les
autorités Tunisienne et les grands bailleurs internationaux.
7.2.2) Une réponse en Tunisie basée sur le Plan Indicatif National
En Tunisie l’UE a su répondre assez rapidement et apporter un soutien, toute proportion gardée,
relativement important pour répondre aux enjeux sur le terrain. En 2011, l’UE a quasiment doublé son
aide au titre de l’IEVP de 80 à 160 millions d’euros. Sur la période 2011-2013 l’UE a réalloué au total
150 millions d’euros via l’IEVP, soit une hausse de 63%. Cette aide s’est principalement répartie à
travers deux programmes. Un programme d’Appui à la Relance « Support for Economic Recovery »
(100 millions d’euros) cofinancé sous forme de prêts à hauteur de 500 millions d’euros par la Banque
mondiale, de 500 millions par la banque africaine de développement et de 185 millions de l’Agence
française de développement125. Ce qui est intéressant ici c’est de voir comment l’UE arrive à créer un
effet de levier non négligeable et à aligner les autres bailleurs de fonds sur des programmes relevant de
l’IEVP. Le programme d’Appui à la relance est en fait la continuité des programmes « Strengthening
economic governance and competitiveness » puis de son successeur « The Programme for Economic
Integration » (ou Programme d’Appui à l’intégration II) programmés dans les Plans Indicatifs Nationaux
2007-2010 et 2011-2013126.
Dans ce cadre, assiste-t-on plus à l’extension des programmes en cours plutôt qu’à la formulation de
nouveaux projets, qui pourrait être mieux adaptés (cf « chemin de la dépendance »). Néanmoins, cette
réallocation des fonds a permis de créer un nouveau programme d’aide aux régions les plus démunies
(20 millions d’euros) et d’accroitre le programme d’appui à l’Accord d’Association via le soutien à la
société civile127. En amont, l’UE a débloqué une aide humanitaire de 80,5 millions d’euros pour faire
face notamment aux afflux de réfugiés venus de Libye128. Ainsi l’UE a-t-elle su articuler des réponses
sur le court terme (aide Humanitaire) et sur le moyen-long terme (programme dans le cadre du PIN).
Mais la véritable nouveauté réside peut-être dans l’allocation - pour la première fois - en Tunisie d’une
enveloppe de 2 millions d’euros au titre de l’Instrument Européen pour la Démocratie et les droits de
l’Homme (IEDDH)129.
125 Commission européenne “Neighbourhood : working for the southern Mediterranean, Eu support for Tunisia”, EUROPAID,
2012; Tunisia: European support of €110 million for economic recovery
European Commission - IP/11/974 23/08/2011 126 Programme Indicatif National 2007-2010, Programme Indicatif National 2011-2013 ; Voir aussi Martin Van Der Linde, Dr
Zine Barka, Yassine Hamza, Alaa Shaheen, Anja Willemsen, « The strategic impact and cost-effectiveness of EU budget
support with regard to supporting democratic transition in southern Mediterrenanean countries », Volume II- Country reports,
Policy department, European Parlaiment Study, October 2013. P37-39. 127 Ibid, p.39 128 Commission européenne “Neighbourhood : working for the southern Mediterranean, Eu support for Tunisia”, op., cit, p.2. 129 « The strategic impact and cost-effectiveness of EU budget…” op., cit, p.40
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
49
La réponse programmatique, tant au niveau de l’IEVP que des autres instruments (IEDDH et
Instruments pour la stabilité) semble corroborer la volonté politique de se focaliser sur la société civile,
notamment à travers le programme « Non-State Actors programme »130. Enfin l’organisation d’une
mission d’observation électorale pour les élections de l’Assemblée constituante est aussi un élément à
prendre en considération pour appréhender l’évolution du rôle de l’UE en Tunisie.
7.2.3) La réponse de l’UE en Egypte, quelle marge de manœuvre ?
En Egypte la réaction de l’UE au niveau de la coopération au développement a pris plus de temps. Ce
n’est qu’à partir de la réunion de la Task Force en novembre 2012 et la visite de M. Morsi à Bruxelles
que l’UE a annoncé le renforcement de son appui financier à hauteur de 750 millions d’euros. On voit
ici clairement le rôle du politique qui prédomine le programmatique. Cependant, il convient de détailler
cette aide qui comprend 90 millions d’euros au titre de l’IEVP ou autrement dit du programme SPRING,
le reste étant principalement alloué sous forme de prêt (500 millions d’aide macro financière et 163
millions au titre de la facilité d’investissement de voisinage).
Selon la délégation de l’UE en Egypte les programmes de coopération n’ont pas substantiellement
évolués du fait de la chute du régime. Tous les programmes ont continué malgré avoir connus un
ralentissement131. En fait il s’avère que le plus gros de la coopération programmatique entre l’Egypte et
l’UE après la révolution ait porté sur la négociation d’un « support budgétaire sectoriel » (SBS) dans les
secteurs de l’éducation, des transports, de la santé, de l’énergie (un SBS a été signé en décembre 2011
pour 26 millions d’euros) et de l’eau (un SBS a été signé en décembre 2011) ou des projets étaient déjà
en cours132. Sur le plan de la gouvernance démocratique, de la consolidation de l’Etat de droit et de
l’appui à la société civile, les négociations pour mener à bien des programmes au titre d’un contrat
d’appui à la consolidation de l’Etat pour les Etats fragiles (« State Building Contracts » (SBCs)) étaient
toujours en cours de négociation en 2013133. Le SBC n’est rien d’autre qu’une forme d’appui budgétaire
(modalité de mise en œuvre de l’aide) 134.
130 Sous forme d’appel à projet les acteurs de la société civile vont bénéficier de 2.5 millions d’euros : « “Neighbourhood :
working for the southern Mediterranea… », op, cit., p.3. 131 « The strategic impact and cost-effectiveness of EU budget…” op., cit p.18 132 Ibid, p.22 : 133 Ibid. p.23 134 L’appui Budgétaire permet d’apporter directement des ressources au budget national des Etats bénéficiaires ; la réforme de
l’appui budgétaire de 2012 a créé 3 types de contrats qui permettent de suivre et de contrôler la mise en œuvre des réformes :
l’appui budgétaire général, l’appui budgétaire sectoriel et le contrat d’appui à la consolidation de l’Etat pour les Etats fragiles
(le «State Building Contract»).
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
50
PARTIE II
La Politique Européenne de Voisinage et les processus
transitionnels en Tunisie et en Egypte
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
51
Au regard des évolutions institutionnelles et politiques la Politique européenne de voisinage se trouve à
un tournant de son évolution. Le dilemme démocratie- stabilité qui prévalait a été remis en question au
niveau de la réponse politico-institutionnelle mais aussi au niveau des nouveaux instruments dont s’est
doté l’UE. Tout au long de notre première partie nous avons voulu montrer comme le SEAE d’une part
avait permis de renforcer la cohérence de la PEV et comment les printemps arabes avaient poussé l’UE
à redéfinir ses objectifs au profit d’une conditionnalité plus stricte autour de droits de l’Homme et de la
démocratie. Pour autant nous avons aussi relevé une certaine continuité dans le discours. S’il y a bien
eut reformulation, et si le SEAE semble avoir joué un rôle déterminant dans les communications de mai
et de mars et dans la montée en charge des droits de l’Homme au sein des politiques extérieures de l’UE,
la capacité de la PEV a effectivement se réformer semble limité. Trois ans seulement après les
soulèvements au sud de la Méditerranée il est encore trop tôt pour appréhender le rôle du SEAE dans la
mise en œuvre de la PEV. Les données sont aussi assez limitées quant au rôle du SEAE et il est difficile
de saisir la capacité du SEAE à s’émanciper des positions des logiques gouvernementales.
Au terme de notre première partie, notre réflexion a permis de mettre en avant des ruptures (ou plutôt
évolutions) et des continuités. L’exercice nous amène donc à évaluer dans quelles mesures ces ruptures
se sont effectivement matérialiser trois ans après les soulèvements au sud de la méditerranée. En d’autres
mots, est-ce que la PEV a réellement évolué ou est-elle toujours limitée dans sa capacité à influencer
des réformes politiques (faible crédibilité de la conditionnalité, dilemme démocratie-stabilité, cadre
institutionnel rigide, indifférence des gouvernements…cf. chapitre I). L’idée étant non seulement
d’appréhender le rôle de l’UE comme acteur des processus transitionnels mais aussi de réfléchir sur la
pertinence du cadre même de la Politique européenne de voisinage pour répondre à des processus
traversés par des crises politiques et institutionnelles chroniques et parfois violentes.
CHAPITRE IV : La PEV, une politique adaptée aux processus transitionnels ?
Après avoir analysé la réponse immédiate de l’UE aux printemps arabes, le cheminement de notre
réflexion nous amène à évaluer comment l’UE a su concrétiser sur le terrain la reformulation de la PEV
et à étudier de manière comparée la capacité de l’UE à réaliser le potentiel de la PEV en Tunisie et en
Egypte. Cette comparaison nous paraît être une porte d’entrée intéressante pour mieux saisir la portée
du processus de politisation de la politique extérieure de l’Union européenne sous l’angle du principe
de différentiation et de conditionnalité. Mais avant d’analyser l’évolution des relations bilatérales UE-
Tunisie et UE-Egypte, il faut revenir sur le cadre même de la politique européenne de voisinage. Permet-
il à l’UE de répondre à des situations de crise ? Est-il adapté aux processus transitionnels ? Comment
les partenaires voient la politique européenne de voisinage ? Tenter de répondre à ces questions n’est
pas chose aisée mais cela nous permettra de mieux comprendre la particularité de la PEV, ses atouts et
ses faiblesses.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
52
8. La PEV – Du cadre politique au cadre programmatique : La réforme de l’Instrument européen de
voisinage : vers un instrument plus politique et plus flexible ?
La politique européenne de voisinage est une politique globale. L’UE est un « partenaire global »135, un
des rares acteurs offrant une telle diversité d’instruments allant de de la coopération au développement
à la politique migratoire en passant par les accords de libre-échange et les politiques sectorielles et la
coopération sécuritaire. Comment dans un contexte d’instabilité et de crises profondes ces instruments,
pris dans un cadre institutionnel complexe, peuvent-il être efficaces et répondre aux besoins des pays
partenaires tout en obéissant à la réorientation/politisation de la PEV en faveur de la promotion d’une
« démocratie solide et durable » ? D’après un entretien réalisé auprès d’un officiel de l’ambassade de
Tunisie à Bruxelles, il ressort que la PEV répond à une « mécanique lourde » au sein de laquelle
interviennent différents acteurs : L’UE a besoin de cadre, de procédures ayant vocation à
institutionnaliser les relations avec ses partenaires136. En période de crise la lourdeur bureaucratique de
certains instruments de coopération peut s’avérer inadaptée à l’urgence de la situation et limite la
capacité de l’UE à répondre rapidement. Mais parallèlement cette « lourdeur mécanique » reflète aussi
la dimension stratégique des relations bilatérales entre l’UE et ses partenaires, qui s’inscrivent dans le
temps long. Ce qui est intéressant dans la PEV, c’est cette tension entre la dimension globale qui
nécessite un dialogue politique approfondi et un cadre institutionnel et les besoins en termes de
flexibilité pour répondre aux processus transitionnels.
Deux éléments sont à prendre en considération quand on aborde la « lourdeur mécanique » de la PEV :
(i) le processus de programmation de l’IEV, (ii) la longueur des négociations faisant interagir de
nombreux acteurs sur des dossiers différents. Ainsi nous faut-il analyser dans quelle mesure l’UE a su
ou non adapter d’une part ses instruments pour simplifier le processus de programmation. Et comment
les différentes politiques qui façonnent la PEV ont évolué en réponse aux printemps arabes. Mais
s’arrêter au niveau de la flexibilité des instruments n’est pas suffisant et ne répond pas à notre réflexion
en termes de politisation de la PEV. Il nous faudra donc prendre en considération dans quelle mesure la
réforme de l’IEV traduit les aspirations des communications de mars et mai 2011.
8.1) La conditionnalité dans l’Instrument européenne de voisinage
Le nouvel Instrument Européen de Voisinage (IEV), adopté le 11 mars 2014 et doté de 15 433 milliards
d’euros, est le bras financier de la PEV. Il remplace l’ancien Instrument européen de voisinage et de
partenariat (IEVP). Concrètement, environ 90%137 de l’enveloppe allouée au titre de l’IEV est octroyé
135 Entretien Ambassade de Tunisie : Conseiller politique de l’Ambassade de Tunisie à Bruxelles, - 6 mai 2014, Bruxelles
137 L’IEV finance aussi des « programmes multi-pays » qui réponde à la dimension régionale de la PEV (UpM pour le sud et
Partenariat Oriental pour l’Est) ; Il finance aussi des programmes de coopération transfrontalière entre des États membres et
des pays partenaires qui partagent une frontière commune, le long de la frontière extérieure de l'UE (y compris la Russie).
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
53
au niveau bilatéral, majoritairement sous forme d’appui budgétaire (appui budgétaire général, appui
budgétaire sectoriel), d’assistance technique et d’appui à la société civile. En d’autres mots, L’IEV
constitue l’instrument qui finance les priorités définies dans les Plans d’Action.
Sous l’impulsion du SEAE et face aux printemps arabes l’UE a engagé une réforme de l’IEVP qui devait
permettre : (i) d’améliorer la flexibilité et de réduire la complexité du processus de programmation, (ii)
de renforcer le lien entre les Plans d’Actions et la programmation en tenant avantage compte des droits
de l'homme et de la démocratie et (iii) d’assurer la mise en œuvre l’approche « more for more »138.
Aligner la programmation de l’IEV sur les objectifs politiques définis au niveau des communications de
la PEV et donner corps à la conditionnalité politique sont surement les enjeux majeurs de la réforme de
l’IEV. L’UE n’ayant jamais usé de la conditionnalité au titre de l’IEVP qui restait soumise à la majorité
qualifiée au sein du Conseil sur proposition de la Commission139 (la majorité qualifiée n’étant pas la
seule cause du faible usage de la conditionnalité). Au-delà des critiques sur l’inconsistance de
l’enveloppe budgétaire par rapport aux ambitions de l’UE, la faiblesse de l’alignement sur les Plans
d’Actions constituent aussi une critique récurrente dans la mise en œuvre de l’IEV140.
Pour autant, au terme du processus de négociation, la révision de l’IEV initiée en 2011, ne répond pas
aux objectifs fixés par la Commission et le SEAE. Si le règlement intègre en effet la notion de
différentiation et de « more for more » dans l’allocation par pays141, sur le plan opérationnel le règlement
reste vague et ne propose aucun mécanismes concrets pour l’application de la conditionnalité. Certaines
analyses considèrent même que le nouveau règlement marque une régression en termes de
conditionnalité142. Premièrement, dans le cas de violation des droits de l’Homme et de l’Etat de droit, la
suspension de l’aide est soumise à la décision du Conseil seulement après consultation avec les
partenaires concernés (nouveauté par rapport à l’ancien règlement IEVP). Deuxièmement, la possibilité
de réallouer l’aide vers les acteurs non étatiques n’est plus mentionnée. Le règlement adopté reste aussi
assez vague sur la possibilité de reprogrammer le soutien financier143. Ce mécanisme ne s’appliquant
qu’en cas de crise alors que la dégradation des droits de l’Homme et de l’Etat de droit est souvent sujette
à un processus progressif et pernicieux. Le programme SPRING annoncé après les printemps arabes
constitue néanmoins un exemple de réallocation efficace144. Mais il aurait était intéressant d’étendre
cette possibilité de manière plus systématique, notamment au profit des acteurs de la société civile. Enfin
138 Proposition de la Commission 2011, mettre aussi le site de l’ENI.. 139 Charles Thépaut “Can the EU Pressure Dictators? Reforming ENP Conditionality after the Arab Spring”, EU diplomacy
paper n°6/11, College of Europe, 2011, p. 6-7/ voir aussi chapitre I. 140 Entretien réalisé avec la coordinatrice du Réseau Euroméditerranéen pour les droits de l’Homme (REMDH), Emilie Dromzé,
Bruxelles le 19 juin 2014. 141 Règlement IEV Article 4 142 Dr Laure Delcour, “Improving the Eu’s aid to its neighbors: lessons learned from the ENPI, recommandations for the ENI”,
Briefing paper, directorate-General for external policies, European Parliament, 23/07/2012, p.10-12. 143 Reglement IEV article 7.9 144 “Improving the Eu’s aid to its neighbors…”, op, cit., p.10
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
54
les critères énoncés dans la communication de mai censés donner corps au principe de conditionnalité
ne sont pas repris dans le règlement145. Pour conclure, il semble que la « refonte » du volet
programmatique ne réponde pas assez au processus de politisation en cours et ne reflète pas assez l’esprit
plus politique des communications de mars et de mai. Les avancées tangibles dans la réforme de l’IEV
découlant plus de la simplification du processus de programmation.
8.2) La simplification du processus de programmation de l’IEV
A première vue, à la question initiale, est-ce que la PEV et, par-là, l’instrument de voisinage, est adapté
au processus transitionnel, la réponse est négative. Tout d’abord parce que les possibilités de réallocation
de fonds alloués en amont sont limitées et ensuite parce que le cadre même de programmation obéit à
plusieurs étapes qui limite de facto la réactivité de l’instrument. Sous l’ancien IEV (IEVP) la
programmation était fondée sur quatre étapes :
1 La définition du Plan d’Action qui fournit le cadre globale des relations bilatérales et définit les
grands axes prioritaires ;
2 La définition d’un « Country Strategy Paper » (CSP) qui fournit une analyse de la situation du
pays et définit en conséquence les domaines prioritaires pour les cinq ou les sept années à venir ;
3 L’élaboration d’un Plan Indicatif National qui traduit les priorités identifiées dans le CSP en
programmes budgétés ;
4 L’élaboration de plans d’action annuels qui détaillent les projets et les activités qui seront
développés dans le cadre de l’appui budgétaire.
A ce processus de programmation il convient aussi de rajouter les évaluations nécessaires à l’allocation
des différentes tranches au titre d’un appui budgétaire qui peut s’étaler sur plusieurs années. Etant donné
que l’élaboration du CSP s’étale généralement sur 18 mois146 et que les PIN et les Plans d’Action annuels
sont aussi soumis à un processus de contrôle relativement long, la dimension procédurale de la
programmation limite la réactivité de l’UE en situation de crise. Un tel processus pose aussi des
problèmes de redondance entre ces différents documents (notamment entre le Plan d’ Action et le CSP).
Cette lenteur est aussi une des conséquences du fait que la programmation de l’IEV emprunte les
procédures de la coopération au développement via l’élaboration d’un CSP et d’un PIN. Cet emprunt à
145 (1) des élections libres et régulières; (2) la liberté d'association, d'expression et de réunion, ainsi que la liberté de la presse
et des médias; (3) l'administration de l'État de droit par un pouvoir judiciaire indépendant et le droit à un procès équitable; (4)
la lutte contre la corruption; (5) la réforme du secteur de la sécurité et du maintien de l'ordre (y compris la police) et
l'établissement d'un contrôle démocratique des forces armées et de sécurité. 146 Dr Laure Delcour, “Improving the Eu’s aid to its neighbors…” op, cit., p.14.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
55
la politique de coopération au développement est, par ailleurs, révélateur du manque de politisation et
de différenciation147 dans la mise en œuvre de l’IEVP avec les pays partenaires.
Dans ce contexte, la réforme de l’IEV qui vise à remplacer le CSP et le PIN par un Single Support
Framework148 constitue une réelle avancée pour la programmation 2014-2020. Non seulement cette
avancée facilitera les négociations pour les nouvelles autorités en place en réduisant considérablement
la durée de la programmation mais elle permettra aussi de prioriser d’avantage le support de l’Union
européenne.
8.3) Appui budgétaire – un instrument programmatique qui présuppose un dialogue politique de haut-niveau :
entre l’urgence des processus transitionnel et le temps long de la construction des relations bilatérales.
Au-delà de la lenteur du processus, la question de l’efficacité de l’IEV et donc de la PEV repose de
manière plus fondamentale sur l’appui budgétaire compris comme une modalité de mise en œuvre de
l’aide financière apportée par l’UE. L’appui budgétaire, représentant le principal canal par lequel l’IEV
est mise en œuvre, constitue l’instrument privilégié du soutien de l’UE au processus transitionnel. En
Egypte selon un rapport de la Cours des Comptes Européenne 60% de l’aide au titre de l’IEV est alloué
via l’appui budgétaire149. « Concrètement, l’appui budgétaire est un contrat entre la Commission
européenne (CE) d’une part, et le gouvernement du pays partenaire d’autre part (…) l’appui budgétaire
est une modalité d’aide par le biais de laquelle les fonds sont transférés par l’UE au compte de la
trésorerie nationale du pays partenaires »150. Aussi, l’initiative SPRING lancée en 2011, qui n’est rien
d’autre qu’une réallocation des fonds de l’IEV en faveur des pays du sud de la méditerranée, s’est-elle
concrétisée majoritairement à travers un appui budgétaire151, soit sectoriel, soit général. . En Tunisie,
depuis 2011 l’appui budgétaire représente 60% de l’aide de l’UE. Le débat se situe donc au niveau de
la pertinence du choix de passer par les canaux de l’appui budgétaire pour faire face à des situations de
crise.
L’appui budgétaire constitue une modalité de soutien qui bénéficie avant tout aux gouvernements des
pays partenaires, qui jouissent alors d’un certain contrôle sur la mise en œuvre effective du soutien
financier ainsi fourni. L’appui budgétaire a notamment vocation à renforcer l’appropriation de l’aide par
les pays partenaires dans l’optique aussi d’améliorer la cohérence et l’impact sur le long terme du soutien
financier de l’UE. Cependant, en période de crise, quelle est la capacité, voire la légitimité des
147 Le manque de différenciation entre les pays relevant de la PEV et ceux de la coopération au développement pose par ailleurs
un problème plus global selon l’entretien réalisé avec un officiel du SEAE (Entretien SEAE 3, op.cit). En effet selon cet officiel
la PEV gagnerait à ce que la mise en œuvre des instruments de coopération lui soit spécifique. 148 Règlement IEV Article 7.5 149 Cour des Comptes Européenne 2013 fr, Rapport spécial n°4, « la coopération de l’UE avec l’Egypte dans le domaine de la
gouvernance » p.14 150 Entretien avec Luca Oriani Vieyra, responsable de l’appui budgétaire, de la politique macro-fiscale et de la coordination
générale avec les institutions financières internationales au sein du Département en charge du voisinage à la Commission :
http://www.enpi-info.eu/files/features/N_Budget%20Support_OrianiFR.pdf 151 Entretien SEAE (1) : Direction IV.A Afrique du Nord, Moyen Orient, … op.cit.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
56
gouvernements –transitoires - travaillés par des conflits institutionnels et politiques violents, à assurer
la bonne mise en œuvre de l’aide européenne ? Quelle est la marge de manœuvre dont dispose l’UE
pour s’assurer du bon usage et de l’efficacité des fonds alloués à des programmes sectoriels assez larges,
qui ne contribuent pas nécessairement aux objectifs prioritaires de l’UE, et ce d’autant plus dans le cadre
d’un appui budgétaire général. Enfin, ce mode d’allocation ne contribue pas à améliorer la visibilité de
l’aide de l’UE, dissoute en quelques sortes dans le budget annuel national. Pour autant doit-on en déduire
que cette forme de soutien n’est pas adaptée aux processus transitionnels ?
Tout d’abord la mise en œuvre de l’appui budgétaire obéit à certaines conditions et critères
d’admissibilité – (i) une politique nationale ou sectorielle de développement ou une stratégie/politique
de réforme bien définie est en place, (ii) un cadre macro-économique orienté vers la stabilité existe et
(iii) un programme crédible et pertinent visant à améliorer la gestion des finances publiques a été
introduit. A première vue, nous pourrions penser que ces conditions ne sont pas adaptées aux besoins
de flexibilité qu’appellent les situations d’urgence et que la précarité de l’exécutif en période de
transition ne permet pas de remplir ces critères.
On retrouve ici la tension entre le temps court, celui des crises, et temps long, celui de la programmation
et de la coopération bilatérale, qui tiraille la PEV. Autrement dit, si d’un côté l’appui budgétaire obéit à
une programmation assez lourde, qui peut limiter la réactivité de l’aide européenne, la nécessité
d’élaborer préalablement des stratégies sur le moyen-long terme contribue au renforcement de la
capacité des institutions à planifier et à formuler des stratégies. L’impact de l’appui budgétaire n’est pas
essentiellement quantitatif (nombre d’enfants scolarisé, nombre d’hôpitaux financés…) mais aussi
qualitatif. Il contribue au travail législatif et au processus de réforme en amont, via l’élaboration de
stratégies, et en aval, via la mise en œuvre et les évaluations mi-parcours dont sont l’objet les
programmes sectoriels ainsi financés. Ce faisant, en période de trouble politique et institutionnel, si le
travail de programmation et de planification est rendu difficile voire impossible pour les administrations,
la coopération bilatérale avec l’UE – via la négociation des contrats d’appui budgétaire – permet en
quelques sorte de maintenir une certaine consistance et d’inciter (participer à) une dynamique de
réforme.
De manière complémentaire, en temps de crise politique où les gouvernements font face à d’intense
difficulté budgétaire la continuité de programmes sectoriels dans des domaines variés l’eau, l’éducation,
l’énergie, les transports ou encore les infrastructures de communications, constitue un appui non
négligeable d’un point de vue social et économique, notamment pour le secteur privé. Ainsi en Tunisie
la continuation de trois programmes financés sous forme d’appui budgétaire général (programme
d’Appui à la Compétitivité, programme d’Appui à la Gestion Budgétaire, Programme d’ Appui à la
Relance) et de deux programmes financés sous forme d’appui budgétaire sectoriel (Gestion de l’eau et
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
57
programme de soutien à l’enseignement supérieur) ont, malgré les difficultés de gestion dues à
l’instabilité politique, contribué à maintenir un « cap », une ligne directrice pour maintenir un dialogue
politique avec les gouvernements en transition. D’un point de vue quantitatif, le support de l’UE ne doit
pas non plus être négligé : Avec 160 millions d’euros de fonds alloués en 2012, suite à la hausse de
l’enveloppe du PIN de 240 à 390 millions pour 2011-2013, l’apport de l’UE s’élève environ à 1.6% du
Budget annuel Tunisien (9.988 Mds d’euros).
D’autre part à travers cet instrument l’UE est en mesure de jouer un rôle catalyseur dans les pays
partenaires. Les institutions internationales et les grands bailleurs de fonds s’alignant sur les programmes
d’appui budgétaire sectoriel et/ou général définis avec l’UE. En Egypte l’appui budgétaire négocié après
l’élection de M. Morsi à la présidence, s’inscrit dans le cadre d’un cofinancement avec la Banque
Mondiale. Il en va de même dans le cadre du Programme d’Appui à la Relance (appui budgétaire
général) développé en Tunisie en partenariat avec la Banque Mondiale, la Banque d’Afrique pour le
développement et l’Agence Française de Développement152.
Au-delà de la critique « bureaucratique de l’appui budgétaire » en termes d’efficacité, la critique de ce
mode d’appui au processus transitionnel réside plutôt dans la faible participation des acteurs de la société
civile et le faible impact en matière de droits de l’Homme et promotion de la démocratie, et de lutte
contre la corruption. Si l’appui budgétaire s’est révélé être un instrument efficace pour améliorer la
gestion publique, plusieurs études ont montré qu’il avait un impact limité sur la réduction de pauvreté
et la promotion de changement politique153. L’évaluation indépendante, commandée par la Commission,
sur la coopération bilatérale UE-Tunisie révèle clairement que « le projet de renforcement de la société
civile n’a jamais démarré, bien que programmé dans le PIN 1999- 2001, (…) le contrôle de l’Etat sur
l’accès aux financements externes comme ceux de la CE, a limité dans la pratique l’utilisation des
opportunités offertes, par exemple par les lignes budgétaires thématiques »154. Ce fait n’est pas propre à
la Tunisie, en Egypte mais aussi dans les pays de l’Est la participation de la société civile a toujours été
faible dans le cadre de l’IEV155.
Cela ne remet pas en cause l’instrument lui-même, mais nécessite d’engager une réflexion sur sa
transparence aux différents stades de la programmation. Engagée en 2011156 la réforme de la politique
d’appui budgétaire de l’UE va dans ce sens en intégrant un critère d’amissibilité spécifique à la
152« The strategic impact and cost-effectiveness of EU budget…” op., cit p.23 et 42 153 Volker Hauck, Greta Galeazzi and Jan Vanheukelom, “The EU’s State Building Contracts Courageous assistance to fragile
states, but how effective in the end?”, Briefing Note, European Center for development policy management ECDPM, No. 60
– December 2013, p.5 154 Selon cette étude “la CE a accordé, par des appels à proposition, des financements d‟un peu moins de deux millions d‟Euros
par an. » : « Évaluation de la coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie », Rapport Final, Volume 1 Ŕ Rapport
Principal, Evaluation pour la Commission Européenne, mai 2011. 155 Dr Laure Delcour, “Improving the Eu’s aid to its neighbors…” op, cit., 156 « La future approche de l'appui budgétaire de l'UE en faveur des pays tiers », COM(2011) 638 final, Bruxelles, le 13.10.201.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
58
transparence budgétaire, en renforçant la responsabilité des gouvernements partenaires et en alignant
davantage les conditions de décaissement des tranches sur les droits de l’Homme et l’Etat de droit. Dans
cette perspective, la Commission a défini 3 nouvelles catégories d’appui budgétaire, « Contrat de bonne
gouvernance et développent » (CBGD), « Contrat de réformes sectorielles » (CRS), « contrat de
renforcement de l’Etat » (« State Building Contract ») (SBS).
Ces trois type de contrats offrent chacun une approche différenciée. Le SBS nous intéresse plus
particulièrement dans la mesure où il a été conçu justement pour les situations de crise et d’appui aux
Etats fragiles et affectés par des conflits157. Son objectif étant d’assurer les fonctions vitales de l’Etat et
d’appuyer les périodes de transitions. En ce sens, le SBS nécessite un dialogue politique de haut niveau
contrairement à l’appui sectoriel. Au niveau des objectifs le SBS et le CBGD se rapprochent, même si
le premier se focalise plus sur la restauration de la paix et la stabilité macroéconomique. Pour autant
contrairement au CBGD, le SBS, qui devrait être utilisé en Tunisie et en Egypte pour la période 2014-
2020, ne présuppose pas une évaluation a priori du respect et de l’engagement du pays partenaire en
faveur des valeurs fondamentales158. Au niveau de la participation de la société civile, la Communication
de 2011 sur la réforme de l’appui budgétaire et les lignes directrices adoptées en 2012, ne font pas
explicitement mention à une consultation « institutionnalisée » ou « obligatoire » des acteurs de la
société civile. Aussi, la participation de la société civile fera l’objet d’une attention particulière quand
nous comparerons les réalisations de la PEV en Tunisie et en Egypte après les printemps arabes.
Ce que nous avons voulu montrer c’est que l’appui budgétaire ne constitue pas « une solution miracle »
mais qu’il offre plusieurs opportunités à l’UE de maintenir et de renforcer son dialogue politique avec
ses partenaires. Si la réactivité de ce mode de soutien peut être améliorée et s’il doit encore faire ses
preuves en termes de promotion des droits de l’Homme et de la démocratie, il constitue un instrument
adapté au processus transitionnel. Il permet au gouvernement de s’approprier l’aide, il facilite les
synergies entre les bailleurs de fond, joue un rôle non négligeable dans la soutenabilité financière des
programmes, incite les gouvernements à planifier et formuler des stratégies sur le moyen-long terme.
D’autre part, la réforme engagée en 2011 semble renforcer le poids des droits de l’Homme dans le cadre
de la gestion des Contrats Appuis Budgétaires. Ainsi verrons-nous que le programme d’Appui à la
société civile adopté en janvier 2014 marque un élargissement du champ d’action de l’appui budgétaire
aux acteurs de la société civile en Tunisie. Le rôle accru joué par les délégations dans le suivi de ces
contrats, la création d’un comité de suivi au niveau central (Commission européenne), reflète aussi la
volonté de mieux encadrer ces contrats pour améliorer leur efficacité et leur alignement sur les Plan
157 Il est intéressant aussi de voir que ce processus de réforme s’inscrit plus largement dans le cadre du “New Deal” adopté à la
conférence de Busan en 2011 sur l’efficacité de l’aide pour les Etats fragiles et affectés par des conflits. Il est trop tôt encore
pour évaluer la réforme de la politique d’appui budgétaire de la Commission mais il faut comprendre que celle-ci répond à une
prose de conscience de la part de la communauté internationale de mieux différencier l’aide selon les situations. 158 “The EU’s State Building Contracts…”, op., cit,
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
59
d’Action et surtout de mieux prendre en compte l’évolution du contexte politique159. En revanche on
peut regretter que le SEAE ne joue pas un rôle prédominant dans la gestion de tel contrat (le comité de
suivi est présidé par DEVCO et se réunis deux fois par mois) afin de renforcer la dimension politique
de cet instrument.
Au niveau programmatique nous avons focalisé notre analyse sur l’appui budgétaire, mais d’autres
instruments, plus flexibles, qui se concentrent sur l’assistance technique, «TAIEX (programme
d’assistance technique et d’échange d’information) et SIGMA (soutien à l’amélioration de la
gouvernance et de la gestion), sont aussi à prendre en compte dans « l’arsenal » dont dispose l’UE pour
accompagner ses partenaires dans les processus transitionnels. Aussi, avons-nous fait le choix de ne pas
aborder les autres instruments comme l’IEDDH, ou la facilité pour la société civile ou le Fonds européen
pour la démocratie, qui participent aussi aux objectifs de la PEV mais de manière différente, selon une
logique d’appels à projet et de convention de subvention avec des acteurs non étatiques. Ces instruments,
bien que moins important que l’IEV, jouent un rôle de rééquilibrage en faveur de la société civile.
9. Politique commerciale et Politique migratoire.
Pour savoir si le cadre même de la PEV est adapté au processus transitionnel, on ne peut s’arrêter au
soutien tangible, financier et technique, de l’UE, mais s’intéresser aussi aux accords commerciaux et à
la politique migratoire. Ces deux politiques faisant partie intégrante de la réponse de l’UE aux printemps
arabes, il est nécessaire d’évaluer comment elles ont évolué et ce qu’elles proposent pour soutenir les
pays partenaires en proie à des processus de transition difficile.
9.1) Vers des Accords de Libre Echange Complets et Approfondis.
La politique commerciale de l’UE envers les pays de la méditerranée repose sur une architecture
relativement complexe et mouvante. Des initiatives régionales (le processus de Barcelone visait
l’établissement d’une zone de libre-échange entre l'UE et ses partenaires méditerranéens et entre les
partenaires eux-mêmes, d'ici à 2010, la Communauté de l'énergie créée en 2006, Accord d’Agadir160)
en passant par le système pan-euro-méditerranéen d’origine161, les Accords d’Associations (prévoyant
des préférences commerciales réciproques, notamment sur la baisse tarifaire sur les produits agricole),
aux accords sectoriels développés dans le cadre des Plans d’Action (rapprochement de la réglementation,
harmonisation des normes, etc.) et aux accords sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des
159 “Budget Support Guidelines Executive Guide A modern approach to Budget support” EuropeAid Development and
Cooperation Directorate-General European Commission, Brussels, September 201 160 Décision 2006/500/CE du Conseil du 29 mai 2006 relative à la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant
la Communauté de l'énergie. 161 Ce système élargis aux pays partenaires du processus de Barcelone permet de déterminer l’origine d’une marchandise afin
de pouvoir lui appliquer des préférences tarifaires (réductions ou des suppressions de droits de douanes et de taxes)
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
60
produits industriels (ACAA)162 (les secteurs concernés sont les produits électriques, les équipements,
les jouets, les produits pharmaceutiques), la politique commerciale de l’UE dans le cadre de la PEV est
parfois difficile à analyser. Ainsi, les ALECA constituent-ils un enjeu majeur pour améliorer la
cohérence entre les initiatives (préférences commerciales) lancées sous les Accords d’Association (AA)
et les Plans d’Actions (harmonisation règlementaire, accords sectoriels). Cependant, contrairement à
l’Ukraine, ces nouveaux accords ne seront pas négociés via l’élaboration d’un nouvel Accord
d’Association mais constitueront des initiatives qui viendront s’ajouter, compléter les Accords
d’Associations existants.
Mais dans quelles mesures ces accords approfondis peuvent-ils être considérés comme une réponse aux
printemps arabes, comme annoncé dans la communication de mai 2011 ? Tout d’abord il convient de
rappeler que les ALECA ont été conçus bien avant les soulèvements populaires à partir de 2006163. Le
fait que de nombreux chapitres repris dans les ALECA - accords de libre-échange pour les biens
industriels, les produits agricoles, la libéralisation des services les marchés publics, les mouvements de
capitaux et de paiements, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les droits de propriété industrielle et
intellectuelle, la concurrence, la douane – soient déjà présents dans les AA et les Plans d’actions reflète
la continuité de la stratégie de l’UE (dans un contexte de relations bilatérales profondément asymétriques
où l’UE exprime sa puissance normative) sans véritable reformulation ni réorientation. Les ALECA
peuvent être conçus alors simplement comme un processus d’approfondissement des AA et des Plans
d’Action qui s’inscrit dans le moyen terme.
Il convient aussi de noter que les barrières tarifaires demeurent assez élevées notamment pour les
produits agricoles où les taxes à l’importation s’élèvent à 40.9% en moyenne en Tunisie et à 70.2% en
Egypte. Ces barrières sont moins faibles pour les produits industriels avec des taxes s’élevant en
moyenne à 18% et 9% respectivement en Tunisie et en Egypte164. Ce qui change (à la marge) c’est la
nature plus règlementaire et plus sectoriel des ALECA qui tendent à dépasser la libéralisation et
l’abaissement des barrières tarifaires. Le rôle de la politique commerciale au sein de la PEV est censé
constituer « l’incitation centrale » en offrant la possibilité aux partenaires à terme « d’intégrer le marché
intérieur » de l’UE. Mais pour autant ces accords certes plus complet que des préférences commerciales,
ne constituent pas l’instauration d’une union douanière et encore moins une intégration au marché
162 « Les pays partenaires adaptent à l'acquis communautaire leurs systèmes de qualité, leur législation et leurs normes dans les
secteurs industriels prioritaires faisant l'objet d'une harmonisation au niveau de l'UE, ainsi que les instances nationales chargées
de la normalisation, de l'accréditation, de l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la surveillance du marché afin de
le mettre en application, en échange d'un accès au marché unique pour les produits concernés par l'accord. » définition de la
Commission. 163 Ahmed farouk Ghoneim, Erwan Lannon “Workshop The Euromed Region after the Arab Spring and the new generation of
DCFTAs”, Directorate_General for external policies, European Parliament, 22 octobre 2013, p.42/ Communication “The
“strengthening of the European Neighborhood Policy”, COM (2006) 726 final, Brussels, 4 December. 164 Iana DREYER, “Trade Policy in the EU’s Neighbourhood Ways Forward for the Deep and Comprehensive Free Trade
Agreements”, Notre Europe Paper n°90, mai 2012
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
61
unique165. Ainsi peut-on difficilement concevoir les ALECA comme une réponse au processus
transitionnels.
Mais ce qui pose problème c’est le décalage entre la situation politique du pays et la portée de ces
ALECA. Comme le mentionne assez justement un rapport du Sénat sur les politiques méditerranéennes
après les printemps arabes, « L'Union européenne tente de fait de négocier avec un pays qui reste en
transition politique et n'a pas encore véritablement abordé sa transition économique. »166. L’entretien
réalisé auprès d’un officiel de l’ambassade de Tunisie confirme la « précipitation » et « l’agenda
soutenu » de la DG TRADE de la Commission, qui cherche à accélérer le processus de négociation. Ce
qui nous renvoie en première analyse au manque de « hiérarchisation » des acteurs institutionnels au
profit du SEAE. Le SEAE n’ayant pas la main sur l’agenda de la DG TRADE, la logique de cette
dernière peut l’emporter sur une approche plus diplomatique, prenant d’avantage en compte la situation
politique des pays partenaires167.
Mais plus fondamentalement, au-delà de l’inadéquation de l’offre économique face à des gouvernements
dont les ressources et l’expertise ne répondent pas à la technicité des dossiers, les bénéfices même de
tels accords commerciaux peuvent être questionnés. En effet, si l’évaluation, publiée le 29 mai 2013,
sur l’impact commercial durable (SIA) sur l’ALECA avec le Maroc et la Tunisie met en avant les
bénéfices estimés à 1,3 milliards pour le Maroc et à 2.5 milliards d’euros pour la Tunisie avec un hausse
des importations respectives de 15% et de 20% (supérieure à la hausse des importations)168, d’autres
analyses169 mettent sérieusement en doute la plus-value de ces accords. Ce qui est mis en avant ne repose
pas seulement sur une critique plus globale de l’approche libérale (mise en concurrence avec des
entreprises européenne beaucoup plus compétitive pour l’accès aux marchés nationaux, établissement
d’un mécanisme de règlement arbitraire entre les investisseurs et l’Etat, concurrence déloyale des
produits agricoles subventionnés par la PAC, risque de dépendance accrue des économies nord
africaines à l’économie européenne, etc.) mais aussi sur le coût que représente l’intégration des normes
européennes : « For them, integrating EU standards into their legislation, and in particular putting them
into practice, will be costly and will probably fail »170.
165 Ahmed farouk Ghoneim, Erwan Lannon “Workshop The Euromed Region… op.cit p.47 166 Rapport d’information, « La politique méditerranéenne de l'Union européenne après le printemps arabe : les cas du Maroc
et de la Tunisie », Simon SUTOUR, Mme Bernadette BOURZAI, M. Jean-François HUMBERT et Mme Catherine MORIN-
DESAILLY, commission des affaires européennes, Rapport d'information n° 100 (2013-2014), déposé le 24 octobre 2013 167 Entretien réalisé le 29 avril 2014. 168 Etude d’impact commercial durable (SIA) ALECA Maroc et Tunisie, European Union, 29 mais 2013, Bruxelles 169 Voir notamment “Lala Hakuma « Accords de libre échange approfondis et complets entre l’Union Européenne et
l’Égypte : quels sont les enjeux ? » L’AITEC, 25 Février 2013 et M.Cermak, A.Canonne, R.Knottnerus, “EU Deep and
Comprehensive Trade Agreements: A Threat to the Aspirations of the 'Arab Revolutions ”. Voir aussi dans une approche moins
idéologique Nathalie Tocci, “state sustainability in the Southern Mediterranean and Scenarios to 2030: The Eu’s response”,
p.10-11 170 Trade Policy in the EU’s Neighbourhood Ways Forward for the Deep and Comprehensive Free Trade Agreements Iana
DREYER
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
62
Si l’on s’en tient à la définition des ALECA qu’on peut trouver sur le site diplomatie.gouv.fr « garantir
un accès effectif aux marchés de pays partenaires pour nos entreprises est nécessaire afin de s’assurer
des débouchés pour nos productions et pour aider nos entreprises à rester compétitives » il est clair que
ces accords doivent faire l’objet d’intenses négociations, qui ne bénéficieront pas nécessairement aux
entreprises tunisiennes. Enfin les ALECA ne semblent pas répondre aussi à l’esprit de la communication
de mai dans la mesure où la société civile est relativement peu consultée. Dans cette optique, Erwan
Lannon, considère que des évaluations d’impact plus systématique sur le plan sectoriel et plus
transparente devraient être mise en place pour légitimer de tels accords mais aussi mieux appréhender
les coûts-bénéfices.
9.2) La politique migratoire de l’UE – ou comment la dimension extérieure des politiques intérieure affecte la
PEV
La politique migratoire de l’UE pourrait à elle seule faire l’objet d’un mémoire spécifique. Nous n’avons
ni le temps, ni l’expertise nécessaire pour développer une analyse exhaustive augmentée d’une
perspective historique. L’idée étant plutôt de montrer que la politique migratoire, qui bénéficie d’une
visibilité inégalée par le SEAE, la politique commerciale et encore moins par la coopération au
développement (IEV, appui budgétaire, appui à la société civile, etc.), tend à décrédibiliser les initiatives
de l’UE en matière d’ouverture et de changement de discours. Dès 2011, après les printemps arabes
alors que la Tunisie accueillait quotidiennement des milliers de réfugiés libyens (en 2012 on comptait
plus de 600 000 libyens réfugiés en Tunisie171), certains Etats membres de l’Union européenne, l’Italie
et la France en tête, posaient la question du rétablissement des contrôles des frontières dans l’espace
Schengen172. On retrouve là un discours sécuritaire, celui de l’Europe forteresse, qui contraste avec la
communication de mai 2005. Mais on se situe là au niveau de la réponse immédiate et non du cadre à
proprement parlé de la politique migratoire de l’UE au titre de la PEV.
La négociation de partenariat pour la mobilité constitue le cœur du volet migratoire de la PEV. Avec la
politique commerciale ce volet constitue un axe fondamental des relations bilatérales de l’UE avec ses
voisins. Répond-t-il aux besoins des pays en transition ? Que recouvre-t-il exactement ? Comment
s’articule-t-il avec les autres volets de la PEV ? Ces questions soulèvent plusieurs problématiques. Avant
tout, il faut revenir sur le plan institutionnel. Comme nous l’avons vu, dans le champ de la politique
migratoire le SEAE semble « exclu » du jeu diplomatique au sein duquel la DG HOME coopère en
priorité avec les Ministères de l’Intérieur des Etats membres plutôt qu’avec les représentants du SEAE
(cf chapitre II).
171 Rapport 2012 du Haut-Commissaire de l’ONU aux réfugiés, « Appel global 2012-2013 du HCR – Tunisie » 172 Voir le Conseil européen extraordinaire de mars 2011.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
63
En fait les Accords de réadmission ne sont pas quelque chose de nouveau. Ils sont nés dans les années
1980 et ont été intégrés au Traité d’Amsterdam, qui transfère des compétences à la Commission pour
inclure des clauses « réadmission » dans les accords avec les pays tiers173. Un Accord de réadmission
est un « accord par lequel les États signataires s’engagent à réadmettre leurs ressortissants, voire des
personnes ayant transité par leur territoire, interpellées en situation irrégulière sur le sol de l’U.E »174.
Ce faisant, outre la vision sécuritaire des Partenariats de mobilité, étant donné que les législations des
pays du sud de la méditerranée en matière de traitement des immigrés (centre de rétention, durée,
existence d’un régime d’asile efficace, etc..) sont moins respectueuses des droits de l’Homme, la
négociation de tels accords tend à décrédibiliser l’action de l’UE auprès de la société civile175. En Tunisie
les dispositions législatives sur le « délit d’émigration clandestine » n’ont toujours pas été abolies176.
Pour répondre à notre question initiale, comment a évolué la politique migratoire et dans quelles mesures
contribue-t-elle à rendre le cadre de la PEV plus adapté aux processus de transition, les Partenariats de
Mobilité n’apporte pas d’innovation majeure et s’inscrivent dans la continuité d’une politique migratoire
sécuritaire. En 2011, cette tendance s’est concrétisée avec l’adoption du programme Eurosur177
(European External Border Surveillance System), un système de reconnaissance et de transmission de
données, coordonné par l’agence Frontex ayant vocation à mieux contrôler les flux migratoires en
méditerranée.
CHAPITRE VI : L’évolution de la PEV en Tunisie et en Egypte : deux trajectoires transitionnelles,
deux PEV
Nous avons vu que le cadre de la PEV, n’est pas spécialement adapté aux processus transitionnels. Le
processus de programmation est relativement long et les principales politiques qui façonnent la PEV, la
173 « Les implications de la politique européenne de voisinage dans le cadre des contrôles aux frontières : (accords de
réadmission, politique des visas, droits de l’homme) », Parlement européen étude, MARS 2008 PE 393.284, p.21 : « Le traité
d'Amsterdam a conféré des compétences à la Communauté dans le domaine de la réadmission. Le Conseil européen invite le
Conseil à conclure des accords de réadmission ou à insérer des clauses-types dans d'autres accords conclus entre la
Communauté européenne et les pays groupes de pays tiers concernés. Il convient également d'examiner les règles relatives à
la réadmission entre États membres » 174 Note de migreeurope, « Accord de réadmission », N°1, décembre 2012 :
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Note_de_MIGREUROP_12122012_Accords_de_readmission_pour_mise_en_ligne.pdf 175Signataire d’une tribune du réseau Migreurope critiquant l’accord partenariat avec la Tunisie : Association Tunisienne des
Femmes Démocrates (ATFD) ; Coordination des Assises de l’Immigration Tunisienne (FTCR – ADTF- UTIT – AIDDA –
COLLECTIF 3C – UTAC – ZEMBRA – ATNF – ATML – FILIGRANES – ACDR – UTS – CAPMED – CFT – YOUNGA) ;
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) ; Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme
(LTDH) ; Union Générale Tunisienne de Travail (UGTT) : Communiqué de presse conjoint Partenariat de Mobilité entre la
Tunisie et l’UE : l’externalisation des frontières européennes à marche forcée 176 Ibid 177 Regulation (EU) no 1052/2013 of the European parliament and of the Council of 22 october 2013 “Establishing the European
Border Surveillance System (Eurosur)”
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
64
politique commerciale et la migratoire n’ont pas fondamentalement évolué. Pour autant, avons-nous
aussi relevé que l’IEV et la réforme de la PEV offre des possibilités de soutien efficace au processus
transitionnel (appui budgétaire, participation de la société civile). Mais au fond, l’adéquation de l’offre
de la PEV reste soumise en premier lieux à la volonté politique du partenaire de coopérer avec l’Union
européenne (cf. chapitre III). Le contexte politico-institutionnel est donc primordial pour comprendre
l’efficacité de la PEV. En Tunisie la recherche du consensus est un élément central pour comprendre
l’approfondissement des relations UE-Tunisie. Au contraire, dans un contexte où en Egypte, la
reformulation de l’autoritarisme a débouché sur une polarisation plus violente de la société et une
dégradation des droits de l’Homme et de l’Etat de droit, l’UE s’est de nouveau retrouvée confrontée au
dilemme démocratie-stabilité.
11. L’UE la Tunisie – Un dialogue politique approfondi et une coopération riche
Il est difficile d’appréhender l’influence de L’UE dans la recherche du consensus au niveau politique et
des conflits interinstitutionnels. En revanche, ce que l’on peut essayer de mettre en lumière c’est la
capacité de l’UE à déployer « une diplomatie structurelle ». La diplomatie structurelle peut être définie
comme la capacité de l’UE à mettre à profit différentes politiques et différents instruments pour se
positionner comme un partenaire stratégique au niveau bilatéral178. En Tunisie, au Maroc, et dans une
moindre mesure en Jordanie et au Liban, l’UE a su développer et jouer sur l’ensemble des volets de la
PEV pour approfondir et consolider ses relations sur différents fronts. Mais la diplomatie structurelle
définie aussi la capacité de l’UE à aligner les différents bailleurs de fonds et les Etats membres sur ses
stratégies et sur « sa » programmation. L’autre aspect de cette forme de diplomatie relève de la capacité
de l’UE à développer une « diplomatie publique » qui prenne en compte d’autre acteurs non étatiques
afin d’influer sur les politiques nationales par différents canaux : le passage d’une diplomatie
conventionnelle où c’est l’Etat qui s’impose comme interlocuteur exclusif à une diplomatie structurelle
qui prend en compte une pluralité d’acteurs qui façonnent l’Etat de droit.
Ce qui différencie donc fondamentalement l’évolution de la PEV entre la Tunisie et l’Egypte, c’est le
déploiement en Tunisie de tous les volets de la PEV (commerciale, migratoire, coopération sectorielle,
programmation de l’IEV) alors qu’en Egypte l’UE n’a pas su/pu mettre à profit ses instruments. Pour
autant, la mise en œuvre d’une « diplomatie structurelle », qui tend à définir l’UE comme un acteur
global, reste fondamentalement tributaire de la capacité de l’UE à établir un dialogue politique de haut
niveau avec son partenaire.
178 Keukeleire, Stephan and Arnout, Justaert, « EU Foreign Policy and the Challenges of Structural Diplomacy:
Comprehensiveness, Coordination, Alignment and Learning » DSEU Policy Paper, 12 February 2012
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
65
11.1) Sur le plan politique : vers un partenariat privilégié
Dans cette perspective, l’accès au statut de partenaire privilégié fin 2012 marque un tournant dans les
relations UE-Tunisie. C’est dans le cadre de la 9ème session du Conseil d’association179 Tunisie-Union
Européenne, qui s’est tenue à Bruxelles le 19 Novembre 2012, que la Tunisie a accédé au statut de
partenaire privilégié. Le « statut privilégié » ne constitue pas un cadre juridique contraignant, mais un
« label politique » pour reprendre la formule d’un diplomate Tunisien180. Concrètement, le statut
privilégié prend corps à travers le nouveau Plan d’Action 2013-2017. Accéder au statut privilégié, n’est
pas anodin, c’est s’engager durablement dans un approfondissement transversal de ses relations
bilatérales avec l’UE. En fait, si le statut privilégié a été validé en Novembre 2012, il a fallu attendre
avril 2014 lors de la 10ème réunion du Conseil d’association Tunisie-UE, pour qu’un accord politique
soit dégagé sur le Plan d’Action 2013-2017181 et donc pour que ce statut prenne corps. Ce temps de
latence n’est pas du ressort de la lenteur des procédures de programmation. C’est le reflet des tensions
politiques et sociales extrêmes de l’année 2013 - assassinat de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmiz,
démission des gouvernements Jebali et Laarayedh – qui ont mis en péril le processus de consolidation
de l’Etat de droit. Le fait qu’il ait fallu attendre que la Tunisie se dote d’une constitution le 26 janvier
2014 avant qu’un accord politique sur le statut privilégié ne soit entériné, illustre la subordination des
instruments de la PEV à la stabilisation politique.
Mais l’on peut aussi, de manière inversée, considérer que le fait d’être parvenu en moins de deux ans à
négocier un statut privilégié témoigne de la capacité de l’UE à inscrire en haut de l’agenda politique des
gouvernements transitoires ses priorités. « Tous les gouvernements transitoires ont réitéré la
« dimension stratégique du partenariat avec l’UE »182. Dans cette perspective, on peut considérer que
l’UE a su influencer les priorités de ses partenaires, qu’elle a su les inciter à maintenir un dialogue
politique en vue de bénéficier des instruments de la PEV. L’offre de la PEV étant « conditionnée » à des
avancées démocratiques, l’on peut arguer qu’elle a joué un rôle vecteur en faveur de la recherche du
consensus et de la consolidation de l’Etat de droit. Si l’UE n’a peut-être pas joué un rôle moteur (elle
n’est pas à l’origine des avancées démocratiques qui sont avant tout le résultat d’un processus endogène)
mais, qu’en « suspendant » le statut privilégié à un accord politique, elle a d’une certaine manière inciter
les gouvernements successifs à prendre des mesures en faveur des valeurs défendues par la PEV.
Sur le plan de la programmation de l’IEV, des accords commerciaux (ALECA) et du Partenariat de
mobilité, le « statut privilégié » confère aux partenaires un « aval » politique puissant. Si aujourd’hui la
179 Les Conseil d’associations sont les conseil chargés du suivi, de la reformulation et de l’adoption des différents documents
stratégique comme les Plans d’Action ou les Single Support Framework. 180 Entretien Ambassade de Tunisie : Conseiller politique de l’Ambassade de Tunisie à Bruxelles, - 6 mai 2014, Bruxelles 181 Conseil d'Association UE-Tunisie, Luxembourg, le 14 avril 2014, 8930/14 182 Entretien Ambassade de Tunisie… op., cit
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
66
Tunisie n’a pas encore ouvert directement les négociations sur les ALECA comme au Maroc qui en est
au cinquième round de négociation, elle a déjà entamé les négociations préliminaires pour définir le
mandat et le champ d’application de ces accords183. Sur le Partenariat de mobilité, les négociations sont
déjà bien avancées. Le 3 mars 2014, l’UE et la Tunisie ont signé une déclaration conjointe184. Cette
déclaration n’a rien de juridiquement contraignant mais doit aboutir à la ratification d’un Accord de
réadmission et d’un Accord de facilitation de Visas. Tout l’enjeu pour la Tunisie, pour qui le premier
accord n’apporte rien185, sera d’étendre la facilitation de Visa au plus grand nombre afin d‘éviter qu’elle
ne cible qu’une partie mineur (étudiant, cadre…) de sa population.
Si l’adoption du Plan d’Action 2013-2017 marque bien un approfondissement des relations bilatérales,
il est intéressant de se pencher sur deux points : Dans quelles mesures reflète-t-il la réorientation plus
politique de la PEV et comment se démarque-t-il des précédents Plans d’Action adoptés sous Ben Ali ?
Sur le plan des droits de l’Hommes, le nouveau Plan d’action semble plus « ferme », et plus précis que
les précédents. Notamment au niveau de la protection des défenseurs des droits de l’Homme (point 14)
ou encore la lutte contre la peine de mort (point 13) qui n’étaient pas mentionnés dans le précédent Plan
d’Action. Il en va de même au niveau du renforcement des institutions garantissant la démocratie et
l’Etat de droit (point 7) avec des objectifs clair « Adoption d’un cadre électoral démocratique,
établissement d’une Commission indépendante pour l’organisation des élections et renforcement des
capacités des organisations de la société civile tunisienne en matière d’observation électorale, adoption
des dispositions règlementaires sur l’observation électorale ».
On a bien une évolution plus politique (au niveau des objectifs à atteindre en termes de droits de
l’Homme, démocratie, Etat de droit). En revanche le nouveau Plan d’Action, qui garde la logique
« catalogue » qui caractérisait l’ancien. Une des critiques adressée au Plan d’Action portait sur le manque
de priorisation. Les Plans contenant beaucoup trop d’axes de coopération (jusqu’à 79 pour le Plan
d’Action de 200) pour qu’ils aient un véritable impact sur la démocratisation des pays partenaires. En
effet avec plus de 13 priorités déclinées en 90 objectifs on peut se demander qu’elle est la faisabilité
d’un tel Plan d’Action et si les priorités en matière d’Etat de droit ne risquent pas d’être diluées, sans
que la conditionnalité ne puissent être opérationnalisée. Le temps dira si ce Plan d’Action sera plus
efficace et s’il permettra à l’UE d’inciter des réformes profondes, mais en l’état actuel la logique
« catalogue » semble subsister au détriment d’une approche plus stratégique. L’absence d’échéance
vient conforter aussi la faiblesse stratégique des Plans d’Action.
183 Ibid. 184 Déclaration conjointe pour le Partenariat de Mobilité entre la Tunisie, l'Union Européenne et ses Etats membres participants 185 Entretien Ambassade de Tunisie… op., cit
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
67
11.2) Sur le plan programmatique : l’impact sur le terrain de la Politique européenne de voisinage – La Tunisie
un « succès story »
11.2.1) La richesse de la coopération bilatéral et le Single Support Framework
Il n’était pas évident de se procurer les informations concernant les négociations en cours sur la future
allocation par pays de l’IEV. Ces négociations sont peu transparentes, elles sont le reflet d’une part des
avancées dans les réformes demandées mais aussi le fruit des positions entre Etats membres au sein du
Conseil des affaires étrangères. Il a fallu pour cela effectuer un travail de veille sur la comitologie et
suivre les travaux du comité PEV de la Commission, présidé par la DG DEVCO. En fait, c’est à travers
la validation du cadre unique d’appui annuel (Single Support Framework annuel), par un acte
d’exécution186, lors de la réunion du Comité PEV du 24 juin que nous pouvons évaluer
l’approfondissement de la coopération entre la Tunisie et l’UE. Selon ce document, l'allocation
indicative bilatérale pour la période 2014-2020 devrait s’élever entre 725 et 886 millions d’euros, soit
une augmentation de près de 64% (si on prend la fourchette haute) par rapport à la précédente
programmation. Pour la période 2013-2017, le Single Support Framework étant toujours en négociation,
l’adoption de l’allocation pluriannuelle définitive n’est toujours pas arrêtée. Mais là encore c’est
d’avantage lié à des raisons politiques qu’à des raisons procédurales de programmation. Selon un
entretien avec la chef de la délégation de l’UE en Tunisie « tant qu’il n’y a pas un gouvernement stable,
nous ne pouvons pas fixer le montant global des engagements du plan d’action »187.
Pour la période 2014-2015, le montant du soutien financier devrait s’élever entre 202 et 246 millions
d’euros. Le cadre unique annuel doit reposer sur les priorités du plan d’action en se focalisant
essentiellement sur trois secteurs : (i) Réformes socio-économiques pour la croissance inclusive, la
compétitivité et l'intégration, (ii) Consolidation des éléments constitutifs de la démocratie (iii)
Développement régional et local durable. Ces trois secteurs répondent aux enjeux moyen-court terme et
reflète l’étendu de la coopération bilatérale. Il ne faudrait pas non plus sous-estimer l’impact des
programmes dans le secteur, développement régional et local durable qui touchent à des éléments
régaliens, comme l’appui à l’élaboration de politiques de déconcentration et de décentralisation. On peut
aussi relever dans le deuxième secteur, l’objectif d’appuyer l’adoption d’une stratégie nationale de
réforme du système de la sécurité. De manière synthétique s’il est encore trop tôt pour évaluer l’impact
de ces projets, la programmation reflète bien un accent mis sur les réformes et en ce sens, témoigne
d’une plus grande politisation de la PEV, qui peut se définir comme la capacité de l’UE à influencer des
réformes structurelles. La Convention de financement du Programme d'Appui à la réforme de la justice
186 RegCom Numéro du projet d'acte d'exécution voté : D033964/01 :
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&D6R8+O9yIExFez+fUX+KhJMsWj7
ARnamfCdACC8v6Os= 187 « Plan d'action Tunisie-UE (2013-2017) : Au moins dix conditionnalités à remplir par la Tunisie » Babnet Tunisie, 13 avril
2013, article consulté sur internet : http://www.babnet.net/cadredetail-63455.asp
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
68
(PARJ), signée en Octobre 2012 en pleine transition est révélatrice aussi de la capacité de l’UE à adapter
ses programmes au contexte politique.
Pour appréhender l’étendue de la coopération bilatérale de l’UE avec la Tunisie encore faut-il souligner
l’ouverture aux entreprises tunisiennes des programmes européens comme Horion 2020 (programme
européen pour la recherche et le développement). Faudrait-il aussi analyser la programmation de la
Facilité de voisinage gérée par la BEI sous forme de prêt aux entreprises. Cependant, pour des raisons
de temps, et pour inscrire notre raisonnement dans la continuité de notre hypothèse d’une politisation
de la PEV, nous faisons le choix de nous focaliser sur l’importance croissante du rôle de la société civile
en Tunisie, mais aussi sur l’impact de l’aide européenne dans le jeu institutionnel Tunisien.
11.2.2 Un coopération plus politique
Pour appréhender la politisation de la programmation de l’IEV il faut prendre en compte le soutien de
l’UE à des nouvelles institutions qui vont se positionner au cœur du jeu institutionnel des processus
transitionnels. Dès le début de la transition L’UE va orienter son aide en faveur de la consolidation des
institutions établies par les décrets-lois élaborés par l’Instance supérieure en avril et mai 2011, appelés
aussi les « six lois de la liberté » 188. Il s’agit de l’Instance supérieure Électorale Indépendante (ISIE) et
de l’Instance nationale pour la réforme du secteur de l’information et de la communication (INRIC).
L’UE a signé des accords de mémorandum d’entente avec L’ISIE qui va jouer un rôle central dans
l’organisation des élections (validation des listes électorales, dépouillement, surveillance des bureaux
de vote, etc.) notamment en vue des futures élections législatives qui devraient se tenir fin 2014.Dans
ce cadre l’UE a organisé, pour la première fois depuis la signature de l’Accords d’Association en 1995,
des missions d’observations électorales (MOE) pour soutenir les différentes phases du processus
électoral lors des élections de l’Assemblée Nationale Constituante le 23 octobre 2011. Avec un budget
de 3,2 millions d’EUR et une délégation de 15 députés du Parlement européen, la MOE organisée pour
les élections du 23 octobre 2011 est l’une de missions les plus importantes jamais envoyées par l’UE189.
Au-delà du caractère inédit de cette coopération, ce qu’il faut comprendre c’est qu’à travers ce soutien
institutionnel, l’aide financière de l’UE agit sur le processus de réforme électorale (la loi électorale a été
adoptée le 11 mai 2014) et judiciaire qui contribue à la consolidation de l’Etat de droit.
L’appui institutionnel dans le domaine de la justice est une dimension importante de la coopération post-
Ben Ali. Le soutien apporté à l’Instance de nationale de Lutte contre la Corruption à travers le
188 ; le décret-loi n°35 du 10 mai 2011, portant élection d’une Assemblée Nationale Constituante (ANC), le décret-loi n°27, du
18 avril qui institue l’Instance supérieure Électorale Indépendante (ISIE), et enfin les décrets-loi 87, 88, 115 et 116 relatifs à la
liberté d’association, aux partis politiques, à la liberté de la presse, avec notamment, la création de l’Instance nationale pour la
réforme du secteur de l’information et de la communication (INRIC). 189Zouhaier DHAHRI, Matylda Maria KONARCZAK, « Transition démocratique en Tunisie de 2011 à 2013 »,
mastercarrièreinternationale, 4 février 2014 p.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
69
programme “Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional” mise en
œuvre par le Conseil d’Europe et financé par l’UE. L’appui technique apporté à l’Assemblée Nationale
Constituante, à travers un soutien financier190 et une coopération renforcée avec le Parlement
européen191. Ou encore l’appui à l’Institut Supérieur de la profession d’Avocat (ISPA)192 sont autant
d’élément qui illustrent la dynamique de l’UE en tant que vecteur du processus transitionnel. L’appui
La coopération institutionnelle dans les domaines judiciaire et législatif illustre bien la mise en
application de la diplomatie publique avec l’élargissement des interlocuteurs de l’UE. Mais c’est aussi
au niveau des acteurs politiques qu’il faut appréhender ce renouveau de la diplomatie publique de l’UE
en Tunisie.
Dans le cadre des projets « Soutenir la transition démocratique en Tunisie en appuyant les organisations
de la société civile et les acteurs politiques »193 et « Dialogue sur le pluralisme politique en Tunisie »,
l’UE a cherché à étendre son action au niveau du dialogue politique autour du processus constitutionnel
entre les acteurs de la société civile et les partis politiques. Chaque mois, tout au long de l’année 2013,
des réunions bilatérales avec les différents partis politiques ont été organisées ainsi que des séminaires
ouverts aux acteurs de la société civile. Ces projets, au-delà de leur faible dotation194, reflètent la capacité
de l’UE à s’adapter à l’évolution du contexte politique. En effet, ce programme a été lancé en 2013,
l’année où la Tunisie a traversé de grave de graves crises politiques conduisant à la démission du
gouvernement et à l’instauration d’un dialogue national195.
11.2.2) Le rôle de la société civile, l’UE et la « nouvelle diplomatie »
La société civile tunisienne est très active et très dynamique. Le souffle démocratique issu de la
révolution de Jasmin en a fait un des acteurs incontournable de la coopération bilatérale avec l’UE. Dès
2011, l’UE s’est rapidement orientée vers la société civile. Comme nous l’avons vu la création d’une
190 L’UE a contribué au projet géré par le PNUD appui au processus constitutionnel et parlementaire en Tunisie
A hauteur de 2 374 400 $. Voire le rapport du PNUD « Fiches projets Gouvernance – Tunisie », p.7, consulté sur internet http://www.tn.undp.org/content/dam/tunisia/docs/Projets/Gouvernance%20D%C3%A9mocratique/Unite-Gouvernance_fiches.pdf 191 Ce projet s’inscrit dans le programme d’appui à la Justice inscrit dans le Plan Indicatif National revu en 2011 après la
révolution. Il est doté de 630 000 euros, voire le rapport 2013 de coopération Tunisie-UE, p.59 192 Programmes dotés de 350.000 euros pour la période 2013-2014, Ibid 193 Projet doté de 217.000 € pour la période 2013-2014, Ibid. 194 Les sommes consacrées aux programmes politiques sont naturellement plus faible, puisque il s’agit non pas de financer un
parti politique, mais d’organiser des événements, des rencontres, des déplacements d’où des besoins qui sont de fait moins
importants que pour les programmes setoriels dans le domaine de l’agriculture et de l’éducation. Ce point-là a été mis en avant
par un diplomate du SEAE (entretien 1) qui reme t en cause les critiques faites à la ventilation de l’IEV concernant les faibles
montants alloués au dialogue politique. 195 L’année 2013 sera un véritable test pour la Tunisie durant laquelle ces conflits vont atteindre leur paroxysme : actes
terroristes, assassinat en février puis en juillet de deux figures politique de l’opposition, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi.
Mais là encore les forces politiques avec la société civile vont trouver les ressorts pour faire émerger un consensus à travers
l’instauration d’un dialogue national lancé le 25 octobre 2014. Sous la houlette d’organisation syndicale l’UGTT et l’Utica et
d’organisation de la société civile la Ligue Tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) et l’Ordre des avocats, le dialogue
national permettra d’aboutir, non sans difficulté, à l’instauration d’un gouvernement technocratique, indépendant, chargé de
mener à l’adoption de la nouvelle Constitution
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
70
Facilité pour la Société civile, l’élargissement du champ d’action de l’IEDDH en Tunisie ou la création
d’un fonds européen pour la démocratie et les droits de l’Homme ont constitué les innovations majeures
des communications de mai et mars 2011.
Source : rapport 2013 de coopération Tunisie-UE196
Les projets de soutien aux acteurs de la société civile ont ainsi pris une ampleur considérable après les
printemps arabes. Aujourd’hui l’UE finance plus d’une cinquantaine de projets portés par la société
civile. Il y a lieu de relever quelque projets qui reflètent le renforcement de l’action de l’UE dans le
domaine des droits de l’Homme – « Vers une transparence du processus Electoral (ATED) », « Soutien
à la démocratisation en Tunisie », « Renforcement des défenseurs et des acteurs de la société civile
tunisienne (FEMDH) », « Appui aux partis politiques (Fondation Konrad Adenauer) », « Une transition
démocratique sensible au genre en Tunisie (AFTURD – ONU Femmes) », « Soutenir les médias
démocratiques en Tunisie (DW-Akademie) », - qui témoignent d’une ouverture radicale de la
coopération vers la société civile.
Mais c’est véritablement avec le lancement du Programme d’Appui à la Société Civile à hauteur de 7
millions d’euros que, l’UE a pu consolider son soutien aux acteurs non étatiques sur une grande partie
du territoire tunisien. Ce programme est le fruit d’un processus de consultation qui a réuni plus de 200
partenaires de la société civile et des organisations internationales et qui s’est déroulé dans 20
gouvernorats durant l’année 2012. La portée de cette consultation nous amène à souligner le rôle
catalyseur et l’effet de levier du soutien de l’UE pour la société civile. Le fait que la convention de
subvention ait été signée avec le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale est
aussi le reflet d’une évolution profonde dans la coopération bilatérale (sachant que sous Ben Ali aucune
convention de ce type n’avait été signée et que le programme d’appui à la société civile programmé en
2001 n’a jamais démarré).
196
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
71
Toutes ces initiatives contribuent aussi à la visibilité de l’UE non seulement auprès des acteurs de la
société civile mais aussi au niveau de l’opinion publique. La visibilité n’est pas une fin en soi mais c’est
un objectif primordial pour l’UE, afin notamment de s’émanciper des chancelleries nationales et
s’affirmer comme un acteur diplomatique à part entière. On peut dans cette perspective recourir à des
enquêtes d’opinion commandées dans le cadre du programme de communication du voisinage de
l’UE197. Ainsi, d’après le dernier baromètre de l’UE en Tunisie, basé sur plus de 1000 entretiens
individuels réalisés en décembre 2013, 64% des Tunisiens considèrent l’UE comme un partenaire
essentiel quand seulement 9% ont une image négative de l’UE. Ce qui est intéressant c’est de constater
que l’UE jouit d’une confiance (59%) plus élevée que les autres acteurs régionaux comme la ligue arabe
(31%) et internationaux comme les Nations Unies (37%)198 . Ces sondages d’opinion doivent être
analysés avec un certain recul, notamment en fonction des différents biais qui peuvent influer les
résultats, mais ils expriment une tendance à l’œuvre, celle d’une meilleure visibilité de l’UE.
Cette tendance peut aussi se refléter au niveau du discours des acteurs de la société civile. En
comparaison avec le rapport du réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme remis en 2010199, les
recommandations des défenseurs des droits de l’Homme se limitent à demander plus transparence,
surtout au niveau des ALECA et a critiquer la politique migratoire. On est loin des accusations et des
critiques sévères dont faisait part la PEV avant les printemps arabes. Par ailleurs l’UE semble se montrer
plus attentive aux demandes de la société civile. Ainsi a-t-elle lancé une consultation sur les ALECA
pour répondre aux attentes de transparences sur les négociations de tels accords.
12. La politique européenne de voisinage en Egypte et le dilemme démocratie-sécurité
La relation de l’UE avec l’Egypte renferme à elle seule toute la complexité des relations euro-
méditerranéennes : Du conflit Israélo-palestinien, à la coopération militaire, en passant par la lutte contre
le terrorisme, la relation à l’Islam politique, le dilemme démocratie-stabilité/sécurité, le soutien implicite
à un régime autoritaire, l’Egypte semble rassembler tous les dilemmes qui travaillent la Politique
européenne de voisinage. Dans ce contexte, tant au niveau politique que programmatique la différence
entre la réalisation du potentiel de la PEV en Tunisie et en Egypte est frappante. En Tunisie, sur le plan
politique l’UE a été en mesure de renégocier un nouveau Plan d’Action adossé à l’octroi du statut
privilégié. En Egypte ce processus de reformulation des relations bilatérales sur de nouvelles bases n’a
jamais vu le jour. Sur le plan programmatique et sectoriel, les négociations sur les ALECA, le Partenariat
197 Voir le site internet : http://euneighbourhood.eu/fr/contactez-le-programme-de-communication-du-voisinage-de-lue/ 198 Baromètre du voisinage de l’UE, « Fiche d’information sur la Tunisie, automne 2013 », TNS sondage opinion, rapport
consulté sur internet : http://euneighbourhood.eu/wp-content/uploads/2014/05/ENPI-Wave-4-Factsheets-TN-with-annexes.pdf 199 Rapport sur la coopération UE-Tunisie, REMDH, op.cit
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
72
de mobilité et la programmation des fonds de l’IEV (élaboration d’un Support Single Framework) sont
au point mort (en Tunisie le Single Support Framework pour l’année 2014-2015 a été validé).
En somme, l’on pourrait y voir la concrétisation de l’approche différenciée qui découle du principe
« more for more » : La Tunisie bénéficiant d’un approfondissement de ses relations à hauteur de ses
engagements démocratiques, tandis qu’en Egypte, où le respect des droits de l’Homme connait une
régression, l’UE n’envisage pas de mettre à profit les instruments de la PEV. Pour autant, il semble que
c’est moins l’application du principe « more for more » que l’incapacité de l’UE à inciter des réformes
sur le plan politique qui explique le degré de différenciation de la PEV en Egypte et Tunisie. Si en
Tunisie, l’UE a su déployer de manière dynamique et incitative toute la palette d’instruments qu’offre
la PEV, en Egypte ces mêmes instruments n’ont eu qu’un effet de levier limité, voire nul. Cela ne signifie
pas que l’UE n’ait pas entretenu un dialogue politique de haut niveau.
L’UE a bénéficié d’une certaine visibilité et a su se positionner au centre du jeu diplomatique (cf création
de la Task Force). Catherine Ashton a notamment été la seule diplomate étrangère à pouvoir visiter
M.Morsi, pendant sa période de détention. Seulement, l’UE n’a pas su, ou pas pu, mettre à profit ce
dialogue politique en termes de consolidation de l’Etat de droit. Alors que le principe « more for more »
(conditionnalité positive) induit aussi la notion d’une conditionnalité négative « less for less », face à la
reformulation de l’autoritarisme militaire en Egypte, l’UE n’a pas user de cette instrument pour faire
pression sur le gouvernement. Bien au contraire, les initiatives diplomatiques de l’UE tendent à légitimer
le pouvoir en place reflétant ainsi tout le poids du dilemme démocratie-stabilité/sécurité qui structure la
PEV en Egypte.
12.1) L’effet de levier limité des instruments de la PEV
La Commission a reconnue elle-même que les instruments déployés en Egypte (appui budgétaire,
négociations commerciales, coopération sectorielle) n’ont eu qu’un effet de levier limité en matière
d’avancées démocratiques et de respect des droits de l’Homme. La délégation de l’UE en Egypte
n’espérant d’ailleurs aucune avancée dans ce domaine sous le régime de Moubarak200. Le soulèvement
de février ouvrait donc une fenêtre d’opportunité pour redéfinir ses relations avec l’Egypte. Quatre ans
après la chute du régime de Moubarak, il apparait que l’UE, n’a pas réussi à influencer l’agenda politique
des autorités égyptiennes successives mais à même perdu de l’influence, les leviers de la PEV n’ayant
eu aucun effet sur l’orientation du processus transitionnel.
200 Richard YOUNGS, Hélène MICHOU, “EU action to strengthen respect for humanrights and democracy in the process of
political changes in the middle east and north africa”, Directorate-General for External Policies of the Union, European
Parliament study, 04 December 2012.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
73
D’une part, l’offre de l’UE en réponse aux printemps arabe, qui reposait sur les « 3M » - Market, Money,
Mobility (cf chapitre III), a totalement été dénuée de toute portée : les autorités égyptiennes ont
clairement refusé d’ouvrir les négociations sur les ALECA et les Partenariat de mobilité201. D’autre part
la conditionnalité de l’aide (Money) s’est retrouvée limité par « l’indifférence202 » des autorités
égyptiennes face aux effets d’une suspension de l’aide européenne ou de la coopération bilatérale : Le
refus des autorités à la demande de l’UE d’organiser une mission d’observation électorale203, l’adoption
du décret qui octroi les pleins pouvoir à M.Morsi au moment même des négociations sur la création de
la Task Force et le plan d’aide de l’Union européenne en Novembre 2012, les vives critiques adressées
à l’UE par le régime militaire après qu’elle eut ne serait-ce que mentionné la possibilité de « revoir »
son aide en raison des violentes répressions d’aout 2013204, la répression systématique sous le régime
militaire des frères musulmans (cf 12.2) et de la société civile, les entraves chroniques à l’indépendance
de l’instance de la justice et à la liberté des médias, sont autant d’éléments qui traduisent l’indifférence
des autorité et l’incapacité de l’UE à user de la conditionnalité.
Au lendemain de la destitution du Président M.Morsi le 3 aout, l’Arabie, les Emirats arabes unis (EAU)
et le Koweit ont annoncé un plan de 12 milliards d’euros qui se déclinent en aides en nature (livraison
de pétrole et de gaz) en prêt et en dons. Un autre accord avec les EAU portant sur un montant de 16
milliards sera aussi annoncé en octobre. Ces deux montant représentant presque 12 fois le montant de
l’IEV alloué à l’Egypte au titre de la PEV sur la période 2007-2013, le premier des trois moteurs
incitatifs de la PEV, Money, Mobility, Market (cf les 3M, chapitre III), se retrouve de facto limité par
l’appui d’autre acteurs. Et ce d’autant plus que ce soutien n’obéit pas à une logique programmatique
relativement lourde et n’est pas soumis à une conditionnalité sur la mise en œuvre de réformes sur les
plans politique et stratégique.
Enfin, d’autre facteurs peuvent mis en avant pour appréhender la perte de vitesse des leviers de la PEV :
Selon plusieurs acteurs de la société civile205, les gouvernements transitoires, et plus spécifiquement le
régime militaire, semblent moins préoccupés pat leur image auprès de la Communauté internationale.
D’autre part, le manque de crédibilité de l’UE, et plus généralement des acteurs extérieurs, à appuyer
des réformes démocratiques, ont contribué à internaliser le débat sur les droits de l’Homme : les
201 Joint communication to the European Parliament, the Council, “Delivering on a new European Neighbourhood Policy « In
the EU’s Southern Neighbourhood” Brussels, 15.5.2012 JOIN(2012) 14 final, p.13 : “the EU has offered to engage in
partnership dialogues on migration, mobility and security with Egypt, Morocco and Tunisia. (…) Egypt has so far declined to
enter into concrete discussions” 202 Entretien Réseau Euroméditerranéen… op.cit 203 Une autre mission sera néanmoins organisée pour le référendum de janvier 2014, mais les conditions dans lesquelles elle
s’est déroulée sont assez révélatrice de l’indifférence des autorités égyptienne à l’égard de l’Union européenne. 204 Mettre le communiqué + un article 205 Richard YOUNGS, Hélène MICHOU, “EU action… » op.cit
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
74
nouveaux médias, les acteurs de la société civile, et la pression de l’opinion publique, apparaissant, à
juste titre, mieux à même d’influencer les gouvernements en place pour mener ces réformes206.
12.2) Le dilemme démocratie-stabilité : Buisinesse as usual
Pour autant que l’UE se soit retrouvée marginalisée, l’indifférence des autorités face à la possibilité
d’une suspension de l’aide ne doit pas faire oublier non plus que l’UE dispose, malgré tout, de levier
d’action pour soutenir une démocratisation de la vie politique. Premièrement, bien que le discours n’ait
pas le poids de l’argent quand il s’agit de peser sur les orientations politiques, il constitue néanmoins un
appui crucial pour l’opposition. Sur ce plan, les acteurs de la société civile n’ont eu de cesse de critiqué
la « timidité » et le contenu des communiqués de presse de la HR/VP207. L’écart entre le volontarisme
affiché lors des communications de mars et de mai 2011 contraste avec l’incapacité du SEAE à formuler
une remise en question de la politique du régime militaire. La diplomatie publique, qui consiste à
multiplier les canaux d’action, est limitée en Egypte quand il s’agit de « condamner » les répressions
violentes et la dégradation des droits de l’Homme. Deuxièmement, le processus de normalisation des
relations avec le régime militaire, qui tend à légitimer le gouvernement en place, révèle de manière aigue
la continuité du dilemme démocratie-stabilité qui structure les relations bilatérales.
Déjà, sous la présidence de M.Morsi, la politique européenne de voisinage s’est retrouvée dominée par
les enjeux sécuritaires régionaux. Face à l’accumulation des évaluations négatives de l’UE sur
l’évolution des politiques internes - revue mi-parcours des avancées de la PEV en Egypte en 2012208
(« No progress was achieved with regard to improving the working conditions for civil society
organisations. Their work continues to be hindered by the current NGO law, which is still not in line
with international standards (…)The culture of violence and torture in the police, the security sector,
and in some cases the military, did not change, etc.), l’adoption de plusieurs résolution du Parlement
européen demandant une stricte conditionnalité de l’aide européenne et condamnant clairement
l’évolution de la situation209 - la reconnaissance positive du rôle de la Egypte sur la scène régionale
semble prendre le dessus. L’UE, en appui des Etats-Unis, a pris soin de s’assurer qu’un de ses partenaires
clé sur la « scène chaotique » du moyen orient, et en particulier avec Israël, ne change pas de position.
206 Entretien REMDH… op.cit 207 Richard YOUNGS, Hélène MICHOU, “EU action…” op.cit p.25 : “This view was widely echoed by Egyptian activists, who
stressed that a consistent, strategic commitment of all EU institutions and MSs to support a democratic Egypt was key, but that
such a commitment was yet to be demonstrated in EU policy practice” 208Joint staff working document « Implementation of the European Neighbourhood Policy in Egypt Progress in 2012 and
recommendations for action », SWD(2013) 89 final, Brussels, 20.3.2013. 209 Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur l'Égypte: évolution récente (2012/2541(RSP)), Résolution du
Parlement européen du 14 mars 2013 sur la situation en Égypte (2013/2542(RSP)),
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
75
Dans cette optique, la politique internationale de M. Morsi peut être qualifiée de pragmatique210. Tout
en redéfinissant ses relations avec l’Iran211 et avec Gaza le positionnement de l’Egypte est resté
relativement stable : Le rôle de l’Egypte dans l’accord de réconciliation signé au Caire entre le Hamas
et l’Autorité palestinienne, l’obtention d’un cessez le feu à gaza en Novembre 2012, le respect des
accords de Camp David de 1979, le positionnement de l’Egypte sur le conflit syrien contre le régime de
Bachar Al Assad, la lutte contre le développement du djihadisme dans le Sinaï, sont apparus comme les
principaux éléments structurant de la politique extérieure de M. Morsi et, par-là, des relations bilatérales
avec l’UE. Ainsi en-a-t-il été de même après le coup d’Etat militaire contre les Frères Musulmans avec
de plus un alignement sur la politique étrangère américaine fondamentalement sécuritaire et militaire.
Avec l’arrivée des militaires au Pouvoir, le dilemme-démocratie va devenir d’autant plus frappant que
l’UE va proposer d’approfondir ses relations avec l’Egypte alors même que la situation se dégrade
considérablement (3 143 personnes tuées, dont au moins 2 528 civils, 17 000 blessés et 18 977 personnes
arrêtées au cours des dix derniers mois après la chute des Frères Musulmans). Par ailleurs, la
condamnation à mort en mars 2014 de 529 personnes, qui aurait entrainé une suspension de l’aide
publique pour tout autre pays, n’a pas eu d’impact sur la normalisation des relations. Dans la déclaration
suivant l’élection du Général Abdel fattah El-Sissi, L’UE va réaffirmer « sa volonté de travailler main
dans la main avec l’Égypte, partenaire important de la région, pour l’aider à relever des défis communs
à l’heure où le pays s’emploie à répondre aux aspirations de son peuple qui souhaite vivre dans une
société démocratique, stable, sûre et prospère »212. L’UE va même jusqu’à féliciter Abdel Fattah El-Sissi
comme nouveau président de l'Egypte alors même que le document souligne les atteintes aux droits de
l’Homme mis en exergue par la Mission d’Observation Electorale (MOE)213.
On retrouve le Speech-Act Gap sous-jacent au dilemme-démocratie stabilité, voire même une forme de
« schizophrénie » propre à la diplomatie des droits de l’Homme (on félicite tout en critiquant…) qui
continue de décrédibiliser l’UE en tant que puissance normative capable d’influer des réformes
politiques. La normalisation des relations bilatérales s’accélère alors même que la situation interne se
dégrade rapidement et violemment sur le plan des droits de l’Homme. Lors d’une conférence sur les
investissements le chef de la délégation européenne, James Moran, a ainsi déclaré que “Our offer for a
far-reaching Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) remains on the table, (…) we
210 Elyès GHANMI, Pasquale DE MICCO, « Egypt - a strategic partner for the EU », Directorate-General for External Policies
of the Union Policy Department, ©, European Union, 2012 p.16 211 L’Egypte a permis aux navires iraniens de passer par le canal de suez. Depuis la révolution islamique les navires iraniens
n’avaient pas le droit d’emprunter ce canal. Cependant la normalisation des relations avec l’Iran a été freinée par la prise de
position lors d’une conférence organisée à Téhéran contre le régime de Bachar Al Assad (soutenu par le régime chiite iranien). 212 Declaration on behalf of the European Union on the presidential elections in Egypt, PRESSE 330, Brussels, 5 June 2014,
10649/1/14 REV. 213 European Union Election Observation Mission Arab Republic of Egypt, Presidential Election, 26/27 May 2014 Preliminary
Statement, Cairo, 29 May 2014
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
76
doubled trade in the six-year period 2004 to 2010. We believe we can do it again and double it again
over the next few years if we get these talks under way.”214
Sur le plan programmatique, la coopération n’a pas évolué. Comme nous l’avons vu (cf chapitre III) les
programmes essentiellement basés sur des aspects sociaux-économiques ont été maintenus. En
revanche, il est difficile d’évaluer l’avancée des négociations dans le cadre du processus de
programmation du nouvel IEV pour la période 2014-2020. En Egypte le Plan d’Action a été prolongé
jusqu’en 2014 lors du dernier Conseil d’Association qui s’est tenu le 23 février. Selon le rapport
d’évolution de la PEV en 2013 les négociations pour l’adoption d’un nouveau Plan d’Action n’ont pas
avancées. Il est probable que ces négociations n’aboutissent pas en 2014, et que l’adoption d’un Single
Support Framework ne soit pas effective avant la fin 2015. Dans ce cadre l’aide au titre de l’IEV se
verrait de facto limitée au niveau règlementaire. En revanche, l’aide macro-financière décidée à hauteur
de 4 milliards d’euros (2 milliards de prêts de la Banque européenne d’investissement et 2 milliards de
prêts de la BERD) pourrait contribuer à maintenir un flux financier (certes pas sous forme de don) de
l’UE vers l’Egypte. En 2013 les prêts accordés par la BERD ont fortement augmenté pour passer de
moins de 20 millions en 2012 à plus de 160 millions en 2013. En 2014 les engagements de la BERD
s’élève à 470 millions en Egypte215. Il est difficile d’évaluer jusqu’à quel point le SEAE et la
Commission ont prise sur ce type d’aide macro-financière qui ne dépend pas du budget européen. Dès
lors, au-delà du dilemme démocratie la capacité de l’UE à réorienter l’aide en fonction du contexte
politique semble aussi limitée par l’existence de canaux financiers parallèle à l’IEV.
En conclusion, la reprise des négociations autour du Plan d’Action et du Single Support Framework,
même si ces documents intègrent finalement des axes relatifs aux droits de l’Homme216 et à lutte contre
la corruption, devrait s’inscrire dans le processus de normalisation en cours des relations avec les
autorités Egyptiennes. Ce faisant, il est probable, comme l’ont relevé les précédentes évaluations217 et
notamment le rapport de la Cour des Comptes sur l’aide européenne en Egypte218, que l’impact de l’aide
européenne via l’appui budgétaire sur la situation des droits de l’Homme reste limité.
214 “EU seeks wider free trade agreement with Egypt”, Reuters, Monday 10 Feb 2014, Article consulté sur internet :
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/93946/Egypt/0/EU-seeks-wider-free-trade-agreement-with-Egypt.aspx 215 European Bank for reconstruction “factsheets Egypt mars 2014” EBRD, mars 2014 216 Voir les réponses du SEAE et de la Commission au Rapport spécial n°4, « la coopération de l’UE avec l’Egypte dans le
domaine de la gouvernance » de la Cour des Comptes Européenne en 2013 qui critiquait la fortement l’efficacité des
programmes d’appui budgétaire : le SEAE et la Commission ont plusieurs fois mis en avant la difficulté d’intégrer des axes de
coopération relatifs aux droits de l’Homme dans de tel document. 217 Final Report, “Evaluation of European Commission’s Support with Egypt – Country level Evaluation” Volume I: Main
Report, December 2010, EuropeAid/122888/C/SER/Multi, p 31-33 218 Cour des Comptes Européenne 2013 fr, Rapport spécial n°4, « la coopération de l’UE … » op.cit
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
77
Conclusion
Du partenariat euro-méditerranéen, à la politique européenne de voisinage, de la politique européenne
de sécurité et de défense commune au Service européen pour l’action extérieure, les relations extérieures
de l’UE n’ont cessez d’évoluer à l’aune des changements institutionnels et géopolitiques. A la manière
d’un historien l’on peut chercher à relever des ruptures dans la politique étrangère de l’UE. Partir d’un
événement politique marquant pour en saisir et analyser ses répercussions sur la politique extérieure des
acteurs diplomatiques en jeu. C’est cette démarche que nous avons cherché à adopter tout au long de
notre exercice. Mais avant de chercher une quelconque rupture il nous fallait définir l’objet de notre
étude, la Politique européenne de voisinage.
D’une part, l’étude du processus de bi-latéralisation des relations euro-méditerranéennes via le
développement d’un cadre institutionnel (Plan d’Action, Accords d’Association) et d’instruments
vecteurs de la puissance normative de l’UE (aide financière, standardisation des normes, accords de
libre-échange, etc.). Et, d’autre part, l’analyse du dilemme démocratie-stabilité, nous ont permis de
mettre en avant l’émergence d’une politique européenne étrangère dont la capacité à influencer ses
partenaires sur le plan politique est restée bridée par (i) le dilemme sécuritaire, (ii) un cadre institutionnel
trop rigide et (iii) une faible cohérence de ses différentes composantes. Mais cela ne doit pas faire oublier
non plus la relative jeunesse de l’affirmation de l’UE comme un acteur diplomatique à part entière dans
un système international fondamentalement structuré par des relations interétatiques. Si l’UE n’a pas su
et pas pu mettre à profit tout le potentiel de la PEV en matière de démocratisation et de réforme politique,
l’on peut définir la formulation de la PEV comme l’acte I de la politisation des relations extérieures de
l’UE.
Cependant, alors que le processus de bi-latéralisation des relations avec le voisinage offrait un espace
pertinent pour approfondir le dialogue politique, la coopération avec les pays partenaires, à l’image de
la dimension régionale du Processus de Barcelone, est restée cantonnée au niveau sectoriel, économique
et sécuritaire. Dès lors, l’objectif qui a sous-tendu tout l’exercice était d’évaluer la politisation de la PEV
par rapport à ces trois éléments - coordination, cadre institutionnel, dilemme démocratie-stabilité. L’idée
était de dégager des ruptures à la lumières des printemps arabes (événement politiques fondateurs) et
des changements internes. Ce faisant notre travail nous a aussi amené à dégager des continuités
spécifiques à la difficulté de réformer la Politique européenne de voisinage. Et c’est là peut-être une des
premières conclusions que nous pouvons tirer.
La PEV est par nature difficile à réformer. Malgré la création d’un service diplomatique autonome et la
reformulation des objectifs, l’Instrument européen de voisinage, le principe de conditionnalité et les
principales politiques qui façonnent la PEV n’ont pas véritablement évolué. Il s’agissait plus de rendre
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
78
l’IEV plus flexible, d’approfondir la conditionnalité positive, les relations économiques et la coopération
en matière de gestion des flux migratoires plutôt que de proposer de nouveaux instruments et de
nouvelles initiatives. A ce titre, le qualitatif « nouvelle politique européenne de voisinage » utilisé par
le SEAE et la Commission est plus un exercice de communication, un « marketing politique », que le
fruit d’un changement en profondeur de la PEV. Pour autant, ces continuités ne sont pas antinomiques
avec un changement dans la coordination des composantes de la PEV, un renforcement de la capacité
d’influence de l’UE et un dépassement du dilemme démocratie-stabilité. L’UE n’a cessez de s’affirmer
comme un partenaire stratégique et c’est plus sa capacité à mettre à profit le potentiel de ses instruments
que leur réforme qui nous intéresse.
Le recul dont nous disposons aujourd’hui pour apporter une réponse définitive sur l’apport du SEAE en
termes de cohérence n’est pas suffisant. Mais une chose est certaine, la création du SEAE, qui joue un
rôle central dans la coordination des différentes parties prenantes à la PEV, a permis de dégager plus de
marge de manœuvre pour formuler des stratégies sur le moyens-long terme au niveau communautaire,
et de politiser le rôle des délégations de l’UE, qui agissent de plus en plus comme de véritables
ambassades. Au niveau des objectifs communs, il semble que le SEAE ait permis aussi de mieux clarifier
les priorités politiques de la PEV, notamment en cherchant à lier de manière plus systématique et plus
dynamique les avancées en matière de droits de l’Homme et de consolidation de l’Etat de droit avec la
mise en œuvre des différents instruments (évaluation mi-parcours de l’IEV, intégration de critère de
transparence pour l’appui budgétaire, création de nouveaux instruments dédiés à la société civile, etc.).
En revanche, la simplification du processus de programmation ne semble pas représenter une garantie
pour opérationnaliser la conditionnalité. Le temps nous dira si le SEAE a su s’impliquer davantage dans
la mise en œuvre des instruments et s’ils ont réellement évolué vers plus de flexibilité et plus de
conditionnalité.
Une chose est certaine, la reformulation de la PEV s’est traduite par une différenciation accrue, qui
repose sur le principe « more for more ». La comparaison entre l’Egypte et la Tunisie est révélatrice de
l’approche différenciée mise en avant par le SEAE. Là encore, il s’agit plus d’une continuité que d’une
réforme en profondeur. La PEV a toujours été conçue selon le principe de différenciation mais, trois ans
après les printemps arabes, force est de constater que ce principe est devenu une réalité tangible. A elle
seule la Tunisie a absorbé plus du tiers des financements supplémentaires alloués à l’Instrument
européen de voisinage dans le cadre du programme SPRING. Enfin, l’adoption d’un nouveau Plan
d’action, les négociations sur l’ALECA et le Partenariat de Mobilité et l’avancement du processus de
programmation pour la période 2014-2020 contrastent avec la stagnation, voire le « néant » des relations
bilatérales entre l’UE et l’Egypte. Nous sommes en présence de deux politiques européennes de
voisinage. Si l’on peut y voir à juste titre la concrétisation du principe de conditionnalité positive, ce
que nous avons voulu montrer c’est que la différence des trajectoires de la PEV en Tunisie et en Egypte
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
79
est plus le fruit d’une différenciation subie que d’une volonté politique assumée de limiter les relations
avec les autorités égyptiennes dans un contexte de reformulation de l’autoritarisme. Partant de ce constat
nous pouvons déduire que la réalisation de la PEV et que la capacité d’influence de l’UE présuppose
déjà un contexte interne « apaisé » ou du moins propice au consensus.
Autrement dit, L’UE n’est pas un acteur moteur du processus transitionnel en ce qu’elle subit le conflit
politique interne et n’est pas à l’origine du consensus interne qui va permettre la redéfinition de la
séparation des pouvoirs, l’instauration d’une juridiction transitionnelle, la réforme de l’appareil
sécuritaire, l’apparition de nouveaux acteurs politiques et la recherche d’un nouvel équilibre
institutionnel qui caractérisent les transitions démocratiques. Mais elle joue un rôle vecteur en ce qu’elle
accompagne ces changements et permet de les consolider. L’approche du processus transitionnel
démocratique est l’objet de diverses analyses219 qui mettent en avant un processus généralement balisé
par deux phases : la transition politique, qui désigne le passage d'un régime à l'autre marqué par des
conflits de légitimé et des conflits interinstitutionnels qui peuvent se traduire par une polarisation de la
société et la consolidation démocratique durant laquelle le régime démocratique s'installe durablement
jusqu'à ce que tous les acteurs n'aient pas ou plus intérêts à sortir du jeu démocratique. Ainsi peut-on
conclure, au regard de l’évolution de la PEV en Tunisie, que si le rôle de l’UE est limité lors de la phase
de transition politique en revanche la politisation du cadre de la PEV - ouverture à la société civile,
renforcement de la coopération judiciaire, réallocation de l’appui budgétaire, montée en charge des
droits de l’Homme dans les Plans d’Actions, etc. – permet à l’UE de jouer un rôle vecteur dans la phase
de consolidation démocratique. Ainsi peut-on conclure que, malgré l’absence de rupture fondamentale
au niveau du cadre institutionnel, l’UE a réussi en Tunisie à mettre à profit tout le potentiel des
instruments dans le sens d’une politisation de la dimension programmatique de la PEV.
Il faut se garder des lectures déterministes, le processus de démocratisation n’est pas linéaire. En Egypte,
la PEV est restée au point mort parce que le pays n’est pas entré en phase de consolidation démocratique.
Pour autant est-ce dire que l’UE n’a pas les moyens d’agir ou, du moins, d’essayer d’activer différents
leviers d’action pour se positionner dans le débat interne en faveur d’une démocratisation au risque
d’assumer des tensions diplomatiques. On n’en vient donc à notre troisième élément – le dilemme-
démocratie stabilité. Ce que nous pouvons déduire c’est que le dilemme démocratie-stabilité reste un
élément structurant de la PEV des lors que le contexte régional joue un rôle déterminant dans les
relations bilatérales et que le partenaire est un acteur stratégique pour les Etats membres. Mais ce que
219 C’est avec la stabilisation des régimes démocratiques en Amérique latine et l’effondrement du régime so-
viétique que les études sur la démocratisation de régimes autoritaires se sont multipliés pour donner naissance à
ce qu’on appelle la « transitologie ». Ces recherches se sont étendues en Afrique et en Asie. Voir Tobias Hagmann,
« La transitologie: mode d’emploi pour la transition et la démocratie », a contrario, numéro 6 janvier 1998, voir
aussi Nathalie Cooren, « Transition démocratique d’un pays : quelques précision théoiques » Documentation
Irénées, Paris, 2005.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
80
nous avons voulu montrer c’est que la PEV n’est pas outillée pour interagir et influencer des régimes
autoritaires : l’offre de l’UE n’ayant pas l’effet escompté en termes incitatif, la conditionnalité est dénuée
de toute portée. Dans cette perspective la notion de différenciation subie prend tout son sens. La
stagnation des relations bilatérale avec l’Egypte est plus du ressort des autorités égyptiennes que de
l’UE. De ce fait, si les négociations sur les ALECA et sur la période de programmation n’ont pas avancé,
le positionnement de l’UE contraste avec les objectifs définis en amont qui mettent au cœur de la PEV
la démocratie et les droits de l’Homme220.
Des lors que l’UE tend elle-même à se définir de manière presque exclusive autour de la promotion de
ces valeurs, c’est la cohérence même des politiques extérieures de l’UE qui se retrouve entravée. En fait,
étant donné que la conditionnalité positive induit aussi une forme de conditionnalité négative (less for
less), la persistance du dilemme démocratie-stabilité se révèle plus par l’incapacité de l’UE à prendre
du recul par rapport aux autorités égyptiennes, qu’à son incapacité à les inciter à se réformer. Ce faisant
la PEV renoue avec le Speech-Act gap qui l’a caractérisée avant les printemps arabes. Cette observation
vient conforter notre conclusion selon laquelle la PEV est une politique adaptée et efficace en phase de
consolidation démocratique mais qu’elle reste limitée en phase de transition politique et ce d’autant plus
que cette dernière débouche sur un régime autoritaire.
220 La communication conjointe du SEAE et de la Commission, Human Rights and democracy at the heart of EU external
action – Towards a more effective approach, adoptée le 12 décembre 2011
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
81
Table des Matières
INTRODUCTION ................................................................................................................................. 5
PARTIE I ............................................................................................................................................................................... 9
CHAPITRE I : MISE EN PERSPECTIVE, DU PARTENARIAT EUROMED A LA PEV ........................ 10
1. Le cadre multilatéral ou l’absence d’une véritable politique étrangère européenne ....................................... 10
1.1) L’échec du processus de Barcelone ............................................................................................................... 10
1.2) L’Union pour la Méditerranée, l’avènement de la coopération programmatique sans vision politique ...... 12
2. La politique européenne de voisinage et la bi-latéralisation du partenariat euro-méditerranéen ................... 13
2.1) L’émergence d’une politique européenne étrangère – La politique européenne de voisinage (PEV) ........... 13
2.2) Bi-latéralisation et politisation : les vecteurs de la puissance normatives .................................................... 14
3. Le dilemme sécurité-démocratie ....................................................................................................................... 16
3.1) De l’Europe élargie à la stratégie européenne de sécurité ........................................................................... 16
3.2) De la PEV à l’inefficacité de la conditionnalité politique ............................................................................. 18
CHAPITRE II : REFORME INSTITUTIONNELLE, LE SEAE VERS UNE POLITISATION DE LA PEV ?
............................................................................................................................................................... 21
4. La genèse du SEAE vers une redéfinition des relations extérieures de l’Union européenne ? ......................... 22
4.1) l’impact du SEAE sur la PEV, cohérence, coordination, politisation. .......................................................... 22
4.2) Le SEAE dans le système diplomatique de l’UE ............................................................................................ 25
5. Vers une « communautarisation » de la diplomatie des droits de l’Homme ..................................................... 28
5.1) Pas de cohérence sans objectif commun : le rôle du SEAE dans la reformulation des objectifs de la PEV .. 28
5.2) Les délégations de l’Union européenne – nouvelles prérogatives, vers des délégations plus politiques ...... 32
CHAPITRE III : LES PRINTEMPS ARABES - L’UNION EUROPEENNE FACE AUX BOULEVERSEMENTS
POLITIQUES ........................................................................................................................................... 34
6. Les bouleversements des printemps arabes et la réaction de l’Union .............................................................. 35
6.1) La réaction immédiate de l’Union européenne .............................................................................................. 35
6.2) Le rôle du Parlement européen…………………………………………………………………………………………39
7. Vers un dépassement du dilemme « démocratie-stabilité » ? ............................................................................ 41
7.1) La réponse politico-institutionnelle de l’Union européenne .......................................................................... 41
7.2) La réponse programmatique de l’Union européenne .................................................................................... 46
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
82
PARTIE II ........................................................................................................................................................................... 50
CHAPITRE IV : LA PEV, UNE POLITIQUE ADAPTEE AUX PROCESSUS TRANSITIONNELS ? .......... 51
8. La PEV – Du cadre politique au cadre programmatique : La réforme de l’Instrument européen de voisinage :
vers un instrument plus politique et plus flexible ? ............................................................................................... 52
8.1) La conditionnalité dans l’Instrument européenne de voisinage .................................................................... 52
8.2) La simplification du processus de programmation de l’IEV.......................................................................... 54
8.3) Appui budgétaire – un instrument programmatique qui présuppose un dialogue politique de haut-niveau :
entre l’urgence des processus transitionnel et le temps long de la construction des relations bilatérales. .......... 55
9. Politique commerciale et Politique migratoire. ................................................................................................ 59
9.1) Vers des Accords de Libre Echange Complets et Approfondis. ..................................................................... 59
9.2) La politique migratoire de l’UE – ou comment la dimension extérieure des politiques intérieure affecte la
PEV ....................................................................................................................................................................... 62
CHAPITRE VI : L’EVOLUTION DE LA PEV EN TUNISIE ET EN EGYPTE : DEUX TRAJECTOIRES
TRANSITIONNELLES, DEUX PEV.......................................................................................................... 63
11. L’UE la Tunisie – Un dialogue politique approfondi et une coopération riche ......................................... 64
11.1) Sur le plan politique : vers un partenariat privilégié .................................................................................. 65
11.2) Sur le plan programmatique : l’impact sur le terrain de la Politique européenne de voisinage – La Tunisie
un « succès story » ................................................................................................................................................ 67
12. La politique européenne de voisinage en Egypte et le dilemme démocratie-sécurité ..................................... 71
12.1) L’effet de levier limité des instruments de la PEV ....................................................................................... 72
12.2) Le dilemme démocratie-stabilité : Buisinesse as usual ................................................................................ 74
CONCLUSION ........................................................................................................................................ 77
TABLE DES MATIERES ......................................................................................................................... 81
BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................................... 83
ANNEXE ................................................................................................................................................ 83
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
83
Bibliographie
Chapitre I
Ouvrages généraux
Zaki Laïdi, « La norme sans la force, Presses de Sciences Po « Références », 2008
Franck Petiteville, « La politique internationale de l’Union européenne », Presses de Sciences Po,
Fabien Terpan, « La politique étrangère, de sécurité et de défense de l'Union européenne » Broché, 18
janvier 2010
Articles
Moratinos Miguel Angel, « Barcelone, entre bilan et relance », Politique étrangère 3/ 2005 (Automne),
p. 523-534
Le Gloannec Anne-Marie, « Chapitre 18. La politique de voisinage », in Renaud Dehousse, Politiques
européennes Presses de Sciences Po « Les Manuels de Sciences Po », 2009 p. 369-38
Labaronne Daniel, « Les difficultés de l'intégration économique régionale des pays maghrébins »,
Mondes en développement, 2013/3 n° 163, p.
Ian Manners, «Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? »
Raffaella A. Del Sarto and Tobias Schumacher, “From EMP to ENP: What's at Stake with the European
Neighbourhood Policy towards the Southern Mediterranean?”, European Foreign Affairs Review 10:
17-38, 2005.
Prodi R., L’Europe et la Méditerranée : venons-en aux faits, Louvain-la-Neuve, 26 novembre 2002.
Julien Jeandesboz, « Définir le voisin. La genèse de la Politique européenne de voisinage », Cultures
& Conflits [En ligne], 66 | été 2007, mis en ligne le 17 novembre 2007
Charles Thépaut “Can the EU Pressure Dictators? Reforming ENP Conditionality after the Arab
Spring”, EU diplomacy paper n°6/11, College of Europe, 2011
Rosa Balfour, “Reassessing the European Neighbourhood Policy, promoting human rights and
democracy in the EU’s neighborhood: tools, strategies and dilemmas” EPC Issue Paper No.54 June 2007
Labaronne Daniel, « Les difficultés de l'intégration économique régionale des pays maghrébins »,
Mondes en développement, 2013/3 n° 163
Petithomme M., « Quelle politique de voisinage pour l’Union européenne ? Entre injonctions
sécuritaires et conditionnalité démocratique, la puissance normative européenne en question. »,
Politique européenne 2009/02, n° 28, p. 163-172.
Rapports
Rapport de la BEI « Union pour la Méditerranée, Rôle et vision de la BEI »
Bruno Reis, “Political Change in the Mediterranean”, EuroMesco n°70, Lisbon, 2008
Roberto Aliboni, Fouad M. Ammo “Under the Shadow of ‘Barcelona’:From the EMP to the Union for
the Mediterranean” EuroMesco n°70, n°77, January 2009
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
84
Röttsches Dagmar, « Le partenariat euro-méditerranéen : la fin d'une vision ? » Introduction, L'Europe
en Formation, 2010/2 n° 356, p. 3-9.
Rapport de Michel VAUZELLE remis au Président de la République « Avec la jeunesse
méditerranéenne, maîtriser et construire, notre communauté de destin », janvier 2013
Rapport du Réseaux Euro-méditerranéen des droits de l’Homme, REMDH, « Les incohérence des
politiques européennes face aux violations des droits de l’Homme en Tunisie », Copenhague, septembre
2010
Rapport Final, « Evaluation des opérations d'aide budgétaire de la Commission Européenne à la Tunisie
entre 1996 et 2008 », EuropeAid/122888/C/SER/M, mars 2011
Communications officielles de l’Union européenne
Commission européenne, L’Europe élargie – Voisinage : un nouveau cadre de relations avec nos voisins
de l’Est et du Sud, Bruxelles, COM(2003) 104 final, 11 mars 2003
« Une Europe sûre dans un monde meilleur, Stratégie européenne de sécurité », Bruxelles, le 12
décembre 2003
Commission européenne, Politique européenne de voisinage. Document d’orientation. Bruxelles, COM
(2004) 373 Final, 12 mai 2004,
Decision No 1/2007 of the EU-Tunisia Association Council of 9 November 2007 setting up a
Subcommittee on Human Rights and Democracy. Retrieved June 15, 2012
Rapport d'information de M. Jacques BLANC, fait au nom de la délégation pour l'Union européenne n°
451 (2007-2008), 9 juillet 2008
Chapitre II
Ouvrage généraux
Fabien Terpan, « La politique étrangère, de sécurité et de défense de l'Union européenne Broché », op.
cit.
Articles
Petiteville Franck, « Les mirages de la politique étrangère européenne après Lisbonne », Critique
internationale 2/ 2011 (n° 51), p. 95
Niklas Helwig Paul Ivan Brant Kostanyan, “The new EU foreign policy architecture reviewing the first
two years of the EEAS” Centre for European Policy Studies (CEPS) Brussels, 2012
Stephan Keukeleire, Michael Smith, SophieVanhoonacker, “The Emerging EU System of
Diplomacy:How Fit for Purpose?”, The Diplomatic System of the European Union, Policy Paper 1,
march 2010
Simon Duke, “The European External Action Service”, The Diplomatic System of the European Union,
Policy Paper 2, July 2010
Simon Duke, Aurélie Courtier , “The EU’s External Public Diplomacy and the EEAS - Cosmetic
Exercise or Intended Change?”, The Diplomatic System of the European Union, Policy Paper 7,
November 2011
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
85
Keukeleire, Stephan and Arnout, Justaert, « EU Foreign Policy and the Challenges of Structural
Diplomacy: Comprehensiveness, Coordination, Alignment and Learning » DSEU Policy Paper, 12
February 201
B., Van Vooren, “A Legal Institutional Perspective on the European External Action Service”.
B. Van Vooren, “A Paradigm for Coherence in EU External Relations: The European Neighbourhood
Policy”, Doctoral Thesis, European University Institute, Florence, 2010, Chapitre VI: Coherence as
synergy in the ENP.
Mercedes Candela Soriano, « l’Union Européenne et la protection des droits de l’homme dans la
coopération au développement : le rôle de la conditionnalité politique », Revue Trimestrielle droits de
l’Homme, Faculté de droit de l’Université de Liège, 2002, p 875-900.
Emerson, M., Balfour, R., Corthaut, T., Wouters, J., Kaczyński, P.M., Renard, T., Upgrading the EU’s
Role as Global Actor – Institutions, Law and the Restructuring of European Diplomacy, Centre for
European Policy Studies, Brussels, 2011,
Drieskens, E., ‘What’s in a Name? – Challenges to the Creation of EU Delegations’, The Hague Journal
of Diplomacy, Vol. 7 (2012), pp. 51-64.
Rosa BALFOUR, The role of EU delegations in EU human rights policy, Directorate-General for
External Policies of the Union Policy Department,European Union, 2013
Andreas KETTIS and Pekka HAKALA “Recovering Tunisian and Egyptian assets: Legal complexity
challenges states in need”, directorate-general for external policies, policy department, AFET-EXPO »
« Un Monsieur Droits de l’Homme pour l’Europe : Stavros Lambrinidis », Info EU-logos, 6 septembre
« La politique de voisinage de l’UE se politise de plus en plus », Euractiv, publié le 02 Avril 2013
Rapports
« The Organisation and functioning of the European External Action Service: achievements, challenges
and opportunities », Etude de la direction des Affaires étrangères du Parlement européen,
EXPO/B/AFET/2012/07, 2013
Youngs, Richard and Hélène Michou (2012), “EU Action to Strengthen Respect for Human Rights and
Democracy in the Process of Political Changes in the Middle East and North Africa” Study, Directorate-
General for External Policy of the Union, European Parliament, EXPO/B/DROI/2011/23,
Rosa Balfour, “The role of eu delegations in EU human rights policy”, Study, Directorate-General for
External Policy of the Union, European Parliament, EXPO/B/DROI/2012/21 July 2013
James Moran and Fernando Ponz Canto « Taking Europe to the world 50 years of the European
Commission’s External Service », Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg, 2004.
Examen Annuel Officiel du SEAE, 2013
Rapport commandé par la Commission européenne “Thematic evaluation of the European Commission
support to respect of Human Rights and Fundamental Freedoms”, , EVA 2007- Lot 2, Volume 1, 2011.
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
86
Communications officielles de l’Union européenne
European Commission, SEC (2012) 48, Working Arrangements between Commission and the European
External Action Service, (EEAS), 13 January 201
The Council of the European Union (2012), EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights
and Democracy, 11855/12, Luxembourg 25 June
Commission européenne, « stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation », COM (2011), 303
final.
Commission européenne, « Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la
Méditerranée », COM(2011), 200 final.
Rapport remis au Haut représentant de la PESC, « Assurer la sécurité dans un monde en mutation »,
Bruxelles, 11 décembre 2008, S407/08
Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du
Service européen pour l’action extérieure, Journal officiel, L 201, 3 août 2010.
Chapitre III
Articles
“The four seasons of the “Arab Spring How EU institutions dealt with the Arab Spring in 2011”,
« Tunisie : les propos "effrayants" d'Alliot-Marie suscitent la polémique », Le Monde.fr | 13.01.2011 à
18h23 • Mis à jour le 14.01.2011
Erwan Lannon, « L’Union européenne et la nouvelle donne géopolitique en Méditerranée : bilan des
premières réponses de l’UE et perspectives dans un contexte en mutation », EuromeSCo, Papiers IEMed,
n°15, Avril 2012.
Erwan Lannon, « L’union européenne et la nouvelle donne géopolitique en Méditerrannée ; bilan des
premières réponses de l’UE et perspectives dans un contexte en mutation », EuroMesco paper, 2011,
Bruxelles
Erwan Lannon,“The Lisbon Treaty and Euromed Relations The New Architecture of the Treaty of
Lisbon: Implications for Euro-Mediterranean Relations”, IeMed, 2011
Rosa Balfour, “EU Conditionality after the Arab Spring”, EuromeSCo, Papiers IEMed, n°16, June
2012.
Rosa Balfour, « Changes and Continuities in EU-Mediterranean Relations after the Arab Spring » in An
Arab Springboard for EU Foreign Policy?, Egmont Paper n°54, January 2010, p27-34
Isabel Schäfer « Les politiques euro-méditerranéennes à la lumière du printemps arabe », Mouvements
2/2011 (n° 66), p. 117-126.
Aoun Elena, « L'Union européenne en Méditerranée », Politique européenne 1/ 2013 (n° 39), p. 76-104
Stephen Calleya, Monika Wohlfeld, « Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean. »
Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, University of Malta, 2012. 495. pp., (ISBN-978-99957-
0-176-5).
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
87
Timo Behr, « Après la Révolution : L’UE et la transition arabe », Institut Jacques Delors-Notre Europe,
avril 2012.
Timo Behr, « The European Union’s Mediterranean Policies after the Arab Spring: Can the Leopard
Change its Spots? », The Amsterdam Law Forum, Vol 4, No 2 (2012), p 76-88, June 2012.
Jean-Yves Moisseron « Après les révolutions arabes : changer de paradigme dans le partenariat euro-
méditerranéen », Confluences Méditerranée 2/2011 (N° 77), p. 153-165.
Rapports
Etude statistique “The four seasons of the “Arab Spring How EU institutions dealt with the Arab Spring
in 2011”, Palorma, 2011
Andreas KETTIS and Pekka HAKALA “Recovering Tunisian and Egyptian assets: Legal complexity
challenges states in need”, directorate-general for external policies, policy department, AFET-EXPO
“Strengthening Parliaments Worldwide: the European Parliament and the promotion of democracy”,
OPPD. Retrieved June
« The Organisation and functioning of the European External Action Service: achievements, challenges
and opportunities », op., cit
EuropeAid Development and Cooperation Directorate-General, Budget Support Guidelines, “Executive
Guide: A modern approach to Budget support”, Brussels: September, 2012
Martin Van Der Linde, Dr Zine Barka, Yassine Hamza, Alaa Shaheen, Anja Willemsen, « The strategic
impact and cost-effectiveness of EU budget support with regard to supporting democratic transition in
southern Mediterrenanean countries », Volume II- Country reports, Policy department, European
Parlaiment Study, October 2013
Communications officielles de l’Union européenne
Déclaration du 10 janvier sur la Tunisie « Statement by the Eu high representative Catherine Ashton and
European Commissioner for Enlargement Stefan Fule on the situation in Tunisia », Brussel, 10 janvier
2011, A010/11.
Commission européenne, « Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la
Méditerranée », COM(2011), 200 final.
Union Européenne, « Réponse de l'UE au «Printemps arabe» : état des lieux deux ans après », Bruxelles,
8 février 2013, A 70/13.
European Union, « Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton at the Senior Officials’
meeting on Egypt and Tunisia », Brussels, 23 February 2011, A 069/11.
Rapport d’information du Sénat N°100 (2013-2014) « La politique méditerranéenne de l’Union
européenne après le printemps arabe : les cas du Maroc et de la Tunisie », Par M. Simon Sutour, Mme
Bernadette Bourzai, M. Jean-Francois Humbert et Mme Catherine Morin-desailly, 24 octobre 2013.
Résolution du Parlement européen, « stratégie de l'Union européenne en matière de commerce et
d'investissements pour le sud de la Méditerranée après les révolutions du Printemps arabe », 10/05/2012,
(2011/2113(INI))
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
88
Commission européenne “Neighbourhood : working for the southern Mediterranean, Eu support for
Tunisia”, EUROPAID, 2012
Chapitre IV
Articles
Charles Thépaut “Can the EU Pressure Dictators? Reforming ENP Conditionality after the Arab
Spring”, EU diplomacy paper n°6/11, College of Europe, 2011, p. 6-7
Dr Laure Delcour, “Improving the Eu’s aid to its neighbors: lessons learned from the ENPI,
recommandations for the ENI”, Briefing paper, directorate-General for external policies, European
Parliament, 23/07/2012, p.10-12.
Volker Hauck, Greta Galeazzi and Jan Vanheukelom, “The EU’s State Building Contracts
Courageous assistance to fragile states, but how effective in the end?”, Briefing Note, European
Center for development policy management ECDPM, No. 60 – December 2013
Ahmed farouk Ghoneim, Erwan Lannon “Workshop The Euromed Region after the Arab Spring
and the new generation of DCFTAs”, Directorate_General for external policies, European
Parliament, 22 octobre 2013,
Lala Hakuma « Accords de libre-échange approfondis et complets entre l’Union Européenne
et l’Égypte : quels sont les enjeux ? » L’AITEC, 25 Février 2013
M.Cermak, A.Canonne, R.Knottnerus, “EU Deep and Comprehensive Trade Agreements: A Threat
to the Aspirations of the 'Arab Revolutions”.
Nathalie Tocci, “state sustainability in the Southern Mediterranean and Scenarios to 2030: The Eu’s
response”, p.10-11
Iana DREYER, Trade Policy in the EU’s Neighbourhood Ways Forward for the Deep and
Comprehensive Free Trade Agreements
Mercedes Candela Soriano, « l’Union Européenne et la protection des droits de l’homme dans la
coopération au développement : le rôle de la conditionnalité politique », Revue Trimestrielle droits
de l’Homme, Faculté de droit de l’Université de Liège, 2002, p 875-900
Rapports
Cour des Comptes Européenne 2013 fr, Rapport spécial n°4, « la coopération de l’UE avec l’Egypte
dans le domaine de la gouvernance ».
Rapport Final, « Evaluation des opérations d'aide budgétaire de la Commission Européenne à la Tunisie
entre 1996 et 2008 », EuropeAid/122888/C/SER/M, mars 2011
EuropeAid Development and Cooperation Directorate-General, Budget Support Guidelines, “Executive
Guide: A modern approach to Budget support”, Brussels: September, 2012
« La politique méditerranéenne de l'Union européenne après le printemps arabe : les cas du Maroc et de
la Tunisie », Simon SUTOUR, Mme Bernadette BOURZAI, M. Jean-François HUMBERT et Mme
Catherine MORIN-DESAILLY, commission des affaires européennes, Rapport d'information n° 100
(2013-2014), déposé le 24 octobre 2013
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
89
Accord de réadmission, Note de migreeurope, « N°1, décembre 2012.
Communiqué de presse conjoint « Partenariat de Mobilité entre la Tunisie et l’UE : l’externalisation des
frontières européennes à marche forcée » Migreeurope, LTDH, UGTT, décembre 2012.
Communications
« La future approche de l'appui budgétaire de l'UE en faveur des pays tiers », COM(2011) 638 final,
Bruxelles, le 13.10.201
Communication “The “strengthening of the European Neighborhood Policy”, COM (2006) 726 final,
Brussels, 4 December.
« Les implications de la politique europeenne de voisinage dans le cadre des controles aux frontieres :
(accords de readmission, politique des visas, droits de l’homme) », Parlement européen étude, mars
2008 PE 393.284,
Regulation (EU) no 1052/2013 of the European parliament and of the Council of 22 october 2013
“Establishing the European Border Surveillance System (Eurosur)
Plan d’Action UE-Egypte
Plan d’Action UE-Tunisie
Plan Indicatif National Tunisie 2011-2013
Entretien avec Luca Oriani Vieyra, responsable de l’appui budgétaire, de la politique macro-fiscale
et de la coordination générale avec les institutions financières internationales au sein du
Département en charge du voisinage à la Commission
Chapitre VI
Articles
Keleire, Stephan and Arnout, Justaert, « EU Foreign Policy and the Challenges of Structural Diplomacy:
Comprehensiveness, Coordination, Alignment and Learning » DSEU Policy Paper, 12 February 2012
« Plan d'action Tunisie-UE (2013-2017) : Au moins dix conditionnalités à remplir par la Tunisie »
Babnet Tunisie, 13 avril 2013,
“EU seeks wider free trade agreement with Egypt”, Reuters, Monday 10 Feb 2014
Ben Néfissa Sarah, « trajectoires transitionnelles et élections en Tunisie et en Egypte », Confluences
Méditerranée, 2012/3 (N°82), p 9-27
Rapport
Dossier Euromedrights : « Égypte : la détérioration de la situation des droits de l’Homme se poursuit
après la formation du nouveau gouvernement »
Richard YOUNGS, Hélène MICHOU, “EU action to strengthen respect for humanrights and democracy
in the process of political changes in the middle east and north africa”, Directorate-General for External
Policies of the Union, European Parliament study, 04 December 2012,
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
90
Egypt - A Strategic Partner for the EU, Directorate-General for External Policies of the Union, European
Parliament study,
European Union Election Observation Mission Arab Republic of Egypt, Presidential Election, 26/27
May 2014 Preliminary Statement, Cairo, 29 May 2014
Zouhaier DHAHRI, Matylda Maria KONARCZAK, « Transition démocratique en Tunisie de 2011 à
2013 », mastercarrièreinternationale, 4 février 2014
Rapport du PNUD « Fiches projets Gouvernance – Tunisie », 2012
Final Report, “Evaluation of European Commission’s Support with Egypt – Country level
Evaluation” Volume I: Main Report, December 2010, EuropeAid/122888/C/SER/Multi,
Communications officielles de l’Union européenne
Conseil d'Association UE-Tunisie, Luxembourg, le 14 avril 2014, 8930/14
Déclaration conjointe pour le Partenariat de Mobilité entre la Tunisie, l'Union Européenne et ses Etats
membres participants
Acte d’exécution « cadre d’appui annuel Tunisie », RegCom Numéro du projet d'acte d'exécution voté
: D033964/01, 24 juin 2014
7 Joint communication to the European Parliament, the Council, “Delivering on a new European
Neighbourhood Policy « In the EU’s Southern Neighbourhood” Brussels, 15.5.2012 JOIN(2012) 14
final
Joint staff working document « Implementation of the European Neighbourhood Policy in Egypt
Progress in 2012 and recommendations for action », SWD (2013) 89 final, Brussels, 20.3.2013.
Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la situation en Égypte (2013/2542(RSP))
Declaration on behalf of the European Union on the presidential elections in Egypt, PRESSE 330,
Brussels, 5 June 2014, 10649/1/14 REV
Baromètre du voisinage de l’UE, « Fiche d’information sur la Tunisie, automne 2013 », TNS
sondage opinion, rapport
Entretien
Entretien SEAE (1) : Direction IV.A Afrique du Nord, Moyen Orient, Péninsule Arabique, Division
IV.A.4 Maghreb, Country Desk Tunisia – 27 mai 2014, Bruxelles
Entretien SEAE (3) : Direction IV Afrique du Nord, Moyen Orient, péninsule Arabique, Division
Politique européenne de voisinage – 1 juillet 2014, Bruxelles
Entretien DG DEVCO (2) (Commission) : Direction F voisinage, Division F.1 coordination
géographique Sud, Country Desk Tunisia – 18 juin 2014, Bruxelles
Entretien Ambassade de Tunisie : Conseiller politique de l’Ambassade de Tunisie à Bruxelles, - 6 mai
2014, Bruxelles
Entretien Réseau Euroméditerranéen pour les droits de l’Homme (REMDH) : coordinatrice du Réseau
REMDH, Emilie Dromzé - 9 juin 2014, Bruxelles
Samuel BAYLET
Mémoire – MRIAE
92
Annexe : les accords d’association et les Plans d’Actions euro-méditerranéens
Accord d’Association
TABLEAU les accords d’association euro-méditerranéens
Pays début des négociations Conclusion de l’accord Signature de l’accord entrée en vigueur
Tunisie décembre 1994 juin 1995 juillet 1995 décembre 1997
Israël décembre 1993 septembre 1995 novembre 1995 juin 2000
Maroc décembre 1993 novembre 1995 février 1996 mars 2000
Palestine mai 1996 décembre 1996 février 1997 juillet 1997*
Jordanie juillet 1995 avril 1997 novembre 1997 mai 2002
Égypte mars 1995 juin 1999 juin 2001 juin 2004
Algérie juin 1997 décembre 2001 avril 2002 septembre 2005
Liban novembre 1995 janvier 2002 juin 2002 avril 2006
Syrie mars 1998 octobre 2004 / décembre
2008
Source : Institut Euro-méditerranéen
Plans d’Action
TABLEAU les plans d’action de la Politique européenne de voisinage
Pays Israël Jordanie Tunisie
Autorité
palestinienne
Maroc Egypte Liban Algérie Libye
Adoption par
le pays avril 2005 juin 2005
juillet
2005 mai 2005
juillet
2005
mars
2007
janvier
2007 - -
Source : Institut Euro-méditerranéen








































































































![[2015] Frédéric Gimello-Mesplomb & Pascal Legrand : "De l'organe de presse professionnelle au relai de l’action publique : le rôle de la revue 'Le Film Français' dans les débats](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315479c5cba183dbf07eab7/2015-frederic-gimello-mesplomb-pascal-legrand-de-lorgane-de-presse-professionnelle.jpg)