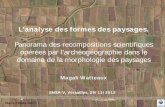Les régions de Bam et de Sabzevar (Iran) : une évolution dans l’implantation des sites...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Les régions de Bam et de Sabzevar (Iran) : une évolution dans l’implantation des sites...
IFEAC
L’ArChéoLogIE FrAnçAIsE En AsIE CEntrALE
Nouvelles recherches et enjeux socioculturels
L’A
rCh
éoLo
gIE
FrA
nçA
IsE
En A
sIE
CEn
trA
LE
Nou
velle
s rec
herc
hes e
t enj
eux
soci
ocul
ture
ls
Cah
iers
d’a
sie
Cen
tral
e
Cah
iers
d’
asie
CeN
tral
e21
/22
21/22
sous la direction de Julio BeNdezu-sarmieNto
issN : 1270-9247isBN : 978-2-7018-0347-0
l’archéologie est une discipline scientifique, complexe mais de plus en plus précise, dont l’objectif essentiel est de mieux connaître l’Homme et la société, depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque moderne, grâce à l’étude des éléments matériels mis au jour (édifices, infra-
structures, poteries, outils, armes, ossements...). L’archéologue, dans une approche diachronique, trouve l’essentiel de sa documentation grâce à des travaux de terrain (prospections, sondages, fouilles, voire études de collections). Les résultats permettent de mettre en lumière une culture ou une civilisation, une ou des population(s), les étapes d’un passé méconnu.
L’Histoire de l’Asie centrale est complexe et jalonnée d’épisodes mouvementés. La grande diversité géographique et orographique en a fait un lieu privilégié où se sont développés de grandes civili-sations et de puissants empires, dont il nous reste encore beaucoup à découvrir : la civilisation de l’Oxus, les empires des Achéménides, d’Alexandre le Grand, des Kouchans, des Sassanides, des Turcs, des Arabes, des Mongols...
Il y a douze ans, le numéro IX des Cahiers d’Asie centrale publiait les résultats des découvertes archéologiques françaises réalisées dans cette région. Cette abondante moisson prenait en compte un immense travail initié par Jean-Claude Gardin en 1979. Aujourd’hui, ce nouveau numéro double des Cahiers amplifie notre connaissance de l’Asie centrale grâce aux trente deux articles pluri-disciplinaires associant les sciences humaines et sociales aux sciences de la terre ; et il nous fait découvrir les résultats des recherches archéologiques menées depuis plus de trois décennies, mettant en exergue le travail scientifique et la méthodologie, l’excellente coopération entre les chercheurs centrasiatiques et français, le souci de formation et de valorisation. Et nous espérons qu’au fil des pages l’archéologue, l’historien ou les lecteurs avertis trouvent dans cet ouvrage les éléments d’une histoire pluridisciplinaire, constamment enrichie.
Julio Bendezu-sarmiento est docteur en archéologie et bioanthropologie, chargé de recherche au CNRS. Il travaille en Asie centrale où il codirige plusieurs missions archéologiques entre l’Ouzbékistan et le Turkménistan. Il a été secrétaire scientifique et directeur par intérim de l’Institut français d’études sur l’Asie centrale (IFEAC) de 2007 à 2009 ; il est actuellement directeur adjoint de la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA).
Édition-diffusion de BoCCardde BoCCard
ISSN : 1270-9247ISBN : 978-2-7018-0347-0© IFEAC / DAFA
cahiers d’Asie centrale
Les Cahiers d’Asie centrale sont une publication de l’Institut français d’études sur l’Asie centrale (IFEAC), Institut de recherche installé à Bichkek (Kirghizstan), rattaché au ministère des Affaires étrangères de la République française, associé au Centre national de la recherche scientifique (CNRS - USR 3140).
Les Cahiers d’Asie centrale présentent les résultats de recherches en sciences humaines et sociales dans l’aire centrasiatique. Appréhendant un vaste espace méconnu, placé au carrefour des mondes russe, turc, chinois, iranien et indien, cette revue pluridisciplinaire aide à la compréhension de ses réalités et de ses mutations. Elle propose une multiplicité de points de vue, en conjuguant des articles écrits par des chercheurs locaux et occidentaux.
Les opinions émises dans les articles ou notes de la revue n’engagent que la responsabilité de leur(s) auteur(s). Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans consentement de l’auteur, ou de ses ayants droit, ou ayants cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, que les copies sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective d’une part et, d’autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration.
Directeur de la publicationFrancis RICHARD
rédacteur en chefJulio BENdEzU-SARmiENTo
comité de rédaction :François Ömer AKAKÇA, Université Humboldt, BerlinBayram BALCI, CNRSingeborg BALdAUF, Université Humboldt, BerlinJulio BENdEzU-SARmiENTo, CNRSStéphane A. dUdoiGNoN, CNRSCarole FERRET, CNRS isabelle oHAYoN, CNRSmaria SzUPPE, CNRS
Comité scientifique Sergey ABASHIN, Institut d’ethnologie et d’anthropologie,
moscoumeruert ABUSEiToVA, institut d’orientalisme, AlmatyHamid ALGAR, Université de Californie, Berkeleydilorom ALimoVA, institut d’histoire, TachkentElisabeth ALLES, CNRSBakhtiyar BABAJANoV, institut d’orientalisme, TachkentAlain BLUm, CNRSmarco BUTTiNo, Université de Turin Pierre CHUViN, Université Paris X – NanterreNathalie CLAYER, CNRSRémy doR, iNALCo, ParisVincent FoURNiAU, EHESS, ParisHenri-Paul FRANCFoRT, CNRSValery GERmANoV, institut d’histoire, TachkentFrantz GRENET, Collège de FranceRoberte HAmAYoN, EPHE, ParisPhilip HUYSE, CNRSSvetlana JACQUESSoN, institut max Planck, HalleAdeeb KHALid, Carleton College, minnesotaAnke von KÜGELGEN, Université de Berne
marlène LARUELLE, The Elliott School of international Affairs, George Washington UniversityScott C. LEVi, Université de Louisville, KentuckyAshirbek mUmiNoV, institut d’orientalisme, AlmatyAlexandre PAPAS, CNRSSébastien PEYRoUSE, The Elliott School of international
Affairs, George Washington UniversityCatherine PoUJoL, iNALCo, ParisJean RAdVANYi, iNALCo, ParisFrancis RiCHARd, BNF, ParisRon SELA, indiana University, BloomingtonJulien THoREz, CNRSThierry zARCoNE, CNRS
ifeAcPanfilova 153, 720040 Bichkek, KiRGHizSTAN Tél. : (996 312) 39 80 07 [email protected]
DAfAAmbassade de France Shash Darak, KaboulTél. : (93 719) 30 70 [email protected]
édition-Diffusion De BoccArD11 rue de médicis75006 PARiSTél. : 01 43 26 00 37http://www.deboccard.com
sommAire
Frantz GRENETAvant-Propos 15
Julio BENdEzU-SARmiENTo, Francis RICHARDintroduction : quel avenir pour l’archéologie en Asie centrale ? 19
L’évoLution Des recherches ArchéoLogiques en Asie centrALe.Des hommes, Des institutions et Des missions ArchéoLogiques
Svetlana GoRSHENiNAL’archéologie française dans l’Asie centrale soviétique et post-soviétique ........... 25
Jean-François JARRiGELes relations archéologiques entre les régions au sud et au nord de l’Hindu Kush du Ve millénaire jusqu’au milieu du IIIe millénaire avant notre ère à la lumière des données fournies par les sites de la région de Kachi-Bolan au Balochistan pakistanais 41
Roland BESENVALLes années noires du patrimoine archéologique d’Afghanistan (1980-2001). Chronologie d’un désastre 69
Philippe mARQUiSLes activités récentes de la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA) 93
Henri-Paul FRANCFoRTLe rôle de la mission archéologique française en Asie centrale (mAFAC) dans l’évolution de la recherche archéologique 99
Claude RAPiN, muhammadjon iSAmiddiNoVEntre sédentaires et nomades : les recherches de la mission archéologique franco-ouzbèke (mAFouz) de Sogdiane sur le site de Koktepe 113
Pierre LERICHEL’apport de la mission archéologique franco-ouzbèque (mAFouz) de Bactriane du Nord à l’histoire de l’Asie centrale 135
olivier LEComTEActivités archéologiques françaises au Turkménistan 165
Frédérique BRUNET, muhiddin HUdžANAzARoV, Karol SzYmCzAKLe site d’Ajakagytma et le complexe culturel de Kel’teminar au sein des processus de néolithisation en Asie centrale (travaux de la mAFANAC) ..... 191
Julio BENdEzU-SARmiENTo, Samariddin mUSTAFAKULoVLe site proto-urbain de dzharkutan durant les âges du bronze et du fer. Recherches de la mission archéologique franco-ouzbèke-Protohistoire 207
Rocco RANTE, Abdisabur RAimKULoVLes fouilles de Paykend : nouveaux éléments 237
interActions Autour De L’oBjet : L’Asie centrALe et ses voisins
Bertille LYoNNETRecherches récentes sur les céramiques de Sogdiane (de la fin de l’âge du bronze à la conquête arabe) : contribution à l’histoire de l’Asie centrale 261
Élise LUNEAU, Julio BENdEzU-SARmiENToÉtude des céramiques de l’âge du bronze de la nécropole 3 de Dzharkutan (ouzbékistan) : nouvelle approche typo-chronologique 283
Armance dUPoNT-dELALEUFÉvolution des techniques céramiques durant la Protohistoire en Asie centrale : l’exemple d’Ulug dépé 317
olivier BRUNET Étude morpho-technologique préliminaire des éléments de parure de l’âge du bronze de Sapalli tépé et dzharkutan (ouzbékistan) 335
Johanna LHUiLLiER, Julio BENdEzU-SARmiENToolivier LEComTE, Claude RAPiNLes cultures à céramique modelée peinte de l’âge du fer ancien : quelques pistes de réflexion d’après les exemples de Koktepe, dzharkutan (ouzbékistan) et Ulug dépé (Turkménistan) 357
Charlotte BARATiN, Laurianne mARTiNEz-SèVELe grenier grec de Samarkand 373
Johanna LHUiLLiER, mutalib HASANoVNouvelles recherches à Padayatak tépé au Kashka-daria (ouzbékistan) 389
Julie VALLÉE-RAEWSKYRésultats préliminaires de la fouille des kourganes de Yangi-rabat et Akdzhar-tépé dans la région de Samarkand (ouzbékistan) 399
marc-olivier PERoULe décor architectural de la ville de Termez à l’époque kouchane 411
JEAN-BAPTiSTE HoUAL avec la collaboration de Sterenn LE mAGUERLa céramique de Termez des époques antique et médiévale 423
Pierre SimÉoNLa céramique de Hulbuk (capitale du Ḥuttal) entre mā warā’al-nahr et Ṭuhāristān. Nouvelles données sur la céramique médiévale d’Asie centrale entre le iXe et le Xie siècle 443
Aurore DIDIER, Benjamin mUTiNLa production céramique protohistorique du makran pakistanais dans la compréhension des relations indo-iraniennes 461
Laurianne BRUNEAUL’art rupestre du Ladakh (Jammu et Cachemire, Inde) : ses liens avec l’Asie centrale protohistorique 487
Autour Du vivAnt, son espAce et son environnement.LA restAurAtion et LA conservAtion ArchéoLogique
Julio BENdEzU-SARmiENToArchéologie funéraire et bio-anthropologie à Ulug dépé et dzharkutan.Âge du bronze au Turkménistan et en ouzbékistan 501
marjan mASHKoURSociétés pastorales et économies de subsistance au nord-est de l’iran et au sud du Turkménistan 533
margareta TENGBERGÉconomies végétales et environnements en Asie centrale du Néolithique à l’époque sassanide : la contribution des disciplines archéobotaniques 545
Éric FoUACHE, Henri-Paul FRANCFoRT, Claude CoSANdEY, Chahryar ADLE, Julio BENdEzU-SARmiENTo, Ali A. VAHdATiLes régions de Bam et de Sabzevar (Iran) : une évolution dans l’implantation des sites archéologiques et dans la gestion des ressources en eau compatible avec l’hypothèse d’une aridification croissante du climat entre 2500-1900 BC .... 559
Gourguen dAVTiANL’apport de la géomatique aux nouvelles recherches archéologiquesen Asie centrale 573
Estelle oTTENWELTEREnjeux de la conservation-restauration de terrain en Asie centrale. Exemples de travail sur les sites d’Ulug dépé et de Gonur dépé (Turkménistan) 587
Géraldine FRAY, marina REUToVAdu terrain à la muséographie. La restauration de peintures murales en ouzbékistan : Kazakl’i-yatkan/Akchakhan-Kala (Khorezm antique) et Afrasiab (Samarkand Qarakhanide) 603
Chamsia SAdozAïPréservation de l’architecture de terre en Asie centrale :l’exemple du site protohistorique d’Ulug dépé (Turkménistan) 623
559
Les régions de Bam et de Sabzevar (Iran) : une évolution dans l’implantation des sites archéologiques et dans la gestion des ressources en eau compatible avec l’hypothèse d’une aridification croissante du climat entre 2500-1900 BC
Éric Fouache1, henri-Paul FrancFort2, claude cosandey3
chahryar adle4, Julio Bendezu-sarmiento5, ali a. Vahdati6
RésuméL’aridification climatique de la fin du IIIe millénaire est un fait attesté par les reconstitutions paléoclimatiques pour le Proche et le Moyen-Orient comme pour l’Asie centrale. Ce qui pose question ce sont les conséquences de cette aridification climatique pour les sociétés humaines et la manière dont elles s’y sont adaptées. L’étude géomorphologique des sites de Sabzevar au nord-est du plateau iranien et de Bam situé au sud-est du plateau iranien montre qu’entre le Chalcholitique et l’âge du fer les ressources en eau diminuent mais que grâce à des contextes tectoniques favorables au piégeage de la nappe phréatique les sociétés humaines s’adaptent en changeant de localisation et en adoptant de nouvelles techniques d’irrigation, en l’occurrence, la technique des qanâts.
Mots-clésIran, géomorphologie, aridification du climat, âge du bronze, âge du fer, qanâts.
1. Éric Fouache est professeur de géomorphologie et de géoarchéologie, vice-chancelier de l’université Paris-sorbonne abu dhabi, membre senior de l’institut universitaire de France, vice-président de l’association internationale des géomorphologues, et rattaché pour sa recherche au laboratoire enec, umr 8185. il est responsable du programme medee (Mer, Désert, Environnement : Asie centrale et Péninsule arabique), financé par le ministère des Affaires étrangères.
Contact : [email protected]. Henri-Paul Francfort est archéologue, directeur de recherche au cnrs et actuellement
président de son comité d’archéologie. il a dirigé des recherches sur plusieurs sites de l’asie centrale dont shortugaï (1976-1979) avec la délégation archéologique française en afghanistan et le kourgane gelé de Berel’ au Kazakhstan (1997-1998). actuellement, il dirige la maFac et les travaux franco-tadjiks sur le site de sarazm.
Contact : [email protected]. Claude Cosandey, géographe et directrice de recherche émérite au cnrs, a travaillé
essentiellement en hydrologie sur les conséquences des activités humaines sur le cycle de l’eau, et particulièrement sur les inondations. Auteur avec Mark Robinson d’un ouvrage «hydrologie continentale» publié dans la collection u armand colin en 2000, dont une réédition est aujourd’hui sous presse.
Contact : [email protected]. Chahryar Adle est archéologue, directeur de recherche au cnrs, membre du Provincial
office of the iranian cultural heritage, handicrafts and tourism organisation, north Khorassan, Bojnord, iran.
L’archéologie française en Asie centrale. Nouvelles recherches et enjeux socioculturels.J. Bendezu-sarmiento (dir.), cac-iFeac # 21-22, 2013 – p. 559-572.
560
É. Fouache / h.-P. FrancFort / cl. cosandey / ch. adle / J. Bendezu-sarmiento / a. a. Vahdati
AbstractThe arid climate of the late 3rd millennium is a fact well documented by palaeoclimatic work in the Near and Middle East as well as in Central Asia. Yet the consequences of this drier climate for human societies and the manner in which they adapted to aridity are issues that require debate. Geomorphological study of the sites of Sabzevar to the north-east of the Iranian plateau and Bam to the south-east of the Iranian plateau shows that, although water resources became scarcer between the Chalcolithic and the Iron Age, human societies were able to adapt, thanks to tectonic contexts that trapped the water-table. Thus societies adapted by changing site locations and adopting a new irrigation technique, the qanat system.
KeywordsIran, geomorphology, climate aridification, Bronze Age, Iron Age, qanats.
les recherches paléoclimatiques menées au Proche et au moyen-orient convergent (roberts, Wright 1993 ; Kuzucuoglou, marro 2007) pour souligner qu’à partir de 2500 Bc on assiste à une aridification progressive du climat. Cette aridification serait parti- culièrement bien marquée sur deux périodes, entre 2250-2150 BC et 2100-1900 BC, séparées par un demi siècle comparativement plus humide (Bar Matthews et al. 1998 ; stevens et al. 2001). ce n’est qu’à partir de 1900 Bc que l’on retrouverait une ambiance climatique un peu plus humide qu’aujourd’hui, laquelle aurait duré jusqu’à la fin du ier millénaire ad. ces données proviennent de recherches situées au Proche-orient, en anatolie et à l’ouest de l’iran et il faut être prudent avant de les extrapoler au plateau iranien, à l’est de l’iran et plus encore à l’asie centrale. néanmoins les recherches archéologiques et environnementales menées (figure 1) dans la région de sabzevar au nord de l’iran (Vahdati, Francfort 2008, 2011 ; Fouache et al. 2010, 2011) et dans la région de Bam, au sud-est de l’iran (adle 2006) permettent de reconstituer une évolution des sites d’occupation humaine et de gestion des ressources en eau compatible avec l’idée d’une aridification croissante entre 2500 BC et 1900 BC.
Contextes topographiques et géologiques des régions de sabzevar et de bam
La région de Sabzevar
La ville moderne de Sabzevar (figure 2) se situe au nord du plateau iranien, à une altitude de 1000 m en rive droite de la rivière “Kal Shur” qui draine à 920 m d’altitude les eaux saumâtres de la nappe phréatique vers la dépression endoréïque du Grand
5. Julio Bendezu-Sarmiento est archéologue chargé de recherche au cnrs il travaille en asie centrale depuis plus de quinze ans. actuellement il est responsable de la fouille du site de dzharkutan (ouzbékistan) et co-responsable de la fouille d’ulug dépé (turkménistan).
Contact : [email protected]. Ali A. Vahdati est archéologue dans la « Provincial Office of the Iranian Cultural Heritage,
handicrafts and tourism organisation, north Khorassan, Bojnord » (iran). il réalise actuellement un doctorat d’archéologie protohistorique à l’université Paris 1 (sous la direction de h.-P. Francfort).
561
imPlantation et ÉVolution des sites archÉoloGiques dans les rÉGions de Bam et saBzeVar
Figure 1 – Carte de localisation des régions étudiées.
Kerman
Yazd
Herat
Zahedan
Bandar Abbas
GRAND DÉSERT SALÉ
DÉSERT DE LOUT
K H O R A S A N
M A K R A N
AFGHANISTAN
PAKISTAN
IRAN
MONTS KUHRUD
G o l f e Pe r s i q u e
G o l f e d ’ O m a n
Halil Roud
Bam
Jiroft
Sabzevar
Altitude > 1 000 m
Ville principale
Zone saisonnièrement
marécageuse
100 km
océan Indien
TURKMENISTAN
AFGHANISTAN
PAKISTAN
QATAR
KOWEÏT
IRAK
E.A.U.
IRAN
200 km
60°E
32°N
60°E
28°N
24°N
56°E
28°N
32°N
562
É. Fouache / h.-P. FrancFort / cl. cosandey / ch. adle / J. Bendezu-sarmiento / a. a. Vahdati
désert salé, le “Dasht-i-Kavir”. La plaine de Sabzevar qui reçoit une moyenne de 180 mm de précipitations par an, se trouve immédiatement au pied d’un talus de 20 m de haut qui délimite la bordure sud d’un plateau argileux très découpé de ravines et de ravins et large de 5 km. au nord de ce plateau s’étend un glacis d’accumu-lation formé d’alluvions quaternaires amenées par les torrents de la montagne du Kuh-e siah qui culmine à 2 040 m.
Le plateau situé au nord de Sabzevar correspond à un Horst miocène porté en altitude par le jeu de deux failles bordières à la charnière du Pliocène et du Quaternaire, tandis que le glacis d’accumulation nord est installé dans un fossé d’effondrement où l’épaisseur des alluvions quaternaires atteint 250 m. cette épaisseur démontre une activité tectonique continue jusqu’à nos jours (Fattahi, Walker 2007).
Figure 2 – Carte géomorphologique simplifiée de la région de Sabzevar.
563
imPlantation et ÉVolution des sites archÉoloGiques dans les rÉGions de Bam et saBzeVar
le horst plio-quaternaire joue un rôle considérable dans les ressources en eau de la région. en effet les terres cultivables se situent entre le plateau central et les marécages salés, “Kavir”, qui bordent le “Kal Shur”. Ces terres ne peuvent être culti-vées que par l’irrigation et la nappe phréatique du “Kal Shur” étant saumâtre seule l’eau douce de la nappe phréatique du fossé d’effondrement nord est disponible pour cette irrigation du néolithique à nos jours. seuls deux ravins présentant un chenal aujourd’hui à sec toute l’année, sauf crue brutale exceptionnelle, témoignent d’écoule-ment par débordement entre le fossé nord et la plaine de sabzevar. il s’agit à l’ouest du ravin Gelyan et à l’est de celui du Kal-e aidgah.
La région de Bam
la ville de Bam (adle 2006) se trouve au sud-est de l’iran, à la limite sud du désert du lut. installée entre 1 000 et 1 100 m d’altitude, en position de piémont, elle est bordée au nord par les monts Kapudi (2 409 m) et au sud par la montagne du Jebâl Bârez (près de 4 000 m). Elle se trouve (figure 3) à la confluence de deux torrents saisonniers la rivière Posht-e Rud, appelée aussi rivière Tah-Rud, au nord, et la rivière chelekhoneh, au sud. les précipitations moyennes annuelles dans la plaine de Bam sont de l’ordre de 55 mm, mais elles atteignent plus de 300 mm sur les versants sud
Figure 3 – La région de Bam et les palmeraies.
564
É. Fouache / h.-P. FrancFort / cl. cosandey / ch. adle / J. Bendezu-sarmiento / a. a. Vahdati
du Jebâl Bârez. Ce sont les pluies sur les montagnes qui rechargent les aquifères de piémont et expliquent que malgré l’aridité de la plaine une agriculture de palmeraie soit largement présente aujourd’hui. ces palmeraies sont inégalement réparties. D’ouest en est, elles sont concentrées le long de la rivière Posht-e Rud, du village de Bâgh-chemak à Bam, puis à l’est de l’escarpement topographique, lié à la faille de Bam, à Baravât, et enfin dans le bassin de Narmâshir. L’organisation générale du relief est acquise depuis la fin du Pliocène. La morphogenèse Quaternaire résulte de la combinaison du ruissellement et de la tectonique toujours active, comme en témoigne le séisme de Bam du 26 décembre 2003 (Fattahi, Walker 2007).
Les torrents intermittents ont édifié au sortir de la montagne des cônes de déjec-tion coalescents qui ont abouti sur 10 à 15 km de large à la formation de vastes glacis d’accumulation sur un maximum de 500 m d’épaisseur (figure 4).
La faille de Bam, accompagnée de linéaments qui lui sont parallèles comme la faille de Baghchamak, à l’ouest et la faille de narmâshir à l’est, constitue l’accident tectonique majeur de la région, toujours actif. selon les géologues l’escarpement de Bam serait apparu autour de 10 000 BP (talebian et al. 2004). cet escarpement est à
Figure 4 – Carte géomorphologique simplifiée de la région de Bam.
565
imPlantation et ÉVolution des sites archÉoloGiques dans les rÉGions de Bam et saBzeVar
l’origine d’une modification des écoulements à la surface du cône de déjection commun aux torrents de Posht-e Rud et de Chelekhoneh. Durant la dernière période froide (figure 5) le cône de déjection était plus large et un bras important du Posht-e Rud se dirigeait vers la dépression de narmâshir. l’apparition de l’escarpement de faille a concentré tous les écoulements holocènes sur le bras septentrional de la rivière
Figure 5 – Modification du tracé du Posht Rud induit par la faille de Bam.
566
É. Fouache / h.-P. FrancFort / cl. cosandey / ch. adle / J. Bendezu-sarmiento / a. a. Vahdati
Posht-e Rud, contrainte dès lors de franchir un seuil où la roche en place affleurait à travers la terminaison des formations rocheuses des monts Kapudi. seul un des bras du torrent chelekhoneh a réussi à maintenir par antécédence le passage à travers l’escarpement vers la dépression de narmâshir. la création de l’escarpement lié à la faille de Bam a aussi eu pour conséquence de créer un barrage naturel favorable à l’existence d’une nappe phréatique plus proche de la surface (figure 6) à l’ouest de la faille (Fouache et al. 2009).
Figure 6 – Effet barrage de la faille de Bam sur la nappe phréatique.
évolution de l’implantation des sites arChéologiques
dans les régions de sabzevar et de bam
Dans la région de Sabzevar
dans la région de sabzevar le site le mieux connu (figure 2) est le tell de tépé Damghani, monticule d’un diamètre de 300 m s’élevant de 2,5 à 3 m au-dessus de la plaine au nord et 5 à 6 m au sud, étudié en 2008 lors d’une campagne de fouille franco- iranienne dirigée par henri-Paul Francfort et ali a. Vahdati. ce tell a été habité du début du troisième millénaire (2800 BC) jusqu’à la période pré-achéménide de l’âge du fer récent au Viie siècle BC. Il est situé à la terminaison du cône d’épandage situé au débouché du ravin du Kal-e aidgah. la stratigraphie du site de tépé damghani témoigne de la présence régulière de lentilles alluviales tandis que la mise en culture des terres proches, attestée par la présence de meules sur le site lui-même, ne pouvait dépendre que d’une irrigation à partir des eaux du Kal-e aidgah, ce qui aujourd’hui ne serait plus possible. d’autres sites archéologiques, dont la période d’occupation est déduite à partir des restes de céramique trouvés en surface, indiquent de l’âge du bronze au fer un choix d’implantation des villages situés toujours au débouché du
567
imPlantation et ÉVolution des sites archÉoloGiques dans les rÉGions de Bam et saBzeVar
ravin du Kal-e aidgah mais plus à l’amont, comme ici les épandages descendaient moins loin. c’est le cas des sites de mirabad 1 et de mirabad 2 identifiés en prospection. le tell de tépé Ferezi occupe la même position relative que le site de mirabad 1, au débouché du ravin de Geylan, symétrique de celui de Kal-e aidgah à l’ouest.
Il faut attendre l’adoption du système des galeries drainantes appelées qanâts (Briant 2001) pour que les implantations humaines puissent s’étendre à tout le piémont. Les galeries drainent l’eau de la nappe du fossé à partir de puits mères qui descendent à plus de 100 m de profondeur et assurent une irrigation pérenne. il est intéressant de noter que sur le site de mirabad-2 on observe un puits de qanât incontestable-ment postérieur au Fer ancien de par les couches de céramiques qu’il traverse. cette observation tendrait à montrer que dans notre région le développement du système des qanâts ne débuterait pas avant la période achéménide.
Dans la région de Bam
la carte archéologique, qui résulte des prospections menées par ch. adle (2006), indique que les secteurs les plus anciennement habités et cultivés le sont du chalco-lithique à l’âge du bronze (iVe-iiie millénaire av. Jc). il s’agit notamment du site de Bidârzin, en amont du village de Baghchamak (figure 3). les vestiges d’habitat actuellement identifiés sont très nombreux mais surtout remarquables par la surface occupée (au moins 150 ha et une vingtaine de sites) ; ils forment de petits monticules repérables au grand nombre de poteries et à la présence de gros cailloux qui ne sont pas autochtones. ce site correspond à la surface d’un lambeau de terrasse alluviale isolé des apports de glacis par des talwegs orientés est-ouest attribuables à des chenaux intermittents parallèles au cours de la rivière Posht-e Rud, enfoncée à ce niveau d’environ un mètre, mais séparée du lit par une levée de terre d’une hauteur approximative de 1,5 m, qui paraît anthropique. le fait que la surface soit recouverte d’un voile de petits graviers et de galets s’explique pour nous par le démantèlement des habitats et les apports d’épandages holocènes lors d’écoulements sporadiques. De notre point de vue, l’intérêt du site est d’être situé quelques mètres au-dessus des écoulements issus de crues brutales toujours susceptibles de descendre des glacis proches, tout en offrant des terres naturellement situées à la terminaison d’épan-dages d’inondation. la datation c14, effectuée selon la méthode ams, sur un charbon de bois prélevé 15 cm sous les tessons archéologiques de surface donne une date qui confirme l’occupation au Chalcolithique du site7.
Les hommes s’installent ensuite dès le IIe millénaire av. Jc sur le revers de l’escarpe-ment de faille de Bam (figure 4). Ce site est lui aussi à l’abri des écoulements torren-tiels ; en outre il a probablement joui de ressources en eau plus abondantes, résultant
7. Lyon 5926, âge radiocarbone non corrigé 4690 +/-BP, et après correction (3627–3371 av. JC).
568
É. Fouache / h.-P. FrancFort / cl. cosandey / ch. adle / J. Bendezu-sarmiento / a. a. Vahdati
de l’affleurement de la nappe, lié à la faille de Bam datée d’environ 10 000 ans (ansari et al. 2006). le revers de l’escarpement de faille est ainsi parcouru par un grand nombre de qanâts, dont les puits d’accès marquent le paysage. Certains sont encore fonctionnels, remis en état ou en cours de remise en état après le tremblement de terre de décembre 2003. ces qanâts, qui tous aboutissent en aval de l’escarpement de ligne de faille et alimentent pour la plupart la palmeraie de Baravat, ont des lon-gueurs et des profondeurs très variables. On trouve trace au pied de l’escarpement d’au moins deux réservoirs alimentés par des qanâts.
l’un d’eux a été daté avec certitude du milieu du Ve siècle av. JC, ce qui prouve qu’à cette époque, le niveau de la nappe était assez haut pour pouvoir émerger à cette altitude, 1 030 m selon la carte topographique. si on en croit les ouvriers qui recreusaient un qanât plus au sud, la profondeur actuelle serait de l’ordre de 960 m. cet accroissement de la profondeur de la nappe oblige depuis longtemps à des qanâts plus longs au droit de l’escarpement, pour prendre l’eau plus loin en amont.
ConClusion
les régions de sabzevar et de Bam présentent l’extrême intérêt d’avoir été occupées en continu du chalcolithique aux périodes actuelles. on constate dans ces deux régions la même évolution de sites chalcolithique ou du Bronze ancien installés en bordure d’un cours d’eau ou à la terminaison d’un chenal naturel, ce qui implique une irrigation par gravité à partir d’écoulements de surface pérennes ou intermit-tents. la remontée le long des talwegs dans le cas de la région de sabzevar et la descente sur le revers de la faille de Bam suggèrent que dans un premier temps la ressource devient moins abondante (figure 7), puisqu’il n’y a plus, à un certain moment, d’écoulements de surface permettant la mise en culture. C’est alors très clairement qu’apparaît le système des galeries drainantes qui permet à nouveau une phase d’expansion de la mise en valeur agricole. La chronologie archéologique confirme que cette évolution se produit entre 2 500 et 1 900 av. Jc, période considérée comme connaissant une aridité de plus en plus marquée par les paléoclimatologues.
lorsque l’on discute de la question de l’effondrement des civilisations de l’âge du bronze au Proche et au moyen-orient, on doit donc faire attention de distinguer entre les grands ensembles urbains, qui sont effectivement très vite abandonnés à la fin du IIIe millénaire et les petits sites ruraux comme ceux des régions de sabzevar et de Bam. Il faut également prendre en compte la durée de l’aridification, qui n’est pas du tout un phénomène brutal, mais une lente évolution sur 600 ans. Attribuer au seul facteur climatique la cause de ces effondrements des civilisations du Bronze apparaît donc comme une simplification abusive. Dans le contexte de l’Asie centrale protohistorique, des recherches archéo-environnementales récentes (cattani 2005 ; Francfort 2005, 2009 ; Francfort, tramblay 2010 ; luneau 2010) tendraient à montrer qu’une aridification prendrait place après la phase mûre de la civilisation de l’Oxus,
569
imPlantation et ÉVolution des sites archÉoloGiques dans les rÉGions de Bam et saBzeVar
Figure 8 – Coupe à travers le Horst de Sabzevar.
Figure 7 – Coupe à travers la faille de Bam et évolution de la nappe phréatique.
570
É. Fouache / h.-P. FrancFort / cl. cosandey / ch. adle / J. Bendezu-sarmiento / a. a. Vahdati
après 1800 (Cremaschi 1998). Celle-ci se produirait donc au moment où le modèle proche-oriental restitue une nouvelle phase humide. traditionnellement, la phase aride du second millénaire, plus intense au cours de la deuxième moitié, permet de rendre compte de l’avancée des sables du désert du Kara-Kum et de celle de populations des steppes vers le sud (cattani 2005). il est clair que des recherches archéologiques et archéo-environnementales ciblées sont nécessaires pour faire la part des facteurs environnementaux autres (tectonique) et des facteurs humains (irrigation, change-ments socio-ethnoculturels) dans les évolutions observables. ce n’est qu’à ce prix que nous obtiendrons une théorie générale, ou éventuellement régionale, valide. des recherches en cours ou à venir vont dans ce sens en Bactriane (afghanistan), ainsi que sur les sites de dzharkutan, d’ayakagitma (ouzbékistan), d’ulug dépé (turkménistan) et de sarazm (tadjikistan).
L’aridification a nécessairement joué un rôle mais les déséquilibres économiques, sociaux et géopolitiques ont également compté. il est clair également que l’existence d’un contexte hydrogéologique favorable au maintien d’une ressource en eau proche de la surface a joué un rôle décisif dans le cas des régions de sabzevar et de Bam. l’inventaire systématique des contextes hydrogéologiques favorables à ces piégeages, associés à des prospections archéologiques régionales, apparaît comme une piste de recherche originale à développer davantage, non seulement sur le plateau iranien, mais aussi en asie centrale.
référenCes bibliographiques
adle (ch.)2006 « qanats of Bam: an archaeological perspective. irrigation system in Bam,
its birth and evolution from the prehistoric Period up to modern times », in UNESCO Tehran Cluster Office. Qanats of Bam. A multidisciplinary approach, p. 33-86.
Balland (d.) [éd.]1992 Les eaux cachées : études géographiques sur les galeries drainantes souterraines,
Publications du département de Géographie de l’université de Paris-sorbonne, Paris 19.
Briant (P.) [éd.]2001 Irrigation et drainage dans l’Antiquité. Qanâts et canalisations souterraines en Iran,
en Egypte et en Grèce, Séminaire tenu au Collège de France sous la direction de Pierre Briant, Paris, thotm éditions.
cattani (m.)2005 « margiana at the end of Bronze age and beginning of iron age », in m. F. Kosa-
REv, P. M. KOžIN, N. A. DuBOvA (dir.), U istokov civilizacii, sbornik statej k 75-letiû viktora Ivanoviča Sarianidi, Moscou, p. 303-315.
571
imPlantation et ÉVolution des sites archÉoloGiques dans les rÉGions de Bam et saBzeVar
cosandey (cl.), roBinson (m.)2000 Hydrologie Continentale, Paris, armand colin.
cremaschi (m.)1998 « Palaeohydrography and Middle Holocene Desertification in the Northern
Fringe of the murghab delta », in a. GuBaeV, G. a. KoshelenKo, m. tosi (dir.), The Archaeological Map of the Murghab Delta. Preliminary Reports 1990-95, (reports and memoirs, vol. series minor Volume iii), rome, istituto italiano per l’africa e l’oriente, centro scavi e ricerche archeologiche, p. 15-25.
Fattahi (m.), WalKer (r. t.)2007 « Walker luminescence dating of the last earthquake of the thrust fault, ne
iran », Quaternary Geochronology, 2, 1-4, p. 284-289.
Fouache (e.), Buchsenschutz (o.), adle (ch.), lÉzine (a. m.)2009 « le passé des villes pour comprendre leur futur », Géosciences, Villes et géologie
urbaine, 10, p. 54-61.
Fouache (É.), FrancFort (h.-P.), Bendezu-sarmiento (J.), Vahdati (a. a.), lhuillier (J.)2011 « the horst of sabzevar and regional water resources from the Bronze age to
the present day (northeastern iran) », Geodinamica Acta, 23, 5-6, p. 287-294.
FrancFort (h.-P.)2005 « la civilisation de l’oxus et les indo-iraniens et indo-aryens », in G. Fussman,
J. Kellens, h.-P. FrancFort, X. tremBlay (dir.), Aryas, Aryens et Iraniens en Asie centrale, Collège de France, Publications de l’Institut de civilisation indienne, 72, Paris, de Boccard, p. 253-328.
2009 « l’âge du bronze en asie centrale. la civilisation de l’oxus », Anthropology of the Middle East, 4-1, p. 91-111.
FrancFort (h.-P.), lecomte (o.)2002 « irrigation et société en asie centrale des origines à l’époque achéménide »,
Annales Histoire et Sciences Sociales, 3, p. 625-663.
FrancFort (h.-P.), tremBlay (X.)2010 « marhaši et la civilisation de l’oxus », Iranica Antiqua, XlV, p. 51-224.
hassaniPaK (a.), Kariminia (m.), moBasher (K.), Ghazi (m.)2003 « new 40 ar/39 ar ages, Biostratigraphic and Geochemical data from the
ophiolite, north central iran ; implications for tectonic of iranian Plate », Eos Transactions of the American Geophysical Union, 84, 46, Fall meeting, supple-ment, abstract t51F-0224.
572
É. Fouache / h.-P. FrancFort / cl. cosandey / ch. adle / J. Bendezu-sarmiento / a. a. Vahdati
KuzuçuoGlou (c.), marro (c.) [éd]2007 Sociétés humaines et changements climatiques à la fin du troisième millénaire : une
crise a-t-elle lieu en Haute Mésopotamie, actes du colloque de lyon, 5-8 décembre 2005, Varia Anatolica 19, institut français d’études anatoliennes Georges dumézil, istanbul-Paris, de Boccard.
luneau (É.)2010 L’Âge du Bronze Final en Asie centrale Méridionale (1750=1500//1450 avant n.e.) : la fin
de la civilisation de l’Oxus, Thèse de doctorat, université Paris 1.
taleBian (m.), FieldinG (J.), FunninG (G. J.), Ghorashi (m.), JacKson (J.), nazari (h.), Parsons (B.), Priestley (K.), rosen (P. a.), Walker (r.), WriGht (t. J.)2004 « the 2003 Bam (iran) earthquake – rupture of a blindstrike-slip fault: auxiliary
material », Geophysical Research Letters 31(11), l11611, doi:10.1029/2004Gl020058.
Vahdati (a. a.), FrancFort (h.-P.)2008 Preliminary report of Iran-France joint archaeological sounding at Tepe Damghani,
Sabzevar, unpublished report archived in icar document centre, tehran.
Vahdati (a. a.), FrancFort (h.-P.)avec appendices de Fouache (É.), tenGBerG (m.), mashKour (m.)2011 « Preliminary report on the Soundings at Tappeh Dāmghāni, Sabzevar », Iranian
Journal of Archaeology and History, 24, 2, iranian university Press, tehran, p. 17-36 (en persan avec résumé en anglais).
IFEAC
L’ArChéoLogIE FrAnçAIsE En AsIE CEntrALE
Nouvelles recherches et enjeux socioculturels
L’A
rCh
éoLo
gIE
FrA
nçA
IsE
En A
sIE
CEn
trA
LE
Nou
velle
s rec
herc
hes e
t enj
eux
soci
ocul
ture
ls
Cah
iers
d’a
sie
Cen
tral
e
Cah
iers
d’
asie
CeN
tral
e21
/22
21/22
sous la direction de Julio BeNdezu-sarmieNto
issN : 1270-9247isBN : 978-2-7018-0347-0
l’archéologie est une discipline scientifique, complexe mais de plus en plus précise, dont l’objectif essentiel est de mieux connaître l’Homme et la société, depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque moderne, grâce à l’étude des éléments matériels mis au jour (édifices, infra-
structures, poteries, outils, armes, ossements...). L’archéologue, dans une approche diachronique, trouve l’essentiel de sa documentation grâce à des travaux de terrain (prospections, sondages, fouilles, voire études de collections). Les résultats permettent de mettre en lumière une culture ou une civilisation, une ou des population(s), les étapes d’un passé méconnu.
L’Histoire de l’Asie centrale est complexe et jalonnée d’épisodes mouvementés. La grande diversité géographique et orographique en a fait un lieu privilégié où se sont développés de grandes civili-sations et de puissants empires, dont il nous reste encore beaucoup à découvrir : la civilisation de l’Oxus, les empires des Achéménides, d’Alexandre le Grand, des Kouchans, des Sassanides, des Turcs, des Arabes, des Mongols...
Il y a douze ans, le numéro IX des Cahiers d’Asie centrale publiait les résultats des découvertes archéologiques françaises réalisées dans cette région. Cette abondante moisson prenait en compte un immense travail initié par Jean-Claude Gardin en 1979. Aujourd’hui, ce nouveau numéro double des Cahiers amplifie notre connaissance de l’Asie centrale grâce aux trente deux articles pluri-disciplinaires associant les sciences humaines et sociales aux sciences de la terre ; et il nous fait découvrir les résultats des recherches archéologiques menées depuis plus de trois décennies, mettant en exergue le travail scientifique et la méthodologie, l’excellente coopération entre les chercheurs centrasiatiques et français, le souci de formation et de valorisation. Et nous espérons qu’au fil des pages l’archéologue, l’historien ou les lecteurs avertis trouvent dans cet ouvrage les éléments d’une histoire pluridisciplinaire, constamment enrichie.
Julio Bendezu-sarmiento est docteur en archéologie et bioanthropologie, chargé de recherche au CNRS. Il travaille en Asie centrale où il codirige plusieurs missions archéologiques entre l’Ouzbékistan et le Turkménistan. Il a été secrétaire scientifique et directeur par intérim de l’Institut français d’études sur l’Asie centrale (IFEAC) de 2007 à 2009 ; il est actuellement directeur adjoint de la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA).
Édition-diffusion de BoCCardde BoCCard