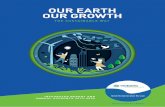Les recits de batailles dans l'oeuvre de Florus - Cairn
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Les recits de batailles dans l'oeuvre de Florus - Cairn
LES RÉCITS DE BATAILLES DANS L'ŒUVRE DE FLORUS : ENJEUXNARRATIFS ET IDÉOLOGIQUE
Guillaume Flamerie de Lachapelle
Presses universitaires de Franche-Comté | « Dialogues d'histoire ancienne »
2010/1 36/1 | pages 137 à 152 ISSN 0755-7256ISBN 9782848673110DOI 10.3917/dha.361.0137
Article disponible en ligne à l'adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.cairn.info/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2010-1-page-137.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses universitaires de Franche-Comté.© Presses universitaires de Franche-Comté. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans leslimites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de lalicence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit del'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockagedans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
Les récits de batailles dans l’œuvre de Florus : enjeux narratifs et idéologique
Dialogues d’ histoire ancienne 36/1 - 2010, 137-152
Guillaume Flamerie de Lachapelle*
L’ouvrage historique de Florus** est si riche en récits militaires que, selon le titre transmis par le codex Bambergensis, le plus ancien des manuscrits que nous ayons conservés, les bella en sont l’objet principal : l’œuvre y est en effet intitulée Epitomae de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC libri duo. Bien que cette appellation ne remonte certainement pas à Florus 1, et qu’il faille pareillement exclure les hypo-thèses modernes conservant le mot bella dans le titre 2, un tel fait est symptomatique 3 : l’Épitomé 4, qui aborde successivement les différents conflits que mena Rome, cette urbs bellatrix (I, 1[1], 7), regorge de relations d’affrontements armés.
* Université Michel-de-Montaigne – Bordeaux 3. Institut Ausonius. [email protected]** Nous suivons les textes et les traductions de la Collection des Universités de France. Les références sans nom d’auteur renvoient à Florus.1 Ne serait-ce que parce que l’ouvrage de Florus n’est pas un « abrégé » (epitoma) de Tite-Live : cf. à cet égard Jal (1967) XXIII-XXIX ; Veneroni (1974) 345 ; Giordano (1988) 116-117 ; Briquel (1994) 209-211. En outre, le but de Florus est d’illustrer les exploits du peuple romain pace belloque (pr. 1), ce qui rend suspect le génitif bellorum : sur l’impossibilité de se fonder sur le témoignage du Bambergensis pour insérer bella dans le titre, cf. déjà Jahn (1852) XXXV, suivi par Reber (1865) 68, Bizos (1876) 34, Klotz (1940) 114-115 et Salomone Gaggero (1981) 16. 2 Monceaux (1894) 198-199, nomme l’œuvre de Florus d’après le titre du Bambergensis : « Abrégé de sept cents ans de guerres, d’après Tite-Live » ; Macé (1900) 100, opte pour « Romanorum bella ».3 Bizos (1876) 101, note ainsi que la pesante répétition des batailles justifie le titre du Bambergensis, bien que celui-ci ne remonte pas à Florus : « Ille vero semper proelia loquitur. [...] Quod haud inepte demonstrat codicis Bambergis titulus, qui, quanquam ab ipso Floro non profectus, quid susceperit auctor recte designare mihi videtur : Epitoma ... bellorum omnium septingentorum ».4 Nous appellerons ainsi, par convention, l’œuvre de Florus : si la proposition de Bessone (1996) 17 (« la prétendue Epitomé de Tite-Live ») est plus fondée scientifiquement, elle est peu commode d’un point de vue pratique. — Quant à l’hypothèse de Jal (1967) XXI-XXIII (tabella, « tableau », encore
DHA 36/1 - 2010
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
138 Guillaume Flamerie de Lachapelle
DHA 36/1 - 2010
Il est donc légitime d’étendre aux récits de batailles effectués par Florus une enquête qui a déjà été menée à propos d’un historien comme Tite-Live 5, sa source principale 6. On se demandera ainsi quelles sont les caractéristiques essentielles, d’un point de vue formel et thématique, des récits de batailles dans l’Épitomé, en laissant de côté la dimension strictement historique, qui aurait appelé des développements trop importants 7.
Plutôt que d’opérer une taxinomie des batailles rapportées par Florus 8, nous suivrons un raisonnement en deux étapes : nous étudierons d’abord les conséquences de la breuitas, caractéristique de son œuvre 9, sur la façon dont les batailles sont narrées ; nous verrons ensuite dans quelle mesure ces récits traduisent des conceptions idéolo-giques de l’auteur, et en particulier le rôle joué par la fortuna et la uirtus dans sa vision de l’histoire. Une telle démarche nous amènera simultanément à mettre au jour diffé-rents procédés mobilisés par l’historien : ainsi seront analysés l’omission, l’ellipse, la condensation, la comparaison, l’effacement ou la dissociation.
1. Les conséquences de la breuitas
1.1. Réduction du contenu informatifAfin de mieux apprécier la réduction du contenu informatif qui caractérise géné-
ralement les récits de batailles chez Florus, procédons par comparaison et partons du
défendue par Jal [1999] 902), elle semble douteuse (cf. Veneroni [1974] 345, n. 1 ; Baldwin [1988] 138-139 ; Bessone [1993] 84).5 Plathner (1933) et, plus récemment, Bartolomé Gómez (1995).6 Il est admis que, si Tite-Live n’est pas la source unique de Florus, son influence demeure la plus importante ; on débat en revanche pour savoir si Florus se fonde directement sur l’Ab Vrbe condita (hypothèse traditionnelle ; cf. e.g. Jal [1999] 902-903) ou s’il dépend d’un abrégé de cet ouvrage (position défendue par Rossbach [1909] col. 2769 ; Malcovati [1937] 71 ; Bessone [1996] 211-217). Nous ne saurions trancher ici cette quaestio uexata.7 Cela est en particulier vrai des batailles pour lesquelles Florus est l’une de nos sources principales : on peut penser, par exemple, au désastre de Varus (II, 30, 34-38), qui a suscité, de la part de la critique, une attention tout à fait inhabituelle pour l’épitomateur (cf. surtout Lemcke [1936]). 8 Tel a été le parti pris, par exemple, par Bartolomé Gómez (1995) à propos de Tite-Live (« batallas ‘sumario’ » ; « batallas breves » ; « batallas desarolladas »). Quant à nous, il nous a semblé, d’une part, que ce type d’approche se prêtait mieux à une démarche purement stylistique, comme celle qui est menée par le savant espagnol ; d’autre part, que la uariatio constamment recherchée par Florus est trop grande pour supporter un découpage de cet ordre.9 Cette breuitas a été soulignée par tous les commentateurs de Florus, lequel donne le ton dès le prologue (cf. pr. 3 : in breui quasi tabella, et, sur ce passage, Facchini Tosi [1990] 94).
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
Les récits de batailles dans l’œuvre de Florus : enjeux narratifs et idéologique 139
DHA 36/1 - 2010
récit le plus détaillé de l’Epitomé, c’est-à-dire celui de Pharsale (II, 13, 43-50). Le schéma narratif est le suivant :
a. Mention du lieu (§ 43 : Philippicis campis urbis) 10 ;b. Décompte des forces en présence (§ 44 : trecenta amplius milia hinc uel illinc) ;c. Énumération des présages annonçant l’issue de la bataille (§ 45) ;d. exemplum individuel (§ 46 : la mort du césarien Crastinus) ;e. Manœuvres et déroulement des opérations (§ 47-49) ;f. Dicta de César (§ 50).Pour une fois, Florus n’a pas complètement cédé à la breuitas – encore que le
récit dût être certainement bien plus long dans sa source livienne –, puisqu’il délivre des informations précises en assez grand nombre. Dans l’Épitomé, les autres relations de batailles n’offrent pas autant de détails.
Leur récit est en effet souvent réduit à son minimum, lequel se traduit par deux données essentielles : le lieu de la bataille et l’issue de celle-ci. Un tel état de fait s’ex-plique facilement lorsque, de l’aveu même de Florus, l’affrontement, par son insigni-fiance, n’en est pas vraiment un, comme dans le cas de Cynocéphales (I, 23, 11) :
Nam postea numquam ausus congredi rex ad tumulos, quos Cynocephalas uocant, uno ac ne hoc quidem iusto proelio opprimitur (« Par la suite, le roi, qui n’avait jamais osé en venir aux mains avec nous, est écrasé près des hauteurs dites de Cynocéphales, en un seul combat – et encore ce ne fut pas un véritable combat ») 11.
Dans cette configuration, on comprend que le narrateur ne s’appesantisse pas. Mais le peu d’importance de la bataille n’est pas toujours mis en avant par Florus, et le modèle <brève localisation + résultat> s’impose dans la plupart des situations. Une phrase comme classem hostium iam in Africo mari apud Aegimurum in Italiam ultro nauigantem cecidit (I, 18, 30, à propos de la première guerre punique) 12 est à cet égard tout à fait typique 13. La fréquente mention du lieu de la bataille, surtout si on compare l’Épitomé à des bréviaires comme ceux de Justin ou d’Eutrope, est sans doute à mettre sur le compte de l’intérêt depuis longtemps remarqué de Florus pour la géographie 14.
10 Sur cette « erreur » de Florus, qui semble confondre Philippes et Pharsale, cf. infra [p. 148].11 Cf. aussi II, 13, 63, à propos de la victoire de César sur Pharnace : Sed hunc Caesar adgressus uno et, ut sic dixerim, non toto proelio obtriuit (« Mais César l’attaqua et l’écrasa en une bataille unique et, pour ainsi dire, inachevée »).12 Comme très souvent, le sujet sous-entendu de cecidit est populus Romanus (nous ne signalerons plus, désormais, ce trait du récit florien).13 Même structure en I, 1[1], 13 ; I, 22, 29 ; I, 32, 3 ; I, 32, 4 ; I, 36, 15 ; I, 40, 11 ; I, 40, 17 ; II, 8, 10 ; II, 10, 7, etc.14 Cf. déjà Reber (1865) 6-15; Zancan (1942) 9-13.
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
140 Guillaume Flamerie de Lachapelle
DHA 36/1 - 2010
Néanmoins, parfois, cette localisation manque. On n’a plus alors qu’une mention de la bataille, le plus souvent à la façon des bulletins militaires rapportant sèchement les faits (I, 1[1], 11 : Pulsi fugatique Veientes ; I, 38, 4 : omnes fugati, exuti castris) 15.
Si l’on revient au récit de Pharsale qui ouvrait notre réflexion, on constate que les renseignements qu’il contient reviennent ponctuellement et isolément au cours d’autres descriptions de batailles. Essayons d’en expliquer les raisons.
• Le lieu, tout d’abord, est rarement décrit de façon précise 16. La topographie n’est l’objet d’une attention spéciale que lorsque son caractère est notablement frappant ou exotique : ainsi en va-t-il de la victoire des esclaves de Spartacus près du Vésuve, qu’a rendue possible la configuration toute particulière des lieux, propice à des attaques de revers inattendues (II, 8, 4), alors que les autres succès remportés par le gladiateur ne sont évoqués qu’en peu de phrases, avec une localisation simplement mentionnée d’un mot (II, 8, 10). De la même façon, si Florus évoque, au cours de la guerre civile entre César et Pompée, une bataille mineure, on a l’impression que c’est en raison de son cadre remarquable et unique (le détroit de Gibraltar), qu’il se plaît à transformer en une sorte de locus horridus (II, 13, 76) 17.
• En ce qui concerne les forces en présence, Florus indique parfois leur nombre ou leur nature :
— Le nombre est mentionné, à l’évidence, pour frapper les esprits : il s’agit toujours de masses imposantes (II, 9, 8 : les huit légions qu’on oppose à Sylla), d’ailleurs parfois exagérées par l’historien lui-même, peut-être pour rehausser le mérite des Romains 18. Comme souvent, en tout cas, l’épitomateur a tendance à arrondir : chez lui, les Fabii, par exemple, sont trois cents (I, 6, 2) et non trois cent six comme ailleurs 19.
— La nature des forces armées est l’objet de considérations particulières lorsqu’elle est jugée révélatrice d’un trait propre de l’ennemi : tel est le cas des éléphants de Pyrrhus (I, 13, 6-12) et de ceux d’Antiochus III (I, 24, 16), ou des frondes des Baléares
15 On a une idée de la forme primitive des rapports militaires d’après les pastiches qu’en fait Cic., Att., V, 20, 3 (= CUF 228) ; Fam., XV, 4, 10 (= CUF 229) : cf. sur ce point Fränkel (1956).16 Pour la place de la nature dans les récits guerriers chez Florus, nous renvoyons à l’analyse minutieuse, d’ordre essentiellement stylistique, de Facchini Tosi (2004).17 Sur la sensation d’oppression que parvient à donner Florus, cf. Facchini Tosi (2004) 85-86.18 À la bataille de Magnésie du Sipyle, livrée contre Antiochus, Flor., I, 24, 16, compte ainsi trois cent mille hommes dans l’armée séleucide, contre soixante-dix mille environ pour la source dont il s’inspire (Liv., XXXVII, 40 [même chiffre dans App., Syr., 32, 161]) ; cf. sur ce point Bizos (1876) 71-72, qui met cette exagération (incredibile dictu, écrit Florus lui-même) en rapport avec la volonté de l’auteur d’écrire un panégyrique, dans lequel le peuple-roi triomphe d’ennemis extrêmement redoutables.19 Cf. Liv., II, 49, 4 ; Dion. Hal., AR, IX, 22, 1 ; Oros., Hist., II, 5, 9.
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
Les récits de batailles dans l’œuvre de Florus : enjeux narratifs et idéologique 141
DHA 36/1 - 2010
(I, 43, 5-6). À l’instar de Pyrrhus ainsi, les éléphants sont dépeints comme les détenteurs d’une puissance inédite ; les pachydermes d’Antiochus, en revanche, ont en commun avec le Séleucide d’être parés d’un luxe extravagant (auro, purpura, argento et suo ebore fulgentibus), qui traduit en fin de compte une grave inaptitude au combat ; quant aux frondes des Baléares, leur caractère rudimentaire est significatif de l’arriération des indigènes, qui détaleront au premier choc 20.
• Les présages (I, 22, 14 ; I, 46, 4 ; II, 17, 6) et autres événements surnaturels (I, 14, 2) se manifestent assez rarement. Moins que la croyance de Florus à l’égard de phénomènes pour lesquels il a tendance à fournir des explications rationnelles 21, ces occurrences témoignent du rôle crucial qu’il accorde à la fortuna et au fatum dans l’his-toire romaine 22 et, secondairement, de son goût pour le pittoresque.
• Les manœuvres 23 ne sont guère détaillées, en règle générale 24. Florus ne s’at-tache à cet aspect des choses que lorsqu’il révèle un côté inattendu, par là même suscep-tible d’attirer l’attention de son lecteur : ce dernier ne manque pas d’apprendre, par exemple, que les yeux des Romains crachaient des flammes lors d’une bataille contre les Samnites (I, 11, 12), ou que l’ombre des combattants portée par la lune joua un grand rôle dans la victoire que Pompée remporta contre Mithridate sur l’Euphrate (I, 40, 23) 25.
20 On peut signaler une variante intéressante du phénomène que nous venons de décrire en I, 37, 5 : cette fois-ci, l’arme utilisée (c’est-à-dire les éléphants) ne sert pas à révéler un trait de caractère de ceux qui l’utilisent, mais de ceux contre qui elle est utilisée (les Allobroges) : Maximus barbaris terror elephanti fuere, inmanitati gentium pares (« Rien n’épouvanta plus les barbares que nos éléphants, dont le caractère sauvage était bien en accord avec celui de ces peuplades »).21 Sur ce point cf. Alba (1953) 53-57. On pourrait citer en exemple la bataille de Trasimène (Flor., I, 22, 14) : Imminentem temerario duci cladem praedixerant insidentia signis examina et aquilae prodire nolentes et commissam aciem secutus ingens terrae tremor : nisi illum horrorem soli equitum uirorumque discursus et mota uehementius arma fecerunt (« L’imminence du désastre avait été annoncée à un chef téméraire par des essaims fixés sur les enseignes, des aigles refusant d’avancer et un violent tremblement de terre, peu après le début de la rencontre: à moins que cet ébranlement du sol n’eût été provoqué par la course des chevaux et des hommes et les mouvements violents des armes »). Ce rationalisme n’est pas exclusif de l’emphase, puisque Liv., XXII, 5, 8, se contente de dire que les combattants, dans l’ardeur de la bataille, ne ressentirent même pas un séisme qui ruina pourtant plusieurs villes d’Italie.22 Cf. infra [p. 146].23 Nous englobons sous ce terme un peu vague l’ensemble des faits et gestes de la masse des combattants.24 Signalons, par exception, les batailles navales, pour lesquelles Florus insiste davantage – peut-être pour tenir compte des connaissances moindres de son lectorat – sur des éléments purement techniques, comme la conception des navires ou leur armement : I, 18, 8-9 ; I, 18, 33-36 ; I, 45, 5 ; II, 21, 6. 25 Si l’on compare ce récit à celui de Plut., Pomp., 32, 5-18, de Dio Cass., XXXVI, 49, Oros., Hist., VI, 4, 4, on constate bien que Florus n’a conservé que le côté le plus spectaculaire de la bataille (en commettant
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
142 Guillaume Flamerie de Lachapelle
DHA 36/1 - 2010
Une fois de plus, l’épitomateur s’attache à la dimension spectaculaire de la bataille ; il est d’ailleurs significatif que le combat soit, à trois reprises, assimilé à un spectaculum 26. Florus ne néglige pas non plus, chaque fois qu’il le peut, de forger une brève sententia qui résumera des manœuvres complexes en quelques mots. Ces derniers forment alors régulièrement une gradation 27, comme pour Magnésie du Sipyle (I, 24, 17 : Primum trepidatio, mox fuga, deinde triumphus fuerunt) ou comme lorsqu’il est rendu compte des trois batailles successives qui opposent Rome à Pyrrhus (I, 13, 13) :
Ac sic eaedem ferae, quae primam uictoriam abstulerunt, secundam parem fecerunt, tertiam sine controuersia tradiderunt (« Ainsi les mêmes animaux qui nous avaient enlevé la première victoire rendirent la deuxième indécise et nous donnèrent sans conteste la troisième ») 28.
d’ailleurs une erreur, puisqu’il place la lune dans le dos de l’armée royale, alors qu’elle se situait derrière les soldats de Pompée) ; cf. sur ce passage les remarques de Facchini Tosi (2004) 76-77. 26 1° Bataille du lac Régille (I, 5, 4) : Ea denique atrocitas proelii fuit, ut interfuisse spectaculo deos fama tradiderit (« Bref, la bataille fut si acharnée qu’à en croire la renommée, les dieux y assistèrent en specta-teurs ») : en plus de l’hyperbole caractéristique de l’Épitomé, ce passage permet d’intéresser symbolique-ment les dieux au destin de Rome, dans une vision téléologique de l’histoire (la suite du passage fait de la victoire romaine une conséquence du soutien des dieux: cf. à cet égard Bessone [1995] sur le rôle accru que confère Florus aux dieux dans cette bataille, par rapport aux autres sources connues).2° Bataille d’Héraclée (I, 13, 8) : Actum erat, nisi elephanti conuerso in spectaculum bello [...] (« C’en était fait, si les éléphants, transformant la bataille en spectacle [...] ») : ainsi que l’ont noté les commentateurs (e.g. Jal [1967] 127 ; Facchini Tosi [1998] 310, à la suite de Graevius), les « spectateurs » sont ici, à n’en pas douter, les légionnaires romains, confrontés pour la première fois à des éléphants.3° Victoire sur les Tigurins (I, 38, 21) : Quippe uelut elata montibus suis Roma spectaculo belli interesset [...] (« Comme si, en effet, transportée au sommet de ses collines, Rome assistait au spectacle de sa guerre [...] ») : les Dioscures ont averti la foule de Rome du succès militaire alors que celle-ci assistait à un spec-tacle en ville. Cette troisième assimilation du proelium à un spectaculum permet, grâce aux Dioscures, de ménager un écho avec la première occurrence de la comparaison ; cet écho ménage aussi une progression, puisque ce ne sont plus les dieux, mais les Romains eux-mêmes qui, tout puissants, assistent désormais à leurs propres triomphes (dans ce troisième passage, les Dioscures n’ont d’ailleurs plus qu’un rôle de messa-gers alors que, dans le premier extrait cité, les dieux intervenaient directement dans la victoire romaine).27 Sur le goût de Florus pour cette figure de style, cf. Sieger (1934) 108, qui donne la bataille de Magnésie en exemple.28 À Héraclée, Pyrrhus, bénéficiant de l’effet de surprise produit par ses éléphants, l’emporta totale-ment; à Asculum, la lutte fut plus disputée, car les Romains avaient appris à lutter contre ces bêtes (signa-lons à cet égard que, si Florus ici adopte la version d’un combat incertain [contra DVI, 35, 8 ; Eutrop., II, 13, 4 ; Oros., Hist., IV, 1, 19-23, pour qui le succès romain ne souffrait pas de contestation, cf. à cet égard Bessone (1978) 429-431], c’est peut-être pour ménager une progression dramatique riche de multiples effets rhétoriques : défaite romaine > bataille incertaine > victoire romaine) ; à Bénévent, les éléphants semèrent la panique dans leurs propres rangs, apportant par là même la victoire aux Romains. Surpris de l’importance prise par les éléphants dans ce chapitre, Reber (1865) 45, écrit même, non sans quelque outrance : « Das ganze Kapitel spricht überhaupt mehr von Elephanten als von Geschichte » ! ; cf. dans le même sens Salomone Gaggero (1981) 34.
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
Les récits de batailles dans l’œuvre de Florus : enjeux narratifs et idéologique 143
DHA 36/1 - 2010
La recherche constante de ce type de formules conduit Florus à réduire le nombre des facteurs explicatifs de l’issue d’une bataille : dans le dernier exemple cité, il met ainsi délibérément en avant le seul rôle des éléphants dans la narration des trois combats. Il en va de même avec l’affrontement du Métaure (I, 22, 50-53), pour lequel c’est l’unité des chefs romains qui est soulignée, unité qui fait contraste à la fois avec ce qui s’était passé à Cannes et avec les Carthaginois, dont les forces – celles d’Hannibal et de son frère Hasdrubal – sont séparées.
On a même le sentiment que c’est pour le plaisir d’écrire une sententia finale – d’un goût douteux au demeurant – que Florus attribue la victoire des Romains sur les Teutons à Verceil au seul stratagème de Marius, qui contraignit ses hommes à vaincre les ennemis pour accéder à un point d’eau (I, 38, 9) :
Itaque tanto ardore pugnatum est eaque caedes hostium fuit, ut uictor Romanus de cruento flumine non plus aquae biberit quam sanguinis barbarorum (« Aussi, si grande fut l’ardeur des combat-tants et tel, le massacre des ennemis, que le Romain victorieux but moins d’eau dans le fleuve ensanglanté que de sang barbare ») 29.
Bref, le caractère unidimensionnel des facteurs explicatifs de victoire ou de défaite est constant dans l’œuvre florienne 30.
• Venons-en enfin au bilan de la bataille. Le total des prisonniers ou des pertes n’est signalé que lorsqu’il est particulièrement significatif, c’est-à-dire quand il est extrêmement bas – victoires de Marius sur les Cimbres (I, 38, 14) ou de Pompée sur les pirates (I, 40, 15) – ou, au contraire, fort élevé : ainsi sont mentionnées la prise de cent éléphants après Panhorme (I, 18, 27-28), les lourdes pertes de Crassus à Carrhes (I, 46, 2) ou la mort de plus de vingt mille hommes à la bataille de Gindaros (II, 19, 6) ; l’his-torien souligne aussi qu’il n’y eut aucun survivant parmi l’armée de Catilina (II, 12, 12). Dans les autres cas, contrairement à Tite-Live, sa source principale, qui aime à donner régulièrement le montant des pertes à l’issue d’un combat 31, l’épitomateur s’abstient de cette précision.
En somme, on le voit, Florus est plutôt avare de renseignements, et choisit en règle générale de donner ceux-ci lorsqu’ils peuvent orner son récit d’une façon ou d’une autre, sans les proportionner à l’importance réelle de la bataille en question.
29 Cf. Facchini Tosi (2004) 94. Les mêmes commentaires pourraient s’appliquer à la victoire de Camille, en I, 7, 17 : subito adgressus a tergo Camillus adeo cecidit, ut omnia incendiorum uestigia Gallici sanguinis inundatione deleret (« Tout à coup, ils furent si bien taillés en pièces par Camille, qui les avait pris à revers, qu’il effaça sous des flots de sang gaulois tous les restes de leur désastre même »).30 Cf. aussi infra [p. 146], nos remarques sur uirtus et fortuna.31 E.g. Liv., III, 5, 12-13 ; XXXIV, 10, 2 ; XXXVIII, 23, 6-8 ; cf. l’étude très détaillée de Erdkamp (2006).
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
144 Guillaume Flamerie de Lachapelle
DHA 36/1 - 2010
Si l’on s’intéresse à présent moins au contenu informatif des récits de batailles qu’à la façon dont ceux-ci sont menés, on constate de même la prédominance des procédés qui tendent à la breuitas.
1.2. Trois procédés narratifs particuliers : condensation, omission, ellipse
1.2.1. La condensationLa condensation est un moyen de simplifier en même temps que de raccourcir
la marche des événements : c’est ainsi, par exemple, que Florus mentionne une seule bataille à Aix, contre les Teutons (I, 38, 7), et fait de même pour Philippes, contre Brutus et Cassius (II, 17), alors qu’à chaque fois, il y en eut, historiquement, deux 32. On pourra signaler, dans le même ordre d’idées, les récits qui s’assimilent à des résumés, comme la mention, en une seule phrase, d’une victoire sur douze peuples voisins (I, 1, 5, 6 : Duodecim namque Tusciae populos frequentibus armis subegit) ; le même phéno-mène se retrouve également pour des victoires importantes, qui sont rapportées « à la chaîne », telles celles que Sylla remporte sur Mithridate (I, 40, 11 : omnis copias uno apud Chaeroniam, apud Orchomenon altero bello dissipauit).
1.2.2. L’omissionIl arrive qu’une bataille soit omise : l’un des exemples les plus nets de ce phéno-
mène est Pydna, qui marqua la fin du royaume de Macédoine, et aurait dû clore le chapitre 28 du livre I. Une telle omission peut certes être attribuée au manque de sens historique de Florus, mais il est aussi permis de penser qu’elle est délibérée, dans la mesure où l’historien est bien conscient de l’existence d’un combat 33, et qu’elle sert un dessein rhétorique précis. Car le silence du narrateur lui permet de renforcer l’effet burlesque d’un Persée si lâche qu’il s’avoue vaincu sans même livrer bataille : le côté irrationnel de sa panique et de sa reddition aurait en revanche été fortement amoindri si Florus s’était étendu sur le désastre qui consacra la domination romaine en Grèce.
Taire une bataille favorise aussi des effets de progression rhétorique que le strict respect de la véracité historique aurait empêché. Pendant la première guerre punique,
32 Pour Aix, cf. Plut., Mar., 19-21 ; pour Philippes, cf. Plut., Brut., 38-49.33 À la fin du chapitre consacré à la guerre contre Persée, après avoir décrit le triomphe de Paul-Émile, l’historien signale en effet, que les Dioscures apparurent aux Romains eodem die quo uictus est Perses in Macedonia (I, 28, 14), c’est-à-dire « le jour même où Persée fut vaincu en Macédoine », comme s’il était bien au courant, en fin de compte, de l’existence de ce combat décisif, mais qu’il avait choisi délibérément de n’en rien dire.
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
Les récits de batailles dans l’œuvre de Florus : enjeux narratifs et idéologique 145
DHA 36/1 - 2010
passer sous silence la grande bataille intermédiaire d’Ecnome (256 a.C.) permet ainsi de conclure en apothéose sur la victoire des îles Égates (241 a.C.), qui avait pourtant mis aux prises moins de participants que la précédente, en soulignant : nec maior alias in mari pugna (I, 18, 33) 34.
1.2.3. L’ellipseL’ellipse se distingue de l’omission en ceci que le lecteur est capable de déduire
du récit qu’une bataille est intervenue, même si cette dernière n’est pas racontée, ni même explicitement mentionnée.
Des exemples de ce procédé se trouvent lorsque Florus passe directement des préparatifs antérieurs à la bataille à son résultat. Dans ce cas de figure, la breuitas n’est pas nécessairement recherchée per se, et Florus sait habilement en tirer des effets variés, au premier rang desquels se place l’humour (I, 20, 4) :
Mox Ariouisto duce uouere de nostrorum militum praeda Marti suo torquem. Intercepit Iuppiter uotum ; nam de torquibus eorum aureum tropaeum Ioui Flaminius erexit (« Puis, sous le comman-dement d’Arioviste, ils vouèrent à leur dieu Mars un collier qu’ils auraient pris à nos soldats. Mais Jupiter se chargea, à la place du dieu, d’exaucer leur vœu ; car ce fut avec leurs colliers que Flaminius éleva un trophée d’or à Jupiter »).
L’ellipse de la bataille, qui permet de juxtaposer les prières des Gaulois au triomphe des Romains, rend d’autant plus soudaine la défaite des premiers, et d’au-tant plus ridicule leur vanité. L’historien recourt trois fois de suite à ce procédé pour rendre compte des défaites gauloises (cf. aussi I, 20, 3, pour Brittomarus ; I, 20, 5, pour Viridomarus) 35. La même technique est présente dans le second livre : Chérusques, Suèves et Sicambres en sont déjà à se partager le butin qu’ils feront aux dépens des Romains, quand la phrase suivante rapporte comment c’est au contraire Drusus qui dépouille leurs troupeaux, leurs bijoux et leurs personnes mêmes (II, 30, 25) !
En somme, la breuitas de Florus a, comme on pouvait s’y attendre, des effets directs sur la façon dont il raconte les batailles. Mais il ne faudrait pas négliger, dans cette enquête, des facteurs qui relèvent de la Weltanschauung de l’historien.
34 Sur ce dernier exemple, cf. Leuze (1911) 559-560.35 Reber (1865) 45, note même : « So ist das ganze Kap. 20 eine Reihe von Wortspielen », ce qui est un peu excessif.
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
146 Guillaume Flamerie de Lachapelle
DHA 36/1 - 2010
2. Les récits de batailles, miroirs des conceptions idéologiques de Florus
2.1. Un constat quantitatif : fréquence de uirtus et fortuna dans les facteurs de victoireFlorus ne signale pas toujours les motifs qui ont décidé de l’issue de la bataille,
et quand il le fait, deux facteurs émergent nettement : la fortuna, d’une part (I, 13, 12 [casus] ; I, 18, 22 ; II, 6, 13 ; II, 19, 5 [ felicitas] ; cf. aussi I, 7, 18) ; la uirtus romaine, d’autre part (I, 13, 12 ; I, 38, 8 ; I, 38, 15 ; I, 45, 8 ; II, 13, 34 ; II, 13, 58-60) – ou, ce qui revient au même, l’absence de uirtus chez les hostes (I, 26, 3 ; II, 13, 62-63). C’est une façon pour l’historien de se conformer clairement à son postulat de départ, qui, s’il ne lui est sans doute pas propre 36, fonde son entreprise tout entière. Ce principe est ainsi énoncé dans la préface (pr., 2) :
Tot in laboribus periculisque iactatus est, ut ad constituendum eius imperium contendisse Virtus et fortuna (« Il [i.e. le peuple romain] fut aux prises avec tant de peines et de dangers que, pour constituer son Empire, Courage et Fortune semblent avoir rivalisé ») 37.
La présence massive de fortuna et uirtus au cours des batailles est bien sûr, occa-sionnellement, au service de la dimension élogieuse de l’Epitomé : il est commode de faire de la uirtus un élément central des succès romains, et d’exciper de la malchance ( fortuna) pour justifier les échecs du peuple-roi (e.g. I, 18, 22 et 25).
Mais ce constat quantitatif ne suffit pas à rendre compte de la présence de fortuna et de uirtus dans les combats : Florus ne signale-t-il pas que, plus encore que la victoire militaire, c’est la victoire morale qui importe, qu’il faut vaincre sur le terrain de la uirtus plutôt que sur le champ de bataille 38 ? La bataille en elle-même n’en vient-elle pas à s’effacer devant l’exaltation de la uirtus ?
C’est ce que semble indiquer l’emploi de divers types de procédés.
36 Sur le poids de la fortuna dans l’issue d’une bataille, cf. e.g. Caes., Gall., VI, 30, 2 : Multum cum in omnibus rebus, tum in re militari potest Fortuna (« Le pouvoir de la Fortune est grand en toutes choses, et spécialement dans les événements militaires ») ; Ciu., III, 68, 1 ; Liv., IX, 17, 3 ; Dion. Hal., AR, IX, 29, 5.37 Sur l’importance du couple uirtus/fortuna dans l’œuvre de Florus, cf. Cupaiuolo (1984) 32-35 ; Facchini Tosi (1990) 41-45 ; Hose (1994) 96-103 ; Bessone (1996) 93-121.38 Flor., I, 6, 6, à propos de l’offre scélérate du maître de Faléries, refusée par Camille, alors même qu’elle lui assurait une victoire facile : Eam namque uir sanctus et sapiens ueram sciebat esse uictoriam, quae salua fide et integra dignitate pareretur (« La vraie victoire, cet homme vénérable et sage le savait, est celle que l’on acquiert en laissant la bonne foi sauve et l’honneur entier »).
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
Les récits de batailles dans l’œuvre de Florus : enjeux narratifs et idéologique 147
DHA 36/1 - 2010
2.2. La transposition chronologique et spatiale
2.2.1. Transposition chronologique : CannesFlorus situe, à tort, la bataille de Cannes avant la tactique temporisatrice de
Fabius Maximus, ce qui lui a été reproché 39. Il semble en fait que cette inversion obéisse à des considérations compositionnelles : l’historien évoque séparément la succession des désastres (défaites du Tessin, de la Trébie, de Trasimène, de Cannes, présentées comme une série cohérente) 40 et le redressement de Rome, dont la stratégie du Cunctator est partie prenante. Intercaler l’intervention de Fabius Maximus entre deux défaites aurait ruiné la logique de la narration, peut-être inspirée de la biographie « thématique » 41 : en premier lieu, les batailles perdues ( fraus carthaginoise); en second lieu, les batailles remportées (uirtus romaine). Ce n’est d’ailleurs pas le seul exemple où Florus chercherait
39 E.g. Zancan (1942) 48-49.40 Il est question du primi impetus turbo (I, 22, 10) pour le Tessin, puis de la secunda Punici belli procella (I, 22, 12) que représente la Trébie, du tertium fulmen (I, 22, 13) du lac Trasimène, avant d’en venir au quartum id est paene ultimum uolnus imperii (I, 22, 15) : Cannes. Les déterminants numéraux et la grada-tion métaphorique font de ces quatre batailles un ensemble dont la cohérence aurait été fortement dimi-nuée par la mention de la tactique temporisatrice de Fabius : Florus privilégie l’intensité dramatique que permet la succession des batailles, au détriment de l’ordre chronologique des affrontements.41 Florus écrit en quelque sorte la « biographie » du peuple romain, ainsi que le résume Hose (1994) 80, qui juge, avec une formule très heureuse, que Florus rédige une « römische Geschichte in einer biogra-phischen Form ». On sait qu’il existait dans l’Antiquité deux types de biographies : la première suit grossièrement l’ordre chronologique, alors que la seconde procède par rubriques. — Pour l’influence du genre biographique sur Florus, cf. e.g. Jal (1967) LIV-LVII, suivi par Bessone (1993) 112 ; Hose 1994 (74-76) estime même que l’ouvrage tout entier est une biographie du peuple romain écrite à la manière de Suétone, mais n’indique pas d’influence directe du biographe sur Florus ; contra Macé (1900) 104-105, pour des motifs futiles (animosité personnelle entre les deux écrivains, que tout séparait). Pour l’in-fluence du genre biographique sur le récit de la deuxième guerre punique en particulier, cf. Klotz (1940), praes. 124-127 (Cannes), qui suppose que Florus ne saurait s’inspirer d’un modèle de type annalistique, puisque les batailles ne sont pas rapportées dans l’ordre où elles se sont produites, mais bien plutôt d’une Vie d’Hannibal (Klotz suggère qu’il s’agit de celle d’Hygin ; pour une influence d’Hygin sur Florus, cf. aussi Monceaux [1894] 200 ; Bessone [1994] 229-230). — Signalons enfin que d’après Bessone (1978) 426-427, il est possible qu’en situant l’action de Fabius après Cannes, Florus se soit conformé à une tradi-tion livienne qui se serait écartée du modèle original de l’Ab urbe condita pour simplifier la succession chronologique (défaites puis victoires).
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
148 Guillaume Flamerie de Lachapelle
DHA 36/1 - 2010
surtout à former des ensembles cohérents de récits de batailles, classés comme en vertu de rubriques ayant trait à la religion 42, à l’onomastique 43 ou à la géographie 44.
2.2.2. Transposition spatiale : PharsaleLa transposition n’est pas seulement chronologique : Florus situe la bataille déci-
sive de l’affrontement entre César et Pompée à Philippes, au lieu de Pharsale (II, 13, 43). On peut y voir une nouvelle preuve de l’incompétence historique de notre épito-mateur, mais il nous paraît préférable de chercher une autre explication 45. Selon nous, Florus chercherait délibérément à souligner le rôle du fatum et de la fortuna, puisque cette « erreur » lui permet de situer le deuxième affrontement décisif, celui qui mit aux prises Octavien et Antoine, d’une part, Brutus et Cassius, d’autre part, au même endroit (II, 17, 6) :
Illi comparatis ingentibus copiis eandem illam, quae fatalis Gnaeo Pompeio fuit, harenam insede-rant (« Ceux-ci [i.e. Brutus et Cassius], qui avaient réuni des forces considérables, les avaient établies dans la même arène que celle qui avait été fatale à Cnéius Pompée »).
Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois que les deux batailles sont mises en parallèle par l’historien 46. De cette façon, la manipulation des lieux de bataille renforce le rôle du fatum dans l’histoire romaine.
42 Ainsi signalera-t-on trois défaites gauloises où, à chaque fois, le vœu des futurs vaincus n’est pas réalisé (Flor., I, 20, 3-5 ; cf. supra [p. 145]). 43 Deux batailles donnent lieu à des surnoms, en I, 8, 2 : les « Torquati » (bataille de l’Anio) et les « Corvini » (bataille en territoire pontin).44 Ainsi, pendant la première guerre punique, les batailles d’Agrigente, Drépane, Panhorme et Camarina sont rapportées en un même mouvement, malgré l’écart chronologique entre ces quatre victoires romaines (I, 18, 12-13 : Leuze [1911] 549-554, avait déjà remarqué que Florus privilégiait ici la cohérence géographique à la succession chronologique).45 L’hypothèse de la simple erreur semble d’autant moins admissible qu’un peu plus loin, comparant cette bataille à celle de Thapsus, Florus rétablit le bon endroit : Pharsale (II, 13, 66). — Il ne s’agit bien évidemment pas de prétendre, dans notre esprit, que toutes les localisations de bataille erronées de l’Épi-tomé relèvent de la même logique : quand Florus situe la bataille de Bénévent en Lucanie, par exemple (I, 13, 11), alors qu’elle eut lieu dans le Samnium (Plut., Pyrrh., 25, 2), il faut sans doute y voir une simple bévue : cf. à cet égard Lévêque (1957) 517-520 ; pour ce qui concerne l’éventuelle confusion Gergovie/Alésia, en I, 45, 24, cf. Jal (1967) 111-118.46 Cf. ainsi Flor., II, 14, 3 : Dum Octauius mortem patris ulciscitur, iterum fuit mouenda Thessalia (« Lorsque Octave vengea la mort de son père, la Thessalie dut une seconde fois en subir le contrecoup »).
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
Les récits de batailles dans l’œuvre de Florus : enjeux narratifs et idéologique 149
DHA 36/1 - 2010
2.3. La comparaisonPour mettre en valeur la uirtus romaine, il arrive également à Florus d’élaborer
des comparaisons visant à rehausser le mérite du peuple-roi. Ainsi les succès obscurs des premiers temps sont-ils comparés à des combats plus récents (I, 5, 8) 47 ; ainsi la bataille de Camarina, lors de la première guerre punique, rappelle-t-elle les Thermopyles (I, 18, 13-14) ; ainsi le succès remporté sur la flotte d’Antiochus près d’Éphèse est-il emphati-quement rapproché de la victoire athénienne de Salamine (I, 24, 12-13).
Parfois, ce ne sont pas les batailles, mais les hommes, qui sont comparés entre eux: Varus fit preuve contre les Germains de la même vaillance que Paulus le jour de Cannes (II, 30, 35) ; la formidable rapidité des Romains, à l’occasion d’une bataille remportée par surprise, leur vaut même de voir comparer leurs traits à ceux des immor-tels en personne (I, 12, 6).
2.4. La mise en valeur des exempla uirtutis individuels Si le populus Romanus est le véritable héros de l’Épitomé, et qu’il est, à ce titre,
le principal dépositaire de la uirtus, des individualités accomplissent ponctuellement des actions d’éclat qui sont dignes, aux yeux de l’historien, d’être rapportées, et qui soulignent l’éclat de la uirtus. Pour mettre ces exempla en valeur au sein des récits de batailles, Florus recourt à deux procédés: l’effacement et la dissociation.
2.4.1. L’effacementL’effacement consiste à minimiser la place accordée au récit de la bataille elle-
même au profit de la narration de l’exemplum. On pourrait citer plusieurs illustrations : dans la guerre contre Porsenna, l’exploit d’Horatius Coclès prend le pas sur le récit de la bataille (I, 4, 4) ; on ne retient d’un combat contre les Èques que l’attachement du vainqueur, Cincinnatus, à ses habitudes paysannes (I, 5, 12-15) ; une victoire sur les Latins se résume à la décision de T. Manlius Torquatus de châtier la désobéissance de son fils et à la deuotio de P. Decius Mus (I, 9, 2-3) 48. L’effacement est utilisé aussi pour magnifier la mort glorieuse d’un combattant au cours de la bataille (II, 8, 13-14 ; II, 12, 12 ; II, 19, 7 ; II, 38, 18).
47 Fésules est rapprochée de Carrhes ; le bois d’Aricie, de la forêt hercynienne ; Frégelles, de Gésoriacum. 48 La bataille est racontée très brièvement (I, 9, 1) : Quo tempore quis cessisse hostem mirabitur ? ; le récit des deux actes mémorables comprend, pour sa part 48 mots (I, 9, 2-3) : Cum alter consulum filium suum, quia contra imperium repugnauerat, quamuis uictorem occiderit ostenderitque plus esse in imperio quam in uictoria ; alter quasi monitu deorum capite uelato primam ante aciem dis manibus se deuouerit, ut in confertissima se hostium tela iaculatus nouum ad uictoriam iter sanguinis sui limite aperiret.
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
150 Guillaume Flamerie de Lachapelle
DHA 36/1 - 2010
Cet effacement est bien sûr un moyen de magnifier la vaillance romaine dans la victoire (la uictoria de Scipion l’Africain à Carthagène est bien peu de chose au regard de sa continence morale : I, 22, 39-40) ou surtout dans la défaite : Régulus, par exemple, est mentionné pour sa fides légendaire bien plus que pour son échec sur le champ de bataille, qui est rapidement évoqué (I, 18, 23-26), et qui est secondaire, puisque, par sa rectitude morale, le vaincu est au fond le véritable vainqueur :
Quid aliud quam uictor de uictoribus atque etiam, quia Carthago non cesserat, de fortuna trium-phauit ? (« Que fit-il d’autre que de vaincre ses vainqueurs et même, puisque Carthage n’avait pas cédé, que de triompher de la fortune ? »)
Les mêmes remarques s’appliqueraient à Crassus, qui, battu par Aristonicos, se rachète en crachant superbement sa langue au visage de son geôlier (I, 35, 4-5).
L’effacement est un procédé est très courant, et traduit le souci de Florus d’édifier moralement ainsi que son goût pour les actions les plus frappantes et les plus brillantes.
2.4.2. La dissociationLa dissociation vise à distinguer clairement, dans la narration, batailles et
exempla : les premières se voient accorder une place convenable – contrairement à ce qui se passe avec l’effacement – mais à un endroit du récit tout à fait séparé des exempla. L’ordre thématique est privilégié au détriment de la succession chronologique 49.
Ce procédé n’apparaît jamais aussi clairement que lorsque Florus raconte la guerre livrée contre Pyrrhus pour le contrôle de Tarente et de la grande Grèce. L’historien commence par organiser une narration fermement structurée autour des trois grands affrontements qui eurent lieu à Héraclée (I, 13, 7 : prima pugna), puis à Asculum (I, 13, 9 : deinde), et enfin à Bénévent (I, 13, 11 : suprema pugna) 50. Une fois ces récits guerriers achevés, Florus regroupe les exempla uirtutis (I, 13, 14-25) 51 : certains
49 Nous avions déjà remarqué un tel fait avec la manipulation chronologique : cf. supra [p. 147].50 Florus nomme ce lieu campi Arusini, mais il est très vraisemblable que cette appellation, inconnue par ailleurs, se confond avec Bénévent : cf. en ce sens Lévêque (1957) 519-520.51 Ce passage s’ouvre avec la constatation, par le roi, de la uirtus romaine (§ 14 : Quippe post primam uictoriam intellecta uir callidus uirtute Romana statim desperauit armis seque ad dolos contulit, « S’étant en effet rendu compte de la valeur romaine, l’habile homme, dès sa première victoire, désespéra aussitôt de la lutte et eut recours à la ruse ») et contient d’autres remarques du même ordre (§ 23 : Quis ergo miretur is moribus, ea uirtute militum uictorem populum Romanum fuisse, « Qui donc s’étonnerait qu’avec de telles mœurs, un tel courage chez les soldats, le peuple romain ait été vainqueur » ?).
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
Les récits de batailles dans l’œuvre de Florus : enjeux narratifs et idéologique 151
DHA 36/1 - 2010
de ces exempla concernent des épisodes qui s’intercalent entre deux batailles 52, mais d’autres se situent chronologiquement au cours des batailles précédemment racontées, comme l’évocation de l’ira des Romains toujours vivante en eux, même après la mort (I, 13, 17) : en dissociant cette anecdote du récit de la bataille, Florus la met en valeur, montrant par là l’importance à ses yeux de ces exempla uirtutis, qui s’inscrivent dans une autre catégorie que le récit des pugnae.
Une autre illustration de ce phénomène concerne Crassus à Carrhes : en vertu d’une habitude qui lui est chère 53, l’historien commence par un résumé dans lequel il annonce la défaite, le trépas du général et la perte de onze légions (I, 46, 1-2). Après cette évocation de la bataille dans son ensemble, il revient sur le destin particulier de certains individus, en détaillant le cruel supplice que les vainqueurs infligent au triumvir, pour lui donner plus d’éclat : ici, c’est le déclin de la uirtus romaine pendant le troisième « âge » du populus Romanus qui est souligné.
La dissociation permet ainsi à Florus de donner du relief à des exempla en les rapportant à part du reste de la bataille.
Concluons. La breuitas qu’il recherche en permanence conduit Florus à limiter le contenu informatif des récits de batailles qu’il livre et à employer des procédés narra-tifs spécifiques tels que la condensation, l’omission ou l’ellipse. Sa conception de l’his-toire romaine a également une influence sur sa narration : il met en valeur la uirtus et la fortuna parmi les facteurs explicatifs de l’issue d’un affrontement, ce qui implique de prendre certaines libertés avec la réalité historique transmise par ses sources, libertés qui passent notamment par des transpositions ayant trait à la chronologie (Cannes) aussi bien qu’à la géographie (Pharsale). Il tisse aussi une série de comparaisons qui rehausse l’intérêt moral d’affrontements qui pourraient, sans cela, paraître secondaires. Enfin, il accorde une place toute spéciale aux exempla uirtutis les plus marquants, en usant principalement de l’effacement et de la dissociation.
52 C’est ce que suggère le sommaire placé en tête de ces exempla uirtutis (I, 13, 14 : Nec uero tantum armis et in campo, sed consiliis quoque et domi cum rege Pyrrho dimicatum est, « Ce n’est pas seulement, d’ailleurs, par les armes et en campagne, mais par les décisions prises aussi à Rome, que l’on combattit contre le roi Pyrrhus ») : ainsi en va-t-il d’Appius Claudius prononçant son discours après que Pyrrhus eut restitué les prisonniers (I, 13, 20), ou de Curius Dentatus refusant la vaisselle précieuse de Pyrrhus (I, 13, 22).53 Cf. déjà Reber (1865) 52-56, qui propose d’y voir une habitude de rhéteur (l’enumeratio précédant l’explicatio).
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
152 Guillaume Flamerie de Lachapelle
DHA 36/1 - 2010
BibliographieV. Alba, La concepción historiográfica de Lucio Anneo Floro (Madrid 1953).B. Baldwin, « Four Problems with Florus », Latomus 47 (1988) 134-142.J. Bartolomé Gómez, Los Relatos bélicos en la obra de Tito Livio. Estudio de la primera década de Ab urbe condita (Vitoria 1995).L. Bessone, « Di alcuni ‘errori’ di Floro », RFIC 106 (1978) 421-431.— « Floro : un retore storico e poeta », ANRW II.34.1 (1993) 80-117.— « Fra storiografia e biografia : Floro e l’età regia », ACD 30 (1994) 223-230.— « Sulle epifanie dei Dioscuri », Patavium 3 (1995) 91-100.— La storia epitomata. Introduzione a Floro (Rome 1996).G. Bizos, Flori historici, uel potius rhetoris, de vero nomine, aetate qua vixerit, et scriptis (Paris 1876).D. Briquel, « La formation du corps de Rome : Florus et la question de l’asylum », ACD 30 (1994) 209-222.F. Cupaiuolo, « Caso, fato e fortuna nel pensiero di alcuni storici latini : spunti e appunti », BStudLat 14 (1984) 3-38.P. Erdkamp, « Valerius Antias and Livy’s Casualty Reports », in C. Deroux (éd.), Studies in Latin Literature and Roman History. XIII (Bruxelles 2006) 166-182.Cl. Facchini Tosi, Il proemio di Floro. La struttura concettuale e formale (Bologne 1990).— Anneo Floro. Storia di Roma. La prima e la seconda età (Bologne 1998).— « Natura e guerra in Floro », Aufidus 18 (2004) 71-95.E. Fränkel, « Eine Form römischer Kriegsbulletins », Eranos 54 (1956) 189-194.F. Giordano, « Interferenze adrianee in Floro », Koinonia 12 (1988) 115-128.M. Hose, Erneuerung der Vergangenheit. Die Historiker im Imperium Romanum von Florus bis Cassius Dio (Stuttgart-Leipzig 1994).O. Jahn (éd.), Iuli Flori Epitomae de Tito Livio Bellorum omnium DCC libri duo (Leipzig 1852).P. Jal (éd.), Florus. Œuvres. Tome I (Paris 1967).— c. r. de Bessone (1996), dans Latomus 58 (1999) 901-903.A. Klotz, « Der zweite punische Krieg bei Florus », RhM 89 (1940) 114-127.G. Lemcke, Die Varusschlacht. Eine Quellenuntersuchung zum Bericht des Florus (Hambourg 1936).O. Leuze, « Die Darstellung des I. punischen Krieg bei Florus », Philologus 70 (1911) 549-560.P. Lévêque, Pyrrhos (Paris 1957).A. Macé, Essai sur Suétone (Paris 1900).E. Malcovati, « Studi su Floro, I », Athenaeum 15 (1937) 69-94.P. Monceaux, Essai sur la littérature latine d’Afrique : les Païens (Paris 1894).H. G. Plathner, Die Schlachtschilderungen bei Livius (diss. Breslau 1933).J. Reber, Das Geschichtswerk des Florus (Freising 1865).O. Rossbach, « Florus », RE VI.2 (1909) col. 2761-2770.E. Salomone Gaggero (comm.), Floro. Epitome di storia romana (Milan 1981).R. Sieger, « Der Stil des Historikers Florus », WS 51 (1934) 94-108.B. Veneroni, « Quatenus, qua ratione res politicas et sociales Florus tractaverit », Aevum 48 (1974) 345-348.P. Zancan, Floro e Livio (Padoue 1942).
© P
ress
es u
nive
rsita
ires
de F
ranc
he-C
omté
| T
éléc
harg
é le
21/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses universitaires de F
ranche-Com
té | Téléchargé le 21/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)