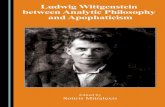"Neuostiranisch", in "Handbuch Iranistik" (herausg. Ludwig Paul / Reichert, Wiesbaden)
Une phénoménologie dans l'oeuvre de Ludwig Wittgenstein
Transcript of Une phénoménologie dans l'oeuvre de Ludwig Wittgenstein
Institut Catholique de Paris
Faculté de Philosophie
Une phénoménologie dans l'œuvre de Ludwig
Wittgenstein
Archibald Pearson
Dicimus haec et audimus haec et intellegimur et intellegimus. Manifestissima et
usitatissima sunt, et eadem rursus nimis latent, et nova est inventio eorum.
Nous parlons et on nous parle tous les jours ainsi; nous comprenons et sommes compris.
Rien de plus clair et de plus usité; rien en même temps de plus caché; rien, jusqu’ici, de
plus impénétrable.
Saint Augustin, Confessions,
XI, 22, 28
3
Introduction
Compte tenu du clivage non négligeable entre le courant
analytique et celui dit continental, le rapprochement de Ludwig
Wittgenstein et de la phénoménologie semble pour le moins
surprenant.
Cependant, ce n’est pas un rapprochement d’une originalité
particulière, ayant été traité de manière assez régulière par
certains universitaires, en particulier outre-Atlantique. Leurs
réflexions tournent pour la plupart autour des occurrences du
terme « phénoménologie » et de ses dérivés, notamment dans les
Remarques Philosophiques de Wittgenstein, et il est indéniable que
l’usage écrit de ce terme par ce dernier exige un examen
approfondi.
Le déclencheur du présent essai fut l’étude, pour une séance de
travaux dirigés, des propositions 4 et suivantes du Tractatus Logico-
Philosophicus1, tandis que les jours précédents avaient été l’occasion
de premiers cours sur la phénoménologie allemande. Le sentiment
d’une similarité que je ne savais m’expliquer m’appela à chercher
plus loin que cette simple intuition, me faisant ainsi découvrir
que je n’étais pas le premier à l’avoir soupçonnée, et que le
débat était déjà bien ouvert.
La philosophie de Ludwig Wittgenstein tourne en grande partie,
sinon entièrement, autour de la question de ce que l'on peut
sensément dire, « what it makes sense to say », comme le rend plus
justement le titre anglais d'un article de Robert Alva Noë2.
1 Dorénavant noté TLP, ainsi que semble le permettre l’usage.2 Robert Alva Noë, « Wittgenstein, Phenomenology and what it makes sense to
say », in Philosophy and Phenomenological Research, vol. 54, No. 1 (March 1994)4
La possibilité ou l'impossibilité du sens est donc un élément
fondamental de la pensée de Wittgenstein, élément traité à travers
toute son œuvre.
Selon mon approche, la phénoménologie wittgensteinienne doit
déterminer ce qui est possible et impossible en termes de sens. Ou
plutôt, elle est la discipline qui recense les occurrences de
relations sensées entre signes et signifiés. C’est ainsi qu’elle
permet d’apprendre à connaître le langage et à éviter son
utilisation erronée. D’où nécessairement un premier temps qui sera
consacré à la Phänomenologie. Cette entreprise a pris deux formes
majeures dans l’œuvre de Wittgenstein, à savoir d’une part la
grammaire, qu’il identifie à la phénoménologie dans le Big Typescript3,
identification qui est le nerf de guerre de la plupart des
commentateurs sur ce sujet, et d’autre part, à mon sens, la
logique, thèse soutenue notamment avec grand entrain par Merril et
Jaakko Hintikka.
Le TLP met en place une première approche de la théorie de la
signification, dont la clé est la faculté de représentation de la
proposition et l'exercice de cette faculté la condition de
possibilité du sens. Dans les Recherches Philosophiques, Wittgenstein
élabore une théorie plus flexible du sens, notamment grâce à ce
qu'il repère et appelle jeux de langage, cadres d'utilisation du
langage adaptés à toute sorte d'activité humaine ou de contexte de
pratiques sociales. La tâche des Recherches est encore de chercher
l'essence du langage, mais pas dans le sens de la détermination
d'un « état d'exactitude parfaite4».
3 « Phänomenologie ist Grammatik », titre du §94 du Big Typescript, TS 213, Blackwell
Publishing, p. 3204 G.G. Granger, « Langage, Logique, Pensée », in Visages de Wittgenstein, dir. Renée
Quilliot-Bouveresse, Beauchesne éditeur p. 1745
Pourquoi une telle obsession ? Parce que « nous sommes en lutte
avec la langue »5, nous nous interrogeons sur le rapport entre le
signe et le signifié :
Le point obscur se trouve manifestement dans la question : en quoi
consiste proprement l’identité logique du signe et du signifié ?
Et cette question est (une fois de plus) un aspect majeur du problème
philosophique dans son ensemble.6
Nous constatons que le projet est annoncé très tôt. Comment rendre
compte de cette relation de signification ? C'est ce que l'analyse
phénoménologique veut faire : montrer pourquoi il y a de la
signification dans l' « attitude naïve ».
Concrètement, selon le début du §94 du Big Typescript, la
phénoménologie comme analyse de la relation entre le signe et le
signifié passe par le repérage des règles de grammaire en vigueur
dans les différents cas (et les fameux jeux de langage sont une
schématisation des différents types de cas, chacun sous un “mode”
grammatical différent), et il nous faudra donc voir dans un
deuxième temps ce qu’est cette Grammatik. Mais antérieurement aux
élaborations explicites sur la phénoménologie, c’est mon opinion
qu’eu égard au Wittgenstein du TLP et des années environnantes, la
logique peut être dite phénoménologie, parce qu’elle tente
d’arriver à un discours exact sur le monde, et que la réflexion
qu’elle engendre sur la forme logique n’est autre qu’une recherche
de ce qui fait que les états de choses sont possibles et sensé. Le
troisième temps de cet essai sera par conséquent consacré à la
5 Ludwig Wittgenstein, Remarques mêlées, GF Flammarion, 2002, p. 656 Ludwig Wittgenstein, Carnets 1914 – 1916, en date du 3.9.14, Tel Gallimard, p.
256
Logik.
Ce qui importe est la possibilité des phénomènes ou des faits, et
nous sommes amenés à réaliser que l’étude de cette possibilité
passe par des considérations grammaticales, ou, plus tôt dans
l’œuvre de Wittgenstein, par la logique. C’est en ce sens que le
propos est ici de dire que la phénoménologie est grammaire, et
plus encore qu’elle est logique.
7
1. Phänomenologie ist…
The investigation of the rules of the use of our language, the recognition of these rules,
and their clearly surveyable representation amounts to, i.e. accomplishes the same
thing as, what one often wants to achieve in constructing a phenomenological
language.7
1.1 De la possibilité de la phénoménalité
Le phénomène de la phénoménologie a à voir avec la phénoménalité.
Le phénomène de la phénoménologie de Wittgenstein aurait plutôt à
voir avec la possibilité de phénoménalité :
Notre recherche cependant n'est pas dirigée sur les
phénomènes, mais, pourrait-on dire, sur les “possibilités” de
phénomènes. Ce qui veut dire que nous nous remettons en mémoire le
type d'énoncés que nous formulons sur les phénomènes.8
Pour le développement de ce propos, il est nécessaire de revenir
sur ce que l’on veut entendre par « phénomène ». Dans le cas
présent, les définitions de la phénoménologie orthodoxe ne sont
pas exactement adaptées. Cependant, elles ne sont pas
antinomiques, elles semblent seulement un peu précipitées. Il
s’agit pour nous ici de surtout mettre l’accent sur une définition
du phénomène comme chose possible, car un enjeu de la
phénoménologie de Wittgenstein – telle qu’elle est réfléchie dans
7 Ludwig Wittgenstein, Big Typescript, TS 213, §94, p. 320e8 Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, §90, NRF Gallimard 2004, p. 78
8
le présent essai – est de déterminer quelles sont les possibilités
de phénomènes, dans quel cas il est possible qu’il y ait phénomène
et, à plus forte raison, sens. Or, le sens de l’expérience est
précisément ce que la phénoménologie étudie, mais il y a lieu de
s’interroger sur l’attention qu’elle prête aux conditions de
possibilité de ce travail qu’elle entreprend.
Que ce soit pour la phénoménologie allemande ou française, au
moment d’éviter de tomber dans le subjectivisme le plus complet,
ce qui est invoqué est la communauté du sens, c’est-à-dire
l’existence d’un réseau de significations que, loin de l’inventer,
chacun de nous découvre dans le monde. Cela est très bien, mais
qu’en est-il de ce réseau de signification ? Plus encore, qu’est-
ce que cette communauté de sens ? Wittgenstein peut nous éclairer
sur ce sujet, notamment en pointant l’universalité de la logique.
Nous voyons transparaître ce qui est au cœur réel de la
phénoménologie de Wittgenstein, à savoir la relation du signe et
du signifié, condition de possibilité même de tout sens et de tout
phénomène.
C’est donc une phénoménologie attentive à la manipulation des
signes qui doit être déployée, et même, c’est la manipulation
correcte des signes qui est l’enjeu de la phénoménologie
wittgensteinienne, et du projet wittgensteinien dans son ensemble,
à vrai dire. Dès les années 1914 – 1916, on trouve la trace de
l’exigence d’un langage « qui n’exprimât que ce que nous savons
effectivement, à savoir les phénomènes »9, exigence qui
s’accompagne du primat de la description, laquelle doit se
cantonner à l’investigation logique des phénomènes, et pour ce
faire rester dans la forme la plus simple, la plus laconique : la
9 Brian McGuiness (ed.), Wittgenstein und der Wiener Kreis, p. 45, cité par Gérard
Guest, Wittgenstein et la question du livre, PUF 2003, note 3, p.719
remarque pure. « Mr. Wittgenstein makes remarks »10. C’est ce style, qui a
pu être qualifié d’aphoristique, qui est si caractéristique de
l’approche de Wittgenstein et qui est le reflet de l’entreprise à
laquelle il sert : l’élaboration fastidieuses de théories
totalisantes serait un contre-sens complet par rapport à
l’humilité préconisée pour le langage. Etant le médium universel11,
c’est-à-dire au-delà duquel il n’y a (évidemment) pas de discours,
le langage, système qu’on ne saurait voir d’en-dehors, ne peut
prétendre aller plus loin que lui même. Et la remarque a ceci
d’intéressant qu’elle ne fait que pointer, qu’elle ne fait que
montrer – et nous verrons plus loin l’importance de ce rôle – sans
prétendre expliquer. Car l’explication est plutôt le rôle de la
physique :
La physique se distingue de la phénoménologie en ce qu’elle veut
établir des lois. La phénoménologie n’établit que des
possibilités.12
Cette phénoménologie traite donc de ce qui est possible et sa
fonction est, nous le verrons, grammaticale, c'est-à-dire qu'elle
régit d’abord la description. Cette phénoménologie ne traite pas
directement des phénomènes mais plutôt des conditions de
description.
Alors certes, une phénoménologie qui vise à décrire les vécus de
l'expérience n'a rien de particulièrement révolutionnaire et est
10 Frank P. Ramsey, Review of Ludwig Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus, in Mind, New Series, Vol. 32, No. 128 (Oct., 1923), p. 478
11 Pour un exposé plus complet du « médium universel, cf. Merill et Jaakko
Hintikka, Investigations sur Wittgenstein, ch. 1, Mardaga, Liège, 198612 Ludwig Wittgenstein, Remarques philosophiques, Recension des matières, I, §1,
TEL Gallimard 2011, p. 1310
d'ailleurs plutôt « orthodoxe » eu égard à la tradition
phénoménologique. En revanche, l'idée d'une phénoménologie qui se
porte sur les conditions de possibilité de la description est
moins banale.
La phénoménologie de Wittgenstein porte sur les limites du
possible, et la phénoménalité n’y pourrait être dite, mais
uniquement montrée depuis l’intérieur des limites du langage.
Et d’ailleurs, ce qu’est proprement « dire » ne saurait jamais
être dit. Il est tout au plus permis de donner à entendre (ou à
voir), sous forme de remarque, que cela ne se montre justement
jamais que parce que nous sommes dans l’impossibilité de dire :
La limite du langage se montre dans l’impossibilité de décrire
le fait qui correspond à une proposition (qui est sa traduction)
sans, justement, répéter la proposition.
(Nous avons ici affaire à la solution kantienne du problème de
la philosophie.)13
Donc un premier aspect de la phénoménologie que nous pouvons
dégager est d’ordre méthodologique et tire au clair qu’il y a des
limites à ce que nous pourrons dire, imposant par la même le choix
de la description pure, et toute explication, tout passage “en
coulisses” sont proscrits, puisqu’inconcevables.
Et c’est une fois la méthode posée que nous voyons comment elle va
s’appliquer, à savoir par le travail de monstration des
possibilités du langage, qui sont en l’occurrence aussi les
limites des possibilités du monde. On pourrait dire que la somme
des possibilités d’occurrences sensées d’un signe est égale à la
somme des possibilités d’occurrences de son signifié : « Une fois 13 Remarques mêlées, p. 63
11
que tu sais ce que le mot désigne, tu le comprends, tu connais
entièrement son application. »14. Ce passage des Recherches
philosophiques souligne bien le lien étroit entre le signe et le
signifié, ce qui n’est pas sans rappeler l’isomorphisme du monde
et du langage qui est une des thèses centrales du TLP, mais qui se
trouve ailleurs également : « L’essence du langage, elle, est une
image de l’essence du monde »15.
Maintenant que ce lien indéfectible est bien établi, le passage
des possibilités de descriptions aux possibilités de phénomènes
est aisé, et on comprend mieux pourquoi la compréhension des
possibilités d’occurrences d’un signe donne en même temps la
compréhension des possibilités d’occurrences de ce qu’il signifie.
Nous sommes ici au centre de la justification de la primauté d’une
phénoménologie du langage, dans la mesure où tout discours portant
sur le monde respecte une logique bien précise, à savoir celle du
monde, qui est (identique à) celle du langage. Afin de dire quoi
que ce soit de sensé, il faut avant tout établir quand c’est
possible, et comment c’est possible. En l’occurrence, c’est
possible quand le rapport entre le signe et le signifié a du sens,
et cela, nous ne pouvons que le montrer.
1.2 Montrer l’indicible
Le premier paragraphe des Remarques philosophiques est pour le moins
explicite en ce qui concerne la thématique de la limite. Il s’agit
de délimiter ce qui est essentiel et inessentiel dans le langage
par la monstration dans sa fonctionnalité, dans son application,
14 Recherches philosophiques, §264, p. 14215 Remarques philosophiques, V, §54, p. 83
12
de ce qui est essentiel au langage.
« Qu'est-ce que le sens ? » (…). Nous sentons que nous ne
pouvons rien montrer en réponse, et que pourtant nous devrions
montrer quelque chose.16
L’ineffable différence entre dire et montrer est là où se situe la
limite que le travail phénoménologique de Wittgenstein cherche à
baliser, établissant ainsi ce qui se laisse décrire, et ce qu’on
ne peut qu’indiquer en silence. Et la relation entre un signe et
un signifié, c’est-à-dire le sens, fait partie de ces choses qu’on
ne peut que montrer, jamais saisir pleinement, mettre à plat et
disséquer. Au mieux, et c’est le but des remarques, peut-on
signaler et inventorier les occurrences du sens, constituant ainsi
un grand registre, image que Wittgenstein utilise par ailleurs.
« Puisse Dieu donner au philosophe la faculté de pénétrer ce
que tout le monde a sous les yeux »17.Le commencement de toute
considération philosophique est justement « ce que tout le monde a
sous les yeux », alors qu’elle cherche constamment à dépasser les
apparences au nom d’une hypothétique profondeur. Mais c’est ce que
Wittgenstein s’efforce à nous rappeler : toute velléité de
dépassement est vaine, car nous ne pouvons nous aventurer plus
loin, bien que cela soit reconnu comme difficile de « voir ce que
j'ai sous les yeux ! »18 et de « ne pas chercher à aller plus loin en
arrière ».19
On retrouve cette exigence de ne pas outrepasser nos capacités,
16 Ludwig Wittgenstein, Le Cahier bleu et le Cahier brun, TEL Gallimard 2004, p. 3517 Remarques mêlées, p. 13118 Remarques mêlées, p. 10019 Ludwig Wittgenstein, De la certitude, §471, NRF Gallimard 2006
13
d’en rester à ce que l’on sait, c’est-à-dire à la description pure
qui exprime humblement les phénomènes.
Mais alors, comment la description rend-elle compte du phénomène ?
Cela revient à demander comment la phrase fait pour représenter.
Et en effet, Wittgenstein imagine cette question, à laquelle il
répond : « Ne le sais-tu donc réellement pas ? Tu le vois bien
quand tu l’emploies. »20
La tâche de la philosophie est de nous rappeler à ce qui est le
plus évident, le plus clair, mais surtout, elle est de permettre in
fine une vue synoptique sur le langage. C’est-à-dire que là où il
serait absurde de tenir un véritable registre dans lequel seraient
notés tous les “coups” joués dans les jeux de langage, la vue
synoptique nous permettrait une saisie complète de ce qui régit le
langage, apportant une réponse définitive à la question « qu’est-
ce que la proposition ? ». Cette réponse serait totale et
porterait en elle l’essence du langage.
Ce que Wittgenstein appelle le « concept général de la
signification » vient complètement brouiller notre accès au
fonctionnement du langage, de manière analogue au déguisement de
la pensée par la parole dans le TLP. Mais c’est précisément la
tâche de la phénoménologie de recouvrer la vue synoptique qui nous
révèlera ce fonctionnement, qui résoudra l’énigme du sens.
Mais il semblerait que nous exigions de la phénoménologie
qu’elle nous révèle ce qui justement ne se donne pas, ce qui est
proprement inapparent, donc même pas sujet à monstration.
Peut-être est-ce dans le reflexe d’une quête de profondeur que le
regard philosophique dépasse sans le voir ce qui est le plus
manifeste, le laissant comme en retrait. Nous pensons ici à cette 20 Recherches philosophiques, §435, p. 186
14
phénoménologie de l’inapparent évoquée tardivement par Heidegger,
mais qui était déjà en germe au moment où il définit le phénomène
en un sens éminent : « quelque chose qui d’emblée et le plus
souvent ne se montre pas ». C’est dans ce même passage du §7 d’Etre
et Temps que nous retrouvons un autre propos tout à fait familier :
« Derrière » les phénomènes de la phénoménologie il n’y a
essentiellement rien d’autre, mais ce qui doit devenir phénomène
peut très bien être en retrait. Et c’est précisément parce que
les phénomènes, de prime abord et le plus souvent, ne sont pas
donnés qu’il est besoin de phénoménologie.21
Il faudrait donc pour nous que les phénomènes wittgensteiniens –
c’est-à-dire la grammaire, les règles de nos jeux de langages et
de nos formes de vie, ou en ce qui concerne le TLP, la logique –
aient les mêmes caractéristiques. Or, l’argument contre le langage
privé, ou l’universalité de la logique, sont autant d’éléments
pour soutenir ce rapprochement et défendre l’idée qu’à défaut
d’une méta-logique ou d’un méta-langage, nous sommes contraints à
ne faire que montrer.
Wittgenstein tient sans doute un peu de ses lectures de Goethe,
pour qui les phénomènes sont eux-mêmes la doctrine et derrière
lesquels il ne sert à rien de chercher quoi que ce soit. Tenter de
passer derrière les phénomènes, c’est l’erreur dont parle le §654
des Recherches philosophiques, celle de chercher à expliquer.
L’investigation logique des phénomènes, c’est l’investigation
grammaticale de ce qui est le plus manifeste, de ce qui est le
filigrane de notre langage, et qui en passe donc tout aussi
21 Martin Heidegger, Etre et Temps, édition hors commerce Authentica 1985, trad.
Emmanuel Martineau, p. 4815
2. Grammatik
2.1 Les règles grammaticales du possible
Comme nous l’avons souligné en introduction, la forme “officielle”
de la phénoménologie de Wittgenstein est l’approche grammaticale.
C’est-à-dire que c’est l’établissement de règles de grammaire qui
est visé à travers l’analyse du langage.
Nos considérations sont donc grammaticales. Et elles élucident
notre problème en écartant des mécompréhensions relatives à
l'usage des mots provoquées notamment par certaines analogies
entre les formes d'expression qui ont cours dans différents
domaines de notre langage. – Certaines peuvent être écartées en
remplaçant une forme d'expression par une autre ; et ce
processus étant parfois analogue à une décomposition, on peut
parler d'une “analyse” de nos formes d'expression.22
« Je n’ai jamais le contre-ut dans mon champ visuel. »23 Ce genre
de proposition est une règle de grammaire destinée à proscrire
tout non-sens. Le but de l’analyse du langage est d’établir, ou
plutôt de découvrir une grammaire, par la description des
phénomènes. Or ces phénomènes sont les règles de grammaire en
vigueur dans nos différents jeux de langage. Pour chaque jeu de
langage, il y a des règles grammaticales propres, et les remarques
grammaticales visent à en donner des exemples, à les suggérer, à
défaut de pouvoir les cristalliser. Mais à force de remarques, la
22 Recherches philosophiques, §90, p. 7823 Remarques philosophiques, §213, p. 253
17
vue synoptique doit s’offrir à nous progressivement jusqu’à la
compréhension totale des possibilités de composition. Le sens
d’une proposition est déterminé par le système grammatical qui
régit ses relations avec d’autres propositions, et la grammaire
d’un langage est la somme des règles qui définissent ce qui a du
sens.
Tu ne saurais entendre Dieu s’adresser à quelqu’un d’autre, à
moins que tu ne sois celui à qui il parle. (Cela est une
remarque grammaticale.)24
La phénoménologie de Wittgenstein prend la forme d’une grammaire
philosophique dont le but est la description et la présentation
englobante des règles tacites de nos formes de vie et des jeux de
langage qui les accompagnent. En ce sens, la grammaire est une
forme de réduction, analogue à celle opérée dans le TLP :
l’objectif est de montrer la trame secrète du monde à travers
celle du langage, mais en restant dans ce geste de monstration, le
langage n’étant pas capable de dire ce qui est du ressort de
l’essence du monde :
Car ce qui appartient à l’essence du monde, le langage ne peut
l’exprimer. (…)
Et la philosophie, si elle pouvait dire quelque chose, aurait à
décrire l’essence du monde. (…)
L’essence du langage, elle, est une image de l’essence du
monde ; et la philosophie, en tant que gérante de la grammaire,
peut effectivement saisir l’essence du monde, non sans doute
dans des propositions du langage, mais dans des règles de ce 24 Ludwig Wittgenstein, Zettel, §717 (référence précise manquante)
18
langage qui excluent les combinaisons de signes faisant non-
sens.25
Nous avons déterminé que les caractéristiques de la phénoménologie
de Wittgenstein étaient qu’elle traitait de la possibilité de la
phénoménalité et qu’elle recensait les occurrences du sens en se
cantonnant à la laconique remarque grammaticale. A travers ce
processus, c’est non seulement l’essence du langage qui doit se
rendre manifeste à nous mais bien aussi l’essence du monde. En
comprenant quelles sont les possibilités de compositions
grammaticales dans le langage, nous saurons ne même temps quelles
sont les possibilités qui s’offrent aux choses du monde. Les
règles grammaticales sont révélées à et relevées par nous à mesure
que nous avançons dans notre maniement de la langue, ce qui pose
évidemment la question de l’apprentissage, question à laquelle
nous arriverons plus tard. Toujours est-il que pour tout
phénomène, il y a un set of rules applicables selon la forme de vie et
le jeu de langage en cours. Mais ce n’est pas simplement de la
littérature, c’est bel et bien de l’essence qu’il s’agit. Notre
accès à l’essence des choses se fait par la grammaire : « L’essence
est exprimée dans la grammaire. »26
On clarifie ce qu'est une chose en donnant les cas dans lesquels
on utilise cette chose.
La structure apparent de la réalité n'est rien d'autre que l'ombre
de la grammaire, laquelle constitue notre forme de la
représentation. Cela dit, ce n’est pas la grammaire qui se règle
sur les choses, mais bien plutôt les objets qui se règlent sur la
grammaire de nos jeux de langage et des formes de vie :
25 Remarques philosophiques, §54, pp. 82 – 8326 Recherches philosophiques, §371, p. 170
19
Quelle sorte d’objet est quelque chose, c’est la grammaire qui
le dit (la théologie comme grammaire).27
Nous retrouverons exactement le même genre d’idée dans le TLP :
Non pas : « le signe complexe aRb dit que a est dans la relation
R avec b, mais bien : que « a » soit dans une relation
déterminée avec « b » dit que aRb.28
Pour en revenir à ce que Wittgenstein dit sur la grammaire, et qui
est par ailleurs aussi valable pour la logique dans le TLP, une
certaine valeur transcendantale en est difficilement contestable.
C’est à dire que tout ce qui se donne à nous, tout ce que nous
comprenons, et tout ce qui se produit le fait selon des règles
grammaticales précises dont c’est notre tâche de philosophes de
les (faire) respecter. Seulement, là où Kant prenait l’espace et
le temps comme concepts limitants et indépassables, Wittgenstein
nous offre la possibilité de découvrir de nouvelles règles pour
chaque découverte de forme de vie. C’est alors qu’intervient la
question de l’apprentissage des règles du possible.
Les règles ne pré-existent pas dans un quelconque vide. Elles
se révèlent par à-coups, à mesure, en ce qui concerne la forme
logique, que l'on fait des propositions, à mesure que l'on
participe à différentes activités humaines et jeux de langage.
Quand Wittgenstein parle des registres de commerce du langage,
27 Recherches philosophiques, §373, p. 17128 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 3.1432, TEL Gallimard 2010, p.
4320
c'est exactement ça : chaque phrase est comme une transaction, et
toutes ces transactions forment le commerce, mais on ne peut pas
expliciter celui-ci, il est l'apparent inapparent, l'évidemment-
caché : on ne peut pas figurer la forme logique29, on ne peut
figurer le commerce (c'est une activité !). On ne peut que
l'indiquer.
La compréhension d’une langue étrangère est un bon exemple :
admettons qu’il n’existe entre deux langues aucune traduction
connue, aucun interprète, soit, aucune communication langagière.
Il serait tentant de dire : aucune concordance logique ; comment
alors envisager d’initier un lien ? Par l’examen des manières
d’agir, par une phénoménologie inversée, exercice virtuellement
fascinant, qui commencerait par l’observation des pratiques pour y
rattacher du langage. Les pratiques humaines, les formes de vie,
sont des signes au même titre que les propositions. In fine, serait
découvert qu’une seule et même logique architectonique régissait
les deux langues, pour reprendre la thèse de l’universalité de la
logique. Et en ce qui concerne l’apprentissage des règles, celui-
ci présuppose une communauté logique des hommes, dans laquelle
l’initiation à des pratiques nouvelles et des sens nouveaux est
possible en vertu du partage de la “même phénoménologie”, c’est-à-
dire de la même faculté d’analyse du rapport entre signe et
signifié :
Pour qu'il y ait compréhension mutuelle au moyen du langage, il
faut qu'il y ait non seulement accord sur les définitions, mais
encore (si étrange que cela puisse paraître) accord sur les
jugements. Cela semble abolir la logique mais il n'en est rien.
– C'est une chose de décrire une méthode de mesure, et c'en est 29 TLP, 4.121, p. 58
21
une autre de trouver et de formuler les résultats d'une mesure.
Mais ce que nous nommons “mesurer” est également déterminé par
une certaine constance dans le résultat des mesures.30
Il me semble qu’il faut mentionner une proposition du TLP, qui va
dans le sens d’un aspect important de la phénoménologie orthodoxe,
tout en évoquant la fin de la précédente citation : « Dans la
proposition, les éléments sont rassemblés à titre d'essai. »31
Nous avons ici la notion chère à Husserl du renouvellement
constant, de la constante correction des descriptions de
phénomènes. Pour le fondateur de la phénoménologie, il s’agit de
s’approcher le plus possible de la description du vécu pur, quitte
à recommencer encore et encore, de ne formuler que des essais de
descriptions avant d’envisager de saisir l’essence. Le rapport
avec la précédente citation se fait sur ce même plan. Quand
Wittgenstein dit que c’est à force de mesurer que nous savons ce
que c’est, nous sommes tout proches de la constance husserlienne.
Cet aparté a pour but de faire un rapprochement très concret et
textuel des deux courants qu’il s’agit d’associer dans le présent
essai, et semble justifié dans la mesure où sur ce point, deux
attitudes très similaires sont synthétisées : la patience, la
répétition scrupuleuse des tentatives sont communes à Wittgenstein
et Husserl, tout deux à la poursuite de l’essence du monde, et
tout deux ayant visiblement compris que c’est dans la répétition
que peut se dévoiler la constance, que tôt ou tard, le divers nous
achemine jusqu’à l’essentiel.
L’apprentissage des règles de grammaire doit à un moment basculer
dans l’Übersicht, la répétition des expériences nous ouvre
30 Recherches philosophiques, §242, p. 13531 TLP, 4.031, p. 54
22
soudainement à l’essence du phénomène. Il est difficile d’accepter
qu’un gouffre théorique et scolaire sépare deux pensées si
proches.
2.2 Les jeux de langage
Les jeux de langage interviennent dans les Recherches
philosophiques et sont une manière de schématiser ce que la
considération grammaticale cherche à expliciter : selon que l’on
se trouve dans telle ou telle situation, dans une quelconque forme
d’activité humaine pendant laquelle intervient le discours, la
façon de signifier de nos propositions va varier. Ce qui se
produit est une variation grammaticale. C’est-à-dire qu’en
découvrant un nouveau de langage qui nous était jusqu’alors
inconnu, nous découvrons tout un nouveau “mode” grammatical dans
lequel nous pouvons formuler certaines propositions qui ailleurs
seraient insensées, parce que l’architecture grammaticale
n’autoriserait pas une telle composition ; elle serait insensée,
impossible.
En somme, les faits ultimes, les Urphänomene auxquels il s’agit de
reconduire en dernière instance, la description des états de
choses du monde, ce seront toujours en fin de compte les règles,
conventions et accords tacites, implicites à la pratique des jeux
de langage et autres jeux grammaticaux, et silencieusement en
vigueur dans le jeu de langage auquel elles appartiennent.
Notre faute est de chercher une explication là où nous
devrions voir les faits comme les « phénomènes originaires » ;
en d'autres termes, là où nous devrions dire que tel jeu de
23
langage se joue.32
Il ne s'agit pas d'expliquer un jeu de langage par nos
expériences vécues, mais de constater un jeu de langage.33
L’essence du monde est reflétée, nous l’avons dit, dans la
grammaire des jeux de langage, et celle-ci est atteinte lors de
l’opération d’une sorte de réduction grammaticale, opération qui
passe par la forme de la remarque pure, de la considération
grammaticale, qui, répétons-le, fonctionne toujours par
exemplarité. Cette réduction grammaticale permet le même genre de
résultat que le TLP, à savoir qu’au moment où l’on croyait
définitivement impossible l’explicitation de la forme logique, il
se trouvait qu’elle s’y reflétait discrètement, dans le filigrane,
et ne pouvait être que montrée.
La phénoménologie de Wittgenstein prend donc la forme de
considérations grammaticales plutôt que la forme d’une science
rigoureuse, et il affirme même l’abandon du projet d’un langage
phénoménologique, qu’il ne tient « plus maintenant pour
indispensable »34. Ce que nous pouvons entendre par cet abandon, ce
serait le renoncement à la thématisation de la forme logique, au
profit de l’élucidation de la grammaire de la proposition. Ce
serait ce point de vue grammatical synoptique qui serait
préférable à l’effort jusqu’alors vain d’arriver aux faits
atomiques du monde. Le mode de considération grammatical s’en
tient à notre langage, avec pour but de distinguer ce qui y est
32 Recherches philosophiques, §654, p. 23533 Recherches philosophiques, §655, p. 23534 Remarques philosophiques, I, §1, p. 51
24
essentiel et ce qui y est inessentiel.
La présentation synoptique, qui est la précisément la monstration
dont nous parlions plus haut, est atteinte par la considération
grammaticale, et la fonction de la grammaire reprend la tâche de
la logique du TLP, à savoir travailler à montrer de façon
synoptique ce qui est essentiel au monde et que le langage ne peut
exprimer. Le monde et sa forme logique sont au centre de la
phénoménologie du TLP.
Le passage à la Logik dans notre recherche d’une phénoménologie
wittgensteinienne peut désormais se faire, mais avec un rappel des
critères choisis : il s’agit de déterminer la possibilité ou
l’impossibilité du sens, et ce par la considération des règles et
accords tacites qui régissent le langage. Ces règles,
« manifestissima et usitatissima »35, nous restent pourtant si
impénétrables. Autant dans les Recherches philosophiques, « il n’y a
rien de dissimulé »36, mais dans le TLP, « le langage déguise la
pensée »37.
35 Saint Augustin, Confessiones, XI, 22, 28, source Internet :
www.thelatinlibrary.com36 Recherches philosophiques, §435, p. 18637 TLP, 4.002, p. 50
25
3. Logik
All meaningful phenomenological problems are really, according
to Wittgenstein, logical problems ; that is to say, they are not
to be solved by appeal to experience of any kind – whether it be
direct (“phenomenological”) or indirect (“experimental”) (…).
The trouble with [Husserlian] “phenomenology” is that it gives
the wrong directions for disclosing essence... : It points to
objects rather than to techniques of use.38
3.1 La forme logique
L’orientation du TLP est explicitée dans l’avant-propos de
l’auteur, où Wittgenstein affirme son ambition radicale de mettre
un terme aux confusions qui naissent dans la philosophie du fait
du mauvais maniement des signes. Ce mauvais maniement est
directement causé par la méconnaissance, ou la mécompréhension des
conventions tacites de la langue usuelle, du fait de la complexité
de ces conventions. Etant donnée sa capacité de construire des
langues, l’homme peut potentiellement exprimer tout sens, mais le
risque de non-sens est considérablement augmenté par cette
mécompréhension des règles à respecter. Et ce qui est d’autant
plus problématique, du point de vue du TLP, c’est que l’accès à
ces règles est rendu très difficile par le déguisement de la
pensée par la langue. Donc ici nous avons vraiment à découvrir, à
travers l’analyse logique, les règles qui sous-tendent l’emploi de
38 William Brenner, « Wittgenstein's Color-Grammar », Southern Journal of Philosophy 20
(Fall, 1982) 298 n. 3, pp. 290-29126
la langue, tandis que la considération grammaticale était
nettement plus aisée, fonctionnant comme exemple dans lequel on
pouvait saisir toute une partie de la grammaire. Dans le TLP, le
travail est vraiment celui de la décomposition, avec une approche
beaucoup plus radicale : il ne s’agit pas de déterminer ce qui
essentiel ou inessentiel, mais sèchement ce qui est sensé et ce
qui ne l’est pas.
Or, ce qui détermine les possibilités de sens dans le TLP, c’est
la forme logique. Et plus encore : « La possibilité de son
occurrence dans des états de choses est la forme de l’objet. »39
Ce n’est pas seulement le langage qui est concerné par la forme
logique, mais bien, du fait de l’isomorphisme entre langage et
monde, les choses elles-mêmes.
La composition des propositions et les états de choses suivent la
même logique : pour les propositions, c’est la syntaxe logique qui
doit être respectée, et pour les choses, c’est seulement des
assemblages autorisés par leurs formes logiques qui peuvent avoir
lieu.
En atteignant une connaissance rigoureuse de la logique, nous nous
trouverons au point de vue synoptique tant espéré, avec un accès
complet à toutes les possibilités, car ne perdons pas de vue que
c’est bien là l’enjeu !
Or le Tractatus, peu réputé pour son éloquence, est plus que généreux
sur le sujet de la possibilité :
Quelque chose de logique ne peut être seulement possible. La
logique traite de chaque possibilité, et toutes les possibilités
sont ses faits.40
39 TLP, 2.0141, p. 3540 TLP, 20121, p. 35
27
Ce en quoi ceci nous intéresse dans notre recherche d’une
phénoménologie, c’est la définition de la logique comme système
total des possibilités, c’est-à-dire que ce qui peut avoir lieu
est logique, respectera des règles logiques et se donnera à nous
comme quelque chose de sensé. Nous pouvons faire le lien entre la
logique et la phénoménologie en disant que c’est une recherche
logique portant sur les phénomènes qui nous fera parvenir à une
analyse correcte de ce qui est sensé. Ce projet explicité dans
Some Remarks on Logical Form est clairement celui du TLP, à la
différence lexicale près que « état de choses » y est préféré à
« phénomène ».
En ce qui concerne la proposition, les règles de la syntaxe
logique sont ce qui détermine si un ensemble de signes a un sens,
ce sont les règles de l’emploi des signes, les règles de
composition propositionnelle. La syntaxe logique se comprend
d’elle-même, pour autant qu’on comprenne chacun des signes qui
sont assemblés selon elle.
Les règles de la syntaxe logique sont irréfutables, puisque rien
n’est possible en dehors d’elles. Il ne peut rien se produire qui
ne soit pas logique, et tout proposition contrevenant à ses règles
n’a aucun sens. La logique est transcendantale :
Non pas : « le signe complexe aRb dit que a est dans la relation
R avec b », mais bien : que « a » soit dans une relation
déterminée avec « b » dit que aRb.41
Nous l’avons déjà souligné, mais le fait que les choses se 41 TLP, 3.1432, p. 43
28
conforment à la logique et pas l’inverse fait de la logique
l’accès le plus parfait à toute chose, donc à toute phénoménalité.
L’échafaudage du monde est figuré par les propositions logiques,
en vertu de la fonction représentationnelle de la proposition,
mais en dernière instance, la forme logique est ce qui prime.
L’arrangement des choses dans le monde montre la forme logique. La
forme logique n’est pas lue dans le monde, elle est l’organisation
du monde. Ainsi la logique est transcendante, au sens kantien.
C’est à travers la connaissance de la syntaxe logique qu’est
possible la vue synoptique, l’Ubersicht de tous les possibles : « Si
nous connaissons la syntaxe logique d’un symbolisme quelconque,
alors nos sont déjà données toutes les propositions de la
logique. »42
En ce qui concerne l’objet, c’est le même procédé :
Si je connais l'objet, je connais aussi l'ensemble de ses
possibilités d'occurrence dans des états de choses.43
L’ensemble des possibilités d’occurrences est défini par la forme
logique de l’objet. Il est possible de se le représenter comme une
pièce de Lego : une pièce carrée tient sur quatre ergots, en
possède elle-même quatre, donc peut être utilisée de telle ou
telle façon en accord avec ses caractéristiques. Ici, la syntaxe
logique du Lego est plutôt élémentaire : une pièce est utilisée en
fonction de sa forme physique, sans grande place pour l’invention.
Mais dans la langue, il n’y a aucune limite physique, donc il est
42 TLP, 6.124, p. 10143 TLP, 2.0123, p. 34
29
nécessaire d’en déterminer une autre. L’objet a bien des
propriétés physiques lui aussi, comme le Lego, mais le langage
n’en a que faire, et les outrepasserait volontiers. C’est pour
cela que la connaissance nécessaire est celle des « propriétés
internes »44 qui déterminent ce que l’on peut sensément dire de
l’objet, et à plus forte raison, sans avoir à recourir à
l’expérience, ce qu’il est possible qu’il se produise avec cet
objet. Aucune surprise n’est alors possible. Sa forme logique est
un élément épistémologique qui conditionne le sens d'une chose. Un
phénomène a du sens s’il respecte une forme logique, c'est-à-dire
s’il est en règle.
Le lien entre le pensable et le possible, entre le sujet pensant
et le monde phénoménal, est forcément à examiner ici, et la
proposition 3.02 du TLP (« Ce qui est pensable est aussi
possible ») résonne avec un élément développé plus tard par
Wittgenstein, à savoir l'idée d'un langage privé, dans les
Recherches Philosophiques.
Wittgenstein a jusqu'ici bien établi comment la compréhension de
la phénoménalité tenait à la compréhension de ce qui était
possible dans le monde phénoménal.
Cependant, nous sommes en droit de nous demander comment établir
un lien entre ce monde et le sujet, ou plus exactement, comment
assurer la compatibilité du monde et du sujet.
« Nous ne pouvons rien penser d'illogique, parce que nous devrions
alors penser illogiquement. »45
Ce qui garantit l'intégration du sujet pensant dans le monde, et
surtout la possibilité pour lui d'y vivre, de la comprendre, c'est
44 TLP, 2.1231, p. 3545 TLP, 3.03, p. 41
30
la logique partagée. Ce qui régit le monde et ce qui régit la
pensée est la même logique, la seule logique, à laquelle même Dieu
n'échappe pas46.
La logique est en quelque sorte la géométrie du langage, elle
édicte les lois inviolables de la composition des propositions. En
effet, tout comme il est impossible de concevoir une figure
“géométrique” (entre guillemets, car elle ne serait justement pas
géométrique, elle ne serait pas du tout, même !) en dehors des lois
de l'espace, il est impossible d'envisager une proposition –
sensée, cela va sans dire – en dehors des lois de la logique.
Dans les Recherches Philosophiques, Wittgenstein développe l'idée selon
laquelle nous sommes fondamentalement “redevables” au monde pour
l'expression de toute subjectivité. C'est-à-dire que toute
expression (personnelle) repose sur des règles (impersonnelles).
Nous ne pouvons inventer une règle, nous ne pouvons inventer une
logique, nous sommes contraints par la logique à ne développer que
des langages pseudo-privés, dont la possibilité de les traduire
dans une langue connue est incontournable. C’est là encore un
trait du langage comme médium universel. Et à plus forte raison,
de la logique comme médium universel.
La logique est donc bel et bien fixée comme gérante des
possibilités de phénomènes, et c’est notre premier critère qui est
rempli. Mais il nous reste à découvrir pourquoi il y a sens, la
coordination d’un signe et d’un signifié, phénomène ultime.
Nous usons du signe sensible (sonore ou écrit, etc.) de la
proposition comme projection de la situation possible.
46 On a dit que Dieu pouvait tout créer, sauf seulement ce qui contredit aux
lois de la logique. (TLP, 3.031)31
La méthode de projection est la pensée du sens de la
proposition.47
La proposition est le lieu de l'expression des phénomènes, c'est-
à-dire le lieu où la pensée peut dire que telle chose est
possible.
Or la proposition est quelque chose qui a du sens. Le sens n'y est
que tant que la proposition exprime quelque chose de possible.
Ceci est de toute façon inclus dans la définition même de la
proposition.
Pour projeter une situation possible, c'est à dire pour montrer un
phénomène, nous avons recours à cet outil, ce médium qu'est la
proposition écrite ou verbale. Dans ce cadre propositionnel, le
sens vient à la pensée. Mais la proposition n'est pas le sens,
attention :
A la proposition appartient tout ce qui appartient à la
projection, mais non pas le projeté. Donc la possibilité du
projeté, non le projeté lui-même. Dans la proposition, le sens
n’est donc pas encore contenu, mais seulement la possibilité de
l’exprimer.48
Le phénomène est le sens, mais ce n'est qu'en regardant le cadre
de sa phénoménalité, c'est-à-dire à dire la manière qu'il a de se
donner, qu'il peut être “senti”. Il est lui-même intangible, on ne
peut toucher le quoi, juste dire comment. Et alors on voit (comme
lorsque je dis, faute de mieux : « C'est comme ça, tu vois ? »).
47 TLP, 3.11, p. 4148 TLP, 3.13, p. 42
32
3.2 Le sens, phénomène ultime
Que la totalité des propositions soit la langue (« La totalité des
propositions est la langue. »49), cela est compréhensible : depuis
l’enfance, nous développons notre capacité à composer des
propositions en articulant un vocabulaire selon une grammaire a
priori claire et comprise de tous et nous constatons l’étendue
indéfinie des possibilités de composition. C’est cela la langue et
la possibilité qu’elle nous offre d’exprimer tout sens (on ne
saurait exprimer du non-sens, cela est contradictoire).
En quoi a-t-on à faire à une phénoménologie ? En ce qu'il s'agit
de la possibilité de la phénoménalité.
L'homme possède la capacité de construire des langues par le
moyen desquelles tout sens peut être exprimé, sans qu'il ait une
idée de ce que chaque mot signifie, ni comment il signifie. (…)
Il est humainement impossible de se saisir immédiatement, à
partir [de la langue usuelle], de la logique de la langue.
La langue déguise la pensée. (…)
Les conventions nécessaires à la compréhension de la langue
usuelle sont extraordinairement compliquées.50
La langue usuelle fait croire que tout peut être phénomène. Mais
un examen de ce qu'est la phénoménalité peut et doit éclaircir
cela. Cet examen est la tâche de la philosophie.
C'est dans le langage que l'on peut découvrir, même dévoiler les
règles : en montrant comment, on saura quoi. Mais c'est bel et bien
49 TLP, 4.001, p. 5050 TLP, 4.002, pp. 50 – 51
33
le comment qu'il faut regarder. Un trait caractéristique de la
phénoménologie est ce penchant pour le comment, et ce que nous
avons pu relever dans l’œuvre de Wittgenstein nous indique que
l’étude des conditions de la phénoménalité y est tout aussi
centrale que chez les phénoménologues orthodoxes.
« L'expression fait reconnaître une forme et un contenu. »51. Cette
affirmation signifie que le contenu que nous recherchons, à savoir
le sens, ne peut aucunement être abordé sans passer par la forme,
à savoir le langage. Ce dernier peut certes formuler des
propositions de sciences naturelles, peut tenir un discours sur
autre chose que lui-même, mais se retrouve dépourvu quand il
s’agit de s’expliquer lui même. Le langage est représentationnel,
il fonctionne comme une métaphore. Le principe de la métaphore est
d’exprimer une chose en faisant référence à une autre, qui, par
voie de similitude, peut être comprise comme remplaçant la
première dans un effet de style. Mais la langage devant porter un
discours sur lui-même ne peut être que dans l’auto-référence, dans
la tautologie pure, sans rien apporter d’intéressant, de
surprenant. A la recherche du sens, nous nous heurtons aux
extrêmes du langage, nous cherchons à aller à l’impossible du
langage, vers un phénomène invisible, un propos indicible. Il est
impossible de dire ce qu’est dire, il est impossible de saisir
dans notre main le sens, pourtant si manifeste.
Nous n’avons pour issue que l’exercice d’auto-monstration du
langage qui, par des remarques laconiques, signale des règles de
grammaire, donne des exemples de syntaxe. C’est la saisie de tout
ce qui entoure le sens, de tout c qui le rend possible, qui
constitue le seul accès que nous y ayons en tant que phénomène.51 TLP, 3.31, p. 45
34
Demande-toi comment on amène quelqu'un à comprendre un poème, ou
un thème. La réponse à cette question nous dit comment on
explique ici le sens.52
52 Recherches philosophiques, §533, p. 20635
Conclusion
Une phénoménologie wittgensteinienne serait le regard porté
sur le lien ineffable entre le signe et le signifié. A défaut de
pouvoir dire ce qu'est ce lien, la phénoménologie
wittgensteinienne s'efforce de décrire laconiquement comment ce
lien se montre.
A la recherche du sens, nous nous sommes heurtés à un phénomène si
impénétrable que nous sentons avec Wittgenstein qu’il ne sert à
rien d’entreprendre une phénoménologie, parce qu’il n’y a pas à
proprement parler de phénoménologie. Il y a certes de problèmes
phénoménologiques, mais aucun discours ne peut prétendre dire le
sens. Il est forcément soumis au sens, il en a ou n’en a pas.
La fin du TLP est célèbre pour son mysticisme, et en effet, à la
recherche du sens du monde, nous nous heurtons à ses limites :
« Le sens du monde doit être en dehors de lui. »53
A défaut de pouvoir fonder un discours rigoureux sur la
phénoménalité, c’est-à-dire sur le sens, Wittgenstein réduit son
protocole à la simple considération grammaticale. Peut-être qu’un
langage phénoménologique aurait pu fonder les bases manquantes de
l’atomisme logique, mais c’est de son propre chef que Wittgenstein
abandonne le projet. Et en effet, il a été chercher à
l’impossible, s’est retrouvé muet face à la limite du monde, il
est arrivé au stade où, justement, il aurait fallu dire autre
chose que le comment, et donc le quoi du monde.
Au §40 d’Etre et Temps, Heidegger indique que ce devant quoi il y a
angoisse, c’est le monde comme tel. On peut le mettre en parallèle
avec ce que Wittgenstein écrit dans le TLP : « Le sentiment du 53 TLP, 6.41, p. 109
36
monde comme totalité bornée est le Mystique ». Quoi qu’il en soit,
interrogé par ses confrères du Cercle de Vienne en décembre 1929,
Wittgenstein dit : « Je puis bien me faire une idée de ce que
Heidegger veut dire par Etre et par Angoisse ».
Examinant les Ideen de Husserl, Lévinas commenta que la
manière dont l’objet se donne à la conscience et le sens de son
objectivité, doivent eux-mêmes devenir objets de recherches
intuitives. En revanche, lorsqu’interrogé sur les Recherches logiques
de Husserl par J.N. Findlay en 1939, Wittgenstein s’étonnât qu’on
s’intéressât encore à ce vieux texte.54
L’emploi du terme « phénoménologie » par Wittgenstein est
suffisamment conséquent pour que l’on s’y intéresse, tout en
gardant à l’esprit qu’il est fort possible que, sensible à l’air
du temps, il ait entendu parler de phénoménologie et ait trouvé le
terme utile. Parce qu’au vu de ce qu’il en fait, il se réapproprie
le terme est en fait une phénoménologie non seulement descriptive,
mais aussi analytique si l’on considère la logique comme
entreprise phénoménologique.
Ludwig Wittgenstein y va de son propre aveu : « You could say of
my work that it is “phenomenology”. »55
54 Herbert Spiegelberg, « The puzzle of Wittgenstein’s “Phänomenologie”
(1929- ?) », in American Philosophical Quarterly, vol. 5, No. 4, Oct. 1968, p. 247,
note 1055 M. O’C. Drury, « Conversations with Wittgenstein », cité par Nicholas F.
Gier, « Witggenstein’s Phenomenology Revisited », in Philosophy Today, Fall
1990 ; 34, 3, p. 27337
Bibliographie
Sources premières :
Wittgenstein, Ludwig :
Le Cahier bleu et le Cahier brun, TEL Gallimard 2004
Carnets 1914 – 1916, TEL Gallimard 2005
De la certitude, NRF Gallimard 2006
Recherches Philosophiques, NRF Gallimard 2011
Remarques mêlées, GF Flammarion 2002
Remarques philosophiques, TEL Gallimard 2011
Tractatus Logico-Philosophicus, TEL Gallimard 2010
The Big Typescript : TS 213, trad. et ed. C.G. Luckhardt, M.A.E. Aue,
Oxford : Blackwell Publishing, 2005
Sources secondaires :
Saint Augustin, Confessiones, source Internet :
www.thelatinlibrary.com
38
Heidegger, Martin : Etre et Temps, édition hors commerce Authentica
1985, trad. Emmanuel Martineau
Sources critiques :
Brenner, William : « Wittgenstein's Color-Grammar », Southern Journal
of Philosophy, 20 (Fall, 1982) 298, No. 3, pp. 290-291
Gier, Nicholas F. : « Witggenstein’s Phenomenology Revisited », in
Philosophy Today, Fall 1990 ; 34, 3, pp. 273 – 287
Granger, Gilles Gaston : « Langage, Logique, Pensée », in Visages de
Wittgenstein, dir. Renée Quilliot-Bouveresse, Beauchesne 1995
Guest, Gérard : Wittgenstein et la question du livre, PUF 2003
Hintikka, Merril et Jaakko : Investigations sur Wittgenstein, Liège :
Mardaga 1986
Noë, Robert Alva : « Wittgenstein, Phenomenology and what it makes
sense to say », in Philosophy and Phenomenological Research, vol. 54, No.
1 (March 1994), pp. 1 – 42
Ramsey, Frank P. : Review of Ludwig Wittgenstein’s Tractatus Logico-
Philosophicus, in Mind, New Series, Vol. 32, No. 128 (Oct., 1923), pp. 465
– 478
39
Spiegelberg, Herbert : « The puzzle of Wittgenstein’s
“Phänomenologie” (1929- ?) », in American Philosophical Quarterly, vol. 5,
No. 4, Oct. 1968, pp. 244 – 256
Munson, Thomas N. : « Wittgenstein’s phenomenology », in Philosophy
and Phenomenological Research, vol. 23, No. 1, Sep. 1962, pp. 37 – 50
40
Table des matières
Introduction 3
1. Phänomenologie ist... 5
1.1 De la possibilité de la phénoménalité5
1.2 Montrer l’indicible 8
2. Grammatik 11
2.1 Les règles grammaticales du possible (la théorie)11
2.2 Formes de vie, jeux de langage (la pratique)14
3. Logik 17
3.1 La forme logique 17
3.2 Le sens, phénomène ultime 22
Conclusion 23
Bibliographie 25
41