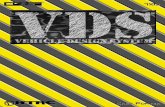La phénoménologie levinassienne du corps dans Totalité et Infini
Transcript of La phénoménologie levinassienne du corps dans Totalité et Infini
LA PHÉNOMÉNOLOGIE LEVINASSIENNE DU CORPS DANSTOTALITÉ ET INFINI Cristian Ciocan P.U.F. | Les Études philosophiques 2014/1 - n° 108pages 137 à 151
ISSN 0014-2166
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2014-1-page-137.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciocan Cristian, « La phénoménologie levinassienne du corps dans Totalité et Infini »,
Les Études philosophiques, 2014/1 n° 108, p. 137-151. DOI : 10.3917/leph.141.0137
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour P.U.F..
© P.U.F.. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 136 / 160
- © PUF - 15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 137 / 160
- © PUF -
Les Études philosophiques, n° 1/2014, pp. 137-151
Introduction
Dans les écrits de Levinas2, nous pouvons repérer toute une constellation d’interrogations qui concernent la dimension corporelle du sujet. Il est tou-tefois difficile de dire si ces micro-analyses phénoménologiques, qui visent à expliciter l’incarnation existentielle de l’ego, arrivent à constituer une véri-table « phénoménologie de la chair », ou si, au contraire, nous avons affaire seulement à des ébauches, à des esquisses qui n’articulent pas de manière effective une analyse phénoménologique concrète de la corporéité humaine, dans le sens rigoureux de ce terme. Partout, il y a des indices, des traces, des allusions, des formules lapidaires où interviennent des références au corps et à l’incarnation. Cependant, sommes-nous véritablement confrontés à une image unitaire du corps, parfaitement cohérente ou systématique ? L’inspiration phénoménologique de Levinas est indubitable, mais la question demeure : une telle inspiration suffit-elle pour constituer effectivement une phénoménologie de la chair ?
Comme nous l’avons montré dans un article récent3, le phénomène du corps apparaît très tôt dans la réflexion du jeune Levinas, notamment dans le court essai intitulé Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme
1. Cet article a été publié dans le cadre du projet PN-II-RU-TE-2010-156, financé par le CNCSIS-UEFISCSU. L’argument central de cet article a été communiqué dans le cadre d’un colloque organisé par le SIREL et consacré à « Totalité et Infini, une œuvre de ruptures » (9-11 mai 2011, Paris), marquant le cinquantenaire de sa publication.
2. Nous citons les éditions suivantes de l’œuvre de Levinas, avec son abréviation cor-respondante : Totalité et infini, La Haye, Martinus Nijhoff, 1961 (TI) ; Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Martinus Nijhoff, La Haye, 1974 (AE) ; Œuvres, t. I : Carnets de captivité suivi de Écrits sur la captivité et Notes philosophiques diverses, volume publié sous la responsa-bilité de Rodolphe Calin et de Catherine Chalier, Paris, Grasset / IMEC, 2009 (Œuvres 1) ; Œuvres, t. II : Parole et silence, volume publié sous la responsabilité de Rodolphe Calin et de Catherine Chalier, Paris, Grasset / IMEC, 2011 (Œuvres 2) ; Le Temps et l’Autre, Paris, Presses Universitaires de France, 1994 (TA).
3. Cristian Ciocan, « Le problème de la corporéité chez le jeune Levinas », Les Études philosophiques, vol. 113 (2013), n° 2, pp. 201-219.
LA PHÉNOMÉNOLOGIE LEVINASSIENNE DU CORPS DANS TOTALITÉ ET INFINI1
La phénoménologie levinassienne du corps dans Totalité et Infini
Cristian Ciocan
137151
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
138 Cristian Ciocan
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 138 / 160
- © PUF - 15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 139 / 160
- © PUF -
(1934), où s’esquisse la tension entre le désir de détachement qui caracté-rise le sujet et son fait d’être essentiellement attaché, par son corps, à son lieu. La chair propre serait ainsi le contre-phénomène de tout détachement, l’empêchement de tout mouvement de transcendance. L’idée revient aussi dans De l’évasion (1935), où l’enchaînement au corps est analysé dans une perspective ontologique, car Levinas décrit le sujet incarné comme « être rivé à soi » et au « fait brutal de l’être ». Il analyse plusieurs phénomènes cor-porels (tels que le besoin, la souffrance, le malaise, la nausée, la satisfaction et le plaisir), en se focalisant sur la liaison entre la honte et la nudité, afin de souligner le caractère insupportable de son propre être. Ensuite, le phéno-mène du corps intervient dans De l’existence à l’existant et Le Temps et l’Autre, les deux écrits jumeaux élaborés pendant la longue période de captivité dans un Oflag nazi et publiés simultanément après la guerre, en 1947. Ici, Levinas essaie de « comprendre […] le corps à partir de la matérialité » et de « le ramener à un événement ontologique », notamment comme « événement concret de la relation entre Moi et Soi » (TA, 37-38). La cohésion du moi avec le soi, qui est un enchaînement à l’être et à son propre corps, trouve dans la figure d’autrui sa pierre d’achoppement. Ce qui est intéressant, c’est que même la fracture de l’identité du moi (qui est effectivement une identifi-cation corporelle), cette brisure qui s’accomplit par l’avènement de l’autre, possède, à son tour, une certaine dimension charnelle, étant liée notamment à la nudité : autrui est décrit comme nudité, car « la relation avec la nudité est la véritable expérience […] de l’altérité d’autrui » (EE, 61). Dans ces textes s’ouvrent d’autres noyaux conceptuels liés à la dimension incarnée du sujet : l’éros, le féminin et la fécondité. Levinas suggère que « c’est dans l’éros que la transcendance peut être pensée d’une manière radicale » et souligne que la relation avec l’autre doit être comprise à partir du « prototype » de la relation érotique. Le paradigme de l’altérité arrive à être déterminé comme féminité. Avec cette idée que « l’autre par excellence, c’est le féminin » (EE, 144), Levinas accentue la résistance à l’assimilation, soulignant la ten-sion entre pudeur et profanation : le féminin devient ainsi le paradigme de l’altérité, tout comme la nudité auparavant. Enfin, la fécondité, cette conti-nuité charnelle, ouvre la possibilité du sujet « de ne pas retourner fatalement à lui-même » (EE, 165).
Nous voyons donc que les écrits de jeunesse de Levinas déploient une véri-table constellation interrogative autour du problème du corps. Cependant, la question est de savoir si nous découvrons de semblables analyses du corps dans la période de maturité de la production philosophique levinassienne, et particulièrement dans Totalité et Infini (1961). Trouverons-nous, dans ce premier magnum opus, un traitement aussi complexe, abondant et ramifié, comme nous l’avons constaté dans les écrits antérieurs ? Ou peut-on plutôt dire que l’importance accordée aux phénomènes corporels s’étiole, pendant que d’autres thèmes entrent en avant-scène, dominant le paysage de la pen-sée levinassienne ? Autrement dit, au fil du temps, la question de la chair s’intensifie-t-elle aux yeux de Levinas ou, au contraire, s’efface-t-elle au profit
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 138 / 160
- © PUF -
139 La phénoménologie levinassienne du corps dans Totalité et Infini
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 139 / 160
- © PUF -
de nouvelles problématiques ? Une réponse simple, sans nuances – en termes de oui ou de non – n’est évidemment pas possible. Il faut plutôt explorer d’une manière appliquée, patiente et différenciée les contextes où le phéno-mène de la chair apparaît dans cet ouvrage et voir de près comment ils se tissent ensemble selon un motif plus ou moins cohérent.
L’équivoque du corps dans Totalité et Infini
Le problème du corps n’est certainement pas absent du projet philoso-phique de Totalité et Infini, néanmoins on ne peut pas dire non plus qu’il est effectivement présent d’une manière thématique, explicite ou articulée. Il est vrai qu’on trouve des passages problématiques, denses et percutants consa-crés à ce sujet, notamment dans la deuxième partie de l’ouvrage (« Intériorité et économie »), laquelle porte sur la constitution de la subjectivité, dans l’intériorité de l’égoïsme, en tant que sensibilité et jouissance, habitation et travail. Nous trouvons aussi de pertinents fragments consacrés à la chair dans la partie finale (« Au-delà du visage »), où se pose la question de l’érotisme, de la caresse et de la volupté. Cependant, au premier abord, il n’est pas tout à fait évident de lier systématiquement les fragments disparates dans les-quels, d’une manière parfois paradoxale et assez souvent lapidaire, Levinas approche – à travers des formules inhabituelles et aporétiques – le phéno-mène de la corporéité.
Illustrons d’abord cette manière spéciale de caractériser le corps. Le corps est parfois désigné « comme le régime même sous lequel s’exerce la sépa-ration, comme le “comment” de cette séparation », « comme un adverbe plu-tôt que comme un substantif » (TI, 137). D’autre part, Levinas affirme que « l’ambiguïté du corps est la conscience » et même que « la conscience […] est un ajournement de la corporéité du corps » (TI, 140). L’essence du corps est « d’accomplir ma position sur terre » (TI, 101)4 et, en tant que tel, il est un moment essentiel de l’identification du moi à soi, de « ma coïncidence avec moi » (TI, 111). Mais le corps constitue aussi la relation primordiale du moi avec le monde, étant, d’une part, « ce qui baigne dans l’élément », et, d’autre part, « ce qui demeure, habite et possède » (TI, 110). Le corps est décrit aussi comme « chaînon d’une réalité élémentale » (TI, 140), mais dans le même corps est inscrite la relation avec l’Autre, notamment par le fait de son élévation, par sa direction du bas vers le haut, mais aussi par l’éro-tisme qui lui est propre. Enfin, la dimension incarnée de l’homme est, pour Levinas, la pierre d’achoppement de toute théorie idéaliste qui se fonde sur la représentation, la constitution et la donation de sens (Sinngebung).
En effet, comment systématiser cette multiplicité bouleversante de déterminations ? Il est en vérité assez difficile d’articuler spontanément la structure compréhensive générale qui émerge de tous ces fragments,
4. Voir aussi le fragment correspondant dans Œuvres 2, p. 163.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
140 Cristian Ciocan
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 140 / 160
- © PUF - 15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 141 / 160
- © PUF -
lesquels abordent, d’une manière parfois évanescente et dispersée, le phé-nomène de la chair. Toutefois, il faut essayer de réunir ces morceaux dis-parates, de rétablir leur cohérence implicite, en mettant au jour les lignes de force qui seraient capables de structurer le phénomène du corps. Ainsi, comme nous le verrons, Levinas montre que le corps (par la jouissance, le besoin ou le bonheur, mais aussi par l’habitation et le travail, et enfin par l’éros) participe de l’intérieur à la relation originaire du sujet avec le monde, avec soi-même et avec l’autre. Pourtant, il s’agit toujours d’une équivoque du corps, car la corporéité est caractérisée constamment par une sorte d’ambivalence et la dimension incarnée du sujet est placée souvent dans une certaine ambiguïté.
Équivocité, ambiguïté, ambivalence – de quoi s’agit-il ? En quoi consiste exactement cette équivocité ? Il y a plusieurs niveaux où nous pouvons la rencontrer. Par exemple, on parle du rapport entre le « corps-maître » et le « corps-esclave », et de leur renversement toujours possible. Levinas affirme en effet que la « vie autochtone » se joue dans une « équivoque originelle » et que l’existence de cette équivoque est précisément le corps. L’ambivalence du corps est donc précisée comme rapport entre le « corps-maître » et le « corps-esclave » : « La vie atteste, dans sa peur profonde, cette inversion toujours possible du corps-maître en corps-esclave, de la santé en maladie » (TI, 138). En tant que corps-maître, il est ce par quoi le sujet a un certain pouvoir qu’il exerce sur le monde. Le corps envisagé ici – santé et égoïsme – est le signe de l’autarcie, de l’indépendance du sujet, qui, par sa puissance même, peut se défendre et se maintenir au monde. Mais il y a aussi un revers : c’est le corps vulnérable, celui qui souffre, qui est affecté, qui est arrivé à la limite de ses pouvoirs, sans défense, qui ne peut plus pouvoir.
L’équivoque du corps peut donc se comprendre aussi comme ambiva-lence du pouvoir et de la vulnérabilité : le corps-maître cache la figure arché-typale de Caïn, qui peut exercer son pouvoir sur son frère, jusqu’à la mort de celui-ci, une mort qui lui est pourtant interdite, par le visage même de son frère ; le revers est le corps-esclave, qui suggère la figure d’Abel, sans défense devant le coup meurtrier de son frère, dépossédé de son pouvoir propre qui pourrait toutefois le défendre, à la limite de ses pouvoirs. Dans cette équivoque du corps, il est essentiel de remarquer que, d’une part, le renversement du corps-maître en corps-esclave est toujours possible, d’autre part, la santé qui soutient la position de soi sur la terre peut se convertir soudainement en maladie et en vulnérabilité, et, enfin, le pouvoir peut, à chaque moment, s’invertir en faiblesse. L’autarcie du sujet, maître au centre de son monde, peut donc s’abîmer et donner lieu à son revers : la fragilité.
L’ambivalence du corps peut se prolonger encore, cette fois par rapport au monde, comme équivoque de la dépendance et de l’indépendance. D’une part, le corps est déterminé comme « chaînon d’une réalité élémentale », ce qui signifie que le corps est pris dans et dépendant de la réalité élémentale anonyme dont il se nourrit, dans laquelle il est plongé et où il se baigne (en
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 140 / 160
- © PUF -
141 La phénoménologie levinassienne du corps dans Totalité et Infini
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 141 / 160
- © PUF -
respirant, en buvant, en mangeant au sein du monde environnant). Le sujet en tant que chair est dépendant et, dans une certaine manière, sous l’emprise (« magique », « mythique », « païenne ») de l’élémental5. Mais, d’autre part, cette dépendance primordiale par rapport à l’élémental comporte aussi son revers : par le travail et la demeure dans laquelle il se sépare de l’élément, le sujet devient indépendant6. En effet, c’est par le pouvoir de son corps que le sujet devient capable de maîtriser le monde, de mouvoir les choses, de les manipuler, de travailler : « Mon corps n’est pas seulement une façon pour le sujet de se réduire en esclavage, de dépendre de ce qui n’est pas lui ; mais une façon de posséder et de travailler, d’avoir du temps, de surmonter l’altérité même de ce dont je dois vivre » (TI, 89). Ainsi, la même ambivalence se retrouve avec le corps saisi aussi bien en tant que corps-maître, que corps-esclave ; aussi bien en tant que santé, que maladie ; aussi bien en tant que capable de dominer par sa force, que dominé à son tour dans sa vulnérabi-lité ; aussi bien en tant que tortionnaire, que victime ; aussi bien en tant que meurtrier, que susceptible d’être tué ; aussi bien en tant que vif, qu’exposé à la mort ; aussi bien en tant que dépendant du monde qui le nourrit, qu’indé-pendant par sa capacité de travailler.
Paradoxalement, Levinas affirme que cette ambivalence du corps est finalement la conscience. Levinas ne dit pas « qu’on a conscience de cette ambiguïté » du corps, ni non plus que « cette ambiguïté du corps est elle-même consciente », mais que, textuellement : « l’ambiguïté du corps est la conscience » (TI, 139). Faut-il comprendre que la conscience naisse comme interface jouant entre plusieurs modalités fondamentales de l’incarnation ? Faut-il penser à une genèse de la conscience à partir de cette ambiguïté ? En tout cas, le rapport entre le corps et la conscience demeure, lui aussi, à son tour, ambigu. Levinas parle dans certains contextes de « l’incarnation de la conscience » (TI, xv, 126), mais par ailleurs, il affirme que « la conscience ne tombe pas dans un corps – ne s’incarne pas ; elle est une désincarnation » (TI, 140). D’autre part, Levinas nous laisse savoir que « [l]e corps est une permanente contestation du privilège qu’on attribue à la conscience de “prê-ter le sens” à toute chose. Il vit en tant que cette contestation » (TI, 102). Mais si le corps est une contestation de la conscience et de son sens privilégié, comment comprendre l’incarnation de la conscience ?
5. Que cette domination est vraiment dramatique, cela se voit dans l’inquiétude viscé-rale qui frappe l’humain dans la faim la plus perçante. En effet, la faim est intéressante du point de vue non pas biologique, mais existential : dans la situation d’une faim aiguë, non seulement le sujet est déstabilisé – car il lui manque précisément ce dont il dépend – mais, dans l’indigence prolongée, il arrive au seuil de son ultime résistance de sujet (voir Knut Hamsun, La Faim). À ce niveau, l’élémental domine le sujet – et cela aussi bien de son côté positif, en tant qu’abondance qui s’offre à la jouissance, que de son côté négatif, comme désespoir de l’inanition, comme besoin qui se confronte au manque. C’est dans ce contexte que prennent sens non seulement la fonction existentielle du jeûne, qui veut en fait défaire la faim, qui veut dominer l’élémental, quoique celui-ci domine cependant celui-là, mais aussi la référence de Levinas au « “ventre affamé qui n’a pas d’oreilles”, capable de tuer pour une bouchée de pain » (TI, 91).
6. Voir Œuvres 2, p. 278.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
142 Cristian Ciocan
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 142 / 160
- © PUF - 15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 143 / 160
- © PUF -
Le corps et le monde, l’élément et le travail. L’habitation
Revenons maintenant au rapport du corps au monde. Le corps est à la frontière de l’élémental (qui le nourrit en abondance) et de la maison (qui l’accueille, l’héberge et le protège). Comment l’expérience du corps se modifie-t-elle par rapport à ces deux dimensions de la vie du sujet ? Comment le corps se modalise-t-il dans ce balancement entre dépendance et indépendance ? Le fait que le corps soit la frontière (ou à la frontière) et qu’il soit l’entre-deux de l’élément et du domicile, se concrétise par le travail. En effet, la relation entre le corps et le travail est tout aussi fondamentale que la relation entre le corps et l’habitation, modalisant la relation originaire entre le corps et l’élémental. Car précisément le corps travaillant fait la transition entre le plongement anonyme dans l’élémental et l’abritement dans une maison.
L’élémental indique le milieu anonyme, pré-chosique, pré-substantiel, « qui enveloppe ou contient, sans pouvoir être contenu ou enveloppé » (TI, 104), non-étant, indéterminé, indéfini, sans face, sans forme, d’une profon-deur abyssale, « l’insondable », « qualité sans substance », « sans support ». L’élémental est inapprochable, car, sans face, la seule relation qu’il permet est le « se baigner » : il s’offre dans la pure jouissance, dans l’immédiateté du besoin, comme ce qui alimente le sujet. L’élémental est cependant non possédable, car seules les choses peuvent être possédées, et cela peut arriver uniquement à partir d’une maison. Cette positivité de l’élémental, dans son abondance et sa plénitude, se double d’un côté négatif (nous retrouvons encore l’ambivalence constante de la pensée levinassienne). La jouissance qui jouit de l’élément est déjà menacée d’inquiétude, dans l’indétermination de l’avenir ; « l’avenir de l’élément est insécurité », il est incertain ; il y a un « gouffre incertain de l’élément », parce que l’élémental, anonyme à son tour, « se prolonge dans l’il y a », avec tout ce que son poids a de négatif. C’est par rapport à ce milieu anonyme, qui est menaçant par l’inquiétude et l’insécurité de son avenir, que le sujet se sépare, en constituant une habitation qui règle ensuite son rapport à l’élément.
Ce qui est important pour notre sujet, c’est que le régime corporel lui-même change, notamment en ce qui concerne la possession de soi. Levinas affirme que « nous disposons de notre corps » seulement au moment où « nous avons déjà suspendu l’être de l’élément qui nous baigne », c’est-à-dire « en habitant » (TI, 135, nous soulignons). Donc, c’est la suspension de l’élé-ment qui rend possible la possession de notre corps. Et encore : « Le corps est ma possession selon que mon être se tient dans une maison à la limite de l’intériorité et de l’extériorité » (TI, 135-136, nous soulignons). Il est donc évident qu’il s’agit d’un rapport privilégié entre la possession du corps propre et le fait d’avoir une maison. Pour Levinas, c’est le fait d’avoir une habi-tation qui détermine la possession de son propre corps, et non pas l’inverse. Autrement dit, ce n’est pas le fait que nous nous approprions notre corps qui rend possible la retraite dans un abri ; au contraire, c’est uniquement cette retraite devant l’élémental, cette séparation, qui nous donne, pour la première
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 142 / 160
- © PUF -
143 La phénoménologie levinassienne du corps dans Totalité et Infini
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 143 / 160
- © PUF -
fois, l’occasion d’entrer dans la possession de notre propre corps. Nous avons donc affaire à des couches architectoniques, structurelles, à travers lesquelles l’expérience du corps se constitue.
La question est de savoir quel statut on peut accorder au corps avant l’entrée dans le régime de l’habitation, avant de bâtir une maison, avant de s’abriter dans une intériorité. Plongé dans l’élémental, baigné dans l’élément, enfoncé dans le magma anonyme, le sujet n’est pas encore moi, ou le moi n’est pas encore sujet, il ne se possède pas lui-même, il n’est pas séparé. Sombrant dans et absorbé par le milieu indéterminé et sans forme, le pré-moi (si cette formule n’est pas trop hérétique) s’immerge dans le « bain vital », il jouit de la nourri-ture que l’élémental lui offre avec abondance, mais il ne se possède pas lui-même ; au contraire, c’est l’élément qui le possède. On peut donc supposer que ce corps qui ne se possède pas lui-même c’est précisément le corps-esclave que nous avons rencontré auparavant, étant donné sa dépendance dont nous avons déjà parlé. Et même si cet asservissement n’est pas visible au moment de la jouissance plénière, où la joie et le bonheur de la satisfaction comblent le sujet, il devient cependant évident dès que l’élémental montre son « autre côté », le côté inquiétant, l’insécurité devant laquelle le sujet devient vulnérable.
Cette emprise de l’élémental sur le sujet constitue le moment « païen » de l’expérience : ici, l’essentiel c’est la jouissance, dans la dynamique du besoin et de la satisfaction, ayant comme finalité le bonheur d’un moi qui n’a pas pris encore possession de son corps – tout cela dans l’horizon de l’incertitude. La prise en possession du corps (et de soi) devient possible seulement après le moment où l’ego se sépare de l’élémental (c’est le moment de l’« athéisme »), après le moment où il délimite l’espace de l’intériorité – une habitation, une maison – à partir de laquelle son rapport avec l’élémental se modifie : il ne s’agit plus d’une pure jouissance plongée dans le tourbillon de l’élément, mais c’est le début d’une exploration – par le travail – de l’élémental. Il s’agit du geste inaugural de « faire des réserves », de ramasser des provisions, de stocker des choses – des choses qui deviennent, seulement maintenant, des biens, qui ensuite peuvent s’échanger, se transformant ainsi en monnayage dans un monde déjà économique7. C’est donc de cette manière que, selon Levinas, « l’extraterritorialité d’une maison conditionne la possession même de mon corps » (TI, 136).
Dans ce contexte, l’analyse de la main, que Levinas entame vers la fin de la deuxième section de l’ouvrage, prend toute sa valeur. Pourquoi la main est-elle si importante pour une phénoménologie de la corporéité ? Il est peut-être inutile de rappeler les riches implications philosophiques de ce terme – main, Hand – dans les écrits de Heidegger, d’autant plus après les subtiles analyses de Jacques Derrida, dans son essai sur La main de Heidegger (Geschlecht II)8,
7. Ainsi, avant l’entrée dans le régime de l’habitation, l’ego vit dans le pur présent de la jouissance. Mais après la délimitation de l’espace de l’intériorité, l’ego ajourne la jouissance – par le fait de ramasser des provisions – pour le « plus tard ». Et ce qui est très intéressant c’est que Levinas voit dans cet ajournement la constitution primaire de l’avenir.
8. Jacques Derrida, Heidegger et la Question, Paris, Flammarion, 1987.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
144 Cristian Ciocan
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 144 / 160
- © PUF - 15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 145 / 160
- © PUF -
et de celles de Jean-François Courtine, dans son chapitre intitulé Donner/prendre : la main9. À une autre occasion, il serait peut-être intéressant de confronter la « main de Levinas » avec la « main de Heidegger »10. En tout cas, la main joue un rôle vraiment essential dans Totalité et Infini. En quoi consiste donc cette prééminence de la main ? D’abord, en ce qu’elle est le paradigme du sujet hypostatique (selon la terminologie de Le Temps et l’Autre – car dans Totalité et Infini le terme hypostase n’est jamais mentionné) : la main tâtonne et prend ; elle travaille et suit son but, toute finalité présupposant donc la chair ; la main est « l’organe de saisie et de prise, de première et aveugle prise dans le grouillement » (TI, 132), ce qui implique donc le pouvoir, l’égoïsme, le travail et l’appropriation, dans sa lutte avec l’élémental ; la main « rapporte l’élémental à la finalité des besoins » (ibid.) et ce qu’elle prend ce sont « des choses arrachées à l’élément » (ibid.) ; son mouvement est « rigoureusement économique, de saisie et d’acquisition » (TI, 133)11. Tout cela montre que le rapport entre la main et le corps est d’une importance primordiale : non seulement le corps est décrit comme « possibilité d’une main », mais en outre « la corporéité tout entière peut se substituer à la main » (TI, 142). Toutefois, cela n’est pas possible dans n’importe quelles conditions. Effectivement, dans un autre contexte, Levinas souligne que « la main comme main ne peut surgir dans le corps immergé dans l’élément, sans le recueillement de la demeure » (TI, 137). Il s’agit donc de la même démarcation discutée aupa-ravant : le corps se modalise différemment avant ou après la séparation d’avec l’élémental. Si la main est le paradigme pour toute prise et pour tout arra-chement, donc pour toute possession et pour tout pouvoir, alors elle ne peut surgir12 qu’après la séparation. En conséquence, il semble que seul le corps-maître soit doté de main, tandis que le corps-esclave – sans pouvoir, sans possession – n’en possède pas. L’observation levinassienne selon laquelle « la
9. Jean-François Courtine, Heidegger et la Phénoménologie, Paris, Vrin, 1987.10. Voir aussi Alexander Schnell, En face de l’extériorité. Levinas et la question de la subjecti-
vité, Paris, Vrin, 2010, pp. 63-64, et yasuhiko Murakami, Lévinas phénoménologue, Grenoble, Millon, 2002, pp. 81-83.
11. « La main, à la fois, amène les qualités élémentaires à la jouissance et les prend et les garde en vue de la jouissance future. La main dessine un monde en arrachant sa prise à l’élé-ment, en dessinant des êtres définis ayant des formes, c’est-à-dire des solides ; l’information de l’informe, c’est la solidification, surgissement du saisissable, de l’étant, support des qualités » (TI, 134-135).
12. Évidemment, pour un lecteur ancré dans une perspective strictement biologique et physiologique, la question « si, comment et quand surgit la main ? » est vraisemblablement absurde. Mais, phénoménologiquement, la question comporte une signification particulière. On peut invoquer ici encore une fois Heidegger, qui disait que nous ne voyons pas parce que nous avons des yeux, mais nous avons yeux parce que nous pouvons voir (GA 29/30, p. 319) et, de même, que nous n’entendons pas parce que nous avons des oreilles, mais nous avons des oreilles parce que nous pouvons entendre (GA 7, p. 220 ; GA 55, p. 247). Il s’agit là d’une précédence des capacités (d’ordre existentiel) par rapport aux organes de sens (d’ordre biologique). Même si, chez Levinas, ce rapport de précédence ne fonctionne pas comme chez Heidegger, il y a une certaine démarcation entre le niveau biologique et le niveau phénomé-nologique. Plus tard, Levinas dira que « [l]e sujet incarné n’est pas un concept biologique » et que « [l]e schéma que dessine la corporéité, soumet le biologique lui-même à une structure plus haute » (AE, 138).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 144 / 160
- © PUF -
145 La phénoménologie levinassienne du corps dans Totalité et Infini
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 145 / 160
- © PUF -
main comme main » ne surgit pas avant la séparation souligne encore une fois le fait que « le corps immergé dans l’élément » et absorbé dans le milieu anonyme soit, en fait, un corps désapproprié, relevant d’un soi qui ne s’est pas encore approprié son corps. C’est uniquement par la séparation que le moi s’approprie son corps, la main devenant ensuite organe du pouvoir, du travail et de la possession. Cependant, il ne faut pas ignorer l’existence d’un autre niveau où la main abandonnerait son principe même – le travail, le pouvoir et la possession. Une situation n’intervient que dans le rapport à l’autre : aussi bien dans l’horizon de l’éros, où la main est d’abord caresse, que dans l’horizon éthique où la main est ce par quoi on donne à autrui (mains pleines, mains qui offrent). Dans ce dernier cas, il s’agit d’une « générosité, incapable d’aborder l’autre les mains vides » (TI, 21), car « aucun visage ne saurait être abordé les mains vides et la maison fermée » (TI, 147). On n’a plus affaire ici à un pouvoir de possession, mais à des « pouvoirs d’accueil, de don, de mains pleines, d’hospitalité » (TI, 179)13.
Le corps et l’autre. De l’érotique à l’éthique (et retour)
Passons donc au rapport entre le corps et l’autre, qui est tout aussi impor-tant que les autres relations que nous avons analysées jusqu’ici : le corps et la conscience, le corps et l’élément, le corps et l’habitation, le corps et le travail. Comment donc le problème du corps s’articule-t-il avec la question de l’Autre ? La première réponse de Levinas est assez surprenante : « La rela-tion avec l’Autre […] s’inscrit dans le corps comme son élévation » (TI, 90). Ainsi, dans la mesure où la hauteur est le lieu propre de l’Autre, le fait que le corps humain soit « dressé de bas vers le haut, engagé dans le sens de la hauteur » (TI, 89)14, montre que le sujet, de par sa position corporelle même, est placé dans l’horizon de l’Autre et en vue de l’Autre.
Pourtant, le rapport entre le corps et l’autre n’est ni simple ni univoque. Il se modalise, en suivant deux directions distinctes. D’une part, il s’agit du corps tel qu’il surgit dans la relation érotique avec l’autre, et ici il faut examiner de près l’esquisse de la phénoménologie de l’éros qui se dessine – par le thème de la volupté et de la caresse – dans la section « Au-delà du visage ». D’autre part, il s’agit de voir le rôle du corps dans la relation éthique avec l’autre, où la dimension charnelle du sujet est d’une certaine façon ascétique. Par exemple, comme disait Berdiaev, même si, pour moi, comme sujet, ma propre faim est un problème charnel (relevant en quelque sorte de l’égoïsme), néanmoins la faim de l’autre est pour moi un problème non pas charnel, mais spirituel et
13. Voir aussi TI, 191 : « Un moi, existence séparée dans sa jouissance et qui n’accueille pas le visage et sa voix venant d’une autre rive, les mains vides. »
14. Levinas affirme dans un autre contexte : « J’existe comme corps, c’est-à-dire comme exhaussé » (TI, 90). Nous retrouvons ici une autre ambivalence du corps : c’est l’« élévation, mais aussi tout le poids de la position » (TI, 100). Ce rapport ambivalent entre élévation et pesanteur a son importance propre, qui est notamment liée au rapport avec autrui.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
146 Cristian Ciocan
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 146 / 160
- © PUF - 15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 147 / 160
- © PUF -
éthique. Devant la faim de l’autre, qui est évidemment une faim qui creuse dans son corps vivant, les exigences éthiques font que ma présence corporelle est ascétique : ma corporéité est en retrait, réduite, restreinte. Dans le Désir métaphysique de l’Infini, qui se signifie dans le visage de l’autre, ma chair ne veut rien pour soi. Donc il faut différencier le rôle du corps dans le désir métaphysique (proprement éthique, dans le face-à-face du visage) et sa fonc-tion dans le désir érotique (charnel de par son essence), car le Désir méta-physique transcende en quelque sorte le régime corporel ; donc l’éthique n’est pas érotique ; ou, autrement dit, l’éros n’est pas encore Désir métaphy-sique (l’éthique), il est en-deçà du métaphysique. Par rapport à l’Autre que le moi désire absolument d’un désir métaphysique, il n’est pas possible « d’esquisser aucune caresse connue, ni inventer aucune caresse nouvelle », car « la métaphysique désire l’Autre par delà les satisfactions » (TI, 4, nous sou-lignons). La caresse ne fait donc pas partie des actes du Désir15. La nécessité de distinguer entre la modalisation du corps dans la relation érotique et sa fonction dans la relation éthique est soulignée aussi par le passage suivant : « Le charnel, tendre par excellence et corrélatif de la caresse, l’aimée – ne se confond ni avec le corps-chose du physiologiste, ni avec le corps propre du “je peux”, ni avec le corps-expression, assistance à sa manifestation, ou visage » (TI, 235). Le « corps-expression » relève évidemment de la relation éthique et se concentre précisément dans le visage, en se distinguant nettement de la chair érotique que Levinas appelle « le tendre ».
Comment le corps, placé dans la situation érotique, est-il décrit ? Nous ne serons pas surpris de constater à nouveau une même ambivalence à l’œuvre. D’une part, le corps est décrit dans le registre du féminin, ce qui rappelle les interrogations des années 1940 : la chair est le tendre, la faiblesse, d’une « fragilité extrême », vulnérabilité qui « se manifeste sur la limite de l’être et du ne pas être, comme une douce chaleur où l’être se dissipe en rayon-nement », « évanescence », « fuite en soi au sein même de sa manifestation » (TI, 233, nous soulignons). Précisément par cette dissipation de l’être, l’éro-tisme semble ouvrir, d’une certaine façon, un « au-delà » de l’être. Même si ce privilège radical sera réservé au Désir métaphysique, qui désire l’Infini, l’érotisme semble toutefois en être l’antichambre, car « dans le charnel de la tendresse, le corps quitte le statut de l’étant » (TI, 236). S’il quitte le sta-tut de l’étant, il se produirait alors ici un saut vers l’epekeina tes ousias. Du moins, la chair érotisée est une figure intermédiaire, entre être et non-être, sans être elle-même ni l’un ni l’autre : « La caresse vise le tendre qui n’a plus le statut d’un “étant”, qui, sorti des “nombres et des êtres”, n’est même pas qualité d’un étant. Le tendre désigne une manière, la manière de se tenir dans le no man’s land, entre l’être et le ne-pas-encore-être » (ibid.). Dans le même sens, Levinas souligne que la caresse « n’est pas une intentionnalité
15. Ce que confirme aussi la citation suivante : « Mourir pour l’invisible – voilà la méta-physique. Mais cela ne veut pas dire que le désir puisse se passer d’actes. Seulement ces actes ne sont ni consommation, ni caresse, ni liturgie » (TI, 5).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 146 / 160
- © PUF -
147 La phénoménologie levinassienne du corps dans Totalité et Infini
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 147 / 160
- © PUF -
de dévoilement, mais de recherche : marche à l’invisible ». La liaison entre l’infini et l’invisible s’impose par elle-même.
Mais l’érotique est-il vraiment le vestibule du sanctuaire de l’éthique, comme le suggèrent ces passages cités ? D’autres fragments de l’analyse levi-nassienne semblent le contester. En effet, comme le montre Levinas, un autre côté du charnel érotique consiste dans une « ultramatérialité exorbitante », un « paroxysme de matérialité » (TI, 234). Le revers de la fragilité et de l’éva-nescence est donc cette « nudité exhibitionniste d’une présence exorbitante » (TI, 234), dans une situation que Levinas conçoit en termes de clandestinité, d’impudeur et de profanation. En tant que « production de l’être », cet « exhi-bitionnisme exorbitant » se situe certainement à l’antipode de la description antérieure du charnel en tant que tendre, à la « limite de l’être et du ne pas être », ce qui dépasse déjà le registre de l’étantité. Ces derniers aspects de la chair érotisée semblent, en quelque sorte, entrer en conflit direct avec la dimension éthique. Plus précisément, non seulement il y aurait une diffé-rence radicale entre la situation érotique et la situation éthique, mais en outre, derrière cette différence, il se cacherait même une sorte d’antagonisme. Dans un contexte dévolu à la profanation, comme violation de ce qui est sacré ou saint, l’insistance de Levinas nous suggère un tel point de vue. Aussi la clan-destinité est-elle décrite par le fait que « l’essentiellement caché se jette vers la lumière, sans devenir signification » (TI, 234). Or, nous savons que la source ultime de la signifiance est précisément le visage. Si l’érotisme est donc privé de signification, s’il est privé de visage, est-il tout simplement neutre du point de vue éthique, étant purement « autre chose » que l’éthique ? Ou, sinon, l’éros serait-il la contrepartie négative ou privative du rapport éthique avec l’autre ?
Dès lors, dans cette perspective levinassienne, comment peut-on penser le passage possible entre les deux registres distincts de la relation avec l’autre, l’érotique et l’éthique ? Faut-il concevoir une hiérarchie entre les deux ? Faut-il postuler une suprématie de l’un sur l’autre ? En effet, on pourrait être tenté d’assimiler le passage de l’érotique à l’éthique à une « ascension », à une élévation – par le Désir métaphysique même – à l’infini, à une traversée qui transcenderait toute jouissance et tout plaisir propre, dans une montée vers l’au-delà de l’être qui laisse derrière soi – ou même contredit – la chair propre. Dans cette perspective, le mouvement de sens contraire – notam-ment le passage de l’éthique à l’érotique – serait une véritable descente, une déchéance dans l’empire de la jouissance, dans la domination élémentale du plaisir propre, qui est uniquement en vue de soi et de son propre bon-heur16. Mais, en fin de compte, la question est : l’éthique est-elle ce qui rend possible l’érotique, ou appartient-il à l’érotique de constituer l’occasion du
16. Par exemple, le passage de l’érotique à l’éthique, de l’attraction charnelle au respect, peut être pensé comme une tendance qui s’accomplit, avec le vieillissement, dans le mariage (évidemment, dans les cas heureux, quand il ne se finit pas par la haine). Mais peut-on penser aussi le revers, notamment le passage de l’éthique à l’érotique ?
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
148 Cristian Ciocan
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 148 / 160
- © PUF - 15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 149 / 160
- © PUF -
surgissement de l’éthique ? Ou bien ne serait-ce ni l’un ni l’autre – et alors il conviendrait de reformuler autrement la question ?
Continuons notre lecture avec un autre fragment : « Le mouvement de l’amant devant cette faiblesse de la féminité, ni compassion pure, ni impassi-bilité, se complaît dans la compassion, s’absorbe dans la complaisance de la caresse » (TI, 235). Cependant, celui qui aime « se complaît-il » vraiment dans la compassion ? Que signifie ici la « complaisance de la caresse » ? La caresse est-elle complaisante ou complaisance ? Comment comprendre ces phrases ? Il est vrai que les deux expressions – « se complaire » et « complai-sance » – ont des nuances négatives dans le langage courant : on entend « se complaire » au sens où l’on se contente simplement de la situation où l’on est, sans essayer autre chose, sans tenter de la dépasser ; le « se complaire » se rapproche ainsi de l’indolence. De même, la complaisance possède une nuance de manque de sincérité, d’amabilité conventionnelle et fausse. Levinas semble toutefois viser autre chose, comme en témoigne la récurrence du com- qui se trouve dans les formes com-plaît, com-passion, com-plaisance, donc l’« avec » et l’« ensemble ». Il s’agit, notamment, de la passion d’être deux, qui se modalise soit comme responsabilité dans le rapport éthique, soit comme jouissance et plaisir dans l’érotisme. Bien que le mouvement de celui qui aime ne soit ni pure compassion, ni impassibilité (remarquons que la passio est présente dans les deux termes), ce mouvement de l’amant « se complaît dans la compassion ». Nous comprenons très bien pourquoi l’amour érotique n’est précisément pas « une pure compassion », comme Levinas le dit textuel-lement, car la pureté de la compassion relève d’un registre complètement désintéressé, d’une bienveillance qui n’attend rien pour soi : de l’éthique. Mais dans l’érotisme il y a toujours une composante essentielle de l’intérêt, il y a toujours une exigence du « pour soi », car celui qui aime cherche (aussi) son plaisir propre dans l’aimée, et le cherche bien sûr avec l’aimée (le com- dont nous avons parlé), en cherchant à la fois son plaisir. D’une certaine façon, l’égoïsme est encore présent (ce qui est visible particulièrement au moment où l’amour s’invertit en jalousie). La com-passion, quand elle est pure, est strictement éthique (la compassion pour la veuve et l’orphelin), la passio qui est présente à l’intérieur de cette compassion étant d’ordre moral : ce n’est pas le corps propre mais seulement le corps de l’autre qui est engagé, par ses frustes besoins vitaux, tels le froid ou la faim. En retour, avec le pas-sage dans la situation érotique, la passio n’est plus morale, la passion avec et pour l’autre ne relève plus de l’ordre éthique : l’affectivité implique cette fois la chair propre, dans sa plénitude, tandis que le corps de l’autre n’est pas visé dans ses besoins vitaux, mais dans l’irisation gratuite de la chair érotisée.
Dans la situation éthique, dans la compassion pure, privée de com-plaisance, le corps propre est ascétique, sec, en retrait : le cœur est ardent, mais la chair est froide ; le bien cherché est seulement celui de l’autre, non pas le mien. En revanche, dans la situation érotique, on ne saurait ignorer que le bien cherché est aussi celui du sujet ; la chaleur couvre non seulement son cœur, mais aussi l’entièreté de sa chair en incandescence. La compassion
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 148 / 160
- © PUF -
149 La phénoménologie levinassienne du corps dans Totalité et Infini
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 149 / 160
- © PUF -
n’est plus morale, mais il s’agit d’un s’éprouver-avec-l’autre, comme épreuve de l’être incarné de chacun, dans la séparation irréductible de chaque partie17. C’est ici que surgit la com-plaisance, comprise non pas comme méfiance cachée, mais – étymologiquement – comme le fait de partager le même plai-sir, le même bonheur, de se délecter du plaisir de l’autre, jouir dans et par la jouissance de l’autre. C’est dans cette direction – peut-être – qu’il faut entendre le syntagme levinassien qui nous a intrigué : « complaisance de la caresse ».
Néanmoins, il faut nous demander si la caresse envisagée ici doit être comprise uniquement comme caresse érotique. Certes, on peut envisager toutefois plusieurs modalités distinctes de la caresse, des modes différents, se situant à des niveaux et à des contextes spécifiques : car un amant ne caresse pas la peau nue de son amante, comme un parent caresse son enfant, ou une sœur de charité un malade incurable, ou enfin comme un vieillard, oublié des siens, n’a plus que son chien à caresser. Ainsi, l’érotique n’est qu’une modalité parmi d’autres de la caresse. Comment la préciser ? La caresse, le geste de toucher doucement quelqu’un, exprime tout simplement une sorte d’affection calme envers quelqu’un, et non pas nécessairement un amour de nature érotique. Celui qui est caressé se caractérise par une sorte de passi-vité : une certaine tranquillité ou sérénité est nécessaire pour que la caresse soit possible, car on ne peut pas caresser quelqu’un qui bouge indéfiniment et impatiemment. Souvent, celui qui est caressé est plutôt fragile ou vulné-rable, comme dans le cas d’un enfant malade qui reçoit la caresse de sa mère à la manière d’un soulagement. Ce n’est peut-être pas par hasard que les enfants se laissent caressés par leurs parents le plus souvent quand ils sont malades, c’est-à-dire vulnérables et fragiles. Dans la caresse non-érotique, il s’agit aussi d’une sorte de protection, d’un geste qui confère une sorte d’abri intersubjectif : il s’agit de défendre autrui devant l’inconnu, devant le mal possible qui l’entoure (la maladie, la souffrance, la mort, la solitude). Cette forme de caresse n’implique donc aucun plaisir, aucune satisfaction, aucun sensualisme : ni du côté de celui qui caresse, car sa chair est ascétique et non-concupiscente, ni du côté de celui qui se laisse caresser car la touche délicate de la caresse lui donne peut-être une sorte de tranquillité, de soulagement, mais non pas de plaisir ou de satisfaction proprement-dite. Dans cette forme de caresse non-érotique (tout comme dans le soin des malades, où scintille l’exigence de ne laisser pas l’autre seul avec sa souffrance), le visage de l’autre est présent et c’est pourquoi elle s’accorde avec le rapport éthique. Si le désir est présent, il s’agit uniquement du Désir éthique, désir sans concupiscence. Par rapport à celui-ci, la caresse érotique s’individualise parce qu’elle s’entre-mêle avec la volupté, donc le désir qui l’anime n’est pas sans concupiscence. Quand l’amant caresse son aimée dans sa nudité érotisée, il ne s’agit d’aucune protection, d’aucun soulagement, mais d’un tendre sensualisme. Même s’il
17. Nous rappelons ici une affirmation très significative du Temps et l’Autre : « Le pathétique de la volupté est dans le fait d’être deux » (TA, 78).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
150 Cristian Ciocan
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 150 / 160
- © PUF - 15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 151 / 160
- © PUF -
s’agit d’une délicatesse de la sensibilité, ce n’est pas exactement une vulnéra-bilité qui relève d’une souffrance ou d’une fragilité douloureuse. La chair de celui qui caresse est d’autant moins en réserve, comme dans la caresse non-érotique, mais elle est enflammée par un désir inassouvissable. Le visage s’obscurcit et, dans l’expérience érotique, la dimension éthique s’efface.
Ouvertures
Nous avons suivi jusqu’ici plusieurs rapports que l’analyse levinassienne de la chair avait traversés, toujours sous le signe de l’ambiguïté, dans le projet philosophique de Totalité et Infini : entre le corps et la conscience, le corps et l’élément, le corps et l’habitation, le corps et le travail, et, finalement, entre le corps et l’autre. Selon une perspective concrète sur ce paysage labyrinthique de la période moyenne de la production levinassienne, il devient possible d’avancer, dans une recherche ultérieure, vers la pensée tardive de Levinas, qui est illustrée par Autrement qu’être. Comment saisir la spécificité du phé-nomène de l’incarnation que ce deuxième magnum opus expose ? Nous trou-verons ici des formules paradoxales sur la chair, des tournures de phrases inhabituelles sur l’incarnation qui ne sont pas, bien sûr, des descriptions effectives, dans le sens technique et phénoménologique du mot. Ce ne sont pas des concepts ou des structures qui sont envisagés quand Levinas invoque le corps dans l’Autrement qu’être, en parlant de « la passivité de la blessure » ou de « l’hémorragie du pour-l’autre », de la peau, de la douleur comme envers de la peau, de la sensibilité à fleur de peau (même de « peau à rides »), du corps maternel (« maternité, gestation de l’autre dans le même »), de la subjectivité comme poumon, du sujet comme fait de chair et de sang, d’une nudité plus nue que tout dépouillement, d’une dénudation au-delà de la peau, se dénudant de sa peau. Ce ne sont pas des descriptions conceptuelles, bien sûr. Mais on ne peut pas dire non plus que ce sont seulement des méta-phores ou des formules poétiques, qu’on peut évacuer rapidement de l’hori-zon raisonnable de la philosophie.
Autrement qu’être est peut-être le plus énigmatique ouvrage de la philo-sophie du xxe siècle. En effet, le style de Levinas y est loin d’être strictement argumentatif et sa philosophie ne se déploie jamais comme une exposition thématique, structurée et explicite. Le style est plutôt inspiré qu’argumen-tatif, plutôt allusif qu’explicite. Il s’agit d’une pensée qu’on peut caracté-riser de « labile », sans fondement stable, sans structures fixes, sans thèses et hypothèses, sans démonstrations et arguments formels. Il n’y a aucune « terre ferme » sur laquelle le lecteur puisse marcher avec assurance, chaque page est plutôt comme un sable mouvant, qui ne garantit aucun point d’appui défi-nitif, aucun substrat solide. Dans le sens tectonique du terme, la philosophie tardive de Levinas n’est pas « continentale », car il n’y a aucun continent – consistant et ferme – qui la soutient, aucun sol. Elle relève plutôt d’une structure en forme d’archipel, où les petites îles paraissent et disparaissent,
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 150 / 160
- © PUF -
151 La phénoménologie levinassienne du corps dans Totalité et Infini
15 janvier 2014 04:02 - Descartes et More - Collectif - Études philosophiques - 155 x 240 - page 151 / 160
- © PUF -
se signalent et se volatilisent au gré du temps. Le lecteur impatient peut res-sentir une certaine irritation devant cette manière inhabituelle de construire les phrases, dotées d’un rythme saccadé et précipité, de métaphores insolites. Mais cela reflète peut-être le caractère extra-ordinaire de cette pensée, comme si elle provenait d’ailleurs. La pensée de Levinas reflète toujours cette étran-geté, comme s’il s’agissait d’une voix étrangère : bien qu’il parle notre langue, on l’entend comme à travers un brouillard. Il la parle, cette langue, à la manière d’un étranger, d’un inconnu venu d’un autre pays. On l’écoute, on a la vague impression d’entendre quelque chose, mais aussitôt on en ressent l’impossibilité de le capter, ce quelque chose fuit aussitôt, irrémédiablement. On ne peut pas saisir cette pensée entre nos mains et la tenir devant les autres en affirmant : là voilà. Elle est plutôt un Dire, aux frontières de l’inef-fable ou de l’indicible, et moins un Dit résumable et thématisable. Comme du sable, cette pensée nous glisse entre les doigts et, ainsi, nous échappe à jamais. Toute la tentative pour l’expliciter, la traduire, la faire nôtre, la ren-dre « solide » et concrète, se confronte à cette limite de l’intransmissible, à ce caractère volatil. Non seulement sa traduction dans notre langue la trahirait, mais cela supposerait en outre de donner une consistance à ce qui rejette toute consistance, ce serait chercher à stabiliser ce qui est réfractaire à toute stabilité. C’est une pensée trépidante, témoignant, comme le dit Levinas lui-même, d’un « essoufflement de l’esprit ou l’esprit retenant son souffle » (AE, 5), ou d’un « essoufflement de l’esprit expirant sans inspirer » (AE, 17).
Cristian CiocanInstitut de Philosophie « Alexandru Dragomir » de Bucarest /
Société Roumaine de Phénoménologie
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 89
.122
.36.
118
- 27
/05/
2014
07h
31. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 89.122.36.118 - 27/05/2014 07h31. ©
P.U
.F.