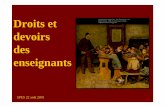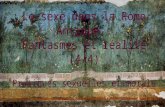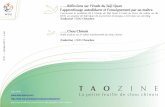La libération par le sexe. L’homosexualité dans Race de monde et Oh Miami Miami Miami
Les orientations de valeur des enseignants d'éducation physique. Influence du sexe, de l'âge et de...
-
Upload
univ-brest -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Les orientations de valeur des enseignants d'éducation physique. Influence du sexe, de l'âge et de...
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=STA&ID_NUMPUBLIE=STA_081&ID_ARTICLE=STA_081_0089
Les orientations de valeur des enseignants d’éducation physique. Influence du sexe, de l’âge et de l’ancienneté
par Denis PASCO, Gilles KERMARREC et Jean-Yves GUINARD
| De Boeck Universi t é | St a ps
2008/3 - N° 81ISSN 0247-106X | ISBN 2-8041-5779-1 | pages 89 à 105
Pour citer cet article : — Pasco D., Kermarrec G. et Guinard J.-Y., Les orientations de valeur des enseignants d’éducation physique. Influence du sexe, de l’âge et de l’ancienneté, St aps 2008/3, N° 81, p. 89-105.
Distribution électronique Cairn pour De Boeck Université.
© De Boeck Université. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
Les orientations de valeur desenseignants d’éducation physique.
Influence du sexe,de l’âge et de l’ancienneté
Denis PASCOUniversité Européenne de Bretagne, France
Université de Brest, EA 3883UFR Sport et Éducation Physique
20 avenue Le GorgeuCS 93 837
29238 Brest Cedex [email protected]
Gilles KERMARRECUniversité de Bretagne OccidentaleUFR Sport et Éducation Physique
20 avenue Le GorgeuCS 93 837
29238 Brest Cedex 3
Jean-Yves GUINARDUniversité de Bretagne OccidentaleUFR Sport et Éducation Physique
20 avenue Le GorgeuCS 93 837
29238 Brest Cedex 3
RÉSUMÉ : L’objet de cette étude est d’examiner l’influence dugenre, de l’âge et de l’ancienneté sur les orientations de valeurd’enseignants d’éducation physique. Les orientations de valeurreprésentent un système de croyances qui guide les enseignantsdans leurs choix de contenus. La version révisée de l’inventairedes orientations de valeur (VOI) a été utilisée pour recueillir lesdonnées de 157 enseignants travaillant dans différentes régionsde France. Les scores totaux sur chacune des orientations de
valeur ont été calculés et utilisés pour diviser les enseignants en deux groupes représentant des catégo-ries de priorités forte et faible. Le test khi-deux a été utilisé pour examiner les données de genre, d’âgeet d’ancienneté. Les résultats indiquent que 83 % des enseignants prennent des décisions sur les conte-nus à enseigner à travers au moins une orientation de valeurs. Il n’y a pas de différences significativessur le genre, l’âge et, pour quatre orientations de valeur, sur l’ancienneté. Les priorités des enseignantspour le processus d’apprentissage évoluent au cours de leur carrière.MOTS-CLÉS : orientations de valeur, éducation physique, croyances des enseignants.
ABSTRACT: Physical education teacher’s value orientations. Influence of gender, age and experience.The purpose of this study was to examine the influence of gender, age and experience on physical edu-cation teachers’ value orientations. Value orientations represent theoretical belief systems that guideteachers’ curricular decision making. The revised Value Orientation Inventory (VOI) was used to col-lect data from 157 teachers working in differents regions of France. Total scores from each value orien-tation on the VOI were computed and used to divide teachers into two groups representing high andlow priority categories. Chi-square tests were used to examine the data by gender, age and experience.Results indicated that 83 % of the physical education teachers made consistent curricular and instruc-tional decisions within on or more of the value orientations. There were no significant differences basedon gender, age and, for four value orientations, on experience. Teachers’ priority on learning processdeveloped on their career.KEY WORDS: value orientations, physical education, teacher beliefs.
DENIS PASCO • GILLES KERMARREC • JEAN-YVES GUINARD
Denis Pasco • Gilles Kermarrec • Jean-Yves Guinard90
Les systèmes éducatifs sont confrontés à desdifficultés récurrentes dans la mise en œuvredes programmes scolaires. De nombreux tra-vaux ont souligné les décalages entre les orien-tations des programmes et la réalité du terrain(Brennan, 1996 ; Tardif & Lessard, 1999 ;Pasco, 2005). Plusieurs facteurs sont avancésdans la littérature pour expliquer ces difficultés :les ressources financières, matérielles ou humai-nes, les caractéristiques du public scolaire ouune implantation de type « top-down », c’est-à-dire un texte élaboré par un groupe d’expertsau niveau central et diffusé auprès des ensei-gnants. Un facteur moins évident, les orienta-tions de valeur des enseignants, constitue unobjet de recherche dans le monde de l’éduca-tion physique (EP) 1 aux États-Unis, au Canada,en Chine et plus récemment en France (Pasco,2004). Cette approche étudie l’influence desorientations de valeur des enseignants d’éduca-tion physique sur les décisions de nature péda-gogique.
Selon Kerlinger et Lee (2000), l’intérêt pourla compréhension et l’étude des croyances estbasée sur l’idée que les différences de valeursconstituent l’essence majeure des choix et desconflits humains. Dans la fabrication de la déci-sion curriculaire, les choix sont fréquemmentbasés sur les croyances au regard de la naturede l’apprenant, de l’importance de la disciplinescolaire et du rôle de l’école dans la société.Durant les vingt-cinq dernières années, des cher-cheurs en éducation ont développé l’idée que lesdécisions des enseignants à propos des objectifs,des contenus, du style pédagogique et de la pro-cédure d’évaluation reposaient sur un ensemblede positions philosophiques ou d’orientationsde valeur (Jewett, 1994). Les orientations devaleur représentent les systèmes de croyancesdes éducateurs à propos des contenus qu’ilsenseignent, de la façon dont ils sont enseignéset, par extension, des contenus qui sont appris.
Plusieurs spécialistes du curriculum (Eisner& Vallance, 1974 ; Orlosky & Smith, 1978 ;Giroux, Penna & Pinar, 1981 ; McNeil, 1985 ;Schubert, 1986 ; Ornstein & Hunkins, 1988)ont travaillé à classifier et à décrire ces orienta-tions de valeur. Les études de Eisner et Val-lance (1974) montrent que les orientations devaleur reflètent des positions philosophiques.Ils postulent que les enseignants émettent desjugements basés sur un système de croyancesqui intègre des connaissances conscientes ouinconscientes en rapport avec les caractéristi-ques des enseignants, du contexte et des con-naissances du corps. Eisner et Vallance (1974)identifient cinq orientations possibles pour unprogramme en fonction des valeurs explicite-ment ou implicitement véhiculées : le rationa-lisme académique, la technologie, les processuscognitifs, l’auto-actualisation et la reconstruc-tion sociale. Jewett et Bain (1985) ont repris cesorientations en éducation physique.
1. CADRE THÉORIQUE
Les valeurs se révèlent à l’occasion de choixqui traduisent un jugement des acteurs, desstructures et des institutions sur ce qui est préfé-rable ou désirable (Houssaye, 1992). Une valeurest un principe fondateur et régulateur del’exercice du jugement et des actions conduitespar les membres d’une communauté (Reboul,1992 ; Guillot, 2000). Elle constitue une réfé-rence qui oriente les convictions et les comporte-ments. Pour un individu donné qui choisit, plusou moins consciemment, d’adhérer à certainesvaleurs, cette référence devient sa préférence.
En fonction des contraintes de temps, desressources disponibles et des contenus à ensei-gner définis par les programmes, les profes-seurs font des choix et déterminent des prioritéspour les élèves. Les orientations de valeurreprésentent les perspectives éducatives qui
1. Nous désignons cette discipline par « éducation physique » (EP) en accord avec la littérature internationale en ce domaine.
91Les orientations de valeur des enseignants d’éducation physique
sous-tendent ces priorités. En référence àEisner et Vallance (1974) et à partir de l’analysedes discours de cinquante spécialistes du curricu-lum, Jewett et Bain (1985) ont dégagé cinq orien-tations de valeur en éducation physique : lamaîtrise de la discipline, le processus d’apprentis-sage, l’auto-actualisation, la responsabilisationsociale et l’intégration écologique.
Les enseignants dont l’orientation prépon-dérante est la maîtrise de la discipline (MD) cen-trent les apprentissages sur le corps deconnaissances le plus traditionnel du domainedisciplinaire. Les tenants de cette approchecroient à la nécessité de préserver et de trans-mettre un héritage culturel à travers des con-naissances de base (McNeil, 1985). Les élèvessont attendus sur leur maîtrise des contenus etsur la démonstration de leur efficacité (Hirst,1974). En éducation physique, les enseignantscentrent leur enseignement sur la maîtrise deconnaissances en physiologie et en biomécani-que ainsi que sur les connaissances techniqueset tactiques liées aux activités physiques prati-quées. L’orientation de valeur de la maîtrise dela discipline apparaît dans le travail de Rink(1985) et de Siedentop (1990). Corbin et Lind-sey (1987) présentent des exemples de cetteorientation pour l’éducation à la santé.
Les enseignants valorisant le processusd’apprentissage (PA) s’attachent à ce que les élè-ves « apprennent comment apprendre » denouvelles connaissances en transférant ce qu’ilssavent déjà à de nouvelles situations. Papert(1980) soutient que l’apprentissage d’habiletésrepose sur la capacité des individus à compren-dre et à synthétiser les informations à partir desconnaissances qu’ils possèdent. Dans le cadredu processus d’apprentissage, les enseignants etles élèves s’appuient sur une division des tâchesen différentes composantes détaillées (Bloom,1981). Les élèves apprennent à identifier lesconditions pour réussir une performance dansle but de faciliter les futurs apprentissages.Cette approche a été proposée en éducationphysique par Lawson et Placek (1981).
Les enseignants qui centrent leur enseigne-ment sur l’auto-actualisation (AA) assignent unegrande priorité au développement personnelet à l’autonomie de l’élève (Maslow, 1979). Lescontenus d’enseignement s’attachent au déve-loppement des potentialités de chaque élève.Les situations d’apprentissage visent le bien-être des élèves et leur permettent d’acquérirune connaissance d’eux-mêmes. L’approched’Hellison (1985) est un exemple de l’orienta-tion de l’auto-actualisation en éducation physi-que. Cette approche est centrée sur la maîtrisede soi qui conduit à la stabilité, la participationet la responsabilité personnelle.
L’orientation de la responsabilisation sociale(RS) conduit les élèves à analyser le contextedans lequel ils vivent et travaillent. Ce contexteest construit autour de facteurs sociaux, politi-ques et économiques qui influencent les déci-sions dans et hors de l’école (Apple, 1982). Lesélèves apprennent à poser des questions cri-tiques et à développer de nouvelles stratégiespour construire un monde plus solidaire(Freire, 1970). Pour les enseignants qui valori-sent la responsabilisation sociale, le but princi-pal est d’augmenter les interactions socialesentre les élèves. Les contenus d’enseignementsont définis en termes de coopération, de tra-vail d’équipe et de respect des autres. En édu-cation physique, cette approche apparaît dansle travail de Griffin (1985) et Bain, Wilson etChaikind (1989).
L’orientation de valeur de l’intégration écolo-gique (IÉ) est centrée sur la compréhension desrelations entre les individus, les contenus de ladiscipline et l’environnement. Les élèvesapprennent à construire un équilibre qui favo-rise et utilise les meilleures ressources (Jewett &Ennis, 1990). Cette orientation a été introduitepar Dewey (1916) et développée par Colwell(1985). L’apprentissage est une expériencepersonnelle d’intégration à un environnementcomplexe et en changement continuel. Lesenseignants centrés sur l’intégration écologiqueproposent des situations d’apprentissage qui
Denis Pasco • Gilles Kermarrec • Jean-Yves Guinard92
Figure 1. Les orientations de valeur en relation avec leur(s) pôle(s) d’influence
(Source : Jewett, Bain et Ennis, 1995, p. 34)
tiennent compte à la fois des élèves, de lamatière à enseigner et de la communauté danslaquelle ils travaillent. Cette approche a étédéveloppée en éducation physique par Jewettet ses associés (Jewett & Mullan, 1977 ; Jewett &Bain, 1985).
La figure 1, traduite de Jewett, Bain et Ennis(1995), situe les orientations de valeur en fonc-tion des trois pôles qui influencent le choix descontenus : l’individu, la matière et la société.Selon les orientations de valeur, un pôle et/ouun autre est privilégié. Ainsi, l’orientation MDest placée sur le pôle « matière », l’auto-actuali-sation sur le pôle « individu » et la responsabili-sation sociale sur le pôle « société ». Les autresorientations de valeur ont une polarité multi-ple. L’orientation PA emprunte à la fois au pôlede l’individu et à celui de la matière tandis quel’orientation IE dispose d’une triple polarité.
Jewett et al. (1995) ont retenu la notiond’orientation de valeurs pour insister sur ladirection des préférences éducatives des ensei-gnants. Cette notion traduit une tendance àprivilégier certaines finalités, certains contenuset certaines situations d’apprentissage. Lesauteurs distinguent ainsi chaque orientation
selon qu’elle constitue une priorité forte, faibleou neutre pour l’enseignant. La combinaisondes différentes orientations de valeur reflète lesystème de croyances de l’enseignant.
1.1. Les recherches sur les orientations de valeur en éducation physique
La plupart des recherches examinant lesorientations de valeur des enseignants d’éduca-tion physique ont été principalement réaliséespar Ennis et ses associés (Ennis, Mueller &Hooper, 1990 ; Ennis & Zhu, 1991 ; Ennis,1992 ; Ennis, Ross & Chen, 1992 ; Ennis, 1994).Ces études ont utilisé un questionnaire spécia-lement conçu par Ennis et Hooper (1988) pourévaluer les orientations de valeur des ensei-gnants d’éducation physique.
En utilisant cet instrument, Ennis, Muelleret Hooper (1990) ont examiné l’influence desorientations de valeur de 25 enseignantsd’école primaire employés dans la Wisconsin surleurs décisions en cours en mesurant les change-ments dans les préparations des leçons. Les con-clusions suggéraient que certaines dimensionsde l’exercice physique étaient évaluées selon lasensibilité des enseignants. Les enseignants
Maîtrise de
la discipline
Auto-
actualisation
Responsabilisation
sociale
Société
Matière Individu
Intégration
écologique
Processus
d'apprentissage
93Les orientations de valeur des enseignants d’éducation physique
développant des perspectives fortes pour la res-ponsabilisation sociale et faibles pour la maîtrisede la discipline laissaient plus d’opportunitésaux élèves pour prendre des décisions dans lescours que les autres enseignants.
Ennis et Zhu (1991) ont examiné les orien-tations de valeur de 90 enseignants travaillantdans la région centrale de l’ouest des États-Unis. Les résultats indiquent que 97 % desenseignants identifient une ou plusieurs orien-tations de valeur comme priorité forte ou fai-ble. L’étude montre aussi que le sexe, l’âge etl’ancienneté de l’enseignant n’influencent pasla définition de ses orientations de valeur.
Ennis, Chen et Ross (1992) ont réalisé uneétude similaire dans un secteur urbain situédans l’Est des États-Unis. Les résultats révèlentque seuls 7,6 % des enseignants placent unegrande importance dans la maîtrise de la disci-pline tandis que 56,8 % considèrent la responsa-bilisation sociale comme une priorité forte. Desrecherches qualitatives dans le même district(Ennis, Ross & Chen, 1992 ; Ennis, 1994) indi-quent que les enseignants qui placent unegrande priorité dans la responsabilisation socialese préoccupent essentiellement d’enseigner auxélèves le respect des autres et la coopération.
D’autres études se sont intéressées àl’influence des orientations de valeur dans lecontenu des leçons. Ennis (1992) a observé etinterviewé trois enseignants d’éducation physi-que expérimentés à propos des différentesorientations de valeur. L’auteur montre que lesenseignants planifient leurs cours en fonctionde leurs orientations de valeur et enseignent enconséquence lorsque la situation d’enseigne-ment est idéale, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas decontraintes environnementales (comportementdes élèves, temps alloué à l’éducation physique,conditions matérielles). Cependant, lorsqu’unecontrainte se présente, des compromis sont faitsen termes de contenus enseignés. Dans ce cas,les enseignants sont moins satisfaits de leurenseignement.
Chen et Ennis (1996) ont observé et inter-viewé deux enseignants d’éducation physiquecentrés sur deux orientations de valeur diffé-rentes de façon à établir une concordance entreleur orientation prioritaire et le contenu deleur cours. Les auteurs montrent que ces deuxenseignants développent un curriculum diffé-rent en relation avec leur orientation priori-taire. L’un est focalisé sur l’analyse des habiletésen sport et leur relation (maîtrise de la disci-pline/processus d’apprentissage) tandis quel’autre s’intéresse davantage aux concepts etcomportements associés aux responsabilitéssociales comme le respect de l’enseignant etl’obéissance aux règles. Chen et Ennis (1996)soulignent que les deux enseignants utilisentles activités sportives comme moyen plutôt quecomme fin. Les auteurs en concluent que la cla-rification des orientations de valeur devrait êtreune première étape avant toute tentative demise en œuvre de nouveaux contenus ou denouvelles stratégies d’enseignement.
Les études sur les orientations de valeur desenseignants d’éducation physique se sont aussidéveloppées dans le cadre de comparaisonsinternationales. Une étude conduite en Chinepar Chen, Lui et Ennis (1997) a comparé lafaçon dont chaque orientation de valeur estprioritaire dans la culture américaine et chi-noise. Les résultats montrent que la maîtrise dela discipline et l’auto-actualisation ne semblentpas être influencées par l’une ou l’autre culturedans la mesure où un pourcentage similaired’enseignants d’EP américains (31,9 %) et chi-nois (32,6 %) sélectionnent ces orientations enpriorité. Cependant, des différences importan-tes ont été trouvées pour d’autres orientations.Les Chinois accordent une grande importanceau processus d’apprentissage (43,7 % vs24,4 %) et à l’intégration écologique (46,2 % vs22,4 %) alors que les Américains donnent unegrande priorité à la responsabilisation sociale(47,7 % vs 4 %). Ces résultats conduisent lesauteurs à suggérer une différence culturelleentre ces deux pays dans le choix des orienta-tions de valeur en EP.
Denis Pasco • Gilles Kermarrec • Jean-Yves Guinard94
Une autre étude conduite par Banville,Desrosiers et Genet-Volet (2002) compare lespriorités des enseignants québécois et améri-cains. Les résultats montrent que les ensei-gnants des deux pays accordent la mêmeimportance à la maîtrise de la discipline (Qué-bécois, 38,7 % ; Américains, 31,9 %). Cetteorientation de valeur n’est pas influencée parchaque culture. Des différences importantesapparaissent pour les autres orientations devaleur. Les Québécois identifient le processusd’apprentissage (39,9 % vs 24,4 %) comme unepriorité forte, tandis que les Américains placentune grande priorité dans la responsabilisationsociale (47,7 % vs 15 %). Les auteurs analysentces différences au regard de l’influence de laculture américaine au Québec.
1.2. Objectifs de l’étude
Les études sur les orientations de valeurmontrent la forte implication de ces systèmes decroyances dans la mise en œuvre de l’enseigne-ment en EP. Il apparaît opportun de connaîtreles orientations de valeur des enseignants avantd’engager des réformes d’envergure pour cettediscipline. Cette étude vise, d’une part, à carac-tériser les orientations de valeur d’un échan-tillon représentatif d’enseignants français et,d’autre part, à examiner l’influence de trois fac-teurs identifiés dans la littérature comme sus-ceptibles d’affecter les orientations de valeur : lesexe, l’âge et l’ancienneté.
L’auto-actualisation est centrée sur le bien-être individuel et la maîtrise de soi, qui sont fré-quemment associés au sexe féminin (Ruble,1983). Ennis et Zhu (1991) suggèrent qu’en rai-son des différences historiques dans l’éducationdes filles et des garçons, les enseignants hommeset femmes peuvent développer des perspectiveséducatives différentes. De même, Ennis et Chen(1995) remarquent que les systèmes de croyan-ces se structurent généralement au cours des dixpremières années d’enseignement. Les orienta-tions de valeur des enseignants disposant de dixou vingt ans d’ancienneté sont plus stables etmoins susceptibles d’évoluer. Enfin, lorsqu’ils
ont plus de vingt ans d’ancienneté, leur systèmede croyances est fermement établi et peu suscep-tible de changer. Les enseignants expérimentéssont soumis depuis de nombreuses années à ceque Zeichner et Tabachnik (1983) ont désignésous le terme de « pression institutionnelle ».Pour Schein (1988), cette pression présentedeux caractéristiques principales : elle reflète ladimension la plus traditionnelle de la disciplineenseignée ; elle est le moyen par lequel unegénération d’enseignants transmet la culturescolaire à la suivante. Dans la mesure où l’orien-tation de valeurs la plus traditionnelle est la maî-trise de la discipline, on peut s’attendre à cequ’elle soit adoptée par les professeurs expéri-mentés. Les enseignants inexpérimentés, pluscritiques vis-à-vis du système éducatif, s’oriente-raient plus facilement vers des orientations asso-ciés à des buts socioculturels.
Notre travail vise à étudier l’influence dusexe, de l’âge et de l’ancienneté des enseignantsd’EP sur leurs orientations de valeur. Nous for-mulons l’hypohèse que la culture spécifique del’EP en France affecte l’influence de ces troisfacteurs sur les orientations de valeur.
2. MÉTHODE
2.1. Participants
Les données de la direction de la prospec-tive et du développement du ministère del’Éducation nationale permettent de caractéri-ser la population des enseignants d’EP enFrance selon leur sexe, leur âge et leur niveaude diplôme. Pour disposer d’un échantillonreprésentatif, nous nous sommes appuyés surces caractéristiques de la population. Nousavons retenu dans chaque catégorie une pro-portion d’enseignants proches de la populationtotale. L’échantillon retenu se compose de 157professeurs d’éducation physique exerçant encollège ou en lycée et volontaires pour partici-per à cette recherche. Le graphique 1 comparela composition de cet échantillon à la popula-tion totale.
95Les orientations de valeur des enseignants d’éducation physique
Graphique 1. Étude de représentativité de l’échantillon
La proportion d’hommes est un peu plusélevée dans l’échantillon que dans la popula-tion totale (respectivement 56,6 % et 53,38 %).A contrario, celle des femmes est plus faible(43,4 contre 46,62). Par catégorie d’âge et desexe, les proportions sont proches. On noteun peu moins de femmes dans les moins de 30ans et les 56 ans et plus. On observe un peuplus d’hommes dans les catégories 30 à 49 ans
et 50 à 55 ans. L’échantillon peut être consi-déré comme représentatif de la populationtotale.
Le tableau 1 présente l’étude démographi-que de l’échantillon. Il se compose de 89 hom-mes et de 68 femmes. La répartition partranche d’âge et d’ancienneté indique des pro-portions proches permettant d’engager descomparaisons entre catégories.
Tableau 1. Étude démographique de l’échantillon
0
10
20
30
40
50
60
70
National Echantillon Nat Ech Nat Ech Nat Ech
Moins de 30 ans 30 à 49 ans 50 à 55 ans 56 ans et plus
Femmes
Hommes
Caractéristiques n %
Genre des enseignants
Homme 89 56,5
Femme 68 43,5
Âge
23-29 43 27,39
30-39 33 21,02
40-49 34 21,65
50-60 47 29,94
Ancienneté (années)
1-5 44 28,02
6-15 36 22,93
16-25 36 22,93
25+ 41 26,12
Denis Pasco • Gilles Kermarrec • Jean-Yves Guinard96
2.2. Matériel
Le but principal de cette étude étant de carac-tériser les orientations de valeur des enseignantsd’EP français, nous avons retenu une approchequantitative sous forme d’un questionnaire.Ennis et Hooper (1988) ont développé un outilde mesure des orientations de valeur des ensei-gnants en éducation physique, le Value Orienta-tion Inventory (VOI). À la suite des travauxeffectués avec cette version, plusieurs indices ontmis en évidence le besoin d’une révision substan-tielle des propositions. Ennis et Chen (1993) ontconduit un examen de la représentativité de cha-que item et construit une nouvelle version, leVOI-2. Cet instrument a été traduit et validé auCanada par Banville, Desrosiers et Genet-Volet(1999) puis adapté et validé en France par Pasco,Guinard et Kermarrec (2008).
La version française du VOI-2 est composéede dix-huit ensembles de cinq énoncés corres-pondant chacun implicitement à l’une des orien-tations de valeur. La tâche de l’enseignant est declasser ces énoncés par ordre d’importance, cinq(5) représentant l’énoncé le plus important del’ensemble pour lui et un (1) l’énoncé qu’il jugele moins important. On obtient pour chaqueprofesseur un score total pour MD, PA, AA, RS
et IE. La figure 2 présente un exemple d’unprofil d’orientations de valeur d’un enseignant.Dans la littérature, un écart-type de plus oumoins 0,6 par rapport à la moyenne est retenupour dégager une orientation de valeurs pré-pondérante (forte ou faible). Dans le cas où lescore de l’orientation de valeurs est comprisentre la moyenne et cet écart-type, elle est iden-tifiée comme neutre. Deux ensembles de cinqénoncés avec les orientations de valeur corres-pondantes sont présentés en annexe. À la suitedes quatre-vingt dix items, une seconde partiedu questionnaire permet de caractériser l’âge, lesexe et l’ancienneté de l’enseignant.
2.3. Procédure
Le recueil de données a été assuré dans dif-férentes régions de France au cours du premiersemestre de l’année 2004 par quinze stagiairesformés à la passation du questionnaire. Cetteformation a consisté en un travail dirigé consa-cré à une simulation de passation du question-naire pour identifier les explications à donnerau professeur et l’assistance en cas de besoin.Chaque stagiaire était chargé de recueillir lesdonnées auprès d’une partie des enseignantscomposant l’échantillon.
Figure 2. Exemple de profil d’orientations de valeur d’un enseignant
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Maîtrise de la
discipline
Processus
d'apprentissage
Auto-actualisation Intégration
Ecologique
Responsabilisation
sociale
Orientations de valeur
97Les orientations de valeur des enseignants d’éducation physique
Cette approche a été préférée à un recueildes données par voie postale. Le VOI-2 est unquestionnaire à choix forcé. Cette forme est spé-cifique et nécessite une explication. De plus, letemps estimé pour répondre aux 18 ensemblesde 5 énoncés est de trente à quarante-cinq minu-tes. Ces contraintes rendent le recueil par voiepostale particulièrement difficile. Le taux moyende retour dans les études sur les orientations devaleur par voie postale est de 30 %. Une propor-tion non négligeable de questionnaires retournésne sont pas exploitables en raison du non-respectde la consigne de classement des énoncés de 1 à5. Banville et al. (2002) ont obtenu moins de 20 %de retour. Sur les 160 VOI-2 distribués aux sta-giaires pour notre étude, 157 ont été retournéset tous étaient utilisables.
3. RÉSULTATS
3.1. Les orientations de valeur des enseignants d’EP en France
Une analyse descriptive du profil des ensei-gnants indique que 83 % (n = 130) possèdent au
moins une orientation de valeurs forte ou faible.27 % placent une priorité dans une seule orienta-tion de valeurs et 29 % environ privilégient desénoncés se rapportant à deux orientations devaleur. Pour 15 %, il est possible d’identifier troisorientations de valeur et 9 % de l’échantillon secompose d’enseignants accordant une priorité àquatre orientations de valeur. Enfin, un profes-seur démontre une forte ou une faible prioritésur chacune des cinq orientations de valeur.
L’analyse présentée dans le tableau 2 indi-que que 52,8 % des enseignants démontrentune position constante (forte ou faible) pour leprocessus d’apprentissage (PA), 33 % pour laresponsabilisation sociale (RS), 31 % pourl’intégration écologique (IE), 30 % pour la maî-trise de la discipline (MD) et 26,7 % pour l’auto-actualisation (AA). L’écart-type mesuré pour leprocessus d’apprentissage (12,17) montre lespositions hétérogènes et contrastées des ensei-gnants pour cette orientation de valeurs.
Les résultats indiquent aussi des corréla-tions significatives entre les différentes orienta-tions de valeur (tableau 3).
Tableau 2. Analyse statistique descriptive des réponses pour les priorités forte et faible
M = moyenne ; E-T = écart-type ; n = nombre ; % = pourcentage
Tableau 3. Corrélations entre orientations de valeur
*p ! 0,01 ; **p ! 0,05
Priorité
Échantillon Forte Faibleorientations de valeur M E-T M E-T n % M E-T n %Maîtrise de la discipline 56,5 9,07 68,73 2,53 34 21,65 39,77 3,74 13 8,28Processus d’apprentissage 61 12,17 71,97 5,24 69 43,95 37,64 3,81 14 8,91Auto-actualisation 49 7,68 68 1,41 4 2,54 40,29 2,47 38 24,20Intégration écologique 48 8,18 67,17 3,06 6 3,82 39,2 3,58 43 27,39Responsabilisation sociale 54 10,37 70,9 4,89 27 17,2 39,28 3,95 25 15,92
MD PA AA IÉ RS
Maîtrise de la discipline 0,16** -0,45* -0,31* -0,48*Processus d’apprentissage -0,53* -0,59* -0,46*Auto-actualisation 0,33* 0,01Intégration écologique -0,06Responsabilisation sociale
Denis Pasco • Gilles Kermarrec • Jean-Yves Guinard98
Graphique 2. Évolution du rapport des enseignants à l’orientation de valeurs « processus d’apprentissage » (PA) au cours de leur carrière
La forme ipsative du VOI-2, c’est-à-direrésultant d’un questionnaire à choix forcéentraîne un grand nombre de liaisons négativesentre les orientations de valeur. Ainsi, l’orienta-tion de valeurs « processus d’apprentissage »est reliée négativement aux orientations devaleur « auto-actualisation » (-0,53 ; p ! 0,01),« responsabilisation sociale » (-0,46 ; p ! 0,01) et« intégration écologique » (-0,59 ; p ! 0,01). Il y adeux corrélations positives significatives : entreAA et IÉ (0,33 ; p ! 0,01) et entre MD et PA(0,16 ; p ! 0,05).
3.2. Les facteurs qui influencent les orientations de valeur des enseignants d’EP
Le test Khi-deux a été utilisé pour étudierles relations des orientations de valeur desenseignants avec l’âge, le sexe et l’ancienneté.
Les analyses Khi-deux des données de sexeet d’âge n’indiquent pas de résultats significatifs(sexe - "2=0,097, p=0,953 ; âge - "2=1,193,p=0,879). Ils sont significatifs pour l’orienta-tion de valeurs « processus d’apprentissage »(PA) et les catégories d’ancienneté 6-15 ans et16-25 ans. Le graphique 2 présente la distribu-tion des effectifs d’enseignants par catégorie
d’ancienneté selon qu’ils accordent une prioritéforte, faible ou neutre au processus d’appren-tissage.
En début (1 à 5 ans) et en fin de carrière(plus de 25 ans), on n’observe pas de différencesignificative entre le nombre d’enseignantsaccordant une priorité forte, neutre ou faibleau processus d’apprentissage. Entre 6 et 15 ansd’ancienneté, les écarts sont significatifs(X2 = 18,83 ; p ! 0,01). Les professeurs sontplus nombreux dans cette catégorie (n = 26 :m = 72,22 %) à considérer PA comme unepriorité neutre. Aucun enseignant ne consi-dère le processus d’apprentissage comme unepriorité faible. Entre 16 et 25 ans, les résultatssont également statistiquement significatifs(X2 = 14,74 ; p ! 0,05). Au sein de cet échan-tillon, on obtient une répartition équilibréeentre les enseignants qui considèrent PAcomme une priorité neutre et ceux qui en fontune priorité forte. Toutes catégories confon-dues, les professeurs disposant de 16 à 25 ansd’ancienneté sont les plus nombreux à considé-rer le processus d’apprentissage comme unepriorité faible.
18
26
20
10
21
14
20
3
7
4
Forte priorité 21 10 14 18
Priorité neutre 20 26 14 20
Faible priorité 4 0 7 3
1 à 5 ans 6 à 15 ans 16 à 25 ans plus de 25 ans
99Les orientations de valeur des enseignants d’éducation physique
4. DISCUSSION
L’objectif de cette étude était de présenterune description des orientations de valeur desenseignants d’EP français et d’identifier des fac-teurs explicatifs. À cette fin, un échantillonnagereprésentatif a été constitué : 157 participantsont renseigné le VOI-2, un questionnaire dontla version française a été validée (Pasco et al.,2008). Les relations entre les différentes échel-les (OV) du questionnaire ont été étudiées ainsique l’influence du sexe, de l’âge et de l’ancien-neté. Trois résultats significatifs se dégagent :un portrait spécifique des orientations devaleur des enseignants d’EP en France, deuxpositions contrastées sur les finalités de l’EP etl’influence de l’ancienneté sur le rapport desprofesseurs au processus d’apprentissage.
4.1. Un portrait spécifique des orientations de valeur des enseignants d’EP en France
Contrairement à la position développée parGuskey (1986), 83 % des enseignants d’EPdémontrent une position constante sur uneorientation de valeurs ou moins. Pour 74 %d’entre eux, il est possible d’identifier une prio-rité forte. Leurs réponses parmi 18 ensemblesd’énoncés suggèrent qu’ils choisissent consciem-ment ou inconsciemment les énoncés se rappor-tant constamment aux mêmes orientations devaleur. À travers leurs réponses, les enseignantsconfirment l’importance (ou la non-importance)d’un système de croyances éducatives particu-lier incluant un ensemble de connaissances et deméthodes correspondantes pour l’apprentis-sage des élèves en éducation physique.
Dans cette recherche, 29 % environ privilé-gient deux orientations de valeur, 15 % troisorientations et 9 % quatre orientations. L’hypo-thèse émise par Jewett et al. (1995) d’une struc-turation de l’enseignement en EP autour de lamaîtrise de la discipline n’est pas observée danscet échantillon. Les enseignants visent autre
chose que la seule maîtrise des contenus del’éducation physique. Ces résultats suggèrentque des perspectives multiples sur les buts del’enseignement et de l’apprentissage sontimbriquées dans le système de croyances desenseignants d’éducation physique. Bien quedes spécialistes des programmes d’EP regret-tent l’absence d’un consensus sur les buts del’éducation physique (Lawson, 1986 ; Pineau,1991), il semble impossible qu’une perspectiveunique puisse être supportée dans un avenirproche. Kliebard (1988) a placé cette diversitéphilosophique en perspective : « Les program-mes, après tout, sont le résultat d’une sélectiondes éléments d’une culture et reflètent par cer-tains aspects la diversité de cette culture… Cequi émerge comme une orientation dominantedes programmes n’est pas fonction de la forced’une seule proposition particulière mais del’interaction des idées sur les programmes et deleur écho ou non dans la société. De plus, sousla pression temporelle, on s’attend à ce qu’unepremière se développe tandis qu’une autredevient importante et que, dans une certainemesure, elles existent toutes côte à côte » (Klie-bard, 1988, 30).
Le processus d’apprentissage est une prio-rité forte des enseignants d’EP français (44 %).Ils se distinguent en cela de leurs homologuesaméricains, qui privilégient la responsabilisationsociale (Ennis & Chen, 1995). Les orientationsde valeur subissent l’influence de différencesculturelles sur les buts et les moyens de l’EP. Lesorientations de valeur des enseignants françaisse rapprochent par contre des enseignants chi-nois qui se centrent sur le processus d’appren-tissage et l’intégration écologique (Chen, Lui &Ennis, 1997) mais surtout, des enseignants qué-bécois qui accordent aussi une grande prioritéau processus d’apprentissage (Banville et al.,2002). Ces résultats montrent la nécessité detravailler l’hypothèse d’une influence euro-péenne de l’EP dans différents pays.
Denis Pasco • Gilles Kermarrec • Jean-Yves Guinard100
4.2. Deux positions contrastées sur les finalités de l’EP
Les corrélations dégagées entre les orienta-tions de valeur permettent d’identifier deuxpositions opposées vis-à-vis des missions oufinalités de l’EP. La première consiste à considé-rer que la mission première de l’EP est de faireapprendre aux élèves les connaissances spécifi-ques de cette discipline. Elle apparaît dans lacorrélation positive entre la maîtrise de la disci-pline (MD) et le processus d’apprentissage (PA).La seconde position considère que l’enseigne-ment de l’EP doit être finalisé par le développe-ment de l’individu. L’enseignant privilégie alorssoit la réalisation autonome de l’élève (AA) etson adaptation à l’environnement (IÉ), soit soninsertion dans la vie sociale (RS).
Ces deux perspectives se retrouvent dansl’histoire des finalités de l’école en France.Durkheim (1905) a dégagé deux orientationsfortes des finalités de l’école quelles que soientles époques : la valorisation de l’érudition etl’étude de toutes les sciences. S’inspirant de cetravail, Isambert-Jamati (1995) a caractérisé dupoint de vue des valeurs véhiculées les positionsdes différents acteurs du système éducatif àl’occasion des différentes réformes de l’école.Elle dégage deux orientations principales. Les« classiques » considèrent que l’école doit ins-truire les élèves par le travail et l’effort à la maî-trise des connaissances des différentes disciplinesscolaires. Les « modernes » envisagent l’écolecomme un lieu d’éducation de l’individu à laconnaissance de soi et des autres. Les travaux deDerouet (1992), Houssaye (1992) et Reboul(1992) confirment que ces deux positions sonthabituellement défendues dans les discours surles valeurs de l’école même si elles peuvent senuancer selon les époques.
Nos résultats montrent que les orientationsde valeur se combinent pour définir deux sys-tèmes de croyances typiques en éducation phy-sique. Le premier envisage l’EP comme unediscipline académique dont la finalité est deviser des savoirs disciplinaires légitimisés par
l’institution scolaire (dans les programmes). Lesecond considère l’EP comme une disciplinequi se penche sur l’individu dans le but de pré-parer sa vie future. Les enseignants prennentposition sur la place et le rôle de l’EP à l’école àtravers les orientations de valeur qu’ils privilé-gient. Ces résultats confirment les conclusionsde Roux-Perez (2003) sur l’identité profession-nelle des enseignants d’EP en France. Sonenquête met en relief un monde de l’EP cons-truit autour d’un clivage entre les tenants d’unecontinuité et d’une spécificité culturelle de l’EPà travers la maîtrise des contenus de la disci-pline et les tenants d’une centration sur l’élèvecomme acteur de ses apprentissages pour seconnaître et s’intégrer.
4.3. L’influence de l’ancienneté sur le rapport des enseignants au processus d’apprentissage
Le second but de cette recherche était d’étu-dier l’influence du sexe, de l’âge et de l’ancien-neté sur la définition des orientations de valeurdes enseignants. Les résultats font apparaîtreune stabilité temporelle des orientations devaleur des enseignants. Elles ne subissent pasl’influence du sexe, de l’âge et, pour quatred’entre elles, de l’ancienneté. L’idée que des sté-rérotypes liés au sexe ou à l’âge des professeurspuissent influencer leur système de croyancespeut être rejetée. Seul le positionnement desenseignants vis-à-vis du processus d’apprentis-sage évolue significativement au cours de leurcarrière.
Entre 6 et 15 ans d’ancienneté, les profes-seurs considèrent le plus souvent que le proces-sus d’apprentissage est une priorité neutre ouaffirment qu’il constitue une priorité forte deleur enseignement mais aucun des participantsà la recherche ne l’identifie comme une prioritéfaible. Entre 16 et 25 ans, on note une évolu-tion significative des enseignants considérant leprocessus d’apprentissage comme une prioritéfaible. Enfin, en début et en fin de carrière, leseffectifs se répartissent de façon équilibréeentre priorité forte et priorité neutre tandis que
101Les orientations de valeur des enseignants d’éducation physique
la tendance à accorder une priorité faible auprocessus d’apprentissage est minimisée.
Les travaux portant sur les trajectoires et lescarrières des enseignants révèlent des cohéren-ces provisoires, laissant place à d’éventuels ajus-tements, lorsque surviennent des changementsinstitutionnels, humains ou contextuels dansleurs parcours (Huberman, 1989 ; Roux-Perez,2005 ; Tardif & Lessard, 2005). Par exemple,l’étude de Roux-Perez (2005) en EP montreque, face aux changements, les enseignants« aménagent et recomposent alors certains élé-ments constitutifs de leur identité en fonctiondes situations, pour s’adapter et construire unmonde cohérent entre contraintes, ressourceset valeurs » (Roux-Perez, 2005, 75).
L’évolution observée dans notre étude nepeut pas être interprétée de façon définitive. Eneffet, la modification du rapport des enseignantsau processus d’apprentissage en milieu de car-rière peut être envisagée soit comme une remiseen cause en EP du modèle dominant del’apprentissage à l’école construit sur des connais-sances déclaratives et visant le développementcognitif de l’élève, soit comme une volonté derelativiser cette dimension par rapport à d’autresorientations de valeur possibles en EP, et notam-ment l’auto-actualisation, l’intégration écologi-que ou la responsabilisation sociale. L’enquêtepar questionnaire révèle ici toutes ses limitespuisqu’elle ne permet pas de caractériser précisé-ment la nature de ce changement. Des entretienscomplémentaires sont à mener avec des ensei-gnants d’EP en milieu de carrière pour mieuxcomprendre et expliquer ces choix.
5. CONCLUSION
Les enseignants d’EP véhiculent un ensem-ble de valeurs et de croyances, partagées avecd’autres enseignants, compatibles avec leurs pra-tiques professionnelles ou personnelles et repé-rables à travers leurs orientations de valeur.Cette étude montre l’intérêt à la compréhen-
sion de la diversité et de l’importance des diffé-rentes orientations de valeur dans unepopulation d’enseignants d’EP pour envisagerdes changements dans les contenus et les prati-ques. Curtney-Smith et Meek (2000) et Banville,Genet-Volet et Desrosiers (2001) ont expliquéles difficultés à la mise en œuvre des nouveauxprogrammes pour l’éducation physique dansleurs pays respectifs par le décalage entre lesorientations de valeur des enseignants et cellescontenues dans les textes.
Cette première étude nécessite d’être com-plétée. D’autres facteurs sont susceptiblesd’influencer les orientations de valeur desenseignants. Par exemple, Lawson (1983a,1983b) remarque que les différents typesd’activités physiques et sportives expérimentéspar les enseignants hommes et femmes et lesattitudes sociales à l’égard des sports masculinset féminins en général peuvent expliquer cer-taines différences dans les perceptions qu’ontles enseignants hommes et femmes des buts deleur travail. Il suggère que les hommes ayantpratiqué un sport traditionnel ont plus dechance d’être conservateurs dans leur choix decontenu en EP et donc de privilégier la maîtrisede la discipline. Par contre, les enseignantsayant pratiqué un sport ou une activité physi-que non traditionnelle ont plus de chance defaire preuve d’innovation dans les contenus. Ilfaudrait aussi étudier, par des observations enclasse, l’impact réel des orientations de valeurdes enseignants sur les contenus enseignés etleurs décisions en cours.
BIBLIOGRAPHIE
APPLE, M. (1982). Education and power. Boston : ARK.BAIN, L. L., WILSON, T. & CHAIKIND, E. (1989). Participant per-
ceptions of exercise programs for overweight women.Research Quarterly for Exercise and Sport, 60, 134-143.
BANVILLE, D., DESROSIERS, P. & GENET-VOLET, Y. (1999). Tra-duction et validation canadienne-française d’un ins-trument portant sur les orientations de valeur deséducateurs physiques. Avante, vol. 5, 2, 21-39.
Denis Pasco • Gilles Kermarrec • Jean-Yves Guinard102
BANVILLE, D., GENET-VOLET, Y., & DESROSIERS, P. (2001). Analy-se des valeurs véhiculées dans Le programme d’étu-des d’éducation physique au secondaire au Québec.Science et Motricité, 42, 37-46.
BANVILLE, D., DESROSIERS, P., & GENET-VOLET, Y. (2002). Com-parison of value orientations of Quebec and Ameri-can teachers : a cultural difference ? Teaching andTeacher Education, 18, 469-482.
BLOOM, B.S. (1981). All our children learning. New York :McGraw-Hill.
BRENNAN, D. (1996). Dance in the Northen Ireland Physi-cal Education Curriculum : A Farsighted Policy or anUnrealistic Innovation ? Women’s Studies InternationalForum, Vol. 19, 5, 493-503.
CHEN, A. & ENNIS, C. D. (1996). Teaching value-laden curri-culum in physical education. Journal of Teaching inPhysical Education, 15, 338-354.
CHEN, A., LUI, Z., & ENNIS, C. D. (1997). Universality anduniqueness of teacher educational value orienta-tions. Journal of Research and Development in Education,30, 135-143.
COLWELL, T. (1985). The ecological perspective in JohnDewey’s philosophy of education. Educational Theory,35, 255-266.
CORBIN, C. B. & LINDSEY, R. (1987). Concepts of physical fitnesswith laboratories. Duduque, IA : Wm. C. Brown.
CURTNEY-SMITH, M.D., & MEEK, G.A. (2000). Teachers’ valueorientations and their compatibility with the Natio-nal Curriculum for Physical Education. EuropeanPhysical Education Review, 6(1), 27-45.
DEROUET, J.L. (1992). Ecole et justice. De l’égalité des chancesaux compromis locaux ? Paris, Métailié.
DEWEY, J. (1916). Democracy and education. New York : Mc-Millan.
DURKHEIM, E. (1905). L’évolution pédagogique en France.Paris : PUF.
EISNER, E.W. & VALLANCE, E. (1974). Conflicting conceptions ofcurriculum. Berkeley, McCutchan.
ENNIS, C.D. & HOOPER, L.M. (1988). Development of an ins-trument for assessing educational value orientations.Journal of Curriculum Studies, Vol. 20, 3, 277-280.
ENNIS, C. D., MUELLER, L. K., & HOOPER, L. M. (1990). The in-fluence of teachers value orientation on curriculumplanning within the parameters of a theorical fra-mework. Research Quaterly for Exercice and Sport, 61,360-368.
ENNIS, C. D., & ZHU, W. (1991). Value orientations : A des-cription of teachers’goals for students learning. Re-search Quaterly for Exercice and Sport, 62, 33-40.
ENNIS, C. D. (1992). Curriculum theory as practiced : Casestudies of operationalized value orientations. Journalof Teaching in Physical Education, 11, 358-375.
ENNIS, C. D., ROSS, J., & CHEN, A. (1992). The role of valueorientations in curriculum decision making : A ratio-nale for teachers’goals et expectations. Research Qua-terly for Exercice and Sport, 63, 38-47.
ENNIS, C. D., CHEN, A. & ROSS, J. (1992). Educationnal valueorientations a a theoretical framework for experiencedurban teachers’ curricular decision making. Journal ofResearch and Development in Education, 25, 156-164.
ENNIS, C.D. & CHEN, A. (1993). Domain specifications andcontent representativeness of the revised ValueOrientation Inventory. Research Quaterly for Exerciceand Sport, 64, 436-446.
ENNIS, C. D. (1994). Urban secondary teachers’ value orien-tations : Delineating curricular goals for social respon-sabilities. Journal of Teaching in Physical Education, 13,163-179.
ENNIS, C. D., & CHEN, A. (1995). Teachers’ value orientationin urban and rural school settings. Research Quarterlyfor Exercise and Sport, 66, 41-50.
FREIRE, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York :Continuum.
GIROUX, H.A., PENNA, A. N., & PINAR, W. F. (1981). Curriculumand Instruction : Alternatives in Education. Berkeley,CA : McCutchan.
GUILLOT, G. (2000). Quelles valeurs pour l’école du XXIe siècle ?Paris : L’Harmattan.
GRIFFIN, P. (1985). Teacher perceptions of reactions toequity problems in middle school physical education.Research Quarterly for Exercice and Sport, 56, 103-110.
GUSKEY, T.R. (1989). Staff development and the process ofteacher change. Educational Researcher, 15(5), 5-12.
HELLISON, D. R. (1985). Goals and strategies for teaching physi-cal education. Champaign, IL : Human Kinetics.
HIRST, P. H. (1974). Knowledge and the curriculum. London :Routledge & Kegan Paul.
HOUSSAYE, J. (1992). Les valeurs de l’école. L’éducation autemps de sécularisation. Paris, Presses Universitaires deFrance.
HUBERMAN, M. (1989). La vie des enseignants. Evolution et bi-lan d’une profession. Neuchâtel, Paris : Delachaux etNiestlé.
ISAMBERT-JAMATI, V. (1995). Les savoirs scolaires. Enjeux so-ciaux des contenus d’enseignement et de leurs réformes.Paris : L’Harmattan.
JEWETT, A. E. & MULLAN, M. R. (1977). Curriculum design :Purposes and processes in physical education teaching-lear-ning. Reston, VA : AAHPER.
JEWETT, A.E. & BAIN, L.L. (1985). The curriculum process inphysical education. Duduque, IA :Wm.C. Brown.
JEWETT, A. E. & ENNIS, C. D. (1990). Ecological integration asa value orientation for curricular decision making.Journal of Curriculum and Supervision, 5, 120-131.
103Les orientations de valeur des enseignants d’éducation physique
JEWETT, A. E. (1994). Curriculum Theory and Research inSport Pedagogy. Sport Science Review, 3(1), 56-72.
JEWETT, A.E., BAIN, L.L. & ENNIS, C.D. (1995). The curriculumprocess in physical education (2nd ed.). Duduque, IA :Brown et Benchmark.
KERLINGER, F.N. & LEE, H.B. (2000). Foundations of behavioralresearch (4nd ed.). Orlando, Florida : Harcourt Col-lege Publishers.
KLIEBARD, H. M. (1988). The effort to reconstruct the modernAmerican curriculum. In L.E.Beyer & M.W. Apple(Eds.), The curriculum : Problems, politics and possibilities,Albany, State University of New York Press, 19-31.
LAWSON, H.A. & PLACEK, J.H. (1981). Physical education in seconda-ry schools : Curriculum alternatives. Boston : Allyn & Bacon.
LAWSON, H. A. (1983a). Toward a model of teacher sociali-zation in Physical Education : The subjective warrant,recruitment, and teacher education (part 1). Journalof Teaching in Physical Education, 2, 3-16.
LAWSON, H. A. (1983b). Toward a model of teacher socializa-tion in Physical Education : Entry in schools, Teachers’role orientations, and Longevity in Teaching (Part 2).Journal of Teaching in Physical Education, 3, 3-15.
LAWSON, H. A. (1986). Toward a national curriculum in physi-cal education. Paper presented at the annual meetingof the American Alliance for Health, Physical Educa-tion, Recreation and Dance . Cincinnati, OH, April.
MASLOW, A. H. (1979). Humanistic education. Journal ofHumanistic Psychology, 19, 13-27
MCNEIL, J.D. (1985). Curriculum : A comprehensive introduc-tion. Boston, Little Brown.
ORLOSKY, D.E. & SMITH, B.O. (1978). Curriculum development :Issues and insights. Chicago, Rand McNally.
ORNSTEIN, A.C., & HUNKINS, F.P. (1988). Curriculum : Founda-tions, Principles, and Issues. Boston, MA : Allyn & Bacon.
PAPERT, S. (1980). Mindstorms : Children, computers andpowerful ideas. New York : Basic Books.
PASCO, D., GUINARD, J.Y. & KERMARREC, G. (2008). Validationtransculturelle canadienne-française d’un instrumentde mesure des orientations de valeur d’enseignantsd’éducation physique. Colloque international de l’Asso-ciation pour le Recherche et l’Intervention en Sport (ARIS),Rodez, France, mai.
PASCO, D. (2004). Les aspects théoriques dans les curriculad’éducation physique et sportive : l’apport des travauxétats-uniens, in M. Loquet et Y. Léziart (Éds), Culturessportives et artistiques. Formalisation des savoirs profession-nels. Pratiques, formations, recherches. Rennes, PressesUniversitaires de Rennes, 125-128.
PASCO, D. (2005). Le premier programme d’éducation physiqueet sportive : mise en œuvre par les enseignants en classe desixième. Thèse de doctorat non publiée, Université deRennes II, Rennes.
PINEAU, C. (1991). Introduction à une didactique de l’EPS.Paris : Éditions Revue EP.S
REBOUL, O. (1992). Les valeurs de l’école. Paris, PUF.RINK, J. E. (1985). Teaching physical education for learning.
St. Louis : Times Mirror/Mosby.ROUX-PEREZ, T. (2003). L’identité professionnelle des ensei-
gnants d’EPS : entre valeurs partagées et interpréta-tions singulières. STAPS, 63, 75-88.
ROUX-PEREZ, T. (2005). Dynamiques identitaires à l’échelledu temps : une étude de cas chez les enseignantsd’Éducation Physique et Sportive. Science & Motricité,56, 75-96.
RUBLE, T.L. (1983). Sex stéréotypes : Issues of change inthe 1970s. Sex Roles, 9, 397-402.
SCHEIN, E.H. (1988). Organizational Culture and Leadership.San Francisco : Jossey-Bass.
SCHUBERT, W.H. (1986). Curriculum : Perspective, Paradigm,Possibility. New York : MacMillan.
SIEDENTOP, D. (1990). Introduction to physical education, fitnessand sport. Mountain View, Californie : Mayfield Pub.Co.
TARDIF, M. & LESSARD, C. (1999). Le travail enseignant au quo-tidien. Expérience, interactions humaines et dilemmes pro-fessionnels. Bruxelles : De Boeck.
TARDIF, M. & LESSARD, C. (2005). La profession d’enseignantaujourd’hui : évolutions, perspectives et enjeux internatio-naux. Bruxelles : De Boeck.
ZEICHNER, K.M. & TABACHNIK, B.R. (1983). Teacher perspectivesin the face of the institution press, paper presented at theannual meeting of the AERA, Montréal, ON, Canada,April.
Denis Pasco • Gilles Kermarrec • Jean-Yves Guinard104
ANNEXE
Exemples d’ensemble d’énoncés de la version française du VOI-2 ; en parenthèse la correspon-dance avec les orientations de valeur (n’apparaît pas dans le questionnaire).
Ensemble XII
56.___ J’enseigne aux élèves la façon la plus efficace d’effectuer des habiletés et des mouve-ments spécifiques (MD).
57.___ Je propose des activités où les élèves doivent apprendre à travailler de façon autonome(AA).
58.___ J’enseigne aux élèves qu’augmenter graduellement la difficulté de la tâche va les menerà une amélioration de leur performance (PA).
59.___ J’enseigne aux élèves à essayer de nouvelles activités pour ainsi trouver celles qu’ilsaiment (IE).
60.___ J’enseigne aux élèves à utiliser leurs habiletés personnelles afin de contribuer au succèsde l’équipe (RS).
Ensemble XVIII
86.___ Je planifie afin que les élèves pratiquent des activités physiques, sportives, artistiques etde développement personnel reliées au développement de la condition physique (MD).
87.___ J’enseigne aux élèves à se centrer dans les activités physiques, sportives, artistiques et dedéveloppement personnel sur les composantes les plus importantes de l’apprentissage(PA).
88.___ J’enseigne aux élèves que les buts du groupe sont parfois plus importants que les besoinspersonnels (RS).
89.___ J’enseigne aux élèves à utiliser les habiletés de chacun des membres de l’équipe (IE).90.___ Je propose plusieurs tâches aux élèves pour qu’ils puissent choisir celles qui sont les plus
significatives et qui les amènent à se dépasser (AA).
ZUSAMMENFASSUNG : Werteorientierungen bei Sportlehrern. Der Einfluss von Geschlecht, Alter undDienstalterZiel dieser Studie ist es, den Einfluss von Geschlecht, Alter und Dienstalter auf die Werteorientierung vonSportlehrern zu untersuchen. Die Werteorientierungen stellen ein Glaubenssystem dar, das die Lehrer beider Wahl ihrer Inhalte leitet. Eine veränderte Form des Werteorientierungsinventars (VOI) wurdebenutzt, um die Daten von 157 auf ganz Frankreich verteilten Lehrkräften zu erfassen. Die Gesamtergeb-nisse für jede der Werteorientierungen dienten dazu, die Lehrkräfte in zwei Gruppen mit starken undschwachen Prioritäten einzuteilen. Der Einfluss von Alter, Geschlecht und Dienstalter wurde mit dem Chi2-Test untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass 83% der Lehrkräfte Inhaltsentscheidungen mehr oder weni-ger auf der Basis ihrer Werteorientierungen treffen. Es gibt keine signifikanten Unterschiede hinsichtlichdes Geschlechts und des Alters sowie für vier Wertorientierungen auch nicht hinsichtlich des Dienstalters.Die Prioritäten der Lehrkräfte bezüglich der Lernprozesse entwickeln sich im Laufe ihrer Karriere.SCHLAGWÖRTER : Wertorientierung, Sportunterricht, Glaube der Lehrkräfte.
105Les orientations de valeur des enseignants d’éducation physique
RESUMEN : Las orientaciones valóricas de los profesores de educación física. Influencias del sexo, laedad y la antigüedadEl objeto de este estudio es examinar la influencia del género, de la edad y de la antigüedad sobre lasorientaciones de valores de profesores de educación física. Las orientaciones de valores representan unsistema de creencias que guían a los profesores en sus elecciones de contenidos. La versión revisada porun inventario de orientaciones de valor (VOI) ha sido utilizada para recoger los datos de 157 profesoresque trabajan en diferentes regiones de Francia. Los resultados totales sobre cada una de las orientacio-nes de valores han sido calculados para dividir a los profesores en dos grupos que representan catego-rías de prioridades débiles y fuertes.La prueba chi -cuadrado ha sido utilizada para examinar los datos de género, de edad y de antigüedad.Los resultados indican que el 83 % de los profesores toman decisiones sobre los contenidos que hay queenseñar por lo menos a través de una orientación de valores. No hay diferencias significativas sobre elgénero, la edad y en cuatro orientaciones de valores sobre la antigüedad. Las prioridades de los profe-sores para el proceso de aprendizaje evolucionan a través de su carrera.PALABRAS CLAVES : orientación en valores, educación física, creencia de los profesores.
RIASSUNTO : Gli orientamenti dei valori degli insegnanti d’educazione fisica. Influenza del sesso,dell’età e dell’anzianitàL’oggetto di questo studio è di esaminare l’influenza del genere, dell’età e dell’anzianità sull’orienta-mento dei valori di insegnanti d’educazione fisica. Gli orientamenti dei valori rappresentano un sistemadi credenze che guida gli insegnanti nelle loro scelte di contenuti. La versione rivista dell’inventariodegli orientamenti dei valori (VOI) è stata utilizzata per raccogliere i dati di 57 insegnanti che lavoranoin differenti regioni della Francia. I punteggi totali su ciascuno degli orientamenti dei valori sono staticalcolati ed utilizzati per dividere gli insegnanti in due gruppi che rappresentano delle categorie di prio-rità forte e debole. Il test khi-2 è stato utilizzato per esaminare i dati di genere, età e anzianità. I risultatiindicano che l’83% degli insegnanti prende delle decisioni sui contenuti da insegnare attraverso almenoun orientamento di valori. Non ci sono differenze significative sul genere, l’età e, per quattro orienta-menti di valori, sull’anzianità. Le priorità degli insegnanti per il processo d’apprendimento evolvono nelcorso della loro carriera.PAROLE CHIAVE : credenze degli insegnanti, educazione fisica, orientamento di valori.