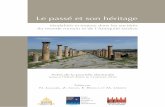Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon
Transcript of Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon
Stéphane péquignot
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon
Les rapports entre diplomatie et commerce constituent un thème de recherche ancien dans les travaux consacrés à l’histoire de la Couronne d’Aragon médiévale. Au XVIIIe siècle déjà, Antonio de Capmany publiait plusieurs traités d’alliance avec des puissances musulmanes dans lesquels figuraient des clauses commerciales.1 Dans ses Memorias históricas so-bre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, le même historien des Lumières soulignait avec emphase le lien heureux en-tre, d’une part, les capacités de navigation et l’esprit travailleur des Cata-lans et, de l’autre, des rois en accord avec leurs sujets grâce à un système pactiste efficace, menant une action extérieure propice au développement du commerce. Sans renier ce riche héritage intellectuel, la diplomatie a ensuite souvent été envisagée comme «un instrument de l’expansion» de la Couronne d’Aragon en Méditerranée (J. Lalinde Abadia) ou un «outil au service des marchands» (C. Batlle). Grâce à des reconstitutions précises des relations de la Couronne avec de nombreuses puissances et territoires étrangers,2 les échanges commerciaux se sont pour leur part révélés tantôt
1. A. de Capmany y de Montpalau, Antiguos tratados de paces y alianzas entre al-gunos reyes de Aragon y diferentes principes infieles de Asia y Africa, desde el siglo XIII hasta el XV, En la Imprenta Real, Madrid 1786; Id., Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, Madrid 1779 (réed. 1961).
2. Voir notamment A. Giménes Soler, La Corona de Aragón y Granada: historia de las relaciones entre ambos reinos, Imp. de la Casa provincial de Caridad, Barcelona 1908; Á. Masia de Ros, La Corona de Aragón y los estados del norte de Africa. Política de Jaime II y Alfonso IV en Egipto, Ifriquía y Tremecén, Instituto Español de Estudios Mediterráneos, Barcelona 1951; A. Riera Melis, La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo XIV, I, Las Repercusiones Arancelarias de la Autonomía Balear (1298-1311), CSIC, Madrid-Barcelona 1986; Á. Masia de Ros, Jaume II: Aragó, Granada i Marroc Apor-
Stéphane Péquignot180
dépendants d’actions diplomatiques ponctuelles, pour l’obtention ou le re-nouvellement de licences ou de privilèges notamment, tantôt relativement autonomes par rapport à la conjoncture politique, au Maghreb en parti-culier.3 Le rôle des consulats comme médiateurs des intérêts marchands auprès des autorités étrangères a lui aussi été éclairé par plusieurs études.4
Dans une perspective complémentaire, on portera ici le regard vers la praxis de la diplomatie royale, en prêtant, à l’instar de travaux récemment menés sur d’autres espaces,5 une attention accrue à ses acteurs et à ses méthodes. L’objectif de ce déplacement est de mieux appréhender les im-brications complexes entre mondes du commerce, négociations politiques et ambassades, de formuler ainsi quelques éléments de réflexion générale sur la place des marchands et des questions commerciales dans l’action diplomatique royale. Le propos, tout en s’efforçant de tenir compte des recherches menées sur les relations de la Couronne d’Aragon avec les pays
tació documental, CSIC, Barcelona 1989; C.-E. Dufourcq, L’Espagne catalane et le Maghrib aux XIIIe et XIVe siècles, Université de Bordeaux et Casa de Velázquez, Paris-Bordeaux 1966; Á. Masia de Ros, Relación castellano-aragonesa desde Jaime II a Pedro el Ceremonioso, CSIC, Barcelona 1994; M.D. López Pérez, La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), CSIC, Barcelona 1995; D. Coulon, Barcelone et le grand commerce d’Orient au Moyen Âge. Un siècle de relations avec l’Égypte et la Syrie-Palestine (ca 1330-ca 1430), Casa de Velázquez – Institut Europeu de la Mediterrània, Madrid-Barcelone 2004; M.T. Fe-rrer Mallol, Entre la paz y la guerra. La Corona catalano-aragonesa y Castilla en la Baja Edad Media, CSIC, Barcelona 2005; D. Valérian, Bougie, port maghrébin, 1067-1510, École française de Rome, Rome 2006; E. Basso, Tra crociata e commercio: le relazione diplo-matiche fra Genova e i regni iberici nei secoli XII-XIII, dans «Medievalismo: Boletín de la Sociedad española de estudios medievales», 19 (2009), pp. 11-56.
3. M.D. López Pérez, Política y comercio en el Mediterráneo Occidental medieval: la conformación del cuadro diplomático y su repercusión en los intercambios económicos Magreb-Corona de Aragón (ss. XIII-XV), dans Relazioni economiche tra Europa e mondo islamico, secoli XIII-XVIII, Atti della XXXVIII Settimana di Studi dell’Istituto internazio-nale di Storia economica F. Datini (Prato, 1-5 maggio 2006), éd S. Cavaciocchi, Le Mon-nier, Prato 2007, I, pp. 419-450.
4. Voir la contribution de Maria Elisa Soldani à ce volume.5. Voir notamment, pour la Hanse, S. Jenks, England. Die Hanse und Preussen Handel
und Diplomatie 1377-1474, Böhlau, Köln-Wien 1992; T. Behrmann, Herrscher und Han-sestädte, Studien zum diplomatischen Verkehr im Spätmittelalter, Verlag Dr Kovač, Hamburg 2004; pour le Portugal, T. Viúla de Faria, F. Miranda, “Pur bonne alliance e amiste faire”. Diplomacia e comércio entre Portugal e Inglaterra no final da Idade Média, dans «Cultura, Espaço e Memória», 1 (2010), pp. 109-127; pour l’Italie, outre les travaux de R. Fubini, H. Lang, Cosimo de’ Medici. Die Gesandten und die Condottieri. Diplomatie und Kriege der Republik Florenz im 15. Jahrhundert, F. Schöningh, Paderborn 2009.
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon 181
d’Islam, concernera essentiellement les échanges avec les puissances chré-tiennes aux XIIIe et XIVe siècles. Dans ces limites, j’envisagerai successi-vement le rôle des marchands comme soutien, puis comme acteurs de la diplomatie royale, la part faite au commerce dans les traités et, enfin, les enjeux diplomatiques liés à la question des représailles.
1. Les marchands, soutiens de la diplomatie des rois d’Aragon
Les rois d’Aragon doivent faire appel à d’autres forces de la Cou-ronne pour leur action diplomatique. Il s’agit d’abord d’un soutien de na-ture logistique. Si les ambassadeurs se déplacent souvent sur des navires appartenant aux rois, ceux-ci n’en ont pas toujours à leur disposition. Il est de surcroît préférable, car plus économique ou plus rapide, d’utiliser le bateau d’un marchand en partance ou de le réquisitionner. En mars 1314, à un moment de grande tension entre Angevins de Naples et partisans de Frédéric III en Sicile, lorsque Jacques II d’Aragon (1291-1327) souhaite envoyer instamment à ce dernier un ambassadeur, il ordonne au bailli de Barcelone de maintenir au port un navire marchand en partance pour l’île. Tous les autres bateaux prêts à lever l’ancre doivent également suspendre leur voyage dans l’attente de nouveaux ordres.6 Une fois à destination, les envoyés diplomatiques sollicitent et reçoivent l’aide des marchands et des consuls, notamment dans les terres d’Islam.7
Les marchands de la Couronne apportent aussi fréquemment à la di-plomatie des rois un soutien financier, selon des mécanismes variés et com-plexes. Les villes où ils détiennent un pouvoir important dans les conseils appuient en espèces les actions favorables aux intérêts commerciaux de leurs concitoyens. En août 1325, Barcelone finance par une taxe prélevée sur les marchandises échangées avec Chypre une ambassade royale dépêchée dans l’île, et prend en charge un prêt de 100 livres avancées par des marchands
6. Lettre de Jacques II d’Aragon au batlle de Barcelone Bernat de Segalars, Valence, 21 février 1314 (Archivo de la Corona de Aragón [ACA], C, reg. 241, fol. 123r).
7. R. Salicrú i Lluch, Más allá de la mediación de la palabra: negociación con los in-fieles y mediación cultural en la Baja Edad Media, dans Negociar en la Edad Media, Actos del coloquio (Barcelona, 14-16 de octubre de 2004), CSIC, Barcelona 2005, pp. 409-439; D. Coulon, Négocier avec les sultans de Méditerranée orientale à la fin du Moyen Âge: un domaine privilégié pour les hommes d’affaires?, dans ibidem, pp. 503-526.
Stéphane Péquignot182
aux représentants de Jacques II.8 La contribution peut s’effectuer par le biais de quèsties, des prélèvements extraordinaires perçus depuis la fin du XIIIe siècle sur les viles royales pour financer – entre autres – des entreprises diplomatiques d’envergure: une grande ambassade à Rome en 1294, une en-trevue avec le roi de France en 1295 et, surtout, des mariages, celui en 1312 de l’infante María d’Aragon avec l’infant Pedro de Castille (1312), celui de sa sœur Isabelle avec le duc d’Autriche Frédéric le Beau en 1314, et l’union du roi avec la princesse Marie de Lusignan en 1315. Les grandes villes en sont néanmoins exemptées par privilège, et la pratique diminue à mesure que la distinction entre quèsties et subsides devient plus nette.9 L’aide fournie par certains marchands, hommes d’affaires ou banquiers étrangers, pallie parfois le sous-financement chronique d’ambassadeurs dont la provisio, à Avignon ou à la Curie romaine, se révèle vite insuffisante.10 Ce soutien financier poly-morphe à la diplomatie royale n’est pas sans contreparties, bien connues pour les relations avec le Maghreb et avec les mamelouks. Justifiées par des motifs religieux (recherche de reliques, protection des lieux saints et des chrétiens d’Orient), les 26 ambassades adressées aux sultans entre 1290 et 1390 sont ainsi ordinairement précédées d’une autorisation pontificale de commercer, ce qui permet aux marchands emmenant des ambassadeurs souvent eux-mê-mes marchands de tirer un profit non négligeable de l’opération.11
La mise en œuvre de l’action diplomatique royale repose aussi sur la circulation et la maîtrise des informations et des nouvelles. Or, en l’ab-sence d’une poste publique, les courriers du roi – un groupe de serviteurs qui se consolide depuis le milieu du XIIIe siècle – demeurent trop peu nom-breux pour acheminer tous les plis des ambassadeurs, des souverains et des princes. En cas de «manque de courriers» (defectum cursorum), il est alors fait appel selon les disponibilités à d’autres officiers du roi, à des compa-gnies privées spécialisées – en Avignon par exemple –, aux ambassadeurs mandatés depuis l’étranger à leur retour, ou bien encore à des marchands.12 Ces derniers se chargent souvent de la tâche, mais l’on mobilise égale-ment leurs courriers. Un certain Rodrigo Xemeno reçoit ainsi 29 sous de
8. Archivo Historico de la ciudad de Barcelona (AHCB), Manual, 1-B-XIII-1, fol. 35 (22 août 1325, Barcelone).
9. V. Baydal Sala, M. Sánchez Martínez, Quèstia, dans Glosario crítico de fiscalidad medieval (en ligne).
10. Pour des exemples, voir Péquignot, Au nom du roi, pp. 156-164.11. Coulon, Barcelone et le grand commerce, pp. 43-51; Id. Négocier.12. Péquignot, Au nom du roi, pp. 119-136.
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon 183
la trésorerie royale pour se rendre à Gênes en 1315.13 Les compétences, les relations et les réseaux des marchands – catalans et valenciens principale-ment, mais aussi originaires des autres territoires de la Couronne ou même étrangers – sont de la sorte mis à profit par la monarchie.
Les marchands eux-mêmes recueillent et transmettent des nouvelles potentiellement utiles pour l’action diplomatique, des nova ou des ardits, c’est-à-dire des informations reconnues comme valides par leur expéditeur, ou bien des rumores, plus sujettes à caution – le pouvoir royal étant friand de tout, plus particulièrement de secrets.14 Depuis les ports, les consulats ou les villes étrangères, de nombreux marchands sujets du roi notifient les mouvements de navires, les déplacements de troupes, les événements qui surviennent dans les cours éloignées. Les voies de l’information sont souvent tortueuses. En 1316, le marchand barcelonais Guillem ça Bastida transmet à Jacques II la teneur d’une lettre qu’il a reçue d’un facteur installé à Naples, dans laquelle figurent des nouvelles d’Arménie.15 Durant le règne de Pierre IV (1336-1387), les consuls de Séville, Messine ou Trapani adres-sent au monarque des informations dont il est précisé qu’elles sont dues à des marchands.16 De grands officiers territoriaux de la Couronne installés en zone frontalière font de même, notamment le bailli général de Valence Ferrer de Corteyl durant le règne de Jacques II,17 ou le gouverneur de Ma-jorque Gilabert de Centelles durant celui de Pierre IV.18 Avant de parvenir au monarque, l’information peut également être médiatisée par son conseil s’il est absent de ses terres péninsulaires, ou par le conseil de Barcelone.19 Déjà bien approvisionnés en nouvelles par leurs sujets, les rois d’Aragon re-çoivent en outre régulièrement, du moins dans le premier quart du XIVe siè-cle, des renseignements fournis par des informateurs installés en Italie, dont
13. ACA, RP, MR 279, fol. 78v.14. Péquignot, Au nom du roi, pp. 100-106.15. Lettre de Jacques II à son ambassadeur Pere Boyl, qui doit vérifier la nouvelle
pour en informer le pape (H. Finke, Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italieni-schen, französischen, spanischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der diploma-tischen Korrespondenz Jaime II. (1291-1327), Dr. Walter Rothschild, Berlin 1922, III, doc. 167, pp. 362-364).
16. L. D’Arienzo, Carte reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re d’Aragona, riguardanti l’Italia, Cedam, Padova 1970, docc. 160-161, pp. 72-74, doc. 165, pp. 75-76, doc. 316, p. 161.
17. Masià de Ros, Aragó, Granada i Marroc, p. 313.18. D’Arienzo, Carte, doc. 328, p. 166.19. Ibidem, doc. 569, pp. 263-264; doc. 534, p. 276.
Stéphane Péquignot184
certains marchands. Après être entré dans la familiaritas de Jacques II en 1291, le génois Cristiano Spinola lui envoie ainsi une vingtaine de rapports sur sa ville, sur la Sicile et sur l’Afrique du Nord où il a des activités com-merciales. Il soutient de surcroît les ambassadeurs du monarque, lui décrit leurs agissements et bénéficie en contrepartie d’une pension annuelle et de nombreuses faveurs.20 Les correspondances demeurent toutefois fréquem-ment imprécises sur leurs sources, et les marchands évoqués ne peuvent pas toujours être identifiés.21 Une discrétion accrue est logiquement de mise pour les “espions” (espies), parmi lesquels figurent certainement des mar-chands.22 Les rois et les membres de la famille royale puisent ensuite dans ces matériaux informatifs d’origines diverses pour la préparation de leurs ambassadeurs et pour leurs correspondances avec l’étranger.
Sachez que j’ai compris de façon certaine par certains marchands qui reve-naient de la curie que le pape viendra sous peu à Marseille, ils m’ont dit de façon certaine que cinq cités de Sicile se sont soulevées contre le roi Charles [d’Anjou] et ont tué tous les Gallici qui y habitaient. Les Parisiens ne racon-tent rien d’autre qui soit digne d’être rapporté23
écrit ainsi en 1282 l’infant Ferdinand d’Aragon, frère du roi Pierre III (1276-1285), au roi Edouard Ier d’Angleterre.
Si la nouvelle, considérable, du soulèvement des Vêpres siciliennes est donc assurément diffusée à la fois par les marchands et par voie diplo-matique, la pérennité des sources d’informations de la monarchie reste à explorer après le règne de Jacques II, et l’investissement financier des mar-chands sur la longue durée demeure difficile à apprécier. Ils apportent en tout cas à l’action diplomatique des rois d’Aragon des soutiens ponctuels
20. G. Petti Balbi, Un “familiare” genovese di Giacomo II: Cristiano Spinola, dans «Medioevo. Saggi e Rassegne», 20 (1995), pp. 113-133; Péquignot, Au nom du roi, p. 116.
21. D’Arienzo, Carte, doc. 316, p. 161.22. Ibidem, doc. 534, p. 276, doc. 536, p. 277; F.C. Casula, Carte reali diplomatiche di
Alfonso III il Benigno, re d’Aragona, riguardanti l’Italia, Cedam, Padova 1970, doc. 352, pp. 207-208.
23. «Ad haec, domine, noveritis quod intellexi pro certo a quibusdam mercatoribus, qui de novo venerunt de curia, quod Papa pro certo in brevi veniet Massiliam; qui etiam pro certo dixerunt mihi quod quinque civitates Siciliae insurrexerunt contra regem Karolum et interfecerunt omnes Gallicos habitantes in eis. Alia non narrantur Parisiis digna referri» (G. La Mantia, Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia: Pietro I, Giacomo, Federico II, Pietro II e Ludovico. Dalla rivoluzione siciliana del 1282 sino al 1355, Boccone del Povero, Palermo 1917, I, doc. XIII, p. 43).
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon 185
importants, parfois forcés, souvent intéressés et médiatisés par les conseils urbains, notamment celui de Barcelone.24 Toutefois, ils ne déterminent pas complètement la diplomatie, et leur rôle se concentre dans les coulisses.
2. Les marchands acteurs secondaires de la diplomatie royale?
La présence des marchands dans les relations diplomatiques diffè-re fortement selon les destinations et les affaires à traiter. Leur activité auprès des puissances non chrétiennes est désormais mieux connue grâce aux nombreuses monographies sur les relations de la Couronne d’Aragon avec Grenade, le Maghreb et la puissance mamelouke, grâce également à plusieurs études spécifiquement consacrées aux intermédiaires – ambassa-deurs et autres – entre Chrétienté et Islam.25 L’interconnexion entre pou-voir, commerce et diplomatie y apparaît plus forte et plus constante que pour les échanges effectués au sein de la Chrétienté. Parmi les ambassa-deurs envoyés auprès de puissances musulmanes ne figurent quasiment pas de religieux, mais des nobles, notamment des bâtards de la famille royale, et, de façon plus originale, des mudéjares,26 des juifs jusqu’au milieu du
24. Péquignot, Au nom du roi, pp. 372-383.25. Y. Tov Assis, Diplomatics jueus de la Corona catalanoaragonesa en terres musul-
manes (1213-1327), dans «Tamid (Barcelona)», 1 (1997), pp. 7-40; Coulon, Négocier; R. Sa-licrú Lluch, Más allá de la mediación; Ead., La diplomacia y las embajadas como expresión de los contactos interculturales entre cristianos y musulmanes en el Mediterráneo occidental durante la Baja Edad Media, dans «Estudios de Historia de España», 9 (2007), pp. 77-106; Ead., Crossing Boundaries in Late Medieval Mediterranean Iberia. Historical Glimpses of Christian-Islamic Intercultural Dialogue, dans «International Journal of euro-mediterranean studies», I (2008), 1, pp. 33-51; Ead., Translators, interpreters and cultural mediators in late medieval Eastern Iberia and western islamic diplomatic relationships, dans Tenth Mediter-ranean Research Meeting (Florence-Montecatini Terme, March 24-27, 2009): Workshop 3. Language and Cultural Mediation in the Mediterranean, 1200-1800, en ligne: http://digital.csic.es/bitstream/10261/12714/1/Translators%20interpreters%20and%20cultural%20media-tors.pdf, pp. 1-21; D. Valérian, Les agents de la diplomatie des souverains maghrébins avec le monde chrétien (XIIe-XVe siècles), dans «Anuario de Estudios Medievales», 38 (2008), 2, pp. 885-900; N. Jaspert, Interreligiöse Diplomatie im Mittelmeerraum. Die Krone Aragon und die islamische Welt im 13. und 14. Jahrhundert, dans Aus der Frühzeit europäischer Diplomatie. Zum geistlichen und weltlichen Gesandtschaftswesen vom 12. bis zum 15. Jahr-hundert, éd. C. Zey, C. Märtl, Chronos, Zürich 2008, pp. 151-190.
26. R. Salicrú i Lluch, Intérpretes y diplomáticos. Mudéjares mediadores y represen-tantes de los poderes cristianos en la Corona de Aragón, dans Biografías mudéjares o la
Stéphane Péquignot186
XIVe siècle,27 ainsi que des marchands en plus grand nombre, choisis pour leurs compétences linguistiques, leurs connaissances des routes, des usa-ges et des territoires. Les envoyés diplomatiques sont parfois, dans les re-lations avec l’Egypte notamment, des hommes d’affaires importants dont la sphère d’activités excède le seul négoce.28 Il s’avère néanmoins souvent difficile de préciser avec certitude l’appartenance sociale de ces intermé-diaires aux activités multiples, pour lesquels une prosopographie détaillée fait encore défaut.29
Comme en terres d’Islam, le terme “marchand” n’est guère employé en Occident pour désigner les ambassadeurs des rois d’Aragon dans les docu-ments techniques de la diplomatie – les lettres de créance, les sauf-conduits, les procurations ou les instructions. Certains traités composés entre 1218 et 1386 contiennent des clauses relatives au commerce, mais aucun ne fait état de marchands ambassadeurs.30 Une telle absence s’explique néanmoins en partie par la nature et les usages des écrits considérés. Dans les traités, les ambassadeurs, quel que soit leur statut, demeurent à l’arrière-plan. Ils sont éclipsés au sein de pacta, conventiones ou tractati conçus et présen-tés comme des unions entre princes, entre rois, entre maisons ou, un peu plus tard, entre peuples, mais pas comme l’aboutissement d’un travail de négociation. D’autre part, les rois d’Aragon confient en réalité à plusieurs reprises des ambassades à des marchands en mettant en avant à l’intention des destinataires leur qualité de «citoyens» (cives) d’une grande universitas de la Couronne. Parmi un échantillon de 349 ambassadeurs de Jacques II identifiés, 36 au moins sont citoyens des villes, pour la plupart barcelonais ou valenciens, et certains exercent des activités marchandes.31 Les cités ita-liennes constituent leur destination de prédilection en Occident. Plus de dix fois ambassadeur d’Alphonse III (1286-1291) puis de Jacques II d’Aragon auprès de Charles II d’Anjou et de Gênes, d’abord pour régler l’affaire des infants angevins prisonniers en Catalogne, puis pour récupérer l’argent pro-mis par Charles II pour la conquête de la Sardaigne, Guillem Llull appar-tient au patriciat de Barcelone, il est conseiller et représentant de la ville à
experiencia de ser minoría: biografías islámicas en la España cristiana, coord. A. Eche-varría Arsuaga, CSIC, Madrid 2008, pp. 471-496.
27. Tov Assis, Diplomatics jueus.28. Coulon, Négocier.29. Desiderata souligné par Salicrú i Lluch, Translators.30. Voir infra.31. Péquignot, Au nom du roi, p. 194.
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon 187
plusieurs reprises, également actif dans des opérations marchandes et finan-cières.32 Son cas n’est pas isolé. Arnau et Francesc de Sabastida se rendent pour le compte de Jacques II en mission diplomatique à Chypre, Tomàs de Vic en Provence, Huguet de Cambrils en Sardaigne.33 Dans les années 1380, le marchand d’Asti Luchino Scarampi oeuvre régulièrement à la pacifica-tion des relations entre Gênes et la Couronne d’Aragon.34 D’autres mar-chands sont sollicités pour sceller des compromis sur le rachat de captifs, par exemple en 1354-1355 pour un échange visant à libérer des prisonniers faits par Gênes à la bataille du Bosphore.35
Les marchands emploient-ils alors des méthodes différentes de celles des autres ambassadeurs ? Leurs instructions et leurs dépêches fournissent à cet égard des indices utiles, dont on se contentera ici de présenter l’un des exemples les plus éloquents, le brouillon d’une lettre composée en 1387 à l’intention du conseil de Barcelone par le marchand Berenguer Morey. Issu d’une véritable dynastie de patrons de navires et d’armateurs de galères, fort également d’une solide expérience commerciale avec la Sardaigne, Gênes et la Sicile, bailli de Barcelone de 1375 à 1378, le Catalan est envoyé à Pise conjointement par la ville et par le roi d’Aragon. Sa mission consiste à mettre fin à l’escalade créée par des réclamations pisanes sur un navire détourné par des sujets de Pierre IV.36 Il échoue, mais sa lettre révèle une mise en récit et des modalités d’action à l’étranger comparables à celles d’autres envoyés diplomatiques des rois et de Barcelone. L’ambassadeur souligne plusieurs fois avoir parfaitement respecté ses instructions (memorial), ou, du moins, tenté de le faire. Il précise s’être entretenu préalablement avec les marchands catalans installés à Pise, et avoir tenu compte de leurs pratiques pour ren-contrer le conseil des anciens de la cité. A l’instar d’autres ambassadeurs des rois d’Aragon ou de la ville de Barcelone, Morey formule des avis détaillés
32. Ibidem, CD-Rom “Annexes”, pp. 87-89.33. Ibidem, ad vocem.34. G. Pistarino, Luchino Scarampi tra Genova e Barcellona per la pace del 1386,
dans «Medioevo. Saggi e Rassegne», 1 (1975), pp. 33-47.35. A. Beauchamp, Gouverner la couronne d’Aragon en l’absence du roi: la lieute-
nance générale de l’infant Pierre d’Aragon (1354-1355), thèse soutenue à l’Université de Bordeaux III Michel de Montaigne, a.a. 2005, p. 71.
36. V. Hurtado, Berenguer Morey, mercader de Barcelona i la seva activitat diplomàti-ca amb Pisa l’any 1387, dans XIV Congresso di storia della Corona d’Aragona sul tema La Corona d’Aragona in Italia, secc. XIII-XVIII (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990), éd. M.G. Meloni, O. Schena, C. Delfino, Sassari 1993, II, pp. 527-544.
Stéphane Péquignot188
et critiques à l’intention de son mandant. Dans sa perspective, l’essentiel de-meure de s’adapter aux circonstances, de faire preuve de prudence dans une négociation à l’issue incertaine.
De même, seigneurs, il est nécessaire que ce qui doit se faire pour le seigneur roi et pour la cité de Barcelone se fasse selon la forme requise et méritée par l’affaire (fet). Puisqu’elle en est arrivée à ce stade, […] il vaudrait bien mieux qu’on ne l’ait ni commencée ni engagée de la part du seigneur roi et de votre part [de la ville], car soyez certains que, si la réputation de notre nation est déjà affaiblie auprès d’eux [les Pisans], elle sera encore diminuée si l’affaire ne prend pas [bonne] voie et conclusion.37
La volonté de préserver l’honneur du roi et de la ville fait à nouveau écho à la teneur des propos tenus par d’autres ambassadeurs des rois d’Aragon sur l’entrée en négociation, un processus que l’on juge extrêmement périlleux et que l’on s’efforce de contrôler du mieux possible. Tout en usant de sa proxi-mité avec les marchands pour s’informer et se présenter auprès des Pisans, Morey appréhende par conséquent de manière générale la négociation d’une façon proche de celle des autres ambassadeurs. La technique s’adapte à l’in-terlocuteur, mais la conception d’ensemble demeure similaire.
Cet exemple frappant, qui mériterait d’être confronté à d’autres, ne doit pas faire oublier la position mineure des marchands dans la diplomatie aragonaise en Occident. Aux XIIIe et XIVe siècles, les conseillers, les fami-liares, les nobles, les clercs et les membres de la famille royale demeurent les ambassadeurs de prédilection des monarques aragonais. Ce recours li-mité aux marchands est commun à la plupart des diplomaties royales et princières contemporaines, qui usent en la matière de pratiques nettement distinctes de celles en vigueur dans les villes d’Empire, de Suisse, de la Hanse, et, plus encore, des principautés et des cités d’Italie, où la richesse, l’expérience de la négociation, la dignité du statut et la proximité avec les gouvernants font des marchands les plus notables des ambassadeurs de choix.38 En revanche, même si élites urbaines et pouvoir royal partagent
37. «Item, senyors, és de necessari que en ço que s’a a fer per lo senyor rey e per la ciutat de Barcelona se fasa en la forma que’l fet requer a merex. Pus que és vengut en aquest terme en altre manera molt més valguera que no sa agués enantant ne procehit [en que ses-seguit] per part del senyor rey e vostre, cor siats certs que en pocha reputacio han la nostar nacio ja l’auran en molt menor si lo fet no fa aquell procés e conclusio» (ibidem, p. 543).
38. Voir les références données en note 5, ainsi que, pour les cas impériaux et suis-se, Spezialisierung und Professionalisierung. Träger und Foren städtischer Aussenpolitik
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon 189
dans la Couronne d’Aragon de nombreux intérêts,39 même si les marchands y jouissent d’une reconnaissance favorisée par la circulation des idées de Francesc Eiximenis,40 ils exercent peu la charge d’ambassadeurs en Occi-dent. Dépourvus du prestige social des nobles ou des grands prélats, moins compétents en droit que les juristes ou en latin que les clercs et les notaires, ils sont dépêchés en mission diplomatique essentiellement en raison de leurs connaissances financières, dans le cadre des relations avec les communes italiennes ou pour des missions de défense des intérêts urbains. Leur activité dans la marchandise demeure cependant très souvent voilée en diplomatie derrière leur qualité plus honorable de citoyen des villes. Les exigences de la représentation royale, les usages des relations inter-dynastiques et la tech-nicité juridique de nombreuses missions les relèguent de la sorte au second plan – de manière générale comme au sein même des ambassades – dans la plupart des échanges diplomatiques menés au nom des rois d’Aragon.
3. Le commerce dans les traités
Les marchands apportent donc leur soutien à une diplomatie qui se refuse à mettre (trop) en avant leur activité. Mais dans quelle mesure et de quelle manière le commerce lui-même constitue-t-il un objet de tractations avec les cités et les souverains étrangers ? Les enjeux, l’élaboration et la matière de nombreux accords diplomatiques ont d’ores et déjà été analysés dans plusieurs études menées sur les relations de la Couronne d’Aragon avec d’autres puissances, notamment musulmanes. L’on voudrait à présent envisager de façon comparative la place faite à l’activité des marchands dans les traités, alors même qu’il n’existe pas de droit international re-connu par tous les protagonistes.
De 1218, date du premier traité de paix passé par Jacques Ier d’Aragon avec le comte Sanche de Provence, jusqu’en 1386, année de signature d’un accord entre Pierre IV et Gênes, au moins 55 trêves et traités ont été établis
während des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, éd. C. Jörg, M. Jucker, Reichert, Wiesbaden 2010. Pour l’Italie, voir l’article d’Isabella Lazzarini dans ce volume.
39. Voir sur ce point F. Sabaté, Municipio i monarquía en la Cataluña bajomedieval, dans «Anales de la Universidad de Alicante Historia Medieval», 13 (2000-2002), pp. 255-282, et les autres travaux du même auteur.
40. P. Evangelisti, I francescani e la costruzione di uno stato: linguaggi politici, valo-ri identitari, progetti di governo in area catalano-aragonese, Il Mulino, Bologna 2006.
Stéphane Péquignot190
par des puissances chrétiennes avec les rois d’Aragon, ou, plus rarement, avec leurs lieutenants.41 Les voisins proches et les grands partenaires éco-nomiques dominent: Gênes, alliée au XIIIe siècle, puis progressivement devenue ennemie au XIVe siècle,42 Pise,43 Florence et Lucques,44 Venise,45 les puissances ibériques – la Castille,46 la Navarre,47 dans une moindre me-sure le Portugal ou d’autres princes48 –, ainsi que le royaume de France,49
41. A. Huici Miranda, M.B. Cabanes Pecourt, Documentos de Jaime I, Anubar, Va-lencia 1976, I, doc. 14, pp. 46-48; G. Meloni, Genova e Aragona al tempo di Pietro il Cerimonioso, 3 vols., CEDAM, Padova 1982, III, pp. 163-186. Les références aux autres traités sont indiquées ensuite, et l’on renoncera ici, faute de place, à indiquer la bibliogra-phie relative à chacun de ces accords.
42. I Libri iurium della Repubblica di Genova, éd. D. Puncuh, Ministero per i beni culturali e ambientali ufficio centrale per i beni archivistici, Genova 1996, I/2, docc. 300-310, pp. 74-113; I/5, doc. 748, pp. 262-270; I/6, docc. 943-944, pp. 26-30; I/8, doc. 1268, pp. 78-94; de Capmany, Memorias, II/1, doc. 48, pp. 72-74; Meloni, Genova, III, p. 126, pp. 163-186.
43. Huici Miranda, Cabanes Pecourt, Documentos, doc. 186, pp. 318-321; V. Sala-vert, Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, CSIC, Madrid-Barce-lona 1956, II, doc. 335, pp. 416-419; A. Arribas Palau, La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón, Instituto Español de Estudios Mediterráneos, Barcelona 1952, pp. 415-420; doc. LVII, pp. 445-447.
44. Salavert, Cerdeña, II, doc. 384, pp. 498-500.45. Meloni, Genova, III, pp. 63-66.46. Reinado y diplomas de Fernando III, éd. J. González, Monte de piedad y caja
de ahorros de Córdoba, Córdoba 1986, III, doc. 721, pp. 280-281; Memorial Histórico Español, Academia de Historia, Madrid 1852, I, pp. 121-122; S.M. Cingolani, Diplo-matari de Pere el Gran, Fundació Noguera, Barcelona 2011, I, doc. 242, pp. 438-443; A. Benavides, Memorias de D. Fernando IV de Castilla, Inprenta de José Rodriguez, Madrid 1860, II, doc. CCLXIII, pp. 398-399, docc. CCLXXIX-CCLXXXIX, pp. 412-429, doc. CDXVI, pp. 621-622; Ferrer i Mallol, Entre la paz y la guerra, doc. 7, pp. 553-563; Masià, Relación, II, doc. 209/64, pp. 411-422; doc. 213/78bis, pp. 443-451; doc. 217/115, pp. 458-476; doc. 227, pp. 500-509; doc. 252/15-16, pp. 577-583; doc. 259/36, pp. 597-605.
47. Huici Miranda, Documentos, I, doc. 147, pp. 265-266, doc. 202, p. 339; III, doc. 645, pp. 130-133, doc. 833, p. 292; Masià, Relación, II, doc. 246/2, pp. 565-570.
48. Des traités sont passés avec les comtes d’Urgell, de Foix et de Cardona, avec le roi de Majorque et avec des infants castillans (Huici Miranda, Documentos, I, doc. 39, pp. 92-95; Cingolani, Diplomatari, I, doc. 13, doc. 158, pp. 305-310; C. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne, jusqu’au commencement du XIVe siècle, Picard et fils, Paris 1896, II, doc. 71, pp. 159-161, doc. 123, pp. 234-237, doc. 145, pp. 268-269; Benavides, Memorias, II, doc. CCXXXIV, pp. 351-353).
49. Huici Miranda, Documentos, IV, doc. 1003-1004, pp. 91-100; Capmany, Memo-rias, II/1, doc. 173, pp. 259-261.
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon 191
le comte de Toulouse50 et les Angevins.51 Quelques traités sont également conclus avec des maisons plus lointaines, comme en témoignent le maria-ge d’Isabelle d’Aragon, fille de Jacques II, avec le Habsbourg Frédéric le Beau, ou bien l’alliance établie le 1er janvier 1369 entre Pierre IV d’Aragon et le roi d’Angleterre.52 Cette diversité des interlocuteurs se double d’une hétérogénéité formelle. Les conventiones côtoient les pacta, les avinen-çes des privilèges expédiés sous forme de lettres patentes. Les originaux sont toujours couchés sur le parchemin qui leur confère un supplément de solennité, mais la longueur des dispositifs, non nécessairement corrélée à leur importance, est extrêmement variable, de quelques lignes à plusieurs folios pour la paix convenue en Avignon le 1er novembre 1336 par Gênes avec les rois d’Aragon et de Majorque.53
Les accords avec des puissances chrétiennes réservent généralement aux questions commerciales une importance moindre que ceux établis avec des puissances islamiques, où l’idée même de paix paraît indissociable de la garantie de conditions satisfaisantes pour le commerce. Seuls 19 traités avec des puissances chrétiennes les évoquent de façon explicite. Particuliè-rement nombreux durant la période en raison des combats qui se poursui-vent contre l’émirat de Grenade et des luttes entre puissances chrétiennes, les traités de paix, les trêves et les alliances militaires offensives ou défen-sives demeurent généralement silencieux à ce sujet. La compositio effec-tuée entre Pierre III d’Aragon et son frère le roi Jacques II de Majorque en 1279 pour régler le conflit sur la nature de leurs liens (le premier sera su-zerain, le second vassal) stipule certes que Jacques II aura la possibilité de lever une leude, mais le commerce demeure à l’arrière-plan.54 Il est néan-moins probable que des marchands interviennent à d’autres titres, comme témoins, ou bien en qualité de consuls ou de citoyens des villes de Palma, Perpignan ou Puigcerdà s’engageant à respecter les accords.55 Le cas n’est
50. Ibidem, II, doc. 326, p. 99. 51. T. Rymer, Foedera, Conventiones litterae et cuiuscumque generis. Acta publica
inter Reges Angliae et alios quosvis, imperatores, reges, pontifices, principes vel comunita-tes…, La Haye 1739, I, doc. 745; Salavert, Cerdeña, II, doc. 13, pp. 11-12; Id., El tratado de Anagni y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, dans «Estudios de la Edad Media en la Corona de Aragón», V (1952), pp. 209-360.
52. Rymer, Foedera, III, p. 855.53. I Libri iurium, I/8, doc. 1268, pp. 78-94; ACA, C, reg. 556, fol. 14v-16r.54. Cingolani, Diplomatari, doc. 158, pp. 305-310.55. Ibidem, docc.160, 162, 201-202, 209, 268, 272-273.
Stéphane Péquignot192
pas isolé. Dans le régime pactiste de la Couronne d’Aragon, le nombre des jureurs est alors fonction de l’importance de la ville représentée. Ils appor-tent une validité supplémentaire à des actes déjà garantis par la remise de places fortes, par les serments et les engagements des princes et des nobles. Toutefois, comme pour les ambassades, la qualité de marchand n’est pas mise en exergue dans les listes de témoins et de prestataires de serments.
Le commerce sort plus nettement de la pénombre dans des dispositions isolées insérées dans des accords de portée générale. Le traité de Campillo (27 mars 1281) entre Alphonse X de Castille et Pierre III d’Aragon prévoit d’interdire tout méfait sur les terres de l’autre contractant.56 Dans l’alliance passée le 20 juin 1303 entre, d’une part, Jacques II d’Aragon et son fils héritier Alphonse, et, de l’autre, des nobles castillans – les premiers devant recevoir Murcie, les seconds remettre la Castille aux infants de la Cerda –, une clause stipule que «les vassaux et les gens du roi d’Aragon, et ceux qui marchandent […] peuvent venir, entrer et demeurer sur nos terres, en nos lieux, et en sortir sains et saufs».57 Deux décennies plus tard, le 20 juin 1324, la paix établie entre l’infant Alphonse d’Aragon et Pise prévoit de façon similaire de laisser les sujets du roi et les citoyens de la commune «faire des contrats et du commerce, aller, demeurer et revenir, faire et ac-complir leurs affaires selon leur volonté comme ils avaient l’habitude de le faire avant la présente guerre».58 Le commerce s’immisce même dans les traités d’alliance offensive. Afin de porter remède aux graves et intollera-biles iniuria et offensa ac damna causés par les Génois, le roi d’Aragon conclut le 16 janvier 1351 avec des ambassadeurs vénitiens une ligue de quatre ans, sans paix séparée possible. Les Aragonais s’engagent à fournir 18 navires de guerre, les Vénitiens une partie essentielle du financement. Dans ce dispositif militaire, chacun s’interdit de commercer avec un en-nemi soumis à une forme de boycott.59 Le roi et les autorités vénitiennes
56. Ibidem, doc. 242, p. 439.57. «Aun otorgamos, et queremos que los vassallos, et gentes de vos dito rey d’Ara-
gon, et mercadants, et aquellos que tienen la vuestra part puedan venir, entrar, et estar en las tierras, et logares de nosotros, et sallir salvos et seguros, é à todas estas cosas complir, et observar» (Benavides, Memorias, II, doc. CCXXXIV, p. 353).
58. «et quod possint ibi contrahere et mercare illucque ire, ibique stare, et inde redire et facere et expedire negocia sua ad eorum voluntatem ut consueverunt ante guerram pre-sentem» (Arribas Palau, La conquista, p. 416).
59. ACA, C, reg. 556, fol. 50v. Sur ce traité, voir Meloni, Genova, III, pp. 163-186 et J.V. Cabezuelo Pliego, Diplomacia y guerra en el Mediterraneo medieval. La liga veneto-
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon 193
affirment ainsi de façon lapidaire détenir une autorité souveraine sur l’ac-tivité commerciale de leurs sujets.
Outre ces clauses formulées en ordre dispersé, les rois d’Aragon et leurs interlocuteurs s’entendent parfois sur des textes plus dévelop-pés spécifiquement consacrés aux affaires commerciales. De conserve avec un mouvement général de juridicisation et de tentative d’accapa-rement souverain par les États des procédures de lettres de marque, les rois d’Aragon passent à ce sujet des accords successifs avec les rois de France, en 1313 et en 1335,60 puis avec la Castille, lors du règlement de la Guerra de los dos Pedros qui a provoqué de nombreuses attaques contre les marchands et déclenché des cycles de représailles. Le 8 décembre 1371, l’on met sur parchemin des “chapitres accordés par les ambassa-deurs de Castille et d’Aragon pour qu’une bonne paix et concorde soit servie entre les rois” (capitulos concordados por los embaxadores de los reyes de Castiella e d’Aragon porque buena paç e concordia se servia entre reyes).61 Il est interdit de recourir à des marques et à des repré-sailles, la libre circulation des marchandises avec les droits accoutumés est garantie; les querelles entre sujets sur des marcas ou des «prises» (prendas) devront être soumises à deux arbitres nobles désignés par les rois, et un impôt sur la circulation des marchandises (derecho o vectigal o quema) est établi pour lutter contre des marques dénoncées comme une «occasion de discorde et de guerre».62
Le commerce occupe une place plus importante encore dans de nom-breux traités passés avec Gênes, tout particulièrement dans les années 1140-1230. Durant cette période, les relations entre les deux puissances sont d’abord dominées par la question de l’hégémonie politique sur le Midi français et par la lutte pour le contrôle des routes commerciales entre l’Italie et le Maghreb. Progressivement, il devient essentiel pour la cité ligure de garantir par l’obtention de privilèges et de consulats la pré-sence de ses communautés marchandes à l’étranger.63 Dans ce contexte, la Couronne d’Aragon fait office d’interlocuteur privilégié avec la pénin-
aragonesa contre Génova de 1351, dans «Anuario de Estudios Medievales», 36 (2006), 1, pp. 253-294.
60. Voir infra.61. Masià, Relación, II, doc. 252/15, pp. 577-583, ici p. 577.62. M. Lafuente Gómez, J. Morelló Baget, Quema, dans Glosario crítico de fiscalidad
medieval (en ligne).63. Basso, Tra crociata e comercio.
Stéphane Péquignot194
sule Ibérique. La paix, le commerce et les conditions d’installation des Génois donnent alors lieu à des accords de natures variées (conventiones, pacta, compromissa).64 Le premier traité d’alliance, établi en 1146 entre le comte de Barcelone et les Génois, est une conventio, un pactum pour la conquête de la ville de Tortosa. Ramon Berenguer promet un tiers de la cité aux Génois et octroie à leurs marchands la liberté de circuler sur ses terres. Ils y seront de surcroît exemptés de différentes taxes.65 La même clause est reprise trois ans plus tard dans une donatio du comte,66 puis, sous une forme légèrement modifiée, dans les conventiones du 2 mai 1167, cette fois-ci aux côtés d’autres dispositions concernant le commerce. Chaque partie s’engage désormais à refuser d’accueillir des marchands pisans et à rendre justice en cas de méfait perpétré à l’en-contre des hommes soumis à l’autorité de l’autre contractant.67 En 1198 ou 1199, lors du renouvellement et de la confirmation des traités signés par les prédécesseurs, le commerce n’est à nouveau l’objet que d’une seule clause, selon laquelle le roi d’Aragon et la commune ne sauraient, pour le bien de la paix, être tenus responsables des forfaits, rapines et autres offenses commises dans le passé.68 Les traités diplomatiques de la deuxième moitié du XIIe siècle réitèrent donc fréquemment des clauses concernant le commerce relativement similaires. C’est à la fois le signe d’une mémoire des traités – dont atteste aujourd’hui encore la conser-vation des originaux dans les archives de la Couronne d’Aragon, et de copies dans les Libri iurium génois – et le témoignage probable d’une relative inefficacité des traités antérieurs.
La commune de Gênes établit ensuite entre 1230 et 1233 une série d’accords avec le roi d’Aragon Jacques Ier et son lieutenant sur l’île de Majorque à peine conquise.69 Ils visent à renouveler la paix, à sécuriser le commerce, à garantir et à définir les droits respectifs des Génois et des Aragonais en terres étrangères, à régler les différends en suspens. Le tra-vail scripturaire d’accommodement ne se limite pas aux seuls traités entre
64. I Libri iurium, I/2, docc. 293, 296-299, 303.65. Ibidem, doc. 297, pp. 62-69, Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya
i de la Corona catalanoaragonesa a l’edat mitjana, dir. M.T. Ferrer i Mallol, Manuel Riu i Riu, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2009, I/1, doc. 51, p. 309.
66. Ibidem, doc. 56, p. 323.67. Ibidem, doc. 85, p. 368; I Libri iurium, I/2, doc. 293, p. 56.68. Ibidem, doc. 299, p. 73 et Tractats i negociacions, doc. 140, p. 451 (daté 1199).69. I Libri iurium, I/2, docc. 300-310, pp. 74-113; I/6, docc. 943-944, pp. 26-30.
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon 195
la commune et le roi ou ses lieutenants. Nomination d’arbitres, entente en cours de négociation sur un délai nécessaire avant de conclure, concessions de privilèges sous forme de lettres patentes précèdent et accompagnent des traités parmi lesquels les accords passés avec les ambassadeurs étrangers se distinguent des ratifications par les rois ou par la cité ligure. La paix proclamée se décline ensuite sous la forme d’accords d’ensemble et de concessions particulières, avec, à chaque fois, une place déterminante pour le commerce.
Un premier traité de portée générale est signé le 28 juin 1230 à Ma-jorque entre le roi d’Aragon et l’ambassadeur de Gênes.70 Après avoir reconnu et renouvelé l’ensemble des conventiones, pacta, promissiones, concessiones, donationes et immunitates effectués depuis le règne de Ramon Berenguer, les deux parties se promettent la paix. S’ensuivent alors de nombreuses clauses relatives au commerce qui reprennent des dispositions figurant dans les accords précédents ou leur apportent des précisions. Un sauf-conduit est ainsi assuré aux Génois et à leurs biens; il leur est possible de librement commercer, sauf dans le cas de “biens interdits”; ils sont exemptés de droits de péage (ripaticum, portaticum, pedagium) sur toutes les terres du roi d’Aragon; le roi leur rendra justice s’ils ont été lésés ou ont subi un dommage commis par ses sujets; il s’en-gage enfin à ne recevoir ni corsaire ni pirate susceptible de porter atteinte à leurs intérêts. L’ambassadeur de la cité ligure effectue des promesses semblables. En guise de corrélat, l’on décide le même jour d’abandonner la poursuite des forfaits les plus anciens, puis de taxer les marchandises échangées entre Gênes et la Couronne à hauteur de 12 deniers par livre afin qu’un tribunal arbitral puisse compenser les victimes des dommages les plus récents.71 Les accords sont parachevés le 30 juin avec la recon-naissance par Jacques Ier d’une dette de 8.000 maravédis pour la conquête de Tortosa, la promesse de donner aux Génois un port (plagiam) à Ma-jorque.72 Cet ensemble forme par conséquent une véritable synthèse des accords antérieurs. Elle sert ensuite de base à la paix contractée le 31 mai 1233 entre les Génois et l’infant Pierre auquel le roi Jacques Ier a confié la seigneurie de l’île de Majorque.73 Les mêmes clauses sont reprises –
70. Ibidem, doc. 302, pp. 81-87.71. Ibidem, doc. 300, pp. 74-78.72. Ibidem, doc. 301, pp. 79 ss.73. Ibidem, pp. 28-29.
Stéphane Péquignot196
sécurité des hommes, libres circulation et commerce, promesse de rendre justice, refus d’accueillir des pirates ou des corsaires – et, le cas échéant, complétées. Ainsi les Génois sont-ils désormais exemptés également de l’ancoragium (ou ancoratge), un impôt récemment créé prélevé sur les bateaux entrant dans le port de Palma.74
La clause commerciale la plus récurrente, souvent la seule, concerne donc la sécurité et la liberté de circulation des marchands. Un pas est ce-pendant franchi dans les traités passés avec la cité ligure en 1230 et 1233. A la différence de la plupart des conventions établies avec les puissances chrétiennes, les dispositions relatives au commerce y apparaissent moins comme une conséquence ou un corrélat d’un accord de paix que comme une condition impérativement nécessaire à son maintien. De la sorte, en faisant la paix avec Gênes, le roi d’Aragon agit finalement d’une manière comparable à celle adoptée pour pacifier les rapports avec les puissances musulmanes. Un siècle plus tard, en 1339, le sultan mérinide Abū l-Ḥasan ‘Alī et le roi de Majorque Jacques III ne procèderont guère autrement. Dans le traité qui les lie, les clauses relatives au commerce jouent aussi un rôle central, elles visent souvent à résoudre les mêmes problèmes, et abou-tissent sur plusieurs points à des solutions similaires: garantir la libre circu-lation et la sécurité pour les sujets des deux royaumes; proscrire le pillage des épaves; interdire l’exportation de certaines catégories de marchandises et percevoir des droits sur celles autorisées; interdire les corsaires de part et d’autre.75 En somme, la “diplomatie du commerce” ou, plus précisément, la façon dont la diplomatie traite des questions commerciales se joue en partie des frontières religieuses, les nécessités économiques et de sécurité important plus, en l’occurrence, que les différences de foi.
En facilitant l’obtention de nombreux privilèges, en apposant parfois leur signature à des accords préalablement établis afin d’en renforcer la validité, et, plus généralement, en concluant des traités censés assurer des conditions propices au développement du commerce, les rois d’Aragon s’affirment en protecteurs des marchands, garants de l’utilitas des sujets soumis à leur autorité.
74. L. Tudela Vilallonga, J. Morelló Baget, M. Sánchez Martínez, Ancoratge, dans Glosario crítico de fiscalidad medieval [en ligne].
75. H. Bresc, Y. Ragib, Le sultan mérinide Abū l-Ḥasan ‘Alī et Jacques III de Major-que. Du traité de paix au pacte secret, Institut français d’archéologie orientale, Le Caire 2011 (Cahiers des Annales islamologiques 32), pp. 41-71.
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon 197
4. Les affaires de marques, enjeu diplomatique
Les traités représentent néanmoins seulement une partie du travail diplomatique, ils tendent à masquer les nombreux échanges qui les pré-cèdent ou ceux qui n’aboutissent pas à un accord en bonne et due forme. Les enjeux et les modalités de l’engagement diplomatique royal dans les affaires commerciales doivent par conséquent être recherchés également dans les correspondances et les ambassades, notamment lorsqu’elles ont trait aux attaques étrangères dont les marchands sont victimes et aux repré-sailles qui en découlent. Après un bref rappel du développement de telles pratiques, on considérera ici à titre d’exemple plus en détail une “affaire” révélatrice de la complexité des imbrications possibles entre commerce et diplomatie.
A l’instar de l’Italie et, peu après, de la France,76 les représailles sont au XIIe siècle monnaie courante pour la Couronne d’Aragon, aussi bien sur les territoires soumis à l’autorité du roi que dans les relations avec les puis-sances étrangères. Cela a pour conséquence la multiplication des exemp-tions et des privilèges pour protéger les marchands des pignorationes ou des marcae. Après quelques tentatives de régulation par des traités conclus avec les Génois dans les années 1160,77 les rois d’Aragon commencent dans le premier tiers du XIIIe siècle à faire usage d’un nouvel instrument, les lettres de marque. Elles offrent «la faculté, concédée à un particulier par les autorités de son pays, de saisir des biens qu’il trouvera appartenir aux sujets d’une nation étrangère, pour s’indemniser du tort à lui causé,
76. Pour une première approche générale, R. de Mas Latrie, Du droit de marque ou droit de représailles au Moyen Âge, suivi de pièces justificatives, Baur, Paris 1875; A. Del Vecchio, E. Casanova, Le rappresaglie nei comuni medioevali e specialmente in Firenze, Zanichelli, Bologna 1894; P.-Cl. Timbal, Les lettres de marque dans le droit de la France médiévale, dans Recueil de la Société Jean Bodin, X, L’étranger, Bruxelles 1958, pp. 109-138; G.S. Pene Vidari, Rappresaglia, in Enciclopedia del diritto, XXXVIII, Giuffrè, Milano 1987, pp. 403-410; M.-Cl. Chavarot, La pratique des lettres de marque d’après les arrêts du Parlement (XIIIe-début XVe siècle), dans «Bibliothèque de l’Ecole des Chartes», 149 (1991), pp. 51-89; M.R. Martín i Fabrega, Marques i represàlies a la Corona d’Aragó a l’etapa final del regnat de Pere el Cerimoniós (1373-1386), tesi doctoral, Barcelona, a.a. 2002; L. Tanzi-ni, Rappresaglie tra Toscana e Catalogna nei registri Marcarum dell’Archivio della Corona d’Aragona, dans «Mercatura è arte». Uomini d’affari toscani in Europa e nel Mediterraneo tardomedievale, éd. L. Tanzini, S. Tognetti, Viella, Roma 2012, pp. 205-223.
77. Voir par exemple le traité du 2 mai 1167 entre Alphonse II d’Aragon et Gênes (I libri iurium, I/2, doc. 293, pp. 54-57; Tractats i negociacions, doc. 85, pp. 367-368).
Stéphane Péquignot198
en dehors de toute guerre, par l’un de ces sujets, s’il n’a pu obtenir jus-tice des juges de ce dernier».78 Sans former d’emblée un élément de “droit commercial” reconnu de façon unanime – la terminologie employée pour ce type de procédure demeure encore flottante à la fin du XIIIe siècle –, les représailles sont progressivement incorporées comme objet légitime de réflexion dans le droit savant, Giovanni de Legnano et Bartole leur consa-crant même des traités spécifiques dans la deuxième moitié du XIVe siècle. En droit comme dans la pratique, les lettres de marque confèrent alors une forme de légitimation à une mesure de rétorsion dont on souhaite contrôler et limiter l’usage. Jacques Ier d’Aragon y recourt avec les Génois et les Pisans,79 ses successeurs lui emboîtent le pas et menacent souvent de s’en servir dans leurs relations avec les Italiens, avec la France et la Castille.80 Fréquents dans une période de vives tensions entre puissances concurren-tes, les différends commerciaux constituent donc aux XIIIe-XIVe siècles un important motif de mobilisation de la diplomatie royale aragonaise.
A partir de la fin du XIIIe siècle, l’accroissement et la diversification de la documentation conservée permettent de saisir de façon diachronique et avec une plus grande précision comment les dommages subis ou provoqués par des marchands peuvent se transformer en affaires diplomatiques. Les méthodes utilisées dans les interventions royales, les enjeux, les modalités et la réalité du règlement des conflits pour les différents protagonistes im-pliqués deviennent plus aisément perceptibles. Les effets de l’attaque portée en 1297 par des sujets de Jacques II in partibus Yspanie contre des navires de la société brugeoise Faytes bien offrent un exemple caractéristique de ces processus souvent longs, non linéaires et irréductibles à un schéma de déroulement uniforme. Les marchands flamands s’adressent ici d’abord di-
78. Chavarot, La pratique, p. 52.79. M.T. Ferrer i Mallol, Panorama general de les relacions internacionals de Jaume
I. Les relacions amb Italia, dans Jaume I: commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, éd. Id., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2011, I, pp. 414-417.
80. Exemples dans J. Mutgé i Vives, La marca de Bernat Melhac, la corona catala-no-aragonesa i el Llenguadoc (1327-1336), dans «Anuario de Estudios Medievales», 16 (1986), pp. 227-238; Ead., Dos ejemplos de negociación en la época del rey catalanoa-ragonés Alfonso el Benigno (1327-1336), dans Negociar en la Edad Media, pp. 527-552; Ead., La inseguretat en el Mediterrani Occidental: acord entre el rei catalanoaragonès Pere el Cerimoniós i el francés Joan II de Valois per a la solució de les marques existents entre ambdós regnes (1351), dans La Corona catalanoaragonesa i el seu entorn mediterra-ni a la Baixa Edat Mitjana, CSIC, Barcelona 2005, pp. 185-204; Chavarot, La pratique et Martín i Fabrega, Marques, passim.
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon 199
rectement au roi d’Aragon pour demander réparation des torts qui leur ont été causés. Par un acte gracieux de justice – l’estimatio des pertes fournie par les Brugeois a en effet paru surévaluée – et sous la forme d’une lettre patente à valeur de quittance (albarà testimonial), le roi reconnaît leur de-voir une somme considérable, 96.579 sous et deux deniers de Barcelone.81 L’acceptation d’une telle dette tient certainement aux preuves apportées par les plaideurs, mais elle s’explique également par le souci de préserver avec la Flandre des relations commerciales importantes – le comte et les échevins de Bruges sont d’ailleurs informés82 –, par la volonté d’éviter que les marchands catalans ne soient soumis à des lettres de marques, et par l’intérêt pour le roi de manifester sa capacité à rendre la justice. Pourtant, malgré les engagements pris, le remboursement tarde. Devant la langueur aragonaise, très probablement à l’instigation des marchands, Philippe le Bel presse alors Jacques II de régler ses créanciers. En s’érigeant en défenseur des Brugeois, le Capétien prolonge de fait le conflit de souveraineté qui l’oppose au comte de Flandre, alors même que la trêve de Saint-Bavon vient de suspendre leurs hostilités.83 Sa demande provoque un micro-incident di-plomatique, car l’auteur de la lettre y précède le destinataire, ce qui déroge aux coutumes en vigueur dans les échanges entre princes.84 Le roi d’Aragon s’en plaint dans sa réponse, mais attribue habilement la faute à l’impéritie d’un scribe – ce que l’on peine à croire, l’erreur étant si grossière qu’elle pa-raît plutôt relever du registre de la provocation. Quoi qu’il en soit, Jacques II s’engage de nouveau à procéder au remboursement des marchands, cette fois-ci avant la Saint-Jean 1300, mais… il n’honore pas plus sa promesse, et les Brugeois sont bientôt invités à patienter jusqu’à la Saint-Jean prochai-ne.85 Tomàs de Vic, un marchand-banquier barcelonais, reçoit l’ordre de les payer en puisant dans des revenus dont il a l’affermage et qui sont assignés en Provence en vertu d’une concession pontificale annuelle de 2.000 onces d’or.86 Même si le Catalan règle effectivement 50.918 sous et deniers, les envoyés successifs de la compagnie Faytes bien, notamment Jean Anhuilt
81. ACA, C, reg. 238, fol. 8v-9r.82. Ibidem, reg. 264, fol. 9v-10r.83. Voir, pour le contexte, X. Hélary, Courtrai. 11 juillet 1302, Tallandier, Paris 2012,
pp. 45-46.84. ACA, C, reg. 252, fol. 196r-v, Finke, Acta Aragonensia, III, doc. 39, pp. 85-87.85. ACA, C, reg. 266, fol. 296r-v (lettre de Jacques II a Tomàs de Vic, Saragosse, 5 août
1300).86. Ibidem.
Stéphane Péquignot200
qui séjourne une année à la cour du roi, ne parviennent pas à obtenir com-plètement satisfaction.87 En dépit des 30.000 sous encore versés à Avignon en septembre 1304 par Jaume Despuig à Jean d’Anhuilt, malgré plusieurs années de pressions marchandes, d’intercessions et de promesses diploma-tiques qui relèvent souvent du procédé dilatoire, la monarchie est encore redevable en 1305 d’une dette de près de 20.000 sous.88
En juillet 1305 se produit un tournant décisif. Le remboursement des marchands de la compagnie Faytes bien est désormais lié par le roi d’Ara-gon à celui des dommages infligés en 1302 ou 1303 par un Narbonnais à un marchand de Tortosa, Jaume Terrer.89 Il s’agit là encore d’une affaire tentaculaire, qui dure plusieurs années. Après avoir tout d’abord cherché à obtenir lui-même satisfaction auprès des autorités françaises, le Catalan s’est tourné vers le roi d’Aragon, qui a adressé au sénéchal de Beaucaire deux lettres réquisitoires de justice, l’une pour protester contre la libération du coupable, l’autre pour demander un complementum justicie. Jacques II lui a ensuite envoyé Jaume Terrer en personne avec une nouvelle réquisi-tion. Le silence opposé à ces exigences et les suppliques renouvelées du marchand pour l’obtention d’une lettre de marque conduisent finalement Jacques II à affecter à Jaume Terrer les quelque 19.600 sous encore dus à la compagnie Faytes bien. Dans la lettre adressée à ce propos à Philippe le Bel en juillet 1305, Jacques II brandit même la menace d’une licencia pignorandi, mais se garde bien de la mettre en oeuvre immédiatement.90 Il s’agit en fait pour le monarque de se présenter en roi de justice interve-nant dans un cas où le droit est dénié (fatiga de dret) tout en faisant pres-sion pour obtenir une solution de transaction acceptable. S’il suggère aux Brugeois de s’adresser au roi de France pour obtenir satisfaction, il tente aussi parallèlement d’amadouer Jean d’Anhuilt en sollicitant à la Curie une prébende en Flandre pour son fils.91 Néanmoins, la substitution financière
87. ACA, C, CR de Jaume II, caixa 16, n. 2120, ACA, C, reg. 235, fol. 115v. Jacques II ordonne finalement de rédiger une lettre d’explication à l’intention de Philippe le Bel pour faciliter le retour de Jean d’Anhuilt, car il a probablement outrepassé la durée de son sauf-conduit
88. ACA, RP, MR 628, fol. 2v-3v (quittance donnée par le mestre racional de Jac-ques II d’Aragon aux représentants de la compagnie brugeoise Faytes bien le 10 avril 1320, à Montblanc).
89. ACA, C, reg. 236, fol. 2v-3v (lettre de Jacques II à Philippe le Bel du 15 juillet 1305).90. Ibidem.91. Ibidem, reg. 236, fol. 136r (lettre de Jacques à Jean d’Anhuilt, 4 mars 1306).
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon 201
envisagée par le roi d’Aragon échoue, pour des raisons que nous ignorons – mais il est très probable que les marchands de la compagnie Faytes bien s’opposent à une solution qui leur est défavorable.
Dès lors, “l’affaire Jaume Terrer” éclipse largement dans la documen-tation les griefs des Flamands, elle devient à son tour un enjeu diplomati-que important dans les relations entre les rois de France et d’Aragon. Le processus est une fois encore très complexe, et l’on se contentera ici d’en rappeler les principales étapes.92 A la fin de l’année 1309, en raison de l’im-possibilité d’obtenir justice et à son grand regret (necessario et compulsi debito nostri officii), Jacques II concède une lettre de marque à Jaume Ter-rer contre les marchands de Narbonne et les sujets du roi de France.93 Une fois le délai de réserve expiré, les deux parties cherchent bientôt à mettre un terme à des violences qui s’emballent. Diverses solutions sont envisa-gées, notamment, du côté aragonais, la possibilité d’égaliser la valeur des biens pris aux marchands de Narbonne victimes du conflit et les sommes encore dues à Jaume Terrer. Alors que les marchands font de part et d’autre pression sur leurs souverains pour obtenir des conditions de rembourse-ment plus favorables, les rois et leurs représentants utilisent le règlement des deux affaires comme une véritable scène de démonstration politique, où ils s’efforcent de faire valoir leur souci de la justice, leur capacité à imposer des solutions équitables et favorables à leurs sujets. Partageant les mêmes principes, les rois divergent sur les modalités concrètes de l’accord. Jacques II propose de considérer les deux parties (marchands de Narbonne, Jaume Terrer) comme quitte, Philippe le Bel imagine des mécanismes plus favorables à ses propres sujets. Inséré dans un règlement de paix plus gé-néral dont le but premier est la restitution du val d’Aran au roi d’Aragon, l’accord obtenu à Poissy en avril 1313 constitue une forme de voie média-ne.94 Il sera désormais théoriquement plus difficile de recourir aux lettres de marque, qui pourront être émises seulement après expiration du délai de justice, neuf mois supplémentaires, et un avertissement par lettre. Une enquête est par ailleurs prévue pour déterminer les dommages subis par
92. Pour plus de détails sur l’affaire Jaume Terrer, voir Péquignot, Au nom du roi, pp. 364-372.
93. ACA, C, reg. 238, fol. 139v-140v (lettre de Jacques II à Philippe le Bel, 13 juillet 1310, Teruel).
94. Lettre patente de Philippe le Bel du 26 avril 1313 (Ordonnances des roys de France de la troisième race…, De Desser, Liège 1738, I, pp. 516-517, ACA, C, reg. 336, fol. 114rv); lettre patente de Jacques II du 29 mai 1313, à Barcelone (ibidem, reg. 336, fol. 105r-v).
Stéphane Péquignot202
les Narbonnais et procéder, au regard des pertes de Jaume Terrer, à une restitution de part et d’autre.
Plutôt que de marquer la “conclusion” de l’ensemble du conflit, l’ac-cord de Poissy et sa difficile mise en oeuvre révèlent toutefois surtout la portée limitée de l’action diplomatique sur le règlement des différends commerciaux et des représailles. L’entente sur les lettres de marque par-ticipe certes à l’effort d’encadrement de cette pratique par les puissances souveraines. Elle fait écho à des traités antérieurs passés par Jacques Ier d’Aragon, en 1246 et en 1253,95 et l’on s’y réfère ensuite à plusieurs re-prises dans les relations entre la France et la Couronne d’Aragon. Des ambassadeurs de Jacques II doivent en solliciter la reformatio à Louis X en 1315;96 les principales dispositions sont reprises dans les accords pas-sés entre Alphonse IV et Philippe VI en 1334-1335 pour faire face à des conflits qui se multiplient,97 tandis que les rois Jean II et Pierre IV d’Ara-gon mettent pour leur part en 1350-1352 plutôt l’accent sur la formation de commissions chargées d’arbitrer les différends.98 La volonté de régler par le traité diplomatique ces affaires concernant des marchands est par consé-quent proclamée, mais, par calcul ou par impuissance, l’effet en est limité, les accords ne parviennent pas à empêcher de nouvelles représailles.
Tandis que les dispositions générales des traités, pour nécessaires qu’elles soient à la manifestation de la capacité des souverains à rendre la justice et au maintien des liens avec leurs voisins, relèvent parfois de l’in-cantation face à des espaces et à des sujets en partie incontrôlés, il s’avère également difficile d’imposer concrètement les accords pris sur des affai-res particulières. L’enquête menée au terme de l’accord de Poissy aboutit à un constat défavorable aux Catalans qui traitent avec la France, puisqu’il appert que les sommes saisies sur les marchands narbonnais dépassent cel-les dont a été spolié Jaume Terrer. De ce fait, les hommes du roi d’Aragon, initialement quémandeurs de justice, deviennent… des sujets soumis à une taxe que le roi et son trésorier Pere Marc s’efforcent d’imposer sans susci-ter d’opposition trop manifeste. L’effort de rhétorique fiscale mérite d’être
95. Ferrer i Mallol, Panorama general, p. 410.96. ACA, C, reg. 337, fol. 244v (ca. 6 février 1315).97. Capmany, Memorias, II/1, doc. 137, pp. 206-210; Chavirot, La pratique; Mutgé,
Dos ejemplos.98. Id., La inseguretat; A. Díaz Borras, Marca, arte de la mercadería y protoorga-
nización de la estructura recaudatoria en la Valencia del Trescientos, dans «Anuario de Estudios Medievales», 41 (2011), 1, pp. 3-29.
Les marchands dans la diplomatie des rois d’Aragon 203
salué: il en va de l’utilitas des sujets, l’affinitas avec le roi de France ne saurait être mise en péril, l’honneur est sauf, et il est nécessaire de porter un remedium à l’arrêt du commerce.99 Fort de cet argumentaire qui se veut imparable, le trésorier tente d’imposer une taxe de quatre deniers par livre sur toutes les marchandises échangées, mais les marchands catalans par-viennent à la transformer en une taxe sur le poids ou le nombre des biens.100 L’accord diplomatique ne règle pas donc pas tout, il doit encore être com-plété par des négociations et des accords entre le roi et ses sujets.
Les affaires Faytes bien, Jaume Terrer et celle des marchands de Nar-bonne sont-elles pour autant terminées? Pour le marchand de Tortosa, on peut le supposer, puisqu’il a réussi à se faire rembourser de l’essentiel à partir des sommes dues aux Brugeois. Il en va différemment pour l’affaire Faytes bien. L’évêque de Barcelone et ses compagnons habilités à effec-tuer des dépenses pour le compte du roi règlent en 1319 les 19.600 sous restant sur la somme principale, mais les procureurs des Flamands doivent attendre le 20 avril 1320 pour obtenir une dernière quittance reconnaissant que 2.500 tournois d’argent ont été dus à la compagnie pour les débours engagés au motif de cinq voyages entrepris depuis Bruges vers le roi, à Bar-celone, à Valence, à Tarragone et à Montblanc.101 Après abattement d’une somme versée par le trésorier, 4.275 sous de Barcelone doivent néanmoins encore être versés. En réalité, plus de vingt ans après le déclenchement de la procédure, l’affaire Faytes bien reste ouverte en 1320…
Elle a en tout cas mobilisé de très nombreux acteurs (victimes, vil-les, grands officiers, juristes, ambassadeurs, princes, rois), et été (presque) résolue, mais de façon très heurtée, en raison des distances, des concur-rences juridictionnelles, des difficultés financières et de la variété des in-térêts défendus. La parabole européenne de cette affaire et de celles qui s’y sont greffées s’apparente donc à une mise à l’épreuve des capacités de résolution diplomatique des conflits et de délivrance de la justice par les monarques, et elle met aussi sous tension les rapports entre le roi d’Aragon et ses sujets lésés. Le résultat en est ambivalent. Le glaive de la justice royale peine à trancher, et c’est l’acharnement ou l’épuisement des parties qui permet d’aboutir. Les souverains s’affirment en rois de justice, mais
99. ACA, C, reg. 299, fol. 10v-11r (lettre de Jacques II à son trésorier Pere Marc, le 25 juillet 1313), fol. 11r-12r (lettre de Jacques II à ses sujets, datée du même jour).
100. Péquignot, Au nom du roi, pp. 371-372.101. ACA, RP, MR 628, fol. 2v-3v.
Stéphane Péquignot204
parviennent difficilement à la rendre; ils établissent des normes dans des conventions diplomatiques, mais elles sont discutées, parfois peu respec-tées, et des problèmes similaires ne cessent de resurgir, ça et là.
Les réflexions développées en ces quelques pages ne sauraient préten-dre à l’exhaustivité, et seront très probablement nuancées par des études ultérieures. Il me semble néanmoins que l’on peut en dégager trois résul-tats principaux. Tout d’abord, les marchands jouent un rôle important de soutien multiforme à la diplomatie royale, mais ils sont rarement mis en avant dans les échanges avec les puissances chrétiennes, moins souvent en tout cas que dans les rapports avec les terres d’Islam. En second lieu, la diplomatie royale manifeste au cours des XIIIe-XIVe siècles un intérêt accru pour le commerce. Moins systématiques qu’avec l’Islam, les clauses puis les traités de commerce se multiplient avec les puissances chrétiennes et adoptent souvent des dispositions similaires. Le commerce apparaît dans ce contexte plus nettement comme une affaire d’Etat, il est mieux perçu pour certaines relations comme une condition sine qua non au maintien de la paix. Enfin, l’engagement diplomatique dans les affaires relatives au commerce révèle un décalage certain entre l’affirmation de prérogatives royales et l’efficacité réelle du pouvoir. De même que les autres princes, le roi d’Aragon se présente dans les échanges diplomatiques comme une source, une fontaine de justice, mais la satisfaction effective des deman-des des sujets lésés à l’étranger et la prévention des conflits par la voie du traité s’avèrent des entreprises difficiles, souvent hors de portée. La prise en considération accrue du commerce par la diplomatie royale apparaît par conséquent paradoxale. Elle témoigne de l’intérêt renforcé de la monarchie pour l’activité économique, atteste une affirmation de souveraineté en ce domaine, mais révèle aussi crûment une triple limitation: la nécessité pour la diplomatie de soutiens non proprement monarchiques, l’impuissance du pouvoir royal à s’arroger dans la fragile construction politique de la Cou-ronne d’Aragon un monopole sur l’exercice de la violence et, plus géné-ralement, l’incapacité de la diplomatie à réglementer complètement une activité marchande qui possède des acteurs multiples et ses propres normes de fonctionnement, largement autonomes.