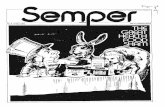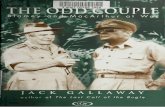Le Vélodrome, un espace en transition
Transcript of Le Vélodrome, un espace en transition
Sébastien Camillo MA3 janvier 2014 Raphaël Chatelet Raphaël Desaules
Sociologie urbaine: Le Vélodrome, un espace en transition
Résumé
Cette étude tente de mettre en lumière la question du statut de l’artiste dans la société d’aujourd’hui, celui-ci changeant au gré des époques il nous semble intéressant de faire le point actuel avec le cas d'étude du Vélodrome, à Genève.
Mots clés
Statut de l’artiste et de l’artisan, ville créative, institutionnalisation de la culture, mouvement squat, Vélodrome, Genève
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
2
Table des matières
Résumé ................................................................................................................................................................... 1
Mots clés ................................................................................................................................................................. 1
Table des matières ................................................................................................................................................. 2
1. Quels phénomènes sociaux ? ............................................................................................................................ 3
1.1. Historique ............................................................................................................................. 3
1.2 Contexte actuel...................................................................................................................... 3
1.3 De quelle activité artistique parle-t-on ? ............................................................................... 4
1.4 Méthode d'étude/démarche ................................................................................................... 5
1.5 Hypothèses ............................................................................................................................ 5
2. Vers un centre artisanal.................................................................................................................................... 6
2.1 L'échelle de la ville ............................................................................................................... 6
2.1.1 La culture alternative ........................................................................................... 6
2.1.2 Le processus d'institutionnalisation ..................................................................... 7
2.1.3 La nouvelle ville créative ..................................................................................... 8
2.2 L'échelle du lieu ...................................................................................................................10
2.2.1 Situation ..............................................................................................................10
2.2.2 Définitions ..........................................................................................................10
2.2.3 In situ ..................................................................................................................10
2.2.4 Vision à long terme .............................................................................................12
2.3 L'échelle de l'homme............................................................................................................13
2.3.1 Définitions ..........................................................................................................13
2.3.2 Un retour vers l'artisanat .....................................................................................14
2.3.3 La relation artisan / artiste ...................................................................................14
2.3.4 L'artiste et son lieu d'exposition (galeries) ..........................................................15
3. Synthèse ............................................................................................................................................................16
4. Bibliographie ....................................................................................................................................................17
Ouvrages ou articles scientifiques ..............................................................................................17
Sites internet ..............................................................................................................................17
Cours ..........................................................................................................................................17
Articles de journaux ...................................................................................................................18
Vidéos ........................................................................................................................................18
5. Annexes .............................................................................................................................................................19
Guide d'entretien avec Séverin Guelpa du 29 octobre 2013 ......................................................19
Documents généraux ..................................................................................................................20
Photos ........................................................................................................................................21
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
3
1. Quels phénomènes sociaux ?
1.1. Historique
Notre étude porte sur le lieu artistique du Vélodrome à Genève, situé dans le quartier de la jonction à Genève. Ce site s'est constitué en 2009, à la suite de la fermeture du squat Artamis. Il s'étend sur 5'500 m2, c'était auparavant un garage datant des années 1960. Il compte environ 70 artistes, occupant une trentaine d'ateliers de manière permanente1. Selon Sandrine Salerno, conseillère administrative de la ville de Genève, "Ce site était vide, sordide. Aujourd'hui nous assistons à une réappropriation des lieux".
Les artistes présents au Vélodrome étaient avant à Artamis, un site occupé pendant 13 ans (1995-2008)2 par des artistes à Genève. Le squat comptait 200 à 300 artistes sur environ 17'000 m2. C'était un lieu créatif et festif en autogestion. Chaque bâtiment était occupé par une ou plusieurs associations indépendantes les unes des autres. Ce squat a été évacué pour permettre la création d'un écoquartier. Ce site était avec Rhino un des derniers sites emblématiques de la période squat.
A noter une certaine différence entre ce site et le Vélodrome, l’un est un squat pur, toléré par la Ville, sans base légale autorisant l’utilisation des lieux. Par contre pour le deuxième site, les artistes présents possèdent un contrat de bail directement géré par l’association qui l’occupe 3.
Certains artistes d'Artamis ont donc pu investir des locaux du Vélodrome, principalement ceux qui avaient besoin de grands espaces. D'autres sont allés à Picto, dans le quartier de la Servette, surtout des vidéastes et graphistes. Au Vélodrome un souci a été de conserver la diversité de la création, avec la présence de danseurs, d’acteurs de théâtre, de sculpteurs, de plasticiens et par conséquent un foisonnement de collaborations possibles.
Pour le Vélodrome, le relogement des artistes à impliquer celui des artisans qui travaillaient auparavant dans ce site désinvesti par la ville en raison de sa vétusté. Ces derniers ont reçu des propositions de relogement avantageuses, dans les zones industrielles de Vernier et des Charmilles 4 .
1.2 Contexte actuel
Suite à son ouverture, ce site a été médiatisé par la presse locale, comme la Tribune de Genève ou le Courrier. Celle-ci mettait en avant sa structure organisationnelle se dirigeant vers une formalisation de l'activité artistique issue du mouvement squat. Ce mouvement était très actif dans les années 1980 et 1990 à Genève. Depuis la culture alternative a beaucoup évolué.
Depuis 2009, nous n'avons pas trouvé de traces de nouveaux articles au sujet de ce lieu de création. Ce qui est un indice d'une normalisation de l'activité artistique en ce lieu et de son inscription dans le temps.
1 Géraldine Viredaz, (2009), Les artisans du Vélodrome inaugurent leur écrin, Le Courrier
2 Ecoquartiers Genève, Jonction-Artamis 3 Entretien avec Séverin Guelpa du 29/10/2013
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
4
En plus de celle du Vélodrome, la scène artistique genevoise compte plusieurs associations majeures proposant des ateliers, parmi celles-ci, on compte Picto (65 ateliers pour 85 locataires), l'usine Kugler (130 locataires) ou encore Motel Campo.
Les artistes sont rentrés dans une relation contractuelle avec la ville, ils payent un loyer de 50.-/m2 par an, l’usine Kugler faisant office de prix de référence pour ce type de locaux. Le loyer est en partie subventionné , le prix normal étant 120.-/m2. Le modèle adopté est celui de l'autogestion mais ce n'est pas un collectif d'artistes, ce qui aurait pour conséquence une ligne artistique et des valeurs communes5.
Les ateliers à prix abordables en ville de Genève viennent sérieusement à manquer. Cela même si la scène artistique genevoise est dynamique est qu'elle fournit un travail de qualité. De ce fait, les artistes dont la situation n'est pas complètement formalisée, encourent le risque de devoir partir dans d'autres lieux. De plus avec la crise du logement le manque d'espace se fait sentir parmi chacune des catégories sociales (familles, étudiants).
La ville est propriétaire du Vélodrome, avant l'arrivée des artistes, on comptait 1/3 de l'espace vide, 1/3 d'artisans, 1/3 destiné aux services de la ville. Les artisans ont été déplacés dans d'autres locaux. On assiste donc à un jeu de "chaises musicales" entre les différentes catégories d'utilisateurs de la ville. Ce phénomène est symptomatique des villes suisses congestionnées, manquant d'espace6.
Selon Alain Girard de la DCTI (Département des constructions)"A Genève, il faudrait consacrer un quartier à la culture émergente pour que la ville reste vivante. Si on déplace les gens, le terreau ne se crée pas et on met en échec à chaque fois l'histoire des associations qui sont créés sur un site. La plupart du temps, le projet meurt quand il bouge, car il est intimement lié à un lieu, au potentiel d'un bâtiment" 7.
1.3 De quelle activité artistique parle-t-on ?
Afin de mieux comprendre les notions fondamentales sur lesquelles nous travaillons, nous retiendrons les définitions de J. Lévy et de M. Lussault:
Culture comme notion non-dénombrable: L'ensemble des productions idéelles disponibles dans une réalité sociales donnée. On appellera culture, ce qui est isolable, transmissible et éventuellement cumulable dans les activités idéelles de l'humanité. Ainsi définie, la culture est donc une production, quelque chose qui peut être appréhendé indépendamment de celui qui la produit 8.
Art: L'ensemble des activités humaines créatrices visant à produire une expression et une réception esthétique9.
5 Entretien avec Séverin Guelpa du 29/10/2013 6 ibid. 7 Anna Vaucher (2011), Les artistes pourraient déserter Genève, Tribune de Genève 8 J. Lévy et M. Lussault (2003), Dictionnaire de la géographie, p. 238 9 J. Lévy et M. Lussault (2003), Dictionnaire de la géographie, p.107
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
5
De nos jours la question de la place de la culture dans la ville est en transformation, elle subit de profondes mutations. Dans les milieux artistiques, on observe un bouleversement des rapports avec les institutions, notamment envers la légitimité de la culture alternative d'occuper un espace donné.
1.4 Méthode d'étude/démarche
Suite à cette entrée analytique, nous identifions trois hypothèses, se situant à trois échelles différentes issues de notre recherche empirique que nous allons ensuite développer par une confrontation avec des éléments théoriques. Après cette première partie, nous souhaitons nous intéresser plus spécifiquement à l'activité artistique et aux évolutions que son environnement de travail subit de nos jours par rapport aux enjeux urbains que Genève connaît de nos jours. Notre problématique de recherche transversale est donc la suivante;
La transition de pouvoir de la culture alternative vers une forme institutionnelle représente-t-elle pour
les artistes une chance ou une contrainte ?
1.5 Hypothèses
Nous allons à présent tenter de mieux comprendre la complexité de la réalité de l’épaisseur sociale de notre problématique en développant les différentes échelles dans laquelle elle se situe :
1. l'échelle de la ville, la transition a pour conséquence une inscription de l'activité artistique dans le temps assurant sa pérennité.
2. l'échelle du lieu, la transition du squat à l'atelier officiel représente une rupture, ce changement de forme d'activité contribue à la richesse du nouveau site.
3. l'échelle de l'homme, la transition s'exprime par le passage d'une activité artistique à une activité artisanale modifiant la condition de l'artiste.
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
6
2. Vers un centre artisanal
2.1 L'échelle de la ville
2.1.1 La culture alternative
La congestion ou le manque de place que la cité de Calvin connaît est une réelle difficulté pour chacune des catégories sociales de la ville. Parallèlement à cela, les autorités genevoises reconnaissent de mieux en mieux l'activité artistique et tendent à pérenniser les espaces qu'elle occupe. Elles se montrent bien plus à l'écoute de la scène culturelle par rapport à ce qui se pratiquait auparavant. Ce phénomène joue un rôle prépondérant dans l'activité de l'artiste de nos jours. A présent, nous pouvons parler d'institutionnalisation de la culture alternative. Dans ce sens quelle sont les impacts de ces évolutions sur le développement de la scène artistique genevoise ?
Dans l'histoire il est possible d'identifier un moment de rupture avec les mouvements étudiants de 1968. En effet, avant cette date, l'activité artistique était très liée à l'académisme. Il y avait un apprentissage dirigé, représenté notamment par l'Ecole des Beaux-Arts qui enseignait une vision de l'esthétique et des styles10. Après cette date, nous observons une rupture avec l'émergence des phénomènes de luttes urbaines et des mouvements squats ce qui participa à la constitution de la culture alternative, en opposition à la culture dominante. Elle est donc alternative par un effet de rupture avec le courant majoritaire (main stream), elle ne peut donc exister qu'en restant minoritaire. A ces débuts, il y eut une période d'âpres luttes entre le pouvoir et ce mouvement11. Il vit par la suite l'émergence du mouvement squat à Genève dans les années 1980 et 1990. Ce mouvement s'était constitué à la suite de la crise du logement dans les années 1980 à Genève, il est né d'une tension urbaine avec d'un côté une jeunesse revendiquant son droit au logement bon marché 12 et de l'autre la généralisation de la logique capitaliste dans les dynamiques urbaines notamment pour le logement. La lutte pour la sauvegarde du quartier des grottes est l'événement fondateur de ce mouvement, il s'agissait de défendre un quartier populaire idéalement situé dans la ville, proche de la gare, contre sa démolition imminente. Dès lors, ce mouvement s'est fortement développé dans la cité de Calvin. La volonté première du mouvement est le retour des habitants dans un immeuble non-occupé. Les squats étaient souvent composés de membres défendant une vision de la ville, ouverte et susceptible d'accueillir toutes les couches sociales, en rupture avec celle qu'il connaissait et la société de consommation. De plus ils étaient souvent engagés politiquement. Ce mouvement permit l'éclosion de nombreux artistes s'affranchissant des conventions établies et développant un art innovant et créatif13. Le squat représentait cependant un ordre précaire pour l'artiste.
"Les politiques publiques sont soucieuses de procéder à une démocratisation de l’art et à favoriser la création artistique. Toutefois, Philippe Henry (2002) souligne qu’il s’agit d’une volonté de rendre accessibles « les œuvres capitales » au plus grand nombre, autrement dit, l’art de quelques-uns pour tous. En opposition, les acteurs culturels alternatifs défendent une
10Jacques Lucan (2009), Cours THA III, Cours 1 , ENAC-EPFL 11 Jean-François Nicod (1980), Centres autonomes, Archives de la RTS 12 Lise Nada (1993), La culture squat, Archives de la RTS 13 ibid.
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
7
démocratie culturelle participative, résultante de la sensibilité, de l’expression et de la créativité de chacun, c’est-à-dire, l’art par tous et pour tous. 14
"
Ce mouvement a servi de terreau à divers artistes, créant ainsi un véritable réseau de créatifs indépendant, à l'image d'une nébuleuse peu contrôlée et contrôlable. Dans ce cas la question du passage d'un pouvoir autonome, à un pouvoir institutionnel, dans le sens de la subordination à un pouvoir supérieur représenté dans ce cas par la puissance publique demeure une rupture. Ceci est particulièrement le cas pour ces artistes ayant connu les mouvements squats, synonymes de résistance et d'opposition à l'ordre urbain établi.
2.1.2 Le processus d'institutionnalisation
Ce processus permettant la transition de la culture alternative et informelle à un nouveau type de pratique de type institutionnelle impacte fortement la dynamique de création. La stratégie mise en œuvre par les autorités de la ville consiste du moins dans le domaine de la culture, à identifier les conflits et à les résoudre par le dialogue en cherchant des compromis entre les différents acteurs, dans ce cas les artistes. La ville est à ce sujet représentée par Sami Kanaan, conseiller administratif (directeur du département de la culture et du sport). Les artistes alternatifs, ont eu donc tendance à se regrouper en association afin de désigner des personnes susceptibles de représenter leurs intérêts dans les discussions avec la puissance publique. Les intérêts privés sont eux aussi impliqués dans cette dynamique dans le sens que de plus en plus d'artistes font appel à des fonds d'origine privés afin de financer des projets et créer des partenariats. Donc cette dynamique s'effectue tant pour la sphère publique que celle privé. L'institutionnalisation peut se définir comme suit:
Institutionnalisé: Dépersonnalisé et exprimé par un titre, une fonction, en vertu duquel l'obéissance des gouvernés est due. Donner à quelque chose un caractère permanent. 15
Il est nécessaire de préciser que tout un pan de la culture est déjà institutionnalisé de longue date, notamment l'Orchestre de Genève, l'Opéra et les musées. Ces institutions rencontrent de nos jours un franc succès et participent à la vivacité culturelle genevoise et au rayonnement de la ville. Par rapport aux autorités, leur intérêt est de réintégrer tout un pan de la culture urbaine au sein de l'institution publique pour ainsi mieux la contrôler. Car l'argent investi permet un droit de regard dans tout le fonctionnement et l'organisation de la scène artistique alternative et les possibles "troubles à l'ordre public" que celle-ci pourrait causer. Il est légitime de penser que la première volonté de la ville est de soutenir la culture mais des avantages inhérents à ce processus émergent.
Ce phénomène est cependant récent dans cette culture qui était encore récemment qualifiée d'alternative. Elle est donc travaillée par des forces et des tensions dont il importe de prendre la mesure, de comprendre les mécanismes et de discerner les tendances à venir. Cette intégration a pour cause et effet ce que nous appelons « processus d’institutionnalisation » dans ce travail.
Les artistes qui devaient quitter le lieu ont fait un inventaire des besoins. Pour ce faire une table ronde a été créée. On y comptait la ville (S. Salerno), le canton (Müller), ainsi qu'une délégation d'artistes. La question centrale était de savoir s'il était possible de se reloger dans un autre bâtiment en gardant l’esprit de l’autogestion. Le thème de la vie nocturne a été
14 Muriel Becerra (2012), Pérenniser les lieux culturels alternatifs? Le cas de la ville de Genève, p.11 15Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (2012), Lexicographie, CNRS
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
8
âprement discuté, il a été écarté. La Ville craignant les nuisances sonores. La volonté première des artistes était de récupérer des ateliers pour le travail 16.
En lien avec l'institutionnalisation, la question des subventions est déterminante. Car de nos jours les possibilités de financement pour la culture se raréfient, le nombre d'acteurs de la scène culturelle augmentant tandis que les possibilités de financement restent limités et dépendantes de la conjoncture. En cas de crise, les subventions à la culture sont bien souvent les premières victimes collatérales 17. L'institutionnalisation représente cependant pour la scène culturelle alternative une réelle opportunité d'amélioration de ces conditions. Mais aussi elle apporte la preuve d'une certaine reconnaissance de son travail ainsi que des nouvelles possibilités de rayonnement culturel. Dès lors surgit la question de l'embourgeoisement de la scène alternative avec la pérennisation de son activité, inhérente à la reconnaissance publique. Ainsi les artistes n'encourent plus les risques d''être expulsés du jour au lendemain, de n'être plus chauffé l'hiver et de vivre dans l'incertitude financière.
2.1.3 La nouvelle ville créative
De nos jours en Europe occidentale, la culture alternative améliore sa reconnaissance. Elle tend à s'affirmer et les mouvements squats évoluent, s'ouvrent de plus en plus sur l'extérieur 18 et leur environnement. Dès lors, les squats sont fortement remis en question, notamment avec l'émergence du phénomène de gentrification. Des quartiers auparavant populaires ou des anciens squats sont en train d'être rénovés, réhabilités. De ce fait, les occupants parmi lesquels des artistes sont progressivement remplacés par des nouvelles classes sociales. Parmi ces sites, on peut noter Ilot 13, Artamis et Rhino.
De nos jours, la gentrification de nombreux quartiers de la ville de Genève est à l'œuvre quand elle n'est pas déjà effective. Cette notion peut se définir comme suit:
La gentrification désigne une forme particulière d’embourgeoisement qui concerne les quartiers populaires et passe par la transformation de l’habitat, voire de l’espace public et
des commerces19.
Parmi les acteurs de ce phénomène, on peut faire émerger les classes "perdantes" comme les classes sociales à revenus inférieurs, les squatteurs, les immigrés, les étudiants et les classes "gagnantes" soit les classes à revenus supérieurs, les promoteurs immobiliers et la classe créative émergente. On parle du retour au centre des classes aisées, qui se trouvaient auparavant en périphérie de la ville. Désormais la société est basée sur le principe d’autonomie individuelle, avec une accélération de la stratégie de marchandisation de l’espace20, et une substitution de la valeur d'échange à la valeur d'usage dans le sens développé par Lefebvre21 . Ceci se renforce de nos jours, en effet on constate l'émergence de nouvelles classes sociales comme la fameuse creative class, que les différentes politiques publiques tentent d'attirer. Elle se définit par une population engagée dans des processus créatifs, parmi laquelle
16 Entretien avec Séverin Guelpa du 29/10/2013
17 (2012) La culture, un secteur en crise...à cause de la crise, Le Huffington Post 18 Creative Capitalist City, The struggle for affordable space in Amsterdam 19 Anne Clerval (2004), Gentrification, Hypergeo 20 Luca Pattaroni (2013), Cours Sociologie Urbaine, Cours II, EPFL-ENAC, p.42 21 Henri Lefebvre (1968), Le droit à la ville, Chapitre I: Urbanisation et Industrialisation, p.2
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
9
on distingue le super creative core (scientifiques, ingénieurs,...) et les creative professionals (secteur high-tech, services financies,...)22. Il est intéressant d'observer que cette nouvelle population est bien souvent demandeuse de différentes formes artistiques, notamment la forme alternative.
« La force du néo-capitalisme managérial actuel [est] d’avoir pu faire de la créativité un facteur de productivité » 23.
Dans ce contexte se pose la question suivante, quelle est la place appropriée pour l’art dans la ville contemporaine capitaliste ? Les grandes villes ont toujours été l’espace d’épanouissement de la singularité et de la créativité 24. Le maintien de l'activité artistique en centre-ville ou en proche périphérie est selon nous un postulat à défendre. Participant à la diversité urbaine et confrontant le tissu urbain à la différence.
Nous avons dans ces lignes, tenté d'exprimer la transition de pouvoir entre la culture alternative et institutionnelle. Pour finir ce développement, il est légitime de s'interroger sur les contradictions inhérentes à ce processus d'institutionnalisation. Car bien que cette dynamique présente de nombreux avantages pour les autorités comme pour les artistes avec la pérennisation de leur activité. Nous constatons une diminution de l'acceptation de la différence par de nombreux certains acteurs de la ville capitaliste. Dans cette perspective, quelle est la relation du site artistique du Vélodrome avec son environnement ? De plus quel sera l'impact de la dynamique d'institutionnalisation sur l'évolution du métier d'artiste et sur le processus de création ?
22 Mischa Piraud (2013), Le Nouvel esprit de la ville, Cours de Sociologie Urbaine, EPFL-ENAC, p.31 23 Jean-Louis Genard (2008), L'idéologie de la créativité et ses contradictions, p.7 24 Elsa Vivant (2009), Qu'est-ce que la ville créative, Paris: PUF
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
10
2.2 L'échelle du lieu
2.2.1 Situation
Notre lieu d'étude se trouve entre le quai Ernest Ansermet et la rue du Vélodrome à la jonction du Rhône et l’Arve. Il abrite aujourd’hui dans son sous-sol l’association des artistes du Vélodrome. Le bâtiment a été réalisé vers la moitié du 19ème siècle et était l’abattoir principal de la cité genevoise. La mention figure toujours sur les plans officiels de la ville. Il fut transformé en marché couvert trois décennies plus tard avant de devenir plus récemment un centre artisanal et enfin culturel, mis à disposition par la ville pour « reloger » une partie des artistes évacuer du site Artamis en 2002.
2.2.2 Définitions
Pour situer cette transition commençons par définir ce qui est communément le squat:
Squat, l’action d’occupation illégale d’un local en vue de son habitation ou de son utilisation collective25
Amy Wong, journaliste pour la radio WRS, nous donne une version pertinente de la culture alternative :
Le terme de « culture alternative » implique une alternative à ce qui est communément admis comme la culture, ce qui suggère peut-être une rébellion contre la convention. Lorsque cette dernière se réfère à l’espace urbain, poursuit-elle, on pourrait alors supposer que l’espace doit être fourni par d’autres moyens, et non par l’État. En tant que tel, elle fait observer que tout ce qui s’appelle « alternatif » sera toujours dans une situation précaire, en particulier à Genève avec une population qui se développe rapidement dans un espace urbain restreint.
On s’aperçoit que le terme de culture alternative est fortement lié à l’endroit où il s’exerce, cela signifierait-il que dès lors que la culture alternative et l’art qui en découle s’exercent dans un cadre conventionnel ceux-ci ne peuvent plus être appréhendé de la même manière ?
2.2.3 In situ
Lors de notre visite au Vélodrome nous n’avons pas trouvé directement l’entrée des ateliers d’artistes et pour cause, l’accès est difficile, on a l’impression de rentrer dans un garage souterrain, rien ne laisse penser ni n'est mentionner que des ateliers d’artistes se trouvent là. Le site est en perpétuel transformation, la dernière date des années 1960. Lorsque les artistes l’ont investi ils ont travaillé à son réaménagement. Aujourd’hui une nouvelle étape est en marche, un panneau de chantier imposant à l’entrée nous montre clairement la volonté de mettre ce lieu en avant, en l’assainissant. On peut s’avancer en disant que l’usage du lieu en tant qu’espace de créativité fait partie d'une vision sur le long terme de la part de la ville.
«Recréer une zone d’émulsion artistique en gardant l’esprit d’Artamis.» tel est le souhait des artistes du Vélodrome26
25 Cécile Péchu (2010), Les Squats, Paris: Presses de Sciences-Po, « Contester » 26 Entretien avec Séverin Guelpa du 29/10/2013
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
11
Il ne faut pas s’y tromper, le Vélodrome n’a pas grand-chose de commun avec son prédécesseur si ce n’est une partie de ses occupants. Si le squat Artamis pouvait cumuler les fonctions de lieu de création avec des espaces de travail, de diffusion avec ses galeries, de divertissement avec des représentations, des soirées festives voire même de résidence. Il était un lieu dans lequel finalement la liberté est grande et avec peu de restrictions, ce qui caractérise le « squat ». Le Vélodrome lui, comme tous les lieux alternatifs créer après 2008 n’a gardé qu’une seule et unique fonction, celle d'un espace de création dans le sens d'espace de travail. Même si des groupes d'artiste ont été transférés tels quels, comme un théâtre ou un atelier de musique, il n’est plus question de représentations scéniques ou de concerts, non plus de débits de boisson. Le Vélodrome sert à l’entrainement uniquement et n’accueille pas de visiteurs extérieurs, conformément aux vœux des pouvoirs publics.
Une réelle rupture s’est donc faite, parallèlement à cela la nuit genevoise a perdu des lieux festifs alternatifs dans cet intervalle. Comme nous l’a glissé S.Guelpa lors de notre interview, la cité de Calvin en manque aujourd’hui cruellement, le grand nettoyage opéré en 2008 a laissé un vide pour une partie des Genevois. La ville adopte une posture réservée quant à offrir à la culture musicale alternative des lieux où elle peut s’exprimer. Les botellón (rassemblement de jeunes en vue de consommer de l'alcool) expriment une tendance et montrent bien la volonté de s’éloigner du système commercial de la nuit pour une partie de la population. Cependant le problème ne dépend pas que d’un acteur, les citadins genevois supportent de moins en moins tout bruit qui n’est pas familier au quartier ou à la ville. Les autorités elle s’en accommode et se dit peut-être qu’une « Usine » suffit pour l’instant.
Du point de vue des artistes du Vélodrome le constat est nuancé :
« Ici, on est mieux pour travailler, c’est plus sérieux, il n’y a pas tout le temps plein de gens qui viennent de l’extérieur. » Mamadou Zerbo et Issiaka Boukungu
Constantin et Seni, de Klat, expliquent que bénéficier d’un bail (collectif) enlève un certain stress lié au statut de squatter.
Harold Bouvard dit pour sa part ne pas regretter Artamis : « Il y avait du bon et du mauvais. Je suis pour que les choses bougent », explique cet ébéniste, designer et couturier en nous accueillant dans son antre. La dimension pluridisciplinaire du Vélodrome, rare à Genève, lui plaît, car elle favorise l’émulsion artistique. « Ici, on collabore bien, la location est abordable et les locaux adéquats » 27
Cette diversité et cette mixité dans les activités représentées au Vélodrome est une force et l’association du lieu en est consciente. En effet, la liste d’attente pour intégrer un atelier dans le quartier de la Jonction est longue d’une cinquantaine de personnes. Le choix se fait sur dossier en respectant cette volonté de lieu de création pluridisciplinaire et aussi en évitant les ateliers fantômes, inoccupés. 28 En tant qu’atelier privé l’effervescence artistique est limitée à l’intérieur des locaux. C'est une force que les disciplines soient variées et cela favorise les échanges. Cependant, le rayonnement est très limité sur le quartier, il n’y a aucune interface avec l’extérieur permettant un échange, les normes de sécurité ou l’intolérance citoyenne aux nuisances sonores participent à rendre l’endroit hermétique. Il ne se différencie à l’heure actuelle pas d’un immeuble de bureau du point de vue de son rayonnement à l’échelle du quartier. Une particularité de ce lieu de création est de promouvoir un certain roulement entre des artistes permanent constituant un ciment artistique et des
27 Géraldine Viredaz, (2009), Les artisans du Vélodrome inaugurent leur écrin, Le Courrier
28 Entretien avec Séverin Guelpa du 29/10/2013
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
12
artistes venant pour une plus courte période permettant d'amener des idées nouvelles et une vision différente. Tous les acteurs de la scène artistique s'accordent à dire qu'un site refermé sur lui-même s'affaiblirait et perdrait en force d'innovation. L'équilibre entre ouverture et fermeture et donc difficile à obtenir.
2.2.4 Vision à long terme
Ils (les artistes) comptent aussi embellir l’extérieur pour rendre le site accueillant. Mais surtout, la Ville doit planifier du gros œuvre pour sécuriser l’endroit. En particulier, l’immense dalle de béton au plafond doit être isolée. C’est un chantier permanent, on ne sait pas si ça finira un jour29.
La Ville est donc en train de rénover et d'assainir le lieu. De plus, 600 m2 de parking situés à l’entrée du Vélodrome, auparavant inoccupées, ont été aménagés et mis aux normes. Est-ce que le site va pouvoir ne serait-ce qu’un peu sortir de son introversion pour s’ouvrir plus sur l’extérieur après ces travaux ? Interrogé sur ce sujet, S.Guelpa ne connaît pas la réponse mais reste optimiste tout en sachant pertinemment que les décisions appartiennent plus aux autorités qu'aux artistes. Il faudra voir comment la situation évolue.
Une part de la population impose une sorte de contrôle normatif posant la question du droit à la ville et créant des tensions avec les lieux dédiés à la culture alternative s’activant aussi en soirée. Le rapport de force penche clairement d’un côté et le constat qu’un citoyen résident peu faire taire un lieu alternatif autour duquel gravite plusieurs dizaines de personnes le confirme. La ville, entre les deux tente de trouver des compromis mais le ton est donné. Le manque d’alliés pour la culture alternative au sein des autorités actuelles est peut-être encore une insuffisante solidarité des acteurs et des défenseurs d'une culture différente.
On pourrait résumer en disant « nous (les autorités) vous avons bien laissez profiter pendant plus de 10 ans, maintenant on vous donne un lieu pour travailler mais ne comptez sur rien de plus 30, certains diront que c’est déjà un beau geste, ce qui est vrai, toutefois les espaces de diffusions et de représentations sont devenus problématiques à trouver avec les facteurs de restrictions comme les nuisances pour les habitants et les normes de sécurité. Tous ces éléments ont, pour l’une des villes qui furent parmi les plus représentatives du mouvement squat et de sa culture, profondément transformés l’esprit alternatif, mais celui-ci n’a pas disparu, le site du vélodrome étant l’un de ses représentant. Il tient à ses occupants par le biais de l’association, de maintenir et faire perdurer des lieux de culture alternative en ville de Genève.
29 Entretien avec Séverin Guelpa du 29/10/2013 30 C’est en réalité la fondation Wilsdorf qui paie, l’état perçoit un loyer normal, la subvention de la fondation permet un loyer abordable aux artistes
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
13
2.3 L'échelle de l'homme
2.3.1 Définitions
La manière de différencier l’artiste de l’artisan varie avec le temps, au fil des siècles les définitions changent : 31
L'artiste:
"Nom que l’on donne aux ouvriers qui excellent dans ceux d’entre les arts méchaniques qui supposent l’intelligence ; & même à ceux, qui, dans certaines Sciences, moitié pratiques, moitié spéculatives, en entendent très-bien la partie pratique, ainsi on dit d’un Chimiste, qui sait exécuter adroitement les procédés que d’autres ont inventés, que c’est un bon artiste ; avec cette différence que le mot artiste est toujours un éloge dans le premier cas, & que dans le second, c’est presque un reproche de ne posséder que la partie subalterne de sa profession. " (Diderot - Encyclopédie 1ere édition)
"Personne qui produit des œuvres suscitant une émotion ou un sentiment et invitant à la réflexion. Elle exerce un savoir-faire, un art ou une technique appartenant aux beaux-arts." 32
L'artisan:
"Nom par lequel on désigne les ouvriers qui professent ceux d’entre les arts méchaniques, qui supposent le moins d’intelligence. On dit d’un bon Cordonnier, que c’est un bon artisan ; & d’un habile Horloger, que c’est un grand artiste. " (Diderot - Encyclopédie 1ere édition)
"Travailleur indépendant, qui justifie d'une qualification professionnelle et d'une immatriculation au répertoire des métiers pour l'exercice, à son propre compte, d'une activité manuelle." 33
Aujourd’hui, l'artisanat se situe en opposition de l'industrialisation. Il véhicule des valeurs plus humaines et durables correspondant très bien à la tendance des consommateurs actuels. Ces derniers souhaitant s’identifier à des modèles de consommation responsables et respectueux de l’environnement. La volonté du développement de l'artisanat s'inscrit dans une dynamique de rupture avec la production industrielle issue du concept du taylorisme, et de la ville machine 34. Elle avait pour principe la répétition de tâches bien pensées pour une mise en œuvre finale commune. L'artisanat est compris comme la capacité de production d'objets uniques, artistiques, ne pouvant en aucune manière être assimilé à un produit industriel. Ce n’est plus un savoir traditionnel qui est mis en valeur mais une manière durable de consommer qui est recherchée.
En ce qui nous concerne plus particulièrement, l’art (de vivre) du squat intrigue quand il est contestation des systèmes établis et le revendique. Il dérange quand il est trop visible et ne correspond pas aux codes sociaux, cependant il ne cherche pas à ce que ça change. Il séduit par sa capacité créative et est mis en valeur par une partie de la société jugeant le produit de cet art comme toutes
31 Jean-Louis Genard (2008), L’idéologie de la créativité et ses contradictions, 32 Larousse, Dictionnaire de Français 33 ibid. 34 Luca Pattaroni (2013), Cours Sociologie Urbaine, Cours 1, EPFL-ENAC, p.14
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
14
autres formes, en lui donnant un prix. Il fascine même car il est libre de toutes contraintes, sans code de mise en œuvre et réalisable sans compromis, sans l’inquiétude de plaire ou non.
Cependant les créatifs pratiquant cet art particulier dérangent. Ils sont présentés comme défiant les règles établies et non intégrés à la société. A Genève ils sont rejetés par une partie de la société de plus en plus fermée à la différence, l'ampleur du succès du MCG en est un exemple. Ils sont contraints d'opérer une mutation de leur mode de vie et de modifier leur manière de voir la société. Ces artistes doivent en quelque sorte se fondre dans la masse culturelle sans trop revendiquer leur appartenance à un mouvement contestataire. De nos jours, ils doivent être beaucoup plus fins et diplomates dans leurs démarches que durant les années fastes du mouvement squat à Genève.
Le produit de cette tension nous semble intéressant et demande à être analysé. Le passage du squat d’Artamis aux ateliers subventionnés du Vélodrome est le cœur de notre étude. Les créatifs étant pour certains d’anciens squatteurs, vivent un tournant majeur de l’histoire de leur statut et de la manière dont ils sont perçus par la société.
2.3.2 Un retour vers l'artisanat
" L'art se distingue aussi de l'artisanat ; l'art est dit libéral, l'artisanat peut également être appelé art mercantile. On considère le premier comme s'il ne pouvait être orienté par rapport à une fin (réussir à l'être) qu'à condition d'être un jeu, i.e. une activité agréable en soi ; le second comme un travail, i.e. comme une activité en soi désagréable (pénible), attirante par ses seuls effets (par exemple, le salaire), qui donc peut être imposée de manière contraignante. " 35
La disparition progressive du mouvement squat est d’une certaine manière favorisée par cette dichotomie. Elle l’est en tous cas par l’utilisation d’arguments difficilement réfutables par les artistes. Ces derniers se trouvent parfois stigmatisés comme profitant d'une situation sur le dos des contribuables. Leur rôle est remis en question par la société dans laquelle nous vivons. Il devient nécessaire pour eux de redéfinir leur rôle et de trouver de nouvelles manières pour donner à voir ce qu’ils produisent dans cette société qui les juge. L’artiste, revendiquant son appartenance au mouvement squat par son implication active dans la contestation, trouve aujourd'hui de moins en moins de partisans à sa cause. Il se trouve en difficulté quand il lui faut prôner son droit de vivre en marge de la société qui le juge et le critique en bien comme en mal. Son droit de considérer que sa place dans la ville comme alternative devient difficilement défendable alors que d’autres s’éreintent au travail pour subvenir à leurs besoins et payer leurs loyers.
Nous pouvons comprendre par le passage Artamis-Vélodrome, du fait que le second soit considéré par les pouvoirs publics comme un centre artisanal, le début d’une nouvelle ère artistique, une manière pas si nouvelle mais différente de parler de l’artiste, de cet artiste qui travaille comme tout le monde mais d’une autre manière.
2.3.3 La relation artisan / artiste
Quand nous observons ce qui se passe pour les artistes du Vélodrome et l’institutionnalisation de leur statut il est possible de supposer que celui-ci doit se cacher derrière une façade artisanale pour exercer sa profession. Il semblerait que la nouveauté est qu’il ait besoin d’une justification sociale l’autorisant à exercer son art. Cependant il faudra le faire sans déranger le voisinage. Bien que gardant une totale
35 Kant, cité sur Philocours.com (2003), Qu'est-ce qui distingue l'art du travail ?
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
15
indépendance face à la commande 36, nous pouvons y lire quand même une forme de perte d’autonomie. Actuellement, bien souvent l’art n’est plus jugé en tant que tel mais c’est la manière de le réaliser qui l’est. Avec des heures de travail journalières définies par un horaire d’ouverture du lieu de production et un accès restreint au public. La création se trouve à présent en quelque sorte automatisée voire industrialisée.
De plus, le grand public ne comprend pas toujours bien le rôle de l'artiste. De plus pourquoi celui-ci défend son statut alors que nous tendons vers une totale démocratisation de l’art et que chacun peut alors prétendre à une créativité égale, une forme de culture partagée et immédiate. La difficulté principale étant que la créativité est quelque peu trop banalisée pour s'inscrire dans la culture de masse. Cette dernière restant démocratisée pour le coup car tout est fait pour que les gens s’évadent 37, la réflexion sur ce qu’ils acceptent comme étant la normalité des choses ne leur est plus indispensable, ceux qui savent s’en chargent pour eux.
2.3.4 L'artiste et son lieu d'exposition (galeries)
Dans le cas du Vélodrome, lieu de production artistique sous couvert d’artisanat, les locaux ne sont pas prévus pour accueillir le public et donc ne permettent pas d’y exposer le travail qui y est réalisé. De ce fait l’artiste se voit obligé d’externaliser son lieu d’exposition par rapport à son lieu de production. A la manière de l’artisan qui loue une vitrine en ville alors que son atelier est en périphérie, là où les loyers sont moins élevés. En ceci il y trouve un avantage, celui d’être dans son cocon sans avoir à être dérangé par le passage de personnes externes et étrangères à son environnement de travail. Le créatif peut ainsi s’adonner de manière complète et sans distractions à l’exécution de son œuvre. Tout au plus son atelier sera ouvert quelques fois par an lors de manifestations prévues à cet effet. D’un autre côté, le fait d’exposer ailleurs implique des dépenses supplémentaires qui peuvent mettre en péril son activité. S’il ne parvient pas à suscité suffisamment d’intérêt sur son travail, il risque de ne pas couvrir ses dépenses et sera peut être tenté de produire des œuvres qui se vendent plutôt que de faire de l’art dans le sens de la pure expression de sa créativité.
" Pour beaucoup, la difficulté de trouver un lieu de travail à un prix abordable, débouche sur un changement d'orientation professionnelle ou un déplacement dans une autre ville. Cela signifie une perte de forces créatives pour Genève et crée un environnement pouvant décourager les nouvelles générations de choisir une voie artistique. " 38
Ceci n’était pas important avant le passage au Vélodrome. L’artiste libre institutionnalisé tente pour le coup de vaincre certains nouveaux obstacles hérités du passé. 39
• L’accessibilité de l’espace en ville • L'image négative accolée à ces lieux : délinquance, drogues, violences, insalubrités. • Les nuisances sonores dans une ville où la majorité des habitants deviennent de plus en plus
intolérants au bruit • Les activités pas ou peu rentables. • La politique de l’Etat de ne pas perdre d’argent sur les espaces mis à disposition de l’art
« off ».
36 Jean-Louis Genard (2008), L’idéologie de la créativité et ses contradiction 37 Moins! journal romand d’écologie politique, N°8 2013 38 Dossier UECA : Revendications de l'UECA el recommandations aux partis et aux élu-e-s pour le soutien de la culture autogérée. Genève 2009. p.6 39 Albane Schlechten, permanente de l’Usine et coordinatrice de l’UECA
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
16
3. Synthèse
Nous avons tenté dans notre analyse de la ville de rendre compte d’une préoccupation actuelle ayant une portée autant politique que sociologique et dans laquelle nous sommes d’une manière ou une autre impliqués en tant qu’architectes. Notre point d’entrée était un cas concret, celui du Vélodrome. Au fil de notre étude nous nous sommes rendu compte que ce cas à priori simple permettait d’élargir notre champ de recherche car il se trouve au centre d’une lutte pour le droit à la culture plutôt âpre en ville de Genève.
La ville et le canton se préoccupent de la valeur monétaire de ses biens, des rendements qu’ils peuvent en retirer. Ils cherchent à revaloriser le moindre espace tout en jouant le rôle de gardien de l’hétérogénéité des activités pour garantir le plus de différences possibles afin de garder une richesse culturelle faisant la renommée de Genève. Le cas un peu atypique du Vélodrome permet de mettre la ville à l'épreuve de la différence, notamment celle de la créativité et de ce que cela implique pour l'artiste Nous avons pu faire ressortir certaines difficultés que les artistes rencontrent dans ce lieu très précisément quand il s’agit de vivre dans une société en mutation et quels nouveaux mécanismes ils peuvent mettre en place pour continuer à prôner la différence face à un système établi qui, malgré son évolution, ne va toujours pas en s’améliorant.
Au vu de la difficulté de la tâche, nous avons fait le choix de diviser nos recherches afin de couvrir la question aux trois échelles différentes que sont celle de l’urbain, du lieu et de l’humain. Toutes trois étant interdépendantes nous ne pouvions pas nous contenter d’en étudier que l’une ou l’autre. Ceci nous a permis d’approfondir la question et de mieux comprendre ce qui semble se jouer aujourd’hui pour les artistes et ainsi de rendre compte de la complexité réelle de l’épaisseur sociale de notre problématique. Cependant toutes ces divisions comportent leur part d'arbitraire, les échelle étant entremêlées. Ces phénomènes de transitions de pouvoir comme d'expérience sont subtiles est difficilement appréhendables.
Les artistes semblent avoir été rattrapés par la mode du développement durable et les valeurs nouvelles qu’elle amène dans l’imaginaire collectif. L’accessibilité à la culture s’est accrue, les gens se l’approprient et ne reconnaissent plus dans le statut d’artiste une valeur spécifique puisqu’ils peuvent faire la même chose au nom de la créativité que chacun porte en lui. De ce fait les artistes ne peuvent plus s’approprier ce statut librement. Durant l’époque glorieuse des squats il était aisé de s’auto déclarer artiste dans le simple but de ne pas faire comme les autres, de profiter de la vie au sens familier que l’on donne à l’artiste. Celui qui apprécie l'art se laisse aller au gré de ses envies du moment.
Le squat donnait l'opportunité de vivre avec peu de contraintes sociales ou économiques, en côtoyant d’autres personnes réellement impliquées dans une idéologie de vie commune et engagées. La transition d’Artamis au Vélodrome a fait d’une certaine manière un tri entre les convaincus œuvrant pour ce qu’ils pensent une juste cause, et d'autres acteurs moins engagés. Seuls les premiers semblent avoir réussi la reconversion et ce n’est pas forcément une mauvaise chose pour des artistes comme Séverin Guelpa qui passent 95% de leur temps à œuvrer pour le bien de leur association. Une ville comme Genève n’a de moins en moins de place pour accueillir des personnes se disant artistes mais n’apportant que trop peu à son développement communautaire et donnant une image négative au statut d’artiste. Dans ce contexte la place de la culture alternative libre et en résistance face au pouvoir dominant capitaliste semble inéluctablement se réduire. Dès lors la formalisation de la culture auparavant squat au sein d'associations d'artistes comme au Vélodrome est une voie intéressante qui mérite d'être continuée et défendue. Dans une certaine mesure, ce type d'expérience a fait ses preuves en dégageant des compromis satisfaisants tant pour le pouvoir que l'artiste.
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
17
4. Bibliographie
Ouvrages ou articles scientifiques
Lévy Jacques & Lussault Michel (2003), Dictionnaire de la géographie, Paris: Editions Belin Becerra Muriel (2012), Pérenniser les lieux culturels alternatifs? Le cas de la ville de Genève. Sous la direction de Laurent Matthey , Co-directeur : Luca Pattaroni Péchu Cécile (2010), Les Squats, Paris: Presses de Sciences-Po, « Contester » Vivant Elsa (2009), Qu'est-ce que la ville créative, chap. III: La ville, territoire de l'économie créative, La ville en débat, Paris: PUF Levebvre Henri (1968), Le droit à la ville, chap 1: Industrialisation et urbanisation, Paris: Editions Economica, 2009
Luca Pattaroni (2007), La ville plurielle: Quand les squatters ébranlent l'ordre urbain, in Bassand M., Kaufman V., Joye D., 2007 (2e éd.), Enjeux de la sociologie urbaine, Lausanne, PPUR, 283-314
Genard Jean-Louis (2008) L’idéologie de la créativité et ses contradiction, In Enjeux de la créativité, réflexions et perspectives, Bruxelles, Ministère le Communauté française, Direction générale de la Culture, pp. 21-29
Sites internet
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (2012), Lexicographie, CNRS http://www.cnrtl.fr/definition/institutionnalisation
Clerval Anne (2004), Gentrification, Hypergeo http://www.hypergeo.eu/spip.php?article497
Creative Capitalist City, The struggle for affordable space in Amsterdam http://www.creativecapitalistcity.org/
Ecoquartiers Genève, Jonction-Artamis http://www.ecoquartiers-geneve.ch/index.php?page=jonction-artamis
Larousse, Dictionnaire de Français http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
Philocours.com (2003), Qu'est-ce qui distingue l'art du travail ? http://www.philocours.com/cours/cours-art.html
Cours
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
18
Lucan Jacques (2009), Cours THA III, Cours1 , ENAC-EPFL
Pattaroni Luca (2013), Cours Sociologie Urbaine, EPFL-ENAC
Piraud Mischa (2013), Le Nouvel esprit de la ville, Cours de Sociologie Urbaine, EPFL-ENAC, p.31
Articles de journaux
Vaucher Anna (2011), Les artistes pourraient déserter Genève, Tribune de Genève
Viredaz Géraldine (2009), Les artisans du Vélodrome inaugurent leur écrin, Le Courrier
(2013) Culture populaire et inculture de masse, Moins! journal romand d’écologie politique, N°8
(2012) La culture, un secteur en crise...à cause de la crise, Le Huffington Post
(2009) Dossier UECA : Revendications de l'UECA et recommandations aux partis et aux élu-e-s pour le soutien de la culture autogérée. Genève
Vidéos
Nicod Jean-François (1980), Centres autonomes, Archives de la RTS
http://www.rts.ch/archives/tv/culture/zone-bleue/3442464-centres-autonomes.html
Nada Lise (1993), La culture squat, Archives de la RTS
http://www.rts.ch/archives/tv/culture/viva/3474276-la-culture-squat.html
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
19
5. Annexes
Guide d'entretien avec Séverin Guelpa du 29 octobre 2013
1_Des questions générales:
A) Comment s'organise le lieu créatif du Vélodrome ? Quels rapports entre les différents membres de l'association ? Comment peuvent-ils se définir ?
B) Quelle relation entre l'association et l'extérieur ? Y a-t-il une volonté de partage de la création avec le grand public ? Ou plutôt celle d’un lieu de création plus discret dans lequel l'artiste développe son art de manière autonome ?
C) Quels critères de sélection (c.f. feuille annexe) sont-ils utilisés pour choisir les artistes ? Y a-t-il des artistes en résidences (temporaires / visites pour des workshops ou des expos) ? Ou les artistes sont-ils là pour une longue durée avec un projet artistique ? Y a-t-il un noyau d’anciens?
D) Existe-t-il une ligne directrice artistique (charte, valeur commune) ?
2_Des questions globales:
A) Quelle est la place de la fonction artistique dans la ville suisse d'aujourd'hui ? Est-elle suffisamment reconnue ? Quelle relation avec les autorités ?
B) La culture a-t-elle une place comme élément générateur de diversité ? Doit-elle rester très autonome ? Ou son institutionnalisation est-elle nécessaire ?
C) La culture alternative genevoise a-t-elle une visibilité suffisante ? Est-ce que des regroupements plus importants permettraient de gagner en visibilité ?
D) Genève, place financière internationale, n'est pas assez connue pour sa créativité artistique, la culture a-t-elle une place dans le rayonnement de la ville ? Si oui comment ?
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
20
Documents généraux
Figure 1: Situation du Vélodrome
Figure 2: La planche du concours pour l'abattoir municipal en 1844
Camillo_Chatelet_Desaules MA3 janvier 2014
21
Photos
Figure 3: Le panneau des travaux entrepris par la ville, photo RC
Figure 4: L'entrée du site du Vélodrome, photo RC