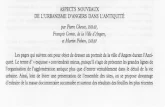Décors et espace architectural en Gaule entre l'Antiquité et le haut Moyen Âge
-
Upload
univ-avignon -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Décors et espace architectural en Gaule entre l'Antiquité et le haut Moyen Âge
Décors et espace architectural en Gaule entre l’Antiquité et le haut Moyen Âge
Apparition et développement des absides dans l’architecture domestique gallo-romaine
Éric Morvillez
Le nombre de domus et de villas connues en Gaule ne cesse d’augmenter. Sans compter des fouilles an-ciennes, parfois revues ou complétées par de nouvelles découvertes, de très nombreux quartiers de villes sont apparus par la multiplication d’opérations urbaines. Les images apportées par l’archéologie aérienne four-nissent aussi, pour les campagnes, de nouveaux exemples mais qui, sans chronologie précise, restent délicats à utiliser 1. Sans vouloir faire preuve ici d’ex-haustivité, nous avons choisi de tenter un bilan sur l’apparition en Gaule de la forme de l’abside, de voir comment cette partie de la salle était décorée et si l’on peut en déduire des principes de fonctionnement. De prime abord, on se rend compte que la forme, pour le début du Haut-Empire, n’est pas si fréquente dans le cadre domestique gallo-romain mais, surtout, que les décors de ces pièces, en particulier celui des absides proprement dites, sont très peu ou très mal conservés ou connus. Dans un premier temps, nous nous pen-cherons sur la naissance et la diffusion de la forme, en revenant à la question des influences de l’architecture domestique italienne. Nous verrons ensuite que, dans un contexte d’imitation, les absides se sont surtout multipliées en Gaule dans les belles demeures à partir du iie et dans le courant du iiie s. ; que les salles d’appa-rat à abside concentrent un degré de luxe qu’elles combinent à des aménagements de confort, comme le
1- Nous ne donneron ici qu’un seul exemple, celui de la villa d’Argilly dans la vallée de la Saône, qui présente dans l’axe de sa galerie de façade une vaste salle à abside, peut-être précédée d’un vestibule David & Goguey 1982, 149, 151, fig. 2b, 5.
chauffage qui en souligne la place prépondérante ; enfin, qu’elles s’agencent souvent au sein d’apparte-ments articulés en plusieurs pièces complémentaires : finalement, elles ne prennent sens que dans des plans assez complets, où leur forme particulière est d’autant plus mise en valeur. Nous étudierons le rapport entre l’abside et l’espace architectural qui la précède, dans une étude de spatialité, mot qui trouve toute sa signi-fication dans ce colloque sur le décor. Bien entendu, nous tiendrons compte de la répartition et de la qua-lité du décor qui induit parfois la fonction possible de ces zones de la pièce.
Sur la diffuSion de la forme abSidée
Mais avant de parler de la Gaule qui suit avec des écarts, comme bien des provinces de l’Empire, cer-taines modes importées d’Italie, il nous a semblé né-cessaire de faire un rappel sur l’apparition de la forme. Lorsque l’on observe le corpus des monuments connus, on s’aperçoit que la forme avec abside semi-circulaire est finalement encore peu diffusée avant le ier s. p.C. 2. Dans l’architecture des temples, on sait que l’abside fait son apparition en Italie autour des années 100 a.C., mais dans l’orbite domestique et privée, elle reste encore très rare avant le ier s. p.C. En contexte sophistiqué, on la retrouve employée dans les créa-tions des nymphées et grottes des résidences de plai-
2- Voir les exemples recensés dans l’œuvre fondatrice de B. Tamm : Tamm 1963, 148-181, fig. 54, 60 et 66.
258 décorS et eSpace architectural en Gaule entre l’antiquité et le haut moyen ÂGe
sance (comme dans la “villa républicaine” antérieure à la Villa Hadriana ou dans la salle à abside aménagée en “grotte” de la villa d’Horace à San’Antonio, près de Tivoli, “un des plus anciens, sinon même le plus ancien des édifices de la série”) 3. Elle se remarque dans l’architecture officielle de la fin de la République et du début du Principat, pour magnifier, dans les cellae des nouveaux temples prestigieux, les statues de culte : ainsi, au sanctuaire de Vénus Genitrix du forum de César puis dans celui de Mars Ultor du forum d’Auguste 4.
C’est aussi naturellement dans les thermes, pour accueillir parfois un labrum sur pied ou un bassin, que
3- Lavagne 1988, 382-385, daté dans les années 50 a.C.4- Gros 1996, pour le temple de Vénus Genitrix, 140-141, fig. 153 et 150, fig. 169 ; pour le temple de Mars Ultor, 142, fig. 154 (abside large et plus plate et nouveauté supplémentaire, en position surélevée par rapport à la cella).
la forme va trouver un développement rapide. Parmi les premiers exemples conservés, avec un décor que l’on puisse appréhender dans sa totalité, on rappellera le petit caldarium des thermes de la maison du Ménandre à Pompéi (1.10.4) 5. Cette pièce démontre clairement le souci d’une ornementation très soignée pour l’abside notamment dans cet exemple du 2e style finissant : cette dernière concentre le raffinement de la décoration dans cette partie de la salle (fig. 1). Mais ce sont les innovations néroniennes qui propulsent la mode des courbes et des culs de four, à partir des rési-dences impériales, à Rome d’abord, grâce au labora-
5- Ling 1997, 61-67, fig. 62 ; Ling & Ling 2005, 65-67, 248-253 ; Cerulli Irelli et al. 1993, t. II, 54, fig. 71 a. La dernière modification du péristyle a lieu vers 40-30 a.C., avec la construction des pièces thermales (46-49), ainsi que des niches (22-25) contre le mur du fond du péristyle, ces dernières se conjuguant à ce désir de rompre avec la monotonie des lignes. PPM II, 240-397, fig. 388.
———Fig. 1. Pompéi, maison du Ménandre. Caldarium (cl. E.M.).———————
apparition et développement deS abSideS danS l’architecture domeStique Gallo-romaine 259
toire de la Domus Transitoria et de la Domus Aurea 6, puis plus tard avec les Flaviens, dans les appartements complexes du palais de Domitien au Palatin.
Mais revenons d’abord à l’Italie pour rappeler le dialogue qu’entretient Rome avec ses provinces ; et nous parlerons ici de mode plutôt que de modèle. Pour analyser le phénomène en Gaule, il nous a paru utile en préambule de souligner l’émergence relative-ment lente de la forme semi-circulaire dans la lignée des riches domus de la péninsule italienne, et de rappe-ler que la forme a connu aussi d’autres faveurs que celle de figurer en partie terminale et axiale d’une salle de réception dans le décor domestique, notamment dans l’art d’aménager les façades et les lignes des jar-dins d’agrément.
Il convient d’abord de rappeler comment évolue la forme en Italie même pour pouvoir comparer avec la Narbonnaise marquée par une romanisation précoce, puis avec le reste de la Gaule. Pour les pièces de récep-
6- Dans les absides plates du nymphée de la Domus Transitoria par exemple, salles à absides de l’aile de l’Esquilin de la Domus Aurea.
tion, les formes à abside se rencontrent en Italie encore rarement au ier s. En observant les sites vésu-viens, on a l’immense avantage d’avoir un instant T pour la connaissance d’un phénomène de mode archi-tecturale. On remarque que la forme s’est encore bien timidement introduite dans les milieux provinciaux, dans une région pourtant très attentive en matière de mode décorative. En dehors des programmes de construction ex novo, on rencontre sans doute la diffi-culté, valable dans tous les contextes urbains, à récu-pérer de l’espace utile au sol pour créer l’abside, sur-tout dans des tissus construits densément. En Campanie, même après le tremblement de terre de 62 qui voit des remaniements importants des maisons, les exemples restent rares. Le cas le plus intéressant est sans doute celui de la maison des Chapiteaux colorés (6.4.51) qui possède deux anciens péristyles. Avec ses 1700 m2, elle faisait partie déjà des plus somptueuses demeures de la période samnite de Pompéi (fig. 2). Sur le péristyle central, la salle de l’aile orientale est modi-fiée dans la seconde moitié du ier s. pour en faire une belle salle d’apparat : longue de 9 m sur près de 4,50 m de large, elle ouvre sur toute sa largeur, sans support intermédiaire, sur le portique. Elle est précédée d’un
———Fig. 2. Pompéi, maison Chapiteaux colorés. Plan (d’après guide Laterza Pompéi).———————
260 décorS et eSpace architectural en Gaule entre l’antiquité et le haut moyen ÂGe
emmarchement recouvert de marbre. L’abside se ca-ractérise par sa forme aplatie, marquée par deux antes en retour. Elle a été ajoutée en abattant le mur du fond de l’ancienne salle. L’hémicycle, au même niveau que le reste de la salle, est dans le prolongement des murs de la partie rectangulaire (fig. 3). Notons qu’un foyer présent à l’arrière de l’abside, accessible par la rue, pourrait, selon certains, permettre de chauffer au moins l’abside de la pièce. Une niche quadrangulaire, prévue pour un décor statuaire, et d’élégants décors peints du IVe style, créés après 62, en font une salle à la pointe de la mode à Pompéi au moment de l’érup-tion, d’autant plus enviée sans doute qu’encore rarissime 7.
7- PPM VI, 996-997,1082-1083. D’après F. Pesando, sur ce péristyle, l’exèdre qui fait face à la salle à abside et cette dernière, toutes les deux au centre des longs côtés, avaient déjà été prévues dans le plan le plus ancien de la domus. Elles fonctionnaient avec le tablinum entre les deux péristyles, deux petits oeci et un triclinium (30) au plan caractéristique allongé dans l’angle nord-ouest (Pesando 1997, 132-133, 163 fig. 30). On peut se demander si la salle à abside, une fois aménagée, avait supplanté, dans la fonction de salle à manger, l’ancien triclinium quadrangulaire, peut-être jugé démodé. Plus en retrait, ce dernier avait-il un rôle plus hivernal ? Ou bien faut-il seulement attribuer à la nouvelle salle la fonction de salon d’apparat ? Le nombre de pièces de réception sur ce péristyle montre combien l’attribution de rôles spécifiques aux salles reste complexe.
À Herculanum, la maison du Squelette (3.3), petite mais très raffinée, présentait, en 79, tous les agréments favoris de son époque, dans une surface très réduite. Dotée d’un triclinium (6) face à un riche nymphée d’un côté, elle possède également un oecus à abside plate (10), profond de 6,50 m seulement, ouvert derrière le petit tablinum (7). Il prenait la lu-mière par une courette, ornée dans l’axe d’un édicule-fontaine et agrandie par des peintures de jardin, dans la dernière phase de la ville 8. Son abside plate, adaptée ici au manque d’espace, voit sa forme compensée par l’illusion décorative picturale : la présence d’un gra-cieux édicule circulaire, dominé par la figure d’un paon faisant la roue, ouvre comme une perspective sur un fond blanc dans l’axe de la salle, en l’agrandissant (fig. 4). Cette abside plate rappelle les formes appré-ciées dans les belles domus de la Rome de la fin de la République, comme la Domus Isiaca ou, au palais fla-vien, l’abside faiblement incurvée du grand triclinium du Palatin 9
Cependant, les villas de plaisance ne sont pas en reste et l’on voit aujourd’hui resurgir des sites ancien-nement connus, qui nous offrent un certain nombre d’exemples de salle à abside de grande taille, comme la grande villa maritime di Contrada Sora à Torre del Greco, à plus de trois km au sud-est d’Herculanum, connue par des fouilles des Bourbon et explorée à nouveau depuis 1989 10. Elle nous montre, dès le ier s., une très vaste salle d’apparat à abside de 12 x 19 m, avec une abside de plus de 7 m, flanquée de deux niches quadrangulaires, peu profondes, pour des sta-tues. Ornée d’opus sectile, elle ouvre sur un péristyle repéré sur plus de 60 m (fig. 5). Elle donne ainsi un écho précieux au type de la basilique privée, la basilica privata, décrite par Vitruve pour le monde domestique urbain aristocratique de la période antérieure et, pour
8- Maiuri 1958, 271-274, Tamm 1963, 165, fig. 172 ; Mazzoleni & Pappalardo 2004, 360-363, vue d’ensemble fig. 7. En dernier lieu, Coralini et al. 2009, 407 et fig. 2, relevé photogrammétrique de l’oecus. La préciosité et l’originalité de la salle, rehaussées par son sol en opus sectile, contrastent avec le manque d’espace de dégagement. On note que l’abside est ornée d’un motif linéaire de bandes isodomes à appareil régulier, le reste de la courbe étant rempli d’un motif de losanges blancs. Cela semble indiquer que les artisans mosaïstes n’ont pas encore, dans leur répertoire, de réponse adaptée à la forme en hémicycle.9- Gibson et al. 1994 ; Vössing 2004, 348-350.10- Pagano 1991, 166-167, fig. 1-4, 12 ; Pagano 1999, 43-44.
———Fig. 3. Pompéi, maison Chapiteaux colorés. Salle à abside (cl. E.M.).———————
apparition et développement deS abSideS danS l’architecture domeStique Gallo-romaine 261
le moment, si peu reconnue sur le terrain pour la fin de la République et du ier s. de l’Empire 11.
N’oublions pas non plus, pour équilibrer notre propos, que l’abside n’est pas forcément placée en position axiale au fond d’une pièce. La mode des hé-micycles ouvrant vers l’extérieur, notamment sur les panoramas, s’est développée dès le ier s. : la maison de Fabius Rufus à Pompéi (7, insula occidentalis 16.22) en donne un exemple très clair. La partie centrale de la maison a été entièrement reprise au milieu du ier s. À l’étage inférieur, un grand salon panoramique (62) ouvrait par sa vaste abside plate sur le jardin suspendu
11- De architectura, 6.5.2-3 ; Gros 2004 ; voir aussi Vetters 1981.
au premier plan et plus loin sur la baie de Naples. Il était somptueusement revêtu au sol d’opus sectile et au mur de peintures raffinées du IVe style sur fond noir. Dans ce cas, nous avons la chance de comprendre la superposition de deux séries de trois fenêtres rectan-gulaires, ouvertes sur l’extérieur, de conception extrê-mement moderne, rarement aussi bien attestées ailleurs 12. On retrouve, toujours à Pompéi mais dans
12- Cerulli Irelli et al. 1993, II, 157-158, n°276-277 ; (1981) Pompéi, 1748-1980, 24, fig. 3. Rappelons que la maison possède aussi un élégant petit caldarium à abside dont les peintures de jardins et de paysages sont datées de la phase finale du IIIe style (milieu du ier s. p.C.). Pompéi, 1748-1980, 177-178 fig. 40 ; Cerulli Irelli et al. 1993, II, 162-163, n°287. Aoyagi & Pappalardo 2006, 259-418, et en particulier pour la salle 62, 376-390.
———Fig. 4. Herculanum, maison du Squelette. Salle à abside (cl. E.M.).———————
262 décorS et eSpace architectural en Gaule entre l’antiquité et le haut moyen ÂGe
un contexte de villa, ce désir d’ouvrir la pièce en hémi-cycle sur le paysage : dans le salon panoramique de la villa des Mystères, créé vers l’époque augustéenne, et la salle (peut-être le laraire ?), sur le côté de la même demeure, ou encore la pièce ouvrant en hémicycle outrepassé, d’un des appartements de la villa de Diomède. La forme reste suffisamment originale et évocatrice pour que Pline le Jeune, un siècle plus tard, l’évoque, dans sa villa des Laurentes, à propos de sa bibliothèque : “À cet angle est jointe une chambre terminée par une courbe en forme d’arc (angulo cubicu-
lum in hapsida curvatum) qui offre successivement au soleil toutes ses fenêtres” 13.
Le phénomène se retrouve sous une autre forme dans une série de maisons de ville occidentales. L’un des côtés du péristyle s’avance en une élégante courbe sur le viridarium. Citons, en Espagne, par exemple l’une des grandes domus d’Ampurias, la maison 2B
13- Ep. 2.17.7 (trad. A.-M. Guillemin). Förtsch 1993, 93-100, pl. 23-25.
———Fig. 5. Torre del Greco, villa de Contrada Sora (plan d’après Pagano, 1991, p. 151).———————
apparition et développement deS abSideS danS l’architecture domeStique Gallo-romaine 263
(fig. 6) 14 ou encore en Narbonnaise, la maison de l’Enclos Reynaud à la salle dite en hémicyle, à Aix-en-Provence 15 (fig. 7). Les plans cités sont d’inspiration identique : ils présentent un vestibule ou une salle d’apparat flanqués de pièces symétriques, ouvrant sur un portique ou un mur élargi en un hémicycle plat vers le jardin ou la cour 16. La perspective s’ouvre sur
14- Santos Retolaza 1991, 31-33 fig. 15 ; Aquilué 2005, 37-3815- Chronologie : seconde moitié du ier siècle. Gros et al. 1996, II, 40-41, fiche n°12 ; Guyon et al. 1998, 46, 50, fig. 10. Certains proposent de voir dans l’hémicycle un mur écran qui, si l’on y voit un vestibule, protègerait l’intimité de la maison.16- La salle de cette habitation a été interprétée aussi comme un vestibule (cf. Vipard 2007, 250, fig. 10). En effet, elle est longée par ce qui semble devoir être interprété comme une voie publique. Au fond de la pièce, côté rue, dans les plans anciens, on distingue une porte avec un seuil rehaussé. Mais on notera contre cette hypothèse que la porte est très étroite pour un vestibule de cette ampleur, en comparaison d’autres exemples connus ; de plus, l’ouverture n’est pas centrée. Un changement de fonction dans un remaniement est aussi possible. La petite porte a pu être aménagée dans une seconde phase. La question reste ouverte.
une courbe agréable à l’œil qui rompt avec la monoto-nie des portiques. Côté cour ou côté jardin, dans l’axe des pièces d’apparat qui conservaient dans la majorité des cas des lignes quadrangulaires simples, les espaces d’agrément pouvaient donc être complétés par le dessin de courbes, exèdres quadrangulaires et contre-courbes. Les formes que l’architecture des pièces ne possédait pas étaient donc dessinées dans les espaces d’agrément qui les prolongeaient : bassins, plateforme formant exèdre semi-circulaire en avancée sur le jardin ou, plus difficiles à discerner, barrière et clôture ou peut-être une ligne de végétation 17.
17- Sans compter les formes circulaires des parterres dessinés par les allées, (comme à la maison des Noces d’Argent à Pompéi, ou pour les formes de haies à courbure et redans quadrangulaires, cf. en dehors de l’exemple bien connu de Fishbourne, celui de Dietikon (Suisse). Dans le plan du jardin de la villa de Richebourg (Yvelines), des pots de plantation dessinent, dans un des carrés du maillage, une forme semi-circulaire (liée à une installation de plein air mobile ou disparue ?).
———Fig. 6. Ampurias, maison 2B. Hémicycle vers le jardin (cl. E.M.).———————
264 décorS et eSpace architectural en Gaule entre l’antiquité et le haut moyen ÂGe
Les images de ce que l’on appelle traditionnelle-ment hortus conclusus nous montrent également ces jeux de niches évoquant des formes de nymphée, avec parfois des bassins épousant la forme des niches et qui indiquent leur popularité dans les jardins, réels ou rêvés. Ainsi, une image d’hortus conclusus provenant de Pompéi montre, au centre d’une composition symé-trique, un bassin bleu abrité sous une niche centrale en lattis très travaillé, flanquée elle-même de deux bassins quadrangulaires, à parapet de couleur rouge-rosé à l’extérieur 18.
De même, les bassins du type abside-fontaine, défini en son temps par R. Rebuffat pour la domus africaine, les absidioles ou les canaux s’élargissant en demi-cercle devant les salles d’apparat ne font que dessiner, au sol et en volume, les formes des absides, absentes au bout des pièces. On citera en Gaule l’exemple de la maison dite “de la Visitation” à Périgueux, où sur le bras d’un bassin rectangulaire – incomplètement connu – qui longe le portique nord du jardin, se greffe une vaste abside dans l’axe de la salle de réception, presque aussi large qu’elle 19. Le bassin monumental récemment découvert de la maison dite du Palais de Justice, à Besançon (21,30 x 3,50 m) montre combien la pièce d’eau peut prolon-ger la salle : sa très vaste abside de 6,90 m, est pratique-ment aussi large que la pièce de réception (fig. 8) 20. On pourrait aussi citer de nombreux plans de bassins extérieurs de maisons de Vienne, Saint-Romain-en-Gal ou Orange, pour ne citer que quelques villes, avec bassin en pi ou rectangulaires, à abside ou absidiole axée sur les espaces d’apparat.
le développement de l’abSide en Gaule à partir du iie et Surtout au iiie S.
Lorsque nous avions entrepris l’étude des formes absidées des salles de réception pour la période de l’Antiquité tardive, une première enquête en Gaule avait montré que la diffusion de la forme à abside, autant qu’on puisse en juger, était relativement lente 21. Dans nos corpus maintenant bien établis de domus
18- Pitture nella Reggia 1999, 75, n°42. Provenant de Pompéi, sans précision.19- Balmelle 1992, 342-345.20- Gaston 2003, 418-419, Adam et al. 2006, 93-95, fig. 109.21- Pascal Vipard dans sa synthèse récente sur les maisons de Gaule parvient à la même conclusion : Vipard 2007, 249.
———Fig. 7. Plan de la maison à l’Hémicycle (plan d’après Gros et al. 1996), II, p. 43).———————
apparition et développement deS abSideS danS l’architecture domeStique Gallo-romaine 265
———Fig. 8. Besançon, maison dite du Palais de Justice. Plan (d’après Vaxelaire et al. 2003, 139).———————
266 décorS et eSpace architectural en Gaule entre l’antiquité et le haut moyen ÂGe
dans les différentes provinces de la Gaule, la forme est assez peu présente. Si l’on laisse de côté les anciennes découvertes, sans contexte ou mal documentés, on est frappé par la grande rareté des salles à absides dans les plans avant le iie s. Ainsi, dans l’Atlas topographique antique d’Aix-en-Provence, ce sont à peine deux exemples qui peuvent être pris en compte. À Vienne - Saint-Romain-en-Gal, même constat de la rigidité quadrangulaire des triclinia, en dehors de la salle ex-ceptionnelle de Lycurgue, malheureusement sans contexte dont nous parlerons plus loin (infra). À Limoges, on verra encore qu’un seul grand exemple peut être cité en ville, même si deux autres nouveaux exemples 22 s’y ajoutent : au nombre d’habitations dé-couvertes, cela fait peu. Pour Autun, nous aurons deux exemples majeurs, d’ailleurs très différents, si l’on retire les quatre ou cinq exemples très incertains et anciennement fouillés que la Carte archéologique nous fournit 23. La forme est bien là, mais sporadique, en comparaison du nombre total de maisons et de salles d’apparat connues. C’est peut-être aussi faute de connaître les premières phases des édifices, souvent refaits sur plusieurs siècles.
Ce n’est en tout cas pas une question de connais-sance technique de construction, ni de maîtrise qui empêche la forme de se développer.
Par ailleurs, les fouilles dans le nord de la Gaule et en Angleterre ont bien montré que la forme était connue soit dans des édifices publics ou militaires (principia notamment), soit dans les thermes ou cer-tains édifices résidentiels majeurs (et donc possible-ment imitables) comme le célèbre palais de
22- Nous remercions Jean-Pierre Loustaud de nous les avoir indiqués, en particulier celle de l’insula VI-4. Loustaud 2006, 14-17, 10, plan d’ensemble. La salle avec sa vaste abside chauffée, large de 6 m, appartient à un espace très vaste de 99 m2. À la corde de l’abside, se trouvaient deux éléments de maçonnerie quadrangulaires emboîtés l’un dans l’autre et portant des placages de marbre. On pourrait les identifier avec une fontaine. On a voulu prudemment rapprocher l’ensemble des séries de scholae, sans que cela soit concluant. L’aspect fragmentaire du plan incite à la prudence quant à une interprétation comme édifice privé.23- On doit citer la découverte en 1834, d’une grande salle à abside dans la villa suburbaine de Montmain, avec hémicycle à la courbure aplatie qui se développait dans le prolongement des murs (Rebourg 1993, 132-133, fig. 112 ; Rebourg 1998, 213). Il faut signaler aussi une grande abside de 10,20 m de diamètre découverte rue du Parc Saint-Jean, dans les dégagements entrepris lors de la percée de la tranchée du chemin de fer au xixe siècle. Mais le caractère incomplet des vestiges ne permet pas de juger de la fonction (Rebourg 1993, 122 fig. 107b).
Fishbourne, daté pour son plan d’origine à l’époque flavienne 24.
De plus, les variantes en forme d’abside se diffu-sent rapidement jusque dans les provinces les plus septentrionales. Ainsi, l’abside plate, déjà utilisée au ier s., qui connaît une large diffusion dans les thermes à l’époque antonine, n’est pas absente dans les contextes privés.
On pourra citer en exemple une maison de Rouen, rue Jeanne d’Arc et place Foch 25 (dans un îlot des ier-fin iiie s.) : on remarque une aile thermale avec salle de bains à abside plate, ajoutée par agrandissement au iie s., tout à fait à la mode. Comme on l’a vu précédem-ment, les contraintes urbaines ont pu aussi jouer un rôle et l’on se rend compte, jusqu’à la fin de l’Anti-quité d’ailleurs, combien les propriétaires ont été tentés d’envahir rues et espaces publics avec les murs de leurs absides (qu’on pense aux exemples connus de Bulla Regia Djemila ou d’Ostie pour ne citer que quelques cas d’école).
Par comparaison, dans une province comme l’Afrique du Nord, les corpus exhaustifs de maisons permettent maintenant de mieux cerner l’apparition des salles à abside aux iie et iiie s., alors qu’en Gaule, les séries de plans sont plus limitées et les données frag-mentaires 26. La forme est souvent utilisée pour des petites salles de réception, comme des salons intimes (maison des Masques d’Hadrumète) ou des petites salles à manger (maison de l’Africa à Thysdrus) utili-sant déjà sans aucun doute le lit en demi-cercle, le sti-badium (qu’Apulée cite déjà dans son Âne d’or imagi-nairement placé en Grèce, mais si frappant de ressemblance avec l’Afrique). La forme avec l’abside dans le prolongement des murs est déjà représentée, comme à Hadrumète, dans la maison des Mois trou-vée au terrain Salah Abdallah 27.
24- La salle dite The Audience Chamber (W 14), dans l’aile ouest, mesure 9,40 m x 10,70 m, avec une abside large de 6,10 m. Elle était ornée d’une mosaïque très fine, dont seule une partie a été conservée. Elle appartient au programme initial du palais, dont la construction est placée entre 75/80 et 80/100 p.C. (Cunliffe 1971, 76-98, fig. 20-22).25- Lequoy & Guillot 2004, 166-174, fig. 160, plan fig. 155.26- Même constatation pour la Grèce à l’époque romaine impériale Bonini 2006, 76-79 ; mais avec comme dans tout l’Empire une tendance à la multiplication de la forme à partir des iiie et surtout ive s.27- Bullo & Ghedini, 2003, 80-83, 98 tableau.
apparition et développement deS abSideS danS l’architecture domeStique Gallo-romaine 267
En Gaule, nous retrouvons ce rôle de salle complé-mentaire des grands espaces de réception quadrangu-laires traditionnels à Aix-en-Provence, villa des jardins de Grassi (fig. 9). La petite salle à abside (9) est située sur l’aile d’apparat nord du péristyle principal (secteur B5). La pièce semble avoir cependant ouvert par son hémicycle axial sur les portiques et espaces d’agrément arrière, s’achevant eux-même par une grande exèdre plate. De plus, surhaussée de 80 cm environ d’après les rapports de fouilles, elle était sans doute montée sur une suspensura et donc chauffée 28.
C’est Vesontio - Besançon qui nous fournit un exemple, chronologiquement très intéressant, avec la fouille du collège Lumière (dite maison de Neptune) (fig. 10A) 29. On programme une imposante maison, munie de plusieurs jardins au début du iie s., avec une vaste salle à abside de plus de 10 m de long, à la cour-bure légèrement aplatie, de près de 6 m d’envergure. La pièce est axée sur un portique à jardin, tandis que son abside déborde sur un autre espace sans doute planté. Ce premier état où la salle est programmée dans le plan d’ensemble remonte à la première moitié du iie siècle. Mais quelques années plus tard, un nou-veau projet est mis en œuvre, abandonnant complète-ment les lignes précédentes. La pièce à abside sera donc très rapidement recouverte, dans le troisième tiers du iie s., par la grande salle rectangulaire de 200 m2 à la mosaïque de Neptune. Son sol de terre battue indiquerait d’ailleurs qu’elle n’avait sans doute pas été achevée.
La forme à abside simple, qu’elle soit en position axiale sur un côté de péristyle ou bien groupée avec d’autres appartements, fait aussi son apparition de plus en plus fréquente dans les villas à partir du début du iie et fleurit au iiie. On remarque le phénomène grâce aux villas du centre ou du nord de la France, mais aussi sur le territoire de l’Allemagne, l’Autriche ou la Suisse. Nous citerons ici l’exemple aquitain de
28- Gros et al. 1996, t. II, 30-31, fiche n°7 ; Guyon et al. 1998, 62-64, 271-277, où il est noté que “les 12 niveaux de sol et de seuils connus s’inscrivent en effet entre 191,75 et 192,68 m, seul faisant exception le seuil de la salle à abside qui culmine à 193,20 m ce qui pose d’ailleurs le problème de savoir s’il faut bien rattacher cette pièce à l’ensemble [B5] qui aurait eu ainsi une largeur de près de 33 m.”29- Adam et al. 2006, 96-104 ; cf. Gaston & Munier, dans ce volume, que nous remercions de m’avoir transmis les plans et éléments de datation de leur fouille.
La Lonquette, où la villa du Haut-Empire, après un élégant vestibule à hémicycle, présentait non seule-ment une salle à abside classique sur la cour péristyle centrale, mais aussi une pièce ouvrant sur le panora-ma, à travers une abside belvédère (?), traitée comme un portique (fig. 10b). À l’époque tardive, la salle à abside se maintient exactement au même endroit, mais cette fois avec une forme polygonale, intérieure et extérieure, dans les remaniements successifs des ive
et ve s. D’autres formes absidées apparaissent et se
———Fig. 9. Aix-en-Provence, maison de Grassi. (plan d’après Gros et al. 1996).———————
268 décorS et eSpace architectural en Gaule entre l’antiquité et le haut moyen ÂGe
———Fig. 10a. Besançon, maison sous le collège Lumière. plan de la première phase (d’après document C. Munier et C. Gaston). NB : la salle à abside a été tramée.———————
apparition et développement deS abSideS danS l’architecture domeStique Gallo-romaine 269
———Fig 10b. Villa de Lalonquette. Plan (d’après Gallia, 31, 1973).———————
270 décorS et eSpace architectural en Gaule entre l’antiquité et le haut moyen ÂGe
combinent avec des alcôves rectangulaires 30. En Haute-Saône, la villa de Membrey apporte un exemple typique. Cette fouille ancienne est assez bien docu-mentée sur le plan graphique : l’abside d’une belle salle d’apparat, légèrement outrepassée, est ornée d’un curieux décor de pyramide végétale et cratère (qui ferait penser à une datation éventuellement plus tardive que les iie-iiie s., avancés autrefois dans le corpus
30- Balmelle 2001, 359-362, 445.
des mosaïques de la Gaule par Henri Stern) (fig. 10c). On remarque, en passant, sa position excentrée et comme ajoutée. Elle semble associée à l’appartement très décoré, voisin des thermes 31. Les villas du terri-toire suisse actuel (que nous nous permettons d’an-nexer ici) en fournissent d’autres exemples concrets (certains malheureusement perdus) comme à Orbe-
31- Stern 1963, 94-98. Salle n°25 : pl. LIII-LV à l’extrémité nord-est : 10,60 m (abside comprise) x 4,22 m. La datation proposée par le corpus est la fin du iie s.
———Fig. 10c. Villa de Membrey : abside (d’après H. Stern recueil mos Gaule).———————
apparition et développement deS abSideS danS l’architecture domeStique Gallo-romaine 271
Boscéaz 32 – on pense à la salle aux tritons, à l’abside au dessin très plat – ou encore à celle de la villa de Vallon, près d’Avenches, à la mosaïque posée au début du iiie s. 33.
Ces quelques exemples montrent que dès les iie et iiie s., la forme est généralisée dans les grands do-maines, où d’ailleurs elle peut prendre plus d’exten-sion au sein d’appartements répartis sur les différentes cours. La salle de Vallon par son abside profonde et très large annonce les formes répandues au ive s., où la partie finale de la pièce devient l’espace qui a le rôle clef. Il n’est plus seulement un point focal du regard dans l’équilibre spatial de la pièce, ni un simple pro-longement ornemental de la salle.
la concentration du luxe et deS décorS leS pluS SpectaculaireS
Observons maintenant le décor de quelques salles d’apparat à absides gallo-romaines. Tout d’abord, on remarque qu’elles concentrent les soins des proprié-taires, associant les niveaux de décor les plus luxueux à des installations de confort de haut niveau 34. Le climat est parfois en cause, mais pas toujours et l’on remarquera plus loin que si la pièce à abside n’est pas chauffée, c’est alors une voisine, de forme plus tradi-tionnelle, qui est équipée d’hypocaustes ou d’une
32- Luginbühl 2001, 40-45, 49, fig. 34, 38.33- La pièce mesure 8,90 m x 8,80 m, avec une abside profonde, large de 4,75 m (surface totale de 97 m2) soit le plus grand pavement actuellement conservé de Suisse. Le décor de venatio est à admirer depuis l’abside. Construite et décorée à l’époque sévérienne, la salle disparaît dans un incendie dans le dernier quart du iiie s. Rebetez 1992, 16-25 ; Fuchs 1996 ; Fuchs 2000, 34-43. La répartition du pavement pourrait évoquer la présence de banquettes pour s’asseoir le long des murs de l’abside, qui auraient pu avoir leur complément dans les deux zones à décor neutre, le long des murs de la partie rectangulaire. Se pose selon nous pour la Gaule et les provinces du nord de l’Europe, comme la Germanie ou la Bretagne, la question, dans les salles de banquet, de l’usage de sièges ou de bancs où l’on se tient assis, et non plus systématiquement de couches. L’iconographie gallo-romaine, en particulier dans le monde funéraire, atteste bien des pratiques mixtes où se côtoient sièges et lits dans une même salle, selon le statut ou le sexe des participants, ou seulement des sièges. La même remarque peut être faite dans la salle à abside de Fishbourne, où les tesselles marquent la fin du pavement de l’abside à environ 60 cm du mur. Cela pourrait indiquer selon le fouilleur la présence d’une banquette (en bois ?) longeant l’hémicycle (Cunliffe 1971, 77-78, fig. 14-15, 20-22).34- Nous avions déjà souligné l’importance du rôle de l’abside comme point focal dans la pièce dans notre contribution sur les salles de réception utilisées pour l’audience, pour la période de l’Antiquité tardive, Morvillez 2006, 184-185.
cheminée. Notons que les absidioles ou les niches, semi-circulaires ou quadrangulaires, prises dans le mur du fond de l’abside, sont rarement connues dans le cadre domestique, en raison de l’arasement et du pillage quasi systématique des structures. Même pro-blème pour évaluer l’éclairage et les ouvertures éven-tuelles de fenêtres ou d’oculi qui ont dû exister pour éclairer les salles plus aisément ; mais les cloisons laté-rales, mitoyennes avec d’autres salles ne permettaient pas, la plupart du temps de loger des ouvertures 35.
Limoges fournit un exemple parlant de cette évolu-tion vers un luxe concentré. Une luxueuse salle à abside a été observée dans une demeure composée de deux maisons réunies, située près du forum de la cité (maison aux Cinq mosaïques et maison à l’Opus sectile) 36. C’est dans une deuxième phase de travaux, à placer à la fin de l’époque sévérienne, que la salle à abside est installée, empiétant sur un espace de service à l’arrière (fig. 11). On procède à l’installation du chauffage dans la salle (1) et à la mise en place d’un opus sectile. Un chauffage sur hypocauste est construit pour la salle (6) : le mur du fond de la pièce est percé et une abside en opus spicatum est édifiée. Sa longueur est alors de 12,50 m sur 5,50 m de large. Un luxueux décor d’opus sectile est posé dans la partie rectangu-laire. Il n’en restait en place que le seuil à motif géo-métrique. De très nombreuses tesselles de mosaïque fine (dont de nombreuses en pâte de verre), apparte-nant sans doute à un décor pariétal, ont été décou-vertes dans l’abside. Elles proviennent probablement du cul de four ou d’une partie des parois. Cependant, le type de pavement de l’abside nous échappe. En re-vanche, les murs étaient plaqués de marbre, au moins sur une certaine hauteur. Rappelons enfin que l’ajout de l’abside n’a été possible qu’en raison de la présence d’un espace libre à l’arrière 37. L’abside n’était pas chauffée, bien qu’elle soit saillante à l’extérieur, avec assez d’espace pour intégrer suspensura et praefurnium. Par la suite, ce sera souvent le contraire ; le système de chauffage sera même parfois limité à l’abside, puisque
35- L’étude attentive des fragments de peintures appartenant à des embrasures des fenêtres apportent cependant de plus en plus de renseignements, mais encore trop peu pour ces espaces : sur cette question, voir Broillet-Ramjoué & Bujard, ainsi que Heckenbenner et al., dans ce volume.36- Loustaud 2000, 191-202 ; Morvillez 2006, 596 ; Loustaud & Aïcha Malek, dans ce volume.37- Il faut voir l’abside plus petite et plus plate que sur le schéma d’évolution dans la publication.
272 décorS et eSpace architectural en Gaule entre l’antiquité et le haut moyen ÂGe
c’est elle qui abritera généralement les installations de banquet. Selon les évidences archéologiques, les amé-nagements de la salle à abside ne peuvent être anté-rieurs à 226-235. J.-P. Loustaud avait proposé la possi-bilité d’une datation constantinienne. Mais, d’après Catherine Balmelle, une datation à la fin de l’époque sévérienne paraît plus vraisemblable, si l’on tient compte des connaissances actuelles sur le style des décors mis en œuvre habituellement dans les de-meures du sud-ouest de la Gaule, à partir du ive s. 38. Enfin, se pose la question de la manière dont on ap-préhendait l’espace de cette salle en y pénétrant :
38- Balmelle 1992, 335.
l’accès était-il axial ou bien entrait-on dans cette salle qui a pu fonctionner comme une salle de banquet par le côté – et cela pour conserver la chaleur ? Les vestiges étaient en trop mauvais état pour qu’on puisse le dire.
la fonction deS abSideS : hiérarchie et SenS de lecture du décor
Voyons, pour finir, la question de l’utilisation possible de ces absides. Étaient-elles déjà utilisées dès le iie s. pour y disposer des lits de banquet ? Cette hy-pothèse suppose une diffusion possible, mais précoce, du stibadium ou sigma encore rare au ier s. p.C. en Italie et diffusé plus largement au iie s. dans les villas impé-riales et les milieux aristocratiques comme l’atteste celui de Pline le Jeune, en plein air, dans sa villa de Toscane 39. En Gaule, l’importante cité d’Autun nous fournit deux exemples très différents, où le décor joue un rôle variable. La maison des Auteurs grecs, autre-fois appelée d’Anacréon, en offre un bon exemple (fig. 12). À travers l’étude de “fragment” de domus, fouillée en 1965, puis en 1990 dans un quartier longé par le cardo maximus, nous entrevoyons une pièce d’ap-parat des élites les plus cultivées, appartenant peut-être au milieu des rhéteurs et professeurs de la ville 40. Cette grande salle de 10,60 m x 6,20 m était chauffée par hypocauste 41. Elle possède une abside semi-circu-laire peu profonde, large d’à peine 4 m, ce qui reste étroit pour installer un sigma de bonne taille 42. La mosaïque, remontant à la fin du iie ou au début du iiie s., présente une série d’images de lettrés accompa-gnées de citations. L’état désastreux du pavement, ef-fondré et bouleversé dans les pilettes du chauffage, ajouté aux conditions de fouilles, n’a pas permis d’éta-blir avec certitude la répartition du tapis. Deux bandes
39- Sur le sigma de Pline le Jeune cf. Förtsch 1993, 93-100 ; sur les problèmes liés à son interprétation fonctionnelle, Morvillez 2008, 40-41.40- Sur la découverte de la maison, Vuillemot et al. 1996 ; Rebourg 1993, 111-112 ; Rebourg 1998, 203-207 ; Morvillez 2006, 600-604 ; Chardron-Picault 2007. Sur la mosaïque et les étapes de son interprétation, Blanchard-Lemée & Blanchard 1973, 268-279 ; Blanchard et al. 1992 ; Blanchard-Lemée & Blanchard 1993, 969-984 et, en dernier lieu, Blanchard-Lemée & Blanchard 2009.41- Pour l’étude technique du chauffage, Chardon-Picault & Parain 1999-2000. La quantité de matériau en terre cuite nécessaire à la construction de l’hypocauste a été évaluée à 22 tonnes.42- Sur la dimension des sigmas et leur adaptabilité aux absides, Morvillez 1996, tableau. Voir en complément, l’article de Volpe 2006, 329-335 et, plus récemment, notre dernière contribution sur les sigmas-fontaines dans Vössing 2008.
———Fig 11 : Limoges, maison à l’Opus sectile l’axonométrie de la salle à abside (d’après Loustaud 2000, fig. 58).———————
apparition et développement deS abSideS danS l’architecture domeStique Gallo-romaine 273
de rallonge devaient encadrer le tapis central de la partie rectangulaire. Mais on ne sait pas si le tapis à motif de méandres allait jusqu’à l’abside et possédait alors huit panneaux figurés ou si, plus réduit, il ne pouvait en contenir que cinq 43. Pourtant, le sens de lecture du pavement montre que les bustes des philo-sophes et des poètes (Anacréon, Métrodore et Épicure pour ceux identifiés 44) étaient tournés vers l’abside. Cependant, il était impossible, compte tenu de la dis-tance, d’imaginer plus qu’un lien visuel : les textes en grec ne devaient pas être lisibles depuis l’hémicycle. C’est seulement en se promenant dans la salle qu’on pouvait lire et comprendre les inscriptions placées autour des images. À charge de les évoquer à table, dans cette salle – ou dans une autre (?), bien que la fonction de salle à manger reste la plus convaincante –, certaines images qui évoquent les agréments du banquet ou du moins de la boisson pouvant servir de
43- C’est cette hypothèse qui est actuellement davantage soutenue. Blanchard-Lemée & Blanchard 2009, 18-19, fig. 4.44- Et le poète Théocrite, si l’on suit l’hypothèse prudente et séduisante que proposent M. Blanchard-Lemée et A. Blanchard pour le quatrième panneau, dont seul un angle avec cinq lettres d’une sentence est conservé : Blanchard-Lemée & Blanchard 2009, 23-24, fig. 5.
prétexte à assaut culturel ensuite. Il reste que l’heu-reux propriétaire de cette domus soulignait son épicu-risme avec science et faisait en sorte ici d’“appuyer sur de grandes autorités son goût pour le plaisir, en préci-sant que c’est un plaisir associé à la modération (Anacréon), à la philosophie (Métrodore) et à la vertu (Épicure)” 45. Nous sommes loin d’un étalage de culture facile. L’ensemble se veut profond, scienti-fique, élitiste.
Évidemment, à l’opposé de l’exemple de Limoges où ce sont les matériaux qui donnent sa primauté à la salle, le choix intellectuel de ce décor manifeste une autre sorte d’élitisme. On peut rapprocher l’esprit du pavement d’Autun de celui d’autres tapis occidentaux comme celui de la salle à abside dite de Monnus, à Trèves 46, ou encore la salle des Philosophes, décou-verte à Cologne dans le jardin de l’Hôpital en 1844 47. Mais le luxe du marbre réel, comme à Limoges, ne suffisait en aucun cas à réaliser le projet du proprié-taire désireux de mettre en valeur sa culture person-nelle. Cela laisse à réfléchir aussi sur le sens du mot “luxueux” et rappelle combien il est difficile de hiérar-chiser nos décors : matériaux nobles et précieux dans un cas ; dans l’autre, images raffinées au contenu ico-nographique et textuel rare, où même le jeu subtil sur la graphie des lettres, archaïsantes ou plus modernes, est calculé 48 ; pavement de roches précieuses ou pré-ciosité des valeurs intellectuelles incarnées par des philosophes et poètes : deux manières opposées d’ex-primer ses choix et ses attentes à ses hôtes comme à soi-même. D’autant que les images pouvaient être in-troduites sur d’autres supports, comme les peintures murales, mais aussi le mobilier, les tentures ou la vais-selle précieuse.
Dans le cas d’Autun, l’affirmation de la culture lettrée, épicurienne et plus largement philosophique
45- Blanchard-Lemée & Blanchard 2009, 20.46- Les neuf Muses associées à des poètes grecs et latins dans une mosaïque dite de Monnus : Lancha 1997, n°68, 131-136, pl. LIV (datée fin du iiie-début du ive s.), Hoffmann, Hupe et Goethert 1999, n°103, 138-141, pl. 64-69 (courant du iiie s.).47- Dans une domus sans doute, cinq philosophes avec inscriptions en grec : Lancha 1997, n°115, p. 272-274, pl. CXVI, vers 250.48- Sur les propositions de mise en page des écrivains dans le pavement, leur nombre et leur position respective, et en particulier sur une possible alternance des personnages en fonction du type graphique des inscriptions, mais aussi de la direction du regard, convergeant vers l’abside, cf. Blanchard-Lemée & Blanchard 2009, 18-22.
———Fig. 12. Autun, maison des Auteurs grecs (d’après P. Chardon Picault).———————
274 décorS et eSpace architectural en Gaule entre l’antiquité et le haut moyen ÂGe
du personnage, ne pouvait passer que par des images, associées ici à des inscriptions. Mais alors, comment évoquer en plus le faste, peu en accord il est vrai avec le sens épicurien des sentences, bien que celles-ci évo-quent sans détour des plaisirs bien réels ? C’est là qu’interviennent les décors de faux marbres qui or-naient les parois : ils représentent de manière évidente et plus conventionnelle, voire stéréotypée, le statut social attendu du commanditaire. Avec plus de moyens, de vrais placages auraient sans doute été choisis. Les parois sont en effet rythmées par des avan-cées quadrangulaires qui supportaient des colonnettes de stuc : marbres vert et jaune bigarrés donnent à la salle sa majesté et cette colonnade fictive plaquée en rehausse l’architecture monumentale et enrichit considérablement l’impression visuelle (fig. 13). Il est enfin fondamental de souligner que les deux décors qui se complétaient dans la salle étaient tous les deux très chargés. Cette association était-elle bien harmo-nieuse ? Il reste enfin une incertitude, et non des moindres : nous ne pouvons déterminer si mosaïques et peintures ont été posées de manière parfaitement
contemporaine. En revanche, nous ne savons rien du décor de l’abside : d’après l’analyse des enduits re-cueillis, il n’existe pas de plaques courbes et d’éléments ayant pu appartenir à l’hémicycle, dont le sol d’ailleurs n’est pas mieux connu : on sait seulement qu’il était en mosaïque 49.
Toujours à Autun, sur le site des maisons voisines dites à l’Étui d’or et de Balbius Iassus, l’évolution est encore différente : des deux domus, la première conti-nue à exister en tant qu’habitation jusque dans l’An-tiquité tardive (fin du ive s.), tandis que la seconde est plus tôt convertie en zone à fonction artisanale (pour de la tabletterie, à base de bois de cerf notamment) (fig. 14) 50.
Dans la maison de Balbius Iassus, ce n’est pas la vaste salle à abside (F), au décor complètement dé-mantelé dans l’Antiquité, qui a attiré le plus l’atten-tion au moment de la découverte, contrairement aux belles salles à sols de marbre voisines. Cette pièce ou-vrant sur un portique qui desservait aussi la salle al-longée rectangulaire (I), au très bel opus sectile (fig. 15) ne semble pas avoir eu un décor exceptionnel : seuls trois petits fragments de mosaïque blanche, en bor-dure des parois, ont pu être observés en place. Des traces de placages de marbre ont été vues sur les murs conservés. Il s’agit ici d’une variante de plan : cette fois-ci, les murs de l’abside sont dans le prolongement de la partie rectangulaire 51.
L’espace courbe de la salle (F) est largement suffi-sant pour installer un sigma. Or on en possède un en maçonnerie, placé à l’extérieur en (L), à quelque dis-tance, dans une zone de cour ou de jardin. Celui-ci, intégrant un bassin à jet d’eau se trouve dans un espace voisin de la maison, à l’extérieur, et appartenait probablement à la maison à l’Étui d’or qui, elle, conti-nue à fonctionner au ive s. 52. On note à titre de com-paraison visuelle – mais est-ce une coïncidence ? – que le volume du sigma d’extérieur tiendrait parfaitement à l’aise à l’intérieur de l’abside.
49- Nous remercions ici chaleureusement Claudine Allag et Florence Monier des informations qu’elles ont bien voulu nous fournir sur ce décor restitué.50- Blanchard-Lemée, Olivier et Rebourg 1986, notamment 148, plan fig. 22. 51- La pièce mesurait 8,75 m x 5,50 m. Blanchard-Lemée et al. 1986, 131-132. Vue d’ensemble, 130 fig. 8.52- Morvillez 2008, 49-50, fig. 11et 13.
———Fig. 13. Autun, XXXXXXX———————
apparition et développement deS abSideS danS l’architecture domeStique Gallo-romaine 275
Périgueux fournit, avec la domus de Campniac, dégagée par secteurs à partir de 1889, un autre exemple de salle à abside dans le prolongement des murs, d’une surface de près de 132 m². Cette maison origi-nale de près de 2500 m², multiplie les absides, notam-ment dans l’aménagement singulier en caissons du bassin qui occupe tout son péristyle (fig. 15) 53. Cette
53- Hardy 1892 ; Hardy 1895 ; Sarradet & Lantonnat, 1989 ; Girardy-Caillat 1998, 55-56, Balmelle 1992, 354-355. Sur cette
riche demeure possédait des sols de mosaïque mais aussi d’opus sectile, ainsi que des placages de marbre et un décor statuaire de qualité, d’après ce que les des-criptions des fouilles laissent entrevoir. On dégagea,
domus à l’agencement original, cf. aussi Morvillez 2006, 604, fig. 8, et Dessales, dans ce volume. Nous remercions Claudine Girardy pour la précieuse documentation fournie sur cette maison, à l’occasion de notre visite à Périgueux, ainsi qu’Aïcha Malek qui a revu récemment les archives de cette maison avec elle. L’interprétation de la documentation n’est pas sans poser de problème.
———Fig. 14. Autun, maisons de Balbius Iassus et de l’Étui d’or. Plan (d’après Gallia, 31, 1973).———————
276 décorS et eSpace architectural en Gaule entre l’antiquité et le haut moyen ÂGe
———Fig 16a et b. Périgueux, mosaïque de la salle à abside, dessins publiés en 1892, p. 167 et 172 (d’après Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 19, 1892).———————
———Fig. 15. Périgueux, domus de Campniac (d’après Durand 1911).———————
en premier lieu, une partie de la mosaïque d’une salle rectangulaire allongée, terminée par un hémicycle dont les dimensions sont données : 5 m de largeur pour 2 m de profondeur. Elle comportait sur fond blanc un motif symétrique de rinceau à feuilles de lierre “contourné en 8 sur le milieu” Un premier schéma de cette abside, qui semble ne plus être entou-rée de murs conservés, est donné dès 1892 (fig. 16a et b) 54. Six ans plus tard est dégagé ce qui semble être le seuil de l’abside, sur une largeur de 6 m environ, qui porte une course de quatre biges, tournés vers l’ab-side 55. Si l’on considère que le plan levé par Ch. Durand pour la publication de 1911 est exact – et il le semble si l’on compare les photographies du
54- Hardy 1892, 167, avec fig.55- Hardy 1895. La mosaïque a été revue et photographiée en 1981 (Sarradet & Lantonnat, 1989, 92, fig. 4 et 5).
apparition et développement deS abSideS danS l’architecture domeStique Gallo-romaine 277
bassin avec le plan soigné – on doit noter la différence entre la largeur de l’abside décrite (5 m), celle de la bande à la mosaïque de cirque qui borde l’abside (6m env.) et la largeur du reste de la salle, décrite pourtant dans le prolongement des murs de la partie rectangu-laire mesurée précisément par Ch. Durand ensuite (7,80 m x 11,60 m) 56 : il faudrait imaginer une bande d’au moins 1,35 m de part et d’autre de l’abside qui en faisait le tour (?) 57. D’après le plan de Durand, l’abside apparaît comme englobée dans la maçonne-rie, limitée par un mur qui part légèrement en biais à l’arrière de la maison. La pièce aurait eu une très grande profondeur, plus de 16 m, abside comprise (fig. 15).
Le pavement de la partie rectangulaire montrait, quant à lui, une composition très géométrique, à base d’octogones adjacents, formés sur des carrés à partir de demi-étoiles de huit losanges. Un pseudo-emblema, à triple bordure comportant des motifs figurés (un hippocampe ?, un poisson, deux oiseaux) puis un champ géométrique, se trouvait décalé vers le fond par rapport à l’axe de la salle 58. Les trames comme les motifs et la bordure de rinceau et les remplissages de fleurons font explicitement référence aux ateliers rhodaniens, dans une fourchette de datation entre la fin du iie et le début du iiie s. 59. La mosaïque de la pièce d’apparat doit être sans doute placée à l’époque sévérienne.
On n’a pas de certitude sur le décor des murs, mais de nombreux débris de placage furent signalés lors du déblaiement de la salle, trouvés effondrés dans la couche d’incendie 60.
Encore une fois, les murs de l’abside sont dans le prolongement de la partie quadrangulaire, mais selon une proportion anormalement longue 61. Le décor de chars de cirque était orienté vers l’abside, depuis la-
56- Durand 1911, 14.57- Dans la description de 1895 il est dit que “quoiqu’elle ne soit entourée d’aucune trace de mur ou de construction, elle était recouverte de débris de cendres ou de charbon qui accusaient un violent incendie” : Hardy, 1895, 104.58- Une partie de la mosaïque est déposée au musée de Périgueux.59- Décor, 270, n°175 b.60- “Au milieu des décombres provenant de l’effondrement de la toiture, et dans lesquels apparaissaient des traces d’incendie, furent recueillies plusieurs plaques de marbre de formes et de couleurs variées et quelques tronçons de moulures démontrant que les parois elles-mêmes avaient été richement décorées” (Hardy 1892, 171).61- Qui ferait envisager l’hypothèse d’un ajout postérieur (sans plus de chance de pouvoir jamais vérifier).
quelle il était lisible : comme l’a proposé C. Balmelle, l’hypothèse d’un lit de table à l’intérieur se justifie. Du moins, le point de vue privilégié de l’abside est indi-qué par le sens de lecture. Cette hypothèse se verrait renforcée s’il y avait une zone neutre sur le pourtour de l’abside.
Nous avons déjà évoqué plusieurs fois à propos des modes de banquet le cas de la fameuse mosaïque de Lycurgue, découverte à Vienne (Isère), en 1900-1907 62. On reste frappé des dimensions réduites de cette petite salle (5, 50 m x 7 m, abside comprise). La partie figurée de l’abside mesurait seulement 2,60 m de large sur 2,30 m de hauteur, avec une large bordure à fond noir, de 40 cm de large. Dans l’abside qui totalise une largeur de près de 3,40 m, une plinthe en mosaïque soulignait une banquette dont seule la base semble avoir été vue 63. On note encore que ce revêtement en paroi se trouve dans l’abside, signe de grand raffine-ment de cette zone de la salle.
Le splendide rinceau se détachant de manière très rare sur un fond vert, ajoute aux autres couleurs claires une impression dorée qui rehausse la préciosité de la salle : le luxe se signale ici par le caractère de la com-position et une gamme de couleur, au point que l’on reste embarrassé pour lui trouver un exact parallèle. L’image de Lycurgue, tournée vers l’abside (fig. 17), donne son sens au banquet en présence du thiase dionysiaque. Mais le problème reste entier pour la datation de cette mosaïque, placée, dans le corpus des mosaïques de la Gaule, durant le dernier quart du iie s. et rabaissée depuis au iiie s. 64.
Après ce bilan sur les exemples les plus représenta-tifs, dans les demeures de Gaule, tant en ville qu’à la campagne, entre le iie et la fin du iiie s., qu’apporte l’Antiquité tardive ?
On constate un net développement de la forme et l’explosion du nombre de salles, une banalisation de son usage, par création d’abside dans les nouveaux plans ou par ajout à des salles antérieures de plan classique. Un complément à l’inventaire général que
62- Lancha, 1981, 157-163, n°331, pl. LXXVII-LXXXI ; Lancha 1990, 82-86 ; Morvillez 1996, 140-141 ; Morvillez 2006, 604-606.63- Sur le fonctionnement possible de la banquette, déjà souligné par K. Dunbabin, Morvillez 1996.64- Lancha, 1990, 86.
278 décorS et eSpace architectural en Gaule entre l’antiquité et le haut moyen ÂGe
nous avions réalisé pour notre thèse s’imposerait 65. Une approche régionale sur l’exemple de l’Aquitaine, publiée par Catherine Balmelle, permettrait d’analy-ser finement les types de décor en vogue et de mieux cerner les particularismes, notamment le développe-ment du chauffage. L’abside tend à devenir un espace qui a sa vie propre : plus vaste, il permet un décor plus
65- Morvillez 1993, vol. 2, 158-199. Sur la question du développement de la mode des salles à abside dans l’Antiquité tardive, lancée à partir du colloque d’Apamée de Syrie en 1980 et publié en 1984 (Balty 2004) : Duval 1984 ; Sodini 1995 ; Sodini 1997 ; Dunbabin 1996 ; Dunbabin 2003 ; Ellis 1997 ; en dernier lieu, Lavan & Özgenel 2007. Jean-Pierre Sodini avait dressé un panorama pour les Trois Gaules (Sodini 1995,153-161). Pour l’Aquitaine spécifiquement, Balmelle 1992 ; Balmelle 2001, 159-175. De très nombreuses monographies par province ou régionales sont parues depuis, qu’il serait trop long ici de citer.
complexe. La forme va alors évoluer en suivant les critères de mode que l’on retrouve aussi bien pour les édifices profanes que pour les édifices sacrés. Semi-circulaires ou polygonaux, les hémicycles peuvent s’élargir en fer à cheval, comme à Cadeilhan-Saint-Clar en Aquitaine 66. La surélévation, que l’on retrouve dans l’ensemble de l’Empire pour les aires de banquet à abside ou à alcôve rectangulaire, semble être un trait nettement caractéristique de la fin de l’Antiquité : cela désigne l’abside comme une partie devenue autonome de la pièce. La profondeur ou l’outrepassement rap-pellent la nécessité de réserver assez d’espace pour ac-cueillir un lit de table, sans pour autant systématiser le lien entre l’abside et la couche. En tout cas, les exemples de Gaule qui proposent désormais des data-tions non seulement stylistiques, mais aussi archéolo- giques, attestent que les absides dans les salles d’appa-rat s’intègrent dans les plans, même dans des villes éloignées, dès le début du iie s. Dans ce sens, la décou-verte de la maison du collège Lumière éclaire – peut-on dire – la problématique de la diffusion de cette forme et nuance les évolutions linéaires que l’on est tenté de faire à partir de corpus aux datations souvent peu fixées par des critères archéologiques. Cette salle, du début du iie s., vaste, bien proportionnée, qui ouvre sur un péristyle et dont l’abside est tournée vers un jardin, est un exemple-type précoce. Inachevée, elle disparaît, gommée par un projet de domus encore plus ambitieux, sous une salle au Neptune, quadrangulaire, surdimensionnée. Les iie et iiie s. ne feront que diffuser et amplifier la mode d’une forme qui reste encore suffisamment rare pour éviter la banalité. Elle se dis-tingue alors non seulement par ses lignes, mais aussi, comme on l’a vu, par la surenchère du décor, luxueux ou rare par son thème ou les matériaux employés, ou encore par des installations de confort, notamment le chauffage. Cela assure de longues années de prospérité à un type qui tend à devenir la norme, jusqu’à la fin de l’Antiquité et même au début du Moyen Âge.
66- Balmelle 2001, 344-345 et 160.
———Fig. 17. Vienne (Isère), salle de Lycurgue. Plan (dessin M.P. Raynaud).———————