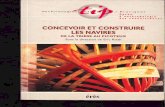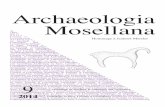USAGES ET LOGIQUES D'APPROPRIATION DES FORUMS DANS DES CONTEXTES UNIVERSITAIRES DIVERSIFIES
"Les transformations du jardin de tradition romaine dans l'Antiquité tardive" dans Archéologie des...
-
Upload
univ-avignon -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of "Les transformations du jardin de tradition romaine dans l'Antiquité tardive" dans Archéologie des...
mm mmISSN 1285-6371
ISBN 978-2-35518-038-5
AArrcc
hhééooll
ooggiiee
ddeess
jjaarrdd
iinnss
Archéologieet HistoireRomaine, 26
PP.. VV
aann OO
sssseell
,,AA..--MM
.. GGuuii
mmiiee
rr--SSoorr
bbeettss ((éédd
ss..))
..
Titres parus dans la collectionA
rc
hé
ol
og
ie
e
t
Hi
st
oi
re
R
om
ai
ne
, 2
6
éditions monique mergoil
textes rassemblés par
Paul Van Ossel
et
Anne-Marie Guimier-Sorbets
Archéologie des jardins
Analyse des espaces et
méthodes d’approche
mm
1• Mauné S - Les campagnes de la cité de Béziers dans l'Antiquité (partie nord-orientale) (IIe s. av. J.-C. - VIe s. ap. J.-C.). Préface de M. Clavel-Lévêque, 1998, 532 p., 216 fig.
2• Veyrac A. - Le symbolisme de l’as de Nîmes au crocodile.Préface de Ph. Leveau, 1998, 74 p., 42 fig.
3• Nickel Cl. - Gaben an die Götter. Der gallo-römische Tempelbezirk von Karden (Kr. Cochem-Zell, D)Mit Beiträgen von N. Benecke, O. Mecking, G. Lagaly und D.G. Wigg ; Vorwort von A. Haffner1999, III-518 p., 149 fig., 89 pl. dessins, 25 pl. ph.
4• Demarolle J.-M. (dir.) - Histoire et céramologie en Gaule mosellane (Sarlorlux), 2001, 271 p., nbr. figs.
5• Augros M. et Feugère M. (dir.) - La nécropole gallo-romainede la Citadelle à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 1. Catalogue, 2002, 192 p., 4 fig., 108 pl.
6• Blázquez Cerrato C. - Circulación monetaria en el área occidental de la península ibérica. La moneda en torno al «Camino de la Plata». Prólogo de Mª Paz García-Bellido, 2002, 358 p., 211 figs., 306 tabl., XVIII lám.
7• Genin M., Vernet A. (dir.) - Céramiques de la Graufesenqueet autres productions d’époque romaine. Nouvelles recherches. Hommages à Bettina Hoffmann.2002, 324 p., nbr. figs.
8• Rivet L., Sciallano M. (Textes rassemblés par) - Vivre, pro-duire et échanger : reflets méditérrnéens. Mélanges offerts à Bernard Liou, 2002, 578 p., nbr. figs., 8 pl. coul.
9• Ferrette R., coll. H. Kérébel - La céramique gallo-romaine du site de Monterfil II à Corseul (Côtes-d’Armor).Études d’ensembles de l’époque augustéenne au début du IVe siècle2003, 223 p., 65 fig., 116 tab., 69 pl.
10• Ballet P., Cordier P., Dieudonné-Glad N. (dir.) - La ville et ses déchets dans le monde romain : rebuts et recyclages. Actes du colloque de Poitiers (19-21 Septembre 2002), 2003, 320 p., nbr. fig.
11• Berdeaux-Le Brazidec M.-L. - Découvertes monétaires des sites gallo-romains de la forêt de Compiègne (Oise)et des environs dans leurs contextes archéolo-giques. Préface de R. Turcan, 2003, 585 p., 221 fig., 9 tab.
12• Sabrié M. et R. (dir.) - Le Clos de la Lombarde à Narbonne. Espaces publics et privés du secteur nord-est. Préface de M. Christol, 2004, 327 p., 292 fig., 8 pl. coul.
13• Thernot R., Bel V., Mauné S. et coll. - L’établissement rural antique de Soumaltre (Aspiran, Hérault). Ferme,
auberge, nécropole et atelier de potier en bordure dela voie Cessero-Condatomagus (Ier-IIe s. ap. J.-C.)Avant-propos d’A. Chartrain, 2004, 388 p., 363 fig.
14• Pomarèdes H., Barberan S., Fabre L., Rigoir Y. et coll. - La Quintarié (Clermont-l’Hérault, 34). Etablissement agricole et viticulture, atelier de céramiques paléochrétiennes (D.S.P) (Ier-VIe s. ap. J.-C.). Avant-propos de Ch. Pellecuer2005, 191 p., 151 fig.
15• Mauné S., Genin M. (dir.) - Du Rhône aux Pyrénées : aspects de la vie matérielle en Gaule Narbonnaise (fin du Ier s. av. J.-C. - VIe s. ap. J.-C.)2006, 371, nbr. fig.
16• Chrzanovski L. - L'urbanisme des villes romaines de Transpadane (Lombardie, Piémont, Vallée d'Aoste)2006, 399 p., 130 fig.
17• Haüßler R. (dir.) - Romanisation et épigraphie. Etudes interdisciplinaires sur l'acculturation et l'identité dans l'Empire romain, 2008, 374 p., nbr. fig.
18• Péchoux L. - Les sanctuaires de périphérie urbaine en Gaule romaine. 2010, 504 p., 220 fig. dont 4 coul.
19• Sabrié M. et R. (dir.) - La Maison au Grand Triclinium du Clos de la Lombarde à Narbonne.2011, 396 p., 310 fig., 32 pl. coul.
20• Schatzmann R., Martin-Kilcher S. (dir. / Hrsg.) - L'Empire romain en mutation. Répercussions sur les villes dans la deuxième moitié du 3e siècle / Das römische Reich im Umbruch. Auswirkungen auf die Städte in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts.2011, 316 p, nbr. fig.
21• Trintignac A., Marot E., Ferdière A. (dir.) - Javols - Anderitum (Lozère), chef-lieu de la cité des Gabales :une ville de moyenne montagne. Bilan de 13 ans d’évaluation et de recherche (1996-2008).2011, 560 p., nbr. ill., 3 pl. coul. h.-t.
22• Pichot A. - Les édifices de spectacle des Maurétanies romaines, 2011, 220 p., 108 fig., 8 tabl.
23• Ancel M.-J. - Pratiques et espaces funéraires :la crémation dans les campagnes romaines de la Gaule Belgique, 2012, 650 p., 218 fig., 120 pl., 81 tabl.
24• Cazanove O. de, Méniel P. (dir.). - Etudier les lieux de culteen Gaule romaine, 2012, 263 p., nbr. fig.
25• Mauné S., Duperron G. (dir.) - Du Rhône aux Pyrénées, Aspects de la vie matérielle, II, 2013, 374 p., nbr. fig.
éditions monique mergoilmontagnac
2014
Archéologie des jardins
Analyse des espaces et méthodes d'approche
Textes rassemblés par
Paul Van Ossel et Anne-Marie Guimier-Sorbets
Ouvrage publiéavec le concours de l'UMR ArScAn
(CNRS, Universités de Paris I et Paris X, Ministère de la Culture)
Tous droits réservés© 2014
Diffusion, vente par correspondance :
Editions Monique Mergoil12 rue des Moulins
F - 34530 Montagnac
Tél/fax : 04 67 24 14 39e-mail : [email protected]
ISBN : 978-2-35518-0ISBN 978-038-5ISSN : 1285-6371
Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduitesous quelque forme que ce soit (photocopie, scanner ou autre)
sans l’autorisation expresse des Editions Monique Mergoil.
Texte : auteurSaisie, illustrations : idem
Mise en pages : Virginie TeilletCouverture : Editions Monique Mergoil
Impression numérique : Maury SAZ.I. des Ondes, BP 235 F - 12102 Millau cedex
— 5 —
Paul Van Ossel, Anne-Marie Guimier-sOrbets Archéologie des jardins. Analyse des espaces et méthodes d’approche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Thème I
Archéologie du jardin : diversité, organisation, équipement et productions
Amina-Aïcha malekDe l’espace pictural à l’espace du jardin : mosaïques et jardins dans les domus de l’Afrique romaine . . . . . . . . 13
Hélène DessalesDu jardin aux jardinières : l’évolution des péristyles dans l’habitat romain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Émilie ChassillanPlace du bassin et spectation dans le jardin de Gaule Narbonnaise au Haut-Empire : problèmes de typo-chronologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Agnès triCOCheJardins funéraires d’Alexandrie aux époques hellénistique et romaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Christian CribellierJardins et habitats de l’agglomération gallo-romaine de Beaune-la-Rolande (Loiret, France) . . . . . . . . . . . . . . . 57
Paul Van OsselDes jardins à tout faire. Les espaces de jardin dans les parcelles du quartier Saint-Honoré de Paris aux XVe et XVIe siècles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Annick heitzmannUn exemple de méthodologie versaillaise : le jardin du Pavillon frais à Trianon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Thème II
Archéologie environnementale du jardin : méthodes d’approches
Fabien PilOn, Kahina maames, Florian JeDrusiakApproche archéologique et paléoenvironnementale des parcelles de l’agglomération gallo-romaine de Châteaubleau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Marnix PietersJardins et transformations des sols : caractéristiques et interprétations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Cécilia Cammas, Carole VissaC, Quentin bOrDerie, Christian DaViDDiversité des espaces végétalisés : contribution de la géoarchéologie à la connaissance des jardins historiques et des espaces non bâtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Anne DietriChMéthode et interprétations xylologiques à propos des puits et des jardins antiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Sommaire
Archéologie des jardins. Analyse des espaces et méthodes d’approche
— 6 —
Thème III
Regards croisés et approches comparatives : les modèles en question
Francis JOannèsL’économie des jardins en Mésopotamie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Anne-Marie Guimier-sOrbets Le jardin pour l’au-delà des bienheureux : représentations funéraires à Alexandrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Éric mOrVillezLes transformations du jardin de tradition romaine dans l’Antiquité tardive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Michel terrasseHéritière de la villa, la muniya médiévale ibéro-maghrébine et ses jardins : tradition littéraire et réalité archéologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Florent Quellier L’historien face au jardin potager-fruitier de l’époque moderne : sources et grilles de lecture . . . . . . . . . . . . . . 185
Catherine saliOuAux limites du jardin. Le droit et les limites du jardin dans le monde romain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Hélène GuiOtJardin et forêt, de l’un à l’autre en Polynésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
— 161 —
Résumé : Les formes du jardin entre la fin de la République et le Ier siècle de notre ère ont été bien analysées grâce aux exemples campaniens et aux études renouvelées sur l’Italie et les provinces. Des habitudes d’agencement se sont mises en place, progressivement transposées dans le vocabulaire décoratif, tant pictural que musival. A partir du IIe siècle, les choix dans l’apparat décoratif du jardin se sont modifiés, mais en conservant certaines parties du mobilier antérieur. Des éléments comme l’oscillum tendent à disparaître et certaines de ces pièces de qualité se retrouveront « recyclées » dans l’Antiquité tardive. Du point de vue typologique, la barrière sous forme de lattis léger employé dans l’hortus conclusus s’est diffusée dans les provinces, sans doute grâce à la peinture. Les décors de jardins fictifs avec croisillons ou balustrade pleine avec niches et cratère-fontaine se maintiennent comme systèmes décoratifs à la période antonine et sévérienne. Dans l’Antiquité tardive, les balustrades deviennent plus massives mais les croisillons et croix de Saint-André continuent d’être employées en décor. La dimension pastorale et bucolique avec association d’animaux comme des brebis peut aussi s’adapter dans un contexte chrétien, comme à l’aula théodorienne sud d’Aquilée. On assiste aussi au croisement de plus en plus fréquent entre l’hermès sculpté de jardin et la barrière elle-même, à l’image des tribunes de certains édifices publics. Devenu support de balustrade, l’hermès décore de têtes sculptées plus ou moins variées les portiques ou parapets de bassin. On en trouve sa meilleure expression à Welschbillig, mais aussi autour du bassin de « l’atrium » de la villa d’Ivaïlovgrad. Cette mode est reflétée dans certains décors picturaux, comme à la catacombe de Saint-Sébastien. Mais le type plus léger à croisillons ne disparaît pas pour autant comme le montre la simple peinture d’une cage d’escalier de la domus sous San Giovanni et Paolo ou une luxueuse imitation en opus sectile découverte récemment dans une zone de jardin d’une résidence du Pincio à Rome. Apparaissent à la fin de l’Antiquité entre le IVe et le début du Ve siècle des images d’aristocrates prenant la pose en leur jardin, notamment sur le pavement du Seigneur Julius de Carthage où l’un des pavements des bains d’Oued Athmenia près de Constantine, ou encore des évocations de leur abondance florale, ainsi qu’on le voit avec les personnifications versant des corbeilles de roses du frigidarium des bains privés de Sidi Ghrib.
Mots-clefs : Jardin, hortus, viridarium, architecture domestique, Haut Empire, Antiquité tardive, oscillum, balustrade, lattis, barrière, cratère fontaine, hermès.
L’attention se porte à nouveau sur le jardin antique et la manière d’intégrer la végétation, réelle ou imaginée, au sein de l’architecture : dans ce domaine, les Romains ont été de véritables créateurs1. Mais on s’est surtout penché sur les formes que l’hortus avait prises à partir
1. La bibliographie est désormais trop longue pour tenter même de la résumer ici. Nous ne citerons que quelques titres récents comme les synthèses de Carroll, 2003 ; Gros de Beler et al., 2009 ; FuChs dans Bertholet et al., 2010 ; pour les jardins de Rome, Villedieu, 2001, p. 23-81, 127-138 ; hartswiCk, 2004 (horti Sallustiani), Frass, 2006 (horti romani) ; di Pasquale, PaoluCCi, 2007 ; sur les résidences de luxe et leurs jardins réels ou fictifs, cf. Pesando, GuidoBaldi, 2006 ; sauron, 2009 ; sur la place des jardins dans la domus en Gaule : MorVillez, 2006, p. 592-598, sur les bassins d’ornements, cf. dessalles, 2007 et 2011 et son article dans ce volume ; Chassillan, 2011a, et son article dans ce volume. Sur la perception de la nature dans la domus, les travaux novateurs de
des derniers siècles de la République romaine2. Si l’on se concentre sur le jardin d’agrément, on se rend compte qu’il se développe comme un art à part entière, tant dans le monde de la domus que celui de la villa de plaisance. Il prend un réel essor entre la fin du Ier siècle av. J.-C. et la première moitié du Ier siècle, pour atteindre une sorte de maturité idéale que les peintures de jardin de la région de Campanie, à l’époque néronienne et flavienne, ont fixée, dans une forme de « perfection » jamais égalée : la Maison
Malek, 2005 (Afrique) et loustaud, Malek, 2011 (sur la Gaule à propos de Limoges).
2. Je tiens à exprimer ma gratitude à Anne-Marie Guimier-Sorbets, Marie-Christine Marinval et Paul Van Ossel pour leur invitation à présenter à Nanterre ce sujet sur mes recherches en cours. Je dois certaines illustrations originales à l’amitié de A. Barbet, G. Volpe et de Cl. Vibert-Guigue.
* Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse ; UMR 8167, Orient et Méditerranée – Équipe Antiquité classique et tardive.
Les transformations du jardin de tradition romaine dans l’Antiquité tardive
Éric MorVillez*
Éric Morvillez
— 162 —
du Bracelet d’or à Pompéi en a fourni une illustration remarquable3. Jusqu’à la fin du Ier siècle, l’environnement végétal de la domus et de la villa nous paraît encore fami-lier, grâce à l’archéologie vésuvienne, épaulée ensuite pour la période de Trajan et d’Hadrien par quelques textes, devenus à juste titre célèbres, comme la description des jardins des villas de Pline le Jeune4. La Villa Hadriana fournit pour sa part une apothéose dans l’invention des jeux entre les formes de l’architecture, parterres et bas-sins5. Il est frappant de constater que les archéologues et historiens d’art renvoient surtout aux formes et décors de cette période dans leurs commentaires, pour comparer les nouvelles découvertes chronologiquement postérieures. Même sans contexte, erratique ou bien lacunaire, les caté-gories d’objets de jardin romain du Haut-Empire sont parfaitement distinguées dans les collections muséales. Elles renvoient à un univers codifié par les Romains eux-mêmes : des croisillons en peinture évoquent instantané-ment une barrière légère de jardin, un fragment d’oscillum ou d’hermès l’identité du jardin romain. Comme l’a écrit J.-M. Croisille dans son histoire de la peinture romaine, « l’essor des représentations de jardin dans le monde romain à partir de la fin de la République s’inscrit dans une véritable culture du jardin privé » où la valeur de type symbolique tend à s’estomper6. Bien que la majo-rité des jardins ait dû être classée, selon l’appellation de W. Jashemski, dans le type informal7, donc assez libre, c’est la catégorie formal, c’est-à-dire plus géométrisée, avec ses parterres et ses allées dessinés et ponctués de sculptures qui consciemment d’abord, et inconsciemment ensuite, a retenu l’attention des historiens de l’art. Mais cela a même créé dans notre imaginaire collectif une série de poncifs, né au XIXe siècle et entretenus depuis sur le jardin romain, qui lui retirent bien des facettes de sa complexité. Le jardin romain se trouve un peu « bloqué » chronologiquement au Ier siècle par la masse documen-taire pompéienne. Au-delà du IIe siècle, l’information se fait plus rare, ou – pour être plus juste – devient plus lacu-naire, moins spectaculaire. Elle manque d’homogénéité et les sources textuelles sont plus difficiles à manier8. Cette sorte d’apothéose formelle atteinte au Ier siècle ap. J.-C. a
3. Sur la peinture de jardin de la Maison du Bracelet d’Or, cf. la synthèse de Carolis dans naVa et al., 2007, p. 50-59, avec bibliographie antérieure.
4. FörsCh, 1993, p. 65-84.5. salza Prina riCotti, 1995 ; laVaGne et al., 2001, l’art des
jardins et le goût de la nature, p. 242-249.6. Croisille, 2005, p. 222.7. Garden design dans JasheMski, 1979, p. 25-34.8. D’où la nécessité du rassemblement de corpus régionaux. Ce travail
de longue haleine, le Corpus des Gardens of the Roman Empire, commencé par Wilhelmina Jashemski, par les cités campaniennes (JasheMski, 1979 et 1993) se termine (JasheMski, Gleason, hartswiCh, Malek, 2 vol. à paraître, Cambridge University Press.) Cf. aussi la thèse d’Émilie Chassillan, sur les jardins de la Gaule (Chassillan, 2011a).
sans aucun doute conduit à l’invention de modèles, repro-duits et transmis en partie ou en totalité d’un bout à l’autre de l’Empire. De là sont nés des « stéréotypes » décoratifs, tant dans la réalité des jardins que dans leurs représenta-tions ou leur simple évocation, en particulier en peinture ou en mosaïque.
On peut donc se demander dans quelle mesure les élé-ments constitutifs du jardin hérités du Ier siècle se main-tiennent avec les changements de la période antonine. Il faut d’abord préciser le sens que nous avons voulu donner ici à l’expression « de tradition romaine » : c’est en partant des caractères acquis par le jardin au Ier siècle de notre ère et la spécificité de son décor que l’on peut chercher une évolution, inévitable en matière de mode, sur une si longue période. La question qui me préoccupera cepen-dant est celle de la continuité des formes, de leur évolution au cours des IIe et IIIe siècles et au-delà dans l’Antiquité tardive. Il m’a paru nécessaire d’observer cette évolution sur une longue période à partir du second siècle : en effet, ces changements de goût sont perceptibles dans la réali-sation des horti réels ou leurs représentations figurées, car jusqu’à la fin de l’Antiquité, nous le verrons, se transmet un héritage d’habitudes, de lignes et de mobilier de jar-din qu’il s’agisse d’éléments décoratifs comme l’hermès sculpté, ou encore la forme des balustrades qui ordonnan-çaient péristyles, parcs et promenades, tandis que d’autres éléments tendent à disparaître.
1. Transformation ou disparition de certains éléments décoratifs ?
Prenons l’exemple de l’oscillum, élément embléma-tique des jardins du Ier siècle. Ces disques de marbre – avec parfois une variante en forme de pelte ou plus rarement de pinax –, étaient destinés à être suspendus entre les colonnes des péristyles9. Ils caractérisent un certain nombre de jar-dins de Pompéi et d’Herculanum10. Cependant, comme l’avaient montré les études de E.-J. Dwyer, J.-M. Pailler et les inventaires de W. Jashemski, ces oscilla ne sont pas présents dans toutes les maisons de Pompéi, mais signalent plutôt une « recherche d’originalité architectu-rale dont la suspension d’oscilla aux épistyles constitue une composante »11. Entré dans le répertoire des peintres, avec d’autres objets suspendus comme les masques, les armes ou les instruments de musique, l’oscillum est dans
9. Nous laisserons de côté ici un autre élément caractéristique, les pinakes sculptés de marbre, posés sur des colonnettes ou supports dans les viridaria, connus par les exemples de la Maison des Amours dorés ou les représentations sur les peintures de la Maison du Bracelet d’or à Pompéi.
10. Sur les oscilla, inventaire de dwyer, complété par les recherches de J.-M. Pailler Cf. aussi loisy, 1999 et Chassillan, 2011a, vol. 1, p. 257-259, et vol. 2, pl. 130. Pour une étude récente sur l’Italie, BaCChetta, 2005.
11. Pailler, 1982, p. 786.
Les transformations du jardin de tradition romaine dans l’Antiquité tardive
— 163 —
certains cas reproduit fidèlement en poncif dans la pein-ture de jardin, comme à la Maison du Verger ou à celle du Bracelet d’or à Pompéi (pour ne citer que deux exemples très connus). Les oscilla, installés en séries « pour obte-nir un effet d’ensemble (entre quatre à treize numéros) »12 dans les plus belles maisons, semblent donc avoir régné dans les portiques de certains jardins au Ier s. des élites, dans la période néronienne et flavienne. Mais ces objets que l’on a retrouvés en pourcentages plus ou moins élevés dans l’ensemble de l’Occident, mais aussi dans la partie orientale de l’Empire, se font plus rares après le Ier siècle. Beaucoup ne sont pas cependant en contexte précis. J.-M. Pailler avait posé déjà la question de la longévité de l’engouement pour ces artefacts, rappelant en premier lieu, qu’on avait supposé une fin de cette mode en raison de leur absence à la Villa Hadriana13. On en a pourtant recensé un certain nombre, dans la zone du Canope, mais on leur a donné une connotation d’objets collectionnés14. Comme le souligne A. Bachetta, la majorité des exemples est placée dans une fourchette entre l’époque augustéenne et la fin du Ier-début du IIe siècle. Mais un exemplaire de Porto Torres en Sardaigne a été daté en pleine époque sévérienne15. J.-M. Pailler a montré leur remploi dans des contextes postérieurs comme bouche de fontaine ou bien regard d’égout (ex. connus à Ostie16), ce qui peut montrer bien sûr une désaffection pour ce genre d’objet, ou, à mon avis, une mise au rebut, une « deuxième vie » de pièces décoratives qui ne pouvaient plus fonctionner en série.
En peinture murale, si l’on continue à employer au-delà du Ier siècle le bouclier (clipeus) suspendu, associé à des rubans ou guirlandes, il semble qu’on ne rencontre presque plus le motif de l’oscillum tel qu’il a été employé dans la peinture des IIIe et IVe styles. Dans les images de portiques de villas, en particulier les représentations en mosaïque de la fin de l’Antiquité, leur silhouette caracté-ristique et facile à représenter a disparu. Mais l’habitude des suspensions ne semble pas disparaître complète-ment17. Compte tenu du nombre d’exemplaires retrouvés
12. Pailler, 1982, p. 783.13. Pailler, 1982, p. 778 et n. 115.14. laVaGne et al., 2001, p. 195, n° 42.15. teatini, 2002, p. 2324-2325 ; BaCChetta, 2005, p. 76-77. On
peut se demander si la chronologie de ces objets souvent stylistique, n’a pas été trop souvent rapprochée de celle des exemplaires les plus nombreux. Un certain nombre de cas ont été datés plus tardivement que le début du IIe siècle, comme le n° 13 de la liste de A. Bacchetta, provenant d’Aquilée (pour V.-M. Scrinari - milieu IIe s.). Rappelons la première date proposée pour l’oscillum de Faragola (cf. infra).
16. Pailler, 1982, p. 811.17. Il serait trop long de poser ici la problématique de l’exposition des
oscilla et de leur lien avec les pinakes et autres objets suspendus ; et sans doute l’aspect religieux (ex-voto). La question a été soulevée par Pailler, 1982, p. 791-805, développée par BaChetta, 2005, p. 79-81 et enrichie par laVaGne dans son article de 2006, où la question d’oscilla circulaires posés sur des supports, comme certains pinakes et non plus suspendus, est clairement soulignée (laVaGne, 2006, p. 1071 ; cf. aussi la notice sur un oscillum de
dans la même fouille, ce n’est plus une coïncidence : à la Maison du Buste en Argent de Vaison-la-Romaine, au quartier de la Villasse, les oscilla découverts, l’un frag-mentaire dans le vestibule (16), les trois autres dans l’un des portiques du premier péristyle (17), devaient faire partie intégrante de la dernière phase de splendeur de la maison, avant sa destruction et son abandon, vraisem-blablement dans le courant des troubles du IIIe siècle, où l’on constate un repli de toutes les grandes demeures de la ville18.
En dehors des oscilla traditionnels, on retrouve ail-leurs la trace de l’usage de suspendre des masques entre les colonnes des viridaria. L’exemple de la Maison dite des masques19, rue des Farges à Lugdunum, capitale des Gaules, semble en démontrer la continuité, peut-être au-delà du Ier siècle. Dans cette belle habitation, les deux ailes connues s’organisent autour d’une cour-jardin de 96 m2, ornée d’un bassin rectangulaire. Les portiques, larges de 2,80 m, au sol de terre battue, bordent le jar-din. À proximité du péristyle ont été retrouvés de petits masques de comédie de théâtre en terre cuite, ayant servi d’oscilla (fig. 1)20. La demeure semble décliner avec le quartier, à partir de la fin du IIe ou le début du IIIe siècle : on ne note pas, comme dans les habitats du site du Verbe Incarné, de reconstruction au IIIe siècle.
Rappelons aussi que pour le Haut-Empire comme pour l’Antiquité tardive, les objets décoratifs dans les domus et les villae peuvent appartenir à des périodes nettement antérieures, d’où la difficulté de les associer aux espaces qu’ils ornaient. Ainsi en est-il pour la sculpture et le mobi-lier de jardin : il est découvert la plupart du temps, brisé, lacunaire et hors de son contexte précis. Le principe de la récupération et du détournement, valable pour bien des éléments architecturaux (chapiteaux, colonnes, placages,
la Villa Hadriana, laVaGne, GaFFiot, 2001, p. 195). La plupart de nos objets – en dehors des cités vésuviennes où ils ne sont pas toujours situés en contexte et incomplètement documentés – ne sont pas en série, la longévité de leur utilisation au sein des jardins pose problème, de même que leur datation stylistique. Ils étaient associés à toute une série d’autres éléments décoratifs suspendus (instruments de musique, masques…) cf. infra, les masques de terre cuite de la Maison de la rue des Farges à Lyon.
18. Chassillan, 2011a, vol. III, p. 111-113 (avec bibliographie), ProVost, MeFFre, 2003, p. 169-172, not. fig. 201b et 206. Rappelons que le fameux buste en argent qui a donné son nom à la maison, daté de la première moitié du IIIe siècle, a été découvert scellé dans les cendres dans l’angle nord-est du 3e péristyle, sous les tuiles de la toiture abattue par un violent incendie (ProVost, MeFFre, 2003, p. 175-176, avec bibliographie).
19. ChoMer, le Mer, 2007, p. 584-586, avec bibliographie antérieure ; desBat, 1985, p. 38-49, fig. 67, où les deux oscilla sont datés du IIe siècle ; Chassillan, 2011a, vol. III, p. 266-267. On citera un autre exemple de masque théâtral de terre cuite découvert dans les fouilles du cours Pourtoules à Orange, qui a pu avoir une fonction similaire (?), Bellet, 1991, p. 65.
20. Un œuf d’autruche, objet exotique d’importation, était peut-être aussi suspendu entre les colonnes. D’autres fragments de masques ont été découverts, formant au moins 10 exemplaires.
Éric Morvillez
— 164 —
vasques) peut aussi être appliqué à des objets précieux, autrefois utilisés différemment. On en connaît désor-mais un exemple spectaculaire pour l’Antiquité tardive, à la Villa de Faragola, dans les Pouilles. Dans le stiba-dium-fontaine somptueux aménagé entre le milieu et la fin du Ve siècle, on a remployé de part et d’autre dans la façade du lit de table, à la place des habituelles rotae de marbre dans les opera sectilia pariétaux, deux oscilla (pl. 15-1 et 15-2). L’un, de marbre blanc, a été trouvé en place, tandis que l’autre avait disparu, laissant seulement son empreinte. On possède un fragment de visage décou-vert dans la salle qui permet de restituer pour le premier, le motif bien connu de la danseuse de calathiscos21. Qu’il s’agisse d’un oscillum remployé, datable du Ier siècle ou d’après son style un peu rigide du IIe siècle, comme
21. VolPe, 2005a, p. 136-139, fig. 14 et 16, où le style du bas-relief avait d’abord fait penser à une datation au IIe siècle ; VolPe, 2005b, p. 275-277, fig. 19-20, et hypothèse de restitution de l’oscillum, fig. 21, où la datation est ramenée au Ier ap. J.-C (?). Cf. aussi laVaGne, 2006, p.1081-1083. Rien n’exclut dans cette pièce au goût de pastiche une copie plus tardive. La dimension de l’oscillum doit être aussi prise en compte. On note que celle de Faragola est de près de 60 cm. Celui de Champlay, découvert dans l’Yonne mesure 41,9 cm, alors que la moyenne se situe entre 20 et 35 cm, avec une moyenne de 30 (laVaGne 2006, p. 1071-1072), ce qui fait de ces pièces des objets de prix. Leur poids est considérable (presque 12,5 kg pour celui de Champlay).
cela avait été suggéré dans une première présentation, il semble avoir traversé les siècles comme œuvre d’art et être mis en valeur dans l’un des espaces de la pièce le plus en vue pour les convives arrivant dans la salle. La ques-tion se pose alors de savoir à partir de quel moment l’objet a perdu sa présentation d’origine. Où bien s’agirait-il d’un disque de marbre fabriqué ad hoc, et donc d’une sorte de pastiche qui supposerait des modèles conservés ? Mais cela signifierait aussi qu’en plein Ve siècle, l’objet oscil-lum en tant que tel avait encore pour le spectateur un sens. Notons cependant que le disque de Faragola, par son dia-mètre de près de 60 cm, se distingue nettement de la taille moyenne de ceux connus habituellement (20 à 35 cm) et doit être placé parmi les objets de luxe de sa catégo-rie (comparable à l’oscillum découvert à Sperlonga qui mesure aussi 60 cm de diamètre). De plus, il n’est pas pos-sible actuellement de voir la face arrière, pour déterminer si elle était décorée – ce qui prouverait indubitablement le remploi. Il sera donc capital d’affiner les connaissances de ce document découvert de manière exceptionnelle dans son contexte22.
22. Je tiens à remercier ici G. Volpe pour les renseignements aima-blement fournis sur cet oscillum, ainsi que la photographie et l’image de synthèse reproduite ici.
Fig. 1 - Lyon, restitution graphique du jardin de la maison des Masques, d’après Desbat, 1985, p. 38.
Les transformations du jardin de tradition romaine dans l’Antiquité tardive
— 165 —
2. L’évolution de la forme de la barrière, réelle ou figurée, à partir du IIe siècle
Mais c’est surtout la barrière matérialisant les limites du jardin et de ses plantations qui a caractérisé le jardin romain réel ou figuré au cours des siècles. L’aspect de ces clôtures évolue considérablement entre Haut et Bas-Empire. Dès l’origine, elles ont pu être représentées de différentes manières, renvoyant à toutes sortes de maté-riaux, plus ou moins luxueux sous forme de chancel de marbre ou de pierre sculptée comme dans les peintures de IIe style de la Villa de Fannius Synistor à Boscoreale 23 ou dans la barrière en second plan sur les peintures de la salle souterraine de Prima Porta24. Le lattis léger, des-sinant un treillage à décor losangé, devient le schéma stéréotypé par excellence de la clôture de jardin25. Son modèle est présent dans pratiquement toutes les provinces de l’Empire, connu à travers les exemples imités en pein-
23. Baldassare et al., 2006, p. 94-95. La peinture est datable entre 50 et 40 av. J.-C.
24. Baldassare et al., 2006, p. 151-154.25. Sur la barrière et les chancels, cf. l’étude de Farrar, 1998,
p. 32-35 ; JasheMski, 1979, p. 49-51 ; ViPard, 2003, p. 99-104, à propos des portiques fenêtrés qui pose une introduction claire sur les balustrades. Sur le rôle de stéréotype de la barrière, cf. notre communication au séminaire de Courrier, Ménard, 2013 (à paraître) ; la contribution de BlanC, « Paradis et hortus conclusus : formes et sens de la clôture », et Gury, « Les jardins romains étaient-ils bien entretenus ? Esthétique du négligé ou expression de la générosité de la Nature ? » dans : Paradeidos, à paraître.
ture : ceux-ci sont cependant plus ou moins bien datés car on a tendance à les rapprocher du Ier siècle et des modèles pompéiens plus nombreux26. En Gaule, l’image de ce que l’on appelle traditionnellement hortus conclusus27, se dif-fuse sans doute d’après le motif des vignettes du IIIe style. Dans une peinture de Vaison-la-Romaine, c’est en partie basse d’une cloison qu’il apparaît28. À Périgueux, on en a identifié peut-être un autre exemple à partir de deux frag-ments de fresque29. À Fréjus, l’étude fine de la Maison de la place Formigé a montré combien la représentation de barrières à croisillons, sur les murets de la cour avait suffi au Ier siècle à remplacer pendant un temps un hortus désiré (fig. 2)30. Ce jardin fictif est caché pour devenir en partie réel, par l’ajout de trois rangées de jardinières pour de véritables plantations, dans la 3e phase de transformation
26. Cf. la synthèse pour la Gaule, BarBet, 2008, p. 295-308.27. Bien que l’appellation ne soit pas antique, cf. la synthèse de BlanC,
dans Paradeidos, à paraître.28. Fouilles au nord de la Cathédrale, BarBet, 2008, p. 295, avec
bibliographie. La présence de ce motif bien en vue montre le rôle de la peinture décorative dans la diffusion du goût pour ce type de jardin à claustra et pergola, sans pour autant prouver la réalité de ce type d’installation dans les jardins vaisonnais ou gallo-romains.
29. BarBet, Girardy-Caillat, Bost, 2004, p. 151-154, fig. 2 p. 154 ; « Dans un remblai ou un état antérieur au Ier siècle », BarBet, 2008, p. 296.
30. BarBet, 1995, p. 103-107 ; BarBet, 2000 ; BarBet, 2008, p. 297-298, fig. 454 à 456 ; pour la synthèse architecture-peinture, riVet, 2010, p. 221-351, not. p. 265-273.
Fig. 2 - Restitution de la cour de la maison de la place Formigé, Fréjus (cl. A. Barbet).
Éric Morvillez
— 166 —
de la cour centrale, juste avant l’incendie final31. Autre variante habituelle, la balustrade pleine, peinte souvent de rouge vif, rythmée d’exèdres contenant des vases ou des fontaines, a fait partie des poncifs de la peinture de jardin du IVe style à Pompéi. On retrouve le schéma sur les murs du jardin de la Domus des Bouquets de Périgueux32. Nous avons la chance ici d’avoir ces fresques en contexte. Le viridarium de cette luxueuse habitation, dans sa seconde phase d’aménagement, se retrouve en contrebas du quadri-portique qui formait le centre de la demeure. Cl. Barrière y découvrit des lambeaux de peinture, très endomma-gés, faisant le tour du jardin. On y voit un chancel plein, de couleur rouge, scandé d’exèdres semi-circulaires qui accueillaient des cratères-fontaines ornementaux à jet d’eau. Régulièrement disposées, des gaines ont été réin-terprétées depuis par A. Barbet comme des statues-her-mès. Ce schéma montre une similitude évidente avec certains décors bien antérieurs connus à Pompéi dans des péristyles ou sur des parois de fond de viridarium, comme à la Maison de Romulus et Rémus (fig. 3)33. À Périgueux, l’ensemble formait un décor d’allée, entre le mur périmé-
31. Évolution dans riVet, 2010, p. 267, fig. 312. La maison, construite dans les années 10-15, est détruite par un incendie dans les années 65-70 et fait place à la fin du Ier siècle à un niveau supérieur, à une domus avec véritable péristyle orné d’un grand bassin d’agrément à fontaine.
32. Barrière, 1996, p. 45-90 ; pour le « bassin » et le décor aux poissons, BarBet et al., 2004, p.177-194 ; BarBet, 2008, not. p. 299, fig. 458, 307 et fig.465-467.
33. Pompéi, VII, 7, 10, Viridarium (q) paroi ouest dans : PPM VII, 1997, p. 271, par exemple. Ex. traités d’ailleurs aussi en lattis, ou en système mixte (niche pleine et barrière à croisillon), cf. par ex. le frigidarium des thermes de Stabies à Pompéi, JasheMski, 1993, p. 358-359. Sur ces décors de jardins et leur intégration dans l’architecture, cf. eristoV, « Peintures de jardins à Pompéi : une question de point de vue », Paradeisos, à paraître.
tral et le bassin ou podium central, recouvert d’un décor de poissons. En tenant compte de la date de transforma-tion de la domus et de son rehaussement qui place la partie plantée en contrebas, on ne peut envisager une datation avant le milieu du IIe siècle (après 150-160)34. Les sys-tèmes décoratifs nés dans la peinture de jardin du IVe style ont donc eu une forte permanence dans les provinces dans le siècle suivant au moins. Si la chronologie relative de ce décor pose encore question, elle indique une belle stabilité des schémas décoratifs en Gaule au IIe siècle.
En Orient, on note aussi dans les maisons des exemples de décor de jardins, avec croisillons et vasques, rempla-çant d’ailleurs de vraies plantations : ils ont souvent orné les cours à nymphée des belles maisons de l’époque impériale, mais ils ont été rarement documentés35. On doit signaler l’exemple de Zeugma de la maison 1 dite de Poséidon, dans la cour P4, ornée de la fameuse mosaïque d’Achille à Skyros36. Des restes de peintures de jardin ont été relevés (fig. 4), à plus d’un mètre du sol, sur le mur sud, dans la cour qui préexista au nymphée. Ils montrent des restes de barrières à croisillons rouges sur fond noir, avec des fleurs dans les losanges dessinés. Seul le piète-ment d’un cratère est conservé, sans qu’on sache s’il abri-tait une fontaine37.
34. C’est la datation proposée dans la première publication (« après 150 ») par le fouilleur (cf. pl. h.t. couleur dans Barrière, 1996). Rappelons que le rebord extérieur du bassin ou terre-plein central ( ?) a été repeint trois fois.
35. Sur les décors disparus de jardins dans des cours d’Antioche, Daphné ou de Séleucie, cf. le témoignage de J. Lassus dans mon article (MorVillez, 2007a, not. p. 63-64 et sur la place des jardins, p. 71-73).
36. BarBet, Monier, yon, 2005, p. 105-106, pl. F, XIX 1, fig. 57.37. Des placages de marbre auraient pu orner le bas des parois, d’après
les traces de crampons observés par Anne-Marie Manière-Lévêque, ce qui renverrait à une constante des belles demeures de la région.
Fig. 3 - Restitution graphique de la peinture (d’après barbet et al., 2004).
Les transformations du jardin de tradition romaine dans l’Antiquité tardive
— 167 —
À côté du type en lattis légers évoquant plutôt roseau ou canne et dessinant ces fameux losanges caractérisant des séparations fragiles38, existe aussi très tôt le motif de la barrière à croisillons, plus lourde, de bois ou de métal, dont les intersections sont parfois soulignées par des sortes de rivets circulaires. Elles imitent des barrières réelles dont les encoches ont été observées nettement dans de nombreux péristyles pompéiens et parfois ailleurs39. Elles servent à délimiter, à habiller la partie inférieure du mur, en décor intérieur ou extérieur d’ailleurs : on le voit déjà à Pompéi, comme celui de la Maison de Triptolème tout autour du péristyle40, sans toujours avoir des décors de jardin au-dessus. Le schéma le plus courant est cepen-dant celui de peinture illusionniste, en perspective de mur de fond de jardin. Les buissons, arbustes et la végétation sont en arrière-plan, plus ou moins élaborés. La balus-
Aucune datation précise n’est proposée (cf. p. 106). Je remercie Alix Barbet et Florence Monier de m’avoir signalé ce document.
38. Sur les barrières, cf. Farrar, 1998, p. 32-35 ; pour une typologie fine, BlanC, Paradeisos, à paraître, cité supra. On rappellera la récente restauration très légère des barrières du jardin de la Maison des Chastes amants à Pompéi.
39. Comme à la Maison du Centenaire à Pompéi, pour les ex. cf. JasheMski, 1979, p. 49-51.
40. PPM 1997, région VII, 5, p. 236, fig. 8 et p. 236-237, fig. 12. Il semble d’après la photographie ancienne que deux traces d’accrochage de barrière existaient sur la partie inférieure de la colonnade. La galerie du péristyle formait alors comme une sorte d’allée de promenade entre deux chancels.
trade permet de mettre en valeur les animaux, en particu-lier des échassiers41.
Les barrières dites en croix de Saint-André forment une autre catégorie : le dessin à quadrillage droit et oblique le plus fréquent se répète dans des cases de dimensions variées42. Des jeux de symétrie géométrique peuvent alors être utilisés, notamment dans les imitations en pein-ture. Ce motif est connu bien sûr à Pompéi43, mais aussi par des exemples plus légers comme à Glanum, dans la Maison des Antes (VI) ou dans deux exemples de Vaison-la-Romaine44.
Le schéma se maintient et on peut l’observer dans plu-sieurs contextes provinciaux qui montrent sa diffusion aux IIe et IIIe siècles. On le trouve bien illustré sur la paroi de cour de la Villa de Balàca (Veszprém - Hongrie) datée de la seconde moitié du IIe siècle (pl. 15-3)45. Entre les colonnes engagées se dressent derrière les barrières de petits arbres et végétaux. On retrouve le procédé égale-ment en Afrique du Nord, à Bulla Regia (Tunisie), dans deux exemples. Le premier dans la salle souterraine (7) de la Maison du Paon46 où le tour de la pièce est sou-ligné par une barrière épaisse surmontée peut-être d’un décor de végétation47, tandis qu’un paon fait la roue dans la niche axiale. La datation proposée est la seconde moi-tié du IIIe siècle (fig. 5). Sur un parapet du grand bassin central de la Maison de la Pêche, a pu être décrit ce qui restait d’un enduit à fresque représentant une clôture avec « un oiseau jaune sur un quadrillage dont le haut est perdu. Ces fresques devaient monter aussi haut que les dalles de schiste »48. La fresque – si l’on part de l’hypothèse qu’elle faisait le pourtour du bassin – était réalisée certainement dans un souci d’alléger le lourd chancel qui entourait le grand bassin aux jeux d’eau complexes. Y. Thébert avait proposé de restituer au-dessus de ce dernier une treille
41. Les exemples sont très nombreux : on citera par exemple la Maison des Amazones (VI, 2, 14, JasheMski, 1993, p.340, fig. 396) et celle dite « du boulanger » VII, 3, 30 (PPM, VII 1997, viridarium k, p. 968-969, fig. 47-49).
42. Jusqu’à former un motif de grille, comme dans le jardin de la Maison de l’Ephèbe à Pompéi. (JasheMski, 1993, p. 58, fig. 93).
43. Maison VII, 6, 7, dans la cour transformée par l’ajout de jardinières, JasheMski, 1979, p. 30, fig. 44 ; Maison du « boulanger », citée supra. À la Maison de la Grande fontaine (VI, 8, 22), la barrière alterne motif losangé et quadrillage droit et oblique (JasheMski, 1993, p. 343, fig. 398).
44. Terrain Thès et Maison du Buste en Argent – BarBet, 2008, p. 303-304, fig. 463-464.
45. Baldassare et al., 2006, p. 335.46. Cf. l’étude de ViBert-GuiGue dans hanoune, 1982 pas la même
date que dans la biblio, p. 60-62 et 79-80, fig. 158. La datation repose sur des critères stylistiques.
47. Le motif de feuillage dans l’abside (que l’on devine sous un voile de calcite) pourrait éventuellement se répéter au-dessus du lattis qui court en bas des autres parois, sans qu’on puisse l’affirmer absolument (renseignement ViBert GuiGue que je remercie pour ces précisions).
48. théBert, 1971, p. 13 ; cf. l’étude de ViBert-GuiGue, dans hanoune, 1980, p. 80, fig. 162.
Fig. 4 - Zeugma, maison dite de Poseidon, peinture de jardin avec vase et clôture, cour P4, mur sud, relevé F. Monier, dessin A. Barbet, d’après barbet, Monier, Yon, 2005).
Éric Morvillez
— 168 —
Fig. 5 - Bulla Regia (Tunisie) : maison du paon, relevé des peintures de la salle souterraine (relevé Cl. Vibert-Guigue, d’après Hanoune, 1980, fig. 158).
Fig. 6 - Villa de Fauroux, barrière de jardin en partie basse de la salle en T, cl. M. Larousse (d’après balMelle, 2001, p. 205, fig. 80).
Fig. 7 - Villa de Séviac (Montréal-du-Gers), décor de barrière à croix de Saint-André du mur extérieur des thermes sud, relevé R. Monturet (d’après balMelle, 2001, p. 205).
Les transformations du jardin de tradition romaine dans l’Antiquité tardive
— 169 —
d’agrément : de cette façon, les portiques du péristyle se transformaient-ils en allées de promenade, simulant en pleine ville un esprit de jardin.
Dans les contextes domestiques de l’Antiquité tardive, ce décor se maintient toujours, dans des villas. Les rares éléments connus de décors muraux des grandes demeures en Aquitaine font appel aussi aux barrières à croix de Saint-André. Hors contexte, ils renvoient davantage à la notion de limite, de rapport entre intérieur et extérieur plus qu’au jardin, puisque le végétal y est absent. À la Villa du Fauroux (Tarn-et-Garonne), le bas du mur d’une salle de réception à plan en T, ouverte sur un vaste por-tique, est orné d’une barrière en partie basse (fig. 6). La simple présence de la barrière transporte l’observateur à l’extérieur. Aucune végétation n’était représentée sur la peinture conservée, mais pourtant les éléments complé-mentaires de décor en stuc recueillis, à structure architec-turale complexe (colonnettes à cannelure, coquilles) avec motifs de grappes de raisin, sans compter les classiques paniers représentés dans les angles d’un des panneaux de mosaïque au sol évoque un contexte agricole, bucolique et campagnard49. Sur les murs extérieurs des thermes de Séviac, a pu être relevé également un décor de croix de Saint-André, de couleur rouge sur fond beige. Aucun végétal n’est même dessiné, mais on peut imaginer si des plantes complétaient l’espace extérieur, l’effet produit de ces silhouettes en arrière-plan (fig. 7)50.
Le meilleur exemple de cette utilisation de la barrière dans un contexte de cour-jardin se trouve dans l’espace du nymphée, à l’arrière du triconque de la Villa de Desenzano (lac de Garde). Trois lambeaux très effacés, restés en place, subsistent, un au nord de l’abside axiale du triconque, les deux autres sur le mur nord (fig. 8). La balustrade, com-
49. BarBet, 1974, p. 123-124 et 2006, p. 303 ; BalMelle, 2001, corpus n° 18, p. 203-205, fig. 80 et p. 352-353.
50. Monturet, riVière, 1987, p. 184, fig. 8.
posée de deux bandes superposées de cases à quadrillages droits et obliques, est peinte en rouge clair, soulignée de striures bordeaux et surtout vertes. Chacun des triangles est rempli d’au moins une fleur rouge vif, avec tiges et feuilles d’un vert brillant51. Cette cour sans portiques, est donc élargie, comme ouverte sur l’extérieur par cette balustrade fleurie qui fait le lien entre la façade extérieure du triconque et le nymphée orné certainement de sculp-tures. Il faut rappeler aussi qu’une aile d’appartement côté sud ouvre directement sur ce jardin, sans galerie : le mur nord du viridarium était la perspective principale visible depuis le vestibule de cette série de pièces.
Le jardin perçu avec une dimension pastorale, liée autant aux réminiscences de la poésie bucolique clas-sique, qu’au thème du bon pasteur, va aussi se perpétuer dans des décors urbains entre la fin du IIe et le IIIe siècle, souvent pour des espaces de passage. À la Via Genova à Rome, dans une domus du Quirinal, un couloir voûté est longé par deux barrières parallèles à croisillons, der-rière lesquelles on distingue des feuillages et des oiseaux, en vol ou posés sur la barrière (fig. 9)52. Seuls quelques tableaux mythologiques comme celui d’un satyre décou-vrant une ménade étendue53, une brebis et des oiseaux ont été déposés, permettant d’avoir une idée du style de ces peintures, l’aquarelle d’ensemble ne le permettant pas suf-fisamment. La datation actuelle proposée serait à placer à la fin du IIe et le début du IIIe siècle. On note la présence, stéréotypée, d’un grand cratère de jardin à godrons, posé devant la barrière, tandis qu’une brebis un peu incongrue,
51. sCaGliarini Corlaita, 1993, p. 100-101, fig. 5, pl. 2.3-4. L’auteur souligne l’aspect abstrait qu’a pris ce décor par rapport aux exemples du Ier siècle.
52. de Carolis, 1976, p. 45, n° 3A et pl. 18-19, 1 ; Baldassare et al., 2006, p. 294.
53. Qui fait penser directement au schéma iconographique de certains pinakes imités dans la Maison du Bracelet d’or.
Fig. 8 - Villa de Desenzano, lac de Garde : relevé des barrières de jardin du viridarium (d’après scagliarini corlaita, 1993, p. 100).
Éric Morvillez
— 170 —
aux allures « pastorales » passe en avant de la clôture54. On constate donc combien quelques éléments choisis permettent d’évoquer immédiatement les composantes caractéristiques soit de décors plus ambitieux, ici réduits à leur plus simple expression parce qu’ils ne touchent que des zones secondaires de passage, soit des jardins absents, souhaités, qu’ils soient rêvés ou bien réels. Dans le même esprit, on rappellera, mais cette fois dans un contexte chrétien, les fameuses peintures de jardins à barrière qui ornaient la partie basse de l’aula théodorienne sud, avec plantes, fleurs et fontaine débordante, mais aussi des pâtres et des amours à Aquilée : elles prennent alors aussi une connotation christianisée paradisiaque55.
3. Quand l’hermès croise la barrière
Parmi les autres évolutions visibles dans les décors de jardin, il faut noter la transformation progressive de la barrière qui s’associe et se « croise », dans une mutation progressive, avec l’hermès de jardin, ancienne silhouette emblématique du viridarium. Entré dans la décoration des villas de plaisance dès la fin de la République56, l’her-mès franchit progressivement les portes des jardins des demeures urbaines, imitant les vastes horti de l’aristocra-
54. L’animal a été décrit parfois comme un bovidé, sans que cela soit justifié.
55. Cf. l’étude récente de salVadori, 2006.56. Cf. les célèbres lettres de Cicéron de commande d’œuvres d’art
pour ses villas, laFon, 1981. On doit penser à l’emploi des hermès dans le second style pompéien, comme dans le cryptoportique de la maison du même nom à Pompéi.
tie57, comme on le constate à Pompéi au Ier siècle. Dès le Haut-Empire, les artistes ont combiné balustrade et têtes sculptées, de manière, somme toute, très logique : les gaines des hermès servent d’appui aux claustras ou lattis. La Maison de l’Ephèbe à Pompéi en donne un bon exemple archéologique démontré pour le Ier siècle : le tri-clinium d’été bien connu était séparé d’un autre espace du jardin par des balustrades en lattis de bois, dont on trouva l’empreinte dans la cendre. Elles étaient suppor-tées par de fins poteaux de marbre, surmontés de quatre têtes d’hermès en marbre de couleur58. En dehors des jardins, on retrouve la formule pour les bastingages de navire, réalisés plus finement en bronze, mais sans lattis, comme on le voit dans le célèbre exemple découvert sur l’épave du bateau de Nemi59. L ‘Antiquité tardive a par-ticulièrement apprécié ces décors de sommet de poteau de chancel60. Cette mode des hermès comme support de balustrade se retrouve également transposée dans les jar-dins au IVe siècle, forme recherchée de bord de parapet de bassin qui permet éventuellement d’ajouter un pro-gramme sculpté. Le cas le plus monumental est certaine-ment celui de la pièce d’eau de la Villa de Welschbillig (aux environs de Trèves), magistralement étudié par H. Wrede 61. Associé à un vaste portique, le bassin d’en-viron 18 m sur 60 m, orné de bras à niches, était entouré de cent douze hermès, dont soixante-douze furent retrou-vés basculés dans le bassin (fig. 10). Les sculptures qui portaient pour certaines des traces de peinture62, étaient tournées vers l’intérieur de la pièce d’eau, apparemment destinées à être vues lors de promenade en barque. Les têtes, dont certaines fonctionnaient par paires en se répon-dant l’une l’autre ou en se complétant, se répartissaient en deux grandes catégories : d’une part, des personnages historiques grecs et romains (souverains hellénistiques, empereurs) ou des philosophes et des hommes de lettres, reprenant des modèles de portraits connus, d’autre part des contemporains du IVe siècle, idéalisés, des serviteurs
57. Sur les hermès, Farrar, 1998, p. 123-125 ; JasheMski, 1979, p. 38-40 ; voir les exemples emblématiques de Pompéi : Maison des Amours dorés ou des Vettii (di Pasquale, PaoluCCi, 2007, p. 276-295) ou de Marcus Lucretius. On rappellera les exemples peints imités sur les pilastres de la pergola supérieure de la domus d’Octavius Quartio.
58. Zeus, Héra, une tête de femme et une dionysiaque : JasheMski, 1993, p. 40, fig. 44, p. 41.
59. wrede, 1972, p. 121 ; uCelli, 1950, p. 220, fig. 241-244 ; Ghini, 1992, p. 49-50, fig. 52-53.
60. Ces têtes, apparaissent par exemple sur l’arc de Constantin (scène de l’adlocutio impériale aux rostres – vers 312-315) ; tribunes d’honneur d’hippodrome ou d’amphithéâtre (ex. de la base théodosienne de l’hippodrome de Constantinople ou certaines scènes de jeux sur diptyques et même sur des décors de plats en sigillée). Synthèse dans wrede, 1972, p. 121-133, avec essai de tableau avec datation p. 133.
61. wrede, 1972.62. Cf. la manière de représenter les têtes sur la balustrade de la fresque
de la « Domus Petri » infra.
Fig. 9 - Décor de jardin de la via Genova Roma, d’après une aquarelle faite au moment de la découverte (d’après De carolis, 1976).
Les transformations du jardin de tradition romaine dans l’Antiquité tardive
— 171 —
ou encore avec des traits ethniques particuliers comme des militaires germains. Il faut y ajouter une série de représentations de divinités païennes et de membres de leur cortège (Zeus, Vénus, Eros ou monde dionysiaque). L’ensemble fonctionnait apparemment comme une galerie d’œuvres d’art de plein air, sans doute organisée avec un programme iconographique précis, comme le démontre la répartition par paire des bustes. Il est daté du dernier quart du IVe siècle et rattaché à l’ambiance raffinée de la prestigieuse cour de Trèves. Le bassin de la cour dit « atrium » de la Villa d’Ivaïlovgrad en Bulgarie montre un autre exemple de cette manière d’employer les hermès63. Un tombeau découvert à Niš remontant sans doute à la seconde moitié du IVe siècle, présente dans la partie basse
63. wrede, 1972, p. 125, 138 ; MladenoVa, 1991.
de sa paroi le même type d’amé-nagement en peinture, mais pour limiter des plantes (fig. 11) 64 : les buissons du jardin sont dessinés derrière des barrières à croisillons en losange irréguliers dont la cou-leur semble indiquer le bois comme matériau.
Dans le monde domestique, on peut rappeler encore les deux (ou trois ?) petits hermès de marbre qui fermaient la fontaine Utere felix de
Carthage65, sans que l’on sache si l’installation de lit de banquet était en plein air, au bord d’un portique ou à l’in-térieur d’une pièce. Le décor d’oiseaux, les jonchées de roses et de guirlandes en mosaïque et en peinture devant et sur le lit de table souhaitaient de toute manière évoquer les plaisirs du jardin liés au banquet.
Un exemple d’adaptation de têtes sculptées à des balustrades de jardin est illustré par le décor peint de l’arcosolium VIII, dit Domus Petri de la catacombe de Saint Sébastien à Rome66. Il montre un bel exemple de la continuité du type de décor cité précédemment pour la Via Genova à Rome : d’épaisses barrières de bois peintes en rouge, à croisillons attachés par des rivets travaillés à décor perlé encadrent la niche, formant un chancel qui souligne la base des piédroits. Vestige des poncifs des peintures du Haut-Empire, un canard coloré passe sur la balustrade. De la végétation est dessinée en arrière-plan : on reconnaît notamment une sorte de petit palmier. Le thème bucolique est introduit par une brebis, un peu effacée, qui passe en avant : elle peut prendre autant une connotation païenne que chrétienne. Les têtes d’hermès, imberbes ou barbues, de couleur claire pour imiter la pierre, ont l’expression rehaussée de peinture et peuvent faire penser que dans la réalité ces objets étaient peints, comme souvent dans l’Antiquité. Les têtes sont en quelque sorte encastrées par leur base décorée de stries dans la balustrade : leur style est bien comparable à celui de la sculpture tardive. La datation proposée est au plus tôt de la fin de la période constantinienne, avec une datation plus vraisemblable vers la fin du IVe siècle.
64. wrede, 1972, p. 133, 136, 138, 141. pl. 77, 4.65. Ils étaient peut-être trois, la base du milieu ayant été repérée,
mais le support avait disparu. Sur les supports de bord de bassin, MorVillez, 2007b, p. 313-314.
66. wrede, 1972, pl. 75-76,1-3 ; MielsCh, 2001, p. 195-196, fig. 233 ; nieddu, 2009, p. 199-291, fig. 231-232.
Fig. 10 - Vue d’un segment de la balustrade de Welschbillig, Rheinisches Landesmuseum, Trèves (cl. E. Morvillez).
Fig. 11 - Nĭs : barrière à hermès avec représentation de jardin, tombeau (d’après WreDe, 1972, pl. 77, 4).
Éric Morvillez
— 172 —
On pourrait avoir le sentiment, d’après le nombre d’exemples découverts, que plus l’on avance vers l’ Antiquité tardive, moins la barrière légère en lattis losangé semble prédominante. Il faut sans doute nuancer cette idée et concevoir plutôt une continuité parallèle des deux modèles. Certes, on note un alourdissement des bar-rières : les montants soulignés sont très épais et les larges rivets circulaires de fixation et autres clous soigneusement dessinés. Mais on trouve encore des exemples de décors à lattis aérés entre les IIIe et Ve siècles67. A Rome, à la domus sous San Giovanni e Paolo, apparaît un excellent exemple de la pérennité du motif décoratif : accompagnant la montée d’escalier, au-dessus d’une large plinthe rouge vif, se développent des lattis surmontés des silhouettes des habituels buissons68 (pl. 16-1). La datation de l’ins-tallation et les travaux de transformation, nous placent dans le courant du IVe siècle (restructuration après 300). On note également un élément vertical blanc (qui pour-rait être un pilastre ou un hermès). Plus intéressant encore est, à mes yeux, la découverte récente d’un luxueux opus sectile pariétal, toujours à Rome, sur le Pincio. Au-dessus d’une plinthe, se développait une série de panneaux imi-tant soigneusement en marbre une barrière à croisillons, conservée à certains endroits sur au moins 1 m de hau-teur. Pour imiter les rivets, les intersections des losanges étaient faites d’un disque à cabochon inséré de pâte de verre bleue ou verte. Ce corridor devait former comme un passage, d’après sa situation : la galerie traversait le jardin d’une résidence hautement aristocratique69. Les compa-raisons stylistiques rapprochent ce décor de ceux réalisés pour la basilique de Junius Bassus ou l’opus sectile de la Porta Marina à Ostie et nous place entre la fin du IVe et le début du Ve siècle.
L’Antiquité tardive a donc à la fois maintenu dans les jardins réels certains héritages formels et esthétiques du Haut-Empire, comme la barrière dans ses différentes déclinaisons ou encore l’hermès qui permet d’intégrer une composante sculptée raffinée. D’autres éléments, démodés, comme l’oscillum, disparaissent : les plus belles pièces collectionnées, peuvent être recyclées, celle de Faragola en donne un excellent exemple. Mais alors que la mode de la « mise en scène de soi-même » se répand dans l’univers domestique70, le jardin et la vie à la cam-pagne deviennent un élément évocateur du statut social. Apparaissent de nouvelles images – rares il est vrai – de ce bonheur au jardin. Autrefois peuplé d’animaux déco-ratifs et d’évocations mythologiques, à travers la sculp-ture notamment, il restait vide de ses occupants humains,
67. Ainsi, on rappellera les décors des triclia de Saint-Sebastien. Coarelli, 1993, p. 26-27 ; BrandenBurG, 2004, p. 68, pl. VI, 7.
68. MielsCh, 1978, p. 162, pl. 83.2 ; Brenk dans ensoli, la roCCa, 2000, p. 156-158 ; Brenk, 2003, p. 82-113, not. p. 87 et fig. 159.
69. ronChetti, 2007, p. 241-246, fig. 1,3 et 4 p. 248-250 (découverte effectuée lors de la restauration de la Casina Valadier).
70. MorVillez, 2006.
y compris des jardiniers eux-mêmes71. Les nouvelles représentations montrent davantage les propriétaires que les installations, sur des sols en mosaïque de résidences urbaines ou rurales, pour le moment en contexte africain, datables de l’extrême fin du IVe siècle ou même au début du Ve siècle. Dans la mosaïque du Seigneur Julius de Carthage, datée autour de 40072, le dominus apparaît dans le cadre de son jardin, simplifié à l’extrême : la barrière reste le meilleur élément pour déterminer l’endroit où il se trouve, pour le distinguer de la nature. C’est une clôture à croisillons pleins, mais si l’on observe attentivement le remplissage des losanges, on y voit non des plantes ou des fleurs, mais encore un « fleuron » ou une feuille de couleur verte, qui rappelle les poncifs vus précédemment dans la peinture et qui existent aussi en sculpture (pl. 16-2). Dans la même mosaïque, la domina, illustrant le printemps, prend une pause élégante, appuyée à un pilastre mouluré, seul élément fixe du décor, puisque la cathèdre, en bois ou en osier sans doute, derrière elle, a été apportée. Elle reçoit des fleurs, des roses cueillies dans le buisson der-rière elle. En face d’elle est représenté son animal de com-pagnie, un petit chien, on ne sait sur quel type de meuble il repose. Dans la partie supérieure de la mosaïque, une seconde femme, peut-être la fille du propriétaire, est assise sur un banc qui semble fixe, avec un piètement sculpté, à l’abri d’une rangée de cyprès. Elle s’évente tandis qu’à ses pieds – note bucolique et champêtre une fois de plus – un poulailler portatif avec des poussins est déposé et qu’à droite est représenté un coq.
Dans une autre fameuse mosaïque d’Algérie, dans une des salles chaudes des bains de Pompeianus, découverts à Oued Athmenia (près de Constantine)73, la domina se repose dans le jardin du domaine, à l’abri d’un large pal-mier (pl. 16-3). Elle est entourée de tout le respect dû à son rang, mais dans une relative simplicité formelle : en dehors des plantes, il n’y a aucun élément de mobilier de jardin spécifique – comme à Carthage, il est apporté –, ni barrière, ni sculpture. Seul le bassin circulaire, situé sous la scène avec ses poissons et ses plantes aquatiques rap-pelle le goût des pièces d’eau. Là encore, elle est accom-pagnée de son animal de compagnie, tenu en laisse par un serviteur qui ombrage sa maîtresse d’un parasol. Comme dans la mosaïque du Seigneur Julius, une vigne monte sur deux arbres voisins. Élément de représentation du statut social, le jardin permet aussi de donner une image plus intime de soi-même. Il incarne ici encore « le lieu du
71. JasheMski, 1979, p. 400, fig. 494.72. BlanChard-leMée et al., 1995, p. 169-172, fig. 120-121 ;
Parrish, 1984, p. 111-113, pl. 15-16 ; MorVillez, 2004, p. 47-55.73. Poulle, 1878, p. 440-442 ; planche couleur réalisée par la Société
archéologique de Constantine (1878), Gsell, 1901, p. 27, de PaChtère, 1911, n° 262, p. 61-62 ; alquier, alquier, 1928-29, p. 301-302 ; pour une réévaluation du dossier archéologique, MorVillez, 2012, p. 304-313.
Les transformations du jardin de tradition romaine dans l’Antiquité tardive
— 173 —
philosophe » et donc du loisir, désigné par l’inscription ( filosofi (lo)locus74).
Mais il serait inexact d’imaginer que la « fausse sim-plicité rustique » de ces représentations de jardins à la campagne puisse synthétiser tout l’art des horti à la fin de l’Antiquité et leur ôte le caractère luxueux et artificiel qu’il devait encore revêtir pour certains propriétaires aristocra-tiques. On l’a vu avec l’exemple précédemment cité du Pincio. L’image la plus emblématique à mon sens de cette survivance du jardin formel, imprégné de paganisme, se retrouve encore en Afrique, dans les panneaux des angles du frigidarium des thermes de Sidi Ghrib, datés du début du Ve siècle75 : quatre jeunes femmes, largement dénu-dées, deux de face et deux de dos, déversent des corbeilles de roses ou de l’eau d’une amphore en dansant, renvoyant sans conteste au monde païen (pl. 16-4). On aperçoit des buissons remplis de fleurs, contenus derrière une barrière
74. Sans doute mal lue et retranscrite par l’abbé Rousset, qui mal-heureusement a inventé une partie des dessins faits pour la Société archéologique de Constantine. La connotation « philosophique » ne fait en revanche aucun doute.
75. ennaBli, 1986.
décorative. Ces dernières sont soulignées de motifs de tresses, soigneusement représentés : l’installation est faite apparemment de roseaux. Demeurent la végétation, les buissons, et les fleurs, quelques installations fixes tandis que les meubles sont apportés par des serviteurs. Reste systématiquement l’image de la barrière, matérialisée en dur, sur les mêmes schémas qu’antérieurement, ou bien en matériaux périssables, comme à Sidi Ghrib. Sur le plan strictement archéologique, – pour remettre toute ma réflexion dans le droit fil de ce colloque consacré à l’archéologie des jardins et à ses vestiges – on doit donc admettre pour conclure que, en dehors des péristyles inté-rieurs des domus bien limités, où les installations de bas-sins aident à comprendre la structuration des espaces76, il est plus difficile de rechercher les formes matérielles des jardins extérieurs aux constructions dans les villas de plai-sance, dont les contours n’ont laissé dans la majorité des cas que des traces évanescentes : d’où la place essentielle de notre documentation figurée.
76. Cf. les conclusions pour l’enquête approfondie menée pour la Gaule, Chassillan, 2011 a, vol. 1, p. 166-184 ; 2011c, p. 145-147.
alquier P., alquier J., 1928-29 : Les Thermes Romains du Val-d’Or (près Oued-Athménia), In : Recueil des notices et mémoires de la société archéologique historique et géo-graphique de la Province de Constantine, vol. 16, 5e série, année 1928-29, éd. Braham, Constantine, p. 289-318.
BaChetta A., 2005 : Gli oscilla in Italia settentrionale, In : Slavazzi, F. (éd.), Arredi di lusso di età romana. Da Roma alla Cisalpina, Borgo S. Lorenzo Fi Al’Insegna del Giglio, Firenze, p. 73-118.
Baldassare I., PontrandolFo A., rouVeret A., sal-Vadori M., 2006 : La peinture romaine, de l’époque hellénistique à l’Antiquité tardive, Actes Sud, Arles, 399 pages.
BalMelle C., 2001 : Les demeures aristocratiques d’Aqui-taine, Aquitania, Supplément 10, Ausonius, Bordeaux-Paris, 497 pages.
BarBet A., 1974 : Recueil général des peintures murales de la Gaule romaine I, Narbonnaise, Gallia suppl. XXVII, Paris, 254 pages.
BarBet A., 1995 : Fréjus, Place Formigé, la maison romaine, le décor de jardin dans la cour-atrium, In : Collectif, Actes des séminaires de l’association française de peintures murales antiques, 1990-1991-1993, Revue archéologique de Picardie, n° spécial 10, p. 103-107.
BarBet A., en collab. BeCq G., Monier F., reBuFFat r., 2000 : La peinture romaine : fresques de jardin et autres décors de Fréjus, catalogue d’exposition, 10 juillet- 11 novembre 2000, Fréjus,
BarBet A., 2008 : La peinture murale en Gaule romaine, Picard, Paris, 391 pages.
BarBet A, Girardy-Caillat Cl., Bost J.-P., 2004 : Pein-tures de Périgueux. Edifice de la rue des Bouquets ou la Domus de Vésone, Aquitania, 2003, vol. 19, p. 81-126.
BarBet a., Monier F., yon J.-B. et al., 2005 : Zeugma II, Peintures murales romaines, Varia Anatolica, XVII, Paris, 330 pages.
Barrière Cl., 1996 : « Domus Pompeia » Fouilles de la villa des Bouquets à Périgueux, Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines, 2e suppl., Périgueux, 162 pages.
Bellet M.-E., 1991 : Orange antique, guide archéologique de la France, Imprimerie Nationale, Paris, 114 pages.
Bertholet F., reBer K., (dir.), 2010 : Jardins antiques, Grèce - Gaule - Rome, Regards sur l’Antiquité, vol. 2, Gollion, Lausanne, 191 pages.
BlanC N., à paraître : Paradis et hortus conclusus : formes et sens de la clôture, In : Paradeisos.
BlanChard-leMee M., ennaiFer M., sliM h., sliM l., 1995 : Sols de l’Afrique romaine, mosaïques de Tunisie, Imprimerie Nationale, Paris, 296 pages.
BrandenBurG H., 2004 : Ancient Churches of Rome from the Fourth to the Seventh Century, Turhout Brepols, Regensburg, 336 pages.
Brenk B., 2003 : Die Christianisierung der spätrömischen Welt : Stadt, Land, Haus, Kirche und Kloster in früh-
Bibliographie
Éric Morvillez
— 174 —
christlicher Zeit, Spätantike, frühes Christentum - Byzanz. Reihe B, Studien und Perspektiven, Bd. 10, Wiesbaden, 392 pages.
Carroll M., 2003 : Earthly Paradises, ancient Gardens in History and Archaeology, British Museum Press, Lon-dres, 144 pages.
Chassillan E., 2011a : Les formes du jardin dans la mai-son en Gaule romaine entre le Haut-Empire et l’Anti-quité tardive : architecture et décor, thèse de doctorat d’histoire de l’art et archéologie, ED VI, 01124 – UMR 8167, Baratte F. (dir.), Morvillez E. (co-dir.), Université de Paris-Sorbonne, 4 vol., 1041 pages, 158 pl.
Chassillan E., 2011b : Pérennité ou disparition du jardin dans l’habitat résidentiel en Gaule romaine entre le Haut-Empire et l’Antiquité tardive ? In : Delamare N., Rocca E., Lecat Z., Uberti M. (éd.), Le passé et son héritage : moda-lités et enjeux dans les sociétés du monde romain et de l’Antiquité tardive, Actes de la journée doctorale, INHA (Paris) 14 janvier 2010, p. 53-67.
Chassillan E., 2011c : Forme et mode du bassin d’ornement dans l’architecture domestique du Haut-Empire en Gaule Narbonnaise, In : Morvillez E. (éd.), Dix ans d’archéo-logie en Vaucluse, n° 77-78, Études vauclusiennes, revue de l’Université d’Avignon, Avignon, p. 139-147.
ChoMer Cl., le Mer a.C., 2007 : Lyon 69/2, Carte archéo-logique de la Gaule, Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, 883 pages.
Coarelli F., 1993 : Dintorni di Roma, Guide archeologiche Laterza 7, Bari, 244 pages.
Courrier C. (éd.), Ménard H. (éd.), 2013 : Miroir des autres, reflet de soi : stéréotypes, politique et société dans le monde occidental (de l’Antiquité romaine à l’époque contemporaine), Paris, Éd. M. Houdiard, 2013 (à paraître).
Croisille J.-M., 2005 : La peinture romaine, (coll. Les manuels d’art et d’archéologie antiques), Picard, Paris, 375 pages.
de Carolis e., 1976 : Gruppo di affreschi da via Genova, In : Affreschi romani dalle raccolte dell’Antiquarium comunale (catalogue d’exposition), Rome-S.P.Q.R., Assessorato Antichità, belle arti, probemi di cultura, Rome, p. 44-47.
de PaChtere M.F.G., 1911 : Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l’Afrique, t. III Afrique proconsulaire, Numi-die, Maurétanie, Paris, 120 pages.
desBat A., 1985 : Jadis, rue des Farges, archéologie d’un quartier de Lyon antique, exposition au musée de la civi-lisation gallo-romaine de Lyon, Lyon, 51 pages.
dessales H., 2007 : Jeux d’eau et fontaines dans l’habitat de Pompéi, In : Petit J.-P., Santoro S., Vivre en Europe romaine, de Pompéi à Bliesbruck-Reinheim, Éd. Errance, Paris, p. 103-107.
dessales H., 2011 : Décor et fontaines domestiques dans les Gaules : une adaptation des modèles italiques ? In :
Décor et architecture en Gaule, entre l’Antiquité et le Haut-Moyen Âge, mosaïque, peinture, stuc, textes réu-nis par C. Balmelle, H. Eristov, F. Monier, Actes du Col-loque international de Toulouse Université du Mirail, 9-12 octobre 2008, Bordeaux, Supplément Aquitania, p. 241-255.
di Pasquale G., PaoluCCi F., 2007 : Il giardino antico, da Babilonia a Roma, scienza, arte e natura, Sillabe, Livorno, 351 pages.
ennaBli A., 1986 : Les thermes du thiase marin, Monument Piot 68, p. 1-59.
ensoli s., la roCCa E., 2000 : Aurea Roma, Dalla città pagana a la città cristiana, L’Erma di Bretschneider, comune di Roma, Rome, 711 pages.
eristoV H., à paraître : Peintures de jardins à Pompéi : une question de point de vue, In : Paradeisos.
Farrar L., 1998 : Ancient Roman Gardens, Stroud, Sutton Pub., 237 pages.
FörtsCh R., 1993 : Archäologischer Kommentar zu den Villenbriefen des jüngeren Plinius, Deutsches Archäo-logisches Institut, Mainz (Beiträge zur Erschließung der hellenistischen und kaiserzeitlichen Skulptur und Archi-tektur XIII), 202 pages.
Frass M., 2006 : Antike römische Gärten : Soziale und wirtschaftliche Funktionen der Horti Romani, Horn, Vienne, 507 pages.
FuChs M., 2010 : Jardins romains au nord des Alpes : entre ville et campagne, In : Bertholet F., Reber K. (éd.), Les jardins antiques : Grèce, Gaule, Rome, Gollion (Suisse), p. 115-146.
Ghini G., 1992 : Museo navi romane, santuario di Diana Nemi, Istituto poligrafico e Zecca dello stato, Rome, 91 pages.
GriMal P., 1984 : Les jardins romains, (1943) (3e éd.), Fayard, Paris, 518 pages.
Gros de Beler a., MarMiroli B., renouF a., 2009 : Jar-dins et paysages de l’Antiquité Grèce-Rome, Actes Sud, Arles, 195 pages.
Gsell S., 1901 : Les monuments antiques de l’Algérie, A. Fontemaing, Paris, 447 pages.
Gury F., à paraître : Les jardins romains étaient-ils bien entretenus ? Esthétique du négligé ou expression de la générosité de la Nature ? In : Paradeisos.
hanoune R., 1980 : Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Bulla Regia. 4-1 Les mosaïques (coll. EFR, 28,4), École Française de Rome, Rome, 116 pages.
hartswiCk K.J., 2004 : Gardens of Sallust, a changing landscape, University of Texas Press, Austin, 219 pages.
JasheMski w., Gleason k., hartswiCk k., Malek a.-a., sous presse : Gardens of the Roman Empire, 2 vol. New York, Cambridge University Press.
Les transformations du jardin de tradition romaine dans l’Antiquité tardive
— 175 —
JasheMski w., 1979 : The gardens of Pompéi, Herculanum and the villas destroyed by the Vesuvius, Caratzas brothers publishers, New Rochelle, New York, vol. 1, 372 pages.
JasheMski w., 1993 : The gardens of Pompéi, Herculanum and the villas destroyed by the Vesuvius, Appendices, Caratzas brothers publishers, New Rochelle, New York, vol. 2, 432 pages.
laFon X., 1981 : À propos des «villae» républicaines. Quelques notes sur les programmes décoratifs et les com-manditaires, In : L’art décoratif à Rome : à la fin de la République et au début du Principat, table ronde organi-sée à l’École Française de Rome (Rome, 10-11 mai 1979), EFR, 55, p. 151-172.
laVaGne H., GaFFiot J.-CH., 2001 : Hadrien, trésors d’une villa impériale, Catalogue d’exposition, Paris, Milan- Paris, 376 pages.
laVaGne H., 2006 : Une danseuse de calathiscos sur un oscillum néo-attique du Nord de la Gaule, Comptes ren-dus de l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, avril-juin, Paris, p. 1067-1107.
loustaud J.-P., Malek A.-A., 2011 : Décors et expériences spatiales dans les domus de l’élite d’ Augustoritum/ Limoges, In : Décor et architecture en Gaule, entre l’An-tiquité et le haut Moyen Âge, mosaïque, peinture, stuc, textes réunis par C. Balmelle, H. Eristov, F. Monier, Actes du Colloque international de Toulouse Université du Mirail, 9-12 octobre 2008, Bordeaux, Supplément Aqui-tania, p. 93-109.
loisy R., 1999 : Les oscilla en Gaule romaine, Éd. du Para-lagme, 99 pages.
Malek A.-A., 2005 : Entre jardin et mosaïque : la vertica-lité et le merveilleux dans la vie quotidienne, In : Morlier h., (éd.) : La mosaïque gréco-romaine IX, Colloque Inter-national sur la Mosaïque Antique. Nouvelles recherches sur la mosaïque antique et médiévale, (AIEMA) Rome, 5-9 novembre 2001, Collection EFR, Rome, t. II, p. 1335-1346.
MielsCh H., 1978 : Zur Stadtrömischen Malerei des 4. Jahr. nach Ch., Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts, Röm abt., Mann, Berlin, p. 151-207.
MielsCh H., 2001 : Römische Wandmalerei, Theiss, Stutt-gart, 331 pages.
MladenoVa, Â., 1991 : Antičnata vila Armira kraj Ivajlov-grad, izd-vo na B”larskata academia na naukite, Sofia, 202 pages.
Monturet r., riViere H., 1986 : Les thermes sud de la villa gallo-romaine de Séviac, Aquitania, suppl. 10, Paris, 251 pages.
MorVillez E., 2004 : La fontaine du Seigneur Julius à Car-thage, In : Balmelle C., Chevalier P., Ripoll G., Mélanges d’Antiquité tardive, Studiola in honorem Noël Duval, Bibliothèque de l’Antiquité tardive 5, Brepols, Turnhout, p. 47-55.
MorVillez E., 2006 : Mise en scène des choix culturels et du statut social des élites d’Occident dans leurs domus et villae II-IVe siècles, In : Quet M.Q. (dir.)., La crise de l’Empire romain de Marc Aurèle à Constantin, PUPS, Paris, p. 591-634.
MorVillez E., 2007a : À propos de l’architecture domes-tique d’Antioche, de Daphné et Séleucie, In : Galor K., Waliszewski T. (éd.), From Antioch to Alexandria, Recent studies in Domestic Architecture, University of Warsaw, Institute of archaeology, Varsovie, p. 51-78.
MorVillez E., 2007b : La fontaine Utere felix de Carthage, une installation de banquet de l’Antiquité tardive et son décor, Antiquité tardive, 15, p. 303-320.
MorVillez E., 2012 : Les mosaïques des bains d’Oued Ath-menia (Algérie) : les calques conservés à la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, séance du 20 déc. 2006, Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France 2006 (2012), Paris, p. 304-322.
MorVillez E., à paraître : Évolution d’un stéréotype, les images des jardins romains, In : Courrier C., Ménard H. (éd.), Le stéréotype, un ressort politique et social à Rome (IIIe siècle av. J.- C. - IVe siècle ap. J.-C.), vol. 2, Montpellier.
naVa M.-r., Paris r., FriGGeri r. (éd.), 2007 : Rosso Pompeiano, la decorazione pittorica nelle collezioni del Museo di Napoli e a Pompei, Rome, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo alle Terme, 20 déc. 2007-31 mars 2008, Milan Electa, 189 pages.
nieddu a.-M., 2009 : La « Basilica Apostolorum » sulla Via Appia e l’area cimiteriale circostante, Cité du Vatican, Rome, 494 pages.
Pailler J.-M., 1982 : Les oscilla retrouvés, du recueil des documents à une théorie d’ensemble, MEFRA, 94, 1982, 2, p. 743-822.
Paradeisos, à paraître : Paradeidos, genèse et métamor-phose de la notion de paradis dans l’Antiquité, Actes du colloque international à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse - Palais des Papes, 20-22 mars 2009, Collection Orient & Méditerranée /archéologie, Éd. de Boccard.
Parrish D., 1984 : Season Mosaics of Roman North Africa, G. Bretschneider, Rome, 272 pages.
Pesando F., GuidoBaldi M.P., 2006 : Gli ozi di Ercole, residenze di lusso a Pompei ed Ercolano, L’erma di Bret-schneider, Rome, 312 pages.
Poulle A., 1878 : Les bains de Pompeianus, Recueils des notices et mémoires de la Société archéologique du Département de Constantine, t. 19, Braham, Constantine, p. 431-457.
PPM VII, 1997 : Pompei. Pitture e mosaici, Regio VII, parte seconda, Rome, 1127 pages.
ProVost M., MeFFre J.-Cl., 2003 : Vaison-la-Romaine et ses campagnes, Vaucluse 84, 1. Carte Archéologique de la
Éric Morvillez
— 176 —
Gaule, Académie des Inscriptions de Belles Lettres, Paris, 553 pages.
riVet L., 2010 : Recherches archéologiques au cœur de Forum Iulii, les fouilles du groupe épiscopal de Fréjus et à ses abords (1979-1989), Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine, Centre Camille Jullian, Éd. Errance, Condé sur Noireau, 419 p.
ronChetti E., 2007 : Opus sectile parietale da une resi-denza sul Pincio, In : Atti del XII Colloquio del AISCOM, Tivoli, p. 241-252.
salVadori M., 2006 : Il tema del paradeisos negli affre-schi della Basilica Teodoriana di Aquileia, Antichità Altoadriatiche, 62, p. 171-184.
salza Prina riCotti E., 1995 : Adriano, Architettura del verde e dell’acqua, In : Cima M., La Rocca E. (éd.), Horti romani, Atti del Convegno internazionale Roma, 4-6 mag-gio 1995, l’Erma di Bretschneider, Rome, p. 363-399.
sauron G., 2009 : Les décors privés des Romains : dans l’in-timité des maîtres du monde, Éd. Picard, Paris, 303 pages.
sCaGliarini Corlaita d., 1993 : Le pitture della villa romana di Desenzano del Garda e il loro rapporto con i mosaici e l’architettura, In : Functional and Spatial Analysis of Wall Painting, Proceedings of the Fifth Inter-national Congress on Ancient Wall Painting, Amsterdam (8-12 September 1992), E.-M. Moormann (éd.), BABesch, Suppl. 3, Leyde, p. 96-101.
teatini A., 2002 : « Oscillorum autem variae sunt opin-iones » : a proposito di un oscillum da Turris Libisonis, In : Africa romana, Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale : geografia storica e economia (Atti Sassari 2000), Rome, p. 2317-2334.
theBert Y., 1971 : L’utilisation de l’eau dans la maison de la pêche à Bulla Regia, Cahiers de Tunisie, 19, n° 73-74, p. 11-17.
thür H. et al., 2005 : Hanghaus 2 in Ephesos : die Wohnein-heit 4 : Baubefund, Ausstattung, Funde, Vienne, 246 pages.
uCelli G., 1950 : Le nave di Nemi, La Libreria dello Stato, Rome, 475 pages.
Villedieu F., 2001 : Il giardino dei Cesari, dai palazzi antichi alla vigna Barberini sul Monte palatino, Scavi dell École Française de Rome, 1985-1999, Éd. Quazar, Rome, 143 pages.
ViPard P., 2003 : Les portiques fenêtrés dans les domus du Haut-Empire romain, BCTH 30, p. 99-134.
VolPe G., de FeliCe G., turChiano M., 2005 a : Musiva e sectilia in una lussuosa residenza rurale dell’Apulia tardoantica : la Villa di Faragola (Ascoli Satriano, Fog-gia), In : Musiva & Sectilia, an international Journal for the Study of ancient Pavements and Wall Revetments in their decorative and architectural Context, 1, 2004, Pise, p. 127-158.
VolPe G., de FeliCe G., turChiano M., 2005 b : Faragola (Ascoli Satriano). Una residenza aristocratica tardoantica e un ‘villaggio’ altomedievale nella Valle del Carapelle : primi dati, In : Volpe G., Turchiano M. (éd.), Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale fra tardoantico e altomedievalo, Atti del Primo Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia Meridionale (Foggia 12-14 feb-braio 2004), Bari, p. 265-297.
wrede H., 1972 : Die spätantike Hermengalerie von Welschbillig, Untersuchung zur Kunsttradition im 4. Jahr hundert n. Chr. und zur allgemeinen Bedeutung des antiken Hermenmals, Römisch-Germaische Forschun-gen, band 32, Trèves, 186 pages.
Archéologie des jardins. Analyse des espaces et méthodes d’approche
— 221 —
Éric MorVillez, Les transformations du jardin de tradition romaine dans l’Antiquité tardive :
Pl. 15-1 et 15-2 - Faragola (Foggia, Pouilles), vue du stibadium-fontaine, avec oscillum et restitution infographique (cl. G. Volpe).Pl. 15-3 - Villa de Balàca (Veszprém, Hongrie), peinture de jardin sur le portique (cl. A. Barbet).
15-1
15-2
15-3
Paul Van Ossel et Anne-Marie Guimier-sOrbets dir.
— 222 —
Éric MorVillez, Les transformations du jardin de tradition romaine dans l’Antiquité tardive :
Pl. 16-1 - Montée d’escalier avec décor de barrière de jardin, domus sotto S. Giovanni et Paolo, Rome (cl. A. Barbet).Pl. 16-2 - Carthage, mosaïque du Seigneur Julius (Musée du Bardo) (cl. E. Morvillez).Pl. 16-3 - Mosaïque d’Oued Athmenia, planche éditée par la Société archéologique de Constantine (doc. Palais du Roure, Avignon) (cl. E. Morvillez).Pl. 16-4 - Femme versant des roses de son panier, mosaïque du frigidarium de Sidi Ghrib (d’après blancHarD-leMée, sliM, 1995, p. 164).
16-1 16-2
16-3
16-4
mm mmISSN 1285-6371
ISBN 978-2-35518-038-5
AArrcc
hhééooll
ooggiiee
ddeess
jjaarrdd
iinnss
Archéologieet HistoireRomaine, 26
PP.. VV
aann OO
sssseell
,,AA..--MM
.. GGuuii
mmiiee
rr--SSoorr
bbeettss ((éédd
ss..))
..
Titres parus dans la collection
Ar
ch
éo
lo
gi
e
et
H
is
to
ir
e
Ro
ma
in
e,
26
éditions monique mergoil
textes rassemblés par
Paul Van Ossel
et
Anne-Marie Guimier-Sorbets
Archéologie des jardins
Analyse des espaces et
méthodes d’approche
mm
1• Mauné S - Les campagnes de la cité de Béziers dans l'Antiquité (partie nord-orientale) (IIe s. av. J.-C. - VIe s. ap. J.-C.). Préface de M. Clavel-Lévêque, 1998, 532 p., 216 fig.
2• Veyrac A. - Le symbolisme de l’as de Nîmes au crocodile.Préface de Ph. Leveau, 1998, 74 p., 42 fig.
3• Nickel Cl. - Gaben an die Götter. Der gallo-römische Tempelbezirk von Karden (Kr. Cochem-Zell, D)Mit Beiträgen von N. Benecke, O. Mecking, G. Lagaly und D.G. Wigg ; Vorwort von A. Haffner1999, III-518 p., 149 fig., 89 pl. dessins, 25 pl. ph.
4• Demarolle J.-M. (dir.) - Histoire et céramologie en Gaule mosellane (Sarlorlux), 2001, 271 p., nbr. figs.
5• Augros M. et Feugère M. (dir.) - La nécropole gallo-romainede la Citadelle à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 1. Catalogue, 2002, 192 p., 4 fig., 108 pl.
6• Blázquez Cerrato C. - Circulación monetaria en el área occidental de la península ibérica. La moneda en torno al «Camino de la Plata». Prólogo de Mª Paz García-Bellido, 2002, 358 p., 211 figs., 306 tabl., XVIII lám.
7• Genin M., Vernet A. (dir.) - Céramiques de la Graufesenqueet autres productions d’époque romaine. Nouvelles recherches. Hommages à Bettina Hoffmann.2002, 324 p., nbr. figs.
8• Rivet L., Sciallano M. (Textes rassemblés par) - Vivre, pro-duire et échanger : reflets méditérrnéens. Mélanges offerts à Bernard Liou, 2002, 578 p., nbr. figs., 8 pl. coul.
9• Ferrette R., coll. H. Kérébel - La céramique gallo-romaine du site de Monterfil II à Corseul (Côtes-d’Armor).Études d’ensembles de l’époque augustéenne au début du IVe siècle2003, 223 p., 65 fig., 116 tab., 69 pl.
10• Ballet P., Cordier P., Dieudonné-Glad N. (dir.) - La ville et ses déchets dans le monde romain : rebuts et recyclages. Actes du colloque de Poitiers (19-21 Septembre 2002), 2003, 320 p., nbr. fig.
11• Berdeaux-Le Brazidec M.-L. - Découvertes monétaires des sites gallo-romains de la forêt de Compiègne (Oise)et des environs dans leurs contextes archéolo-giques. Préface de R. Turcan, 2003, 585 p., 221 fig., 9 tab.
12• Sabrié M. et R. (dir.) - Le Clos de la Lombarde à Narbonne. Espaces publics et privés du secteur nord-est. Préface de M. Christol, 2004, 327 p., 292 fig., 8 pl. coul.
13• Thernot R., Bel V., Mauné S. et coll. - L’établissement rural antique de Soumaltre (Aspiran, Hérault). Ferme,
auberge, nécropole et atelier de potier en bordure dela voie Cessero-Condatomagus (Ier-IIe s. ap. J.-C.)Avant-propos d’A. Chartrain, 2004, 388 p., 363 fig.
14• Pomarèdes H., Barberan S., Fabre L., Rigoir Y. et coll. - La Quintarié (Clermont-l’Hérault, 34). Etablissement agricole et viticulture, atelier de céramiques paléochrétiennes (D.S.P) (Ier-VIe s. ap. J.-C.). Avant-propos de Ch. Pellecuer2005, 191 p., 151 fig.
15• Mauné S., Genin M. (dir.) - Du Rhône aux Pyrénées : aspects de la vie matérielle en Gaule Narbonnaise (fin du Ier s. av. J.-C. - VIe s. ap. J.-C.)2006, 371, nbr. fig.
16• Chrzanovski L. - L'urbanisme des villes romaines de Transpadane (Lombardie, Piémont, Vallée d'Aoste)2006, 399 p., 130 fig.
17• Haüßler R. (dir.) - Romanisation et épigraphie. Etudes interdisciplinaires sur l'acculturation et l'identité dans l'Empire romain, 2008, 374 p., nbr. fig.
18• Péchoux L. - Les sanctuaires de périphérie urbaine en Gaule romaine. 2010, 504 p., 220 fig. dont 4 coul.
19• Sabrié M. et R. (dir.) - La Maison au Grand Triclinium du Clos de la Lombarde à Narbonne.2011, 396 p., 310 fig., 32 pl. coul.
20• Schatzmann R., Martin-Kilcher S. (dir. / Hrsg.) - L'Empire romain en mutation. Répercussions sur les villes dans la deuxième moitié du 3e siècle / Das römische Reich im Umbruch. Auswirkungen auf die Städte in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts.2011, 316 p, nbr. fig.
21• Trintignac A., Marot E., Ferdière A. (dir.) - Javols - Anderitum (Lozère), chef-lieu de la cité des Gabales :une ville de moyenne montagne. Bilan de 13 ans d’évaluation et de recherche (1996-2008).2011, 560 p., nbr. ill., 3 pl. coul. h.-t.
22• Pichot A. - Les édifices de spectacle des Maurétanies romaines, 2011, 220 p., 108 fig., 8 tabl.
23• Ancel M.-J. - Pratiques et espaces funéraires :la crémation dans les campagnes romaines de la Gaule Belgique, 2012, 650 p., 218 fig., 120 pl., 81 tabl.
24• Cazanove O. de, Méniel P. (dir.). - Etudier les lieux de culteen Gaule romaine, 2012, 263 p., nbr. fig.
25• Mauné S., Duperron G. (dir.) - Du Rhône aux Pyrénées, Aspects de la vie matérielle, II, 2013, 374 p., nbr. fig.